

À l’occasion de la rentrée littéraire 2022, Yannick Haenel vous présente son ouvrage "Le trésorier-payeur". Parution le 18 août aux éditions Gallimard, dans la collection L’infini.

24 août.

30 août.

18 octobre



De retour de Venise le 29 juin, j’ai trouvé dans ma boîte aux lettres Le Trésorier-payeur, le dernier roman de Yannick Haenel. Le roman fait plus de 400 pages. « C’est l’histoire d’un banquier qui veut tout dépenser » et qui répond au nom de Georges Bataille. On y croise aussi un nommé Jean Deichel déjà rencontré dans plusieurs romans de Haenel. Work in progress de plusieurs années, j’en avais repris sur Pileface différents extraits que Haenel avait publiés, au fil du temps, sous forme de nouvelles. D’autres extraits ont également été publiés dans les numéros 147 (Printemps 2021) et 148 (Printemps 2022) de la revue L’Infini. Première approche [1].
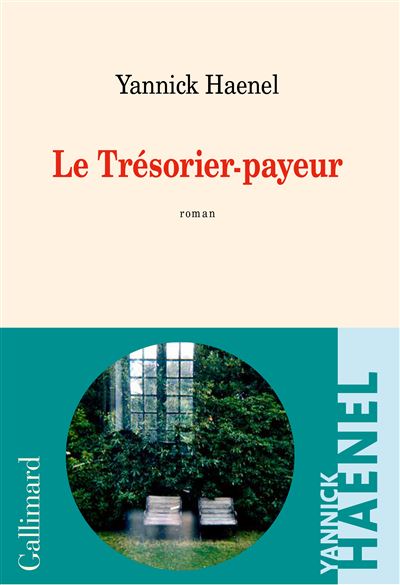
C’est l’histoire d’un banquier qui veut tout dépenser.
Au début des années 90, le jeune Bataille arrête la philosophie pour s’inscrire dans une école de commerce et décroche son premier poste à Béthune, dans la succursale de la Banque de France.
Dans cette ville où la fermeture des mines et les ravages du néo-libéralisme ont installé un paysage de crise, la vie du Trésorier-payeur devient une aventure passionnée : protégé par le directeur de la banque, Charles Dereine, il défend les surendettés, découvre le vertige sexuel avec Annabelle, une libraire rimbaldienne, s’engage dans la confrérie des Charitables, collabore avec Emmaüs et rencontre l’amour de sa vie, la dentiste Lilya Mizaki.
Comment être anarchiste et travailler dans une banque ? Peut-on tout donner ? Yannick Haenel raconte comment il est possible, par la charité et l’érotisme, de résister de l’intérieur au monde du calcul.
Yannick Haenel a publié, entre autres, Tiens ferme ta couronne (Gallimard, « L’Infini », prix Médicis 2017) et La solitude Caravage (Fayard, prix Méditerranée 2019). Il a récemment chroniqué pour Charlie Hebdo le procès des attentats de janvier 2015 [2].
Il participera au rencontres de Chaminadour N°17 (15-18 septembre 2022). Cf. Yannick Haenel sur les grands chemins de Michel Leiris et Georges Bataille.



Entretien Gallimard - Le Trésorier-Payeur, Yannick Haenel from PAGE des libraires on Vimeo.

L’amour et l’érotisme
Le Trésorier-payeur, p.384-385. Dans ce passage qui se trouve vers la fin du roman, Haenel cite expressément Georges Bataille, auteur de L’érotisme, comme il l’avait déjà fait dans Je cherche l’Italie, livre déjà très « bataillien » (p. 150 [3]) :
« En la raccompagnant chez elle, dans la nuit, il s’arrêta devant la porte de la chambre des Charitables. Le visage de Lilya était grave, le Trésorier s’avança vers elle, et en la regardant dans les yeux, il récita d’une voix très douce le texte qu’elle avait lu lors de l’enterrement de Charles Dereine et que depuis douze ans il connaissait par cœur :
C’est seulement dans l’amour qui les embrase qu’un homme ou une femme sont aussitôt, silencieusement, rendus à l’univers. L’être aimé ne propose à l’amant de l’ouvrir à la totalité de ce qui est qu’en s’ouvrant lui-même à son amour, une ouverture illimitée n’est donnée que dans cette fusion, où l’objet et le sujet, l’être aimé et l’amant, cessent d’être dans le monde isolément — cessent d’être séparés l’un de l’autre et du monde, et sont deux souffles dans un seul vent. Aucune communauté ne peut comprendre cet élan, véritablement fou, qui entre en jeu dans la préférence pour un être. Si nous nous consumons de langueur, si nous nous ruinons, ou si, parfois, nous nous donnons la mort, c’est qu’un tel sentiment de préférence nous a mis dans l’attente de la prodigieuse dissolution et de l’éclatement qu’est l’étreinte accordée. Et si tout porte dans la fièvre à anticiper sur l’étreinte en un mouvement de passion qui nous épuise, celle-ci, à l’image des nuées d’étoiles qui tourbillonnent dans l’ivresse du ciel, nous accorde enfin à l’immensité contenue dans l’amour d’un être mortel.
Les yeux de Lilya Mizaki s’emplirent de larmes. Elle porta son index à sa bouche, pour intimer silence. Le signe s’adressait autant à elle qu’au Trésorier : ils n’en parleraient plus jamais.
Elle s’approcha de lui et, très émue, l’embrassa sur la joue ; puis elle s’enfuit dans la nuit, et il la regarda disparaître au bout de la rue. »



Table des matières
|
|
11. Eszter 12. Béthune 13. Charles Dereine 14. La gifle 15. Le miroir tournant 16. Annabelle 17. La maison 18. Le Bon Samaritain 19. Le tunnel 20. Extase 21. Emmaüs 22. Les Charitables PARTIE III |



LE DÉBUT DE LA PREMIÈRE PARTIE DU LIVRE

Je veux caresser le temps.
Vladimir Nabokov,
Ada ou l’ardeurI En avril 2015, Léa Bismuth m’invita à participer à une exposition consacrée à l’influence de Georges Bataille sur l’art contemporain. Cette exposition, dont elle était la commissaire, aurait lieu à Béthune, dans les locaux de l’ancienne Banque de France.
Léa Bismuth envisageait un dispositif sur trois années, autour de la notion de dépense ; elle rêvait de mêler littérature, art et pensée, et de proposer, dans une ancienne banque, une réflexion sur l’argent, la crise et le capitalisme ; cette ambition me passionna.
Dans le train qui nous conduisait vers le nord de la France, Léa nous expliqua, aux artistes et à moi, que le centre d’art était en travaux : nous allions voir un chantier, et cette idée d’inachèvement nous séduisait, comme si quelque chose s’y montrait qui n’apparaît jamais dans les objets finis.
Les jours précédant ce voyage, j’avais relu La Part maudite, le livre de Georges Bataille qui était à l’origine du projet de Léa – celui qui, en quelque sorte, avait déclenché son désir. Sous les dehors d’un traité d’économie, ce livre est des plus fous : il s’élève contre l’ensemble des actes humains ; non seulement il en dresse la critique la plus cinglante, mais il tente de leur substituer un déchaînement rigoureux.
Je voudrais en dire deux mots, car la personnalité du Trésorier‑payeur n’est pas étrangère à la singularité d’un tel ouvrage. Sans doute manque‑t‑il à La Part maudite le charme féroce et pervers qui anime les autres publications de Georges Bataille : celui‑ci se veut sérieux, et son caractère implacable exige des raisonnements plutôt que des éclats ; il paraît ainsi un peu fastidieux, mais j’ai rarement lu un livre qui échappe à ce point à l’ordinaire : il envisage la dépense, voire la ruine, comme la vérité de l’économie et considère que les richesses appartiennent moins à l’épargne qu’au rite qui les consume.
On concédera qu’une telle lecture est pour le moins paradoxale, et que monter une exposition dans une banque sous la bannière d’une telle philosophie relève d’un certain esprit de contradiction : cet esprit, cette contradiction, c’était précisément ce qui nous animait, Léa Bismuth, les artistes et moi.
Une phrase en particulier, parmi toutes celles de La Part maudite qui combattent l’avidité, attira mon attention :
« Rien de plus logique que d’assigner des fins splendides à l’activité économique. » Je peux dire, sans dévoiler la substance de ce récit, que c’est le Trésorier‑payeur qui me fit comprendre le sens d’une telle phrase, lui qui, personnellement, voulut assigner des fins splendides à l’économie – et qui, en un sens, y parvint.Béthune est une sous‑préfecture du nord de la France, située dans le département du Pas‑de‑Calais, à une quarantaine de kilomètres de Lille ; il faut à peu près une heure et demie pour y arriver en train depuis Paris. Lorsque nous débarquâmes ce matin‑là, les artistes, Léa Bismuth et moi, il nous sembla que les abords de la gare avaient l’allure d’une ville fantôme : les façades des commerces étaient murées, le chômage avait littéralement vidé ces rues dont ne subsistaient que des enseignes vieillies, parmi lesquelles je notai avec amusement celles des bars de nuit qui, il y a vingt ans encore, offraient des plaisirs interlopes, peut‑être même une liberté qui n’existe plus.
En arrivant dans le centre d’art, j’ignorais ce que les artistes choisis par Léa avaient en tête ; nous avions un peu échangé dans le train, et s’ils ne paraissaient pas tellement au fait des théories économiques de Georges Bataille, de mon côté je n’avais pas non plus envie de jouer avec eux au spécialiste, et encore moins de signer pour le catalogue une énième étude sur la dépense selon Georges Bataille : je devais trouver un biais.
Le directeur du centre d’art, Philippe Massardier, nous fit visiter les lieux. Il y a, je l’ai dit, une joie à traverser des ruines, des friches, des chantiers : l’espace semble naître, il respire encore pour quelque temps l’étrangeté du vide, et même saturé de gravats, encombré de parpaings, de vieux plâtres et de panneaux d’outillage, il garde en lui la vérité de la désaffection, celle du désert qui court entre les silhouettes, et qui déjà, tandis que nous croyons vivre, nous indique combien l’effacement nous guette : les murs nous regarderont disparaître.
Ainsi le plaisir que nous avions en passant d’étage en étage, en traversant les merveilleux espaces de l’ancienne Banque de France, la salle des coffres, la salle des archives aux immenses classeurs muraux, la serre des monnaies avec sa coursive, ses pupitres à roulettes et son monte‑charge, et tous les espaces glacés où l’on stockait naguère les billets usagés – ce plaisir nous ouvrait‑il à la fois à cette chance des géométries inoccupées, à cette espèce d’oisiveté sauvage des lieux qui répond à notre mélancolie, mais aussi au verdict plus cru de la perdition : à une époque, il n’y avait rien, et un jour, de nouveau, il n’y aura plus rien.
Philippe Massardier déambulait dans les étages en s’appuyant sur une canne qui lui donnait un air à la fois goguenard et shakespearien : il avait la souveraineté malicieuse de celui qui a les clefs du château ; non seulement il jouait pour nous à merveille le rôle de guide, voire de pilote, et tout en ouvrant les portes, nous racontait les histoires, petites et grandes, de ce lieu, mais il nous introduisait dans l’épaisseur du temps : toute architecture est d’abord spectrale, et je me disais, en marchant sagement derrière le maître des lieux, qu’il me fallait écouter les fantômes. À un moment ou un autre, l’un d’eux me ferait signe, et je le suivrais, comme je suivais Philippe Massardier.
En toute occasion, j’attends ce trouble qui déclenche les romans. Je fus servi : en sortant dans le jardin pour fumer une cigarette, je découvris, juste derrière la banque et pour ainsi dire tournée vers elle, comme si elle n’existait que pour la contempler, pour en être à chaque instant rattachée, comme une extension maladive, une belle maison de briques rouges à deux étages qui semblait abandonnée.
Philippe Massardier m’apprit qu’elle avait appartenu à quelqu’un qu’il appelait le « Trésorier‑payeur » ; il ajouta que cette maison était reliée à la banque par un souterrain aujourd’hui bouché.
Au moment où il me révéla ce détail, il se tourna brusquement vers moi, un éclat ironique passa sur son visage ; il vit que j’avais vu – je compris que son objectif était atteint : il avait déclenché ma curiosité, un roman scintillait, j’étais pris.
Cet éclat sur le visage du directeur m’avait paru louche, autant que cette histoire de tunnel, trop belle pour être vraie ; pourtant, elle me fascina. Tout le reste de la jour‑ née, je ne pensai qu’à ça, au tunnel, aux trous, à l’obsession qui nous les fait creuser. Non seulement je pensais à cet invraisemblable trou creusé sous la Banque de France, mais déjà moi‑même, en y pensant, je ne cessais de creuser. Le tunnel, je le voyais, je m’y engouffrais, je le continuais. On pourrait considérer que tout ce qui va suivre – le récit entier que je vous destine – a été calculé par le directeur du centre d’art : en me livrant cette information, il savait quel effet elle peut produire sur l’esprit d’un romancier. On pourrait même considérer que Philippe Massardier ne m’a lancé sur cette piste qu’afin d’en savoir plus : que je mène à sa place une enquête dont il était curieux, et que peut‑être il avait menée lui‑même quelque temps avant de la laisser tomber – chacun son travail, devait‑il songer, l’un dirige le centre d’art, et l’autre des fantômes.En rentrant à Paris, l’obsession se mit à grandir : je ne pensais qu’au tunnel du Trésorier‑payeur. J’en rêvais, même : je ne cessais la nuit d’arpenter ce long trou qui reliait dans mon imagination la salle des coffres à la chambre à coucher du Trésorier. Je le voyais, je me voyais descendre dans les arcanes humides de la Banque de France, et à travers les couches d’argile et de craie qui composent la terre des bassins miniers, je passais sans cesse de la vie à la mort. Chaque matin, en me réveillant, j’avais la sensation d’avoir fait le casse du siècle, mais aussi de revenir du pays des morts.
J’écrivis à Léa Bismuth que j’avais trouvé le biais – le fameux biais qui me permettrait de participer à son exposition. Je lui proposai, sur le ton de la blague – et ce ton me permettait pudiquement de tester le sérieux de mon projet –, d’écrire le monologue du Trésorier‑payeur en fantôme venant hanter la nuit les sous‑sols de la banque. Dans mon esprit, la silhouette et le visage de Philippe Massardier se mêlaient au personnage du spectre dans Hamlet, le père assassiné qui enjoint à son fils de régler ses comptes. Si Philippe Massardier était le Trésorier‑payeur, si le Trésorier‑payeur était mon père, et si mon père était celui d’Hamlet, j’étais donc Hamlet. Ça commençait fort. Je préférai taire la partie psychanalytique de ce micmac : Léa Bismuth aurait déjà fort à faire avec la personnalité des artistes, je n’allais pas la déranger avec mes histoires de trous.
Je me contentai de lui dire que ce monologue serait enregistré et diffusé, pourquoi pas continuellement, dans ce sous‑sol de la banque où débouchait le tunnel du Trésorier ; j’allai jusqu’à lui proposer de dire ce monologue, de le prononcer certains soirs dans la pénombre, de le mur‑ murer comme une bête tapie dans l’obscurité : j’imaginai une performance ténébreuse, une sorte de rituel artistico‑ésotérique, où à travers mes paroles la voix souterraine du Trésorier‑payeur reviendrait parcourir les couloirs et faire communiquer entre elles les chambres secrètes de cette banque qui, dis‑je à Léa, n’était jamais que le masque de l’immémorial château d’Elseneur où Hamlet cherche la différence entre l’être et le non‑être.
Léa, qui en avait vu d’autres, se contenta de m’encourager. Après tout, chacun son tunnel, devait‑elle penser avec raison.
Justement, en matière de tunnel, j’enquêtai. Il y a des tunnels d’évasion et des tunnels d’obsession ; celui du Trésorier‑ payeur relevait du second cas de figure : ce genre de tunnel, on passe sa vie à le creuser. Celui qui s’est mis dans la tête de creuser un tunnel n’en finit plus de se creuser la tête, il n’en finit pas d’explorer les galeries qui font des trous dans sa tête, il cherche inlassablement une grotte. Sans doute le Trésorier‑payeur n’avait‑il cherché qu’à établir dans sa vie (dans sa tête) la grotte où loger son désir perdu.
Mais, honnêtement, je le voyais mal creusant la nuit en bleu de travail à coups de piolet dans la roche de Béthune : le tunnel, forcément, existait avant lui. C’est précisément parce qu’il avait découvert l’existence de ce tunnel qu’il avait commencé à en être obsédé, et à vouloir le rouvrir.Quelques mois plus tard, je fis une découverte. En me documentant sur cette étrange institution qu’est la Banque de France, je compris que le personnage qui avait travaillé à Béthune ne pouvait, contrairement à ce que Philippe Massardier s’était plu à affirmer, avoir été « Trésorier‑ payeur » : un tel titre est en France d’une importance capitale, presque aussi cruciale que celle d’un ministre ; ainsi est‑il dévolu, par l’entremise des Finances publiques, à quelqu’un qui administre non pas les banques, mais la comptabilité publique. L’homme du tunnel pouvait avoir été Trésorier de la Banque de France de Béthune, mais pas Trésorier‑payeur.
Je décidai pourtant de continuer à l’appeler le Trésorier‑ payeur, avec cette épithète presque énigmatique, parce que d’une part c’est ainsi qu’on me l’avait présenté, et d’autre part parce qu’il prenait sous cette dénomination figure de personnage. Un simple « trésorier », même si le mot qui le désigne éclate comme un soleil, n’est jamais qu’un employé, alors qu’on peut très bien imaginer, sous l’étrange dénomination de « Trésorier‑payeur », des compétences occultes : les rayons du soleil sont ici plus abondants et touchent à l’inconnu.
Au gré des échanges téléphoniques avec Philippe Massardier et ses collaborateurs du centre d’art – j’allais dire de la banque, car précisément, et pour embrouiller plus encore mon esprit, on avait choisi d’appeler ce centre d’art — « LaBanque », en un seul mot —, je me rendis compte que le personnage du Trésorier‑payeur était devenu, au fur et à mesure que j’y projetais mes interrogations, un sujet de blague collective, à la fois une mascotte et un monstre dont chacun se plaisait à imaginer que j’allais le sortir des placards ; il arrivait même qu’on m’aidât à l’attraper en me confiant telle anecdote ou en m’indiquant une adresse ; il me semble que quelques‑uns se prêtèrent au jeu, et, comme des romanciers, lui inventèrent des traits qu’ils firent passer pour vrais.
Et puis un jour, Lara Vallet, qui allait bientôt être nommée à la direction du centre à la place de Philippe Massardier, et m’avait déjà procuré plusieurs informations capitales concernant le Trésorier‑payeur, m’apprit que celui‑ci se nommait Georges Bataille.
Sur le coup, je n’en crus rien. Je pensais à une blague, je pensais qu’elle avait fait une confusion. Mais non, elle était surprise que je ne sois pas au courant : elle pensait même que la référence à Georges Bataille était venue de là, et que Léa Bismuth avait précisément choisi l’ancienne Banque de France parce qu’elle savait pour Bataille.
J’eus vite fait, sur Internet, d’accéder aux organigrammes de la Banque de France : Lara Vallet avait raison, celui qui occupait le poste de Trésorier de la Banque de France à Béthune entre 1999 et 2007 s’appelait bel et bien Georges Bataille.
Lors d’un rendez‑vous de travail que nous eûmes à Paris, au café de la Cité de la Musique, je fis part de cette découverte à Léa Bismuth, elle éclata de rire : elle non plus ne savait pas. Mais tout de suite, elle se souvint qu’Édouard Levé avait photographié une série d’homonymes d’artistes et d’écrivains célèbres, qu’il avait trouvés dans l’annuaire. Parmi eux, il y avait par exemple un André Breton, un Eugène Delacroix, un Fernand Léger, un Henri Michaux, et puis un certain Georges Bataille y figurait.
Quand on regardait ces photographies, me dit Léa, l’identité du visage se brouillait à la lecture du nom et du prénom apposés au‑dessous du portrait.
Léa se souvenait bien du portrait de Georges Bataille, elle avait même pensé utiliser ce portrait pour l’exposition, puis y avait renoncé, n’y voyant aucune nécessité ; mais là, il devenait évident qu’il fallait exposer le portrait : avec un peu de chance, le Georges Bataille d’Édouard Levé était le Georges Bataille de la banque de Béthune – il était le Trésorier‑payeur.
Dans la journée, elle me confirma l’information et me joignit par mail la photographie de ce Georges Bataille par Édouard Levé ; sur le cartel figuraient les mots « Béthune, 2007 ».
Il s’agissait bel et bien de lui : non seulement nous étions pris dans un tourbillon d’homonymes qui suffisait à réjouir notre goût du jeu, mais nous étions sans doute tombés sur le bon Georges Bataille.
J’ai toujours aimé Édouard Levé. Sans même que je ne m’en rende compte, j’ai lu tous ses livres. Il y en a quatre, qui en l’espace de cinq ans refondent à eux seuls les genres littéraires en les subvertissant avec une ironie qui s’entend déjà dans les titres : Œuvres, Journal, Auto-portrait, Suicide.
Je ne connaissais pas son œuvre d’artiste, sauf quelques photographies qu’il avait publiées dans un de ces numéros « spécial Sexe » que le magazine Les Inrockuptibles sort chaque été. Ces images étaient étranges, et suscitaient chez moi un malaise : elles représentaient des hommes et des femmes photographiés dans des positions explicitement sexuelles, mais les uns et les autres étant entièrement habillés, et leurs parties génitales ainsi recouvertes, les positions sexuelles adoptées semblaient l’œuvre de mutants. Quand nous baisons, nous avons l’air de fous et de robots, voilà ce que disaient ces images.
Quant au portrait du Trésorier‑payeur, j’hésite à en parler. Je voudrais que mon récit se substitue, en un sens, au visage de Georges Bataille ; je voudrais qu’il le suscite par le simple pouvoir des mots ; je voudrais que son image se lève en vous.
Sachez simplement que cet homme avait, comme me l’a dit tout de suite Léa Bismuth, un air effaré. Le front dégarni, une couronne de cheveux gris, un regard fuyant. Impeccablement mis, veston, cravate. Il ne sourit pas, il préférerait ne pas être là.
J’aurais aimé me lancer à la poursuite de cette photographie, mais Édouard Levé est mort, il s’est tué il y a quelques années, et mes tentatives pour approcher sa famille et son cercle d’amis se sont révélées inefficaces. D’ailleurs, qu’aurais‑je obtenu ? Une adresse ? Elle aurait forcément été celle de la Banque de France, ou du domicile du Trésorier‑payeur, rue Émile‑Zola, où sans doute Édouard Levé s’est rendu, en 2007, pour prendre la photographie : je n’aurais rien appris de plus.
En écrivant ces lignes, je me rends compte que 2007 est précisément l’année où Édouard Levé s’est suicidé : sa rencontre avec Georges Bataille a donc précédé de peu sa mort, et lorsque l’on sait qu’à son tour le Trésorier‑payeur s’est volatilisé à peine deux ans plus tard, au plus fort de la crise des subprimes, il devient flagrant que le lien entre les deux hommes débordait les évidences : l’un comme l’autre avaient ce qu’on appelle un destin.
Léa Bismuth décida donc de montrer la photographie de Georges Bataille dans l’exposition ; elle me proposa, en souriant, de faire « œuvre d’artiste » : on pouvait prévoir une salle consacrée au Trésorier‑payeur, elle la mettait à ma disposition, à moi d’imaginer ce qu’il y aurait dedans.Je revins à Béthune six mois plus tard afin de préparer l’exposition. Les travaux dans la banque étaient terminés, il y avait maintenant de larges pièces vides, très lumineuses, où le régisseur de l’exposition fixait les cimaises. Je parcourus les étages du nouveau centre d’art en compagnie de la photographe Anne‑Lise Broyer, dont le travail se focalisait sur les lieux de Georges Bataille – plus précisément sur ces foyers d’incandescence où, pour un écrivain, la vie et l’œuvre se confondent au point de fonder une géographie qui ne se trouve sur aucune carte, et brûle l’idée même de frontière. Elle me montra des échantillons de ces photographies sur son téléphone ; celle d’un hibou provoqua en moi un appel de fiction semblable à celui qu’avait allumé Philippe Massardier en parlant du tunnel. Dès l’instant où, penché sur le téléphone d’Anne‑Lise, je découvris cette image, un univers se déplia. Je m’en souviens encore, une lumière d’automne étincelante traversait le couloir du deuxième étage de LaBanque : le hibou et le tunnel se mirent à scintiller ensemble dans ma tête.
Cette photographie en noir et blanc, dont un tirage surplombe aujourd’hui le petit bureau sur lequel j’écris ce livre, donne à voir, en une légère plongée, un hibou dressé sur un perchoir, dont le plumage immaculé, semblable au manteau d’hermine d’un roi, suscita en moi une idée de souveraineté.
Anne‑Lise Broyer me corrigea aussitôt : ce n’était pas un hibou mais une chouette, plus précisément une dame blanche. Si cette précision devint vite une blague entre nous, et que nous ne cessions de répéter à tout bout de champ un hibou, ou plutôt une chouette, plus précisément une dame blanche, c’est justement grâce à cette phrase que j’eus la révélation d’un certain visage qui va jouer un rôle éminent dans ce récit.
J’interrogeai Anne‑Lise sur l’instant qui avait rendu possible une image dont la clarté nous ouvrait aussi violemment à l’énigme ; car il me semblait qu’à travers la blancheur si désirable de cet oiseau, présence et disparition coïncidaient parfaitement : sa blancheur en témoignait, et plus encore cet adorable duvet qui appelle les caresses.
Elle avait pris cette photographie lors d’un séjour à l’abbaye de Piedra, non loin de Saragosse, tandis qu’elle sillonnait l’Espagne à la recherche de traces que Georges Bataille y avait laissées ; et dans le parc de cette abbaye, qui se déploie au bord d’une ligne de falaises où déferlent des cascades, elle avait assisté à une démonstration de vols de rapaces, et photographié l’un d’eux : ce hibou, cette chouette, cette dame blanche.
J’insiste sur cette photographie car, au‑delà de Georges Bataille, elle lançait son présage vers ma recherche à moi. Nous cherchons tous un objet qui s’absente ; peut‑être même nous inventons‑nous grâce à lui un désir : le voici en tout cas qui appelle des romans entiers, et nous les vivons jusqu’à ce que le feu s’éteigne. Un monde composé de foudre et d’aurore ne raconte que la soif qui le rend possible : à regarder cette chouette, j’entrai en ébullition. Je me souvins que Georges Bataille appelait la philosophie le « principe du hibou ». Son ironie faisait bien sûr référence à la chouette de Minerve dont parle Hegel, qui ne prend son envol qu’à la tombée de la nuit : qu’une chouette, qui plus est une chouette en retard, décidât de l’histoire de la pensée, cela faisait sans doute rire Bataille, cela nous fit rire aussi.
Je dis alors à Anne‑Lise que personne n’était plus là que cette chouette, et qu’en même temps elle s’absentait devant nous, à l’image de certaines femmes. Car oui, dans cet ovale de lumière blanche, c’est un visage de femme que j’aperçus ; et avec lui l’éclat, les détails, les inflexions d’une vie entière. Anne‑Lise me proposa généreusement d’accrocher l’image dans la pièce qui serait consacrée au Trésorier‑payeur, plutôt que dans l’une de celles où seraient montrées ses photos. Ainsi, dans cette chambre dont je n’avais pour le moment aucune idée, figuraient déjà aux murs le portrait de Georges Bataille par Édouard Levé et face à lui, condensés en une seule image, le hibou, la chouette de Minerve, la dame blanche.
C’est à partir de ce portrait imaginaire de la femme du Trésorier‑payeur en oiseau, virtuellement accroché au mur de la pièce dont Léa Bismuth m’avait attribué l’usage, que je conçus en un éclair le dispositif qui ferait renaître le Trésorier. Le regard des hiboux traverse la nuit ; de même, un bureau allait surgir de cette pièce mansardée au plancher grinçant, et avec ce bureau, des épaisseurs de temps allaient fleurir, des journées entières allaient revivre, et le Trésorier‑payeur lui‑même apparaîtrait, comme un roi qui, en ressuscitant, revient s’asseoir sur son trône, immobile entre les deux photographies qui ordonnent son royaume.
Je parle de résurrection, mais le Trésorier‑payeur était‑il mort ? Et d’ailleurs, avait‑il réellement existé ? L’effervescence qui m’animait relevait peut‑être d’un excès : les figures muettes vous incitent à parler à leur place. Et s’il m’est par‑ fois arrivé, parcourant les allées d’un cimetière, d’imaginer la vie entière d’un homme ou d’une femme en lisant simplement leur nom sur une tombe, l’incitation goguenarde de Philippe Massardier m’avait peut‑être embrouillé l’esprit. Mais non, c’était très simple : j’allais me mettre à la place du Trésorier‑payeur. En réinventant son bureau, j’allais m’asseoir dans son fauteuil, fermer les yeux, retrouver ses gestes, ses pensées, jouir de ses secrets – pour vous les raconter.J’empruntai une voiture et nous prîmes, Anne‑Lise, Léa et moi, la direction de Bruay‑la‑Buissière. En pleine campagne, à une quinzaine de kilomètres après la sortie de Béthune, se trouvaient les hangars du dépôt‑vente d’Emmaüs. Nous avions lu sur Internet que cet Emmaüs était le plus vaste de France : il proposait sa « braderie solidaire » sur plus de 6 500 m2. Anne‑Lise était à la recherche d’objets qui nourrissent son œuvre, et l’amplifient vers des contrées toujours plus rêveuses.
Quant à moi, je désirais peupler le bureau du Trésorier‑payeur : y loger un mobilier aussi crédible qu’ambigu. Mon projet, que je détaillais à Léa et Anne‑Lise tout en conduisant – projet qu’en réalité j’inventais en leur parlant –, consistait à installer une impression d’intériorité bourgeoise, laquelle suggérerait l’image vraisemblable d’un banquier au travail (si tant est qu’un tel travail pût se représenter) ; mais il s’agissait en même temps de provoquer cette séduction qui s’allume au contact du gouffre : chaque jour davantage, en pensant aux activités du Trésorier‑ payeur, j’en pressentais le caractère ténébreux.
Ainsi, dans mon esprit, ce bureau devait‑il refléter la rigueur d’un homme voué au secret bancaire, à l’idée impérieuse de stabilité, à des codes de confiance qui, peut‑être, sont aujourd’hui révolus ; mais il devait aussi témoigner des méandres de l’obsession et de l’excès d’une conduite radicale : a‑t‑on jamais vu un banquier creuser un tunnel dans sa propre banque ?
Car je ne perdais pas de vue qu’il était question de ruine : l’exposition s’appelait d’ailleurs « Dépenses ». Et si je voyais d’infinis attraits dans cette notion qui renverse tous les principes, à commencer par celui qui gouverne la conservation de l’espèce, il me plaisait d’en imaginer le vertige bien au‑delà de l’économie : la ruine que je voulais faire sentir était celle qui affecte l’esprit lui‑même.
On imagine combien mon souhait dépassait la simple décoration ; et aussi comme il était difficile de trouver tout simplement à meubler cette pièce. Philippe Massardier m’avait assuré que le centre d’art mettrait à ma disposition le bureau de l’ancien directeur de la banque. Je l’avais aperçu, stocké dans les combles du bâtiment, et son format presque monstrueux m’avait convaincu : sur une telle surface, un monde pouvait tenir en équilibre – ou s’écrouler. Mais il me fallait plus qu’un solide assemblage d’acajou : quel est ce lieu intérieur où flambent les richesses ?
Je garai la voiture sous une allée de noisetiers. Des papillons voltigeaient dans l’après‑midi d’été ; des corbeaux se dandinaient sur le gravier en croassant. Cet Emmaüs était effectivement immense : il y avait dix chapiteaux surmontés chaque fois d’une photographie de tel compagnon de l’abbé Pierre, et d’une enseigne qui en renseignait le contenu : « Meubles », « Vaisselle », « Bibelots », etc.
C’est en circulant parmi l’encombrement de vieilles armoires, d’abat‑jour boiteux et de canapés jaunis, en nous faufilant entre des pyramides de chaises et de fauteuils amochés, de tables, d’étagères, de vitrines, de buffets, de guéridons, de pupitres, de consoles, de crédences, en découvrant les rogatons de mille vide‑greniers où des collections de vaissellerie approximatives proclamaient une tristesse des objets, de la soupière ébréchée aux cuvettes entières de salières en passant par des reliefs de chaînes stéréo et de tourne‑disques usagés où je reconnus, comme chacun en fait l’expérience en ce genre d’occasion, un peu de mon enfance, que je pris conscience de l’épaisseur du temps : nos vies forment des tas ; la mémoire n’est qu’un empilement ; les souvenirs sont moches.
Je ne sais quelle vision terrible jeta soudain une ombre sur ce lieu voué à l’entraide : mon esprit s’égare toujours, sans que je puisse l’en empêcher, vers les horreurs que le monde invisible recèle, comme si un trou au creux de la présence appelait le réel à glisser jusqu’à lui.
Je pensais à Georges Bataille – l’écrivain –, à son œil sur ces choses : lorsqu’on chasse les réalités furtives, dit‑il à peu près, apparaît dans l’angoisse ce qui est là – et ce qui est là est entièrement à la mesure de l’effroi.
Mais n’exagérons rien : une féerie régnait en même temps à l’intérieur de ce bric‑à‑brac, celle qu’allument, au détour d’une allée de jouets qui ont vieilli, un merveilleux lustre vénitien, une robe de mariée qui scintille, des escarpins qui appellent un bal princier, et des volumes abandonnés d’Alexandre Dumas reliés pleine peau – toute la trilogie des Mousquetaires –, sur lesquels je jetai mon dévolu comme sur un trésor ignoré de tous.
Essayant de repousser l’emprise sur nous de la mélancolie, Anne‑Lise, Léa et moi, munis d’un maigre butin (chacun de nous, arrêtant de chercher ce qui pouvait nous être utile ou nous attirer, avait glané quelque objet dont la solitude insoutenable appelait des réminiscences personnelles ou rallumait un chagrin ; ainsi, par compassion, nous étions‑nous chargés chacun d’un carton entier de rebuts qui, désormais, nous appartiendraient) ; bref, un peu secoués par cette rencontre avec un monde qui clamait avec tant de pauvreté son engloutissement, et dépensant chacun quelques euros dérisoires afin de récupérer l’irrécupérable, nous nous accordâmes, à la sortie du hangar des livres, une pause sous les châtaigniers de la buvette, dont l’auvent protégeait une volée de tables munies de bancs, comme on en voit dans les salles des fêtes à la campagne. Et bien que la lumière de septembre fût douce, et pleinement chaleureuse, nous commandâmes sans nous concerter du vin chaud qu’on nous servit dans de larges gobelets à bière, et dont l’odeur d’orange et de cannelle nous apporta une consolation.
Il y eut, durant ces quelques minutes silencieuses sous l’abri des châtaigniers, une pensée commune qui nous rendit à la nudité de toute vie humaine, et à l’humilité de nos projets ; nous adoptâmes, dès lors, un autre ton pour parler de Georges Bataille, de la dépense et de la part maudite, comme si nous en avions rencontré la vérité : la seule vraie dépense, c’est la disparition.
Et son paradoxe, bien visible, étalé sous nos yeux à travers les dix hangars d’Emmaüs, nous clamait qu’aucune disparition n’est complète, mais qu’elle laisse toujours derrière elle les poubelles d’une vie ; qu’il y a un reste, comme dans le sacrifice ; et que peut‑être c’est ce reste, ce sacrifice, qui nous unit.
Nous restâmes ainsi plus d’une heure à savourer notre vin épicé, dont nous reprîmes plusieurs gobelets. Derrière la ligne des châtaigniers qui formaient un petit bois, un couple de chevaux, dont les têtes penchaient par‑dessus la barrière, nous contemplait. Avec l’ivresse, une sorte d’amour se diffusait autour de nous, dans les sourires, les arbres, dans le hennissement des chevaux.
Anne‑Lise avait fait l’acquisition d’une pelle en cuivre au manche très court, sur laquelle étaient gravées des lettres à moitié effacées, qui paraissaient former le mot « fantôme », et une somptueuse queue de paon sur laquelle la poussière avait déposé un camaïeu de grisaille qui conférait à ses plumes l’éclat des choses éteintes.
— C’est l’œil du diable, nous dit Anne‑Lise en montrant fièrement les ocelles.
Elle avait déniché aussi un renard naturalisé dont la fourrure violemment rousse semblait surgir d’un rêve ; elle avait également trouvé une série de bois de cerf, qu’elle voulait me confier afin d’en orner le bureau du Trésorier. Quant à moi, outre les belles éditions d’Alexandre Dumas, j’avais rempli plusieurs cartons de volumes défraîchis de romans policiers, pour la plupart des Simenon, que je destinais aux étagères du bureau de mon Trésorier‑ payeur, sans trop savoir pourquoi je lui supposais cet univers de lecture ; et pour supporter ces kilos de livres, j’avais pris soin d’acquérir l’un de ces meubles d’appoint sans style, une sorte de table de chevet trapue, sur laquelle j’empilerais sa cargaison de polars.
Alors que la fin d’après‑midi rougeoyait à travers les frondaisons, et que le vin chaud nous tournait joyeusement la tête, un homme s’approcha, avec une allure de vieux cowboy, tout maigre, barbe et catogan. Son regard était clair, il s’appelait Jean, et sur sa gourmette, le mot CARITAS était gravé. Je pensai : la charité est cette clef.
Il nous demanda très poliment s’il pouvait replier les chaises et enlever la table : un véhicule allait arriver qui stationnerait ici, il fallait lui faire de la place.
Nous regagnâmes le parking et je chargeai nos cartons dans le coffre de la voiture ; en nous retournant, nous assistâmes à une scène qui me hante encore : six hommes descendirent d’une camionnette, vêtus à l’identique d’un mantelet noir et portant une étrange coiffe, un bicorne, noir lui aussi, aux bords aigus comme des ailes de corbeau. Le soir tombait. Le vieux cowboy et d’autres compagnons accueillirent en silence les hommes en noir ; ils les accompagnèrent jusqu’à l’entrée du centre d’hébergement, où ils s’engouffrèrent. Il y eut dans l’air un flottement d’angoisse : cette coulée de silhouettes sombres avait glacé notre escapade.
Léa et Anne‑Lise s’étaient figées, la pâleur de leur visage se perdait dans la lumière du crépuscule. Des éclats fauves miroitaient à travers le feuillage des noisetiers. Je pensais aux étoiles qui s’effacent dans la nuit ; au vide qui s’ouvre sous nos pieds tandis que nous dévorons les nuances du ciel. Nous fixions tous la porte par laquelle les hommes en noir étaient entrés ; seul le chant d’un oiseau brisa le silence, comme une giclée de bonheur qui s’affirme sans raison.
Quelques minutes plus tard, les six hommes en noir ressortirent en portant un cercueil qu’ils déposèrent sur une charrette ; ils poussaient maintenant la charrette avec lenteur, accompagnant son avancée d’un pas solennel jusqu’à la camionnette. Leurs bicornes taillaient dans l’air des formes aiguës jusqu’au malaise. Chacun d’eux portait des gants ; celui qui ouvrait la marche brandissait une baguette ornée de buis ; et l’on distinguait mal leurs visages mangés par la nuit. Un bourdonnement enveloppait la procession : des phrases en latin, je crois, qui donnaient à cette scène la cadence d’un sale rêve.Le soir, nous rejoignîmes Philippe Massardier au Potin de Casseroles, un restaurant qui proposait des plats du Nord, dont il nous vanta la carbonnade de bœuf à la flamande et le welsh au maroilles. Depuis Emmaüs, notre ivresse avait pris une tournure plus apaisée ; et sans me méfier, je commandai des vins lourds : une joie plus ancienne que la mélancolie transperce les ombres et fait glisser les soirs vers une confiance qui parfois me joue des tours.
Philippe Massardier nous confia qu’une fois réglés les détails de l’exposition « Dépenses », il s’éclipserait : d’ailleurs sa succession était prête. Ce n’était pas un départ à la retraite, il était encore jeune, mais il lui tardait de se consacrer à autre chose qu’à « gérer des problèmes », comme il disait. Le centre d’art était un projet qu’il avait porté pendant une dizaine d’années, et à présent qu’on allait l’inaugurer en grande pompe, il lui semblait que non seulement on n’avait plus besoin de lui, mais que la vie s’ouvrait ailleurs.Où s’ouvrait‑elle ? Malgré nos questions, Philippe Massardier n’en dit rien. J’insistai maladroitement, avec une familiarité peut‑être grossière (mon affection pour cet homme bousculait les convenances) ; il se contenta de sourire, comme le premier jour lorsqu’il avait prononcé le mot « tunnel », et derrière ses lunettes à la monture un brin désuète, derrière le miroitement des verres qui protégeaient son regard, je devinais un labyrinthe malicieux. Celui qui se retire d’une tâche longtemps exercée nous fascine parce qu’il semble que son influence imprègne encore l’air que nous respirons ; il y a une séduction dans les choix radicaux ; le renoncement paraît alors plus glorieux que la continuation : s’arrêter prend figure de vérité.
Quel genre de savoir était donc le sien ? J’ai parfois reconnu, chez des gens qui, comme Philippe Massardier, voulaient en finir avec leur poste, une connaissance du vide qui confirmait leur décision ; et le vide est ici une promesse : celle d’ajuster son existence à la profondeur d’un espace qui ne se mesure plus.
Nous lui racontâmes ce que nous avions vu chez Emmaüs : le cortège, les hommes en noir. Son œil brillait, il savourait notre trouble : il nous expliqua que ces hommes faisaient partie de la confrérie des Charitables de saint Éloi qui, depuis le Moyen Âge et encore aujourd’hui, s’occupe d’enterrer les morts.
La peste s’était déclarée ici, vers le début du XIIe siècle, comme dans toute la Flandre, où les sols marécageux favorisaient l’épidémie. Les morts s’amoncelaient dans les rues, ils n’étaient pas enterrés. Une légende raconte – et Philippe Massardier nous la raconta en insistant plaisamment sur les corps putréfiés, sur la trame renouvelée des massacres qui ponctuent l’histoire humaine aussi bien que celle de Béthune – qu’au comble de l’épidémie, alors même que la moitié de la ville agonisait sous les bubons, saint Éloi apparut à deux maréchaux‑ferrants nommés Germon de Beuvry et Gauthier de Béthune ; il leur demanda de se réunir afin de fonder ce qu’on nomme une charité.
Ce qu’ils firent, réunis au Quinty, devenu un parc où l’on peut voir aujourd’hui la grotte de saint Éloi ; un moine, nommé Rogon, de l’ordre de Cluny de Saint‑Pierre d’Abbeville, prieur au monastère de Saint‑Pry, recommanda alors aux deux maréchaux‑ferrants de faire une chandelle de cire vierge et de la partager ; ils créèrent ainsi la confrérie des Charitables de saint Éloi, chargée de donner du pain aux pauvres et des soins aux malades, de consoler les mourants, d’ensevelir les morts et de leur donner une sépulture, d’autres choses encore. Il y a sept œuvres de miséricorde, rapportées par saint Matthieu, précisa Philippe Massardier, et chacune d’elles nous engage, bien au‑delà de ce qu’il en est de vivre avec les autres.
Voilà, cette confrérie existait encore aujourd’hui, et Philippe Massardier, en riant, nous dit qu’il en faisait partie – il ajouta, en tournant son regard vers moi :
— Votre Trésorier‑payeur aussi.
Je jubilais. Il y a ce moment, dans une recherche, où les détails convergent : le mystère s’illumine, on se met à y croire ; c’est tout un peuple, alors, qu’on forme par son esprit.J’aurais voulu poser des rafales de questions à Philippe Massardier, mais avec un homme aussi prompt au silence, il valait mieux s’abstenir. D’ailleurs, que m’importaient de nouvelles confidences, n’avais‑je pas tout ce qu’il fallait pour écrire un roman : un personnage énigmatique, un lieu captivant, des temporalités qui vacillent ? Sans compter le magnétisme d’un nom glorieux – celui de Georges Bataille –, et l’image pleine d’avenir d’un hibou (d’une chouette, d’une dame blanche).
Voici qu’à cette matière idéale s’ajoutaient encore la figure de la mort et celle de la charité – c’est‑à‑dire, plus forte encore que tout ce qui existe, celle de l’amour. C’était parfait ; trop, peut‑être.
Nous bûmes comme des insensés ce soir‑là, le vin du restaurant était grisant, et nous ne cessâmes de lever notre verre à notre ami Georges Bataille – l’écrivain, mais aussi le banquier – qui faisait bouillir dans ses veines le sang de Dionysos, dont il nous semblait entendre le halètement de ses courses nocturnes tandis qu’il traverse sa forêt de tunnels en déchaînant les désirs.
Philippe Massardier nous proposa d’aller boire un verre dans un des rares bars de nuit qui avaient survécu à la crise : Le Cercle rouge. Il y avait un peu de monde, des amis en virée, des couples qui s’amusaient, des buveurs solitaires. Quelques femmes étaient assises au bar, juchées sur les tabourets, leur sac à main sur les genoux ; d’autres, plus jeunes, se trémoussaient sur une minuscule piste de danse entourée de plantes vertes ; et à notre arrivée, l’une d’entre elles se dirigea vers notre table en nous proposant une bouteille de champagne, puis revint plusieurs fois remplir nos coupes.
Un des artistes, Laurent Pernot, nous rejoignit ; il était épuisé car il avait passé la journée à badigeonner les murs du centre d’art avec du sang humain : le sien, et celui qu’il avait obtenu des autres artistes. Il décrivait son travail avec une étrange douceur, et si l’acte de plonger des brosses et des rouleaux dans une cuvette remplie de sang suscitait chez moi des visions de boucherie ou de tueur en série, il y voyait au contraire un geste lustral, apaisé – « moins du côté de la mort que de celui d’une fertilité nouvelle », dit‑il.
J’étais ivre, je m’emportai :
— Il y a pourtant bien quelqu’un ici qui tient le couteau !À la table voisine, un homme gris qu’une des danseuses enlaçait se retourna. Les yeux de cet homme étaient vitreux. Le brouhaha de la musique empêcha que la conversation se poursuive. Léa parlait avec Anne‑Lise d’une image où celle‑ci s’était photographiée pleurant des larmes de sperme. Laurent Pernot regardait son téléphone ; Philippe Massardier me fixait sans un mot, trempant ses lèvres dans un grand verre de vodka : on sentait en lui une passion silencieuse qui jetait sur ses moindres actions la silhouette d’un combat inconnu.
Les filles qui dansaient là‑bas sur des talons hauts riaient à gorge déployée et je mêlai bientôt mon rire à leur joie. Lorsque le sang coule, des étoiles se noient en suffoquant dans nos gorges. Des chevreaux immolés, des biches égorgées, des béliers dévorés de charogne étincellent au soleil : on peut faire semblant de ne pas les voir, on peut très bien ignorer qu’une hécatombe hurle en filigrane derrière l’histoire des hommes. Qu’on le veuille ou non, un immense acte sacrificiel organise nos vies, et ceux que l’avidité ou l’aveuglement empêchent de partager l’ivresse des mondes retrouvent de toute façon accès à cette ivresse, fût‑ce avec écœurement, dans le sacrifice. Il faudrait ne jamais cesser de dire ce que chacun de nous découvre d’éblouissant quand il rit : le monde a tant d’éclat qu’il crie lui‑même de joie en nous effaçant.
Ainsi l’exposition était‑elle en train de prendre la forme d’une aire sacrificielle. Je ne sais si Léa l’avait conçue de la sorte, ou si c’est notre petite communauté qui la métamorphosait peu à peu : les proies grasses emplissent l’univers, et celui‑ci les engloutit, afin que jamais le ciel ne se referme. Il y a forcément dans le silence qu’une commissaire d’exposition orchestre entre des œuvres d’art l’écho de fêtes divines. Ces fêtes sont un tabou. Cette nuit, tandis que la sono martelait des tubes de variétés françaises des années 80 sur fond de lumières fluo jaune et rose, j’en reconnaissais l’exubérance : j’étais très loin dans la nuit, traversé par les époques, accroupi dans le désert du Sinaï près d’un fagot de bois ou contemplant l’aurore au bord d’une mer grecque, allongé à l’intérieur d’un temple, mais toujours guidé par l’éclat d’une lame de couteau.
Philippe Massardier nous présenta un ancien flic chauve et trapu, dont j’ai oublié le nom ; je me souviens en tout cas qu’il parlait à toute vitesse et voulait savoir si l’exposition serait « sulfureuse » ; il ne cessait de prononcer ce mot : « sulfureuse », et chaque fois, il clignait de l’œil.
Tandis que des femmes de plus en plus décolletées et de plus en plus pressantes se succédaient à notre table pour nous encourager à consommer, et que certaines se joignaient à nous pour rire et boire, nous eûmes, Léa, Anne‑Lise, Laurent Pernot, Philippe Massardier, le flic et moi, une conversation aussi folle que décousue sur l’étroitesse des vies réduites à l’épargne, sur l’argent qui, en manquant, astreint nos rêves à une comptabilité dérisoire, sur ce rabougrissement qui partout frappe nos désirs, sur la pesanteur d’un monde qui à la fin nous assigne à ne plus rien vouloir que notre intégration.
Ce qu’il y a de beau, c’est que toujours, à force de parler – et même si l’on parle du pire –, la douceur est en vue : soit elle est là ; soit elle viendra. L’horizon lui appartient : c’est un point lumineux où se mêlent la joie, le vin, l’humour.
Et que se passe‑t‑il réellement lorsque l’on titube en riant dans les toilettes d’un bouge avec une dame un peu trop fardée ? Vers 3 heures du matin, l’ivresse atteint son point d’oubli. C’est le bonheur ; ou le néant. On ne sait pas. Même le lendemain matin, en se réveillant, on l’ignore. L’oubli couvre des étendues d’existence qui se destinaient peut‑être à être mémorables, et resteront égarées, comme un parapluie, comme le vent. Où vont ces instants dilapidés ? Y a‑t‑il un refuge pour les moments d’ivresse ? Une bibliothèque où les discussions perdues sont stockées, en attendant qu’on les retrouve ? Peut‑être écrit‑on des romans pour faire entendre cet oubli, pour le conjurer. Dans une telle hébétude passe en tout cas un amour pudique, qui relève à la fois de la fatigue où l’on se vautre, et de la certitude que rien d’affreux ne pourra nous arriver ; une certaine aberration nous maintient collés aux banquettes devant lesquelles passent des alcools, des camarades rieurs, des tentatrices : c’est la vie vécue pour raconter des histoires. Cette nuit‑là au Cercle rouge, et plus tard encore, notre joie en appelait à une chose plus intense qui n’a pas d’autre nom que la ruine : dans l’ivresse, nous savons que nos forces, en se dissolvant, en appellent de nouvelles, plus folles encore, qui exigent de l’existence qu’elle se donne tout entière en se dénudant jusqu’au silence.
En dévalant dans la nuit tous les cinq, nous réalisions à notre manière le programme de l’exposition : l’ivresse n’est‑elle pas, comme la ruine économique, une opération glorieuse ? En elle, un excédent se consume, comme si l’on mettait le feu à sa propre joie – comme si, enfin, chacun de nous se hissait à la mesure de la vérité.
Ainsi notre petite communauté fut‑elle en proie, le temps d’une soirée heureuse, au démon dont s’organisait le retour à la faveur d’une exposition : la dépense. On n’arrêtait pas de prononcer ce mot, je crois même qu’on se la jouait un peu : qui s’expose dans sa vie à de telles extrémités ? Bataille l’a écrit, l’a répété, et pourtant chacun se contente d’en répéter à son tour le constat séduisant sans jamais se l’appliquer, ni en incendier le monde, alors même que de telles choses éclairent le brasier de nos esprits.Je continue à croire, en écrivant ce livre, que l’ébullition dont nous sommes les porteurs hilares secoue la croûte des évidences. Tout s’ouvre avec le feu qui détruit ce qui était ordonné : l’univers est ce chaos d’une chambre d’enfant qui résiste au rangement. C’était ça le bureau du Trésorier‑ payeur : un trou dans la banque qui disait le trou dans l’univers.
En rentrant cette nuit‑là, je courus vers ma chambre d’hôtel en riant ; les images du Trésorier-payeur se bousculaient dans ma tête : je voyais des moments de sa vie clignoter, j’apercevais sa silhouette rigoureuse entrant dans la salle des coffres, s’approchant, une clef à la main, des douze armoires blindées, et sortant de l’une d’elles une chose énorme : un lingot d’or ? un tableau de maître ? les pages d’une correspondance obscène ? le cœur à vif d’une femme sacrifiée ?
Oui, je voyais une porte s’ouvrir sur un couloir souterrain, et le Trésorier de dos s’avançant dans le tunnel, une lampe torche à la main ; puis les images se mêlaient, s’obscurcissaient ; de nouveau je voyais apparaître la silhouette du Trésorier effectuant son trajet entre la banque et sa maison ; tout cela se répétait interminablement ; et voici que je trébuchai dans l’escalier : les images se brisèrent en se mélangeant, comme dans un kaléidoscope – c’est dans l’escalier de l’hôtel du Vieux Beffroi que j’aperçus ce roman en entier.
Les jours suivants, tandis que le régisseur et son équipe préparaient les salles pour les artistes, je m’appliquai à remplir celle qui m’avait été attribuée pour le Trésorier‑payeur.La visite chez Emmaüs avait porté ses fruits : non seulement je disposai autour de l’authentique bureau du directeur le mobilier que je m’étais procuré (consoles, étagères, fauteuil, table basse, et même un divan récupéré dans la rue), mais je commençai, sans trop savoir pourquoi, à entasser des montagnes de papiers qui s’écroulaient comme des dunes. Je fis des tas, j’empilai des livres, des cahiers de comptes et des classeurs d’archives ; j’accumulai en vrac des kilos de documents, de vieux journaux, des liasses de papiers vierges ou usagers trouvés ici et là.
Je passai deux jours, fébrile, presque fiévreux, à orchestrer ce désordre : me déplacer à l’intérieur d’un tel encombrement provoquait en moi une joie étrange, comme si ce lieu qui s’inventait sous mes yeux m’était familier depuis toujours, comme si au cœur du désordre se découvrait une vérité liée à l’art, au temps, peut‑être à la lumière.
Le sol avait disparu sous des entassements, et je progressais avec lenteur entre les piles, créant de minuscules sentiers qui, en déplaçant toutes ces masses, suscitaient des rigoles de luminosité soudaine ; je me tenais alors en équilibre, et parfois immobile durant trois, quatre, cinq minutes, vacillant un peu pour ne pas perdre pied, il m’arrivait, pour jouir des éclats de nacre venus du ciel de Béthune qui se reflétaient par la vitre de cette chambre du premier étage de l’ancienne Banque de France, de fermer les yeux, comme si les couleurs qui fondent leur arc‑en‑ciel à l’intérieur d’un rayon éclairaient l’intérieur de ma tête, y serpentaient comme des lucioles, et me guidaient vers des espaces plus subtils, vers cette minutie de l’amour qui nous accompagne lorsque nous créons. Oui, il me semblait bien – tout en en riant – qu’au long de ces quelques minutes éclaboussées de lumières chaudes, je devenais un artiste. Ou plutôt je jouais à faire l’artiste, sculptant les piles, veillant sur la position de leurs arêtes, modulant chaque détail d’un flux qui ne s’arrêtait pas.
Le désordre fait toujours impression sur les âmes simples ; mais je crois qu’autre chose était en jeu dans ce bureau démentiel que la puissance équivoque de l’entassement. S’il y a un monstre, il ne réside pas dans ces tas de dossiers qui s’agglutinaient autour du bureau, et venaient en lécher les pieds comme des flammes infernales, mais peut‑être dans l’esprit de celui qui en avait conçu l’extraordinaire dispositif.
Il nous est tous arrivé, un jour que nous étions invités dans une maison de campagne ou que nous dînions chez un ami, de découvrir, au hasard d’un couloir où l’on s’égare en revenant de la salle de bains, une chambre où d’un coup s’offre, avec la violence d’un à‑pic, un somptueux désordre : l’encombrement absolu nous saisit alors comme une image de la déflagration que le savoir produit en nous ; les parois disparaissent derrière des amoncellements, les meubles eux‑ mêmes subissent le poids des piles qui s’affaissent.
Comme une végétation sauvage envahit la jungle, les archives, me disais‑je, s’étaient emparées de l’espace tout entier du bureau du Trésorier‑payeur, lui conférant un caractère sacré ; on ne pouvait raisonnablement occuper ce bureau, il avait été soustrait au monde de l’utile, on ne pouvait qu’essayer de s’y glisser, dans l’espoir de découvrir un chemin, de capter une lumière qui saurait allumer un parcours entre ces couches, ces massifs, ces alluvions. J’ai pensé que le Trésorier-payeur se tenait là, la nuit, les yeux fermés. Il priait, si je puis dire. Il brûlait. Pour penser, il faut être ardent.
On touche ici à des points que la raison ne connaît pas. Les mains se joignent pour étrangler ou pour prier. Mais qui serait capable de les joindre pour dénouer les liens qui vous enserrent le cou — pour dégager de l’espace au lieu d’en occuper, comme font la plupart des hommes ? Là où les brides sont dénouées, le feu va libre.Le vernissage de l’exposition « Dépenses » fut un succès. La joie qui n’avait cessé de porter notre petite communauté durant les jours précédant l’exposition se propagea aux visiteurs qui envahirent les espaces de l’ancienne banque avec une curiosité fascinée : il y avait des étudiants, des amis, des journalistes, de nombreux critiques d’art qui, soucieux de ne pas rater ce qu’ils pressentaient être l’événement de la saison artistique, avaient fait le voyage en train depuis Paris ; et surtout une foule de curieux venue de Béthune et des alentours, des amateurs d’art, mais aussi tous ceux qui voulaient savoir ce qu’était devenue la Banque de France — leur banque —, et comment une telle institution avait bien pu être métamorphosée en un centre d’art.
Une note, à la fin du livre, précise :
La première partie de ce livre s’inspire des préparatifs d’une exposition à laquelle j’ai participé :
La Traversée des inquiétudes
Une trilogie librement adaptée de l’œuvre de Georges Bataille « Dépenses » (2016-2017), « Intériorités » (2017-2018), « Vertiges » (2018-2019)
LaBanque, centre de production et diffusion en arts visuels, Béthune
Commissariat d’exposition et écriture du projet : Léa BismuthJe tiens à remercier toutes les personnes citées, et en particulier Léa Bismuth, Anne-Lise Broyer, Philippe Massardier et Lara Vallet.
Mes remerciements vont aussi à Dominique Foule, Maren Sell, Olivier Rubinstein et Victor Depardieu pour leur aide précieuse.
La traversée des inquiétudes a fait l’objet de plusieurs expositions dont la revue art press s’est fait l’écho (cf. Valeur d’usage de Georges Bataille et La traversée des inquiétudes). Dans le cadre de la première exposition « Dépenses », Haenel avait écrit un texte et Anne-Lise Broyer, photographe, répondait aux questions de Frédéric Lemaître sous un titre très godardien « Pas juste une image, une image juste » (LIRE ICI pdf
 ).
).
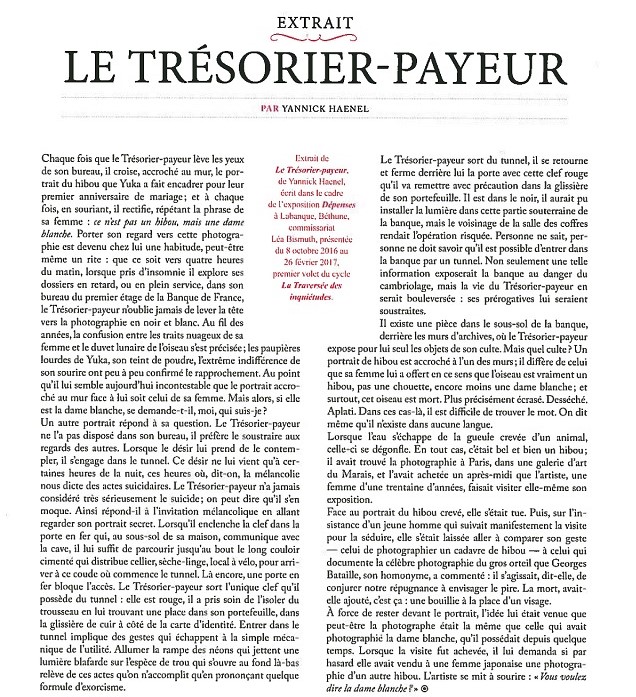
Extrait du texte de Haenel.
ZOOM : cliquer sur l’image.



Work in progress
Le Trésorier-payeur
Extraits dans AOC, 18 mars 2018
Par Yannick Haenel
Récent lauréat du prix Médicis pour son roman « Tiens ferme ta couronne », Yannick Haenel bâtit, depuis une vingtaine d’années, l’une des œuvres importantes de la littérature française contemporaine. Il donne aujourd’hui à AOC une nouvelle inédite où il est question, à Béthune, d’un (drôle) de banquier et d’un souterrain…
Lors d’un séjour à Béthune, il y a quelques années, j’ai visité l’ancienne Banque de France. Elle était en chantier car on la transformait en centre d’art. Je pris plaisir, ce jour-là, à déambuler sous la conduite de son futur directeur à travers la grande salle des Guichets, celle des Coffres, celle aussi des Archives aux immenses classeurs muraux ; nous traversâmes la serre des monnaies, avec sa coursive, ses pupitres à roulettes et son monte-charge ; et je fus convié à admirer cette chambre froide où l’on stockait naguère les billets usagés.
En gravissant les deux étages de ce somptueux édifice, où de larges espaces en enfilade donnaient aux lieux un air de château bourgeois, je rêvassais à la vie des employés, que je me figurais aussi obscure que romanesque, quand mon guide approcha d’une fenêtre et attira mon attention sur une maison de briques rouges à deux étages, qui semblait abandonnée.
Il m’apprit qu’elle avait appartenu à quelqu’un qu’il appelait le « Trésorier-payeur » ; il ajouta que cette maison était reliée à la banque par un sous-terrain aujourd’hui bouché.
Au moment où il me révéla ce détail, il se tourna brusquement vers moi, un éclat ironique passa sur son visage ; je compris que son objectif était atteint : il avait déclenché ma curiosité, un roman scintillait, j’étais pris.
Cet éclat sur le visage du directeur m’avait semblé louche, autant que cette histoire de tunnel, trop belle pour être vraie ; pourtant, elle me fascina. Tout le reste de la journée, je ne pensais qu’à ça, au tunnel, aux trous, à l’obsession qui nous les fait creuser. Non seulement je pensais à cet invraisemblable trou creusé sous la Banque de France, mais déjà moi-même, en y pensant, je ne cessais de creuser. Le tunnel, je le voyais, je m’y engouffrais, et déjà je le continuais.
En rentrant à Paris, l’obsession se mit à grandir : je ne pensais qu’au tunnel du Trésorier-payeur. J’en rêvais, même. Je ne cessais la nuit d’arpenter ce long trou qui reliait dans mon imagination la salle des coffres à la chambre à coucher du Trésorier. Je le voyais, je me voyais descendre dans les arcanes humides de la Banque de France, et à travers les couches d’argile et de craie qui composent la terre des bassins miniers, je passais sans cesse de la vie à la mort. Chaque matin, en me réveillant, j’avais la sensation non seulement d’avoir fait le casse du siècle, mais aussi de revenir du pays des morts.
Il y a des tunnels d’évasion et des tunnels d’obsession ; celui du Trésorier-payeur relevait du deuxième cas de figure : ce genre de tunnel, on passe sa vie à le creuser. Celui qui s’est mis dans la tête de creuser un tunnel n’en finit plus de se creuser la tête, il n’en finit pas d’explorer les galeries qui font des trous dans sa tête, il cherche inlassablement une grotte. Sans doute le Trésorier-payeur n’avait-il cherché qu’à établir dans sa vie (dans sa tête), la grotte où loger son désir perdu.
Mais, honnêtement, je le voyais mal creusant la nuit en bleu de travail à coups de piolet dans la roche de Béthune : le tunnel, forcément, existait avant lui. C’est précisément parce qu’il avait découvert l’existence de ce tunnel qu’il avait commencé à en être obsédé, et à vouloir le rouvrir.
Un soir, pris de fièvre, je griffonnai à la diable l’esquisse d’un récit où un très sérieux banquier entretenait avec la salle des coffres de sa banque un rapport insensé : tout en gardant le feu, à la manière d’une vestale, il était entièrement travaillé par l’idée de profaner l’objet de son culte.
Le sacré commence lorsque l’objet de ce qu’on aime coïncide avec la possibilité de sa négation. Dieu et la mort de Dieu sont une même chose. Je ne peux « croire » en Dieu que si je le tue — que si je peux le tuer. Croire en la banque, c’est être toujours au bord de la remplacer par le geste qui, en la faisant disparaître, prend sa place.
Six mois plus tard, je revins à Béthune. Les travaux dans la banque étaient terminés, je visitai le nouveau centre d’art, qui ouvrirait bientôt.
La figure du Trésorier-payeur ne m’avait pas quitté. Le paradoxe qui l’animait avait pris à mes yeux une consistance presque mythique : il était un homme ordinaire, nécessairement ordinaire, comme on l’est quand on se voue à une tâche rigoureuse, et en même temps un fou furieux qui hurle la nuit dans son souterrain.
Je devais à présent étayer cette intuition, lui donner forme, construire l’histoire grâce à laquelle cet homme se mettrait à revivre.
En me documentant sur cette étrange institution qu’est la Banque de France, je compris que le personnage qui avait travaillé à Béthune ne pouvait, contrairement à ce que le directeur du centre d’art s’était plu à affirmer, avoir été « Trésorier-payeur » : un tel titre est en France d’une importance capitale, presque aussi cruciale que celle d’un ministre ; ainsi est-il dévolu, par l’entremise de l’Inspection des Impôts, à quelqu’un qui administre non pas les banques, mais la comptabilité publique.
L’homme du tunnel pouvait avoir été trésorier de la banque de France de Béthune, mais pas trésorier-payeur.
Je décidai pourtant de continuer à l’appeler le Trésorier-payeur, avec cette épithète presque énigmatique, parce que d’une part c’est ainsi qu’on me l’avait présenté, et d’autre part parce qu’il prenait sous cette dénomination figure de personnage. Un simple « trésorier », même si le mot qui le désigne éclate comme un soleil, n’est jamais qu’un employé, alors qu’on peut très bien imaginer, sous l’étrange dénomination de « trésorier-payeur », des compétences occultes : les rayons du soleil sont ici plus abondants et touchent à l’inconnu.
En février 2016, presque un an après ma première visite, je passai trois jours à Béthune. C’est là que je compris qui était vraiment le Trésorier-payeur ; c’est là que j’entrevis les rouages de son esprit, et comment le capitalisme était devenue chez lui une passion.
Je pris une chambre au Vieux Beffroi, sur la Grand-Place. Le premier matin, au moment de taper sur mon portable le numéro du centre d’art, je me ravisai : au fond, pour enquêter sur un tel homme, je n’avais besoin de personne ; être seul dans cette ville serait préférable, j’allais déambuler dans les rues de Béthune, penser au Trésorier-payeur, trouver sa voix, ses vêtements, ses manies, son grand projet.
J’aime assez les habitudes : j’allais dîner tous les soirs dans le même restaurant, dont le nom me plaisait. Le Trou du nord était une de ces auberges à l’ancienne où l’on trouve au mur une tête de chevreuil ou de cerf empaillée. On ne chassait pas vraiment dans la région, mais il y avait bel et bien, au-dessus de la cheminée, à côté des inévitables peintures de genre — en l’occurrence, des Retours de la mine et des Dimanches de marché sur la Grand-Place —, un cerf dont l’œil éternellement brillant me fixait avec dédain.
C’est là que trois soirs de suite, je pus observer une femme d’une soixantaine d’années qui dînait seule. Une table lui était réservée chaque soir. On ne lui apportait aucun menu : elle prenait toujours le même plat, une soupe au vermicelle avec un verre de vin rouge.
J’ai promis à cette femme de ne pas communiquer son nom ; ni même de préciser en quoi elle fut proche du Trésorier-payeur. Ceux qui liront ou entendront ce récit la reconnaîtront peut-être parmi les femmes qui y sont évoquées ; ils la devineront forcément : elle est au premier plan. Je ne peux en dire plus, même si c’est d’elle que je tiens la trame à peu près complète de la vie du Trésorier-payeur. C’est aussi grâce à elle que j’ai rencontré, durant ces trois jours à Béthune, les autres personnes qui m’ont conduites au plus près de la folie du Trésorier-payeur. Là aussi, j’ai promis. Je dois maquiller mes sources. Je raconterai ce que je sais de cet homme comme si je l’avais connu moi-même, comme si je lui étais proche, infiniment proche, comme si, en quelque sorte, il était moi.
Cet homme qui avait fait creuser un tunnel entre sa maison et la banque, qui avait la rigueur classique des banquiers, mais aussi l’excès du pyromane et l’extravagance dissimulée de l’obsédé sexuel, cet homme veilla pendant vingt ans avec professionnalisme sur les intérêts de ses clients, tout en projetant en secret d’incendier les locaux de la banque et d’escamoter ses réserves de liquidités. Même si ce projet a été contrarié, il est impossible de le contester : le Trésorier-payeur lui-même n’aura fait que le signer par l’étrangeté de sa conduite. Est-il possible de détruire l’argent ? Seul un banquier, sans doute, peut résoudre une telle énigme.
Il avait établi chez lui, dans une petite pièce attenante au salon, un bureau qui était l’exacte réplique de celui qu’il occupait dans la banque. Mêmes proportions, même fenêtre, même ameublement. Les murs étaient décorés de la même façon : à côté d’une vue du Pavillon d’Or — un banal encadrement d’une reproduction imprimée dans le supplément Les Cent Merveilles du monde de Télé 7 Jours —, figurait la photographie en noir et blanc d’un hibou. Ou plutôt d’une chouette : une dame blanche, pour être précis ; elle fixait l’objectif avec cette splendide indifférence des animaux qui vous efface.
Et si l’on fixe à notre tour cette étrange tête qui, en s’absentant, semble s’adresser précisément à notre absence, comme si elle nous inoculait la sienne, et nous ouvrait à une transparence effacée semblable à la pluie et au vent, on remarque des traits féminins, aussi discrets qu’une estampe, qui font signe vers le Japon, vers le visage enfoui en eux-mêmes des femmes japonaises.
Les yeux se protègent, mi-clos, la bouche ne s’ouvre pas, et pourtant cette tête vous regarde droit dans les yeux, comme si en elle un rapport de force ambigu se jouait de vos dispositions à dominer ou à être dominé : vous proposait — sans même le vouloir — de brouiller les rapports ; de n’être qu’une surface blanche aux yeux mi-clos tandis que vous la fouettez ou la ligotez avec du cuir.
Donc, le Trésorier-payeur avait reproduit avec exactitude, chez lui, dans sa maison, le bureau qu’il occupait au rez-de-chaussée de la banque, afin de poursuivre ses activités financières — mais à l’envers. Ce bureau — ou plutôt sa duplication — m’a toujours intrigué. On me l’a décrit comme l’antre d’un fou, la tanière d’un monomaniaque, mais ces descriptions, pour exaltées qu’elles fussent, étaient décevantes. Le désordre fait toujours impression sur les âmes simples ; mais je crois qu’autre chose était en jeu dans ce bureau démentiel que la puissance équivoque de l’entassement. S’il y a un monstre, il ne réside pas dans ces tas de dossiers qui s’agglutinaient, paraît-il, autour du bureau, et venaient en lécher les pieds comme des flammes infernales.
Il nous est tous arrivé, un jour que nous étions invités dans une maison de campagne ou que nous dînions chez quelque ami, de découvrir, au hasard d’un couloir où l’on s’égare en revenant de la salle de bain, une chambre où d’un coup s’offre, avec la violence d’un à-pic, un somptueux désordre. L’encombrement absolu nous saisit comme une image de la déflagration que le savoir produit en nous. Les parois disparaissent derrière des alignements, le sol sous des entassements, les meubles eux-mêmes subissent le poids des piles qui s’affaissent.
Comme une végétation sauvage envahit la jungle, les archives s’étaient emparées de l’espace tout entier du bureau du Trésorier-payeur, lui conférant un caractère sacré. On ne pouvait occuper ce bureau, il avait été soustrait méthodiquement au monde de l’utile, on ne pouvait qu’essayer de s’y glisser, dans l’espoir d’un chemin, d’une lumière hésitante qui saurait serpenter entre les couches, les massifs, les alluvions de papiers. J’ai pensé que le Trésorier-payeur se tenait là, la nuit, les yeux fermés. Il priait, si je puis dire. Il brûlait. Pour penser, il faut être ardent.
On touche ici à des points que la raison ne connaît pas. Les mains se joignent pour étrangler ou pour prier. Mais qui serait capable de les joindre pour dénouer les liens qui vous enserrent le cou ? Pour dégager de l’espace au lieu d’occuper de l’espace, comme font tous les hommes. Là où les brides sont dénouées, le feu va libre.
L’impression que provoque un tel amoncellement dans le bureau du Trésorier-payeur relève de la rupture d’un barrage hydraulique ou de l’arrivée sur la lune ; en même temps, il vous semble connaître ce pays qui s’ouvre. Peut-être y êtes-vous né. Il saute aux yeux que ce monde saturé est aussi un monde de tunnels. Le Trésorier-payeur s’était entouré d’une masse de documents qui autour de lui élevaient leur muraille, établissaient une forteresse ; et lorsqu’il se levait de son fauteuil il lui fallait, contournant les piles, les tas, les pyramides, emprunter des couloirs à l’intérieur de son propre bureau qui lui donnaient déjà la sensation, grisante, sensuelle, de pénétrer à l’intérieur d’un tunnel.
L’approche d’un tel désordre, sa révélation plausible, est bouleversante. On côtoie alors réellement ce que l’on redoutait, et qu’on avait le plus souvent relégué dans le domaine de la fiction. Je le sais : j’y habite.
Pourquoi ces deux bureaux ? Je crois que cette duplication obéissait dans l’esprit du Trésorier-payeur à ce double régime qui fait sans cesse se regarder, comme en miroir, le profane et le sacré : veiller sur les finances est une activité occulte (personne ne saurait la réduire à la comptabilité). La réplique du bureau du Trésorier-payeur était un temple. Dans celui qu’il occupait à la banque, il comptait ; dans celui qu’il s’était inventé chez lui, il faisait le contraire. Quel est le contraire de compter ? Faire disparaître ? Effacer ? Escamoter ?
L’idée d’inversion peut-elle s’appliquer à quelque chose d’aussi volatil que la finance ? La tentation de profaner l’argent peut sembler complètement illusoire. D’ailleurs, est-ce possible ? Le Capital est-il destructible ? Suffit-il de brûler des billets de banque pour dépasser l’économie ?
Ces questions ne sont nullement théoriques. La réversibilité, seule, accomplit l’amour (dans le sacré, la destruction renforce l’adoration). Les liens économiques détiennent le monopole de tous les rapports. Il n’en existe pas un qui soit susceptible d’échapper longtemps à leur empire. Seul le mystique, ou disons le saint, résiste ; mais ils ne courent pas les rues.
La solution du Trésorier-payeur, aussi lumineuse qu’ardue, aussi ardue que singulière, aura donc été de briser cette puissance qu’est l’économie depuis l’intérieur même de l’économie — depuis son intérieur extrême ; dans son cœur atomique. Certains clients de la banque ne comparaient-ils pas la salle des coffres à un réacteur nucléaire ?
Pour le dire en d’autres termes : on ne peut se tenir à l’écart de la banque, si bien que le Trésorier-payeur chercha l’écart au cœur même de la banque. Dans l’œil du cyclone.
Il y en a qui sentent combien la vie en eux se dépense ; ils sont capables de ressentir cette étrange gloire : la nature gaspille bien ses fleurs une à une. Je ne sais si le Trésorier-payeur en est un jour arrivé là ; un dieu seul pourrait jouir avec exactitude de ce qu’il perd — de ce qu’il sacrifie. Mais personne n’est mieux placé que les banquiers pour évaluer ce qu’il en est de la ruine : l’argent qui part en fumée vous ôte une part si intense que seule la mort s’avère capable de vous offrir le même attrait. Entre ce qu’on vous retire brutalement et ce qui vous tombe dessus — entre la ruine et le cadeau —, des affinités se créent qui racontent une histoire où l’esprit manœuvre. Car personne jamais n’a été capable de n’avoir rien : même le Christ tenait à ses pensées.
Ainsi, celui dont la vie est ordonnée au soin d’un objet doit un jour en souiller la valeur, ne serait-ce qu’à ses propres yeux ; c’est la loi du pervers — et c’est une loi plus générale, aussi obscure que l’adoration dont elle est l’envers trouble. Peut-être même est-ce la vérité enfouie de tout amour : il est impossible de vénérer un dieu sans le mettre à mort.
Je le répète : il fallait donc qu’un jour le Trésorier-payeur brûlât de l’argent. Car détourner l’échange suffit sans doute aux esprits tordus, mais le Trésorier-payeur n’était pas qu’un simple pervers : en lui, la contre-nature avait pris figure de royaume. Dilapider, détourner, corrompre, souiller ne pouvaient en aucune façon le satisfaire : de telles opérations ne sont jamais que des manières, certes tortueuses, de faire encore des bénéfices, et il y a bien longtemps qu’un tel homme avait abandonné une idée aussi ordinaire : ses ambitions étaient autres, il ne cherchait ni à s’enrichir ni à dominer. Il voulait soulever le voile, se retrouver seul face à ce qui est seul. Peut-on appeler ça la ruine ? Je ne crois pas. Le dénuement qui nous occupe ne possède pas de nom : il est ce qui adviendrait si l’on parvenait à sortir du calcul. Réfléchissez bien, soyez honnête : ça ne vous arrive jamais.
On manque d’imagination lorsqu’on réfléchit sur l’expérience intérieure des autres. Je peux bien imaginer qu’à sa manière le Trésorier-payeur de Béthune avait une expérience intérieure. Mais j’utilise le verbe « avoir » alors qu’une telle expérience glisse entre les doigts : la vivre, c’est essentiellement lui faire défaut. L’expérience intérieure est avant tout ce qui se dérobe à la prise. Georges Bataille a écrit plusieurs livres sur le réel de l’extase, c’est-à-dire le foyer indomptable, ce feu où se défont les mots. Il les a réunis sous un titre ambigu : la Somme athéologique, qui laisse entendre combien Dieu et la mort de Dieu sont une même chose. Car celui ou celle qui parvient à tuer en lui (en elle) l’idée même de Dieu (ou disons du Cogito absolu), s’ouvre au râle de l’absence de limite, et ce râle est une jouissance déchirée qui se rencontre — se rattrape — dans les actes sexuels (ceux qui lient deux personnes).
(Personne n’est capable d’effacer Dieu car en l’effaçant, on affirme encore cet effacement, et l’affirmation prend la place de Dieu.)
Dieu, l’Argent, le Cogito : je tourne autour de ces grands mots. Le Trésorier-payeur était un cartésien, comme tous les banquiers ; il aimait le pli que prennent les raisonnements. Mais le livre de comptes est une bible dont l’horizon est l’arraisonnement de chaque étant à sa valeur chiffrée. C’est le dieu du Tout. Chaque chiffre est final. Ainsi le Trésorier-payeur était-il un familier de la fin de toute chose ; peut-être même, en un sens, vivait-il après la fin, dans ce territoire de l’esprit où l’apocalypse a déjà eu lieu.
Les crises mondiales ont accrédité l’idée que nous sommes là, que peut-être la psychose qui affecte depuis une vingtaine d’années l’économie et qui a rendu l’argent fou se transcrit, se comprend, s’interprète en termes démoniaques. Je dois réfléchir à cette idée : quel monde surgit-il de la spéculation financière devenue planétaire ? Le Trésorier-payeur savait qu’une telle perversion de l’économie entraînait automatiquement la déshumanisation. Il n’y a plus personne aux manettes, plus aucun décideur. La finance régit le monde toute seule, comme un ordinateur devenu fou. Ainsi vivons-nous — et le Trésorier-payeur le savait, lui qui arpentait le couloir de son tunnel avec la concentration fiévreuse du prêtre sacré —, oui, ainsi vivons-nous comme des bêtes à sacrifier.
Voilà : les humains sont tous en état de sacrifice, ils sont sacrifiables à merci. Ils ont remplacé les billets de banque, ils ont pris la place de l’argent qu’on dilapide. L’immense dilapidation qui enveloppe la Terre n’a plus seulement la couleur de l’argent qu’on jetterait par la fenêtre, comme le capitalisme, en une extase noire, en a pris l’habitude, mais, d’une manière plus terrible, plus criminelle, la couleur des vies humaines qui sont aujourd’hui en permanence l’objet d’un krach. Le krach est la vérité de notre époque, celle que le Trésorier-payeur, en la mimant la nuit, dans le sous-sol de la banque, avait prévue.
S’il y a bien quelqu’un qui a pensé jusqu’au bout l’idée du monde offert à sa propre spéculation, c’est lui ; il a vu, seul, dans son sous-sol, que la Terre, la planète, puis l’univers un jour, seraient mis en bourse.
L’expérience dont je parle est avant tout une économie sacrée ; et le Trésorier-payeur, on l’a compris, l’équivalent, en costume-cravate, du sacrificateur.
Il serait bien sûr excessif de prêter à un banquier anonyme le désir intellectuel d’immoler l’existence, de contester Dieu en consumant son image en lui ; non pas qu’il n’en soit pas capable, mais un homme qui travaille huit heures par jour sous l’astreinte (et qui, en dormant, continue à diriger d’une manière occulte la banque) ne cherche à sortir de lui-même que pour penser à autre chose (et je crois que le destin de la banque et la mort de Dieu ont à voir ensemble).
La passion de l’inutile s’aggrave en destruction masquée. Le camouflage auquel s’est astreint le Trésorier-payeur ne s’ordonne peut-être à aucun but. Être un banquier, et compromettre en même temps l’argent sur lequel on veille prodigue un approfondissement de la jouissance dont les perspectives ne sont pas mesurables, et c’est précisément cela dont il s’agit dans la mélancolie d’un tel homme : la possibilité de sortir du mesurable.
À la fin, le banquier ne compte plus ; il appelle sur lui non la ruine, mais l’infini. Il aime le gratuit, qui est l’autre nom de la source.
À quoi le Trésorier-payeur passait-il son temps ? Les horaires de la banque étaient stricts : à huit heures, il était à son bureau du premier étage ; mais je l’ai dit : son étrangeté consistait à ne faire que travailler — à ridiculiser l’idée même d’horaire par l’excès de sa passion pour la Banque. Rentré chez lui à dix-sept heures, il pensait encore à la salle des coffres. Il revenait.
Sans doute accédait-il enfin à sa propre intimité à partir du tunnel, à partir de l’instant où il dépassait la notion de travail quantifié, où il se dépensait dans le rien effarant d’une adoration.
Qu’un fonctionnaire d’État fût en secret un héros de la déraison digne de Louis II de Bavière, cela étonne : on imagine mal un mystique en costume-cravate. C’est pourtant un tel contraste qui régit la vie d’un homme comme le Trésorier-payeur : sortir de chez soi vers vingt et une heure et accéder à la salle des coffres par le tunnel relève de l’itinéraire sacré.


Autre extrait publié en avril 2020 (Yoko Mizaki est devenue Lilya Mizaki dans la version définitive du roman. L’il y a, c’est mieux.).
C’est à dix-sept heures dix que le Trésorier-payeur, chaque jour, entrait dans la salle d’attente. À cette heure-là, elle était toujours vide, le dernier patient ouvrait grand sa bouche aux soubresauts de la roulette et ne sortirait que vers dix-sept heures trente.
Le Trésorier-payeur aimait par-dessus tout ces vingt minutes où enfin libéré de la banque et pas encore entré dans cet autre temps qui est celui de l’amour, il pouvait se laisser envahir par la lumière qui à cette heure-ci entrait par la fenêtre de la salle d’attente où les murs blancs, les papyrus et le mobilier en osier produisaient chez lui une sensation d’été paisible.
Il ne s’asseyait pas ; il se tenait debout, les yeux clos, appuyé contre le rebord de la fenêtre, le visage offert au ruissellement de la lumière, et il arrivait que celle-ci fût si violente qu’en lui enveloppant le visage une lueur rouge lui apparût au fond de ses yeux en même temps qu’une agréable chaleur. Les chiffres commençaient à disparaître de ses pensées ; plus exactement ses pensées commençaient à chasser les chiffres, dont l’effacement progressif se faisait sentir comme l’effet d’une aspirine dissolvant une migraine. Ses traits s’adoucissaient, ses muscles se détendaient, et le visage nimbé d’un éclat orangé, incandescent, solaire, il s’ouvrait à l’imminence du long baiser qu’il échangerait bientôt avec sa femme, dont l’intensité se substituerait non seulement aux soucis de leur journée, à la fatigue de leur travail, mais aussi au monde, aux êtres, aux paroles, à l’univers entier qui nous tient enfermés dans son poing.
Lorsqu’on évoque les préliminaires de l’amour, on se contente souvent de décrire des caresses ; mais tout aussi excitants sont les moments qui précèdent la rencontre : en faisant monter le désir, l’attente compose une région ardente où le corps se prépare. En offrant son visage au soleil, le Trésorier-payeur s’imprégnait de ces couleurs chaudes qui se diffuseraient à travers ses étreintes avec sa femme ; et si déjà de sa gorge à ses cuisses un feu se réveillait qui propagerait bientôt jusqu’au bas de son ventre l’incendie que la seule pensée du corps nu de Yoko provoquait, il lui suffisait, après sa station au bord de la fenêtre, de se placer à un endroit précis de la salle d’attente pour qu’aussitôt son esprit, presque entièrement délivré des chiffres, entrât dans un climat propice à la joie des sens.
Il y avait en effet, accrochées aux murs de la salle d’attente, deux grandes photographies qui se faisaient face. L’une d’elle représentait le Pavillon d’argent — Ginkaku-ji — et l’autre le Pavillon d’or — Kinkaku-ji. Ces deux paysages à l’harmonie éblouissante accomplissaient l’image de la perfection : leur célébrité n’atténuait en rien le plaisir qu’on éprouvait à les contempler, plaisir encore multiplié par l’effet de symétrie que provoquait leur face-à-face.
Le Trésorier-payeur, tel était son rituel, commençait toujours par observer le Pavillon d’argent, sans doute parce que celui-ci avait la préférence de Yoko, mais aussi parce que ses couleurs, plus discrètes que celles du Pavillon d’or, se fondaient dans les montagnes qui l’entouraient ; il se laissait d’abord envahir par la douceur des mousses et la clarté des pierres ; puis les reflets des panneaux de bois du temple dans les eaux du lac mobilisaient son attention ; enfin la ligne des pins qui serpente à travers la montagne, le jardin de sable blanc et de graviers : tout s’ajustait au fur et à mesure pour s’emparer de son esprit comme une vision intérieure qui intime le silence.
Puis il se tournait vers le Pavillon d’or, dont l’image le ravissait plus rapidement, trop peut-être : ces feuilles d’or qui recouvrent les parois du temple lui rappelaient la couleur du métal sur quoi tout l’édifice monétaire avait longtemps reposé. Le ciel qui tournait autour du pavillon renvoyait son image dans l’étang où des îlots rocheux en modulaient les proportions ; et le phénix qui étincèle au sommet de la toiture avec ses ailes déployées pour l’éternité indiquait au Trésorier-payeur que rien, pas même un incendie, ne pouvait troubler l’ordonnance de ces lieux qui toujours renaîtraient de leurs cendres.
De la lumière conjuguée du Pavillon d’or et du Pavillon d’argent se diffusait dans l’esprit du Trésorier-payeur, immobile à mi-chemin des deux images, l’une à sa droite, l’autre à sa gauche, une clarté qui le remplissait. Plus aucun chiffre ne rôdait dans sa tête ; ils avaient fondu, laissant un vide que le plaisir occuperait d’ici quelques minutes.
Cet espace libre en chacun de nous que nous cherchons parfois vainement, le Trésorier-payeur, à force d’application, le retrouvait quotidiennement ; il s’était fait un art de le sculpter dans la lumière des après-midi, au point que son esprit, bridé par la vie de bureau, ne tendait plus que vers cet instant où la fine architecture de ses sens recevait avec les lueurs des deux chefs-d’œuvre de Kyôto sa provision d’extase.
Mais l’émotion qui naissait alors en lui ne se consumait pas dans la jouissance — elle attendait. Le corps de sa bien-aimée lui apparaissait miroitant d’or et d’argent, comme si la lune et le soleil l’avaient enduite d’une rosée dont il allait goûter le nectar. Les prières glissent ainsi vers un temple invisible ; le Trésorier-payeur, quant à lui, méditait son érotisme.
Et alors qu’il ne restait plus qu’une minute ou deux avant que Yoko, toujours ponctuelle, n’ouvrît la porte, et que le patient s’éclipsât ; alors que l’image de sa blouse blanche entrouverte sur ses cuisses se précisait, le Trésorier-payeur comme à son habitude laissait ses souvenirs naviguer au long des sentiers que Yoko et lui avaient empruntés lors de leur voyage de noces à Kyôto, lorsque cheminant d’un temple à un autre, parmi les collines boisées qui surmontaient la ville, et se perdant avec joie parmi les jardins et le long des rivières, s’étreignant sous l’ombre légère des érables, ils s’ouvraient à une volupté dont ils découvraient qu’elle allait les occuper toute leur vie. Car la rencontre entre Yoko Mizaki et le Trésorier-payeur leur avait ouvert un pays de nuances, aussi crues que délicates, dont les variations s’affinaient au fur et à mesure des soirs passés ensemble, des semaines, des mois, des années ; et voici que la dernière image avant dix-sept heures trente déroulait sa flamboyance dans l’esprit du Trésorier-payeur : le visage béat de Yoko tourné vers les branches des cerisiers en fleur, lorsque durant ce même voyage ils avaient vécu fébrilement le sakura — l’avancée de la floraison des cerisiers roses et blancs —, courant d’un arbre à un autre afin de recevoir sur le visage les pétales qui éclosent. Et il ne pouvait oublier cet instant où la tête jetée en arrière en un geste de ravissement qui l’offrait à l’ondée rose pâle des fleurs, Yoko avait ouvert sa bouche en un râle d’abandon semblable à celui qui la jetait hors d’elle au comble de leurs étreintes, et cette bouche que depuis ce jour il ne pensait qu’à remplir avec sa langue ou son sexe, et qui s’ouvrait à l’univers entier, à la pluie, au vent, il allait bientôt la retrouver et recevoir d’elle ces baisers au goût de lune qui avaient changé sa vie.
YANNICK HAENEL


Pierre Michon recommande fortement ce livre qui paraîtra chez Gallimard, le 18 août… mais que vous pouvez dès aujourd’hui réserver auprès de votre libraire.

Les Rencontres de Chaminadour.
ZOOM : cliquer sur l’image.



Bataille est mort en juillet 1962. Dix ans plus tard, Sollers organisait le colloque de Cerisy : « Artaud/Bataille, vers une révolution culturelle ». Cinquante après ce colloque historique, Yannick Haenel participera au rencontres de Chaminadour N°17 (15-18 septembre 2022). Cf. Yannick Haenel sur les grands chemins de Michel Leiris et Georges Bataille.


Les Rencontres de Chaminadour.
ZOOM : cliquer sur l’image.

Cher Albert Gauvin,
[...] Juste pour vous dire que je consulte votre site constamment ; et qu’il me passionne.
Tout sur Sollers, bien sûr ; mais aussi tout sur Bataille. Et le reste du monde s’en suit.
Nos passions convergent sur mille points, et c’est une joie de les approfondir grâce à vous.
Je vous remercie infiniment de rendre compte si régulièrement de ce que j’écris, notamment à Charlie Hebdo.
Merci encore, et très bel été à vous,
Yannick Haenel (24-07-21)
LIRE :
 Georges Bataille, La part maudite pdf
Georges Bataille, La part maudite pdf

 Bataille politique
Bataille politique
 Georges Bataille sur Pileface
Georges Bataille sur Pileface
 Yannick Haenel sur Pileface
Yannick Haenel sur Pileface


Georges Bataille, le plus libre
Yannick Haenel
Mis en ligne le 13 juillet 2022
Paru dans l’édition 1564 du 13 juillet de Charlie
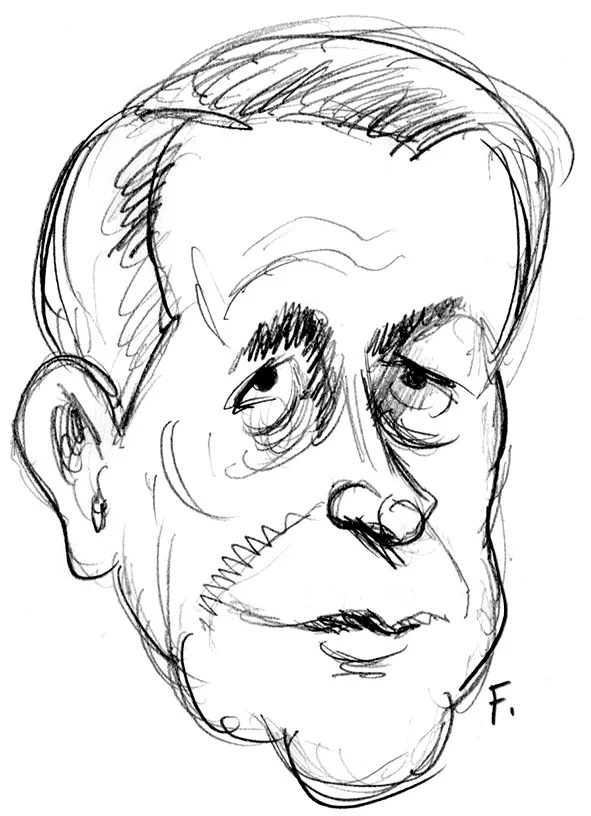
J’aurais pu choisir Rimbaud ou Saint-Just, car la liberté d’un homme va aussi loin que le langage dont il est capable. Mais celui que j’estime le plus libre de tous les hommes, et que j’admire le plus, car sa liberté, en m’inspirant, se transmet à moi comme elle se transmet à toutes celles et à tous ceux qui cherchent à l’agrandir en eux, et à faire de leur vie une expérience radicale, c’est Georges Bataille (1897–1962).
Il n’a pas bâti d’empire ni déclenché de révolution ; il n’a rien fait d’« utile » sinon inspirer du mauvais esprit à ses lecteurs, bouleversant les « notions consciencieuses », mettant le feu à leurs désirs.
C’est un « écrivain », c’est-à-dire beaucoup plus qu’un simple publieur de livres : quelqu’un qui vit l’aventure du langage comme insubordination et comme destin. Il a écrit des récits érotiques parmi les plus extatiques : Histoire de l’œil (1928), Madame Edwarda (1941). S’est intéressé à Hegel, à Lascaux et à Sade. A créé, avec Michel Leiris et contre les surréalistes, la plus belle revue du monde : Documents (1929–1931). A découvert des gisements de pensée inédite et déchaînée en écrivant L’Expérience intérieure (1943), La Part maudite (1949) ou Les Larmes d’Éros (1961). A compris que le monde des amants était plus souverain que la politique.
Ni dieu ni maître, c’est-à-dire – si l’on veut être rigoureux – ni production ni épargne. Cesser de produire, de consommer, d’économiser : dépense à l’état pur.
La liberté ne se vote pas, ne se décrète pas : elle s’éprouve à travers le degré de poésie dont on est capable à chaque instant.
Georges Bataille n’a tremblé devant aucune idée – c’est-à-dire devant aucun pouvoir. L’amplitude de sa pensée le met largement au-dessus de Sartre ou de Camus, ses collègues qui auront persisté à se représenter le monde en termes politiques. Bataille a compris, dès Hiroshima, que le vieux monde avait implosé et que les Temps modernes avaient tourné au démoniaque.
La société nous étouffe, elle est peuplée d’hommes de paille qui se mentent à eux-mêmes sur fond de renoncement terrifié. Aucune politique ne sera plus jamais à la hauteur de ce que nous exigeons désormais comme liberté vivable. C’est pourquoi, avec Bataille, je ne respecte rien de ce qui émane de ce secteur ; et rien non plus de ce qui se prétend capable de parler pour les autres. L’anarchiste en moi ne reconnaît partout que des fripouilles désemparées. La planète implose par la faute des humanoïdes ; alors qu’ils ne viennent pas nous culpabiliser.
S’il est possible d’anéantir intégralement en soi le désir de se raccrocher à quelque valeur, un homme l’a fait, et cet homme c’est Bataille. Je me répète sa phrase avec joie, on croirait entendre rire Charlie : « Le monde n’est habitable qu’à la condition que rien n’en soit respecté. »


Critiques
Georges Bataille à la Banque de France, par Yannick Haenel, romancier

« J’étais très loin dans la nuit, traversé par les époques, accroupi dans le désert du Sinaï près d’un fagot de bois ou contemplant l’aurore au bord d’une mer grecque, allongé à l’intérieur d’un temple, mais toujours guidé par l’éclat d’une lame de couteau. »
Quelquefois, le souffle est puissant, brûlant.
C’est alors un feu grégeois de phrases, une myriade de brasiers éparpillés sur chaque page formant la substance d’un livre échappant à toute forme d’arraisonnement.
Dieu vomit les tièdes, comme le fait aussi la littérature.
Il y a chez Yannick Haenel des livres où la flamme est peut-être plus haute encore que d’autres, où rien n’est plus essentiel que l’intensité de ce qui s’invente par l’écrit.
Cercle (2007), Tiens ferme ta couronne (2017), La solitude Caravage (2019) et Notre solitude (2021) font partie de ces œuvres qui débordent, élargissent le champ de l’expérience sensible, et convoquent une pensée atteignant le cœur de l’impossible, du mal, de la beauté, du salut.
Le Trésorier-payeur, où s’exprime un plaisir romanesque renouvelé, presque neuf dans le goût de la construction des situations et des personnages, est sans nul doute de ces livres dont on se dit que l’auteur y a déposé son âme, et sa fantaisie.
Une offrande sans componction, la transmission d’un feu de vie dans une ébriété du style relevant à certains moments de la sprezzatura stendhalienne.
Le Trésorier-payeur est un livre sur la dépense, sur le plaisir, sur les lieux fondateurs.
Un livre constellé de femmes et de gouttes de rosée, d’éclats d’or et de vide, de rire et de folie.
C’est un traité d’économie générale – la ruine et la consumation comme vérités dernières de l’économie – avec des personnages ardents, un jardin merveilleux, une crypte secrète, l’ovale tant désiré d’un visage de femme.
Comme dans tous les grands romans, il s’agit d’une expérience intérieure, d’un apprendre à vivre enfin, mieux encore d’une initiation menant à des mystères que seuls les lecteurs ayant déposé leur armure forgée par les conditionnements sociaux pourront pleinement accueillir.
A partir d’un texte écrit pour une exposition à laquelle Yannick Haenel a participé à LaBanque de Béthune en 2016 – commissariat Léa Bismuth – questionnant sous la forme d’une mosaïque d’œuvres radicales et superbes (Antoine d’Agata, Kendel Geers, Laurent Pernot Anne-Lise Broyer, Eric Rondepierre, Michel Journiac, Pierre Klossowski, Clément Cogitore, mounir fatmi, Benoit Huot…) la notion de dépense, l’auteur de Introduction à la mort française (2001) a imaginé le destin d’un jeune philosophe devenu banquier portant le même nom que celui du génial animateur des revues Documents et Acéphale, et cherchant à « assigner des fins splendides à l’économie » – un nom qui par ailleurs, fait extraordinaire, fut aussi celui du trésorier de l’institution entre 1999 et 2007.
Don, dilapidation, gratuité.
Sacrifice, énergie, sang.
Rencontre, chance, richesse.
« La seule vraie dépense, c’est la disparition », mais qui « laisse toujours derrière elle les poubelles d’une vie », un reste qui peut-être unit.
Dans la première partie de son livre (XXIe siècle), Yannick Haenel rappelle sur le ton de la confidence alerte, en une cinquantaine de pages, la portée destinale d’une exposition ayant eu lieu dans la totalité de l’espace d’une banque transformée en un centre d’art regardé comme un château shakespearien habité par une chouette appelée dame blanche, mais aussi la façon dont son dispositif romanesque s’est constitué, notamment à partir de la rencontre des membres de la confrérie des Charitables de saint Eloi qui depuis la peste du XIIe siècle et encore aujourd’hui s’occupe d’enterrer les morts après avoir porté dans la ville leur cercueil.
La deuxième partie (fin du XXe siècle) commence par un baiser, celui du Trésorier-payeur à son épouse Lilya, dans la saveur duquel le roman s’écrira, et dont il n’est au fond que l’histoire.
Il y a les chiffres, les dossiers de surendettement à traiter, la routine des opérations bancaires, et il y a leur envers, l’amour fou, la rencontre des sexes, l’existence poétique, la présence subtile des oiseaux.
L’homme qui aimait les femmes – le motif truffaldien irrigue le livre – ne souhaitait finalement s’unir qu’à l’ultime, l’accomplie, miracle d’une apparition ayant eu lieu dans un cabinet dentaire entre les photographies du Pavillon d’or et du Pavillon d’argent situés à Kyoto, présence physique précédée d’une voix, qui fut celle d’une femme mystérieuse ayant prononcé un éloge de l’amour lors d’un enterrement dans une commune du Nord où l’on ne penserait pas d’abord qu’elle est peut-être l’un des lieux de l’infini.
Etudiant à Rennes aux alentours de 1986 – Yannick Haenel se souvient ici de ses années d’études et de dérives nocturnes dans une ville où la musique jouait un rôle prépondérant –, apprenti philosophe ayant choisi l’économie après avoir vécu une extase devant le portail de la Banque de France de Paris lors d’un stage d’été, Georges Bataille est le nom d’un jeune homme désigné par Minerve ayant eu l’heur d’accéder au cœur même du pouvoir – descendre jusqu’aux réserves d’or de notre pays, puis en revenir, comme on fait l’expérience d’une catabase —, avant que de s’en détourner pour de plus hautes valeurs.
Les personnages défilent, le plaisir de les créer est évident : Rousselier, l’encyclopédiste gouailleur ; l’ami, le double, Jean Deichel, personnage récurrent des romans de Yannick Haenel, fou de littérature ; Charles Dereine, le directeur de la Banque de France de Béthune portant smoking et nœud papillon, mais ne se prenant pas pour un notable, à la différence de son successeur, le méprisant Blagnac ; Vergnier la teigne ; les Walski, couple perdu, sans argent, au bord du suicide, que Bataille héberge dans le royaume de sa maison au jardin édénique ; Yvon Berhier, journaliste retors de La Voix du Nord ; Casabian, le brocanteur haïtien ; Victor Malanga, patron de l’usine locale de l’entreprise Bridgestone.
Et les femmes, pour la plupart irrésistibles : Katia Cremer, la directrice de la communication au charme de succube ; Bénédicte, grande connaisseuse du tableau du Caravage se trouvant à Naples, Les Sept Œuvres de miséricorde, jolie rousse pétillante ne portant pas de soutien-gorge, et ayant vécu une expérience mystique ; Eszter, étudiante comme Bataille à la Business School de Rennes, « Rita Hayworth punk » ; la mutique Valérie Moignard, collègue de travail ; Annabelle la libraire, reine du désir le plus libre déclarant haut et fort : « Quand on jouir, on vide les coffres. » ; Nadège, l’entrepreneuse mélancolique ayant racheté la structure d’Emmaüs à Béthune ; et enfin, la plus importante de toutes, Lilya Mizaki, la femme-amour, dont les grands-parents moururent à Hiroshima.
« Je pense que la caresse est le nom secret du temps, écrit le narrateur en prolongeant une pensée de Nabokov placée en exergue, sa vraie substance, sa matière éblouie. Il y a une douceur intérieure du langage, qui est sa richesse cachée. C’est ce que Lilya et le Trésorier découvraient à travers leurs étreintes. »
Le Trésorier-payeur est un livre dont le lieu central est un tunnel, creusé entre une maison particulière et une banque symbole de l’Etat dans une ville modeste ayant subi lourdement les effets de la désindustrialisation.
« Il se demanda, s’interroge avec lui le narrateur, s’il existait un endroit au monde où la lutte s’interrompt, où les échanges s’arrêtent, où le marché n’existe plus. Etait-ce sous la terre, dans le silence des grottes ? Etait-ce entre les cuisses des femmes ? »
Plus loin : « En fait, il n’allait pas étudier pour comprendre comment on gagne de l’argent, mais pour savoir ce qui gît au fond des grottes. »
Y gît un espace de paix – comme l’extrémité de la cavité où se réfugie le Robinson de Michel Tournier -, mais y gît aussi un tombeau d’où ressusciter, lieu d’accès aux royaumes souterrains peuplés de lingots d’or transformés par la logique de la dette exponentielle voulue par le capitalisme de la finance débridée en purs chiffres de néantisation (faire crever les pauvres sous le poids d’une faute originelle – manquer d’argent – les réduisant, par l’effet mécanique de son alourdissement, à la vie nue, puis à la mort).
Il faut un trou, un territoire préservé où offrir aux dieux la chance de se révéler, et aux êtres d’aller se renouveler au contact de leur nuit originelle.
On lit dans Le Trésorier-payeur, comme dans chacun des livres de Yannick Haenel, des phrases qui sont des joyaux de vérité, à considérer comme des mantras, ou des prières inversées : « Toujours le calcul prélude aux orgies de mort. » ; « Le monde est en proie à des attaques qui sont invisibles. » ; « Le monde vivait à l’intérieur d’une crise qui avait fini par l’avaler : il n’y avait plus de monde, juste une interminable crise – et pire qu’une crise : un krach. » ; « Car la crise, depuis le 15 août 1971 [jour où Nixon décide de suspendre la convertibilité du dollar en or, ouvrant le marché à la spéculation illimitée], avait pris la place du monde, elle avait pris toutes les places, il n’en existait plus aucune autre, il n’y avait plus que la crise, il n’y avait plus que le 15 août 1971. » ; « La société ne cesse de dépouiller ceux qui n’ont rien ; elle veut, en leur prêtant l’argent qui les asservit, que mêmes les pauvres participent au banquet funèbre de la dette : ce fonctionnement s’appelle l’économie. » ; « Selon lui, le capitalisme reproduisait obscurément à travers son mécanisme la plus antique des procédures, c’est-à-dire le sacrifice. Il lui fallait sa part de victimes. L’objet du capitalisme, c’est le profit ; et la part inavouable du profit, c’est la mise à mort. »
Mais ce livre est aussi un éclat de rire continu, une immensité de joie déchirant le calcul, la possibilité de l’amour comme force alchimique universelle.
Le père d’Anne de Bretagne put déclarer, solennel et heureux : « Amis, vous qui m’écoutez, sachez-le, il n’est trésor que de liesse. »
Une féérie de liesse tentant le dépassement de la métaphysique de l’argent par l’amour, tel est Le Trésorier-payeur.
Il sera lu, mais il faudra le relire souvent, pour ne pas oublier que la dépense est aussi charité.
Fabien Ribery, L’intervalle, 18 août 2022.


Yannick Haenel : la nuit transfigurée

 Un bain de sang. Celui du massacre en 2015 des journalistes de Charlie Hebdo, puis des victimes de l’Hyper Cacher et de Montrouge, soit 17 morts. Le romancier-essayiste Yannick Haenel — chroniqueur du procès qui se déroula du 2 septembre au 10 novembre 2020 — revit des semaines durant la scène de crime de Charlie. Il rédigeait chaque nuit sa chronique du procès, tant pour le journal (comme l’avait souhaité Riss) que pour le site. Les caméras de surveillance montraient l’arrivée des assassins cagoulés de noir. Ces images matérialisaient un cauchemar récurrent attaquant la psyché de Yannick Haenel et coupant en deux « époques » — à jamais distinctes (avant/après) — la vie et l’imaginaire de cet auteur ultrasensible comme tous les artistes, mais plus encore : « Il est nécessaire que nous continuions à tendre vers la lumière, même lorsqu’elle est complètement éteinte, parce que l’obscurité profite de nos moindres distractions : elle veut vivre à notre place, et lorsqu’elle y est parvenue, elle nous expulse », disait Yannick Haenel dans son précédent roman au titre Proustien : « Tiens ferme ta couronne » (Gallimard/ L’Infini — finaliste du Goncourt et Prix Médicis 2019) . « Comment écrire après que l’horreur a fait taire les mots ? », s’interrogea Yannick Haenel lorsqu’il fut victime du syndrome de la page blanche. Traumatisme qu’il parvint à dominer via la parution d’un essai :« Notre solitude » (éditions « Les Échappés).
Un bain de sang. Celui du massacre en 2015 des journalistes de Charlie Hebdo, puis des victimes de l’Hyper Cacher et de Montrouge, soit 17 morts. Le romancier-essayiste Yannick Haenel — chroniqueur du procès qui se déroula du 2 septembre au 10 novembre 2020 — revit des semaines durant la scène de crime de Charlie. Il rédigeait chaque nuit sa chronique du procès, tant pour le journal (comme l’avait souhaité Riss) que pour le site. Les caméras de surveillance montraient l’arrivée des assassins cagoulés de noir. Ces images matérialisaient un cauchemar récurrent attaquant la psyché de Yannick Haenel et coupant en deux « époques » — à jamais distinctes (avant/après) — la vie et l’imaginaire de cet auteur ultrasensible comme tous les artistes, mais plus encore : « Il est nécessaire que nous continuions à tendre vers la lumière, même lorsqu’elle est complètement éteinte, parce que l’obscurité profite de nos moindres distractions : elle veut vivre à notre place, et lorsqu’elle y est parvenue, elle nous expulse », disait Yannick Haenel dans son précédent roman au titre Proustien : « Tiens ferme ta couronne » (Gallimard/ L’Infini — finaliste du Goncourt et Prix Médicis 2019) . « Comment écrire après que l’horreur a fait taire les mots ? », s’interrogea Yannick Haenel lorsqu’il fut victime du syndrome de la page blanche. Traumatisme qu’il parvint à dominer via la parution d’un essai :« Notre solitude » (éditions « Les Échappés).
Lorsque l’on sait ce qui précède, on comprend mieux l’exultation créative animant le nouvel ouvrage de Yannick Haenel : « Le Trésorier-payeur ». "Chacun mène comme il le peut le mystère de sa propre existence ; notre blessure s’apaise ou s’infecte, selon la manière dont nous considérons notre âme. Mais il arrive un moment où chacun de nous parvient à se cacher non plus dans l’obscurité, mais dans la lumière, et il ne faut pas rater ce rendez‐vous." Publié ces jours-ci sur plus de quatre-cents pages, truffées de clins-d’œil, simulacres et faux-semblants (destinés à nous lecteurs aussi bien qu’aux proches de Yannick Haenel), l’auteur mariant avec un art consommé le vrai et le faux, le réel et l’imaginaire, vérités et mensonges. Le « Trésorier-payeur » joue avec les apparences pour installer un texte fou construit par un géomètre-expert des Arts et Lettres. Une fiction aux trouvailles superbes pour ce qui est de l’écriture, une leçon de profondeur, donc de style. Comme si la mort que l’auteur affronta longtemps dans son précédent livre l’avait libéré de toute pudeur, scrupule, réserve, crainte, comme si tout à coup le romancier brisait le lien qui — sans doute et en secret — le tenait imperceptiblement prisonnier ; un lien certes, ténu, mais ligotant l’âme tout de même.« Il fallait rompre le maléfice : la mort ne pouvait avoir le dernier mot. L’écriture toujours a le dernier mot ». Pour triompher de l’impuissance à écrire (cf. les images des assassins jaillies des caméras de surveillance et la scène de crime à la rédaction de Charlie-Hebdo), Yannick Haenel s’est souvenu que dans le processus d’écriture, il faut toujours vaincre un obstacle « sinon, le récit est sans intérêt ». Comme si le langage étant empreint d’une dimension sacrée (cf. « La maison de l’être » selon Heidegger ; comme si délivré du mal, en mémoire des morts, et pour tous les morts qui viendraient, l’écrivain-philosophe regardait en face sa littérature, soutenant son regard et ne cillant pas, car audacieux, effronté, osant tout. Comme si — enchanteresse enchantée —, la littérature lui rendait mieux que jamais son amour, révélant ainsi la supériorité de Yannick Haenel sur la scène littéraire française.
« J’écris pour qui, entrant dans mon livre, y tomberait comme dans un trou et n’en sortirait plus », déclara Georges Bataille (1887-1962) à propos de son ouvrage « L’expérience intérieure » (Gallimard). « Endurer la tragédie en pilotage automatique » dit Yannick Haenel, l’un des plus fervents lecteurs de Bataille .Pour ne pas mourir à soi-même, écrire encore et toujours, écrire pour les morts et pour que vivent en chacun d’entre nous, lecteurs du « Trésorier-payeur » cet esprit de liberté, cette audace, ce culot qu’avait dans chacun de ses livres Bataille, le transgressif, et qu’ont forcément aussi, contaminés qu’ils sont par la liberté et la beauté des textes, les lecteurs de « Histoire de l’œil », « Le Bleu du ciel », « Madame Edwarda », "L’Impossible", "Ma mère". « Quant au portrait du « Trésorier-payeur, » j’hésite à en parler. Je voudrais que mon récit se substitue, en un sens, au visage de Georges Bataille ». Il faut refuser l’ « obscurité ». Yannick Haenel est un fin connaisseur du mythe de la Caverne et de Platon. Chacun de ses romans offre une vision critique de l’époque et de sa cupidité (le personnage principal refusant le « système ») et entreprend une louange passionnée de l’Art, en particulier la littérature. Celle-ci est pour Yannick Haenel — comme elle le fut pour Georges Bataille (le vrai) : « L’héritière des religions ». Il y a en effet du sacré dans chaque écrit exprimant par la beauté du verbe une poésie porteuse de sens, et ouvrant La Caverne. Yannick Haenel rend au passage hommage à Shakespeare, Melville, Joyce, Rimbaud, Dante — et à la Bible que l’auteur chérit tout autant. Illusions comiques la vie ! Trucages le décor ! Le réel d’une banque n’existe que dans la fiction. Dans Le Trésorier, le personnage principal est banquier à Béthune, dans une succursale de la banque de France et se nomme… Georges Bataille. Nous savons alors que le circuit romanesque va secouer fort nos petites âmes fatiguées. Il ya par exemple, déguisé en personnage, Philippe Sollers le « patron » de « l’Institut des Arts », initiateur en chef, magicien qui parle couramment tous les arts. « Philippe Massardier (…) avait la souveraineté malicieuse de celui qui a les clefs du château ; non seulement il jouait pour nous le rôle de guide, voire de pilote, et tout en ouvrant les portes, nous racontait des histoires, petites et grandes, de ce lieu, mais il nous introduisait dans l’épaisseur du temps : toute architecture est d’abord spectrale, et je me disais, en marchant sagement derrière le maître des lieux, qu’il me fallait écouter des fantômes. »
Dans la vie, Philippe Sollers est l’éditeur de Yannick Haenel, son ami et père spirituel en quelque sorte. Le Trésorier-payeur qui porte le nom de Bataille est un banquier qui aime tellement la littérature qu’il préfère les mots aux maux induits par le règne des banques. La dépense, c’est son rêve. S’emparant ici ou là de la pensée du vrai Bataille, Haenel la met en pratique. Il théâtralise cette pensée. Albert Cohen — auquel on songe parfois dans la richesse et l’ampleur du texte — aurait aimé ces pages où rayonne l’amour des protagonistes : Georges Bataille et Llya. « C’est seulement dans l’amour qui les embrase qu’un homme et une femme sont aussitôt silencieusement, rendus à l’univers. L’être aimé ne propose à l’amant de l’ouvrir à la totalité de ce qui est qu’en s’ouvrant lui-même à son amour, une ouverture illimitée n’est donnée que dans cette fusion, où l’objet et le sujet, l’être aimé et l’amant cessent d’être dans le monde isolément-cessent d’être séparés l’un de l’autre et du monde, et sont deux souffles dans un seul vent » .Yannick Haenel aime mêler les personnes véritables à ses personnages, donnant ainsi la parfaite recette de l’art romanesque. « Au moment où il me révéla ce détail, il se tourna brusquement vers moi, un éclat ironique passa sur son visage ; il vit que j’avais vu — je compris que son objectif était atteint : il avait déclenché ma curiosité, un roman scintillait, j’étais pris. » « Le roman qui « scintillait » dans l’imaginaire du narrateur est celui que nous lisons. L’une des parutions les plus importantes de cette rentrée.
Comme font souvent les grands livres, le roman de Yannick Haenel livre un secret. Un secret concernant le temps — qui gouverne tout, dans la vie comme chez Proust — et concernant aussi l’amour (cf. le désir) – qui nous gouverne tous : « La caresse est le nom secret du temps, sa vraie substance, sa matière éblouie. Il y a une douceur intérieure du langage qui est sa richesse cachée, c’est ce que Lilya et le Trésorier (voir nos extraits ci-dessous) découvraient à travers leurs étreintes. »
« La Littérature peut tout, comme l’amour » conclut Yannick Haenel. La sienne est foisonnante, touffue telle une forêt qui ne brûlerait jamais. Yannick Haenel nous le chuchote à l’oreille : Le Trésorier-payeur c’est l’artiste jouant au banquier pour faire semblant de suivre le rythme de l’époque, — la nôtre étant intéressée, c’est-à-dire cupide, avide, vide. Au lieu de compter, de thésauriser, le banquier Bataille désire : il songe à l’amour ; c’est un doux, le désir est son chemin (« Heureux les doux, ilsrecevront la terreen héritage » chapitre 5, verset 1-12/Matthieu).
Par la volonté de l’auteur, le lecteur du « Trésorier-payeur » est mis dans la confidence et « initié » ; « au courant » de tout, il refusera les pièges de l’époque. Se passionnant seulement pourla bonté (la charité), il chérira les cœurs-à-corps : aucune faute, l’amour partagé et deux adultes consentants. Dans le même mouvement, cet « informé » sera parfois perdu, paumé, largué, tel ce petit enfant que nous sommes tous en secret. Yannick Haenel le sait : « la littérature redonne vie, la Mort est vaincue par le langage. » Bravo.
Annick GEILLE, atlantico, 21 août 2022.
Extrait IV
(Rappel : le personnage principal du roman de Yannick Haenel « Le Trésorier-payeur » s’appelle Georges Bataille, comme l’écrivain NDLR).
Les présages
« Entre octobre 1987 et juin 1990, Georges Bataille étudia à la Business School de Rennes. À l’époque, le mot « business » le faisait déjà rire ; et il ne parvint jamais à prendre tout à fait au sérieux cette activité, qui pourtant dirige le monde. Ses camarades avaient le goût des affaires, ce qui semble logique puisqu’ils avaient choisi cette voie ; mais lui, quoi qu’il fît pour se persuader que l’enrichissement était l’objet de tout échange, demeurait un philosophe, et voyait dans la richesse une vertu très secondaire et dans le profit, un vice ; il apprit néanmoins les arcanes de l’économie à sa manière, parce qu’il était résolu à se perfectionner dans cette matière qu’il estimait fondamentale et réussit, en se forçant, à s’initier aux labyrinthes de la finance.
Quand il parlait à Lilya de cette période de sa vie, qui fut riche en péripéties et détermina certaines de ses passions, il n’oubliait jamais de préciser que son premier jour dans l’école avait coïncidé avec un orage et un krach, ce qu’il avait interprété comme un présage ironique : les dieux accueillent ainsi le début dans la vie des illustres Romains, en faisant s’effondrer des étoiles sur leurs têtes.
Les nuages dans le ciel de Rennes se déchiraient ainsi ce soir‐là comme s’ils promettaient une révolution. Bataille avait une chambre à la sortie de la ville, sur la route de Fougères, la même depuis trois années ; un lit, un bureau, un lavabo, neuf mètres carrés à l’intérieur desquels s’était élaboré son monde solitaire, rempli de livres, de disques et de cahiers qui s’entassaient à même le sol. Les murs étaient couverts d’inscriptions à l’encre rouge : des phrases, des noms propres, des diagrammes que Bataille avait disposés comme autant de fragments d’une mosaïque dont lui seul possédait la clef. On sait qu’il prenait continuellement des notes sur ses lectures, et leur accordait la valeur d’un trésor (son stock d’études, disait‐il) ; ainsi sa chambre s’organisait‐elle à la fois comme une réserve de livres et comme le lieu où s’élabore leur culte : il faut imaginer Bataille écrivant sur le mur comme un adepte cherchant l’équation de l’univers.
Il avait pris l’habitude, après les cours en classes préparatoires, puis plus tard en licence de philo, d’étudier dans sa chambre jusqu’au dîner, après quoi il venait lire À la Belle Étoile, une brasserie en bord de route où il se sentait bien : la patronne, une robuste blonde qui accueillait les routiers avec chaleur, choyait « son étudiant », à qui elle offrait souvent le café. Parfois il dînait là, seul, quand il avait envie d’un steak, et qu’il lui restait un peu d’argent. Et malgré les conversations animées, malgré le boucan de la télévision, il parvenait à lire, et même à être heureux.
C’est là, à deux minutes à peine de sa chambre, que durant trois années, tous les soirs, de 20 heures à 23 heures, il avait lu avec application Nietzsche, puis Spinoza, puis Hegel ; et c’est là que, le 19 octobre 1987, avec les deux mille pages du Capital de Marx ouvertes devant lui, il apprit que l’indice Dow Jones de la Bourse de New York avait perdu 22,6 %, ce qui constituait la deuxième plus importante baisse jamais enregistrée sur un marché d’actions, et allait provoquer une telle panique dans les milieux boursiers qu’on qualifierait cette journée d’octobre de « lundi noir », en référence au « jeudi noir » du 24 octobre 1929, première journée du krach de la Bourse de New York, qui fit entrer les États‐Unis dans la Grande Dépression.
Alors qu’il regardait ce soir‐là le journal de 20 heures sur l’écran de télévision fixé au bout du comptoir, et que les commentateurs économiques soulignaient l’ampleur et la gravité de cette crise qui était plus qu’une crise, et dont il était impossible encore de mesurer les conséquences, lesquelles seraient très certainement catastrophiques non seu‐ lement pour les banques mais pour tous les particuliers qui avaient un compte, le tonnerre éclata avec une violence telle que Bataille vit clairement la foudre jaillir au‐dessus de la ville et composer dans un ciel blanc d’abominables figures de mâchoires.
L’effondrement des mondes étoilés se fera, comme la Création, dans une grandiose beauté. Qui a dit cela ? Le ciel se déchirait, les plombs sautèrent et la lumière s’éteignit dans le café. Tandis que les clients râlaient, Bataille, debout face à la vitre où se déchaînaient des feux blanchâtres, exultait, comme si l’on saluait personnellement son entrée dans un monde interdit.
Le lendemain, aucun professeur n’y fit allusion, et ceux que l’on sollicita se montrèrent réticents. Bataille trouva surprenant, voire scandaleux, qu’on coupât ainsi l’enseignement économique de ce qui arrivait réellement au monde, comme si les combinaisons du capital formaient une sphère séparée, dont les rouages, le fonctionnement et la connaissance étaient réservés à une élite qui tirait profit de ses privilèges et s’en partageait le considérable butin.
Il était clair qu’une chose folle se déchaînait au cœur du marché, et qu’un tel événement débordait le secteur du calcul ; il en avait perçu la menace dans le ciel où, à travers les exubérances de l’orage, s’écrivaient en réalité des turbulences qui affecteraient la terre entière.
Bataille avait noté dans ses cahiers que toujours le calcul prélude aux orgies de mort. Et c’était ça, pour lui, l’économie : le cœur ardent, explosif, du fonctionnement mondial ; alors si quelque chose n’allait pas, si la machine se grippait, c’est que se préparaient des choses obscures, sans doute dangereuses, en tous les cas passionnantes.
Qu’on voulût, à l’école, masquer cette part ténébreuse et occulter le monstre renforçait sa détermination : il avait compris que les places boursières contenaient la chaudière de l’enfer ; et même si personne ne voulait voir les flammes qui s’en dégageaient, la chaudière fonctionnait bel et bien : non seulement elle n’était pas tombée en panne, mais son grondement en révélait la surchauffe. À travers elle se consumaient la vérité du krach de Wall Street et celle des prochains krachs, tous les krachs qui ne manqueraient pas d’avoir lieu, car telle était désormais la tournure qu’avait prise le monde des échanges.
Ce qui nous arrive réellement se déchiffre comme un maléfice car le monde est en proie à des attaques qui sont invisibles : c’était, en gros, ce que pensait Bataille, mais il se contenta, la première année, d’étudier sagement le marketing international, la finance d’entreprise, le contrôle de gestion et le fonctionnement bancaire – celui des banques d’affaires et celui des banques d’épargne.
Comme il venait d’une filière littéraire, il avait dû rattraper son retard dans certaines matières, mais il apprenait vite. Il crut mourir d’ennui pendant les cours de comptabilité, qui occupaient chaque semaine un nombre d’heures considérable. On leur disait en effet que tout se résumait à un exercice comptable, même les opérations boursières. Est‐ce parce que la dette ne fait jamais que s’approfondir ? Ce qui mène les hommes est précisément ce qui leur manque, et qu’ils veulent avoir à tout prix ; ainsi l’argent n’est‐il jamais ni gagné ni perdu, mais continuellement transféré ; et c’est avant tout ce transfert qui fonde ce que les manuels auxquels s’astreignait Bataille nomment l’économie.
Il n’avait avec ses camarades que très peu de rapports ; d’ailleurs aucun d’eux ne se souciait vraiment du sens de l’économie, encore moins de sa métaphysique : ils étaient ici pour trouver un métier, c’est‐à‐dire pour gagner de l’argent ; et ce qu’on apprenait dans cette école visait précisément à gagner le plus d’argent possible. Ainsi adhéraient‐ils en toute innocence à cette rapacité spéculative qui prévalait chez les golden boys de Wall Street, lesquels étaient capables d’empocher des millions de dollars en quelques secondes grâce à d’ingénieux montages financiers : le film Wall Street d’Oliver Stone exerçait alors une influence considérable, et il n’était pas difficile de comprendre que le personnage de Gordon Gekko, le trader sans scrupules joué par Michael Douglas, était leur modèle. D’ailleurs, la plupart de ceux qui s’étaient inscrits dans cette école l’avaient fait après avoir vu ce film, ainsi les écoles de commerce du monde entier n’avaient‐ elles aucun besoin de faire de la publicité : le personnage de Michael Douglas était leur meilleur agent recruteur.
Si les professeurs dénigraient ces dérives dont le cynisme leur paraissait une trahison des idéaux du commerce, la plupart des étudiants s’identifiaient aux jeunes loups de Wall Street, le plus souvent d’une manière superficielle, mais les rares qui avaient conscience de la crapulerie en admiraient l’insolence, en laquelle ils voyaient le comble de la classe.
Bataille comprit vite que l’énergie avec laquelle il plongeait dans l’économie lui faisait du tort car elle paraissait excessive aux autres : sa passion intellectuelle était perçue comme un zèle fâcheux par ses camarades qui, de leur côté, se contentaient d’un savoir moyen dont s’accommodaient leurs professeurs : ils auraient leur diplôme et seraient embauchés dans des entreprises performantes, alors à quoi bon projeter sur ces matières une radicalité qui les rendait inquiétantes ?
Mais c’est surtout parce qu’il n’allait pas à leurs fêtes qu’il passa pour un type négligeable : dans ce genre d’école, il est de bon ton d’avoir l’air décontracté, festif et nonchalant, quitte à simuler l’insouciance ; les étudiants passent leur temps à faire savoir bruyamment qu’ils ne travaillent pas : être pris pour quelqu’un de besogneux est un péché capital.
Ces fêtes étaient le plus souvent des prétextes à beuverie, et les étudiants s’y défoulaient selon la tradition, c’est‐ à‐dire jusqu’à des extrémités vomitives ; elles possédaient aussi une fonction sociale, car celui qui s’y révélait grand fêtard était reconnu comme un des leurs, il était désormais admis et considéré.
Il aurait sans doute été facile pour Bataille, qui aimait tant boire et se griser d’oubli, de rompre avec son humeur dédaigneuse, de se mêler à ses camarades à travers l’alcool et la danse, et de se faire accepter par eux en les étonnant grâce à son usage extrême de la nuit, mais son orgueil le retenait. Quelque chose de farouche s’opposait en lui aux sympathies ; il avait pris des habitudes de loup ; et les soirs de fête, il s’obstinait à étudier, plus durement encore que les autres jours.
Bref, il les trouvait puérils et leur tourna le dos ; il se foutait complètement d’être intégré et ne cherchait qu’à s’initier. Sa solitude ne fit alors que s’accroître et ses rapports avec les autres devinrent fantomatiques.
Il y eut de longues périodes de découragement : rien de plus fermé que cet univers comptable où l’esprit se réduit à la pesanteur qui l’accable. Bataille se maudissait de toujours choisir des directions contraires à la facilité, mais il tenait bon.
À force de l’étudier si scrupuleusement, l’économie s’était mise à lui apparaître comme une chose de l’esprit qui, au lieu de le relier, le coupait des autres, car il s’y vouait avec l’assiduité des mystiques.
Il lui arrivait de plus en plus souvent de passer la nuit à lire, allongé sur son lit, fumant, buvant du café jusqu’à l’aube, après quoi il se préparait pour aller en cours comme si de rien n’était ; il lisait avant tout les économistes, Schumpeter, Keynes, Marx et von Mises, et même si ces lectures étaient austères, la plus morne théorie du crédit prenait chez lui tournure enflammée, et ouvrait à Bataille une région spéciale de la solitude qui l’accordait à une extase désertique : plus il lisait, plus la nuit s’éclairait ; et il lui semblait qu’elle produisait alors sa propre matière, une substance nacrée qui ressemblait à la manne que Dieu envoie aux Hébreux.
Ainsi lui arrivait‐il vers 3 heures du matin, vers 4 heures, vers 5 heures, d’approcher ce qui reste à atteindre lorsque tout a été atteint et de s’introduire dans un espace qui fait taire le silence lui‐même. C’était une expérience qu’il menait sur son esprit, dont il cherchait chaque nuit à reculer les limites. Le savoir est au fond intolérable, c’est pourquoi on ne peut lui résister ; et s’il arrive que la pensée la plus rigoureuse se retrouve au bord de sa propre béance, n’est‐ce pas alors qu’elle s’accomplit ?
À partir d’un certain point, toute chose s’efface au profit de la vérité, et à travers son extase Bataille était emporté dans la splendeur intérieure d’un univers coloré. Il y a une petite lumière bleutée qui clignote au fond de chaque instant ; tant qu’on la voit, on est en vie, on a sa solitude. Des gouffres d’azur et des étincelles défilent. Les yeux flambent dans un clair déluge. On met alors sa confiance dans la direction qui nous appelle et la nuit, doucement, s’efface.
En sortant dans la rue le matin pour aller en cours, il se sentait flotter dans les airs ; la nuit blanche l’entourait comme un foulard de soie, lui donnant l’allure d’un prince qui revient d’une aventure.
p. 159-167.

Extrait V
« Dans l’amour, elle était aussi tendre qu’entreprenante »
Les jours suivants, leurs étreintes prirent des formes intrépides. Ils ne s’arrêtaient plus. Le corps de Lilya était fait pour lui, et le sien pour elle : dans les bras l’un de l’autre, ils s’étreignaient durant des heures. Le Trésorier s’étonna d’être aussi endurant : à peine avait‐il joui qu’il recommençait. Lilya était si langoureuse avec lui qu’il lui arrivait de jouir cinq fois en deux heures. Dans l’amour, elle était aussi tendre qu’entreprenante ; ses gestes étaient délicats et follement crus. Elle était capable de s’aban‐ donner merveilleusement, comme seules les vraies amoureuses ; puis de s’activer sur le plaisir du Trésorier avec une lubricité passionnée. Quand elle jouissait, de petits soupirs s’échappaient de ses lèvres qui prenaient une couleur pâle, celle qui m’obsède depuis que j’ai commencé à écrire ce livre – celle, un peu laiteuse, que prend le ciel au moment d’un orage.
A chaque flash du plaisir entre les bras du Trésorier, et sans doute en solitaire, deux doigts glissés entre ses cuisses, Lilya rejoignait un point qui la hantait. En s’absentant ainsi, mieux qu’à travers l’ivresse ou le sommeil, elle voyait passer furtivement le sourire de ses grands‐parents bien‐aimés que la bombe tombée sur Hiroshima avait effacés. Elle disait « effacer » parce que leurs corps avaient disparu. Il lui était impossible de se figurer cet affreux prodige : qu’un corps ait pu exister et qu’il n’en restât nulle trace, qu’en une seconde il passât de la présence à l’absence, cela l’obsédait.
Lorsqu’elle en parla au Trésorier, il lui sembla que sa voix retrouvait les accents qu’elle avait eus devant la tombe de Charles Dereine. Que faisaient ses grands‐parents le lundi 6 août 1945 à 8 h 15 du matin sur la plage d’Hiroshima, juste en face de l’île sacrée Miyajima ? Ils avaient vingt ans, se tenaient la main, s’embrassaient sur la plage ; ils venaient d’avoir un enfant, une petite fille qu’ils avaient laissée quelques jours à la famille afin de se purifier selon le rite shinto. On avait dit à Lilya que le sanctuaire gardait la mémoire des bénédictions et que leur nom y était inscrit.
Lilya dit que cette petite fille était sa mère. On envoya celle‐ci en Europe, elle grandit à Londres, puis à Paris sous la protection d’un oncle qui travaillait à la Maison de l’UNESCO. Elle rencontra un chirurgien, avec qui elle eut une fille ; le chirurgien était marié, il ne reconnut pas l’enfant et décampa. C’est ainsi que Lilya ne connut jamais son père, et qu’elle vécut dans le culte transmis par sa mère, celui de ses grands‐parents dont les cendres s’étaient évanouies dans la poudre du temps.
Sa mère lui avait donné leur photographie ; et elle confia ce soir‐là au Trésorier qu’il lui arrivait de voir leur visage au moment de jouir : l’éclair du plaisir était parfois si déchirant qu’il ouvrait en elle une brèche où elle les rejoignait.
Et puis, Lilya était tourmentée par l’emprise que Malanga exerçait sur elle. Cet homme à qui rien ne résistait, et qui dirigeait la filiale française d’une firme leader mondial de la fabrication de pneumatiques, avait jeté son dévolu sur elle, l’avait demandée en mariage, et lorsqu’il s’absentait de Béthune pour aller à Paris ou à Nashville, où Bridgestone avait son siège social, il la faisait surveiller.
Il avait rencontré Lilya un an plus tôt, le soir de l’inauguration de « La Piscine », le musée de Roubaix, lors du spectacle des derviches tourneurs de l’orchestre Al‐Kindi, venus de Damas, dont Bridgestone avait assuré le mécénat ; et ils avaient alors entamé ce que Lilya appelait une « relation tumultueuse ».
Elle avait refusé la demande en mariage de Malanga, ce qui rendait celui‐ci furieux : la violence de cet homme n’avait fait que grandir au fil des mois, et s’il ne la dirigeait pas contre Lilya, elle prenait néanmoins des formes dangereuses, car Malanga ne mettait jamais aucune limite dans ses désirs, et imposait depuis le début ses choix à Lilya : ainsi, quand il revenait de ses séjours autour du monde, devait‐elle se plier à sa volonté. Cet homme s’était entiché de la plastique de Lilya et n’avait qu’une obsession : pouvoir disposer d’elle à sa guise.
Elle avait bien essayé plusieurs fois de mettre fin à cette relation qui la rendait malheureuse, mais les histoires où l’un domine l’autre n’en finissent jamais, et ainsi ne pouvait‐elle accéder réellement à la liberté qu’elle convoitait : toujours cet homme pouvait surgir et réduire à néant son indépendance.
La rencontre avec le Trésorier était donc une belle surprise ; et si, au début, elle avait imaginé qu’elle ne partagerait avec cet homme que des moments agréables, elle fut vite intriguée par sa douceur, sa délicatesse, sa manière limpide et attentive d’aimer. L’absence de rapports de force l’avait d’abord déconcertée, car elle était tellement habituée à la violence qu’elle ne pouvait que trouver inconsistante une personne qui lui voulait du bien. Mais très vite, la joie sexuelle s’était élargie à tout son être, et chaque fois qu’elle faisait l’amour avec le Trésorier, elle y trouvait non seulement un plaisir qui s’amplifiait à chaque rendez‐vous, mais une vérité : elle découvrait que les matins, les après‐midi, les soirs, les nuits, tout pouvait prendre couleur de flamme et scintiller comme un poème ; elle comprenait que l’amour pouvait rendre heureux. »
p. 397-400.



Yannick Haenel : écrire, jouir et vider les coffres (Le Trésorier-payeur)
 « Les intellectuels ne se promènent pas torse nu, ils meublent leur appartement avec soin et se battent pour le pouvoir ; lui semblait flotter comme un ange à l’intérieur du monde des idées. » Tout Yannick Haenel se tient dans cette description du Trésorier-payeur, le prodigieux personnage qui donne son titre à un roman qui transcende la rentrée littéraire. Cinq ans après Tiens ferme ta couronne qui obtint le prix Médicis, l’écrivain flotte en majesté à l’intérieur du monde des idées : il tient chaque semaine une chronique dans Charlie Hebdo dont il a suivi l’historique et intense procès (deux livres en sont nés, Janvier 2015, le procès et Notre solitude), il a composé des ouvrages majeurs sur l’histoire de l’art ancien et contemporain (La solitude Caravage, Adrian Ghenie) et a écrit un texte d’opéra moderne (Papillon noir). Le Trésorier-payeur marque donc le retour aux affaires romanesques pour Haenel qui s’explique sur la genèse de son arc narratif dans une première partie éblouissante ; le livre débute en effet par une explication-confidence proprement géniale, aussi éloignée que possible de l’autofiction, elle répond tout simplement à la question cruciale : qu’est-ce qu’un écrivain ? Il est, Haenel est, celui qui peut à la fois vivre et dire une stance de patience spéciale : « En toute occasion, j’attends ce trouble qui déclenche les romans » — celui qui voit en un éclair les lignes avant de les coucher sur le papier.
« Les intellectuels ne se promènent pas torse nu, ils meublent leur appartement avec soin et se battent pour le pouvoir ; lui semblait flotter comme un ange à l’intérieur du monde des idées. » Tout Yannick Haenel se tient dans cette description du Trésorier-payeur, le prodigieux personnage qui donne son titre à un roman qui transcende la rentrée littéraire. Cinq ans après Tiens ferme ta couronne qui obtint le prix Médicis, l’écrivain flotte en majesté à l’intérieur du monde des idées : il tient chaque semaine une chronique dans Charlie Hebdo dont il a suivi l’historique et intense procès (deux livres en sont nés, Janvier 2015, le procès et Notre solitude), il a composé des ouvrages majeurs sur l’histoire de l’art ancien et contemporain (La solitude Caravage, Adrian Ghenie) et a écrit un texte d’opéra moderne (Papillon noir). Le Trésorier-payeur marque donc le retour aux affaires romanesques pour Haenel qui s’explique sur la genèse de son arc narratif dans une première partie éblouissante ; le livre débute en effet par une explication-confidence proprement géniale, aussi éloignée que possible de l’autofiction, elle répond tout simplement à la question cruciale : qu’est-ce qu’un écrivain ? Il est, Haenel est, celui qui peut à la fois vivre et dire une stance de patience spéciale : « En toute occasion, j’attends ce trouble qui déclenche les romans » — celui qui voit en un éclair les lignes avant de les coucher sur le papier.
Avec ces premières dizaines de pages nous sommes dans le cœur du cœur de la littérature et de son mouvement enroulant, texte et dévoilement de l’origine du texte : « Il n’y a rien de plus beau qu’un roman qui s’écrit ; le temps qu’on y consacre ressemble à celui de l’amour : aussi intense, aussi radieux, aussi blessant. On ne cesse d’avancer, de reculer, et c’est tout un château de nuances qui se construit avec notre désir : on s’exalte, on se décourage, mais à aucun moment on ne lâche sa vision. Parfois un mur se dresse, on tâtonne le long des pierres, et lorsqu’on trouve une brèche, on s’y rue avec un sentiment de liberté inouïe. Les lueurs, alors, s’agrandissent, et c’est toute une mosaïque de petites lumières qui s’assemble peu à peu, jusqu’à former non seulement un soleil, mais aussi une lune : un univers complet, avec ses nuits et ses jours. » La littérature comme monde total ? Lorsqu’elle n’a pas cette ambition, je crois qu’elle se goûte comme un ornement.
Comment s’impose donc ce livre ? On propose à l’écrivain de participer à une exposition dans Labanque, un nouveau centre d’art de Béthune installé dans une ancienne succursale de la Banque de France. Haenel apprend que celui qui y occupait le poste de Trésorier entre 1999 et 2007 s’appelait Georges Bataille. Collusion dans le Temps, naissance du personnage dans l’instant : il porte le nom de l’immense écrivain de la dépense érotique. Nous le suivons dans son évolution au sein de la Banque Nationale depuis son stage et son intégration en 1991 jusqu’à ses actions au sein du Comité national de l’euro où il est chargé de préparer le passage à la monnaie unique avant de le quitter sans prévenir. L’homme est double et trouble. « Le Trésorier-payeur était ainsi de ces êtres impeccables qui à chaque instant voient le monde s’écrouler : un banquier irréprochable, perfectionniste et apprécié de tous pour son dévouement, mais dont les aventures intérieures relevaient d’une apocalypse. » Bataille ne cesse d’opérer comme un infiltré, cette figure foncière de l’écrivain, qui « envisage la dépense, voire la ruine, comme la vérité de l’économie et considère que les richesses appartiennent moins à l’épargne qu’au rite qui les consume. » Il monte de brillants dossiers pour les surendettés, continue son étude profonde de l’économie tout en couchant avec des femmes, découvre un souterrain à haute valeur métaphysique reliant la banque à l’ancienne demeure du Trésorier réel, fait preuve d’une charité sans conditions en hébergeant un couple de polonais puis en rejoignant une confrérie… Sans répit, dans la course d’une dépense de désir, il entre dans la dimension décisive de l’amour, Clarisse, Pauline, Annabelle, Lilya… et accède à des conclusions. Bataille est un érudit, un illuminé, un saint qui, à travers la moindre inclinaison de ses gestes ou de ses silences, fixe le puissant vertige de la circulation étourdissante de l’argent. Il voit que si le capitalisme a maléfiquement unifié le monde, c’est qu’il se tient effectivement en son sein comme une véritable religion. Tout est net, s’éclaire et se dit : « … l’économie s’offrait soudain à lui comme une transcription chiffrée de l’histoire de l’être. »
Comme vous, j’ouvre le journal, je scrolle Twitter et je pioche des idées ; mais en lisant Haenel, j’entre dans un très grand roman qui impose naturellement une ouverture dans cette époque fermée du krach permanent, de la crise lisse parfaitement organisée et de l’injonction nationale quotidienne à éponger une dette. La sordidité est déployée à tous les étages, même dans le ciel. Ce matin justement, je lis que stars et milliardaires se plaignent que des gens sur les réseaux sociaux suivent leurs courts trajets en jets privés et comptent les tonnes de CO2 rejetés à chaque vol alors que la terre suffoque. J’ouvre ensuite au hasard une page du Trésorier-payeur qui m’offre une phrase judicieuse des Évangiles : « Il est plus difficile à un riche d’entrer dans le royaume des Cieux qu’à un chameau de passer par le trou d’une aiguille. » Je ris très haut avant de relire. Le style haenelien s’ouvre dans une célérité illuminée qui relance sans cesse le récit grâce aux combinaisons mentales d’une pensée furtive à même de tout exploser, faisant advenir le simple éclair de la pensée : « Tout s’ouvre avec le feu qui détruit ce qui était ordonné : l’univers est ce chaos d’une chambre d’enfant qui résiste au rangement. » Et ceci, définitif et salutaire, proche d’une formule de la langue classique de Chateaubriand : « La société ne cesse de dépouiller ceux qui n’ont rien ; elle veut, en leur prêtant l’argent qui les asservit, que même les pauvres participent au banquet funèbre de la dette : ce fonctionnement s’appelle l’économie. » De même, sur plusieurs pages, une scène irradiante à étudier dans les écoles de commerce du futur : le jeune Bataille assiste à la visite officielle de Ronald Reagan et de son épouse dans le sous-sol de la Banque de France. Le service de sécurité américain est nerveux, comme la délégation française. Mais tout se calme quand l’or apparaît au fond de la terre, l’argent étant autre chose qu’une valeur. Le personnage assiste à une puissante catabase et au moment où un lingot passe entre les êtres, la petite assemblée de dirigeants entre dans un au-delà de l’hypnose. « Il s’était passé quelque chose de plus sulfureux, de plus dangereux qu’une simple communion dans les jouissances illimitées du profit : en se passant un lingot d’or de main à main, ils participaient à un sacrifice. Ils s’étaient rechargés spirituellement. C’était une messe noire. » Haenel scande aussi l’évolution de ses personnages par l’évocation de dates historiques finement choisies, fidèle à l’exercice fondamental de liberté de la littérature, capable d’apporter la contradiction dans tous les domaines. La fiction croise alors miraculeusement l’histoire quand il est ainsi question du 15 août 1971, jour où le président américain Nixon décida de suspendre la convertibilité du dollar en or. Bataille étudiant parle ainsi devant sa classe : « En fabriquant des dollars sans équivalence avec la quantité d’or entreposée dans leurs réserves, les États-Unis avaient démonétisé la monnaie.(…) Bataille dit que cette date du 15 août 1971 ne faisait pas seulement partie de l’histoire du passé, mais qu’en un sens nous étions à chaque instant le 15 août 1971. Il ajouta que sans doute nous le serions longtemps, car on pouvait estimer que le 15 août 1971 était la date de naissance réelle de la "crise" ; et qu’un tel événement n’avait pas de fin puisqu’il n’était que le masque pervers du système lui-même : à chaque instant nous glissions dans l’abîme que recouvre le mot "crise", et à chaque instant nous tombions dans le trou creusé par le 15 août 1971. » Une date comme un coup de couteau sacrificiel à grande échelle. Puis Bataille est dans un dîner et il nous lance dans les toutes premières journées du 19e siècle en France ; cela saignait déjà. « Le Trésorier-payeur raconta en effet l’origine de la Banque de France. Il dit qu’elle avait été créée le I8 janvier 1800 par Napoléon Bonaparte afin de perpétuer la machine à faire des riches avec le travail des pauvres, et de donner un contenu légal à cette éternelle spoliation. Bonaparte avait été porté au pouvoir par un groupe financier qui n’était pas disposé à s’arrêter de s’enrichir ; et une fois à la tête de l’État, il décida de conférer une légitimité nationale à ce consortium d’hommes d’affaires privées ; son tour de force consista à faire en sorte que l’État français se mette au service d’une banque d’intérêt privé, à l’inverse de ce qui s’était toujours pratiqué. C’était la première fois dans l’histoire de France, dit le Trésorier-payeur, qu’un gouvernement donna de l’argent à une banque d’escompte afin qu’elle puisse exploiter un privilège lucratif, au lieu d’en demander à ses actionnaires pour prix de ce privilège. » Qui peut exposer aussi lumineusement ce crime oublié parce que parfaitement exécuté ? Un énième podcast pompeux sur Napoléon ou la puissance révélatrice de la littérature ?
Il faudrait aussi parler de Charles Dereine, grand banquier lucide sur le Mal, avec lequel Bataille entretient une parfaite distance, celle du respect et de la pudeur ; un personnage qui dédie comme lui son temps à un amour fou et secret pour les femmes. L’amour, cette mesure parfaite et réinventée du poème Génie de Rimbaud, vit dans un pli du monde, à l’abri du bruit. « La société ne comprend rien à l’amour ; elle en parle sans cesse, mais en réalité elle lui est contraire, et blâme ceux qui lui consacrent leur vie, réduisant leur comportement à du donjuanisme. Le Trésorier-payeur se plaisait à croire que Charles Dereine avait vécu scandaleusement sans faire de scandale : en se passionnant avec tant d’ardeur pour des femmes, il s’était rendu disponible à une forme d’adoration. » Je pourrais évoquer aussi la figure de Jean Deichel, alter ego de Haenel dans de précédents romans, qui ici fait signe sous une forme amicale et amplifie autant le récit que l’œuvre entière de l’écrivain comme Zuckerman le fit dans l’œuvre de Philip Roth. Mais il faudrait alors que je pousse le lyrisme jusqu’à suggérer au jury du plus prestigieux prix littéraire de l’automne de célébrer enfin Yannick Haenel. Je me contenterai de déposer aux pieds du lecteur de Diacritik toutes les armes du critique littéraire et de lui dire droit dans les yeux de lire cet immense livre capital.
Arnaud Jamin, diacritik, 22 août 2022.
Vendredi 7 octobre dernier, Yannick Haenel s’entretenait avec Arnaud Jamin autour de son nouveau roman Le Trésorier-payeur à la Maison de la poésie. Dépense, crise, histoire du capitalisme, charité, amour… dans cette vidéo de la soirée, l’écrivain parle longuement du livre que nous avons chroniqué à sa sortie au mois d’août dans la collection l’Infini de Gallimard. Retrouvez ci-dessous la captation vidéo de la rencontre.



[1] Les lecteurs de Charlie Hebdo ont sans doute été étonnés de ne pas lire la chronique de Haenel dans la dernière semaine de juin. Elle était due à une mauvaise chute de vélo ! Mais ce n’est qu’un mauvais souvenir. Dans sa chronique du 6 juillet, Haenel parle de La maman et la putain, le film d’Eustache (un chef-d’oeuvre) et rend un bel hommage à Jean-Louis Schefer décédé le 8 juin. Lire : Guérison du chroniqueur.
[2] LIRE AUSSI : Le récit du « procès Charlie » par Yannick Haenel : une « plongée dans l’espèce humaine et ses abîmes ».
[3] « Je viens d’ouvrir le volume de Georges Bataille. Il écrit : "C’est seulement dans l’amour qui l’embrase qu’un homme est aussitôt, silencieusement, rendu à l’univers." Bataille a raison : dans l’amour, on n’est pas aiguillonné par le manque, au contraire on est enfin comblé – on s’ouvre à l’univers. Le "trouble sentiment de totalité qui grise les amants" coïncide avec l’immensité de l’être. En un sens, le monde entier n’existe que pour l’instant de la rencontre des amants. »



 Rentrée littéraire automne 2022. Parution le 18 août.
Rentrée littéraire automne 2022. Parution le 18 août. 
 Version imprimable
Version imprimable
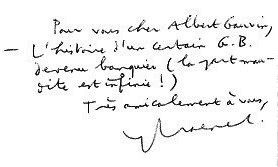

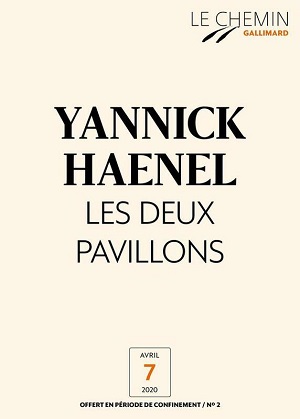

 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?



10 Messages
RTBF, Dans quel monde on vit, 17 octobre 2022. Invités : Dominique A et Yannick Haenel.
La dépense plutôt que l’épargne. Dépense qui est la vérité de l’économie. C’est l’idée de Georges Bataille, que défend l’écrivain Yannick Haenel dans Le Trésorier-payeur, son nouveau roman publié aux éditions Gallimard.
Une thèse développée en 1949 par Georges Bataille
Le héros de ce livre est un jeune banquier défendant l’idée que l’économie est à la base de la poésie : "C’est un poète masqué, c’est Rimbaud chez les capitalistes. Cette idée m’excitait depuis longtemps, depuis la crise des subprimes. Précisément là c’était trop : je me suis dit qu’il fallait s’intéresser à l’économie car elle est en train de nous faire la peau. Elle nous fait la peau à chaque instant. Se contenter de dire : ’Je n’y comprends rien’, à la fin cela devient une posture dandy, de victime pitoyable. Plutôt que de raconter mes histoires à la Kerouac, de poésie instantanée, je me suis dit un jour que j’allais envoyer un de mes personnages dans la banque (pour voir) ce qu’il s’y passe".
Yannick Haenel s’est intéressé à la Banque de France lors de la visite d’une ancienne succursale à Béthune, transformée en un centre d’art contemporain. Celui-ci proposait une exposition sur Georges Bataille. Le philosophe a écrit La part maudite en 1949, "une tentative très rare pour les écrivains, d’écrire sur l’économie". Sa thèse : le cœur de l’économie ne relève pas du profit, donc de l’épargne, mais de la dépense.
L’auteur français la reprend dans Le Trésorier-payeur : "Il s’agit de se dépenser, il s’agit même de donner. C’est une dépense qui est un don. Ce personnage étrange cherche en mon sens, à vider les caisses parce que la perversion économique qui nous tient en otage c’est la volonté de profit. Il y a quelque chose de très simple dans cette circulation, qu’il connaît pour travailler à la Banque de France, celle de la redistribution".
Yannick Haenel.
ZOOM : cliquer sur l’image.
LIRE AUSSI : L’écrivain Yannick Haenel hanté par le procès des attentats de Charlie Hebdo ou sur Pileface ICI.
Le Trésorier-payeur, en désordre de Bataille
Vendredi 14 octobre à 18h30, la libraire Les Temps Modernes, [à Orléans, a reçu] le romancier Yannick Haenel pour une rencontre autour de son nouveau roman, Le Trésorier-payeur, un livre vertigineux sur la révolte au sein du système bancaire.
Tout commence par une invitation et une lecture. Yannick Haenel est invité à participer à une exposition consacrée à Georges Bataille, auteur, philosophe et pendant quelques années, Conservateur de la bibliothèque municipale d’Orléans. Le romancier en déplacement à Béthune, lieu où se tient l’exposition, replonge dans un livre de Bataille et, hasard étonnant, trouve un homonyme du célèbre artiste. Un certain Georges Bataille, malgré sa formation de philosophe, décide de rentrer dans la banque et devient Trésorier-payeur. Ce roman est l’histoire de ce deuxième Georges Bataille.
« C’est donc là que cet homme de quarante-trois ans, à l’allure nonchalante, aux épais cheveux grisonnants, et toujours vêtu d’un long manteau bleu marine, vivait depuis presque vingt ans ; il y avait longtemps vécu seul, quelques femmes étaient passées, certaines avaient même tenté de rester, butant les unes après les autres sur un secret, une opacité d’autant plus curieuse qu’elle contrastait avec des manières charmantes et avec l’éclat d’une séduction certes un peu froide, mais qui lui avait donné avec le temps la réputation d’un vieux célibataire donjuanesque, l’un de ces types qui, sans que personne en sache rien, auront au bout du compte couché avec toutes les femmes de la ville. »
Voici donc Georges Bataille, cet étrange philosophe devenu banquier, ce mystérieux trésorier-payeur riche de sombres secrets. Le livre s’ouvre sur une situation proche de la réalité. Yannick Haenel a bien été invité à participer à une exposition à Béthune dans une banque devenue centre d’art, Labanque. Dans ces quelques pages, que l’on pourrait prendre comme une mise en bouche ou un avertissement, le romancier distille les nombreux paradoxes entourant l’artiste Georges Bataille et cela met en curiosité, en mouvement. Cette énergie anime alors le romancier et surtout l’histoire qu’il veut nous raconter, celle d’un homme qui aurait pu passer inaperçu. Dans cette histoire de l’autre Georges Bataille, on découvre la Banque de France, la visite de Ronald Reagan, des femmes mystérieuses et libres, la puissance de la littérature et la nécessité de résister même quand on est au cœur d’un système.
Le roman de Yannick Haenel est une véritable aventure avec une galerie de personnages atypiques qui ont tous comme point commun d’avoir rencontré le trésorier-payeur Georges Bataille. Cet homme est d’une intensité à toute épreuve. Il veut vivre pleinement mais pas aveuglément. C’est un personnage en toute conscience et cela lui donne une assise dans l’histoire. Il est sensible à tous les plaisirs, charnels notamment, ce qui en fait un rebelle dans un monde qui compte le moindre sou. Georges Bataille voit plus loin que les chiffres et se moque de l’argent qui n’a pas de valeurs. Par son regard, il démonte le système capitaliste, son goût pour l’argent est tel qu’il en a imprégné tous les domaines de la société. Tout est monétisé. Tout peut être possédé. Par sa fantaisie, sa liberté grandissante, Georges Bataille est un grain de sable dans la machine. Il en vient même à prouver à quel point le système marche sur la tête.
Après Jan Karski (Jan Karski), Le Caravage (La solitude Caravage) ou le cinéaste Michael Cimino (Tiens ferme ta couronne), Yannick Haenel s’approche encore une fois d’une personnalité en lutte contre son monde et son époque. Avec une joie d’écrire les pérégrinations d’un homme surprenant, le romancier pointe les failles actuelles tout en rendant hommage à la détermination d’un être qui trace son sillon.
Julien Leclerc, www.magcentre.fr
L’Heure bleue, 22 septembre 2022. À l’occasion de la rentrée littéraire, l’Heure bleue reçoit Yannick Haenel, qui publie son roman Le Trésorier-payeur aux éditions Gallimard. Entre calcul et désir, le monde de l’argent dévoilerait une vérité de l’être.
En savoir plus
Musiques :
 "Tombé pour la France" — Etienne Daho
"Tombé pour la France" — Etienne Daho
 "Variations Golberg" — Jean Sébastien Bach, interprété par Glenn Gould
"Variations Golberg" — Jean Sébastien Bach, interprété par Glenn Gould
 "Miel" — November Ultra
"Miel" — November Ultra
Archives :
 Archive INA de 1947 : Jean-Paul Sartre sur l’existentialisme et l’humanisme
Archive INA de 1947 : Jean-Paul Sartre sur l’existentialisme et l’humanisme
 Archive INA du 7 janvier 1948 : Antonin Artaud, extrait de Pour en finir avec le jugement de dieu
Archive INA du 7 janvier 1948 : Antonin Artaud, extrait de Pour en finir avec le jugement de dieu
 Archive INA du 21 mai 1958 : George Bataille dit qu’il faut affronter les dangers de la littérature
Archive INA du 21 mai 1958 : George Bataille dit qu’il faut affronter les dangers de la littérature
 Archive INA de 1984 : l’Abbé Pierre donne sa définition du riche.
Archive INA de 1984 : l’Abbé Pierre donne sa définition du riche.
Générique : "Veridis Quo" — Daft Punk
Merci Laure Adler.
Le Monde des livres, 15 septembre 2022. Notre feuilletoniste salue ce roman que sous-tend une passionnante critique du capitalisme. LIRE ICI
Une biographie imaginaire de Georges Bataille, non pas l’écrivain, mais un Trésorier-payeur né de Béthune, qui défend les surendettés d’une région en crise et tient que « la vraie richesse est sexuelle car en elle tout se dépense ».
Le point de vue de : Jérôme Garcin, Elisabeth Philippe, Jean-Claude Raspiengeas, Frédéric Beigbeder, Arnaud Viviant.
Crédit Radio France
Voici la lecture du début du Trésorier-payeur (pages 13 à 16)
RCJ, Post Face, émission littéraire présentée par Caroline Gutmann, 30 août 2022.
1. Le Trésorier-payeur, de Yannick Haenel : nouvel extrait. Entretien sur RCJ, 1er février 2023, 18:25, par Albert Gauvin
Voici, restaurée, la lecture du début du Trésorier-payeur (pages 13 à 16)
Le Trésorier-payeur
De : Yannick Haenel
Lu par : Pierre-François Garel
Durée : 10 h et 6 min
Version intégrale Livre audio
Extrait
A COMMANDER ICI
Bienvenue au club : c’est la nouvelle émission animée par Olivia Gesbert. Premier invité : Yannick Haenel.
Pour ouvrir cette nouvelle saison, réflexion autour de la valeur insensée de l’argent, à travers le regard d’un banquier philosophe.
Peut-on sortir du capitalisme ? Plongée dans une succursale de la Banque de France suite au 15 août 1971, date de la suspension de la convertibilité du dollar en or, avec un jeune banquier : Georges Bataille, homonyme du célèbre auteur de La Part maudite (1949). Avec Le Trésorier-payeur (Gallimard, 18 août), Yannick Haenel propose une forme de méditation un peu farfelue mais non moins sérieuse, plaçant un personnage un peu anarchique et très poétique au coeur du système capitaliste. Une biographie imaginaire du célèbre auteur et philosophe Georges Bataille.
Une première émission qui permet aussi de se questionner : que signifie écrire des romans ? Pour notre invité, il s’agit presque d’un exercice spirituel "au plus près de l’insaisissable". La rentrée littéraire, attendue chaque année, est aussi le moment de porter un livre en lequel on croit. Une "fête" au cours de laquelle le public s’intéresse aux nouvelles publications.
A noter, Yannick Haenel est l’invité fil rouge des Rencontres de Chaminadour (15-17 septembre 2022, Guéret ). Pour leur 17e édition, celles-ci rendront hommage à Georges Bataille et à Michel Leiris.
Crédit : France Culture
Je me suis livré à un petit montage des trois "objets" qui sont très proches dans ma bibliothèque : la photographie de Georges Bataille, le roman de Haenel et... la lampe de mineur que j’ai héritée de mon père — qui n’était pas mineur, mais journaliste à Valenciennes où je suis né alors que le bassin minier était encore actif non loin de là...
Montage, 29-08-2022.
ZOOM : cliquer sur l’image.
Un banquier converti à la charité organise son épuisement sexuel et littéraire pour atteindre la vraie liberté. Yannick Haenel signe un roman jouissif autour de la notion de « dépense » chère à Georges Bataille. (Eric Loret, Libération). LIRE ICI.
Yannick Haenel : écrire, jouir et vider les coffres (Le Trésorier-payeur)
« Les intellectuels ne se promènent pas torse nu, ils meublent leur appartement avec soin et se battent pour le pouvoir ; lui semblait flotter comme un ange à l’intérieur du monde des idées. » Tout Yannick Haenel se tient dans cette description du Trésorier-payeur, le prodigieux personnage qui donne son titre à un roman qui transcende la rentrée littéraire. Cinq ans après Tiens ferme ta couronne qui obtint le prix Médicis, l’écrivain flotte en majesté à l’intérieur du monde des idées : il tient chaque semaine une chronique dans Charlie Hebdo dont il a suivi l’historique et intense procès (deux livres en sont nés, Janvier 2015, le procès et Notre solitude), il a composé des ouvrages majeurs sur l’histoire de l’art ancien et contemporain (La solitude Caravage, Adrian Ghenie) et a écrit un texte d’opéra moderne (Papillon noir). Le Trésorier-payeur marque donc le retour aux affaires romanesques pour Haenel qui s’explique sur la genèse de son arc narratif dans une première partie éblouissante ; le livre débute en effet par une explication-confidence proprement géniale, aussi éloignée que possible de l’autofiction, elle répond tout simplement à la question cruciale : qu’est-ce qu’un écrivain ? Il est, Haenel est, celui qui peut à la fois vivre et dire une stance de patience spéciale : « En toute occasion, j’attends ce trouble qui déclenche les romans » — celui qui voit en un éclair les lignes avant de les coucher sur le papier. — (Arnaud Jamin, diacritik, 22 août 2022).