 Un rire majeur
Un rire majeur Philippe Sollers, Madame Edwarda
 Georges Bataille, Préface de « Madame Edwarda »
Georges Bataille, Préface de « Madame Edwarda »
Bataille et Sollers. Dans la « bibliothèque » de Sollers, les livres sont innombrables, on le sait. Ceux de Bataille y occupent, semble-t-il, une place particulière. On peut aisément démontrer que la présence de Bataille y est, dans la durée, plus insistante que celle d’autres écrivains. Il ne s’agit pas d’une référence "littéraire", mais d’une expérience où la vie est en jeu. La vie personnelle. Philippe Sollers et Julia Kristeva ne racontent-ils pas, l’un et l’autre, que, dès l’une de leurs premières rencontres, il fut question de L’expérience intérieure, le livre que Bataille publia en 1943 ?
Cela dure donc depuis plus de quarante ans.
Dès 1963 Sollers écrit sur Bataille. Ce sera d’abord « De grandes irrégularités de langage » (n° spécial de la revue « Critique » en « hommage à Bataille »), puis, en 1966, « Le récit impossible », un article sur « Ma mère », et, en 1967, un texte fondamental Le toit dont le sous-titre précise d’entrée l’enjeu : Essai de lecture systématique [1]. Puis il y aura le fameux colloque de Cerisy (juillet 1972) : « Pourquoi Artaud ? Pourquoi Bataille ? » [2]
Pourquoi Bataille ? Il y a peu de rapport en apparence entre les récits de Bataille et les romans de Sollers si l’on s’en tient à la simple technique narrative. Il faut donc aller au fond des choses. L’enjeu est à la fois personnel — celui d’une "expérience" et d’une "opération" souveraine — et philosophique.
Qu’écrit Sollers dans son intervention au colloque de Cerisy intitulée « L’acte Bataille » ?
Pour Bataille, Hegel dans le déploiement du temps manque donc la matérialité « sacrificielle » de l’opération, son « moment ». Il n’est pas sans intérêt de préciser pour quelle raison, selon lui : par manque d’une expérience de type « catholique » (plus proche, aux yeux de Bataille, de la vérité païenne que de la Réforme). Autrement dit, il s’agit de variations historiques du refoulement (mais ici la base réprimée de la pensée matérialiste est capitale). Cependant, il ne sert à rien de procéder à un refoulement des formes du refoulement : ce geste éloignerait d’une désimplication centrale, il faut poser la question au coeur de toutes ses stratifications. C’est pourquoi on ne peut pas « contourner » le christianisme :
« Le christianisme n’est, au fond, qu’une cristallisation du langage. La solennelle affirmation du quatrième évangile : Et Verbum caro factum est, est en un sens, cette vérité profonde : la vérité du langage est chrétienne. Soit l’homme et le langage doublant le monde réel d’un autre imaginé - disponible au moyen de l’évocation -, le christianisme est nécessaire. Ou, sinon, quelque affirmation analogue. » [3]
Ce qui, du même coup, signifie que la vérité enfouie de l’érotisme est chrétienne, dans la mesure où elle condense à un point inégalé le sondage sur la reproduction du sujet.
Affirmations dont on a aucun mal à imaginer qu’elles restent, à bien des égards, aujourd’hui, scandaleuses [4].
C’est à la lumière de ces affirmations — éloignées aussi bien du mysticisme, du spiritualisme que du rationalisme "classique" — qu’on peut relire ces « Scènes de Bataille », l’article publié par Sollers dans Le Monde des Livres du 2 décembre 2004 (L’Infini n° 91, été 2005). Scènes de fiction sans doute, mais aussi, aujourd’hui comme hier, scènes et batailles « philosophiques ».

- Georges Bataille
- Coll. privée. A.G.
Scènes de Bataille
Quarante-deux ans après sa mort, voici donc, en Pléiade, les romans de Georges Bataille (1897-1962). Tout arrive : ces livres ont été publiés sous le manteau ou à tirage limité, on les a crus voués à l’enfer des bibliothèques, ils ont été signés de pseudonymes divers, Lord Auch, Pierre Angélique, Louis Trente, leurs titres sont autant de signaux brûlants pour l’amateur de vraie philosophie débarrassée de l’hypocrisie cléricale philosophique : Histoire de l’oeil, Le Bleu du ciel, Madame Edwarda, Le Petit, Le Mort, L’Impossible, Ma mère. Vraie philosophie, enfin, sous forme de romans obscènes : "Voici donc la première théologie proposée par un homme que le rire illumine et qui daigne ne pas limiter ce qui ne sait pas ce qu’est la limite. Marquez le jour où vous lisez d’un caillou de flamme, vous qui avez pâli sur les textes des philosophes ! Comment peut s’exprimer celui qui les fait taire, sinon d’une manière qui ne leur est pas concevable ?"
Dieu est mort, c’est entendu (trop vite entendu), mais sa décomposition et sa putréfaction n’en finissent pas de polluer l’histoire. Dieu, en réalité, n’en finit pas de mourir et d’irréaliser la mort. De même que la théologie veut se faire "athéologie", la philosophie se révèle, à la fin, comme bavardage plus ou moins moral sur fond de dévastation technique. Comment démasquer ce vide ? Par une expérience personnelle, et un récit cru. "La solitude et l’obscurité achevèrent mon ivresse. La nuit était nue dans des rues désertes et je voulus me dénuder comme elle : je retirai mon pantalon que je mis sur mon bras ; j’aurais voulu lier la fraîcheur de la nuit dans mes jambes, une étourdissante liberté me portait. Je me sentais grandi. Je tenais dans la main mon sexe droit."
Cet étrange philosophe, passé par les séductions du dieu ancien, a beaucoup médité sur Hegel, Sade et Nietzsche. Mais ce romancier, pour qui le réalisme est une erreur et la poésie un leurre, veut pousser le roman (après Proust) jusqu’à ses conséquences extrêmes. D’où la brusque apparition de figures féminines aux prénoms inoubliables : Simone, Madame Edwarda, Dirty, Lazare, Julie, Hansi, jusqu’à l’extraordinaire mise en scène d’une mère débauchée et incestueuse. Dieu et la philosophie sont interrogés au bordel.
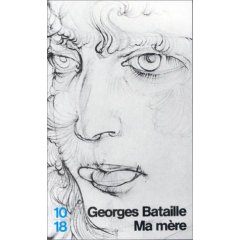 Imagine-t-on la mère de Proust s’exprimant ainsi : "Ah, serre les dents mon fils, tu ressembles à ta pine, à cette pine ruisselante de rage qui crispe mon désir comme un poignet" ? Non, n’est-ce pas ? Et pourtant, la mère profanée ou profanatrice est bien le grand secret de tous les sacrés. Bataille relève ce défi immémorial, il renverse la grande idole, il s’identifie à elle dans la souillure comme dans la folie, il va, ce que personne n’a osé faire avant lui, au coeur de la crise hystérique : "Les sauts de poisson de son corps, la rage ignoble exprimée par son visage mauvais, calcinaient la vie en moi et la brisaient jusqu’au dégoût."
Imagine-t-on la mère de Proust s’exprimant ainsi : "Ah, serre les dents mon fils, tu ressembles à ta pine, à cette pine ruisselante de rage qui crispe mon désir comme un poignet" ? Non, n’est-ce pas ? Et pourtant, la mère profanée ou profanatrice est bien le grand secret de tous les sacrés. Bataille relève ce défi immémorial, il renverse la grande idole, il s’identifie à elle dans la souillure comme dans la folie, il va, ce que personne n’a osé faire avant lui, au coeur de la crise hystérique : "Les sauts de poisson de son corps, la rage ignoble exprimée par son visage mauvais, calcinaient la vie en moi et la brisaient jusqu’au dégoût."
Bataille veut voir ce qui se cache vraiment au bout de l’ivresse, de la déchéance, de la fièvre, du sommeil, de l’oubli, de la vulgarité, du vomi. "Que Dieu soit une prostituée de maison close, et une folle, n’a pas de sens en raison." D’ailleurs : "Dieu s’il "savait" serait un porc." Formidable proposition, qui coupe court à toutes les idéalisations comme aux religions se vautrant le plus souvent dans le crime (tuer au nom de Dieu étant redevenu, n’est-ce pas, un sport courant).
En 1957, à propos du Bleu du ciel, Bataille s’explique très clairement : "Le verbe vivre n’est pas tellement bien vu, puisque les mots viveur et faire la vie sont péjoratifs. Si l’on veut être moral, il vaut mieux éviter tout ce qui est vif, car choisir la vie au lieu de se contenter de rester en vie n’est que débauche et gaspillage. A son niveau le plus simple, Le Bleu du ciel inverse cette morale en décrivant un personnage qui se dépense jusqu’à toucher la mort à force de beuveries, de nuits blanches, et de coucheries. Cette dépense, volontaire et systématique, est une méthode qui transforme la perdition en connaissance et découvre le ciel d’en-bas."
Cette dépense systématique, mettant en oeuvre une "part maudite", ouvre un ciel imprévu, "une souveraineté". A côté des récits de Bataille, la plupart des romans paraissent fades, lâches, timides, apeurés, lourds, lents, économes, et surtout prudes jusque dans leur laborieuse pornographie. L’absence en eux de personnages féminins inspirés est flagrante. C’est toujours le même disque psychologique et sentimental, rien n’est réellement mis à nu, c’est l’ennui conventionnel et déprimé obligatoire.
La société de résignation triche avec l’érotisme (escroquerie porno, fausses partouzes, rituels mondains), elle triche du même coup avec la mort assimilée au triste destin égalitaire de la reproduction des corps. Basse époque de bassesse servile et frivole, où la sexualité (comme on dit) est du même mouvement exhibée et niée. Or, dit Bataille (et tous ses romans le prouvent), il est possible de dénuder au fond de chacun de nous une fente qui est la présence, toujours latente, de notre propre mort. "Ce qui apparaît à travers la fente c’est le bleu du ciel dont la profondeur "impossible" nous appelle et nous refuse aussi vertigineusement que notre vie appelle et refuse la mort."
Morbidité de Bataille ? Tout le contraire (et on comprend pourquoi Francis Bacon, le plus viveur des peintres, aimait Madame Edwarda). Ce qui frappe plutôt, c’est la présence constante, malgré l’angoisse et le vertige, d’une grande désinvolture et d’un rire qui ambitionne même de devenir "rire absolu". Bataille ne revendiquait rien, pas même le statut sacralisé de son oeuvre. D’où le comique involontaire de cette réaction de Maurice Blanchot : « Bataille me dit un jour, à mon véritable effroi, qu’il souhaitait écrire une suite à Madame Edwarda, et il me demanda mon avis. Je ne pus que lui répondre aussitôt et comme si un coup m’avait été porté : "C’est impossible. Je vous en prie, n’y touchez pas." » Mais Bataille, cet extravagant volume et ses appendices le démontrent, a bel et bien continué à y "toucher" (Madame Edwarda date de 1941, le splendide Ma mère de 1955, publié en 1966, après la mort de Bataille). Il est vrai qu’on n’imagine pas Blanchot (mais pas davantage Sartre, Camus, Foucault, Derrida, Lacan) se laissant aller à écrire : "J’imagine une jolie putain, élégante, nue, triste dans sa gaîté de petit porc." Ni ceci : "L’être ouvert — à la mort, au supplice, à la joie — sans réserve, l’être ouvert et mourant, douloureux et heureux, paraît déjà dans sa lumière voilée : cette lumière est divine. Et le cri que, la bouche tordue, cet être tord peut-être mais profère est un immense alléluia, perdu dans le silence sans fin."
Je revois Georges Bataille entrant autrefois dans le petit bureau de la revue Tel Quel, et s’asseyant dans un coin. Je suis peu enclin au respect. Mais là, en effet, silence. Sans fin.
Philippe Sollers, Le Monde des livres, 02.12.2004.
Un rire majeur
Bataille est, de tous les penseurs du XXe siècle, celui qui semble avoir constamment habité son corps. Son existence physique est une expérience, il la met en jeu de façon mobile, de l’angoisse à l’extase, de la fiction à l’essai, de l’abjection au sublime, du rire à l’orgie. Il a la fièvre, il s’ennuie, le ciel s’ouvre brusquement pour lui, il est fou, c’est le plus sage des philosophes. Il peut passer sans transition de Hegel à Sade, de Nietzsche à sainte Angèle de Foligno. Il boit, il va au bordel, il parle avec douceur et distinction, ses yeux bleus sont effacés et calmes, il écrit sur Kafka, conteste Sartre, cite longuement Proust. Son style est reconnaissable entre mille : « Il m’est doux d’entrer dans la nuit sale et de m’y enfermer fièrement. » Ou bien : « L’amour le plus grand, le plus sûr, pourrait s’accorder avec la moquerie infinie. Un tel amour ressemblerait à la folle musique, au ravissement d’être lucide. » Ou encore : « Les dieux rient des raisons qui les animent, tant elles sont profondes, inexprimables dans la langue des autres. » Cet homme était réellement divin. Il pensait, comme Nietzsche, que le plus grand péché, en ce monde, était de faire honte à quelqu’un, ou d’attirer le malheur sur ceux qui rient. Le monde est sans but, l’univers n’a aucun projet, l’homme est une passion inutile, on ne doit l’engager à rien, il est une part maudite irrécupérable, comme la dépense d’énergie du soleil, de l’érotisme, de la poésie. A propos de la mort, on peut dire simplement ceci : « Le temps accède à la simplicité qui le supprime. »
Ce qui compte donc, c’est « l’émotion méditée ». On l’atteint par certains récits tordus, où surgissent des figures brûlantes de femmes : Simone dans l’Histoire de l’oeil, Dirty et Lazare dans le Bleu du ciel, Madame Edwarda. La littérature est un mal qui traite le mal par le mal, elle ne doit jamais être un bien, sinon elle ment, alors qu’elle doit, sans cesse, nous montrer l’impossible. Pas de honte, pas de culpabilité, un savoir qui consiste à transformer l’angoisse en délice. Impossible d’enfermer Bataille : il aura été un des esprits les plus libres et les plus insaisissables d’un temps de grande servitude (rien de plus émouvant que de relire le Coupable, commencé en septembre 1939, pendant la guerre, et poursuivi, dans une solitude pauvre et illuminée, au milieu de l’effondrement général). « Il faudrait ne jamais cesser de dire ce que les hommes découvrent d’éblouissant quand ils rient : leur ivresse ouvre une fenêtre de lumière donnant sur un monde criant de joie. A vrai dire, ce monde a tant d’éclat qu’ils en détournent vite les yeux. Une grande force est nécessaire à celui qui veut maintenir son attention fixée sur ce point de glissement vertigineux. »
Bataille, au début des années 60, dans le petit bureau de Tel Quel, dit brusquement : « Au lycée, quand j’étais jeune, on m’appelait "la brute". » Phrase étrange, prononcée dans un murmure. Il vient nous confier ses Conférences sur le non-savoir, l’un de ses grands textes. Il y distingue le rire majeur du rire mineur. Oui, c’est cela : un rire majeur.
Philippe Sollers, Libération du 11 septembre 1997.
« Madame Edwarda »
« On est capable de lire ce qu’on est capable de vivre, ne serait-ce qu’en imagination. Mes premières impressions érotiques, je les ai eues très tôt, à 14 ans, avec les peintures dans les livres, et Baudelaire, le plus grand poète érotique : "Tes nobles jambes, sous les volants qu’elles chassent, tourmentent les désirs obscurs et les agacent..." Puis, très vite, Sade. Sous le manteau. L’érotisme est lié au discours. "Longtemps je me suis couché de bonne heure", c’est érotique. Et voyez les sonnets de Shakespeare ! Il n’y a pas d’érotisme sans dire, le dire est le plus important dans la chose. L’acte érotique est un acte de pensée. Goûter et penser, c’est la même chose. La sexualité sans philosophie est sans intérêt. Georges Bataille provoque une émotion, parce que la chose érotique est pensée. La lecture de Bataille est saisissante car elle fait à la fois plaisir et penser. Dans l’Expérience intérieure ou Madame Edwarda, les femmes sont extravagantes. Les personnages de Bataille ont l’audace des explorateurs qui vont dans des femmes intéressantes. Ils prennent des risques. Mais toutes ces choses ne peuvent se faire que dans la discrétion. Voyez Vivant Denon dans Leçon de nuit : l’amour vrai est clandestin. ». Ph. Sollers.
Préface de « Madame Edwarda »
Georges Bataille
« La mort est ce qu’il y a de plus terrible et maintenir l’œuvre de la mort est ce qui demande la plus grande force » – HEGEL.
 L’auteur de Madame Edwarda [5] a lui-même attiré l’attention sur la gravité de son livre. Néanmoins, il me semble bon d’insister, en raison de légèreté avec laquelle il est d’usage de traiter les écrits dont la vie sexuelle est le thème. Non que j’aie l’espoir — ou l’intention d’y rien changer. Mais je demande au lecteur de ma préface de réfléchir un court instant sur l’attitude traditionnelle à l’égard du plaisir (qui, dans le jeu des sexes, atteint la folle intensité) et de la douleur (que la mort apaise, il est vrai, mais que d’abord elle porte au pire). Un ensemble de conditions nous conduit à nous faire de l’homme (de l’humanité), une image également éloignée du plaisir extrême et de l’extrême douleur : les interdits les plus communs frappent les uns la vie sexuelle et les autres la mort, si bien que l’une et l’autre ont formé un domaine sacré, qui relève de la religion. Le plus pénible commença lorsque les interdits touchant les circonstances de la disparition de l’être reçurent seuls un aspect grave et que ceux qui touchaient les circonstances de l’apparition — toute l’activité génétique ont été pris à la légère. Je ne songe pas à protester contre la tendance profonde du grand nombré : elle est l’expression du destin qui voulut l’homme riant de ses organes reproducteurs. Mais ce rire, qui accuse l’opposition du plaisir et de la douleur (la douleur et la mort sont dignes de respect, tandis que le plaisir est dérisoire, désigné au mépris), en marque aussi la parenté fondamentale. Le rire n’est plus respectueux, mais c’est le signe de l’horreur. Le rire est l’attitude de compromis qu’adopte l’homme en présence d’un aspect qui répugne, quand cet aspect ne paraît pas grave. Aussi bien l’érotisme envisagé gravement, tragiquement, représente un entier renversement.
L’auteur de Madame Edwarda [5] a lui-même attiré l’attention sur la gravité de son livre. Néanmoins, il me semble bon d’insister, en raison de légèreté avec laquelle il est d’usage de traiter les écrits dont la vie sexuelle est le thème. Non que j’aie l’espoir — ou l’intention d’y rien changer. Mais je demande au lecteur de ma préface de réfléchir un court instant sur l’attitude traditionnelle à l’égard du plaisir (qui, dans le jeu des sexes, atteint la folle intensité) et de la douleur (que la mort apaise, il est vrai, mais que d’abord elle porte au pire). Un ensemble de conditions nous conduit à nous faire de l’homme (de l’humanité), une image également éloignée du plaisir extrême et de l’extrême douleur : les interdits les plus communs frappent les uns la vie sexuelle et les autres la mort, si bien que l’une et l’autre ont formé un domaine sacré, qui relève de la religion. Le plus pénible commença lorsque les interdits touchant les circonstances de la disparition de l’être reçurent seuls un aspect grave et que ceux qui touchaient les circonstances de l’apparition — toute l’activité génétique ont été pris à la légère. Je ne songe pas à protester contre la tendance profonde du grand nombré : elle est l’expression du destin qui voulut l’homme riant de ses organes reproducteurs. Mais ce rire, qui accuse l’opposition du plaisir et de la douleur (la douleur et la mort sont dignes de respect, tandis que le plaisir est dérisoire, désigné au mépris), en marque aussi la parenté fondamentale. Le rire n’est plus respectueux, mais c’est le signe de l’horreur. Le rire est l’attitude de compromis qu’adopte l’homme en présence d’un aspect qui répugne, quand cet aspect ne paraît pas grave. Aussi bien l’érotisme envisagé gravement, tragiquement, représente un entier renversement.
Je tiens d’abord à préciser à quel point sont vaines ces affirmations banales, selon lesquelles l’interdit sexuel est un préjugé, dont il est temps de se défaire. La honte, la pudeur, qui accompagnent le sentiment fort du plaisir, ne seraient elles-mêmes que des preuves d’inintelligence. Autant dire que nous devrions faire table rase et revenir au temps — de l’animalité, de la libre dévoration et de l’indifférence aux immondices. Comme si l’humanité entière ne résultait pas de grands et violents mouvements d’horreur suivie d’attrait, auxquels se lient la sensibilité et l’intelligence. Mais sans vouloir rien opposer au rire dont l’indécence est la cause, il nous est loisible de revenir — en partie — sur une vue que le rire seul introduisit.
C’est le rire en effet qui justifie une forme de condamnation déshonorante. Le rire nous engage dans cette voie où le principe d’une interdiction, de décences nécessaires, inévitables, se change en hypocrisie fermée, en incompréhension de ce qui est en jeu. L’extrême licence liée à la plaisanterie s’accompagne d’un refus de prendre au sérieux — j’entends : au tragique — la vérité de l’érotisme.
La préface de ce petit livre où l’érotisme est représenté, sans détour, ouvrant sur la conscience d’une déchirure, est pour moi l’occasion d’un appel que je veux pathétique. Non qu’il soit à mes yeux surprenant que l’esprit se détourne de lui-même et, pour ainsi dire se tournant le dos, devienne dans son obstination la caricature de sa vérité. Si l’homme a besoin du mensonge, après tout, libre à lui ! L’homme, qui, peut-être, a sa fierté, est noyé par la masse humaine… Mais enfin : je n’oublierai jamais ce qui se lie de violent et de merveilleux à la volonté d’ouvrir les yeux, de voir en face ce qui arrive, ce qui est. Et je ne saurais pas ce qui arrive, si je ne savais rien du plaisir extrême, si je ne savais rien de l’extrême douleur !
Entendons-nous. Pierre Angélique a soin de le dire : nous ne savons rien et nous sommes dans le fond de la nuit. Mais au moins pouvons-nous voir ce qui nous trompe, ce qui nous détourne de savoir notre détresse, de savoir, plus exactement, que la joie est le même chose que la douleur, la même chose que la mort.
Ce dont ce grand rire nous détourne, que suscite la plaisanterie licencieuse, est l’identité du plaisir extrême et de l’extrême douleur : l’identité de l’être et de la mort, du savoir s’achevant sur cette perspective éclatante et de l’obscurité définitive. De cette vérité, sans doute, nous pourrons finalement rire, mais cette fois d’un rire absolu, qui ne s’arrête pas au mépris de ce qui peut être répugnant, mais dont le dégoût nous enfonce.
Pour aller au bout de l’extase où nous nous perdons dans la jouissance, nous devons toujours en poser l’immédiate limite : c’est l’horreur.
Non seulement la douleur des autres ou la mienne propre, approchant du moment où l’horreur me soulèvera, peut me faire parvenir à l’état de joie glissant au délire, mais il n’est pas de forme de répugnance dont je ne discerne l’affinité avec le désir. Non que l’horreur se confonde jamais avec l’attrait, mais si elle ne peut l’inhiber, le détruire, l’horreur renforce l’attrait ! Le danger paralyse, mais moins fort, il peut exciter le désir. Nous ne parvenons à l’extase, sinon, fût-elle lointaine, dans la perspective de la mort, de ce qui nous détruit.
Un homme diffère d’un animal en ce que certaines sensations le blessent et le liquident au plus intime. Ces sensations varient suivant l’individu et suivant les manières de vivre. Mais la vue du sang, l’odeur du vomi, qui suscitent en nous l’horreur de la mort, nous font parfois connaître un état de nausée qui nous atteint plus cruellement que la douleur. Nous ne supportons pas ces sensations liées au vertige suprême. Certains préfèrent la mort au contact inoffensif. Il existe un domaine où la mort ne signifie plus seulement la disparition, mais le mouvement intolérable où nous disparaissons malgré nous, alors qu’à tout prix, il ne faudrait pas disparaître. C’est justement cet à tout prix, ce malgré nous, qui distinguent le moment de l’extrême joie et de l’extase innommable mais merveilleuse. S’il n’est rien qui ne nous dépasse, qui ne nous dépasse malgré nous, devant à tout prix ne pas être, nous n’atteignons pas le moment insensé auquel nous tendons de toutes nos forces et qu’en même temps nous repoussons de toutes nos forces.
Le plaisir serait méprisable s’il n’était ce dépassement atterrant, qui n’est pas réservé à l’extase sexuelle, que les mystiques de différentes religions, qu’avant tout les mystiques chrétiens ont connu de la même façon. L’être nous est donné dans un dépassement intolérable de l’être, non moins intolérable que la mort. Et puisque, dans la mort, en même temps qu’il nous est donné, il nous est retiré, nous devons le chercher dans le sentiment de la mort, dans ces moments intolérables où il nous semble que nous mourons, parce que l’être en nous n’est plus là que par excès, quand la plénitude de l’horreur et celle de la joie coïncident.
Même la pensée (la réflexion) ne s’achève en nous que dans l’excès. Que signifie la vérité, en dehors de la représentation de l’excès, si nous ne voyons ce qui excède la possibilité de voir, ce qu’il est intolérable de voir, comme, dans l’extase, il est intolérable de jouir ? si nous ne pensons ce qui excède la possibilité de penser… [6] ?
A l’issue de cette réflexion pathétique, qui, dans un cri, s’anéantit elle-même en ce qu’elle sombre dans l’intolérance d’elle-même, nous retrouvons Dieu. C’est le sens, c’est l’énormité, de ce livre insensé : ce récit met en jeu dans la plénitude de ses attributs, Dieu lui-même ; et ce Dieu, néanmoins, est une fille publique, en tout pareille aux autres. Mais ce que le mysticisme n’a pu dire (au moment de le dire, il défaillait), l’érotisme le dit : Dieu n’est rien s’il n’est pas dépassement de Dieu dans tous les sens ; dans le sens de l’être vulgaire, dans celui de l’horreur et de l’impureté ; à la fin, dans le sens de rien… Nous ne pouvons ajouter au langage impunément le mot qui dépasse les mots, le mot Dieu ; dès l’instant où nous le faisons, ce mot se dépassant lui-même détruit vertigineusement ses limites. Ce qu’il est ne recule devant rien, il est partout où il est impossible de l’attendre : lui-même est une énormité. Quiconque en a le plus petit soupçon, se tait aussitôt. Ou, cherchant l’issue, et sachant qu’il s’enferre, il cherche en lui ce qui, pouvant l’anéantir, le rend semblable à rien [7].
Dans cette inénarrable voie où nous engage le plus incongru de tous les livres, il se peut cependant que nous fassions quelques découvertes encore.
Par exemple, au hasard, celle du bonheur…
La joie se trouverait justement dans la perspective de la mort (ainsi est-elle masquée sous l’aspect de son contraire, la tristesse).
Je ne suis en rien porté à penser que l’essentiel en ce monde est la volupté. L’homme n’est pas limité à l’organe de la jouissance. Mais cet inavouable organe lui enseigne son secret [8]. Puisque la jouissance dépend de la perspective délétère ouverte à l’esprit, il est probable que nous tricherons et que nous tenterons d’accéder à la joie tout en nous approchant le moins possible de l’horreur. Les images qui excitent le désir ou provoquent le spasme final sont extraordinairement louches, équivoques : si c’est l’horreur, si c’est la mort qu’elles ont en vue, c’est toujours d’une manière sournoise. Même dans la perspective de Sade, la mort est détournée sur l’autre, et l’autre est tout d’abord une expression délicieuse de la vie. Le domaine de l’érotisme est voué sans échappatoire à la ruse. L’objet qui provoque le mouvement d’Eros se donne pour autre qu’il n’est. Si bien qu’en matière d’érotisme, ce sont les ascètes qui ont raison. Les ascètes disent de la beauté qu’elle est le piège du diable : la beauté seule, en effet, rend tolérable un besoin de désordre, de violence et d’indignité qui est la racine de l’amour. Je ne puis examiner ici le détail de délires dont les formes se multiplient et dont l’amour pur nous fait connaître sournoisement le plus violent, qui porte aux limites de la mort l’excès aveugle de la vie. Sans doute la condamnation ascétique est grossière, elle est lâche, elle est cruelle, mais elle s’accorde, au tremblement sans lequel nous nous éloignons de la vérité de la nuit. Il n’est pas de raison de donner à l’amour sexuel une éminence que seule a la vie tout entière, mais si nous ne portions la lumière au point même où la nuit tombe, comment nous saurions-nous, comme nous le sommes, faits de la projection de l’être dans l’horreur ? s’il sombre dans le vide nauséeux qu’à tout prix il devait fuir… ?
Rien, assurément, n’est plus redoutable ! A quel point les images de l’enfer aux porches des églises devraient nous sembler dérisoires ! L’enfer est l’idée faible que Dieu nous donne volontairement de lui-même ! Mais à l’échelle de la perte illimitée, nous retrouvons le triomphe de l’être — auquel il ne manqua jamais que de s’accorder au mouvement qui le veut périssable. L’être s’invite lui-même à la terrible danse, dont la syncope est le rythme danseur, et que nous devons prendre comme elle est, sachant seulement l’horreur à laquelle elle s’accorde. Si le cœur nous manque, il n’est rien de plus suppliciant. Et jamais le moment suppliciant ne manquera : comment, s’il nous manquait, le surmonter ? Mais l’être ouvert — à la mort, au supplice, à la joie — sans réserve, l’être ouvert et mourant, douloureux et heureux, paraît déjà dans sa lumière voilée : cette lumière est divine. Et le cri que, la bouche tordue, cet être tord peut-être mais profère, est un immense alleluia perdu dans le silence sans fin.
NOTES DE LA PRÉFACE
1. Je m’excuse d’ajouter ici que cette définition de l’être et de l’excès ne peut philosophiquement se fonder, en ce que l’excès excède le fondement : l’excès est cela même par quoi l’être est d’abord, avant toutes choses, hors de toutes limites. L’être sans doute se trouve aussi dans des limites : ces limites nous permettent de parler (je parle aussi, mais en parlant je n’oublie pas que la parole, non seulement m’échappera, mais qu’elle m’échappe). Ces phrases méthodiquement rangées sont possibles (elles le sont dans une large mesure, puisque l’excès est l’exception, c’est le merveilleux, le miracle... ; et l’excès désigne l’attrait — l’attrait, sinon l’horreur, tout ce qui est plus que ce qui est, mais leur impossibilité est d’abord donnée. Si bien que jamais je ne suis lié ; jamais je ne m’asservis, mais je réserve ma souveraineté, que seule ma mort, qui prouvera l’impossibilité où j’étais de me limiter à l’être sans excès, sépare de moi. Je ne récuse pas la connaissance, sans laquelle je n’écrirais pas, mais cette main qui écrit est mourante et par cette mort à elle promise, elle échappe aux limites acceptées en écrivant (acceptées de la main qui écrit mais refusées de celle qui meurt).
2. Voici donc la première théologie proposée par un homme que le rire illumine et qui daigne ne pas limiter ce qui ne sait pas ce qu’est la limite. Marquez le jour où vous lisez d’un caillou de flamme, vous qui avez pâli sur les textes des philosophes ! Comment peut s’exprimer celui qui les fait taire, sinon d’une manière qui ne leur est pas concevable ?
3. Je pourrais faire observer, au surplus, que l’excès est le principe même de la reproduction sexuelle : en effet la divine providence voulut que, dans son œuvre, son secret demeurât lisible ! Rien pouvait-il être épargné à l’homme ? Le jour même où il aperçoit que le sol lui manque, il lui est dit qu’il lui manque providentiellement ! Mais tirât-il l’enfant de son blasphème, c’est en blasphémant, crachant sur sa limite, que le plus misérable jouit, c’est en blasphémant qu’il est Dieu. Tant il est vrai que la création est inextricable, irréductible à un autre mouvement d’esprit qu’à la certitude, étant excédé, d’excéder.
Georges Bataille (1956)
Mystique de Georges Bataille
Émission de France Culture Les vivants et les dieux du samedi 26 février 2005 par Michel Cazenave (réalisation : Isabelle Yhuel).
A l’occasion de la publication dans la bibliothèque de La Pléiade des Romans et Récits de Georges Bataille.
« Issu des milieux de la sociologie, et par ailleurs proche de certains courants du surréalisme, Georges Bataille a développé une pensée que beaucoup ont qualifiée d’ « athéisme mystique.
Fasciné par le Sacré, par l’imposition de la Loi et par sa transgression, par la puissance du sexe et la bienheureuse inéluctabilité de la mort, il prône un dessaisissement de tout soi-même qui mène jusqu’aux abords d’un "Dieu" qui se révèle sous la forme du déchet et de l’horreur. »
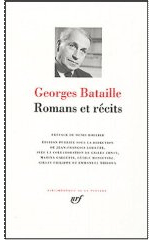 Avec Jean-François Louette, professeur de littérature française à l’université de Lyon II, directeur du volume de la Pléiade et Christian Jambet, professeur agrégé de philosophie en classe préparatoire à l’Ecole normale supérieure.
Avec Jean-François Louette, professeur de littérature française à l’université de Lyon II, directeur du volume de la Pléiade et Christian Jambet, professeur agrégé de philosophie en classe préparatoire à l’Ecole normale supérieure.
ROMANS ET RÉCITS de Georges Bataille. Sous la direction de Jean-François Louette, préface de Denis Hollier, Gallimard, "Bibliothèque de la Pléiade", 1 552 p. Comprend : Histoire de l’oeil, Le bleu du ciel, Madame Edwarda, Le petit, Le mort, La maison brûlée.
Jean-François Louette est également l’auteur d’un essai, Existence, dépense : Bataille, Sartre, paru dans le numéro spécial de la revue Les Temps Modernes (janvier-février 1999), numéro dans lequel Ph. Sollers donne un entretien important, Solitude de Bataille (repris dans Eloge de l’Infini, 2001) [9].
LIRE : Jean-François Louette, La Lecture, une pratique impensable ? (Ce texte constitue une première esquisse de l’Introduction aux Romans et récits de Georges Bataille).
On lira aussi avec intérêt l’étude consacrée au Bleu du ciel, Madame Edwarda et L’abbé C par Jean-Louis Cornille Bataille conservateur. Emprunts intimes d’un bibliothécaire.
[1] Textes repris, en avril 68, au milieu de « Logiques ». Cf. Hommage à Georges Bataille.
Un témoignage personnel : j’ai découvert Philippe Sollers à peu près en même temps que Georges Bataille : vers 1966-67. J’avais acheté « Le coupable » dans une librairie d’Aix-en-Provence ainsi que Le petit. Révélation. Peu après, à Valenciennes, j’achète « L’érotisme ». J’entends encore mon professeur de philosophie (excellent professeur) me dire : « Vous trouvez ça intéressant ? Pour moi, c’est plutôt "cochon". » « Ah bon ? Vraiment ? » Puis, au printemps de 1967, je découvre Tel Quel, numéro 29. Je feuillette la revue, je tombe sur « Le toit. Essai de lecture systématique », long texte de Sollers sur Bataille (le sous-titre est important). J’achète, je lis. Aussitôt, je me dis : « C’est là que ça se joue » Dans le même numéro, il y avait aussi « Pour une sémiologie des paragrammes » de Julia Kristeva.
J’ai eu de la chance : la suite ne l’a pas démentie. A.G.
[3] Bataille, "Le coupable", Gallimard, OC, tome V, p. 382. NDLR.
[4] Sollers ajoutait : « (...) A l’éternel retour de Nietzsche, qui est comme l’anticipation achevée et relancée, l’explosion de la culmination hégelienne, Bataille substitue l’expérience de l’instant et c’est là qu’une certaine marque surgit, sans retour. »
Proposition qu’il ne réécrirait peut-être pas dans les mêmes termes aujourd’hui après la relecture du Sur Nietzsche de Bataille et celle de Nietzsche lui-même qui nous est proposée dans Une vie divine.
Penser l’éternel retour d’une marque sans retour — la contradiction même — c’est cela aussi l’impossible.
[5] « L’auteur » évoqué est en fait Georges Bataille lui-même, le texte « Madame Edwarda » ayant d’abord été édité sous le pseudonyme de Pierre Angélique.
[6] Je m’excuse d’ajouter ici que cette définition de l’être et de l’excès ne peut philosophiquement se fonder, en ce que l’excès excède le fondement : l’excès est cela même par quoi l’être est d’abord, avant toutes choses, hors de toutes limites. L’être sans doute se trouve aussi dans des limites : ces limites nous permettent de parler (je parle aussi, mais en parlant je n’oublie pas que la parole, non seulement m’échappera, mais qu’elle m’échappe). Ces phrases méthodiquement rangées sont possibles (elles le sont dans une large mesure, puisque l’excès est l’exception, c’est le merveilleux, le miracle… ; et l’excès désigne l’attrait – l’attrait, sinon l’horreur, tout ce qui est plus ce qui est, mais leur impossibilité est d’abord donnée. Si bien que jamais je ne suis lié jamais je ne m’asservis, mais je réserve ma souveraineté, que seule ma mort, qui prouvera l’impossibilité où j’étais de me limiter à l’être sans excès, sépare de moi. Je ne récuse pas la connaissance, sans laquelle je n’écrirais pas, mais cette main qui écrit est mourante et par cette mort à elle promise, elle échappe aux limites acceptées en écrivant (acceptées de la main qui écrit mais refusées de celle qui meurt).
[7] Voici donc la première théologie proposée par un homme que le rire illumine et qui daigne ne pas limiter ce qui ne sait pas ce qu’est la limite. Marquez le jour où vous lisez d’un caillou de flamme, vous qui avez pâli sur les textes des philosophes ! Comment peut s’exprimer celui qui les fait taire, sinon d’une manière qui ne leur est pas concevable ?
[8] Je pourrais faire observer, au surplus, que l’excès est le principe même de la reproduction Sexuelle : en effet la divine providence voulut que, dans son oeuvre, son secret demeurât lisible ! Rien pouvait-il être épargné à l’homme ? Le jour même où il s’aperçoit que le sol lui manque, il lui est dit qu’il lui manque, providentiellement ! Mais tirât-il l’enfant de son blasphème, c’est en blasphémant, crachant sur sa limite, que le plus misérable jouit, c’est en blasphémant qu’il est Dieu. Tant il est vrai que la création est inextricable, irréductible à un autre mouvement d’esprit qu’à la certitude, étant excédé, d’excéder.
[9]





 Version imprimable
Version imprimable
 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?



1 Messages
Georges Bataille a été amené à déposer dans la procès qui accusait Jean-Jacques Pauvert d’outrage aux moeurs pour l’édition des oeuvres du Marquis de Sade en 1956
Bataille en défendant Pauvert, défend Sade -
extrait :
"...En effet ce qu’a innové le marquis de Sade, parce que personne ne l’avait dit avant lui, c’est que l’homme trouvait une satisfaction dans la contemplation de la mort et de la douleur. Cela peut être considéré comme condamnable et je m’inscris dans ce sens. Je considère comme parfaitement condamnable la contemplation de la mort et de la douleur ; mais si nous tenons compte de la réalité, nous nous apercevons que si condamnable que soit cette contemplation, elle a toujours joué un rôle historique considérable. J’estime que du point de vue moral il est extrêmement important pour nous de savoir, étant donné que la morale nous commande d’obéir à la raison, quelles sont les causes possibles de la désobéissance à cette règle. Or Sade a représenté pour nous un document inestimable, en ce sens qu’il a su développer et rendre sensible la cause la plus profonde que nous avons de désobéir à la raison.
Si nous considérons que cette désobéissance éclate dans les guerres et dans l’histoire, nous ne pouvons pas négliger ce fait. Vous me direz que nous avons d’autres documents qui plaident dans le même sens que Sade, mais en le démontrant par des témoignages et des documents, au lieu de le dire. Les documents médicaux-légaux d’une part, les documents ethnographiques d’autre part, les documents historiques nous montrent que l’homme a toujours trouvé une satisfaction dans la contemplation de la mort et de la douleur. <BR
Seulement ce que je tiens à faire observer ici, c’est que ces documents se trouvent sous de nombreuses formes - après tout toute l’histoire joue dans le même sens - tandis qu’au contraire l’oeuvre de Sade est unique ; l’oeuvre de Sade contraste avec tout ce qui l’a précédée. Sade est un homme qui a voulu non seulement dépeindre - et certainement il a voulu cela - dépeindre le plaisir, mais il a voulu dépeindre aussi le dilemme où était enfermé un homme qui vivait dans une société pour laquelle les provocations de la mort et de la douleur n’étaient pas rares, une société où l’injustice régnait encore.
Il s’est certainement trouvé en présence d’une contradiction, en ce sens qu’il n’a trouvé d’excuse à ses crimes, ou plutôt à ses velléités de crimes, que dans la société dans laquelle il a vécu. Cette société, il la combat, mais cependant il a participé à son esprit criminel. Mais toujours est-il que son oeuvre mérite autre chose, je crois, que le jugement de simple pornographie qu’on serait tenté de lui attribuer, au premier abord, et qui est d’autant moins justifié que la plupart du temps, n’importe qui s’essayant à la lecture de Sade se trouve plutôt soulevé d’horreur.
Il est certain que ce n’est pas le sens que la lecture de Sade peut prendre actuellement. <BR
Actuellement nous ne devons retenir que la possibilité de descendre par Sade dans une espèce d’abîme d’horreur, abîme d’horreur que nous devons connaître, qu’il est en outre du devoir en particulier de la philosophie - c’est ici la philosophie que je représente - de mettre en avant, d’éclairer et de faire connaître, mais non pas, je dirai, d’une façon très générale. Il est certain en effet que la lecture de Sade ne peut être que réservée. Je suis bibliothécaire ; il est certain que je ne mettrai pas les livres de Sade à la disposition de mes lecteurs sans aucune espèce de formalité. Mais la formalité nécessaire, demande d’autorisation au conservateur, étant accomplie, les précautions voulues étant prises, j’estime que pour quelqu’un qui veut aller jusqu’au fond de ce que signifie l’homme, la lecture de Sade est non seulement recommandable, mais parfaitement nécessaire."
Jean-Jacques Pauvert écopera pourtant de 80.000 francs d’amende outre la confiscation et la destruction de l’ouvrage saisi.
Voir en ligne : L’affaire Sade