Juillet. Remis d’une mauvaise chute de vélo, Yannick Haenel se venge en regardant le Tour de France masculin, à peine moins épargné par les chutes que le Tour de France Femmes qui vient, et c’est tant mieux, de ressusciter (Ah ! cette ascension de Van Vleuten vers la Super Planche des Belles Filles !). En attendant, il n’en poursuit pas moins ses lectures et ses chroniques. Celle sur Bataille est à lire en marge de la publication de son prochain roman Le Trésorier-payeur (que j’ai relu en regardant le Tour de France) et du colloque qui s’ensuivra en septembre à Guéret.
Me souvenant tout à coup qu’on circule beaucoup à bicyclette dans les récits de Bataille, je jette un oeil sur la Toile (Revue des Deux mondes, mai 2012) et je tombe sur ce « rêve » que j’ai retrouvé au début du Tome II des Oeuvres complètes :
« Dans la rue devant la maison que nous habitions à Reims. Je pars en bicyclette. rue pavée et rails de tramways. très embêtant pour la bicyclette. rue pavée on ne sait où aller à droite ou à gauche. multiplication des rails de tramways. Je frôle un tramway mais il n’y a pas d’accident. Je voudrais arriver à l’endroit où après un tournant il y a une route lisse mais désormais il est sans doute trop tard et l’admirable route lisse sur laquelle on va puis redescend avec la vitesse acquise [est] maintenant pavée. En effet lorsque je tourne la route n’est plus comme autrefois on la refait mais pour la refaire on l’a transformée en une immense tranchée de laquelle sortent de très forts _|¯|_ [...] »
Je passe sur la suite qui vire au cauchemar [1]...
Il y a moins de pavés à Reims qu’au début du siècle dernier, mais la circulation à bicyclette n’en est pas plus aisée. C’est pourquoi, de peur de tomber, j’évite, à regret, la bicyclette. Même si je sais que Jacques Henric qui « aime les hommes qui tombent » ne parlera pas de moi dans son prochain feuilleton d’art press.


Guérison du chroniqueur
Yannick Haenel
Mis en ligne le 6 juillet 2022
Paru dans l’édition 1563 du 6 juillet

- Hans Bellmer, étude pour Histoire de l’Oeil
de Georges Bataille, vers 1946.
Chers amis, après deux semaines d’absence dues à un accident de vélo (plusieurs côtes cassées, sept points de suture au menton et une infection à la main qui a salement dégénéré), me voici de nouveau d’attaque. Je ne sais si le mot « attaque » est le bon : comme je me remets tout juste à écrire, mon esprit est encore balbutiant. Disons que me voici de nouveau disponible pour observer le délire ordinaire du monde, et témoigner pour vous de ses beautés inattendues.
À ce propos, je note que tandis que je pansais mes plaies, la plupart du temps allongé dans mon lit (« Comme d’habitude », me fait remarquer notre vénéré rédacteur en chef, Gérard Biard), le monde n’a pas cessé d’être fou : alors qu’elle venait me chercher aux urgences, ma femme s’est fait agresser dans la rue. Et comme j’avais aussi perdu ma carte de crédit pendant mon accident, car le type qui m’a aidé à me relever cette nuit-là en a discrètement profité pour me la chaparder, je n’ai rien acheté depuis deux semaines. Vivre au lit : avenir de la décroissance !
Entre deux accès de violence du monde et de montée des prix, je me suis quand même glissé dans une salle de cinéma pour revoir La Maman et la Putain, de Jean Eustache (1973), enfin visible sur les écrans après cinquante ans de versions piratées.
Je ne sais si vous l’avez vu, peut-être hésitez-vous à cause de sa durée extravagante (trois heures quarante), mais franchement c’est une après-midi ou une soirée qui en vaudra la peine. Je ne connais pas de film – sauf peut-être ceux de John Cassavetes – qui montre d’aussi près la vie de ses personnages : on est avec eux, au lit (Gérard Biard s’esclaffe) ou dans les cafés de Paris, on boit leurs paroles incessantes, on aime leurs histoires de cœur comme une épopée existentielle. Le sujet : le désir, l’ivresse, la nuit. La vie est une insomnie bavarde, saturée d’excès, d’amour et de fatigue. La pâleur de Jean-Pierre Léaud, de Bernadette Lafont et de Françoise Lebrun est la couleur adorée du déchirement.
Et tandis que je guérissais, j’ai appris la mort de Jean-Louis Schefer, l’un des plus grands écrivains français, l’un des plus secrets aussi (nous sommes quelques-uns à le lire passionnément, et nous serons toujours plus). Ses livres sur Chardin, sur le Corrège, sur Paolo Uccello ou sur le cinéma sont des merveilles.
Qu’aurait donc écrit Jean-Louis Schefer s’il avait revu La Maman et la Putain ? L’émotion d’un spectateur est aussi riche que le cœur d’un prince dans Shakespeare. Il faudrait toujours raconter ce qu’on ressent au sortir d’un film. « Il faut que ça se sache », comme le dit Jean-Pierre Léaud à propos de tout autre chose. Il faut que nos amours continuent à nous inspirer des romans. Il faut que la féerie s’empare de nos fragilités, et qu’à la violence du monde réponde le bonheur des détails. Le cinéma, la peinture, la littérature : l’amour, le cœur, la joie.


Georges Bataille, le plus libre
Yannick Haenel
Mis en ligne le 13 juillet 2022
Paru dans l’édition 1564 du 13 juillet de Charlie
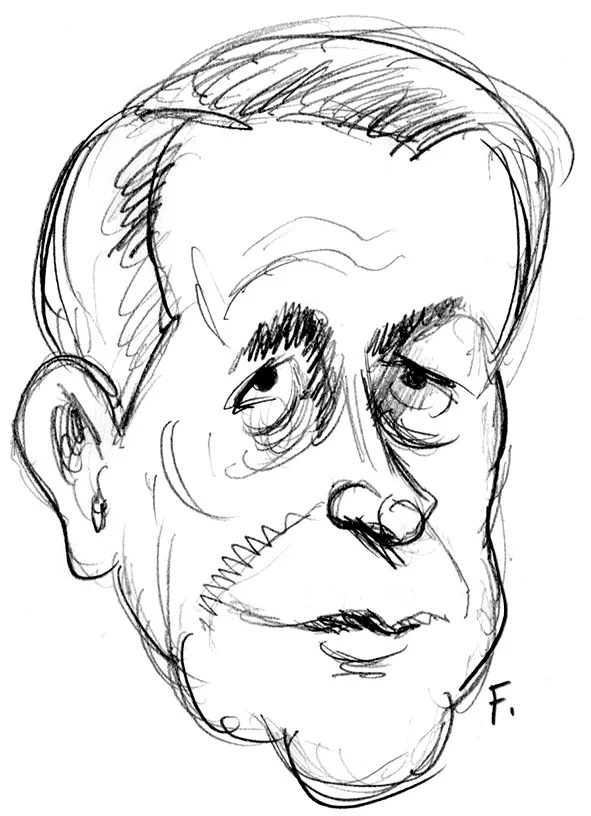
J’aurais pu choisir Rimbaud ou Saint-Just, car la liberté d’un homme va aussi loin que le langage dont il est capable. Mais celui que j’estime le plus libre de tous les hommes, et que j’admire le plus, car sa liberté, en m’inspirant, se transmet à moi comme elle se transmet à toutes celles et à tous ceux qui cherchent à l’agrandir en eux, et à faire de leur vie une expérience radicale, c’est Georges Bataille (1897–1962).
Il n’a pas bâti d’empire ni déclenché de révolution ; il n’a rien fait d’« utile » sinon inspirer du mauvais esprit à ses lecteurs, bouleversant les « notions consciencieuses », mettant le feu à leurs désirs.
C’est un « écrivain », c’est-à-dire beaucoup plus qu’un simple publieur de livres : quelqu’un qui vit l’aventure du langage comme insubordination et comme destin. Il a écrit des récits érotiques parmi les plus extatiques : Histoire de l’œil (1928), Madame Edwarda (1941). S’est intéressé à Hegel, à Lascaux et à Sade. A créé, avec Michel Leiris et contre les surréalistes, la plus belle revue du monde : Documents (1929–1931). A découvert des gisements de pensée inédite et déchaînée en écrivant L’Expérience intérieure (1943), La Part maudite (1949) ou Les Larmes d’Éros (1961). A compris que le monde des amants était plus souverain que la politique.
Ni dieu ni maître, c’est-à-dire – si l’on veut être rigoureux – ni production ni épargne. Cesser de produire, de consommer, d’économiser : dépense à l’état pur.
La liberté ne se vote pas, ne se décrète pas : elle s’éprouve à travers le degré de poésie dont on est capable à chaque instant.
Georges Bataille n’a tremblé devant aucune idée – c’est-à-dire devant aucun pouvoir. L’amplitude de sa pensée le met largement au-dessus de Sartre ou de Camus, ses collègues qui auront persisté à se représenter le monde en termes politiques. Bataille a compris, dès Hiroshima, que le vieux monde avait implosé et que les Temps modernes avaient tourné au démoniaque.
La société nous étouffe, elle est peuplée d’hommes de paille qui se mentent à eux-mêmes sur fond de renoncement terrifié. Aucune politique ne sera plus jamais à la hauteur de ce que nous exigeons désormais comme liberté vivable. C’est pourquoi, avec Bataille, je ne respecte rien de ce qui émane de ce secteur ; et rien non plus de ce qui se prétend capable de parler pour les autres. L’anarchiste en moi ne reconnaît partout que des fripouilles désemparées. La planète implose par la faute des humanoïdes ; alors qu’ils ne viennent pas nous culpabiliser.
S’il est possible d’anéantir intégralement en soi le désir de se raccrocher à quelque valeur, un homme l’a fait, et cet homme c’est Bataille. Je me répète sa phrase avec joie, on croirait entendre rire Charlie : « Le monde n’est habitable qu’à la condition que rien n’en soit respecté. »


La science des étés
Yannick Haenel
Mis en ligne le 20 juillet 2022
Paru dans l’édition 1565 du 20 juillet
C’est l’été, j’ai envie de silence. Les humains n’arrêtent pas de la ramener, ils blablatent, ils sont lourds, surtout les politiques : Cioran dirait qu’ils bricolent dans l’incurable. Faut-il attendre le mois d’août pour qu’ils se la ferment ? En allumant la télé, le 14 juillet, pour suivre l’étape du Tour de France, je suis tombé malencontreusement sur l’interview de Macron. Alors même que tout implose, que le pays est déchiré entre ses tentations extrémistes et que la pauvreté commence à dévorer la vie des classes moyennes, il avait l’air très content : un paon, me suis-je dit, un dominant décomplexé. J’ai pensé à la phrase du milliardaire américain Warren Buffett : « Il y a une guerre des classes, c’est un fait, mais c’est ma classe, celle des riches, qui mène cette guerre, et nous gagnons. » L’autosatisfaction n’est-elle pas une forme particulièrement vulgaire d’impunité ?
En attendant la grève générale et le prochain krach financier, je me consacre donc au silence. Le matin, écriture ; l’après-midi, Tour de France ; le soir, lecture de Proust. Certains jours, grand style : je mélange ces trois occupations, j’enlève le son de la télé et allongé sur mon divan, pendant des heures, je passe du peloton à Proust, et je prends des notes pour mon prochain livre. Ainsi ai-je regardé, volets fermés, la montée vers l’Alpe-d’Huez en suivant les aventures comiques du narrateur avec Albertine et ses amis aristocrates.
L’approche du bonheur n’implique-t-elle pas la fixité ?
Je viens d’ailleurs de tomber sur cette phrase que je recopie pour vous : « L’existence n’a guère d’intérêt que dans les journées où la poussière des réalités est mêlée de sable magique. » C’est dans À l’ombre des jeunes filles en fleurs. L’approche du bonheur n’implique-t-elle pas la fixité ? Bouger le moins possible : se taire, faire la sieste. C’est la science des étés.
À LIRE AUSSI : Proust et « Charlie »
Existe-t-elle la joie qui dure et que personne ne rompt ? J’y crois : répéter chaque jour les mêmes gestes lents vous conduit à la béatitude. Les croyants ont leur prière, j’ai mon sable magique. Ténuités, douceur, lumières fraîches. Murmure des émotions ralenties. L’amour du temps est dévoilé par l’absence même d’emploi du temps. C’est lorsqu’on parvient enfin à ne plus rien faire, lorsqu’on est intégralement disponible à ce rien, sans qu’aucun projet, pas même l’ennui, ne s’intercale entre soi et le vide, que le temps se donne. Il est alors à l’état pur : on n’a plus seulement le temps, on le devient – on est le temps. Franchement, qu’y a-t-il de plus beau, l’été ? Aucun besoin de se ruiner pour louer une chambre sur une île grecque ou un parasol sur une plage italienne : avec mon sable magique, le temps me sourit où je veux. Je suis partout chez moi, surtout dans mon salon. Le temps existe sans moi, il est là, libre et poudreux, et je m’efface à l’intérieur, comme une étoile.


Une lumière orangée
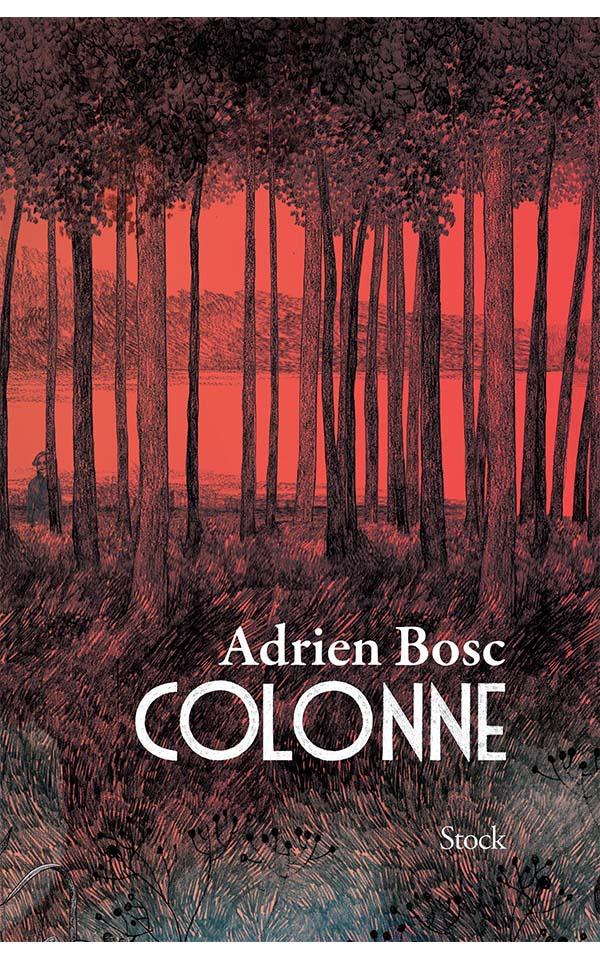
Yannick Haenel
Mis en ligne le 27 juillet 2022
Paru dans l’édition 1566 du 27 juillet
Il y a parfois de petits miracles. Dans la pile des livres qui s’amoncellent au pied de votre lit, l’un d’eux attendait depuis des mois. La pile s’écroule, vous ouvrez le livre et vous ne le lâchez plus pendant trois heures. Joie totale. La littérature est comme l’amour : elle comble.
Le roman s’appelle Colonne, d’Adrien Bosc, il est publié aux éditions Stock, il fait un peu plus d’une centaine de pages, et chacune d’elles vous lance vers l’aventure, comme lorsque vous lisiez, enfant, des romans de Stevenson, couché sur le ventre durant les après-midi d’été.
À LIRE AUSSI : Goethe et la liberté
Il y a cette phrase qui m’a sauté au visage lorsque j’ai ouvert le livre au hasard : « Il ne peut y avoir de cause juste qu’on ne salisse un jour par nécessité de la voir triompher. » Cette salissure, c’est le sujet de ce roman qui revient sur la guerre d’Espagne, sur 1936, sur l’affrontement infernal entre les phalangistes et les républicains. Adrien Bosc nous jette dès les premières phrases dans le quotidien guerrier de la célèbre colonne Durruti, composée de volontaires antifascistes et d’anarchistes engagés contre les rebelles nationalistes.
VOIR SUR PILEFACE
Parmi ces anarchistes, il y a la philosophe Simone Weil, intrépide, innocente, sacrificielle, admirée par Bataille et Camus, qui, toujours, « craignait davantage de fuir le péril et le malheur que de s’en protéger », et qui, lors d’une offensive en Aragon, se blesse en plongeant le pied dans une bassine d’huile brûlante.
On suit passionnément la vie de cette femme qui se consume pour les humbles et, en parallèle, la trajectoire de Georges Bernanos (lui aussi a une jambe de douleur) qui vit alors à Majorque, qui, politiquement, appartient au camp adverse (il est royaliste) et qui, pourtant, dénoncera dans Les Grands Cimetières sous la lune les atrocités commises par les nationalistes.
La beauté de ce livre qui s’ouvre à un montage de chemins narratifs, et qui retrouve, vous verrez, Angel Caro, le jeune assassiné de l’histoire, c’est de nous plonger au cœur de cette ambiguïté des causes salies.
Dans le portefeuille de Bernanos, on retrouvera à sa mort une lettre que Simone Weil lui avait envoyée, lettre imprimée au milieu du livre comme son âme en feu, lettre stupéfiante, d’une sagesse folle, d’une grandeur d’esprit renversante et d’une intensité de cœur telle que la guerre et les hommes y sont remis à leur place dérisoire.
Simone Weil a vu ses amis commettre des atrocités ; elle ne s’en remet pas : une cause ne peut être juste si elle assassine, même en temps de guerre. « Quand on sait qu’il est possible de tuer sans risquer ni châtiment ni blâme, déplore-t-elle, on tue ; ou du moins on entoure de sourires encourageants ceux qui tuent. » Ce sourire est la trace de l’infamie. Mais pour les êtres qui ont su maintenir le crime loin d’eux, une lumière orangée passe dans le livre : c’est la vérité vivante.
À LIRE AUSSI : Jean Birnbaum : « La vraie lâcheté, c’est l’arrogance idéologique, la vraie impuissance, c’est le fanatisme »


Toutes les chroniques de Yannick Haenel dans Charlie
Toutes les chroniques de Yannick Haenel dans Pileface


BONUS
Jean Douchet, À bicyclette
Court-métrage, 2009. Avec Benjamin Siksou, Claude Chabrol et Xavier Beauvois.
À bicyclette : Un jeune homme schizophrène en voie de rémission se voit pris par une obsession pour les vélos. Il se remémore un souvenir d’enfance où il sort traumatisé par son impossibilité à pédaler. Malgré tout, il tente à nouveau de monter à vélo et chute. Il finit à l’hôpital. Deux incroyables bonshommes vont alors prendre le relais, et l’aider par la magie du septième art afin d’éviter toute « rechute ». Petite leçon sur le cinéma d’Ozu et de Keaton.

[1] « Notes en rapport avec Le Coupable », rédigée en 1927, vers juin. Ce récit de rêve doit être sans doute rattaché à la psychanalyse que Bataille venait de commencer sous la direction du Docteur Borel. (p. 413).




 Version imprimable
Version imprimable


 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?


