Après la lecture du très beau texte de Frédéric Berthet Kafka, histoire d’un corps qui date de 1978 et que Yannick Haenel a eu l’heureuse idée de publier dans sa nouvelle revue Aventures, j’ai pensé qu’il était bon de redécouvrir ce rare et excellent écrivain à travers la longue "Conversation à Notre-Dame" qu’il eut avec Sollers, également en 1978, et la présentation de certains de ses écrits. Voici l’article que je lui consacrais en 2015, actualisé.
Au printemps 1995 sort le numéro 49/50 de L’Infini, contemporain de la publication de Histoire de « Tel Quel », de Philippe Forest. Il réunit différents témoignages d’écrivains ou d’intellectuels qui ont participé, directement ou indirectement, à l’aventure de Tel Quel ou, du moins aux « années Tel Quel » (1960-1982, 94 numéros). Sur la couverture de L’infini figure la reproduction du numéro 83 de Tel Quel, publié au printemps 1980, qui portait lui-même, en couverture une photographie de James Joyce. Joyce est donc désigné comme celui qui sert de fil rouge « de Tel Quel à L’Infini » [1]. À l’intérieur, un témoignage attire l’attention, celui de Frédéric Berthet qui, en 1995, a quarante ans et a déjà publié dans la collection L’infini trois livres : deux recueils de nouvelles, Simple journée d’été et Felicidad, et un roman, Daimler s’en va, qui obtint, en 1988, le Prix Roger Nimier. En 1989, Sollers lui a confié la coordination du numéro 26 de L’Infini consacré à vingt-deux jeunes écrivains d’une hypothétique « Génération 89 ». Le bandeau rouge du numéro dit : « Nous voilà ».
En 1995, Berthet, de son propre aveu, n’a « pas grand-chose à dire » sur Tel Quel ou L’Infini. Son texte, qui est bref, est une réflexion sur un art en perdition (aussi bien dans la vie que dans le roman), celui de la conversation. C’est donc la présentation d’une des nombreuses conversations que l’auteur a eues avec Philippe Sollers. La « Conversation à Notre-Dame » eut lieu en 1978, le 14 août précisément, veille de l’Assomption. Le pape Paul VI est mort une semaine auparavant, le 6 août, jour de la Transfiguration du Christ. Ses funérailles ont eu lieu le 12 août. La mort du pape est donc le prétexte pour lancer, si on peut dire, la conversation. C’est à ma connaissance le premier texte où Sollers parle aussi longuement d’un pape, et de celui-là, qui, en 1965, inscrivit le nom de Dante dans le baptistère de Florence et qui vient d’être béatifié par le pape François (le 19 octobre 2014 [2]). Une vraie conversation a lieu entre les « vivants » (parfois), mais aussi avec les « morts ». Au cours de celle-ci, à Notre-Dame, surgissent trois ou quatre autres « personnages » : Joyce (le revoilà), saint Augustin et saint Ambroise. « Une vraie, une bonne, une excellente conversation ne serait ni plus ni moins que de la pensée [...] en acte, en mouvement, en expérimentation, de la pensée en vie » écrit Berthet dans son texte liminaire.
La preuve.

- Frédéric Berthet © Jacques Sassier, Gallimard.
14 août 1978
FRÉDÉRIC BERTHET
Conversation à Notre-Dame
Tout commence par une conversation, se continue par une conversation, et vraisemblablement s’achève sur une conversation.
Vraisemblablement. Car, s’achève ? Voire.
D’ailleurs, de temps en temps, on peut se plaire à imaginer divers dialogues entre des personnages ayant vécu à des siècles différents. Ou bien, d’un autre point de vue, il est toujours possible d’avoir par jour plusieurs heures de conversation avec Baudelaire ou Balzac ou Kafka, de manière simple, directe, non occulte, immédiate, spontanée.
Une vraie, une bonne, une excellente conversation ne serait ni plus ni moins que de la pensée (terme aussi balzacien) en acte, en mouvement, en expérimentation, de la pensée en vie.
Ce pour quoi il y a si peu de conversations.
Le grand succès social, sociologique, de la psychanalyse appliquée ou de ses dérivés (talk-shows télévisés, confessions au rabais) est dû, au fond, à ce que les gens y parlent tout seuls. Ils ne cherchent pas avec qui parler, mais à qui parler, ce qui est tout à fait différent. C’est-à-dire qu’ils ne veulent absolument pas avoir de conversation - et encore moins de pensée. Pour leur excuse, il faut reconnaître qu’on les y encourage.
Il y a une obscénité de la pensée qui n’est pas celle du « débat d’idées ».
Quand aujourd’hui on dit : « Je pense que... », il s’agit seulement d’une prudente porte de sortie, au cas où il deviendrait plus opportun de retirer précipitamment ce qu’on vient de dire.
Balzac : de la pensée comme volonté.
Le roman contemporain (« mondial ») utilise peu les ressources de la conversation. Ou alors celle-ci y est réduite à des inepties. Ces inepties sont supposées « faire avancer l’action ». Donc les personnages n’y disent rien, sinon diverses révélations abominables qui préludent au drame ou à la solution (finale ?), par exemple : « Mais tu ne savais pas que Samantha était la fille de Jacques ? » Non, il, ou elle, ne savait pas. Patatras !
Pourtant, les épileptiques de Dostoievski n’étaient pas mauvais, dans leur genre.
Ou bien, encore fallait-il restituer aux parlottes habituelles leurs dimensions de folie : en ce cas, le microphone tournant de Proust, dans les dîners justement dits mondains, donnait des résultats étonnants.
Ou enfin, à mi-chemin, les romans de Waugh ou de Greene (Graham) savent parfois exploiter à merveille [es décalages, les sauts logiques, les rapidités entre chaque réplique.
Je laisse de côté, pour le roman contemporain, le cas des romans historiques, dont Balzac fit la théorie en attribuant à Lucien de Rubempré L’Archer de Charles X, et qui consiste à écrire des choses que l’on n’a jamais ressenties.
Dialogues chez Nabokov : voir Ada ou l’Ardeur.
Dans la mesure où j’avais à peine six ans quand s’est fondé, en 1960, le mouvement (ou plus exactement la revue) Tel Quel, inutile de dire que je n’ai participé que d’une façon assez lointaine à ses débuts, puis à son développement.
En revanche, lorsqu’en 1977 je me suis trouvé nez à nez avec son directeur Philippe Sollers, de manière inopinée et relativement froissante (traquenard !), ce fut le début de nombreuses conversations.
J’aimerais bien me souvenir de toutes (et je m’en souviens probablement). Dès qu’il fut acquis que je n’étais pas un œdipien forcené (première conversation), une relative confiance put s’établir. Les meilleurs déjeuners commençaient vers midi, se terminaient vers quatre heures (sortie de l’aquarium, sombre et au fur et à mesure devenu désert et tranquille, de la Closerie des Lilas, clignant des yeux dans la lumière du jour). Un retour de la Pitié-Salpêtrière, en terrasse aux Deux-Magots, côté rue Bonaparte, très belle fin de matinée, ce jour-là pas un mot échangé. Grands amusements, déclics, victoires instantanées, triomphes d’Alexandre entrant à Babylone, déchirures du temps, trouvailles, systèmes aléatoires, points de grammaire, énigmes. Ou la formule dite du rendez-vous téléphonique, en plein été, tel jour telle heure (car la conversation exige la ponctualité), le temps de se servir avant un petit scotch, chacun de son côté. Et puis un suivant, mais dans ce cas-là c’est l’autre qui rappelle, et ainsi de suite. Un peu comme deux personnes, habitant aux deux bouts de la ville, se raccompagnent sans cesse, à la lueur des réverbères - figure bien connue, et bien peu pratiquée.
Mais dans la mémoire, qui en ce cas devient la libre, accorte, fuyante et obéissante servante de la pensée, toutes ces conversations n’en font qu’une, sans qu’on puisse, au total, en arrêter le mouvement, comme le grand jeu en spirale des saisons.
Donc, de Tel Quel, ou de L’Infini, je n’ai pas grand-chose à dire, sinon des trucs élémentaires : une revue est une arme de guerre ; dans tout combat il faut des fantassins, et « ô combien de marins... » ; les écoles littéraires apprennent au mieux à lire, ce qui est déjà énorme, mais pas à écrire ; parfois mieux vaut faire quelque chose plutôt que rien ; avoir pignon sur rue ; et même : « le loup mourra dans sa peau », très vieux proverbe français qui sonne agréablement aux oreilles, aux oreilles longues, pointues, mobiles, attentives, frémissantes, dressées contre le vent.
Mais, hors toute évocation typiquement a-temporelle, ou non chronologique (procédé déjà largement utilisé dans les quelques lignes qui précèdent), il se trouve qu’une seule de ces conversations [3] que j’ai tenté de rendre sensibles a été enregistrée, transcrite et publiée. C’était le 14 août 1978. J’avais tout juste encore vingt-trois ans (une année de moins qu’il y a d’heures dans la journée). Ce qui ne nous rajeunit pas. Quoique...
CONVERSATION À NOTRE-DAME
New York, 31 octobre 78
Cher ami,
Décidément, c’est encore moi... Il vient de m’apparaître que l’illustration qui s’impose pour notre Conversation est la Vue de Notre-Dame de Matisse (été 1914). Je viens de la revoir au Musée d’art moderne, ici. C’est évident, pour plusieurs raisons.
Amitiés,
Ph. S.
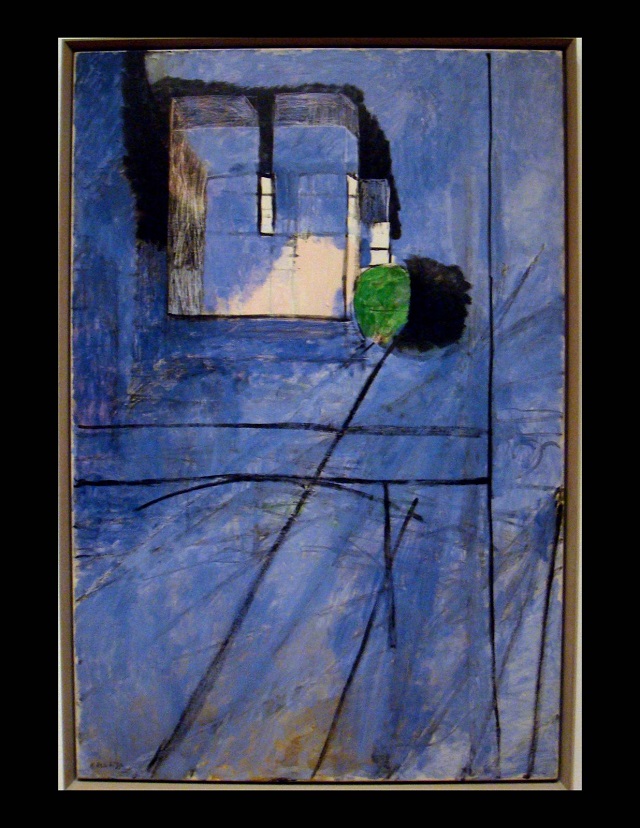
Henri Matisse, Vue de Notre-Dame, 1914.
ZOOM : cliquer sur l’image.

Notre-Dame, le 14 août 1978. Dans la matinée.
Mort du pape (I)
Ph. S. — Drôle d’endroit...
F. B. — Drôle d’endroit ?
Ph. S. — Oui, parce que c’est quand même de plus en plus visiblement aujourd’hui l’envers quasiment de plus en plus absolu de notre petite aventure occidentale... Vous avez regardé les funérailles du pape à la télévision ? Mise en scène particulièrement remarquable. Vous savez que c’est la première fois que des funérailles de pape se déroulent non pas à l’intérieur de Saint-Pierre, mais dehors, sur le parvis ; et de telle façon que ce qui s’est passé est assez nouveau par rapport à la tradition de l’enterrement. Il y a donc eu cette manifestation très forte de la part de l’appareil catholique, qui a consisté à mettre Paul VI dans un cercueil très simplifié, dans une boîte, posée par terre sur un tapis d’Orient (j’aimerais bien savoir exactement quel tapis), avec l’Évangile ouvert sur la boîte, et simplement un grand cierge un peu décalé par-derrière. Vous avez donc quatre éléments de mise en scène : la boîte contenant le corps, le livre ouvert sur la boîte, le tapis d’Orient et le cierge derrière. Et cela a donné lieu à un incident extrêmement intéressant, justement parce que l’enterrement avait lieu, donc, dehors (du latent on est brusquement passé au manifeste) : au moment où la cérémonie a été terminée, et remarquablement organisée — avec un sens des médias qui prouve que les jésuites sont très en avance dans l’audiovisuel : c’est, entre parenthèses, aussi bien fait que l’art de propagande des Brigades rouges, très bonne réponse aux Brigades rouges — alors que le PCI en est encore aux affiches hypocrites sur les murs pour exprimer ses condoléances, des affiches de deuil, pour la mort du pape... Donc ça a donné lieu à l’incident suivant, calculable mais insolite, après... ah, tout de même, après qu’eut résonné le rite en araméen, parce que brusquement sur la place Saint-Pierre après le latin et les modulations en français, anglais, allemand, italien, espagnol, et Dieu sait quoi, modulations dans les différentes langues qui auraient ravi Joyce s’il avait été là, après cela il y a donc eu la proclamation araméenne, ce qui quand même, avec le tapis d’Orient, donnait un son extrêmement curieux — vous imaginez Saint-Pierre de Rome, avec ce qu’il y a de sédimentation — entendre tout à coup la psalmodie arabe, le catholicisme en araméen, c’est quelque chose. Tout à coup ce décalage de deux mille ans, avec une atmosphère orientale, le cercueil sur son tapis persan... Il s’est donc produit cet incident insolite, quand on a repris le cercueil pour l’enterrer à l’intérieur, qu’ont fait les deux cent mille personnes qui étaient là ? Elles ont applaudi. Elles ont applaudi parce qu’elles en avaient l’habitude, quand le pape apparaissait de temps en temps au balcon et puis de toute façon il n’est pas mort, puisque la doctrine dit qu’il est par définition ressuscité... Vous avez donc eu, en gros plan, une simple petite boîte à l’intérieur de laquelle il y avait un cadavre, en train d’être applaudie par deux cent mille personnes... Vraiment extraordinaire, plan extravagant, car à ma connaissance on n’a jamais vu deux cent mille personnes applaudir un cercueil... et qui m’amène à penser que cette affaire-là est quand même beaucoup plus coriace que ne le croyaient les révolutionnaires de 89-94, qui ont fini par se demander comment se substituer à ce signifiant-là, avec le culte de l’Être suprême... Ce qui a donné lieu notamment à l’abandon du calendrier grégorien, cette incroyable tentative de refaire le calendrier, Messidor, Fructidor, Thermidor... Thermidor au sens politique, maintenant, sans lequel Sade aurait été guillotiné par de sinistres crétins du genre du Père Duchesne — Sade, vous le savez, a été condamné à mort par Fouquier-Tinville, comme girondin. J’attache une énorme importance, quant à moi, et ici, au fait que Sade ait été sauvé finalement par Notre-Dame... Alors, voilà, la cantatrice sur l’autel (Mlle Maillard), la fête de la déesse Raison, c’est du moins comme ça que je perçois la chose — et notre incursion aujourd’hui — c’est une proposition pour le décor...
F. B. — On pourrait mettre aussi Claudel derrière son pilier...
Ph. S. — Mais Claudel derrière son pilier, en effet, on pourrait dire qu’il communique, bien entendu sans le savoir, avec Sade, dans une même répugnance pour l’aplatissement du langage.
F. B. — Étant entendu qu’on ne se répond jamais, je voudrais vous répondre par ce que j’ai entendu, la même histoire, celle que vous racontez, mais ici même. Ici aussi il y a les cierges, le livre n’est pas loin, on peut imaginer que le tapis...
Ph. S. — Le tapis, c’est très important...
F. B. — II y a des tableaux, c’est-à-dire des tapis dressés, et enfin une boîte, ce petit magnétophone, et quelque chose dedans, quelque chose qui se passe, de la parole qui s’enroule en bandelettes... autour d’un mort. Dans ce que vous venez de mettre en place, ce qui m’apparaît c’est combien ça répond exactement à l’une des pratiques les plus... humaines de la parole, et qui est celle-ci : qui enterre-t-on ? C’est une question qu’il est possible de poser de droit à toute parole. Et surtout lorsque des noms propres arrivent dans le discours, comme ils sont effectivement arrivés, Paul VI, Sade, Robespierre : là aussi il y a de la stratification, comme à Saint-Pierre... Vous savez que le pape a voulu se faire enterrer à même la terre, et qu’il a été très dur de creuser un trou dans le sol surpeuplé pour arriver à y glisser un cadavre de plus, à le faire passer en somme, quand il y en a déjà tellement d’empilés, et que les vivants viennent parler du dernier enterrement, juste au-dessus... Il faudra se demander tout à l’heure comment, malgré tout, ne pas faire d’une conversation un cimetière. Parce que, tout de même, si on passe son temps à enterrer, il y a toujours des passages à blanc entre deux enterrements, comme on est aujourd’hui, 14 août 1978, entre deux papes... Autre chose : une des questions que je pouvais me poser, en venant ici, était, non pas : de quoi allons-nous parler ? mais : de quoi n’allons-nous pas parler ? Puisqu’il est bien entendu, d’autre part, que ce qui peut faire communauté, ou disons parodie de communauté provisoire, va se définir non pas par ce dont on parle, mais par ce qu’on tait. On va s’entendre sur ce qu’on ne va pas dire. Voir Totem et Tabou. Naturellement, parler d’entrée de jeu d’un mort, d’un enterrement, puisque c’est bien de cela qu’il s’agit, produit, disons, des effets de surexposition importants, mais il n’est pas sûr que ça ne produise pas des post-refoulements...
Ph. S. — II s’agit d’un mort très particulier, parce que évidemment, le réflexe d’applaudissement est doctrinalement fondé : la résurrection. Alors de deux choses l’une, on y croit ou pas, mais enfin les gens qui sont là sont censés y croire, ou du moins faire fonctionner la machine de telle façon qu’elle adhère à son sens. Donc le pape n’est pas mort, au sens où en général on pratique des rites funéraires et une parole par rapport à la mort. Il y a là un coup pratique qui à mon avis n’arrête pas depuis deux mille ans de distribuer les enjeux de la parole sur terre, qu’on hyperbolise la chose ou qu’on la dénie.
F. B. — Oui mais, quand vous écrivez, vous parlez d’un mort, ou pas ?
Ph. S. — Pas du tout, absolument pas. Jamais de la vie !
F. B. — II y a de plus en plus de monde dans les travées. Alors, on sera de toute façon aujourd’hui dans un endroit très peuplé, mais absolument en retrait... de l’écrit ?
Ph. S. — Oui, justement.
F. B. — Je me demandais avec curiosité comment vous feriez circuler le pape dans ces allées où on se promène...
Ph. S. — Ces années ?
F. B. — Ces allées.
Ph. S. — Dans ces allées... Le pape, lequel ?
F. B. — Le mort...
Ph. S. — Mais il n’est pas mort, je vous dis, il est probablement dans quelque cercle du Purgatoire ou du Paradis, c’est difficile à déterminer... Vous avez lu son testament [4] ? Le Monde a écrit que ce testament était inspiré de Dante. Je n’ai pas vu en quoi. C’est en tout cas ce pape qui est allé, en 1965, poser une plaque, à l’intérieur du baptistère Saint-Jean à Florence, commémorative du 700e anniversaire de la naissance de Dante... Je vous réponds quand même, indirectement... Mais je voudrais faire un petit détour sur Notre-Dame et la Révolution... Voilà, j’y pensais en lisant les épreuves d’un très bon livre qui va paraître, de Laurent Dispot, la Machine à Terreur, sur la question du terrorisme, au fond ça tourne autour de la guillotine, intéressante machine...
F. B. — qu’on appelait ’la Veuve" : je dis ça parce que demain c’est la fête de la Vierge...
Ph. S. — Voilà, justement, nous y sommes... Alors Dispot montre très bien qu’il y avait un choix très simple à l’époque de la thermodynamique entre la machine à vapeur et la machine à terreur, et qu’en somme l’Angleterre s’est prémunie de l’une en inventant l’autre. Ce qu’il faut voir dans cette histoire, c’est qu’au plus fort du fonctionnement de la machine, de la guillotine — dont Kafka naturellement tracera plus tard la signification complète dans la Colonie pénitentiaire —, il a quand même fallu se pointer à Notre-Dame pour essayer d’introniser en quelque sorte transcendantalement, de façon incarnée, la signification de la machine, et il y a entre le plein fonctionnement de la coupe en plein corps et la tentative de faire irruption sur l’autel de Notre-Dame une coïncidence tout à fait bizarre. Au moment même où la machine fonctionne à plein tranchant, voilà qu’on essaie de mettre tout de même une femme, la Femme, à la place de la Vierge Marie... Et au moment même où on se la met là, la Femme, en chair et en os, on peut dire que c’est le moment où la Veuve en effet n’en finit pas de fonctionner, mais alors avec une répétition inquiétante, puisque Robespierre va bientôt y passer lui-même (l’histoire de l’Être suprême, c’était trop tard par rapport à la déesse Raison).


Mort du pape (II)
Ph. S. — Donc supposons que l’Église catholique décide de mettre en vente la totalité de ses biens, les tableaux, les ciboires, les monuments...
F. B. — Mais aussi les sociétés, les actions...
Ph. S. — Même pas, ne prenons que le stock, le capital constant. Supposons que ceci soit mis en vente, problème très singulier (c’est celui de la simonie, Dante ne pense qu’à ça, justement), eh bien la masse monétaire ainsi constituée serait, non seulement difficilement chiffrable, mais en tout cas telle qu’aucun Etat, et même tous les États réunis ne seraient pas en mesure de l’acheter. C’est intéressant parce que ça pose, entre autres, le problème de la chiffration, de l’évaluation de l’art. Bien. Je voulais montrer par là à quel point toutes les conversations sont historiquement surdéterminées par cette prévalence de l’Église catholique, qu’on y adhère ou qu’on la dénie. Et que donc, en un sens, on ne parle que de ça.
F. B. — Sans en parler ?
Ph. S. — C’est pour ça que j’en parle. Je crois possible de démontrer que ça ne parle que de ça, évidemment avec des relais, des indirections, des arborescences de subordonnées... Et je dirais même que sur le divan aussi, ça ne parle que de ça, évidemment sous une forme plus concentrée que dans les conversations normales... C’est pour ça que le divan analytique est une machine à senseur ; une invention au sens fort du terme, qui devrait faire apparaître ce que je suis en train de dire d’une manière irréfutable : je dis bien devrait, parce que l’enjeu est tel...
F. B. — La question est tout de même de savoir si, en en parlant, en ce moment, par exemple, vous en parlez — vous en parlez sans reste. En faisant venir, comme tout à l’heure, le mort sur la table d’opération, qu’est-ce qui restera toujours ombré par ce coup d’éclairage...
Ph. S. — Sans reste, sûrement pas, bien sûr, il y a toujours du reste, mais on peut y avancer, dans ce reste...
F. B. — Je veux dire : de quel point de vue prétendre parler de ce qui fait parler ?
Ph. S. — Eh bien... c’est ça la littérature, vous venez de la définir d’un mot qui fait aphorisme, non ? On est en pleine littérature.
F. B. — Justement ! C’est ça, la question. Remarquez bien qu’on est aussi en pleine conversation. Alors où passe la frontière du retournement ? Voilà, vous parliez de Joyce et des langues...
Ph. S. — J’ai pensé à Joyce pendant la cérémonie du Vatican, ça l’aurait sûrement beaucoup intéressé...
F. B. — Et c’est en même temps le point d’où reconstruire cette histoire d’enterrement sans enterrer personne : je reprends : les langues s’élèvent autour de la boîte à pape qui s’éclipse discrètement dans l’église, et arrive le nom de Joyce dans le cortège des noms propres, le défilé des morts dont j’ai parlé tout à l’heure — mais il arrive d’une façon tout à fait différente que Paul VI ou Robespierre...
Ph. S. — Ah mais d’accord !
F. B. — Autrement dit dans cette scène apparaît, silhouetté dans la foule au milieu des bruits de mains, comme dirait Dante, quelque chose qui s’apparente à la figure imaginaire d’un écrivain...
Ph. S. — Je vous ferai remarquer qu’il n’y a pas que la boîte, le tapis et le cierge, il y a aussi le Livre ouvert...
F. B. — A quelle page ?
Ph. S. — II y avait un peu de vent ce jour-là...
F. B. — Qui tournait les pages et avait nom Joyce. Mettre Joyce dans la foule, ce n’est pas du tout pareil que faire venir un mort au milieu d’un repas totémique, un mort à qui on ferait faire dans la conversation son tour de table — inventer Joyce en témoin transitoire du cortège s’apparenterait plutôt à faire tourner la table. C’est le support qui bouge. Le statut de revenant n’est pas un statut funéraire.
Ph. S. — C’est le sujet de Finnegans Wake...
F. B. — C’est le sujet de Finnegans Wake ; et à parler de conversation, d’enterrement et de religion, cette silhouette ainsi venue peut seule mettre le jeu en mouvement et nous permettre d’y circuler, avec elle. Je me demande si on ne pourrait pas définir l’incontournable de la question littéraire en la prenant sous cet angle, c’est-à-dire en posant la question de l’écrivain : à quoi nous sert au fond qu’existe un écrivain ? Ça nous sert à envisager la possibilité de penser sans meurtre à la clé. Je dirais volontiers ceci : tant qu’il y aura des écrivains, il sera possible de faire circuler dans le discours un personnage qui ne soit pas un mort. C’est la chose la plus difficile qui soit, et c’est pourtant bien cela, Joyce dans la foule...
Ph. S. — Exactement. Exactement. Mais alors vous m’accorderez du même coup que toute conversation, comme vous le disiez je crois tout à l’heure, implique un principe du tiers exclu, qui consiste à tuer quelqu’un entre soi...
F. B. — Disons que la conversation débat de ceci : qui est mort /qui est vivant ? D’un côté le pape, le mort, de l’autre les bruits de mains, les vivants, mais si Joyce a vraiment existé, et par exemple est apparu sur la place Saint-Pierre, autrement dit s’il est possible de faire peser Finnegans Wake sur une conversation, alors ce débat est vraiment traversé, et nous pourrons peut-être un jour, quand Joyce passera dans toutes les foules et toutes les conversations, envisager de parler sans tuer. Peut-être que chaque fois que le nom d’un écrivain produit une bouffée de fiction dans une conversation, se produit dans l’espace, disons imaginaire, un effet homologue, en écho, à ce que l’usage qu’un écrivain fait de la langue peut produire comme effet dans le symbolique. A propos, nous parlions des langues étrangères, mais il faudrait aussi se demander ce que c’est qu’une langue morte — et pour Joyce.
Ph. S. — Pour la première fois dans l’histoire ces problèmes sont abordés par Joyce. A savoir que toutes les langues sont mortes et sont en train d’en appeler à autre chose. Je revois Lacan, après son exposé sur Joyce, hochant la tête le soir à dîner, et dire l’air rêveur, évaluant la rêverie de la chose : « C’est sûr qu’après lui la littérature ne peut pas être comme avant. » Pas comme avant. Et il est bien clair qu’on ne parle pas seulement, à ce moment-là, de littérature. Pas comme avant...


Blasons
F. B. — Quel type de savoir trimbale le texte de Joyce ? Parce que dans Finnegans Wake, par exemple, on peut dire que telle ou telle question y est "traitée" ; évidemment, la façon dont le texte de fiction traite l’objet, l’objet de discours, l’objet de savoir, ne le porte pas à consistance... il reste que le savoir ainsi produit est d’un type très particulier, en ceci qu’il ne s’agit ni d’un savoir de spécialiste ni d’un savoir encyclopédique, qui sont tous deux à leur manière des savoirs identitaires. Vous parliez de Robespierre, tout à l’heure, ce n’est pas par hasard non plus si, en plus de la Femme, on a mis l’Encyclopédie de Diderot à côté de la guillotine...
Ph. S. — Heureusement d’ailleurs... Remarquez bien que l’Encyclopédie posée sur la guillotine fait pendant aux Évangiles ouverts sur la boîte du pape... ça fait en somme deux blasons assez satisfaisants...


Mort de la mère
F. B. — Je vais vous raconter une autre d’histoire d’enterrement et de conversation : un envers, encore une fois. Ça se passe dans les Confessions de saint Augustin, à la fin du livre IX, si je me souviens bien. Là où saint Augustin raconte comment, un jour, à Ostie sur le Tibre, il eut avec sa mère, quelques jours avant la mort de celle-ci, une étrange conversation, accoudés tous deux à une fenêtre. Cette scène a souvent été peinte, mais dans ces tableaux on a toujours oublié la fenêtre, ce qui n’est pas sans intérêt... Pas de boîte, une fenêtre. Bref, à Ostie, Augustin et Monique — Monica, la seule : Augustin a eu d’une femme un fils illégitime, et cette femme, il l’appelle dans ces Confessions l’innominata... —, bref la mère et le fils se sont mis à parler ensemble de choses et d’autres, et puis de Dieu — et s’élevant progressivement dans ces régions de l’Esprit où les Anges ne chantent même plus, vers ce qui « n’a été ni vu ni entendu », comme il est dit dans les Psaumes, et où tout fait silence, non seulement le tumulte de la chair, dit Augustin, mais aussi les rêves... Les rêves mêmes se taisent... Et à ce moment-là, n’est-ce pas, arrive cette chose rare qu’est une extase commune : la mère et le fils y atteignent ensemble, pour retomber ensuite au « vain bruit de leurs bouches », là où, dit Augustin, commence et finit la parole... Voilà la substance de cette conversation, que saint Augustin rapporte en précisant d’ailleurs que les termes qu’il emploie pour la raconter ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux qui avaient été exactement prononcés : très intéressante précision, où il ne faut pas voir un affaiblissement de la mémoire, mais un défaut constitutif, une sorte d’amnésie obligée — et un magnétophone, pour le coup, n’arrangerait rien... Le réel, ou le silence, ne peuvent pas être "rendus" : il y a toujours du bruit de fond... Voilà pour le premier acte : une extase à Ostie. Acte deux : cinq jours après la mère tombe malade, et est emportée en neuf jours.
Ph. S. — Très beaux chiffres...
F. B. — L’acte deux tient en deux phrases : qu’est-ce que je fais ici, et où étais-je. D’abord, saint Augustin rapporte que sa mère, à la suite de cette conversation très particulière, sent à ce point ses désirs exaucés, de "voir avant de mourir son fils chrétien catholique" (c’est ce qu’elle dit), qu’elle va partout, durant ces cinq jours de "répit", répétant de par le monde, enfin ce qui est le monde à cette époque, en somme quand elle sort, répétant que désormais elle n’a plus rien à faire ici, quid hic facio, qu’est-ce que je fais ici ? Très intéressante petite phrase... qui m’amène à penser, à l’instant, ceci : qu’il est possible, au cœur d’une conversation, lorsqu’on va dîner dans un restaurant plein de bruit de fond, prenons par exemple la Coupole, à cause des résonances romaines du mot — qu’il est possible d’entrer dans un état discrètement crépusculaire en laissant simplement se former dans sa tête ce quid hic facio : à ceci près, et c’est ce qu’il faut remarquer, que pour pouvoir vraiment le dire, il faut bien qu’il y ait eu une extase avant... Ce qui n’est et de loin que rarement le cas... Qu’est-ce que je fais ici, bien sûr, ça suppose pour pouvoir être énoncé sans trucage la certitude d’une réponse à qu’ai-je fait avant ?... Bien, je continue l’histoire : la mère tombe malade, et il lui arrive, juste avant de mourir, de perdre un instant connaissance ; revenant de cette syncope, elle a juste ce mot, l’air un peu égaré, en ayant l’air de chercher quelque chose, écrit saint Augustin, elle a ce simple mot : Où étais-je ? De la conversation aux ultima verba... Il reste que dans le quid hic facio et le ubi eram, il s’agit bien à chaque fois d’un sujet revenu d’on ne sait trop quoi... Même si les deux formules ne sont pas tout à fait équivalentes... C’est en tout cas entre les deux que ça se passe. Acte trois : l’enterrement : il faut se souvenir qu’ils sont à l’étranger, en Afrique ; encore une histoire d’exil. Eh bien, le testament de la mère, ou plutôt sa dernière injonction avant de mourir, ce n’est pas rien, si je puis dire : « Enterrez-moi n’importe où. » Mon cadavre, dit la Mère, vous pouvez bien le mettre n’importe où. Pas besoin de creuser pour le déposer. C’est une demande très ambiguë, presque affolante, exorbitante. Et qui, mais toute cette histoire que j’esquisse ici demanderait à être reprise de très près, et qui donc remplit de joie Augustin. Si je me souviens bien, il donne lui-même une interprétation du Quid hic facio en écrivant que dès ce moment il était clair qu’elle ne souhaitait plus mourir dans sa patrie, ni se faire enterrer aux côtés de son mari... Acte quatre : le deuil : Augustin, pris d’une immense douleur, ne sait comment l’apaiser, jusqu’au moment où, se souvenant avoir entendu dire que le mot « bains », balneus, vient du grec balaneion, ce qui impliquerait, selon le savoir étymologique de l’époque, que « le bain chasse de l’âme l’angoisse »... jusqu’au moment où sur la foi de cette étymologie, de cet ultime raccroc du signifiant, Augustin s’en va donc aux bains. Et tente en somme de faire son deuil sur le temps d’une étymologie. Acte de foi dans la langue un peu scandaleux ou dérisoire. Deuil étymologique d’un corps sans sépulture... Je m’interromps ici, pour préciser que nous sommes presque à la fin du livre IX, et que quelques pages après, des livres X à XIII, les Confessions vont virer subitement — et sans transition autre que, précisément, celle qu’opère dans la fiction le petit montage que j’ai rappelé — de l’autobiographie à l’exégèse. Une conversation, un enterrement, saint Augustin a trente-trois ans, et il semble que sa vie s’arrête là. Conversation-conversion.
Fabuleux renversement à la suite de ce livre IX : les Confessions, ce livre coupé en deux par la mort de la mère. Car le sujet qui va prendre la parole dans les quatre derniers livres, purement exégétiques, semble alors nettoyé de tout imaginaire. L’autobiographie vire à l’exégèse, c’est-à-dire encore que l’exégèse va prendre en charge la biographie du sujet : ce qui correspond, important indice, à un renversement du courant citationnel : si dans les neuf premiers livres, la Bible ou les Psaumes sont cités à l’appui du récit, si la parole divine n’arrive que comme citation incidente dans la parole du sujet, après le neuvième livre c’est le sujet qui va devenir une citation de la parole divine. Très serré, tout cela ?
Ph. S. — Très serré.
F. B. — La question restant de l’articulation, de la conversion...
Ph. S. — Mais c’est très clair : je me souviens très bien, en effet, de ce passage dont vous parlez : après le bain, Augustin revient et doit confesser au « Père des orphelins » qu’il se retrouve pourtant tel qu’il était avant. Là-dessus il s’endort, se réveille, et lui reviennent en mémoire des vers de qui ? de saint Ambroise [5]. On peut en effet interpréter cet épisode comme une sorte d’adhérence étymologique, parce que saint Augustin était un rhéteur, et que cela le tenait d’une façon très obsessionnelle : alors que fait-il ? Il se livre à un passage à l’acte typique, d’ordre obsessionnel, il entend « bains » et croit que la chose qui lui est dictée par le mot et qui résonne en lui sous la forme de l’étymologie, de la langue morte, va le tirer d’affaire...
F. B. — On peut dire qu’il fait de l’étymologie parce que sa mère lui a dit de mettre son cadavre n’importe où...
Ph. S. — Cette mère est vraiment très bien, exceptionnelle, elle n’est pas si hystérique que ça... D’ailleurs, saint Ambroise s’était aussi fait remarquer en déterrant des cadavres de martyrs pour les transporter de-ci de-là...
F. B. — Eh oui...
VOIR SUR PILEFACE
Ph. S. — Et c’est très important, n’est-ce pas, que nous ayons là une citation de saint Ambroise... saint Ambroise à qui une fois de plus je rendrai hommage en passant, car finalement s’il y a quelqu’un que nous cache saint Augustin, c’est bien cet admirable saint Ambroise... Vous avez vu à quel point le pape dans son testament lui rendu un hommage solennel, en disant qu’il a occupé, quoique en étant bien indigne, sa chaire à Milan : et c’est dur de prendre la place de saint Ambroise, même quand on est saint Augustin... Eh bien, pour en revenir à notre épisode, saint Augustin a dormi et c’est saint Ambroise qui a pris sa place pendant le sommeil : excellente leçon de communication intrathéo-logique, car en effet le bain ça n’avait pas marché... En revanche, Ambroise, ça marche : Augustin se réveille et il va rentrer, comme vous l’avez dit si bien, dans le fonctionnement, un fonctionnement qui l’a changé parce qu’évidemment c’est très difficile de faire le deuil de sa mère. Le témoignage de saint Augustin là-dessus est très impressionnant. Je le rapprocherai, et vous verrez que ça boucle la chose de façon logique, du début d’Ulysse. Je ne sais pas si cela a déjà été mis en lumière, mais le début d’Ulysse est d’inspiration vraiment augustinienne (même si c’est à l’envers). Quant à la question « qu’est-ce que je fais ici », il ne faut pas oublier que ces gens avaient une solide formation gnostique, qu’ils étaient manichéens, et que cette question, c’est le sérieux de leur rumination... Ce n’est pas seulement cet état en effet décalé qu’on peut ressentir à n’importe quel moment, l’inquiétante étrangeté... Il n’y a qu’à voir comment, à force de se promener dans le quartier des prostituées, à force de tourner et de retrouver toujours les mêmes prostituées, Freud a l’idée de l’Unheimlich... Dieu sait si on cogite éperdument sur cette question de l’Unheimlich, mais ce n’est pas dans n’importe quelle rue que Freud a eu la révélation de l’éternel inquiétant retour : épisode éminemment comique.
F. B. — Saint Augustin dit avoir oublié ce qu’il a répondu à sa mère quand celle-ci demandait « qu’est-ce que je fais ici... » Qu’est-ce qu’on peut répondre, en effet, à cela ?
Ph. S. — II faut surtout se garder d’y répondre autrement que par...
F. B. — Saint Ambroise ?
Ph. S. — Non, autrement que par l’endroit d’où vient la question...
F. B. — « D’où venez-vous ? »...
Ph. S. — D’où viennent les enfants : qu’est-ce que je fais ici et d’où viennent les enfants, je vous assure que ce n’est pas loin, c’est dans la même ligne.
F. B. — D’où l’’étymologie, d’où viennent les mots...
Ph. S. — Oui... Ce qui est remarquable dans ce passage que vous avez évoqué, et pas par hasard, c’est que quand même on voit bien que saint Augustin avait droit à sa canonisation... Il l’avait gagnée : il est quand même arrivé, non seulement à parler avec sa mère, ce qui est très compliqué — il est clair qu’on est à la source de tout ce qui se dit dans et par la conversation : parler avec sa mère c’est... coton, parce qu’une mère ça ne parle pas facilement avec son rejeton. C’est bien connu, elles sont à ce moment-là saisies d’une sorte d’angoisse qui fait que soit elles se taisent d’une façon opaque, soit elles deviennent intarissables. Eh bien non seulement saint Augustin arrive à parler avec sa mère...
F. B. — Conversation « à » Notre-Dame...
Ph. S. — Non seulement il arrive à le faire, mais encore il arrive à s’interrompre en même temps qu’elle : ils s’interrompent ensemble, figure qui, y compris par sa coloration sexuelle, donne en quelque sorte le bord de ce qui peut être tout juste possible comme approximation de l’inceste. Arriver à se taire du même côté. Il mérite bien sa sainteté... Ce qui fait que les deux partenaires à ce moment, séparés par tout l’abîme qu’il peut y avoir entre eux, se mettent quand même, le temps d’une interruption, d’accord sur le fait qu’ils ont le même père, ce qui entre une mère et un fils ne va pas du tout de soi. Car c’est bien, dans le texte même de saint Augustin, du père qu’il s’agit, à qui il s’adresse — et c’est bien saint Ambroise qu’Augustin et sa mère ont reconnu comme père commun, puisque c’est lui qui les a convertis tous les deux.
Je me permets d’insister sur saint Ambroise parce que précisément dans l’augustinisme latent de notre culture, on a toujours tendance à oublier qu’Augustin et sa mère avaient été épatés par un certain Ambroise, qui vaut le déplacement — c’est le terme propre. Et ce n’est pas rien, saint Ambroise, puisque c’est lui qui a commencé à faire chanter les antiennes, et qu’il a marqué l’époque de sa rythmique... ce qui n’a pas échappé à notre Joyce de l’époque.
F. B. — Très important, en effet, cette position selon laquelle une mère et un fils admettraient un instant qu’ils ont le même père...
Ph. S. — C’est là où ça coince, vous comprenez... Et c’est pour ça que personne n’arrive vraiment à parler avec sa mère et à plus forte raison à s’interrompre en même temps qu’elle... Les femmes commencent à croire ça possible, mais quelle idée. Elles se religionnent de plus en plus dans quelque chose de l’ordre de la scissiparité... Il faudra en reparler un jour avec elles...
F. B. — Mais il m’intéresserait tout autant de savoir ce qui se passerait si une mère et un fils arrivaient à admettre qu’ils ont la même mère... Bien sûr dans le cas d’Augustin ça n’aurait pas de sens...
Ph. S. — Absolument pas... « Grands Dieux » !... On retomberait dans l’organique. Je vous dis qu’ils étaient manichéens. Il faut ici, pour que ça fasse poids, pour que les deux acceptent de s’y référer, une parole... d’« au-delà du monde »... Je mets tous les guillemets que vous voulez...
F. B. — Bien d’accord avec vous. Mais je pensais à ce tableau de Vinci, où sont représentés le Christ, la Vierge, et la mère de la Vierge, sainte Anne...

Léonard de Vinci, La Vierge, l’enfant Jésus et sainte Anne, entre 1500 et 1515.
Version restaurée. Grande galerie du Louvre. Photo A.G., 25 janvier 2017. Zoom : cliquez l’image.

Ph. S. — Peinture ! Peinture ! [6]
F. B. — Justement — où ces trois personnages sont représentés dans une sorte de fabuleux emboîtement, l’Enfant entre les jambes de la Vierge, la Vierge entre les jambes de sa mère ; scissiparité de l’Un qui se divise en Un — quand le Fils s’y met sans pour autant que le sériel se fasse généalogique : je désigne là, j’insiste sur un moment d’un procès — qui, je nous l’accorde, aurait fait stase pour "les femmes". Je ne sais plus ce que Freud a noté de ce tableau, à part le célèbre vautour qui s’y dessine, mais je me demande s’il ne s’agit pas là pour le fils et la mère d’avoir, et c’est aussi, vous l’avouerez, assez particulier, d’avoir la même mère...
Ph. S. — Eh bien, Léonard de Vinci n’est pas un saint, que je sache...
F. B. — Vous voulez dire que c’est pour cela qu’il est un peintre ?
Ph. S. — Je n’irai pas jusque-là parce que cette affaire de peinture est bien compliquée, mais enfin ça le qualifie comme peintre, bien sûr... Et la Joconde, de ce point de vue, ce n’est pas rien : et pour ce qui est de l’époque moderne, il a fallu tout l’irrespect fabuleux de Duchamp pour poser indirectement une question à Freud, et mettre, pour ainsi dire, les pieds dans le plat. Il n’y a pas d’art moderne sans cette intervention fameuse, ce passage à l’acte d’un nouvel ordre, cette agression de Duchamp qui s’est portée — pas par hasard — sur Vinci. Ça signe un certain effet de modernité. Inscrire au bas de la Joconde LHOOQ et signer un urinoir, il ne faut pas seulement y voir, comme on le fait d’habitude, une intervention au niveau de l’objet, mais comprendre qu’il s’agit d’une intervention sur la signature même. Duchamp, dont je n’oublie pas qu’il nous a révélé la « broyeuse de chocolat », a voulu clore par là quelque chose qui aura duré le temps d’une Renaissance... En bon joueur d’échecs, il a pris la Reine de façon cavalière [7].


Signatures
F. B. — On peut signer une conversation ?
Ph. S. — Bien sûr. Ça n’a aucune importance.
F. B. — Et si les interlocuteurs sont vraiment impartiaux, comme disait Breton, la ligne de partage, la partition passe où ?
Ph. S. — Entre les interlocuteurs ? Ça dépend de ce qu’ils disent...
F. B. — Personne ne viendra en plus, au dernier moment, un troisième larron tardif, et signera la conversation ?
Ph. S. — Cette conversation est enregistrée, il va en rester une trace audible, lisible : il y aura certainement un certain nombre de signataires potentiels, des gens qui viendront dire qu’il aurait fallu parler de ceci ou de cela à tel ou tel moment — ce qui prouvera que notre conversation était vraiment... au sommet ! Un événement.
F. B. — L’événement, pour nous, c’est peut-être aussi, à revers, se laisser une chance de n’avoir rien dit, parce qu’il faut toujours se laisser une chance de n’avoir rien dit — ça permet de changer éventuellement de contemporains beaucoup plus vite, et de commuter les signatures possibles... Bien, nous parlons depuis plus d’une heure, d’une façon un peu sinueuse, mais tout à fait précise en même temps ; et il se trouvera toujours quelqu’un pour nous reprocher de ne pas avoir tout dit — il est évident par ailleurs que lorsqu’on est censé ne pas avoir tout dit, on peut être du même coup suspecté d’avoir dit n’importe quoi... Pratique courante, et intéressante, d’invoquer un tout-dit pour annuler un dire — au nom, en fait, du refoulement. N’est-ce pas, il ne s’agit pas ici du « De quoi n’allons-nous pas parler », mais du « Vous n’avez pas parlé de » : c’est très différent, puisque ce « vous n’avez pas parlé de » n’est, paradoxalement, pas autre chose qu’un « vous n’auriez pas dû parler de »... Ce qui reporte encore assez loin la question du dire et ne pas dire, du manifeste et du latent, du pape qui est dans la cathédrale ou dehors... De la conversation comme exercice fluctuant de parole, défilé d’objets dans le discours, mais sans rémission... Et si Joyce vient à y circuler, alors ce qui compte, ce n’est pas le dit ou le non-tout-dit, c’est la façon renouvelée d’en être sorti et d’y être rentré, le pape dedans, dehors, mille fois le trajet dans les deux sens...
Ph. S. — Ce qui compte pour qui ?
F. B. — Ce qui compte pour la personne qui est dans la foule et qui s’amuse bien pendant la cérémonie. Ce qui supposerait aussi de pouvoir être, sinon partout à la fois, dans la foule, mais plusieurs à la fois, et à plusieurs moments...
Ph. S. — Ouais...


Retour à Saint-Pierre
F. B. — Oui, je me demandais pourquoi les événements se réduisent souvent à une petite phrase. Ce qu’il y a de fascinant dans les interruptions de parole, ce sont leurs effets... déroutants. Là aussi on change de langue dans la langue, je veux dire par là que le bégaiement est une drôle de chose...
Ph. S. — Ça peut être le ratage de quelque chose qui bée gaiement...
F. B. — Exactement...
Ph. S. — D’une béance gaie, d’une heureuse erreur...
F. B. — Un battement, battarismus... Eh bien le texte de fiction aurait aussi ceci de bégaillant, en ceci que le tracé du sujet qui s’y dessine se fait au milieu d’un éclatement d’objet continuel, d’un égaillement de l’être, où le désir et l’objet ne sont pas séparés en un temps d’expérimentation et un temps d’interprétation, mais où ces deux temps se télescopent... Et ce qui prend la place du Tout, alors, c’est le style.
Ph. S. — Quelqu’un a bien parlé de tout ça — de ça — c’est Lacan : la vérité mais pas toute, etc. Télévision. C’est donc de ce mi-dire qu’il est question... Et pour reprendre ce qui est arrivé tout à l’heure dans la conversation, on pourrait aussi bien appeler cela un bégaisavoir.
C’est-à-dire justement ce qui propulse de la béance dans l’objet et dans le sujet : l’objet c’est le sujet, le sujet c’est l’objet, mais pas tout. Autrement dit, c’est la seule façon de pas poser la Toute.
F. B. — De papoter ?
Ph. S. — De pas poser.
F. B. — De papauter ?
Ph. S. — Non ! Parce que papoter, c’est canoter sur le fait qu’il y aurait de toute façon la Toute, et que par conséquent il n’y aurait plus qu’à faire des fioritures. Ça papote parce que ça croit à la toute-puissance de la popote et le Pape ça dérange vraiment ladite popote, enfin disons que ça lui donne un coup d’arrêt. Et c’est aussi pourquoi il y a dans toute conversation l’angoisse : l’angoisse qu’il se dirait quelque chose qui n’irait pas avec les mots. Autrement dit, et Dieu merci, dans toute conversation, à un moment ou à un autre, il y a un lapsus. Même s’il ne se prononce pas, on peut l’entendre. Le premier qui y a fait attention, c’est Freud : il n’y a plus qu’à pousser dans ce sens-là pour s’apercevoir que ça ne parle qu’en fonction du fait paradoxal qu’on est sûr que quelque part tout est dit. Et c’est pour ça qu’il y a si peu d’écrivains. Alors, la petite phrase, c’est de l’ordre de la condensation des prestations de stratégie qu’il y a dans cette affaire. C’est un lapsus à l’envers. C’est par quoi on juge aussi que toute conversation est un rituel de bagarre : le dire inagressif, c’est ça le problème ; c’est aussi difficile que d’arriver à parler avec sa mère. C’est pour cela que je terminerai quand même sur la fonction de sainteté qu’après Lacan j’évoque ; et le sinthôme est une excellente façon de parler de l’événement Joyce. Je ferai une réserve sur le fait que par exemple dans Télévision, Lacan dit que Dante l’ennuie : c’est un malentendu... Un mouvement d’humeur... Il croit que Dante identifie l’Autre à l’Un ! Alors que son Paradis se clôt sur le nœud borroméen lui-même en action ! Le bégaisavoir, c’est en effet ce qui se balbutie de façon qui nous paraît monstrueuse dans ce qu’on a coutume d’appeler encore la littérature. Ça semble bégayer, mais en fait c’est le comble de l’à-coup sûr, celui qui n’a pas à s’énoncer comme tel. Et c’est pour cela que ça ne prendra jamais la forme du commandement biblique. Pour en revenir au blason, l’Encyclopédie sur la guillotine, ça implique qu’en effet on peut tout savoir à condition que chaque fois on en décolle une tête. Mieux vaut tête bien faite que tête bien pleine, comme disait Montaigne... C’était son rêve, évidemment irréalisable comme tout humanisme... C’est pour cela que des gens sérieux, s’étant rendu compte que ce rêve terre à terre avait fait son temps, ont commencé à faire fonctionner le Savoir sous sa forme la plus tranchante. Eh bien... à ceci correspond le fait que le jour n’est pas proche où l’on verra deux cent mille personnes et un milliard de téléspectateurs regarder à la télévision un simple plan de Finnegans Wake ouvert sur un tapis d’Orient sans cercueil sur la place Saint-Pierre de Rome.
Frédéric Berthet et Philippe Sollers.
Annexe
New York, 12 octobre 78
Cher ami,
II me semble maintenant qu’une note s’impose à la fin de notre Conversation. Elle pourrait venir au terme de ma dernière réplique et aller en bas de page, comme suit : () Ce qui n’empêchera pas, désormais, pour l’Institution, des attaques d’angoisse : voir l’entracte Jean-Paul Ier... Du point de vue massives de l’inconscient, l’Église catholique se révèle en effet automatiquement dans le coup, même dans ses lapsus et ses gaffes.
Bien à vous,
Ph. S.
New York, 18 octobre 78
Cher ami,
Évidemment, il faut maintenant ajouter à la note que je vous ai envoyée la dernière phrase suivante : () D’où il ressort finalement que le choix d’un pape polonais (après 455 ans d’italiens) est génial.
Amitiés,
Ph. S.
New York, 31 octobre 78
Cher ami,
Décidément, c’est encore moi... Il vient de m’apparaître que l’illustration qui s’impose pour notre Conversation est la Vue de Notre-Dame de Matisse (été 1914). Je viens de la revoir au Musée d’art moderne, ici. C’est évident, pour plusieurs raisons.
Amitiés,
Ph. S.
Paris, 10 novembre 78
Cher ami,
Pris note pour Matisse. Naturellement, il nous faut maintenant publier cette esquisse de correspondance. Comme s’il n’y avait pas de hors-texte : mais y a-t-il un point de vue romanesque sur l’Incarnation ?
Amitiés,
F. B.
Extrait du n° 30 de la revue Communications, ayant pour thème « La Conversation » (EHESS/Éditions du Seuil) 1979. pp. 235-249. Le numéro est dirigé par Frédéric Berthet et Roland Barthes (autre adepte de la conversation).
L’Infini 49/50, printemps 1995, p. 69-83 (avec la présentation de Frédéric Berthet).
Fugues, 2012, Gallimard, p. 889-914 (avec la photographie de Sollers avec la pape Jean-Paul II).
Fugues, Folio 5697, p. 989-1018 (idem).
Dans Fugues, cet entretien est suivie de la photographie (en noir et blanc) de Sollers en compagnie de Jean-Paul II, en octobre 2000, lorsque l’écrivain remet au pape un exemplaire de son livre d’entretiens avec Benoît Chantre, La Divine Comédie. Elle figure en couleurs sur le site de l’auteur.

- Jean-Paul II et Philippe Sollers, Rome, 4 octobre 2000.
Frédéric Berthet en quelques dates
Plusieurs livres de Frédéric Berthet ont été publiés dans la collection L’infini :
 Simple journée d’été (nouvelles), Denoël, coll. L’Infini, 1986 ; rééd. Denoël, coll. Romans français, 2006.
Simple journée d’été (nouvelles), Denoël, coll. L’Infini, 1986 ; rééd. Denoël, coll. Romans français, 2006.
 Daimler s’en va (roman), Gallimard, coll. L’Infini, 1988 (prix Roger-Nimier 1989) ; rééd. La Table Ronde, coll. « La petite vermillon », 2011.
Daimler s’en va (roman), Gallimard, coll. L’Infini, 1988 (prix Roger-Nimier 1989) ; rééd. La Table Ronde, coll. « La petite vermillon », 2011.
 Felicidad, coll. L’Infini, 1993.
Felicidad, coll. L’Infini, 1993.
 Journal de Trêve (Journal littéraire 1979-1982), suivi de Lettre à Saul Bellow, Gallimard, coll. L’Infini, 2006 (extraits parus dans l’Infini n° 96). Lire la critique du Magazine littéraire.
Journal de Trêve (Journal littéraire 1979-1982), suivi de Lettre à Saul Bellow, Gallimard, coll. L’Infini, 2006 (extraits parus dans l’Infini n° 96). Lire la critique du Magazine littéraire.
Et dans la revue :
 Traité d’illégitime défense, n° 7, été 1984
Traité d’illégitime défense, n° 7, été 1984
 Nouvelles françaises (entretien), n° 16, automne 1986
Nouvelles françaises (entretien), n° 16, automne 1986
 Un père, n° 21, printemps 1988
Un père, n° 21, printemps 1988
 Un point de vue divin, n° 26, été 1989
Un point de vue divin, n° 26, été 1989
 L’Écrivain, n° 28, hiver 1989-1990
L’Écrivain, n° 28, hiver 1989-1990
 Journal de Trêve, n° 96, automne 2006
Journal de Trêve, n° 96, automne 2006
En 1976, C’est Frédéric Berthet qui, à vingt et un ans, interviewe Julia Kristeva pour parler de l’art moderne, de la psychanalyse et de la révolte de l’être parlant (extrait du DVD, Julia Kristeva).
En 1989, Sollers lui confie la coordination d’un numéro du n° 26 de L’Infini « Génération 89 », consacré à vingt-deux jeunes écrivains, « des parias intelligents ». Le 16 mai, sur Antenne 2, Bernard Pivot le reçoit dans son émission « ’Strophes ».
En 1996, Berthet publie Le Retour de Bouvard & Pécuchet, réédité en 2014 par Norbert Cassegrain dans la collection Remake.
Frédéric Berthet meurt dans la nuit du 24 au 25 décembre 2003, à l’âge de 49 ans. « A son enterrement, Philippe Sollers lit sur le cercueil un passage des Confessions de saint Augustin » [8]. On aimerait connaître le passage.
 « Frédéric Berthet (1954-2003) est considéré, à juste titre, comme le meilleur écrivain et l’un des plus grands espoirs de sa génération. Sa mort prématurée, à l’âge de quarante-neuf ans, a été, pour tous ses amis, une épreuve douloureuse. Ses livres Simple journée d’été, Daimler s’en va, Felicidad ont des admirateurs nombreux et fervents.
« Frédéric Berthet (1954-2003) est considéré, à juste titre, comme le meilleur écrivain et l’un des plus grands espoirs de sa génération. Sa mort prématurée, à l’âge de quarante-neuf ans, a été, pour tous ses amis, une épreuve douloureuse. Ses livres Simple journée d’été, Daimler s’en va, Felicidad ont des admirateurs nombreux et fervents.
Mais voici la surprise : le journal, très détaillé, qu’il a tenu, à l’âge de vingt-cinq ans, dans la perspective d’un grand roman, "Trêve". Ce sont des cahiers, transcrits par un de ses amis, Norbert Cassegrain, qui montrent à l’évidence un talent exceptionnel. Tout, ici, est intelligent, rapide, frais, déchirant et drôle. On ne s’ennuie pas une minute dans ce volume effervescent où règnent, en filigrane, deux figures majeures, Kafka et Fitzgerald. Portraits de jeunes filles étourdissants. Franchement, c’est une grande révélation, et, bien qu’on soit entre 1979 et 1982, entre Paris et New York, la sensation d’actualité est frappante. Plus franchement encore : c’est génial. »
Philippe Sollers.
« Je suppose d’ailleurs que j’ai dû présenter quelques affinités avec les enfants qu’on dit mutiques. Evidemment, ils ne sont pas aphasiques — quoique à force d’être par trop mutique on coure le risque de devenir aphasique-, ils savent parfaitement leur langue, et ce n’est pas d’elle qu’ils s’excluent, mais bien des conversations qui se tiennent devant eux, et ils font simplement comme s’ils ne comprenaient pas. On a remarqué de ces enfants qu’ils ne se décident un jour enfin à parler qu’en l’occasion d’une rencontre avec quelqu’un qui leur était parfaitement inconnu. Dans mon cas présent, l’inconnu est poussé à son comble, et je peux en un sens considérer que tout ce que j’ai dit pendant toutes ces années équivalait à ne rien dire. Mais on n’imagine pas ce qu’on peut prendre comme notes quand, droit à table ou circulant dans les congrès, on n’ouvre quasiment la bouche que pour éviter de laisser transparaître l’essentiel sur son visage. J’attendais une occasion – une occasion humaine, un regard, une preuve pour parler. Les rares fois où je m’y suis résigné, on dirait que ça n’a pas suffi à changer le cours des choses. Même, plus je ne disais rien, plus on était content. »
Frédéric Berthet, Journal de Trêve
Frédéric Berthet, écrivain inspiré
Emmanuel Moses
L’écrivain Frédéric Berthet a été retrouvé mort samedi 27 décembre dans son appartement parisien. Il était âgé de 48 ans.
Né à Lyon en 1955, Frédéric Berthet rencontre, alors qu’il est élève à l’Ecole normale supérieure de la rue d’Ulm, Roland Barthes puis Philippe Sollers, avec lesquels il se liera d’une amitié profonde et exigeante. C’est d’ailleurs dans la revue du premier, Communication, qu’il publiera un de ses premiers textes, un entretien avec Sollers intitulé "Conversation à Notre-Dame", réalisé au moment de l’élection de Jean Paul II. Philippe Sollers, qui deviendra son éditeur, demeurera toute sa vie un interlocuteur privilégié dans un dialogue consacré entièrement à ce qui constituait la raison d’être de Frédéric Berthet : la littérature. Il avait d’ailleurs mis fin à une carrière diplomatique prometteuse qui l’avait conduit à New York, au poste de conseiller culturel, pour se vouer à l’écriture.
DÉSESPOIR ET AUTODÉRISION
Auteur d’un roman où la mélancolie poignante s’atténuait d’un voile d’ironie, Daimler s’en va (Gallimard, "L’Infini", 1988, prix Roger-Nimier), de deux recueils de nouvelles, Simple journée d’été (Denoël, 1986) et Felicidad (Gallimard, 1993, Prix de la nouvelle de l’Académie française), d’un récit étrange et élégant, Paris-Berry (Gallimard, 1993), et d’une suite éblouissante d’humour de Bouvard et Pécuchet intitulée Le Retour de Bouvard & Pécuchet (Le Rocher, 1996), Frédéric Berthet travaillait depuis plusieurs années à un roman attendu par tous ceux qui appréciaient son talent nourri de désespoir et d’autodérision.
Courtois, d’une grande culture (il connaissait par coeur le journal de Kafka), Frédéric Berthet croisait dans les eaux territoriales limpides et versicolores de Graham Greene, Somerset Maugham, qu’il avait traduit, et Evelyn Waugh, comme dans celles, plus troubles, de Saul Bellow ou Philip Roth. Un cercle d’amis, Patrick Besson, Eric Neuhoff, Jean Echenoz avec qui il pêchait le goujon, l’entourait de son admiration et de son affection. Quant à celle de ses lecteurs, gageons qu’elle ira s’élargissant, leur procurant la jouissance que suscite seule la littérature inspirée.
Emmanuel Moses, Le Monde du 31.12.2003.
Frédéric Berthet : fragments d’un testament
par Josyane Savigneau
Il avait 25 ans quand il a commencé, en 1979, le premier cahier de ce Journal de Trêve, et 29 ans à la fin du dernier. Et pourtant tout semble très actuel, d’une étonnante nouveauté, dans ces pages, à la fois Journal et genèse d’une oeuvre à venir, dont un grand roman, Trêve. Frédéric Berthet, qui est mort en décembre 2003 à l’âge de 49 ans, a publié cinq livres en dix ans (1986-1996). Dès le premier, Simple journée d’été, il a été remarqué. Du deuxième, Daimler s’en va (1988), Bertrand Poirot-Delpech disait ici dans son "Feuilleton" : « Il fait au lecteur ce cadeau de prix : de quoi se découvrir soi-même plus original qu’on ne croyait. A tout le moins plus singulier. »
On peut appliquer cette remarque au gros volume qui paraît aujourd’hui et prouve que Berthet était un grand écrivain, à la pensée déjà affirmée. Mais la reconnaissance de son talent par ses aînés — Michel Déon, Philippe Sollers, son éditeur — et ses contemporains — dont Jean Echenoz et Patrick Besson — n’a pas suffi. Berthet a cessé de publier. Il est mort prématurément, et c’est comme un magnifique testament qu’arrive ce récit éclaté dont on a envie, à chaque page, de retenir et de citer une phrase, tant il témoigne d’une extraordinaire lucidité, d’un sens parfait du rythme, d’un style.
Peut-on être aussi lucide à 25 ans et vivre assez longtemps pour accomplir son oeuvre ? Sans doute, mais il y faut une force extrême, une folie de soi-même, une certitude d’avoir raison contre tous, qui, peut-être, ont fait défaut à Frédéric Berthet.
On rêverait de convaincre les lecteurs de romans bien ficelés que ce livre en fragments est plus important que tous ceux qui vont recevoir bientôt des prix littéraires. Et qu’il est passionnant d’entrer, avec Berthet, dans une oeuvre majeure en construction, avec des allers et retours, des listes de chapitres, des plans parfois contradictoires, des échappées, des repentirs, des scènes isolées dont on ignore encore la place dans la narration finale, des interrogations sur ce que doit être le livre à venir, le temps qui convient au récit, les pronoms, l’éventuelle « valeur humoristique de l’adverbe »...
KAFKA ET FITZGERALD
C’est un texte éblouissant, profond et drôle, d’un jeune homme de grande culture, où dominent les figures de Kafka — « à 20 ans j’ai développé une sympathie irrésistible, irrésistible et douloureuse naturellement, pour Kafka » — et de Fitzgerald — de nombreux passages sont tout à fait fitzgeraldiens.
Les personnages d’hommes, jeunes, au désespoir élégant, aux incertitudes peut-être mortelles, Jérémie, Bonneval (qu’on retrouve dans Simple journée d’été), Raph (héros de Daimler s’en va), ne sont pas sans rapport avec Berthet lui-même. Les portraits de femmes sont tous subtils et pertinents, même dans la cruauté. Johana, Lady West, Anita, Alice et les autres sont inoubliables. Comme Sixtine, Felicidad, que l’on croisera ailleurs si l’on lit tous les livres de Berthet, ou Constance « mélange de sensualité et d’abstraction », « corps élastique. Le front légèrement bombé d’une enfant asiatique », héroïne de la dernière nouvelle de Simple journée d’été, « Regarde ».
La nature est constamment présente, source d’infinies sensations. Les parcs, les jardins, les matins d’automne, les odeurs de feuilles brûlées, les clématites, et le « rose foncé » des aubépines, « tout ce qu’on peut attendre en fait de couleur — comment dire ? de couleur terminale ».
A deux reprises, Frédéric Berthet écrit ceci : « Je ne pense pas à la mort, mais elle pense souvent à moi. » Evidemment, ses interrogations sur le vieillissement et la mort sont lues aujourd’hui à la lumière de sa propre mort. Comme ses multiples réflexions et variations sur le mot posthume, dont celle-ci, allusion directe aux cahiers que l’on est en train de lire : « Si je devais un jour publier ce "Journal de Trêve", alors faudrait-il y faire figurer en exergue la citation de Kafka, sur l’écrivain qui assiste continuellement à sa propre mort — ceci pour remettre en place la notion de posthume, qui n’a rien — alors — de macabre, ni de très narcissique, mais profondément gaie, et partageable par chacun — ? —. » On peut désormais enlever le point d’interrogation.
Josyane Savigneau, Le Monde du 19 octobre 2006.
Lire aussi : Amaury da Cunha, « Correspondances : 1973-2003 », de Frédéric Berthet : les lettres vives de Frédéric Berthet.
Daimler s’en va
Préface de Jérôme Leroy
Nouvelle édition en 2018
Collection La petite vermillon (n° 341), La Table Ronde
Parution : 24-05-2018
 Un détective privé dont les affaires ne marcheraient pas très fort : c’est ainsi que Frédéric Berthet présente le héros de Daimler s’en va. Un héros, ce Raphaël Daimler, dit Raph ? Plutôt un anti-héros. Il tombe amoureux, se fait larguer, consulte Uri Geller qui se propose de tordre une fourchette, puis un psy qui lui vole les photos de l’aimée. Perdant pied, Raph s’imagine en chien de garde, rêve qu’il est poursuivi par un oeuf au plat géant, se prend pour l’abbé Faria du Comte de Monte-Cristo. Puis Daimler s’en va. Apparaît son ami Bonneval, lecteur du Chasseur français qui reçoit des nouvelles de Raph : une longue lettre cocasse et posthume. Daimler s’en est allé pour considérer le monde, notre monde, d’un peu plus haut.
Un détective privé dont les affaires ne marcheraient pas très fort : c’est ainsi que Frédéric Berthet présente le héros de Daimler s’en va. Un héros, ce Raphaël Daimler, dit Raph ? Plutôt un anti-héros. Il tombe amoureux, se fait larguer, consulte Uri Geller qui se propose de tordre une fourchette, puis un psy qui lui vole les photos de l’aimée. Perdant pied, Raph s’imagine en chien de garde, rêve qu’il est poursuivi par un oeuf au plat géant, se prend pour l’abbé Faria du Comte de Monte-Cristo. Puis Daimler s’en va. Apparaît son ami Bonneval, lecteur du Chasseur français qui reçoit des nouvelles de Raph : une longue lettre cocasse et posthume. Daimler s’en est allé pour considérer le monde, notre monde, d’un peu plus haut.
« Daimler s’en va », de Frédéric Berthet, enfin réédité
Ce court roman fait partie des livres méconnus du grand public, mais devenus des talismans pour nombre de lecteurs. Sa reparution est l’occasion d’élargir le cercle.
Par Monica Sabolo (Ecrivaine)
Daimler s’en va, de Frédéric Berthet, La Petite Vermillon, 128 p., 6,10 €.
Il me semblait que dans Correspondances (1973-2003), publié en 2011 aux éditions de La Table ronde, figurait une lettre dans laquelle Frédéric Berthet évoquait, avec cet humour féroce et gracieux qui n’est pas le moindre de ses charmes, les maigres ventes de son deuxième livre, Daimler s’en va (Gallimard, 1988). Un court roman, 108 pages, aujourd’hui réédité par La Table ronde, merveille de nonchalance et de drôlerie désespérée mettant en scène un détective privé raté et sentimental. Une merveille qui, pour d’obscures raisons ayant trait à l’injustice divine, s’était peu vendue et ce en dépit de critiques enamourées et d’un prix Roger-Nimier décroché en 1989.
Fulgurance du style
Mais quel était ce chiffre de vente ? Bon sang, impossible de m’en souvenir. A l’aube, échevelée, marchant de long en large en pyjama et parlant à voix haute, ainsi que pourrait le faire Daimler lui-même, s’invectivant couvert de mousse à raser dans sa salle de bains, je feuilletai fiévreusement Correspondances, à la recherche de cette satanée lettre – et ce qui devait arriver arriva. Je me mis à tout relire, émerveillée par la fulgurance du style Berthet, sa drôlerie étincelante, son dandysme fatigué, mais surtout son angoisse concernant à peu près tout : l’existence, les femmes (« au fond la vie conjugale réserve bien des mystères – dont on se demande si certains sont nécessaires »), la mort, l’ennui et, plus que tout, l’écriture.
Dans une missive (jamais envoyée) à Christian Bourgois, au sujet de ce qui deviendra son premier recueil de nouvelles, Simple journée d’été, publié en 1986 chez Denoël : « Cher Christian, votre avis de lecteur ? Et d’éditeur ?? (ne perdez jamais de vue que les “héros” ont entre dix-neuf et vingt-quatre ans – ce qui les excuse, eux, peut-être, mais, je vous l’accorde, pas moi). »
Les doutes et l’obsession de la littérature, une certaine terreur de la paralysie (des romans entamés par trois pour, peut-être, échapper à l’anxiété, romans par ailleurs jamais terminés), la fuite, la tendresse déguisée en cynisme sont sans doute les aspects les plus bouleversants d’un écrivain génial, mort en décembre 2003 à l’âge de 49 ans (d’alcool et de mélancolie, dit-on), après avoir publié seulement cinq livres.
Lire aussi : Bouvard et Pécuchet réactivés
Le deuxième d’entre eux, et unique roman, Daimler s’en va, est une pierre précieuse, minuscule et scintillante, qui vous laisse dans un drôle d’état, entre la fébrilité et l’accablement. On reste sidéré par sa fantaisie hilarante, le maniement éblouissant de la ponctuation et de l’incise, le voile élégant posé sur la tristesse, quelque chose de l’ordre de l’absurde et de l’inconsolable.
Daimler, qui semble un double à peine déguisé de Berthet, est le genre de type qui se parle à haute voix, donc, devant le miroir de sa salle de bains : « “Qu’est-ce que tu veux Daimler ?” Daimler ne dit rien. Même sous la torture, il ne parlera pas. Il a subi un entraînement spécial pour faire face à ce genre de situation. » Un jeune homme de 27 ans qui se souvient « de l’époque où, mégalomane, il voulait apprivoiser un merle et le dresser à lui rapporter des vers de terre (vivants), pour aller les revendre au magasin de pêche du coin. De l’époque où, mythomane, il voulait sortir un 45-tours dont le tube aurait été Héroïque. Daimler aurait pris un pseudonyme, du genre Michaël Hawaï ».
« Marqué par le destin »
Dans cette vie, tout n’est que désarroi et échappées. Amoureux malheureux, il contacte un mentaliste pour envoyer des messages télépathiques à celle qu’il aime, enfuie à la Barbade. Un échec. (« “Je peux vous tordre cette fourchette à distance, si vous voulez” propose-t-il, à titre de compensation. ») Rien ne va dans cette vie où même les pigeons ne sont pas vraiment fidèles. Alors Daimler s’en va, et laisse, dans la dernière partie du livre, le soin à son ami Charlie Bonneval, « également marqué par le destin », de se souvenir de lui.
Des pages déchirantes sur l’ennui et l’insoutenable répétition des choses, qui, à nouveau, font songer à Frédéric Berthet lui-même, et donnent étrangement envie de vivre, de faire des choses absurdes. Comme lui écrire, par exemple, une lettre semblable à celle qu’il rédigea à l’attention de Roland Barthes, en 1986, six ans après la mort du philosophe : « D’une certaine façon, voyez-vous, je suis comme l’inconscient. Je n’arrive pas à croire à la mort. Ni à la vôtre, ni à la mienne. (…) Nous reparlerons de tout cela de vive voix, lorsque je serai mort à mon tour. Merci pour tout. Ne m’oubliez pas. »
Le Monde des livres, 13 juin 2018.
Frédéric Berthet, FELICIDAD (Extraits)

« Il va falloir s’y habituer, mais quand même ça fait bizarre. […] Dix ans déjà que Frédéric Berthet est mort. On l’avait retrouvé chez lui, entre Noël et le jour de l’an. […] Ce normalien n’avait pas le profil de la rue d’Ulm. Il aimait Salinger et le champagne, la pêche à la mouche, le tennis et Kafka. Il avait été conseiller culturel à New York, le seul travail qu’il ait jamais eu. Son métier était écrivain, mais comme écrivain n’est pas un métier, il ne pouvait pas s’en tirer. […]
Il avait cru que l’alcool serait son compagnon de route. Il fut son ennemi. « Écrire : se sortir de l’eau soi-même en se tirant par les cheveux. » Il se noya dans le whisky et le vin blanc. Il était pourri de talent. Ses incertitudes l’asphyxiaient. […] Ses livres continuent à clignoter, comme ces étoiles dont la lumière nous parvient encore après qu’elles sont éteintes. […]
[…] Ceux qui restent ont toujours tort. « Yep ! », aurait fait Frédéric, avec ce petit rire qui n’était qu’à lui. » (Éric Neuhoff, Deux ou trois leçons de snobisme, Éditions Écriture, 2016)
« […] Comment il avait écrit son deuxième livre, il l’ignorait encore. Il avait eu le choix entre terminer le troisième et se tirer une balle dans la tête. Quant au quatrième, on avait commencé à considérer qu’il en écrirait même un cinquième : s’il était toujours là, c’est qu’il tenait le coup. […]
[…] Il savait bien que tout ce que la littérature lui prenait, elle était forcée de le lui rendre de temps en temps.
[…] » (Un point de vue divin)
« […] Distraction ? Fatigue ? Devait-il tenter de se justifier ? Écrire un éloge de la distraction ? Une apologie de la fatigue ? Ha ha ! Il ne pouvait plus écrire, justement ! Depuis trois mois ! L’écrivain s’était taillé, l’avait abandonné ! Oh, je sais, ajoutait Trimbert sentencieux, ces périodes sont imprévisibles, comme des accès de malaria, et il le pensait avec conviction, c’était une loi de l’existence, encore que chaque accès le laissât pantelant. « Dans la maladie, la santé se repose » c’était le plus joli, le plus sympathique, le plus profond dicton qu’il eût à sa disposition. Peut-être fallait-il ficher la paix à l’écrivain, de temps en temps. Soit. Peut-être l’écrivain pouvait-il partir en permission. Se faire porter pâle. Demander un mot d’absence à ses parents. Oui, exactement : à ses parents. Pauvre type. […] » (Hors-piste)
De Frédéric Berthet (1954-2003), « cinq libres ont été publiés de son vivant, en l’espace de dix années. […]
En 1993 paraissent simultanément Felicidad, second recueil de nouvelles (le bandeau de la collection L’Infini précise : « Nouvelles du front » […], qui suscite dans la presse une vague d’interrogations […].
Berthet revient

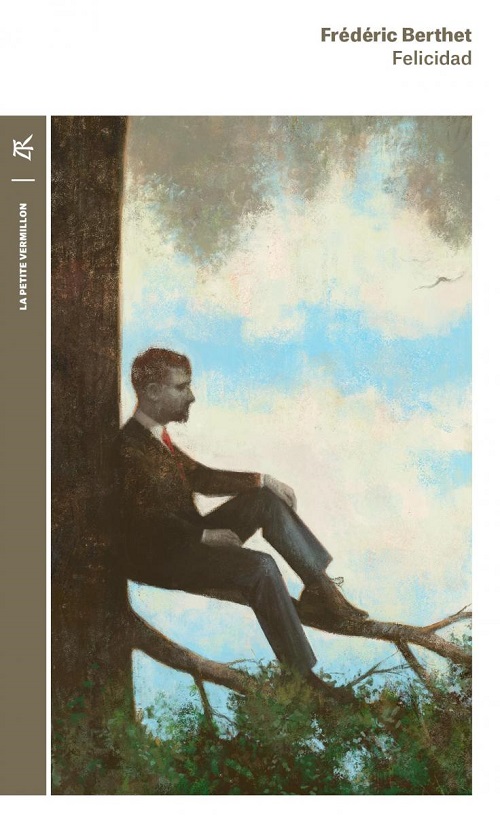
Par Philippe Lacoche
Le Courrier picard. Publié le 25 Mai 2023.
« Nous pouvions faire l’amour pendant des heures, au fond de cette fatigue cristalline qui se levait en nous avec l’aube. C’était comme une rançon versée à l’épuisement atteint. » Cette phrase de la nouvelle éponyme se trouve à la page 68 du recueil Felicidad ; elle est l’œuvre de Frédéric Berthet. Elle est non seulement belle, émouvante, gracieuse ; elle interpelle à l’image de son auteur trop tôt disparu (1954-2003), retrouvé mort dans son appartement de la rue Tournefort, dans le Ve arrondissement de Paris. Même si elle est de qualité inégale, son œuvre envoûte, fascine, entraîne le lecteur vers les sommets du plaisir ; et tout ça, on ne sait pas trop pourquoi. Magie de la littérature, un peu comme chez Modiano et chez Carver. Pas d’effets, pas d’afféterie ; une façon étrange et très personnelle d’utiliser les virgules et les deux points, et ça marche. Avec seulement cinq livres publiés de son vivant (dont le sublime roman Daimler s’en va, prix Roger-Nimier 1989 ; rééd. La Table Ronde, coll. « La petite vermillon », 2011, 2018.), Frédéric Berthet a imposé sa petite musique mélancolique, souvent drôle et aussi aquoiboniste qu’un blues de Jimmy Reed. Bref : un grand écrivain. On s’en doutait car un homme qui aimait à ce point la pêche à la ligne (et particulièrement celle aux carnassiers) ne pouvait pas être foncièrement mauvais.
« À la fois minuscule et délicieux. »
La Table Ronde réédite son recueil de nouvelles Felicidad et son récit Paris-Berry. Le premier contient des petites perles comme celle éponyme et déjà citée, simple et belle qui n’est rien d’autre qu’une déclaration d’amour à une femme. Comment résister à cette phrase ? « Bien plus tard, elle m’apprit qu’elle avait, quelques minutes avant, regardé mes mains, et que mes mains lui avaient donné envie de faire l’amour. » On adorera aussi « Le Père », texte étrange qu’on croit d’abord empreint d’absurde et qu’on découvre, au fond, d’un infini désespoir. On savourera également « Voyageur », étrange. En revanche, les nouvelles « Pas là » et « Hors-piste » peinent à accrocher avec leur parfum d’inachevé.
Le récit Paris-Berry ne manque pas de charme, lui non plus. L’histoire ? Un écrivain s’installe à la campagne en hiver dans une maison pour écrire un roman. Ce dernier se fera attendre car l’attention de l’homme de plume se trouve trop souvent détournée par des rencontres, des objets, des souvenirs. Constitué de textes courts, voire très courts, Paris-Berry est une constellation d’émotions, de ressentis. C’est à la fois minuscule et délicieux.
Philippe Lacoche
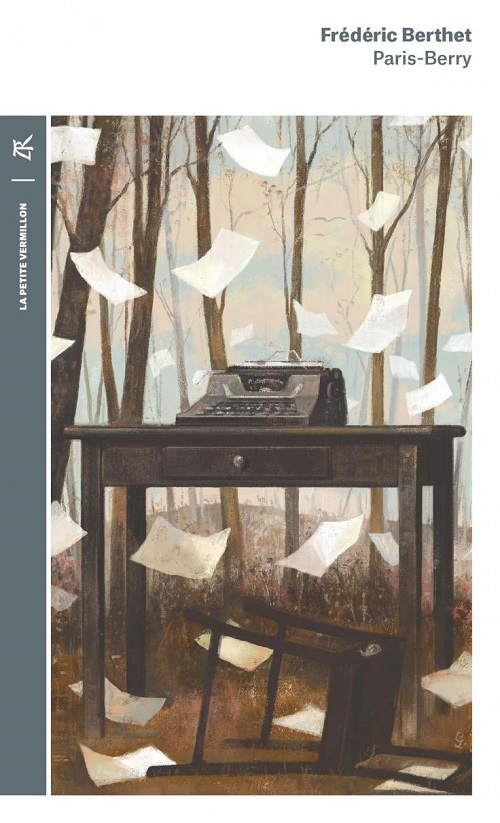


D’une certaine façon, il semble toujours y avoir quelque chose de dérisoire à vouloir rendre compte d’un livre de Frédéric Berthet. Avancer des hypothèses, décrire des sensations, vouloir dégager les « intentions » de l’auteur ou les caractéristiques de son style, c’est d’emblée prendre le risque d’alourdir des textes qui se suffisent à eux-mêmes, de laisser des traces de gras sur un cristal d’une parfaite pureté, de lester de plomb des phrases qui filent, aussi légères qu’une brise de mai ou qu’un vol d’oiseau. Prenons par exemple la nouvelle qui ouvre ce recueil, Un père. Le narrateur, une nuit de beuverie, croit reconnaître son père à l’arrière d’un taxi. A travers ce récit aux confins de l’onirisme (ou du délire l’éthylique), le lecteur peut deviner de nombreuses notations sur le rapport au père, sur la difficulté pour un fils de trouver sa place sur la scène du monde… Mais l’auteur n’insiste pas et préfère à l’analyse psychologique une pure approche sensorielle, le détail fugace, le sentiment éphémère… Pour paraphraser une de ses (belles) expressions, Felicidad apparaît une fois de plus comme des « bouffées de mémoire », un ensemble de nouvelles élégantes et délicates où l’auteur se dévoile autant qu’il se cache.
Certaines nouvelles apparaissent comme un codicille à Paris-Berry (L’Écrivain, Pas là) puisque Berthet couche sur papier, avec beaucoup de grâce, un ensemble d’impressions fugitives, de petites réflexions dont la légèreté ne masque qu’imparfaitement la profondeur et la mélancolie. A travers ces petits instants, l’auteur s’interroge sur sa propre inspiration, son écriture, désireux qu’il est de puiser dans le quotidien pour nourrir un prochain roman à venir (et qui ne viendra jamais). Et ce faisceau de petites notations triviales parvient à donner un aspect romanesque à la banalité du quotidien. A cela il faut ajouter une bonne dose d’humour et d’autodérision quant à son personnage d’écrivain en panne d’inspiration. Citons, à titre d’exemple, cette divagation drôlatique :
« Il lui vient de nombreuses idées, par exemple, en matière de politique culturelle. Il devrait former avec d’autres écrivains des Brigades d’intervention culturelle : les B.I.C. liraient à haute voix plusieurs passages d’Homère dans le métro aux heures de pointe, accrochées d’une main aux poignées. Ou bien, des petites choses d’Ovide ou de Sénèque, assises à la droite des chauffeurs de taxi, pendant la durée du trajet. Une association serait créée, ses statuts seraient déposés à la préfecture. Le ministre de la Culture serait obligé de la subventionner. »
Lorsqu’il n’utilise pas la première personne du singulier (Felicidad), Berthet fait appel à son alter-ego romanesque Victor Trimbert, notamment dans la nouvelle Un point de vue divin où l’auteur vit une courte aventure avec un jeune lectrice. Dans ce face à face charriant un feuilleté d’émotions diverses (le désir, la culpabilité, une certaine nostalgie…), Berthet livre une sorte de quintessence de son art, entre le sentiment mélancolique du temps qui passe et ces petites épiphanies éphémères qui font le sel de la vie. Rarement on aura aussi bien saisi la beauté fugace et fuyante des jeunes filles :
« Elle rit. Ce rire, pensa-t-il, ce rire, ce rire de toutes les années disparues, aussi, de tous les livres écrits, de toutes celles qui avaient son âge quand j’avais moi aussi le sien, ce rire des années où je me disais qu’un jour je me ferais écrivain. »
Felicidad, l’héroïne éponyme d’une des nouvelles, fait également partie de ces jeunes filles aussi évanescentes qu’une sensation, aussi mystérieuses qu’un sentiment amoureux et aussi volatiles que les moments privilégiés de l’existence :
« D’une certaine façon, il existe des êtres qui ne se développent pas ; il n’est pas de leur nature, ni de leur volonté, de le faire. De sorte que parler trop longuement d’eux reviendrait à leur faire la même injure probable que la vie, lorsqu’elle dure inutilement. Ils occupent donc l’espace d’un court récit. Après quoi, nous n’avons plus nous-même, à notre tour, qu’à plier bagage. »
Dans cette nouvelle, le narrateur rencontre une jeune femme à la « beauté insurpassable » et vivra avec elle une histoire d’amour en pointillé. Ce qui intéresse Frédéric Berthet, ce sont les « trous » de cette histoire : non pas un récit bien charpenté avec un début, un milieu, une fin mais une succession de temps forts, d’instants où les sentiments brûlent plus vite et plus fort. Felicidad, c’est l’image même de l’amour et du temps qui filent à toute allure. Un vrai courant d’air qu’il est impossible à l’auteur de saisir, d’arrêter. Toutes les nouvelles de Berthet sont hantées par cette fuite du temps, par cet échec à le saisir et à en rendre la complexité. Dans chacune, l’auteur tente de transfigurer son quotidien en œuvre mais dresse dans le même mouvement un constat de son échec. Et ce sont ces flux contradictoires qui donnent cette couleur si particulière aux œuvres de Frédéric Berthet, entre le rire désenchanté et une profonde mélancolie.
[1] Cf. Joyce, de Tel Quel à l’Infini.
[3] A propos : « Car la conversation est presque morte,et bientôt le seront beaucoup de ceux qui savaient parler. » Guy Debord, Commentaires sur la société du spectacle, éditions Lebovici, 1988.
[4] La version anglaise du testament de Paul VI.
[5] « O Dieu Créateur de toutes choses, Modérateur des cieux, qui revêtez le jour de l’éclat de la lumière, la nuit de la douceur du sommeil, afin que le repos rende les membres épuisés à leur ordinaire labeur, allège les cœurs fatigués et dissipe l’angoisse des soucis » (Hymnes ambrosiennes).
[7] Cf Marcel Duchamp, l’anartiste.
[8] Cf. Philippe Lançon, Berthet retrouvé pdf
 , (Libération du 14 décembre 2006).
, (Libération du 14 décembre 2006).






 Version imprimable
Version imprimable


 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?



1 Messages
Ce court roman fait partie des livres méconnus du grand public, mais devenus des talismans pour nombre de lecteurs. Sa reparution est l’occasion d’élargir le cercle. LIRE ICI.