


26 novembre 2014.
Ce matin, j’ouvre la radio. Il est 7h50. Florian Philippot, le souriant vice-président du Front National, après un passage incessant dans les chaînes d’information en continu et Canal+, est l’invité des Matins de France-Culture. Apprenant qu’il va être confronté au politologue libéral Dominique Reynié, auteur de la formule « le FN, c’est une sorte d’ethno-socialisme, le socialisme pour les "petits blancs" » et d’une récente étude montrant la montée de l’’antisémitisme en France — et que, de père en fille, le FN n’a pas fondamentalement changé, ses électeurs, pour 37% d’entre eux, estimant « qu’un Français juif n’est pas aussi français qu’un autre Français, contre 16% en moyenne » [1] —, Philippot quitte la station.
Quelques minutes plus tard, un éditorialiste commence sa tribune par une anecdote : en déplacement en province, Thierry Lepaon, le leader de la CGT tombe sur un tract qui l’interpelle ; il en donne lecture au Bureau confédéral de sa centrale. Tout le monde en approuve le contenu. Lepaon révèle alors qu’il s’agit d’un tract du Front National et dit : « Bon, alors, qu’est-ce qu’on fait ? ». Je n’ai pas vérifié l’anecdote et je me garderai bien de tout amalgame, mais je trouve que, en quinze minutes, France Culture nous a livré un condensé des paradoxes guignolesques de la situation politique actuelle. On pourrait en rire (c’est même, dans un premier temps, vivement conseillé), mais qui ne voit pas, pour peu qu’il ait un peu d’expérience, que, dans le discours, le FN a repris les slogans du PC des années 70 ? Qu’est-ce qui s’est passé en trente ans ?
1. Le PC, avalé par le PS de Mitterrand, a laissé le champ de la protestation partisane au FN promu, pour des raisons électoralistes (division de la droite), par le même Mitterrand.
2. Dans la situation de déliquescence politique et morale où se trouvent la droite et la gauche actuelles (les exemples pullulent au quotidien), le FN a un boulevard devant lui.
Y-a-t-il un danger fasciste en France ? En Europe ? On préfère parler de « populisme » (de droite ? de gauche ? les deux ? tour à tour ?). On se rassure. C’est oublier que le « populisme » peut, dans certaines circonstances, se muer en quelque chose de plus dur.
Je relis des passages de deux petits volumes publiés en 1976, chez 10/18 : Éléments pour une analyse du fascisme. C’est le contenu des interventions faites par onze intellectuels ou universitaires à l’Université de Vincennes lors du séminaire de Maria-Antonietta Macchiocchi (1974-75). Philippe Sollers n’y était pas intervenu, mais il en avait fait un compte-rendu dans Le Monde. Vous le lirez plus loin. Il ne manque pas d’enseignements.
Certes, dira-t-on, mais la situation a changé, l’histoire ne se répète pas. Ou pas de la même manière (Marx ne disait-il pas : « les grands événements se produisent toujours deux fois, la première fois comme une tragédie, la seconde comme une farce » ?), ou, en tout cas, pas « chez nous », il y a pire ailleurs (du côté de l’Irak ou du soi-disant « État Islamique », par exemple, où ce n’est pas une farce)... C’est vrai. La société du spectacle, en fusionnant ce que Debord appelait le « spectaculaire diffus » (sociétés capitalistes « classiques ») et le « spectaculaire concentré » (sociétés totalitaires) dans le « spectaculaire intégré » (le capitalisme intégrant certaines formes et certains contenus propres au totalitarisme), a connu de grands progrès et, notamment, sous l’emprise de la Technique (contrôle cybernétique, NSA, bio-pouvoir, main-mise sur les corps et la reproduction des corps) [2]. Mais est-ce une raison pour ne pas tenir compte des leçons du passé ? Après tout, on sait que, déjà dans les années trente, de larges fractions du « peuple » et de la petite-bourgeoisie ont basculé des rangs révolutionnaires dans le camp de la pire réaction. Qu’il y avait déjà dans le nazisme et le stalinisme une fascination pour la puissance de la technique. Et ne voit-on pas aujourd’hui même, se former d’étranges complicités entre la Russie du lieutenant-colonel du KGB Poutine et le FN (cf. Poutine et le FN : révélations sur les réseaux russes des Le Pen), qu’il s’agisse de la politique internationale (Syrie, Crimée, Ukraine) ou de tractations plus terre-à-terre (cf. Financement du Front national : Marine Le Pen en eau rouble) ?
Le fascisme, qu’il soit gris, noir, marron, brun ou rouge, a donc périodiquement la même couleur blanche de purification psychique. On peut d’ailleurs lui ajouter, pour faire bonne mesure, le vert islamique, comme le prouvent les intellectuels arabes et musulmans condamnés à mort ou assassinés un peu partout dans le monde. Mais s’y ajoute aussi, nous le savons bien, un para-fascisme sournois, tourbillonnant et multicolore de la marchandise (liquidation en douceur par la loi du marché, le Spectacle, la dégradation de l’enseignement).
Philippe Sollers, Vérité de Barthes, 1993.
Éléments pour une analyse du fascisme
Deux volumes 10-18, 1976.
Résumé
Dans le monde, des bruits de bottes se font toujours entendre. Le développement du néo-fascisme en Italie, le coup d’Etat chilien, la fin d’une dictature cauchemardesque en Espagne et la libération des séquelles du passé, qui se fera au prix de quel combat, montrent la nécessité de rester vigilants. Maria-Antonietta Macciocchi a tenu au cours de l’année 1975, à l’université de Vincennes, un séminaire consacré à l’étude du fascisme et du néo-fascisme. Elle a invité à participer à son enseignement d’autres universitaires venus des disciplines les plus diverses. Ces textes tentent de combler un vide théorique en éclairant les méandres des superstructures qui ont accompagné les dictatures fascistes pour mystifier les masses : les limites et les faiblesses des mouvements ouvriers face au fascisme, le rôle de soumission imposé à la femme, l’asservissement des intellectuels, l’utilisation de l’art, de la littérature, du cinéma comme moyens de propagande de masse, la répression sexuelle, l’antisémitisme. Il est probable qu’une telle analyse est tentée ici pour la première fois en France et les difficultés que soulèvent cette entreprise sont à la mesure de l’originalité de l’expérience pédagogique de Maria-Antonietta Macciocchi.
Les deux volumes contiennent des textes de : François Chatelet, Jean Toussaint Desanti, Roger Dadoun, Jean-Pierre Faye, Maria-Antonietta Macciocchi, Gérard Miller, Jean-Michel Palmier, Nikos Poulantzas, Daniel Sibony, Philippe Sollers, Jean-Marie Vincent et Armando Uribe.
Le premier volume s’ouvre sur Gramsci et la question du fascisme (M.-A. M) [3].
Le deuxième volume comporte une postface : Rapport sur un cours universitaire à Vincennes sur le Fascisme, suivie d’une Lettre de Philippe Sollers.
Le fascisme vu par onze intellectuels... et un douzième : Philippe Sollers
On nous le dit trop souvent : le fascisme aurait été et resterait un accident, une folie sans racines, un cauchemar. Faut-il l’oublier ? Ne pas s’en occuper ? Tourner la page ? Faut-il accepter l’ignorance sur ce passé criminel ? Rien ne prouve que notre civilisation, notre culture, aient effectivement surmonté (c’est-à-dire pris pleinement conscience) de ce qui s’est joué là, en son cœur. Et rien ne prouve non plus que le fascisme soit sans avenir dans le monde. S’agit-il d’une simple question historique ? Ou d’un phénomène qui, de proche en proche, met en cause la structure même de notre raison ? Y a-t-il, comme le voudrait le marxisme, une réponse théorique dont la lutte des classes serait la clé ? Faut-il considérer le fascisme comme un abcès transitoire, une déviation, une anomalie, une exacerbation ou — plus gravement — comme une donnée latente du fait social lui-même ? On voit l’enjeu de ces interrogations qui animent ces deux volumes modestement intitulés Éléments pour une analyse du fascisme, résultat du travail d’une douzaine d’intellectuels au séminaire tenu à Vincennes, l’année dernière, par Maria-Antonietta Macciocchi.
Travail passionnant d’ampleur et remarquable par la variété de ses angles d’attaque. Parler du fascisme, des fascismes, montrer (à travers des documents et des films) ce qu’il a été, comment il a fonctionné, cela semble tout à coup d’une actualité violente. La preuve en est dans les résistances, les obstructions que ce travail a provoquées immédiatement : comme si certains se sentaient préposés au sommeil de la mémoire qui, comme on sait, est fait de stéréotypes et d’idées reçues. Macciocchi, dans une postface vive, aiguë, drôle, raconte les circonstances agitées dans lesquelles son séminaire a pu quand même avoir lieu. Ceux qui ne voulaient rien savoir ni rien entendre du fascisme s’appelaient eux-mêmes « marxistes ».
Comme si, désormais, être marxiste, c’était être gêné par la vérité.
VOIR AUSSI
Vérité accablante, en effet, et de plus en plus difficile à cacher, irréfutable. Ce n’est pas un hasard si ces livres s’ouvrent avec la figure d’Antonio Gramsci, c’est-à-dire précisément du plus grand témoin emprisonné de la montée fasciste. Écoutons Gramsci dire de Mussolini qu’il est un « masque du folklore italien, destiné à passer à l’histoire dans la lignée des différents guignols de province ». Et pourtant, ce guignol sanglant, nous le voyons suivi, adoré, bientôt redoublé d’une ombre encore plus noire, celle de Hitler, et voici Franco, et voici Pétain, et la machine est en marche, l’Europe se ferme et se courbe devant le phénomène. Phénomène de régression tellement lourd et puissant que, tournés vers lui, la plupart des hommes semblent pris de vertige.
Car le fascisme est passé, et il a touché à tout. Il a investi et façonné le corps social des pieds à la tête. Avec la force de la bêtise lorsqu’elle se fait exhibition mortelle, il a pensé le travail, la philosophie, l’art, la famille, les manifestations de masse et les moindres détails. Délire organisé, pleinement rationnel ; délire que presque personne ne semble trouver fou sur le coup (comme s’il satisfaisait à une folie endémique), il en viendra vite à industrialiser la répression, ouvrant ainsi sur un charnier généralisé. Oui, il ne faut pas se lasser de reparler de cette affaire : elle a été parmi nous, elle reste en nous, elle peut revenir sur nous (de ce point de vue, le Chili, ce pourrait être l’Italie ou la France). Et surtout qu’on ne dise pas : il y a eu le mal, il y a le bien, le bien étant défini comme étant le socialisme. Car ce que le socialisme a fait est aussi, nous le savons de mieux en mieux, en question. Ce qui définit la première moitié du siècle, serait-ce donc les camps de concentration ?
Un immense refoulement
Maria-Antonietta Macciocchi parle de « l’immense refoulement qui est à la base du fascisme ». Et c’est bien là ce qui ressort peu à peu des analyses proposées ici. Certes, les thèses marxistes ne sont pas fausses : l’action du capital financier et son appui donné à la solution fasciste, le ralliement de la petite bourgeoisie, élément essentiel du totalitarisme d’Etat, le désarroi du prolétariat et de ses organisations sous-estimant la conjoncture, les erreurs de la IIIe Internationale, tout cela peut être articulé, clarifié. Et, pourtant, nous sentons bien que cette justification après coup n’est pas suffisante, que le fascisme a fait apparaître et jouer quelque chose en plus, quelque chose que nous ne pouvons découvrir que par une connaissance simultanée de la tragédie stalinienne. Comment aborder cette dimension irrationnelle du fascisme, comment ne pas l’éluder ? C’est là qu’intervient la nécessité d’introduire en même temps que l’analyse économique (dont les limites mécaniques ne peuvent pas aller au fond de la question) la découverte irréductible que constitue la psychanalyse. Si une explosion historique prouve la force de l’inconscient sexuel, c’est bien celle du fascisme. Et cela à tous les niveaux de la réalité humaine, dans sa manière même de produire, de se reproduire, de détruire, de s’identifier, de se représenter.
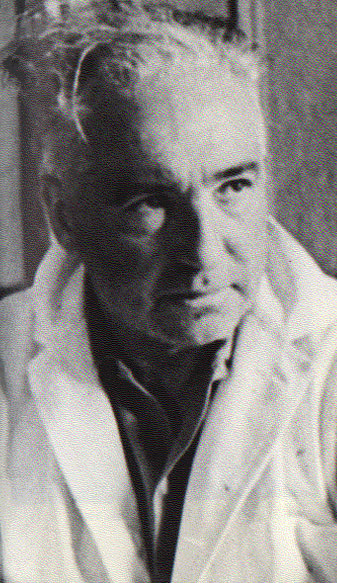
- Wilhelm Reich en 1937.
Une hypothèse : le vingtième siècle serait celui de la résistance acharnée aux deux grandes pensées critiques venant rompre avec deux mille ans de mythologie religieuse, celles de Marx et de Freud. Liquidation de la pensée de Marx par un marxisme fonctionnant comme scolastique. Négation de la vérité sexuelle en train de se faire jour, peu à peu. Comme l’écrivait Wilhelm Reich, autre témoin exemplaire du déferlement de la peste fasciste, mais aussi de l’aveuglement du mouvement ouvrier (ce n’est pas un hasard si Reich est aussi présent dans ces Éléments pour une analyse du fascisme) : « La sexualité humaine revendiquait le droit de passer de l’escalier de service de la vie sociale où, depuis des milliers d’années elle menait une existence sordide, malsaine et purulente, à la façade de l’édifice lumineux appelé pompeusement "culture" et "civilisation". » Pour sauver la façade, il y a donc eu un peintre en bâtiment (Hitler) commandant des massacres. Et tout ce qui pouvait révolutionner l’ordre ancien, collectif et individuel, a été détourné, falsifié, nié.
Marx écrivait et agissait dans la perspective de l’abolition de l’Etat. A l’inverse, on va assister à son renforcement maximum. La démocratie du travail telle que la tentaient les conseils ouvriers ? Voici la caricature : « corporations », parti unique, dictature de l’appareil sur la base. La démystification de la soi-disant puissance du travail qui est un temps fort de la réflexion de Marx et d’Engels ? Voici, à l’envers, le culte de l’effort et de la musculature glorifiée. La mise en cause des origines de la famille ? Voilà, au contraire, le noyau familial exalté de façon mystique. L’internationalisme ? Voilà le gonflement national. Et ce grand retournement de toutes les valeurs de libération en valeurs d’oppression, il marche, il vient, semble-t-il, combler une sorte d’attente sombre, d’angoisse, de peur de l’inconnu et du vide. Et c’est ici qu’intervient la portée subjective du fascisme. Car il a su exploiter à fond, et en allant vite, ce moment de suspension et de transition entre un monde immémorial (deux mille ans de christianisme ébranlés) et un continent nouveau encore sans forme. Ce qui produit cette contradiction formidable : la technique au service de l’obscurantisme le plus médiéval.
Trois objectifs fondamentaux
Ayant réussi à canaliser l’aspiration socialiste en national-socialisme, le fascisme s’est inlassablement occupé de trois objectifs fondamentaux : l’obsession raciste, les femmes, la question des intellectuels et de l’art [4]. Le racisme, et sa condensation absolue, l’antisémitisme, est une pierre angulaire de l’édifice fasciste. La France, nous le savons depuis l’affaire Dreyfus, a eu le sinistre privilège de s’être particulièrement distinguée sur ce terrain. Lisez ces documents d’archives du commissariat aux questions juives, vous ne les lirez jamais assez pour savoir jusqu’où a pu aller l’abjection petite-bourgeoise française sous le maréchal qu’elle s’était donné. Quant aux femmes, tout a été mobilisé par la propagande fasciste pour en faire le quadrillage systématique en tablant sur leurs pulsions les plus archaïques. Les femmes, en effet, représentaient un danger révolutionnaire si elles s’avisaient de l’effondrement de l’idéologie religieuse. Voici donc, pour elles, la nouvelle religion : culte du chef et des héros morts, maternité « à la chaîne ». La danse hystérique de Mussolini et d’Hitler, par exemple, autour de la population féminine, est un des chapitres les plus ahurissants de ce scénario démentiel. Morts-naissances, morts-naissances, il faut absolument abrutir des peuples entiers dans cette équation accélérée (cf. l’intervention de M.-A. Macciocchi sur les Femmes et la traversée du fascisme [5]). Voici « la foule vivante et recueillie des mères et des veuves des disparus » plongée hypnotiquement dans son masochisme sacrificiel, dans sa jouissance renonciatrice. Le fascisme, revendication virile et maternelle, sang et sol, pureté et propreté, vrai homme et vraie femme, se donne alors comme l’incarnation fanatique d’une normalité qui vit d’une négation permanente de la sexualité. La série race-famille-parti-Etat est cette immense machine à broyer du corps pour le compte d’une mère primordiale qui fonde une « fraternité » dérisoire. Notre siècle aura vu ce spectacle : le châtrage océanique de masse, avec, au sommet, ces grands prêtres gesticulants, équivoques, grandes folles militaires ou vieillards gâteux (Pétain). Mais, à côté, si l’on peut dire, voici une autre incarnation messianique ; celle du « petit père des peuples » vers qui monte le gémissement sacral.
Génocide, obsession génétique : voilà comment fonctionne le cerveau fasciste. Il a sans cesse peur d’être altéré, contaminé, souillé. Plus il entasse les cadavres et plus il se crispe dans son idéal définitivement hygiénique, une race, un guide, un sang, un empire, un cœur. C’est le tout-fait-un. Qui aurait cru que le Messie prendrait la figure de ces extraordinaires imbéciles que des intellectuels fascinés créditeraient de toutes les vertus et des connaissances en toutes choses ?
Car le fait est là : non seulement les masses ont accepté de faire tourner l’histoire à l’envers, non seulement le « moteur » qu’elles représentent s’est bloqué sur la marche arrière (dans le moteur « marxiste », on le sait, seule existe la marche avant), mais des philosophes, des artistes, y ont cru, ont servi. Et c’est ici qu’il faut rendre hommage à ceux qui vivaient la grande aventure internationale de la pensée et de l’art modernes : ceux qui ont été pourchassés et éliminés dans toute l’Europe, et pas seulement à Rome, Madrid ou Berlin, mais aussi à Moscou. Ceux qui étaient pour le fascisme les porteurs d’un art « dégénéré », « nègre », « Juif ». Ceux qui, pour Staline et Jdanov, étaient « décadents », « coupés des masses ». Joyce, par exemple. Mais encore : les dadaïstes (dont Hitler disait qu’ils « développaient à l’envers le cerveau humain » ), les futuristes, les expressionnistes, les formalistes, les surréalistes... Bref, tous ceux qui prenaient réellement acte de la possibilité d’un monde nouveau. Le fascisme, lui, se voulait néo-classique, monumental, néo-grec : son ambition (nous le redécouvrons dans les interventions de ces livres) aura été d’arrêter les formes, comme il voulait pétrifier les corps. Sa peinture ? Celle du calendrier. Son architecture ? Le massif bétonneux déclamatoire. Sa littérature ? La répétition des slogans ou de la bonne pensée « réaliste » , la bonne pensée du foyer tranquillement installé au bord de la torture, du four crématoire, de l’asile psychiatrique. Son idéal esthétique ? Le feuilleton moral sur fond de grand-messe unitaire. Et pendant que les trains de déportés roulent dans la nuit vers la « solution finale », Freud va mourir à Londres, les exilés du langage s’appellent par exemple Schönberg, parmi combien d’autres, et les livres brûlent, comme les hommes. Le silence qui couvre alors l’Europe, nous sommes nés dedans, mais savons-nous l’écouter comme il sera toujours urgent de le faire ? Sommes-nous débarrassés des appels à la « moralité » qui sous-entendent toujours une pente fasciste ? Sommes-nous libérés de ce monde hanté ?
Philippe Sollers, Le Monde du 3 mars 1976.
« Quelques points d’analyse du fascisme »
C’est complètement anecdotique, mais quand même symptomatique : qui, à l’époque, manifesta sa violente hostilité au Séminaire de Macciocchi ? Un groupe « Foudre » dit « d’intervention culturelle » dont le grand timonier était Alain Badiou !
A propos des « manifestations » de ce Groupe, le philosophe Bernard Sichère écrivait récemment : « De fait, au "Groupe Foudre" de piètre mémoire, nos "ennemis" laissèrent à désirer : Macciocchi, Gérard Miller, Ariane Mnouchkine... on aurait pu rêver plus ardent combat de classe ! Foucault, quand j’osai le solliciter au téléphone, me rembarra sans ménagement : "Le groupe comment ? Le groupe Moon ?". Sans commentaire. » [6]. Le Groupe Foudre, donc, eut la prétention à s’opposer à tout débat public sur le fascisme s’appuyant sur des documents concrets. Philippe Sollers adressa alors à Maria-Antonietta Macciocchi la lettre suivante :
Le marxisme n’a perçu l’événement que de profil et à l’envers. La psychanalyse était encore « trop jeune » : pourtant, elle seule frayait déjà la voie de la connaissance par rapport à la racine de cette explosion. Une victime exemplaire à la charnière : Reich.
Le marxisme s’étant trompé lourdement (stalinisme) la conséquence sera inévitablement un effet de « pudeur » bien compréhensible pour aborder la dimension du fascisme. Ce n’est pas son intérêt profond d’y voir clair sur ce point, parce qu’y voir clair sur ce point serait remettre en cause la structure même de ce qui le constitue comme théorie et comme pratique.
On peut aujourd’hui dire fermement : non le marxisme ne peut pas analyser réellement le fascisme. Symptôme : la convulsion dérisoire de Foudre, à Vincennes, manifestant au grand jour tous les archaïsmes « marxistes » (là où les « partis responsables » ont appris à rogner les angles et arranger le paysage selon l’opportunité du moment).
Il ne s’agit pas de « révisionnisme » mais d’autre chose. On n’est pas « révisionniste » ou non face au fascisme : on est intégralement d’un côté ou de l’autre. C’est gênant, mais c’est comme ça. Pourquoi ? Crise de la rationalité elle-même. Sinon, on ne comprendra jamais la pointe inéluctable du fascisme : l’antisémitisme. Nécessité de penser autrement (nécessité marquée par la psychanalyse).
Le fascisme doit être analysé sur trois faits fondamentaux :
— l’antisémitisme,
— la conception des intellectuels et de l’art,
— les femmes.
que dit le marxisme ? Qu’être juif, artiste ou écrivain, femme, est secondaire par rapport à la lutte des classes, etc. Le marxisme a cru abolir ces différences. N’importe qui est à écouter aujourd’hui par rapport à ces trois pôles fondamentaux : sa façon d’en dénier la singularité, ou même simplement l’existence.
J’ai abordé ce problème du « symbolique » dans Critiques (Tel Quel, 57, début 74.) [Voir ci-dessous.] L’histoire du XXe siècle ne peut progresser qu’en mettant définitivement en cause l’idée du « progrès » antérieur, et en analysant radicalement le phénomène fasciste. En partant de là : que le fascisme est présent partout, à chaque instant ; qu’il est à l’intérieur de chacun ; qu’il peut se manifester là où on l’attend le moins comme germe. C’est donc, à travers des faits sociaux d’une ampleur immense (nazisme, mussolinisme, franquisme, pétainisme etc.) toute une microbiologie qu’il s’agit d’établir.
Philippe Sollers, Juin 1975.
Et dans Tel Quel n° 66 (Eté 1976)
A PROPOS D’UNE FAÇON DE FAIRE GROUPE
Pendant un an, à l’université de Vincennes, un groupe se prétendant « marxiste-léniniste » a tenté d’empêcher le travail de Maria-Antonietta Macciocchi sur le fascisme.
Tracts, insultes, rien n’a manqué à leur mise en scène malade. Ils recommencent aujourd’hui en distribuant un torchon qui a au moins le mérite de les montrer à visage découvert. Plus de « marxisme », ici : la simple répétition injurieuse et diffamatoire. Le fait que cette violence s’adresse à une femme, et à une femme qui n’est pas française, ne peut être tenu pour un hasard.
Le « groupe » en question compte sur votre complicité, active ou passive. Sur votre silence. Sur votre gêne. Bref, sur votre lâcheté.
Les soi-disant « marxistes » Badiou et Boons, leurs comparses, leurs relations, leurs amis, doivent savoir qu’ils ne peuvent espérer aucun accord, fût-il viscéral.
Le cas de Macciocchi est parfaitement exemplaire : une femme, une étrangère, a-t-elle oui ou non le droit de vivre, de parler et de penser dans notre pays aujourd’hui sans avoir affaire au nationalisme fasciste qui court dans les inconscients ? Le groupe « Foudre » distribue son délire jusqu’au séminaire de Lacan : symptôme.
Quant à nous, nous sommes décidés à juger chacun et chacune sur cet incident.
Tel Quel, 10 mars 1976.
Archives Tel Quel
1. Le fascisme
Exposés internes à Tel Quel (1973) [7]
Peut-on, après la seconde guerre mondiale, considérer le fascisme comme disparu, effacé ? Nullement. Au contraire. Il a subi une défaite militaire (Allemagne, Italie, Japon) mais pas organique . Il n’a pas été renversé « de l’intérieur ». Il est maintenu, varié, aménagé par l’impérialisme américain partout dans le monde. Il s’étend pratiquement en ce moment à tout le continent sud-américain.
Le Chili constitue ici un exemple particulièrement frappant. Voilà un pays qui, comblant les fantasmes évolutionnistes, semblait accéder au socialisme naturellement, légalement, c’est-à-dire sans révolution. En somme, il s’agissait du premier cas dans l’histoire, tous les autres passages au socialisme, toute autre transformation des rapports de production s’étant déroulés à la faveur de la guerre ou d’une armée extérieure. Ce dernier point est décisif car si l’on se fait une idée « pacifique » de l’évolution de l’humanité, le Chili semblait répondre enfin à cette attente. Or qu’est-ce qui se passe : putsch fasciste à l’encontre de la croyance humaniste-évolutionniste. Catastrophe pour la gauche occidentale.
Je reviens sur le fait que le marxisme laisse le fascisme non pensé en profondeur, par une méconnaissance traditionnelle du poids matériel de l’idéologie. Tout s’est passé, en somme, comme si ce qu’avaient amené Marx, Engels, Lénine était si énorme, si complexe à penser à tous les niveaux, si difficile à appliquer selon cette pensée critique et dialectique, qu’une « chute » comme celle du stalinisme avait été inéluctable. Les seuls efforts pour en sortir ont été, on comprend pourquoi, une défense minimale des droits de la science. Mais l’efficacité propre de l’idéologie, le problème des superstructures (droit, philosophie, art, etc.), reste encore opaque pour les marxistes eux-mêmes. On a dit, pour sortir du drame stalinien : sauvons la science, la procédure, la rationalité scientifique. C’est élémentaire. A présent, on se rend de plus en plus compte que c’est tout le domaine des superstructures qui demande à être réexaminé. Mis à part Mao, et la révolution culturelle, aucun marxiste n’a sur ce terrain grand-chose à dire. Regardez : quelques percées de Gramsci (en prison, mort en 37, c’est très tôt) ou de Brecht, c’est tout. La lucidité, de plus en plus intenable, pour lui, de Reich. Et aujourd’hui ? Presque rien. En revanche, les idéologues bourgeois ont beau jeu de mettre en scène la « convergence » nazisme-stalinisme. Leur problème est simple : défendre le droit bourgeois qui, (en effet, constitue encore quelque chose d’indépassé dans l’histoire occidentale (et pour cause). Sauver les « droits de l’homme ». Mais précisément, ce qui est en cause, c’est l’homme soi-disant universel et abstrait de la bourgeoisie. Et on ne peut pas sortir de cet « homme » avec des formules passe-partout, du genre « ce n’est pas l’homme, ce sont les masses qui font l’histoire », ou encore « dictature du prolétariat ». Il faut traiter le problème concrètement, et si l’on veut éviter que ressurgisse « l’homme », alors on ne peut pas se passer de la science qui dissout, de l’intérieur, sa fétichisation : la psychanalyse.
Sans une inscription de la problématique psychanalytique au cœur du matérialisme historique on court à l’impasse. C’est si vrai que l’impasse, si l’on peut dire, n’arrête pas. Vous obtenez alors cette autre composante, nouvelle dans l’histoire, qui est le social-fascisme. A savoir : dans les pays dits « socialistes » traitement psychiatrique mécanique des « anomalies idéologiques », généralisation policière. Comme en URSS. Personnellement, je reste confondu quand je vois tout un petit monde universitaire, philosophes, spécialistes de ceci ou cela, se servant ici de la psychanalyse et restant insensible à la tragédie que représente pour le socialisme cette méconnaissance du freudisme. Vous me direz qu’ils ne sont pas marxistes. C’est vrai. C’est même, on le sait, un critère favorable pour être membre du parti communiste français. Vous me direz qu’ils se moquent de la vérité psychanalytique. C’est vrai aussi. Ce qu’ils veulent, c’est leur bouillon universitaire. Quand ils sont marxistes, leur ignorance des problèmes sexuels est confondante, énorme. Quand ils sont psychanalystes, l’histoire leur est aussi étrangère que, comme disait Freud, l’ours blanc pour la baleine. Alors ?
Le fascisme introduit quelque chose de plus que la catégorie économique. C’est ce facteur, irrationnel pour une vieille raison, qu’est la libido. Et c’est ce facteur qui cimente la viscéralisation idéologique de la petite-bourgeoisie. Trop souvent, les marxistes pensent que la petite-bourgeoisie est un accident de l’histoire. Encore le schéma : il y a la bourgeoisie d’un côté, le prolétariat de l’autre, la petite-bourgeoisie fait du va-et-vient, et bascule du côté du pouvoir. Or, pas du tout. La petite-bourgeoisie est très capable de prendre le pouvoir pour son compte : c’est le fascisme. Bien sûr, en dernière instance, elle le fait pour le compte de la bourgeoisie. N’empêche que le fascisme est sa création spécifique. Sa connerie à elle. Que vous pouvez toujours senti en elle de façon latente. C’est là.
Je n’ai jamais rencontré un seul marxiste à la hauteur du problème. En revanche, cet impensé du fascisme peut très bien fonctionner, et rapidement, de façon fasciste dans un processus de petite-bourgeoisisation du marxisme. Il suffit d’entrer en contact avec des individus des pays dits socialistes pour s’en rendre compte. Un : le marxisme devenu dogme stéréotypé est privé à leurs yeux de toute valeur critique et gnoséologique. Deux : ce qui fonctionne au-dessous de cette loi, pour ainsi dire châtrée, ce sont les pulsions les plus archaïques. Trois : vous allumez la lumière, et immanquablement vous avez une réaction de type fasciste.
Même état chez les retraités du stalinisme. Ou chez les néo-staliniens. Même mélange de rigidité pathologique et d’élancement anal. Même familialisme débile.
Pour la gauche, le fascisme est devenu quelque chose de religieux, le mal absolu, donc qui ne peut exister que dehors, qu’ailleurs. Alors qu’il s’agit d’une réalité interne permanente. Plus la gauche conjure imaginairement le fascisme au lieu de le traiter en lui-même, c’est-à-dire selon sa causalité non seulement externe mais interne , et plus vous constatez qu’il s’installe tranquillement partout. C’est la réalité dramatique de notre époque.
2. Le droit/la religion
Donc on a affaire à ce droit de l’homme bourgeois, incapable évidemment de se laisser subvertir par la psychanalyse, par la découverte de l’inconscient freudien. Il n’y a qu’à aller devant n’importe quel tribunal en train de juger n’importe quel ouvrage soit-disant pornographique, pour se rendre compte que le droit bourgeois tel qu’il fonctionne sur ces problèmes est dans l’incapacité absolue de voir apparaître en lui une découverte scientifique. Cela signifie que le droit bourgeois, de ce point de vue, retarde d’un siècle et demi ou deux. Tous les problèmes qu’est censé synthétiser ou résoudre le droit bourgeois sont complètement dépassés par la pratique de la bourgeoisie elle-même. On a le choix entre ce droit bourgeois et une absence de droit ou un squelette de droit dit "socialiste" qui est encore en deçà du droit bourgeois puisqu’il ne critique pas fondamentalement les catégories instituées par la bourgeoisie pour sa domination de classe, pour sa reproduction élargie (problème de la famille, etc.). Je veux dire qu’il ne critique pas le facteur "homme" de ce droit, mais seulement sa place dans la production. Cette lacune de droit correspond à un traitement par dénégation (par exemple : les besoins sexuels) qui se traduit par toute sorte de retards, non seulement au niveau juridique mais même au niveau scientifique puisque le droit influence tout le corps social. De même que du temps de la période de Staline étaient faites des erreurs aussi grossières que : "il y a une biologie prolétarienne et une biologie bourgeoise", de même aujourd’hui et souvent chez les mêmes qui croient être revenus de ces erreurs, il y a par rapport, disons, aux problèmes du psychisme, de la sexualité, les mêmes aberrations anti-scientifiques qui sont en retard sur la progression, malgré tout, sur ce terrain, de la bourgeoisie. Ce qui prouve que si on laisse tomber un droit bourgeois pour s’en tenir à un droit lacunaire, c’est-à-dire si on prend un droit lacunaire par rapport à un droit qui retarde déjà d’un siècle et demi , il y a de fortes chances que se produise dans cet appel de vide ce quelque chose comme un phénomène de fascisation qui serait un phénomène de bourgeoisisation petite-bourgeoise sans même les garanties, pourtant complètement dépassées, du droit bourgeois lui-même . Alors on serait passé du droit de l’homme au droit de l’État, de la nation, finalement un droit d’État qui ne fera que sanctionner des intérêts nationaux. Dans tout cela, ce qui reste complètement intact c’est la mise en question de tout ce qui règle précisément les choses les plus fondamentales de la reproduction de l’espèce (sexualité, langage).
Or la question du langage est la même que celle de la sexualité. Il n’y a pas de sexualité sans langage et réciproquement. Autrement dit, l’état d’un langage c’est l’état d’une sexualité, et l’état d’une sexualité c’est l’état d’un langage. Dans le monde, on peut remarquer une forme de domination bourgeoise impérialiste qui est en avance pour l’instant dans ce domaine. C’est-à-dire : possibilité de poser, même de façon complètement falsifiée, les problèmes de la sexualité, possibilité de poser les problèmes du langage. Autrement dit : développement de ces questions au niveau de l’idéologie, de l’art, etc. Je ne veux pas dire du tout que la société bourgeoise accepte l’articulation entre sexualité et langage. Son droit le lui interdit (d’où : pornographie d’un côté, famille de l’autre). Mais la possibilité existe, minoritaire, de poser cette vérité. Il ne faut pas oublier que la thèse que je soutiens là est une thèse freudienne et une thèse qui ne peut pas être connue officiellement par la société bourgeoise, d’où le côté en écart, perpétuellement menacé, des thèses freudiennes, des thèses sur l’inconscient, le corps, le langage, etc. En réaction au freudisme, il y a le formalisme, l’histoire des formes et du langage suspendue en l’air, non liée à l’histoire sociale, cela va de soi, puisque c’est une conception idéaliste, mais ce qui est plus grave, non liée à l’économie sexuelle. Il y a le formalisme ou, à l’envers, la théorie du reflet débile — c’est-à-dire le langage comme reflet passif de la position de classe, etc. Fétichisé par le formalisme, on ne sait pas ce que devient le langage dans la théorie du reflet débile. Il n’a qu’à se faire le plus discret possible. En général, ce n’est pas ce qui arrive, car si encore il était neutre, ce serait très bien, mais dans l’expérience du reflet débile, car le langage ne se supprime pas comme ça, ce qui revient ce sont évidemment des formes archaïques. Chaque fois qu’on ne veut pas savoir qu’il y a de toutes façons le langage, qu’on croit qu’il est transparent, on met un truc ancien automatiquement à la place de ce qu’on croit être transparent. Et puis, il y a une troisième forme de résistance, qui est la conception métaphysique de la sexualité comme dernier refuge de toute cette grande désertion qu’introduit l’analyse freudienne dans l’ordre des superstructures religieuses. On a parlé du droit mais les superstructures religieuses ne sont pas une petite affaire. Beaucoup de gens seraient étonnés, eux qui se croient comiquement débarrassés de toute trace religieuse, si on leur démontrait et c’est toujours possible avec n’importe qui, que leur discours est constamment religieux, constamment branché sur la religion dans laquelle ils baignent sans la voir. On les trouvera complètement démunis sur des problèmes élémentaires du christianisme ou du judaïsme. On les trouvera dans l’incapacité de se faire la moindre idée de leur imprégnation religieuse refoulée. En tout cas, l’attention ne sera jamais attirée sur la critique analytique de la structure dans laquelle ces individus se vivent, où ils sont nés, dans laquelle leur langage s’est formé etc. Donc il y a là un mur, dont on ne voit pas pour l’instant qu’il puisse être franchi.
De plus, la religion est un phénomène de masse. Personne n’a jamais constaté deux siècles après les lumières, que la religion ait disparu. Elle est toujours là. Comme quoi le rationalisme et le matérialisme mécaniste bourgeois ne suffisaient pas à la mettre en l’air. Il fallait quelque chose d’autre. On l’a en main en principe. Mais il faut le développer, s’en servir. C’est la théorie de l’inconscient freudien. Alors on peut imaginer très bien comment la dégradation qui n’entame pas malgré tout le fond du problème des superstructures religieuses pose un phénomène transitoire de crise qui sera précisément (ça répond à une certaine levée du refoulement seulement dans la représentation) un surinvestissement de la sexualité comme miroir aux alouettes. On comprend très bien que tous ceux qui ont des problèmes religieux (névrotiques) très profonds auront tendance, tout naturellement, à reporter leurs investissements dans ce champ sur la sexualité. C’est particulièrement vrai pour les artistes, les intellectuels. L’intellectuel ou l’artiste n’est plus un salarié de la religion ; il n’est pas un salarié de la science. Il est flottant sur le marché symbolique et ne se vend que comme fétiche (peinture) ou comme agent de la reproduction du savoir. Il peut alors placer toute sa croyance religieuse non critique dans le domaine d’une croyance à l’investissement sexuel. De façon non critique, c’est-à-dire valorisée comme une instance sacrée, mystérieuse. Là-dessus on peut voir que ce phénomène sera plus particulièrement petit-bourgeois. Pourquoi ? La bourgeoisie fait sa révolution rationaliste. Quand elle s’aperçoit que pousser trop loin, c’est-à-dire pousser la déconstitution complète de la religion, cela va être ne plus pouvoir tenir ce qui vient derrière elle, c’est-à-dire le prolétariat, elle laisse la religion en place. Elle clive simplement les problèmes. Il y aura la religion, il y aura les affaires rationnelles, l’Église et l’État. Elle conserve la religion pour tenir le peuple. Mais à partir de ce moment, la bourgeoisie a sur les problèmes de la sexualité par exemple, une incrédulité profonde, c’est une classe qui fait la révolution, qui a le pouvoir, et avec une parfaite hypocrisie peut très bien laisser subsister des structures de croyances religieuses en n’y croyant pas elle-même une seconde. C’est ce qu’elle a fait. Tous ses idéologues sont en majorité convaincus que la religion, on n’en a rien à faire. D’où refoulement et, par conséquent, survie inconsciente. Et du point de vue de la sexualité, ça donne la chose suivante : on clive au niveau du droit. Le droit reste un droit normatif, qui ne fait aucune place dans la conscience législative à la sexualité, mais en même temps la pratique de la bourgeoisie est émancipée dans ce domaine. En revanche, la petite-bourgeoisie va voir lui arriver la sexualité comme un énorme problème par rapport auquel elle n’a aucun instrument critique et qui va fonctionner pour elle comme la nouvelle religion. La sexualité, par définition, c’est la religion de la petite-bourgeoisie. C’est d’ailleurs pour ça que c’est sur le terrain de la sexualité que la fascisation de la petite-bourgeoisie pourra s’opérer. Comme une traînée de poudre, comme l’expérience historique le prouve, comme Reich l’a très bien montré, les masses petites-bourgeoises peuvent être saisies par la religion sexuelle du fascisme, par la sexualisation du manque de religion. Cela s’est produit. Cela peut se reproduire. Et, là, on voit bien que la lutte est très difficile, car la bourgeoisie n’a aucun intérêt à soutenir la moindre analyse freudienne, sauf très indirectement, si elle a l’assurance que cela ne posera aucune question sociale ou politique directe, et qu’il s’agira d’un ronron idéaliste de plus. L’influence bourgeoise sur la théorie analytique, qu’est-ce que c’est ? C’est la dénégation, par la philosophie, de la pratique analytique, dénégation qui devient une spéculation "philosophique" sur Freud, sur l’inconscient, sur ceci, sur cela. C’est la dénégation de la pratique analytique et de la vérité qu’elle peut faire surgir. Voilà l’influence de la bourgeoisie sur l’analyse. C’est, si on veut, une influence de droite qui consiste à bloquer la théorie et la pratique de l’analyse. L’influence plus radicalement petite-bourgeoise se marquera, elle, par un refus pur et simple. Les investissements sexuels étant beaucoup plus forts, beaucoup plus immédiats, la petite-bourgeoisie ne voudra pas voir une connaissance dans ce qui risque à ses yeux d’amoindrir cette valeur suprême (le sexe), de la rendre fallacieuse, de la rendre moins consistante. C’est un problème de croyance. Pour la bourgeoisie, c’est un problème de pouvoir : ce n’est pas du tout la même chose. Quant au prolétariat, il n’y a pas à en parler, car il est très loin de pouvoir : à travers ses théoriciens, ses penseurs organiques, quand il en a, et il n’en a pas la plupart du temps, il est très loin de pouvoir se poser la question de sa situation dans la société, et de savoir ce qui se passe là où il est contraint de se reproduire. La question, neuf fois sur dix, ne peut même pas être posée. De plus, il subit l’influence bourgeoise et petite-bourgeoise, notamment à travers le parti révisionniste, et sa seule réaction peut être de nier le problème, ce qui aboutit à une négation renforcée.
De quoi parle la religion ? De sexualité. Mais ce n’est pas la sexualité qui peut mettre la religion en danger. Elle en vit très bien. Elle s’y retrempe. Elle s’y retrempe surtout dans le type de religion que nous connaissons dans notre civilisation. Autrement dit, on peut parler d’un très bon avenir très présent de la religion. Avenir présent du fascisme, avenir présent de la religion. La plupart n’en sont pas conscients. Cela fonctionne comme un appel à la loi, lorsque celle-ci ne peut plus garantir la jouissance. C’est un appel à la répression. Voilà ce qui fonctionne en ce moment. C’est probablement une crise de paternité, telle que l’histoire n’en jamais connu, d’où quelque chose qui est assez sensible, la prégnance du problème, cet espèce de profil du droit maternel non critiqué qui se profile derrière la crise du droit patriarcal ; c’est-à-dire un retour de refoulé qui se montre dans la crise générale du droit. Vous voyez on en revient toujours au droit ; c’est le vieux problème de la loi. Ce qui se montre derrière ces phénomènes de résurgences du fascisme et de fascisation interne sur base sexualo-religieuse de la petite-bourgeoisie, c’est cette crise de la loi. Or la loi, si on peut dire, il en faut. Parce que s’il n’y en a pas, ou s’il y en a comme purement extérieure, la jouissance n’a pas lieu. C’est ça que la découverte de Freud indique. Autrement dit, une situation sans loi, c’est une situation sans jouissance, c’est-à-dire une situation sans langage, une situation sans sexe et réciproquement. Et ce qui vient à la place d’une loi, qui ne garantit pas la jouissance, qui ne la permet pas, tout en l’interdisant, c’est-à-dire en la pensant et en la parlant, c’est évidemment une loi qui, dix fois pire, va infliger la jouissance sous la forme par exemple du massacre, qui est un phénomène qui relève aussi de la jouissance, sous la forme du racisme, etc. Dès qu’il y a cette crise dans l’accès à la jouissance par la loi, la loi inflige la jouissance. Voilà ce qui se produit dans ce qu’on appelle le fascisme. On peut jouir de se voir infliger la jouissance . C’est connu. Des masses entières peuvent en jouir. C’est ça le fait nouveau apporté par la psychanalyse. Car si ça jouissait pas quelque part, il n’y aurait pas de problème. Tout le monde se soulèverait, se révolterait, renverserait quelque chose qui est aussi désagréable. Seulement voilà, il faut bien que ça jouisse aussi de se faire infliger la jouissance, pas de se la donner . Et c’est pour cela qu’on ne sait pas encore ce que serait le sujet d’un droit à la jouissance. Le marxisme n’en accouchera pas dans le temps évolutif de l’histoire, l’histoire n’accouchera pas toute seule de cette réalité. Elle n’est pas un "devenir". Elle est là ou elle n’est pas là. Elle "n’advient" pas à quelqu’un quand tout simplement il vit un peu mieux, quand il passe de la faim à une vie relativement correcte, puis à une relative aisance. Ça peut très bien continuer comme ça longtemps, et la vérité dont je suis en train de parler peut ne jamais lui arriver. Donc, en quelque sorte, c’est d’un autre ordre. Il ne faut pas essayer de mettre la main dessus. Ça ne s’achète pas ; ça ne peut pas se mettre dans un tiroir, dans un compte en banque... C’est un autre type de découverte, de fonctionnement. Et tant que cette vérité, en quelque sorte "à contre-temps", n’aura pas pénétré d’une certaine façon, irrésistible, dans la conception matérialiste de l’histoire, à chaque instant, le fascisme menacera.
Je résume : le droit bourgeois est un "droit de l’homme". Le problème est de dépasser ce droit en même temps que l’image pour lequel il est fait (l’homme idéal, abstrait, en miroir). Ce qui doit accéder au droit, c’est : 1) les masses s’appropriant les rapports de production et de reproduction ; 2) le sujet de la jouissance pris entre langage et sexualité dans une sphère de dépense , à ce jour encore méconnue. C’est pourquoi plus les droits des masses populaires sont reconnus dans la sphère de la production-reproduction, plus il est urgent d’insister sur le problème d’un droit à la dépense. Il y a là une "inégalité", une dissymétrie, qu’il faut aborder. En effet, autant l’égalité de tous devant la circulation quantitative des biens doit être affirmée, autant cette égalité est un leurre répressif dans le champ qualitatif du langage. L’arithmétique n’est pas l’algèbre. La production et la reproduction "pleines" ne sont pas la négativité dépensée. Ici, une évidence : il n’y a pas de "démocratie du signifiant" pas plus que de la sexualité. A ceux qui, dans une visée idéaliste et métaphysique voudraient maintenir ce leurre, la crise de la différence sexuelle (homme/femme) se chargerait de rappeler cette négativité, de même que l’impossibilité d’arriver à une transparence de la communication. C’est en ce point, on le voit, que la psychanalyse intervient, seule réponse possible au faux débat interminable entre "humanisme" et "anti-humanisme ". Humanisme et anti-humanisme restent fondamentalement abstraits , et ne résolvent aucun problème. Ils sont d’ailleurs incapables, l’un comme l’autre, dans leur métaphysique viscérale, d’intervenir efficacement au niveau de l’idéologie, du langage et, par exemple, de la littérature ou de l’art. Ils laissent intacts les problèmes de la sexualité et, finalement, renforcent un retour du refoulé religieux qui fonctionne comme chez lui entre cet "homme" et cette "absence d’homme". En quoi, ce n’est plus de l’homme qu’il s’agit, ni de sa négation, mais désormais d’autre chose.
Philippe Sollers, Tel Quel 57, p. 127-134.
Littérature et politique
« La politique moralisante s’insinue partout et juge la littérature,
alors que, sans efforts, c’est à la littérature de juger la politique. »Philippe Sollers, Littérature et politique, 2014.
L’air du fascisme
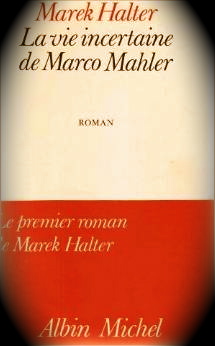 Comment un pays s’installe-t-il insensiblement dans le fascisme ? Par une sorte de mouvement lent, vaseux, coupé de saccades ; comme un mauvais rêve qui sortirait peu à peu du sommeil pour prendre la couleur même des visages, des rues. C’est la vie incertaine, c’est-à-dire privée de repère fixe, d’identité assurée, une géométrie qui vacille, le double fond des apparences, une atmosphère sourde de manipulation, d’espionnage diffus avec, de temps en temps, des sirènes de police, des bombes. Voilà la Vie incertaine de Marco Mahler, à Buenos-Aires, la ville de Borgès, du tango et des informations parallèles.
Comment un pays s’installe-t-il insensiblement dans le fascisme ? Par une sorte de mouvement lent, vaseux, coupé de saccades ; comme un mauvais rêve qui sortirait peu à peu du sommeil pour prendre la couleur même des visages, des rues. C’est la vie incertaine, c’est-à-dire privée de repère fixe, d’identité assurée, une géométrie qui vacille, le double fond des apparences, une atmosphère sourde de manipulation, d’espionnage diffus avec, de temps en temps, des sirènes de police, des bombes. Voilà la Vie incertaine de Marco Mahler, à Buenos-Aires, la ville de Borgès, du tango et des informations parallèles.
Mais sommes-nous en réalité en Argentine en 1953, en 1974, l’année dernière encore, ou déjà à peu près partout, n’importe où, dans une des mégapoles de 1984 ? Le Chili n’est pas la France, nous a-t-on dit et répété, il y a six ans, pour montrer que le socialisme, en France, serait autre chose qu’un engrenage fatal vers la dictature militaire. L’Argentine des disparus d’aujourd’hui n’est pas la France ? Mais alors d’où vient ce malaise, plus profond que la crise, ces instants lourds, ce soupçon, et surtout, symptôme qui ne trompe pas, ces soudaines discussions à propos d’un personnage central, vous savez, enfin celui qui fait question, celui qui est en lui-même un problème, comment l’appelez-vous déjà ? On en parle beaucoup ces temps-ci... Comme le dit Marek Halter, dans l’une des scènes de son roman : dites que vous êtes juif, et il y aura chaque fois ce silence. Un silence hurlant, en quelque sorte, lourd comme une pétrification de toute l’histoire et qui échappe à chacun des acteurs.
Le président a les sympathies de la gauche et des syndicats, mais déjà les groupes révolutionnaires veulent aller plus loin et déclenchent le terrorisme. Dans le même temps, la droite s’infiltre dans tous les rouages de l’administration et de l’État, et elle aussi prépare sa terreur. La droite ressemble à s’y méprendre à la gauche et la gauche, de plus en plus, se comporte comme une droite qui se croirait à gauche. Dans ce chassé-croisé où chacun (c’est peut-être là l’essence du fascisme : une apparition du lien social comme faisceau de déplacements, le fait que tout le monde pousse à un moment donné dans le même sens mais sans le savoir), où chacun, donc, est un autre, se ressent intimement comme un autre, le narrateur porte une mémoire plus ancienne, celle d’un exil qui le tient à distance des communautés. 1953 : c’est l’année de la mort de Staline, et comment est-il possible qu’il soit pleuré en Argentine par de vieux juifs de Varsovie ? Là encore, le malentendu rend la vie toujours moins certaine. Les amis du narrateur, les femmes qu’il rencontre, sont-ils, sont-elles, du côté du jour ou de la nuit ? L’air fasciste est à double respiration, on y entend résonner à la fois deux paroles en une. Vérité, mensonge, bonne ou mauvaise foi, fidélité, trahison ? Il n’y a pas de sol sûr, chacun se prépare, c’est la grande fascination venue du dedans, celle de la mort.
Écoutez ce que dit Peron dans le roman, c’est édifiant : « On a dit que j’avais eu des sympathies pour le nazisme. C’est faux. J’avais de l’admiration pour le fascisme italien, ce qui n’est pas la même chose. » Eh oui, cette idée fasciste de "socialisme" national, qui n’est « ni avec les uns ni avec les autres » mais d’abord pour la nation, elle est là, parmi nous, elle y est depuis bien longtemps, et ce qu’il faut comprendre une bonne fois c’est que la chose est possible, les nazis sont allés simplement trop loin, de façon trop voyante, bruyante. Il y a mieux à faire, plus huilé, plus discret, modernisé. Il y aura une nouvelle gauche et une nouvelle droite, et la nouvelle droite sera par certains côté de gauche alors que la nouvelle gauche prendra ses nouvelles à droite. C’est une vieille histoire, si vieille qu’elle est chaque fois plus nouvelle. Simplement parce que ce renouvellement de la pression humaine dans le désir de faire un Tout s’adresse immanquablement à l’autre, à l’autre comme tel, à celui qui ne veut pas se plier au Tout, adorer le Tout.
De ce point de vue, le seul fait de dire d’abord « je », quoi qu’il en coûte, suffit à vous désigner comme juif. « Tous les pouvoirs totalitaires sont amenés à tuer les juifs, parce que c’est une dimension irréductible. » Et si on ne les tue pas, le problème sera de savoir comment les assimiler, les intégrer, les diluer, les gommer et, avec eux, en même temps qu’eux, tous ceux qui ne se sentent pas à leur aise en Totalité, tous ceux, même, qui refusent d’être catalogués dans les cases prévues du gros Tout comme minoritaires.
Comment, vous n’appartenez pas ? Vous n’êtes ni ceci ni cela ? La gestion sociale, la manie du survol politique, c’est cela : empêcher le plus possible le « je » irréductible. Le sujet doit être réductible. C’est la loi. Et la loi ne supporte pas qu’on mette au-dessus d’elle une Loi impalpable. Un Dieu, par exemple, qui a dit de lui-même « je suis celui qui suis » est donc, par définition, suspect.
Écoutez-les, de nouveau, les vieilles sirènes, très anciennes rengaines appelées nouvelles, quand elles vous redisent que s’il y a de l’antisémitisme, c’est quand même que les juifs le cherchent bien. Pourquoi ne se fondent-ils pas ? Pourquoi veulent-ils être eux ? Et vous, de quel droit voulez-vous être un autre ? « Je est un autre », ce n’est pas pour nous. Toi, c’est nous, et, nous c’est nous.
Le narrateur de ce roman, en Argentine, de 1953 à 1978, voit donc monter et se perfectionner le mal. Il assiste au mouvement de sa propre exclusion. Le mal se perfectionne, oui, et le bien ne se présente qu’en creux, par une absence ou une résistance obstinée de celui qui bouge, s’en va, ne se « réduit » pas. Qui meurt ? Qui devient fou ? Qui se renie ? Qui reste intact ? C’est la fameuse question des quatre rabbins soumis à l’épreuve du jardin mystique, le Pardes, le Paradis. Un seul s’en sort. Peut-être celui qui a compris que ce lieu était lui ? Et par conséquent aussi les autres, tous les autres ? La vérité de l’illusion, c’est toujours un roman qui la dit : voilà pourquoi ce livre, plus que tous les débats plus ou moins truqués en cours, vous parle de votre pays, de ses sombres viscères possibles. Le Chili, l’Argentine, l’U.R.S.S., le Cambodge sont la France. Qui ne comprend pas cela est fou.
Philippe Sollers, Le Monde du 28 septembre 1979.
Une prophétie de Bataille
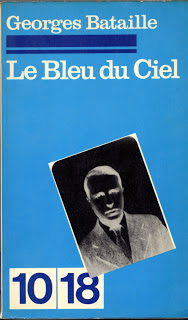 Jour après jour, maintenant, nous évoquons le cataclysme de la seconde guerre mondiale et son double coeur meurtrier : le nazisme, le stalinisme. Mais savons-nous pour autant expliquer cette explosion noire dont nous condamnons l’horreur ? Le vingtième siècle, on s’en doute de plus en plus, aura été celui de la mort programmée. Nous sentons pourtant que cette boucherie froide se distingue de toutes les autres. Mais en quoi exactement ? Les historiens peuvent-ils répondre ? Ou encore les timides freudiens socialisés ? Voici un roman qui nous renseigne mieux que tout discours sur cette ténébreuse et massacrante histoire. Ecrit en mai 1935, il a été publié seulement en 1957. Le revoici soudain devant nous. Qui l’a vraiment lu ? Qui osera le lire ?
Jour après jour, maintenant, nous évoquons le cataclysme de la seconde guerre mondiale et son double coeur meurtrier : le nazisme, le stalinisme. Mais savons-nous pour autant expliquer cette explosion noire dont nous condamnons l’horreur ? Le vingtième siècle, on s’en doute de plus en plus, aura été celui de la mort programmée. Nous sentons pourtant que cette boucherie froide se distingue de toutes les autres. Mais en quoi exactement ? Les historiens peuvent-ils répondre ? Ou encore les timides freudiens socialisés ? Voici un roman qui nous renseigne mieux que tout discours sur cette ténébreuse et massacrante histoire. Ecrit en mai 1935, il a été publié seulement en 1957. Le revoici soudain devant nous. Qui l’a vraiment lu ? Qui osera le lire ?
Avec le Château et le Procès, Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit, Journal du voleur et la Nausée, le Bleu du ciel est sans doute le plus prophétique des récits d’avant la catastrophe. Regardons le paysage littéraire entre 1925 et 1940. Proust est mort, le temps retrouvé est aussitôt reperdu. Dans les oeuvres fortes de l’époque, la mort s’annonce à chaque instant, insiste, grimace, introduit sa suffocation, sombre dans chaque repli de la narration. L’absurde, le non-sens sont maîtres du jeu. L’acteur le plus compromis dans cet effondrement généralisé est bien celui que Bataille met en scène : il est sans cesse hors de lui, dans un vertige fiévreux, il pleure, il s’observe, il vomit, son corps ne lui répond plus, mais il persiste à trouver la situation comique, terrible et comique. « Comment nous attarder à des livres auxquels l’auteur, sensiblement, n’a pas été contraint ? »
C’est là, nous dit Bataille, la fonction sans égale du roman qui « restitue la vérité multiple de la vie » et nous « situe devant le destin ». Il faut raconter l’écoeurement, le trouble, la déchéance, le mensonge criant, la douleur, pour retrouver un « bonheur affirmé contre toute raison ». Tel est l’anti-héros de Bataille : il doit surmonter, page après page, comme dans la vie devenue invivable, une sorte d’invitation permanente à la décomposition. Son diagnostic est celui-ci : la société tout entière est devenue une énorme sexualité ratée, les hommes et les femmes ne peuvent plus se jouer qu’un ballet sinistre et dégoûté d’incompatibilité radicale. Cette impasse mène droit à la répression brutale, c’est elle, au fond, qui est désirée. Les intermédiaires de cette révélation ? Des femmes.
Trois femmes, en tout cas, inoubliables. D’abord Lazare, figure de l’antirésurrection (et transposition très reconnaissable des rapports ambivalents de Bataille avec Simone Weil). Elle est « l’oiseau de malheur » dont « la démarche saccadée et somnambulique » implique « un contrat qu’elle aurait accordé à la mort » . Sainte renversée, inconsciente de son vrai désir, elle rêve et croit agir pour une révolution socialiste. Xénie, ensuite, mondaine hystérique, qui est ici comme un animal pris au piège. Dorothea, enfin, Dirty, un des plus étonnants personnages féminins de tous les romans, qui exprime ouvertement la vérité glaçante du goût pour la mort.
Le Bleu du ciel, d’emblée, est aux antipodes de la fascination romantique ou surréaliste pour « la femme » et sa poésie supposée. Rien à voir avec Nadja ou Elsa. Le voyage, de Londres à Paris, de Paris à Barcelone, puis de Barcelone à Trèves, en Allemagne, est celui de la révélation d’une nécrophilie de plus en plus dure, endiablée. Lazare, sous couvert d’activisme révolutionnaire, est une pure mécanique sacrificielle. Xénie est une pauvre fille qui ne comprend rien, mais finira, comme malgré elle, par faire tuer un homme. Dirty, enfin, ne s’excite que dans la représentation avouée de la destruction cadavérique.
Cette trinité féminine semble concentrer en elle tous les maléfices à l’oeuvre, en secret, sous les apparences historiques. Le narrateur, entre elles, va, titubant, ivre, mais décidé à aller jusqu’au bout, à retrouver, quoi qu’il lui en coûte, une certitude, une « ironie noire » souveraine et neuve : « J’avais ri de la même façon quand j’étais petit et que j’étais certain qu’un jour, moi, parce qu’une insolence heureuse me portait, je devrais tout renverser, de toute nécessité tout renverser. »
Tout est noir, donc, mais dans l’expérience intérieure poursuivie par cet aventurier buté et qui veut tout savoir, la nuit s’éclaire comme en plein midi, ciel bleu et soleil, dans une extase jamais vue qui traverse la dépréciation systématique des autres et de soi. La débauche négative et sale avec Dirty, la maladie endurée en présence de la pauvre et ridicule Xénie, l’agitation insurrectionnelle et morbide avec Lazare ouvrent, chaque fois, sur un rire navré mais cependant triomphal. « Elle devint hideuse. Je compris que j’aimais en elle ce violent mouvement. Ce que j’aimais en elle était sa haine, j’aimais la laideur imprévue, la laideur affreuse que la haine donnait à ses traits... »
Dès 1935, Bataille, comme Picasso dans Guernica, comprend la suite. Non pas de façon abstraite, "politique", mais dans la convulsion intime, bars, chambres d’hôtel, nudité des corps. Tout le monde est d’accord, au fond, pour interdire la jouissance et réclamer, sans le dire, la « marée montante du meurtre » . La mort est l’ersatz de la jouissance sexuelle quand celle-ci est bloquée de tous les côtés.
Cette lucidité visionnaire — si rare — est acquise dans la scène capitale du roman (une des plus belles jamais écrites), à Trèves (la ville où Marx, enterré à Londres, a été « petit garçon »). Scène d’amour ? Oui, dans un cimetière où brûlent des bougies, la nuit : « La terre, sous ce corps, était ouverte comme une tombe, son ventre nu s’ouvrit à moi comme une tombe fraîche. Nous étions frappés de stupeur, faisant l’amour au-dessus d’un cimetière étoilé. Chacune des lumières annonçait un squelette dans une tombe, elles formaient ainsi un ciel vacillant, aussi trouble que les mouvements de nos corps mêlés. » Et plus tard (il s’agit toujours de Dirty) : « Elle colla sa bouche fraîche à la mienne. Je fus dans un état d’intolérable joie. Quand sa langue lécha la mienne, ce fut si beau que j’aurais voulu ne plus vivre. »
Résultat : Bataille y voit. Et ce qu’il voit, peut-être seul de son temps, est l’ignominie qui va venir. Dans cette gare allemande, une parade de jeunes nazis « raides comme des triques » avec, à leur tête, « un gosse d’une maigreur de dégénéré, avec le visage hargneux d’un poisson ». Il aboie des ordres. Il tient sa canne de tambour-major comme « un pénis de singe ». Ils sont tous en transe, « envoûtés par le désir d’aller à la mort ». Le temps des assassins est là. Et pour cause. Voilà donc ce qui, dans l’ombre, se voulait.
Et aujourd’hui ? Qu’est-ce qui se veut de nouveau ? Le savons-nous clairement ? Pouvons-nous l’entendre ?
Aucune issue collective ? interroge Bataille. Non, mais le ciel est bleu.
Philippe Sollers, Le Monde du 12 juillet 1991.
« La Structure psychologique du fascisme »
 L’époque, le contexte : nous sommes début 1933 ; Boris Souvarine a réuni autour de lui les premiers des « communistes oppositionnels » (antistaliniens), auxquels se joignent des « surréalistes dissidents » : ce sera la revue La Critique sociale, où paraît « La structure psychologique du fascisme » en 1933. Les analyses de Souvarine joueront un rôle considérable : elles seront les premières à faire la lumière sur le totalitarisme soviétique naissant ; Bataille y souscrit pleinement ; mais il faut, aux uns et aux autres, faire la part de l’analyse qui revient à l’autre totalitarisme, au totalitarisme concurrent, le totalitarisme fasciste.
L’époque, le contexte : nous sommes début 1933 ; Boris Souvarine a réuni autour de lui les premiers des « communistes oppositionnels » (antistaliniens), auxquels se joignent des « surréalistes dissidents » : ce sera la revue La Critique sociale, où paraît « La structure psychologique du fascisme » en 1933. Les analyses de Souvarine joueront un rôle considérable : elles seront les premières à faire la lumière sur le totalitarisme soviétique naissant ; Bataille y souscrit pleinement ; mais il faut, aux uns et aux autres, faire la part de l’analyse qui revient à l’autre totalitarisme, au totalitarisme concurrent, le totalitarisme fasciste.
Bataille n’est pas le seul à s’y employer, mais il le fait d’une façon qui ne ressemble à aucune autre. Qui, non seulement inaugure la possibilité d’une théorisation qui fera date (il n’y a guère que Wilhem Reich à entreprendre la même chose au même moment, mais sans que l’un ni l’autre n’en sache rien) ; mais qui, en outre, demeure d’une vitalité et d’une validité exemplaires aujourd’hui.
De cet article, un livre devait naître, auquel Bataille a beaucoup travaillé ; son titre : « Le Fascisme en France ». Des problèmes personnels (une « grave crise », comme il le dit lui-même), s’ajoutant à l’accélération de l’histoire, ne permettront pas qu’il le mène à bien. De ce livre, qui eût sans doute aucun été essentiel, ne restent que cet article fondateur, qui l’est lui-même ; et, d’une certaine façon, si insolite que cela paraisse, ou peu courant (comment un « roman » pourrait-il résulter de plein droit d’un « essai » ?), Le Bleu du ciel, achevé en 1935 (et publié en 1957 seulement), le roman des années trente où se lit le mieux ce qu’a dès lors la guerre d’inéluctable.
L’analyse
En quoi l’analyse de Bataille se distingue-t-elle ? En ceci essentiellement, que Bataille use de tous les moyens disponibles pour « penser » (et non pas plaindre, reprocher, « moraliser ») le fascisme. Tous les moyens : ceux de la sociologie durkheimienne (touchant au « sacré », que Bataille appelle pour sa part l’hétérogène) ; ceux de la phénoménologie allemande ; ceux de la psychanalyse freudienne, enfin. C’est nouveau. Il ne faut pas moins qu’eux, selon lui, pour comprendre et interpréter comment se forme une superstructure, qu’elle soit sociale, religieuse ou politique. Son analyse se distingue en cela déjà qu’elle pose qu’une superstructure peut être de constitution psychologique (ce que le marxisme n’a pas su voir). « Lire » le fascisme comme un phénomène politique supplémentaire, c’est ne pas voir de quoi il naît, de l’hétérogène (ainsi que Bataille l’appelle ; en quelque sorte, le « sacré » ainsi que Durkheim l’appelait) et de l’inconscient (au sens strictement freudien) ; et comment il s’alimente de cette provenance violente. Violence que le fascisme n’a plus, dès lors, qu’à concentrer au profit de sa toute-puissance fatidique.
Éditions Lignes
Georges Bataille, La structure psychologique du fascisme
 .
.
La littérature contre Jean-Marie Le Pen
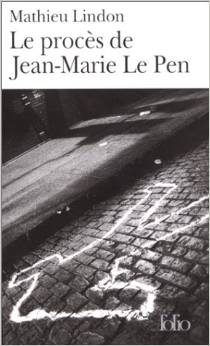 C’est entendu, la France est championne du monde de football ; la République est refondée sur des bases saines ; la liberté, l’égalité, la fraternité, brillent partout par leur évidence ; tout est pour le mieux dans le meilleur des Hexagones possibles, la haine est vaincue, l’exclusion aussi, le racisme n’est plus qu’un mauvais souvenir. On a vu tout un peuple en liesse, peaux blanches ou brunes tatouées aux trois couleurs ; on a admiré non seulement les joueurs, mais toute une jeunesse sportive, enthousiaste, au milieu de laquelle le président flottait, comme en pleine ivresse. Quel jour noir pour le fascisme ainsi écrasé, humilié, gommé ; quel moment radieux de conscience. L’automne, déjà, et les premiers brouillards s’appellent sans-papiers, immigration, chômage, misère, crise asiatique, débâcle du rouble, angoisses autour de l’euro. C’est la rentrée : scolaire, politique, littéraire. Je lis un bref roman, et non seulement je le trouve littérairement excellent, mais politiquement remarquable de justesse (ce qui est le contraire de correct). Un roman pourrait donc, à un moment donné, être plus vrai, sur la situation réelle d’un pays, que toutes les analyses, discussions, protestations, manifestations, pétitions et proclamations ? Oui, et le voici : Le Procès de Jean-Marie Le Pen, de Mathieu Lindon (POL, 144 p., 80 F.). C’est un livre exact, clair, subtil, drôle, terrible. Un livre de contrepoison et de contre-illusion. Un exorcisme efficace, comme toute bonne littérature.
C’est entendu, la France est championne du monde de football ; la République est refondée sur des bases saines ; la liberté, l’égalité, la fraternité, brillent partout par leur évidence ; tout est pour le mieux dans le meilleur des Hexagones possibles, la haine est vaincue, l’exclusion aussi, le racisme n’est plus qu’un mauvais souvenir. On a vu tout un peuple en liesse, peaux blanches ou brunes tatouées aux trois couleurs ; on a admiré non seulement les joueurs, mais toute une jeunesse sportive, enthousiaste, au milieu de laquelle le président flottait, comme en pleine ivresse. Quel jour noir pour le fascisme ainsi écrasé, humilié, gommé ; quel moment radieux de conscience. L’automne, déjà, et les premiers brouillards s’appellent sans-papiers, immigration, chômage, misère, crise asiatique, débâcle du rouble, angoisses autour de l’euro. C’est la rentrée : scolaire, politique, littéraire. Je lis un bref roman, et non seulement je le trouve littérairement excellent, mais politiquement remarquable de justesse (ce qui est le contraire de correct). Un roman pourrait donc, à un moment donné, être plus vrai, sur la situation réelle d’un pays, que toutes les analyses, discussions, protestations, manifestations, pétitions et proclamations ? Oui, et le voici : Le Procès de Jean-Marie Le Pen, de Mathieu Lindon (POL, 144 p., 80 F.). C’est un livre exact, clair, subtil, drôle, terrible. Un livre de contrepoison et de contre-illusion. Un exorcisme efficace, comme toute bonne littérature.
L’histoire est simple, elle a déjà eu lieu d’une autre façon, elle peut avoir lieu de nouveau demain. Un jeune militant du Front national, colleur d’affiches, tue en pleine rue, à la carabine, un jeune Français d’origine algérienne (comme on dit). Nous assistons à son procès, dont l’opinion, presque unanime, attend qu’il soit aussi le procès de Le Pen. Un coupable ne suffit pas, il faut un responsable, et ce dernier, avec ses provocations continuelles et ses appels à la haine, est tout désigné. Le personnage principal, ici, est pourtant l’avocat du tueur : « Un jeune homme de gauche, à la vie personnelle, très personnelle. [...] Fils d’avocats juifs, Me Mine a les cheveux longs, il est élégant, il a trente ans. »
L’avocat et son client (« crâne tondu, l’air brut et maladroit ») forment dans le roman de Mathieu Lindon un couple étrange. La présidente de la cour, le procureur, les avocats de la partie civile, et les militants antiracistes qui manifestent à l’extérieur, en sont pour le moins désorientés. Quelles sont les motivations réelles du jeune avocat ? Carriérisme, ambition, calcul machiavélique ?
On découvre peu à peu que c’est lui, et peut-être lui seul, qui veut vraiment en arriver au procès de Le Pen. Le tueur multiplie les déclarations imbéciles, son racisme est une sorte de roc résistant à tout raisonnement. Il dit simplement qu’il n’aime pas les Arabes, que « tout le monde se porterait mieux s’ils restaient chez eux ». Son comportement agressif, dans le box des accusés, est extrême : « Oui, je suis raciste, dit-il, mais je ne vais jamais à l’étranger, si les étrangers ne venaient pas chez nous, ils n’auraient pas à souffrir de moi. »
Bref, il incarne la stupidité butée, insensible. L’accusé est un imbécile total, comme ses parents, d’ailleurs ; un déchet irrécupérable. La Justice, pourtant, doit suivre son cours démocratique, et donc comprendre ce qui a eu lieu. Or, semble-t-il, il n’y a rien à comprendre, c’est « l’empoisonnement de l’abjection » à laquelle correspond le discours de Le Pen qui, chaque fois qu’il est attaqué, renforce paradoxalement sa position (car enfin, si les sondages sont euphoriques, et on s’en réjouit pour le couple dirigeant au pouvoir, il n’en reste pas moins que le Front national fait toujours 15 % des voix, et que la droite tout entière se laisse lentement glisser de ce côté sombre).
Excitation communautaire
L’engagement de ce livre, avec une précision et une ironie qui évoquent Voltaire, Kafka ou Brecht, montre comment le cas Le Pen est l’objet d’une étrange excitation communautaire. C’est une question de style négatif. Le Pen sait « dire en public le minimum de mots pour provoquer le maximum de mal. S’il parlait moins bien, s’il bafouillait, c’est toute une autre stratégie politique qu’il aurait dû choisir ».
On commence à se douter que c’est précisément la raison pour laquelle Le Pen a « fait son temps », que quelque chose de plus gris, insidieux, normal, mais de tout aussi infecté, se prépare. Vous dites Mégret, vous avez compris. Pour l’instant, le tueur, « par sa conduite et ses déclarations, provoque soit la répugnance pure et simple, soit un début de compréhension horrifiée, un malaise ».
L’avocat, à la vie « très personnelle » (quelle autre vie mérite d’être vécue ?), a un ami intime, Mahmoud, qui lui demande de temps en temps pourquoi il défend « un salaud ». Me Mine emmène son ami chez ses parents, eux aussi avocats, « insoupçonnables du moindre racisme ». Ils dînent, ils jouent au bridge (et c’est là que le roman, en lui-même, est probablement le plus fort). Toute la conversation est en effet hantée par l’origine de Mahmoud et par l’homosexualité du fils, « pas encore marié, même à une goy ». La scène est décrite en finesse, avec ce mot du fils à son père : « C’est mon côté juif, papa : je trouve plus sain quand l’opinion publique est ouvertement contre moi, c’est plus honnête. » L’opinion publique, en effet, juge sévèrement le comportement du jeune avocat (et ses parents ont bien raison de se faire du souci pour sa carrière). Quand il va au restaurant avec son ami Mahmoud, il se fait insulter, par des antiracistes, avec des propos racistes.
On n’en sort pas, l’horreur et la bêtise sont malheureusement contagieuses, et c’est une stupeur désarmée qu’on ressent devant le tueur : « On manque d’arguments face à un tel discours, comme s’il fallait prouver que la vie est préférable à la mort à quelqu’un qui prétendrait ne pas comprendre pourquoi. »
Qui est coupable ?
Le Front national est « le parti des gens qui n’ont rien à perdre » (du moins, à la base ; en haut, dans le confort de l’hypocrisie sociale, on peut toujours faire semblant de déplorer la violence des égouts). Mais le mal est plus radical qu’on ne croit, c’est une « gangrène », « comme si Le Pen mettait la société tout entière sur la défensive ». C’est un « maître à hurler », et « amour ou détestation, c’est lui le personnage central ». Pire : « On a l’impression que l’ambition de la majorité de ses ennemis est d’être manipulés par lui. Pourquoi tant de gens sont-ils fous, bêtes, énervants ? »
Que veut dire, d’ailleurs, cet affairement autour de Le Pen, c’est-à-dire, ne l’oublions pas, d’un « élu du peuple » ? Fallait-il interdire un parti défini officiellement comme étant raciste et xénophobe ? Sans doute, mais il est trop tard, et « l’immonde charme » prospère dans les têtes. D’où la question posée par le jeune avocat : « Qui est coupable ? Celui qui parle, celui qui laisse parler, ou celui qui entend ? » On assisterait ainsi à une sorte de « conspiration publique », expression paradoxale, puisque les complots exigent en général le secret. Tout se passerait à ciel ouvert, en pleine clarté, et pour le voir, il faudrait ouvrir les yeux d’une autre façon. C’est en effet le message (s’il en a un) de ce roman, je le rappelle, mais où, en somme, tout est vrai.
Il y a un dénouement, que je laisse découvrir au lecteur. Et une conclusion que chacun est appelé à méditer pour soi-même (puisque la question de la bêtise raciste doit être personnellement éprouvée pour être comprise dans ses effets intimes et dévastateurs) : « Je crois que le Front national fait partie de chacun de nous, l’exclusion nous est familière. La bassesse que chacun recèle en soi et souhaite étouffer, Jean-Marie Le Pen cherche au contraire à la cultiver, il la fait fructifier. Notre violence contre lui vient aussi de la crainte qu’il y parvienne. » Il n’y parviendra pas. Mais d’autres, derrière lui, sont déjà prêts à tout faire pour y parvenir. C’est à chacun de nous que cet avertissement s’adresse.
Mieux que des dizaines d’essais approximatifs sur le Front national, ce petit livre de fiction vraie dit le réel de l’énorme machinerie sociale de l’infâme. Après tout, Candide n’était pas autre chose, et cela a suffi [8].
Philippe Sollers, Le Monde des livres du 27 août 1998.
Épilogue provisoire
Tiens, ce soir, 19h20 — je n’invente rien ! —, Florian Philippot est maintenant sur BFMTV ! Il est gaulliste, républicain, défend les fonctionnaires, le service public, la « patriote » Rachida Dati (« un succès de l’intégration ») contre son ancien mentor Nicolas Sarkozy, dément toute divergence avec Marion Maréchal-Le Pen qu’il appelle « Marion Maréchal », lui retirant ainsi son plus bel organe (curieux, d’ailleurs, ce nom biface qui semble établir une généalogie française, bien française), rappelle que le FN est un parti de gouvernement (vous en doutiez ?) et que « Marine », « 30% dans les sondages », doit gagner la prochaine présidentielle. Quelle journée harassante ! Est-ce que ça paiera dimanche au Congrès ? doit se demander Philippot.
Une bonne nouvelle quand même : les députés (beaucoup d’absents) ont adopté, ce mercredi 26 novembre, par 143 voix contre 7, une résolution pour « réaffirmer le droit fondamental à l’IVG en France et en Europe ». « Il n’est pas question de revenir sur la loi Veil. » Voilà un combat qui méritait d’être rappelé.
Simone Veil à l’Assemblée nationale le 26 novembre 1974.

Hiver 2017

- Le second tour des présidentielles que les sondages annonçaient.
Printemps 2017

- Et voici les élus du second tour...
Le climat est décidément délétère. Alors que François Fillon, chantre (jusqu’à nouveau désordre) de la droite pour l’élection présidentielle, s’embourbe dans les dénégations et le « Pénélope gate », Marine Le Pen, mise en cause, elle aussi, dans de nombreuses affaires d’emplois fictifs, reste en tête dans les sondages. L’un se rendra à la convocation des magistrats, l’autre refuse. Tous deux mettent en accusation « le gouvernement des juges » et en appellent au « peuple ». Le premier appelle à manifester le dimanche 5 mars (initiative périlleuse désavouée par certains de ses proches), la seconde veut mettre les fonctionnaires au pas. La « gauche de gouvernement » (ou ce qu’il en reste) et les syndicats protestent (et même le syndicat de la police « Alliance » [9]). Courageusement, Aurélie Filipetti, porte-parole de Benoît Hamon, déclare : « Ça veut dire que ce que propose Mme Le Pen, c’est un système fasciste » [10]. Propos excessifs ? En tout cas, elle ne sera pas poursuivie en diffamation puisque la Cour de cassation vient de débouter définitivement Marine Le Pen qui avait porté plainte contre Mélenchon pour des propos analogues tenus en 2011 [11]. Alors, y-a-t-il un danger « fasciste » en France (et ailleurs) ? Certains, désormais, le suggèrent [12]. Dans un livre récent, Les Nouveaux Visages du fascisme, l’historien italien Enzo Traverso préfère parler de « post-fascisme » : « C’est une catégorie transitoire. Le post-fascisme est un concept qui tente de saisir ce processus de mutation en cours : le FN n’est plus un mouvement fasciste, mais il reste un mouvement d’extrême droite, xénophobe, qui n’a pas encore rompu le cordon ombilical qui le lie à sa matrice fasciste ». Il est vrai qu’il faut être précis sur les termes (même si parler de « post-fascisme » n’est, en soi, pas plus rassurant : « Cette notion ne vise ni à sous-estimer le danger, ni à le rendre plus acceptable, mais à le comprendre si on veut le combattre efficacement » [13]).
Dans ce contexte, faire un peu l’histoire de la « matrice fasciste » n’est pas inutile. Lire ce que des écrivains ont dit et parfois prophétisé, non plus. Voilà le dossier que je mettais en ligne le 26 novembre 2014 [14]. — A.G., 2 mars 2017.
[1] Lire L’antisémitisme en France : voir la réalité, sortir des non dits. Je ne me prononce pas sur la validité de l’étude de la Fondation pour l’innovation politique (Fondapol), proche de l’UMP.
[2] Voir à ce sujet : François Meyronnis, Proclamation sur la vraie crise mondiale.
[3] Sur le fascisme vu par Gramsci, cf. La crise italienne, 1924.
[4] Sur ce dernier point, lire Jean-Michel Palmier, De l’Expressionnisme au nazisme ; les arts et la contre révolution en Allemagne.
[5] Cf. aussi M.-A. Macciocchi, Sexualité féminine dans l’idéologie fasciste, dans Tel Quel 66, Été 1976.
[6] Voir à ce sujet : Mai 68, Mao, Badiou et moi par Bernard Sichère.
[7] Dans Tel Quel 57, printemps 1974. Le troisième exposé portait sur « « Ancien. Nouveau. » (la crise de l’université, Lacan).
[8] Ici vous pouvez relire La France moisie et Voltaire contre-attaque.
[10] Cf. RTL du 28 février.
[11] Cf. Le Monde du 28 février.
[12] Lire, par exemple, Elisabeth Roudinesco : "Il y a un désir inconscient de fascisme dans ce pays"
Donald Trump vu par le célèbre historien du régime de Vichy, Robert Paxton.
[13] On lira avec intérêt son interview dans L’Humanité du 17 février, Enzo Traverso « L’extrême droite reprend les codes de l’antisémitisme des années 1930 ».
[14] J’ai repris quelques textes de Sollers sur le fascisme qui s’étalent sur une quarantaine d’années. C’est dire si, pour lui, la préoccupation est ancienne. La dernière illustration se trouve dans BEAUTÉ, un film de G.K.Galabov & Sophie Zhang (2017). Il y est longuement question de Leni Riefensthal (1902-2003), la cinéaste d’Hitler.




 Version imprimable
Version imprimable







 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?



5 Messages
Tout reprendre : « Génocide, obsession génétique : voilà comment fonctionne le cerveau fasciste. Il a sans cesse peur d’être altéré, contaminé, souillé. Plus il entasse les cadavres et plus il se crispe dans son idéal définitivement hygiénique, une race, un guide, un sang, un empire, un cœur. C’est le tout-fait-un. Qui aurait cru que le Messie prendrait la figure de ces extraordinaires imbéciles que des intellectuels fascinés créditeraient de toutes les vertus et des connaissances en toutes choses ? » (Philippe Sollers, mars 1976)
Parler de fascisme à propos de la France actuelle n’est pas un abus de langage
Slate, Titiou Lecoq — 11 juin 2021
Le sociologue Ugo Palheta dépeint très justement la situation : « Il n’y a pas de régime fasciste en France actuellement, mais il y a des mouvements politiques qui propagent diverses idéologies fascistes. » Il ne faut pas tomber dans le piège de la banalisation.
LIRE L’ARTICLE.
L’historien Pascal Ory analyse les origines et les métamorphoses du populisme, dont se réclame ouvertement Jean-Luc Mélenchon.
Professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne, Pascal Ory est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont "Peuple souverain. De la révolution populaire à la radicalité populiste" (Gallimard, 2018). Dans cet entretien à "l’Obs", il explique pourquoi, selon lui, le "populisme de gauche", dont se réclame Jean-Luc Mélenchon, est "une contradiction dans les termes". LIRE : Le populisme de gauche n’existe pas. pdf
Que se passe-t-il en Italie ?
par Bernard-Henri Lévy, 12 novembre 2018
Maurizio Molinari, directeur de la rédaction de La Stampa.
Zoom : cliquez sur l’image.
Pourquoi l’Italie est-elle devenue le laboratoire du haut mal politique contemporain ? Pour le comprendre il faut lire le livre de Maurizio Molinari, le directeur de « La Stampa ».
Pourquoi l’Italie est-elle devenue, en Europe occidentale, le laboratoire du haut mal politique contemporain ?
Pourquoi ce qu’on appelle populisme, souverainisme, néofascisme s’y trouve-t-il en position de primauté ou, pour mieux dire, en pole position ?
Et ce pays qui a si souvent montré la voie du beau et du meilleur, cette autre patrie des poètes et des penseurs dont on ne sait pas assez que, bien avant les massifs immenses de la pensée française et allemande, elle avait déjà taillé son diamant et permis que les plus grands, les Descartes, les Kant, tant d’autres, revinssent de leur sommeil théologique, ce pays qui, à l’inverse, a eu, avec dix ans d’avance sur l’Allemagne, le sinistre privilège d’inventer Mussolini et le premier fascisme – se pourrait-il que ce pays, donc, soit en train de connaître, à nouveau, son moment ?
Un livre vient de paraître, en Italie, qui répond à cette question.
Il est signé par l’un des éditorialistes les plus écoutés de la scène italienne, directeur du grand journal de Turin, La Stampa, Maurizio Molinari.
Et j’espère qu’il se trouvera un éditeur, en France, pour le traduire.
On y apprendra que l’improbable tandem de la Ligue et du Mouvement 5 étoiles est tout sauf une surprise, et moins encore une aberration, pour un observateur averti de la scène italienne.
On y verra les gueulards, soiffards et autres soudards des deux mouvements se renifler l’un l’autre depuis des années, exactement comme, en France, le font les Insoumis et les lepénistes – et on les verra, d’alliances tactiques en réflexes partagés, de glissements subtils et imperceptibles en partenariats honteux, finir par clamer au grand jour que ce qui les unit compte plus que ce qui les divise.
On y trouvera de fortes pages sur le cancer d’une corruption dont les Italiens se disent las mais dont ils sont si anciennement et intimement pétris qu’elle semble devenue l’un des ciments de leur façon de faire société – et on y voit les 5 étoiles, nés d’un site Web, d’une affectation de « parler vrai » typique des mœurs digitales contemporaines et d’une confusion, non moins caractéristique de nos temps sombres, entre le vomissement de la « sincérité » et l’âpre effort qu’exige la recherche vraie du vrai, s’en faire un cheval de bataille.
L’auteur insiste encore sur le traumatisme d’une mondialisation à laquelle a répondu – histoire italienne oblige – une véritable hémorragie démographique.
Il lie – et c’est plus contestable – l’ampleur du choc migratoire d’aujourd’hui à cette autre spécificité nationale qu’est, comme en Allemagne, mais contrairement à la France ou à l’Angleterre, l’absence de tradition coloniale (souvenons-nous de la pantalonnade mussolinienne à Tripoli) avec ce que cela peut éventuellement impliquer de découverte de l’autre.
Il raconte – et il est, là, à nouveau, très convaincant – cet autre choc qu’ont été les élections successives de trois papes non italiens et la destitution subséquente de cette aînesse de fait que reconnaissait à la nation italienne l’Eglise catholique, apostolique et romaine.
Il met en scène – et c’est une autre des parties originales du livre – le fantasme d’une « identité » qui, dans ce pays ontologiquement morcelé, a moins de sens encore qu’ailleurs : y a-t-il plus identitairement éloigné qu’un Vénitien d’un Milanais ? un Romain d’un Napolitain ? un « guépard » lampedusien d’un Florentin fils de Dante ?
Et puis le ressentiment contre l’Allemagne.
Et puis la haine amourée de la nation sœur française.
Et puis la bureaucratie bruxelloise dont Molinari sait bien que la complexité peut aussi être, comme dans l’Empire austro-hongrois, un gage de civilisation mais que les conjurés de la nouvelle alliance rouge-brune ont constituée en bouc émissaire.
Et puis Poutine, enfin, dépeint en activiste de l’ombre, plus redoutable encore que l’ancien KGB, et devenu, ici comme ailleurs, le suprême agent pathogène du cancer populiste : n’est-il pas attesté qu’il est, par le biais des réseaux sociaux, intervenu dans les élections italiennes au moins autant que dans celles des Etats-Unis ? et n’a-t-il pas trouvé en Matteo Salvini une sorte de semblable, de double raté, de frère faible et fasciné ?
Tantôt Maurizio Molinari semble penser que ces hommes qui règnent aujourd’hui sur l’Italie et proposent au reste de l’Europe une gouvernementalité alternative sont déjà des chevaux de retour, des zombies, l’ombre de leurs maîtres, leur pâle copie : incapables de la moindre production doctrinale, impuissants à formuler quelque proposition économique, politique, culturelle que ce soit, ils remâchent leurs manuels de préfascisme et demeureront, selon toute vraisemblance, d’éternels deuxièmes couteaux.
Tantôt il se rappelle que, de la plus exsangue et la plus délavée des faiblesses, de la plus grande des lassitudes et de la plus poignante des angoisses, il est arrivé à l’histoire européenne de voir naître des contempteurs, des destructeurs, des nihilistes, acharnés à la détruire et, hélas, y parvenant – et, alors, il n’exclut plus que, du laboratoire italien, puisse un jour sortir l’une de ces terribles synthèses que l’on tient pour chimériques jusqu’au moment (mais c’est trop tard !) où il s’avère qu’elles suivent aussi l’une des lignes de pente de l’époque.
Le combat pour l’Europe, en Italie comme ailleurs, va commencer. Le rideau est cramoisi. C’est normal. C’est toujours comme ça, sur le théâtre des choses et des hommes.
L’essentiel est d’être prêt, et de n’avoir pas peur.
La Règle du jeu
Perché è successo qui.
Perché è successo qui.
Viaggio all’origine del populismo italiano che scuote l’Europa
Maurizio Molinari
Editore : La nave di Teseo
Collana : I fari
Anno edizione : 2018
In commercio dal : 25 ottobre 2018
Dans un entretien récent, Sollers déclare :
Je l’ai rappelé dans l’article ci-dessus, cette question du « fascisme » est un leitmotif de la réflexion de Sollers depuis quarante ans (ce qu’il appelle souvent « l’axe Vichy-Moscou »). Dans le numéro hors-série du Monde (juillet-août 2015), Sollers rappelle le rôle précurseur de Roland Barthes.
L’antifascisme de Barthes
Je ferai un éloge politique de Roland Barthes. D’autant plus politique que nous sommes en plein bouleversement de ce pays qu’on a appelé autrefois la France, qui est dans un état de putréfaction avancé, où on voit se dessiner très bien un passé qui ne passe pas et revient sous la forme de ce qu’il faut bien appeler le fascisme. Barthes est à ma connaissance le seul écrivain français qui, très tôt, d’instinct — il faut souligner cet instinct — a compris le phénomène fasciste français. Il ne faut pas espérer comprendre ce qui s’est passé sous différentes formes totalitaires, qu’elles soient communistes ou strictement fascistes, ou qu’elles soient entre les deux de façon grise, si on ne fait pas référence à une politique de Barthes. Une conscience qu’il a très jeune, nous en avons la preuve par le petit groupe qu’il fonde au lycée Louis-le-Grand. Il a 19 ans, nous sommes en 1934, l’année des émeutes fascistes. Il réagit immédiatement en fondant avec quelques camarades de lycée un petit groupe antifasciste. À 19 ans, c’est remarquable. Mais c’est bien avant encore que son corps a compris quelque chose du corps fasciste, qui l’a profondément révulsé. Quand je dis « corps fasciste », il suffit de regarder ce qu’on voit constamment dans l’information, l’extraordinaire vulgarité, le populisme qui se développe à nouveau, sur ce fond qui n’a jamais été vraiment analysé et qui est toujours recouvert par ce qu’on nous dit.
Le corps, aussi, parce que Barthes a dû vivre tôt avec la maladie, la tuberculose, donc dans une certaine distance. Avec, d’autre part une passion pour la littérature et le langage lui-même. Donc pour savoir ce qu’il faut comprendre à la politique de Barthes, il faut aller au-delà des commémorations, même si elles sont légitimes. C’est Gide dans un premier temps et puis le langage. Qu’est-ce que cela veut dire ? Voilà un corps très attentif, qui perçoit que la société ment. Alors on va étudier systématiquement et très rationnellement — Barthes est un protestant des Lumières — la façon dont ladite société se représente. Ce qui donne des livres majeurs comme Le Degré zéro de l’écriture et Mythologies. Le portrait de l’abbé Pierre est un chef-d’œuvre. Le magazine Elle est décrit comme un journal tout à fait intéressant par ses symptômes. Barthes est très minutieux, il a une énorme documentation, c’est de la sociologie de haut niveau, rien à voir avec ce qu’on lit désormais dans des commentaires journalistiques brouillés. C’est aussi une vision du système de la mode. Comment la société habille-t-elle son mensonge dans ce déferlement de mode ? C’est tout à fait précurseur de ce qui sera appelé ensuite la société du spectacle, même si Debord ne fait pas référence à Barthes, a même une méfiance à son égard et ne l’a peut-être pas vraiment lu. Mais Barthes est le premier, politiquement, à envisager la société comme un spectacle. Un spectacle permanent de mensonges traversé évidemment par l’argent, à chaque instant. Ne jamais oublier que Barthes a été brechtien et marxiste, d’une certaine façon. Nous parlions souvent de Marx, on se disait qu’on était les seuls dans ce pays hexagonal, avec Althusser qui de son côté essayait de montrer que personne n’avait jamais lu Marx, surtout pas les communistes — de même que les catholiques ne lisent pas la Bible.
Barthes est donc le précurseur de l’analyse impitoyable du Spectacle, ce qui est extraordinairement politique. Je crois qu’aujourd’hui, il referait des Mythologies. Des portraits, la façon dont les politiques se présentent, la façon dont la télévision fonctionne, en boucle. La façon dont l’information est évacuée... On est dans un autre temps. Le temps où Barthes écrit est encore un temps lourd, un temps où l’on peut montrer du doigt le réalisme socialiste. Ce qui est intéressant dans le cas de Barthes, c’est que sa critique n’est jamais idéologique, nourrie d’un quelconque espoir en vue de l’avenir. Ça c’est le rôle de Sartre, il suffit de relire les Situations. Rien de cela chez Barthes. C’est sa grande singularité. Tout le monde est sommé, à partir de sa jeunesse, d’être d’un côté ou de l’autre, l’URSS ou le fascisme. Cela déchire tout le paysage. Barthes, lui, n’est jamais du côté d’une « ensemblisation sociétale » comme on dit aujourd’hui. De plus en plus, il va être attiré par les singularités, il va écouter comment les gens parlent, comment ils réagissent, souvent sans réfléchir, comment tout le monde est envahi de clichés. Le « clichisme », voilà l’ennemi. Pas de parole nouvelle sur le plan politique, on le voit aujourd’hui, alors qu’il est mort en 1980.
Il a eu cette invention merveilleuse qu’il appelle « le babil », par référence à la tour de Babel. Mais la tour de Babel est un mythe grandiose biblique. Le « babil » est autre chose : Barthes souffrait du bavardage. Il écoutait toujours généreusement, il répondait aux lettres, mais il ne supportait pas « le babil ». Je peux témoigner du fait que quand on dînait avec lui ce n’était pas pour faire du « babil ». Il y a deux individus qui m’ont paru extraordinaires dans les rapports que j’ai eus avec eux, avec qui parler voulait dire quelque chose, c’est Barthes et Lacan. Il y aurait d’ailleurs lieu de faire aussi un Lacan politique. Tout ça a l’air très loin dans le temps. Pas du tout. L’écart se creuse entre eux et les intellectuels qui sont en vue, à la mode, qui ne s’intéressent pas vraiment à la politique. Ils s’intéressent à des idéologies politiques, ce qui n’a rien à voir. La politique, c’est le savoir vivre concret au présent. Avec la distance que l’on doit avoir sur la société, la distanciation. C’est central pour le regard que Barthes porte sur toute chose, et tout individu. Il forge une formule magnifique pour aujourd’hui qui est un temps de violence, d’ignorance, de fanatisme, d’illettrisme exponentiel. Barthes serait ahuri de voir avec quelle rapidité on peut se passer de toute la bibliothèque, du latin, du grec, de Voltaire, tout cela entraînant une formidable mégalomanie des gens qui sont ignorants. C’est ce qu’il appelle « l’arrogance des paumés », une grande misère, mais sûre d’elle-même. À son époque, « l’arrogance des paumés » est là, certes, mais il faut se battre contre des systèmes très lourds, totalitaires. Il faut garder le mot fasciste, sinon c’est un peu confus. Il y a eu un fascisme fasciste, il y a eu un fascisme communiste, désormais on peut parler d’un islamofascisme. Je ne sais pas ce que Barthes en dirait, il ne faut pas faire parler les morts, encore que pour moi Barthes ne soit pas mort, mais très vivant.
Puisqu’on parle de fascisme, on ne peut pas ignorer sa phrase, qui a suscité tant de commentaires, « la langue est fasciste ». C’est une déclaration très étonnante, qui m’a surpris. Forcer à parler serait le fait de la langue elle-même. Ce qui est aussi très politique. On est entré depuis longtemps dans une société de surveillance, ce qui faisait beaucoup réfléchir Barthes. On serait parasité par le fait d’être forcé à parler. Il se situe toujours devant ce rapport de force qui consiste à forcer à avoir des opinions, à forcer à être de tel ou tel côté. Il avait un goût très profond du secret, du retrait. Politiquement on rentre là dans la prise que l’idéologie peut avoir sur toute formulation. Barthes, même s’il me laissait faire avec gentillesse, n’était pas un explorateur des extrêmes. Il y a une phrase de Kafka qui dit les choses d’une façon plus extrême que Barthes ne l’aurait fait : « La vérité ne détruit rien. Elle ne détruit que ce qui est détruit. » Barthes sentait cela très fortement, très sensible comme il l’était à la question de la mort. La mort de sa mère a été un cataclysme, le Journal de deuil est très émouvant. Tout cela redoublé du drame qui aurait eu lieu si sa mère avait appris son homosexualité. C’est ce qu’on peut appeler une certaine limite politique de Barthes. Ce qui ne veut pas dire, bien au contraire, comme on le lui reproche souvent dans la militance gay, qu’il aurait dû être militant. Ce n’est pas la conception que Barthes se faisait de sa propre homosexualité, qui est toujours teintée d’un désir qui reste le plus souvent insatisfait. Mais c’est une question politique et on est en plein dedans avec le mariage pour tous, la procréation assistée, etc. Qu’aurait-il eu à dire là-dessus ? Je ne sais pas mais je sais qu’il se serait certainement beaucoup intéressé à la façon dont la société actuelle se ment à travers ses procédures de renseignements et de diffusion d’informations qui s’effacent.