

C’est sous cette citation que, sur le site « Kairos » (du nom grec du « petit dieu ailé de l’opportunité, qu’il faut attraper quand il passe »), le philosophe « controversé » — comme on parle, médiatiquement, de manière cauteleuse, de tel « professeur controversé » —, Medhi Belaj Kacem revient sur l’étrange période que la France et le monde ont traversée durant ce qu’il est médiatiquement convenu d’appeler la « pandémie » liée au coronavirus. J’en ai suffisamment parlé pour ne pas m’y attarder cette fois [1]. J’ai déjà évoqué, à travers quelques titres, ce que sont, pour moi et quelques autres, les évènements de la rentrée littéraire. Bataille bien connu(e), je n’y reviens pas non plus. MBK présente, lui, sa propre rentrée littéraire qui, précise-t-il, « ne réfère à aucune "actualité" stricte ». N’ayant pas lu tous les livres dont il fait la longue recension [2], je ne reprendrai ici que la lecture qu’il nous propose de deux titres que nous avons eu l’occasion de présenter sur Pileface (les premiers ? Eh oui, je le crains). Il s’agit de L’Histoire splendide de Guillaume Basquin et du numéro 3 de Ligne de risque : Aperçus sur l’Immonde ou la route de la servitude dont, d’ailleurs, Basquin lui-même m’a volontairement proposé de publier sa propre « note de lecture » après que j’ai porté ce numéro à sa connaissance. Médiatiquement reconnus ou pas (c’est aussi une question de stratégie personnelle), ceux dont, par goût, je choisis de lire les livres ont tous un point commun, celui d’en appeler, mutatis mutandis, « à une nouvelle Raison », musicale, pensante, non calculante, ainsi que le voulait Rimbaud en son temps.
Me relisant, j’ajoute avec Ducasse réécrivant Vauvenargues :
« La raison, le sentiment se conseillent, se suppléent. Quiconque ne connaît qu’un des deux, en renonçant à l’autre, se prive de la totalité des secours qui nous ont été accordés pour nous conduire. » Poésies II.
Voici des extraits de l’article de Medhi Belaj Kacem.
1. L’Histoire splendide
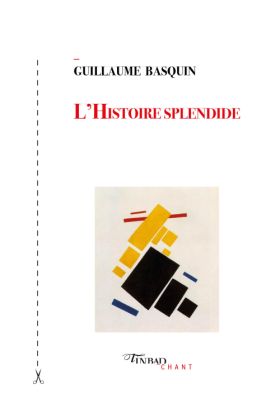 Je commencerai par le livre incontestablement le plus littéraire de tous ceux dont je vais parler. Il s’agit d’un certain Guillaume Basquin, auteur de plusieurs essais (sur le cinéma, sur des écrivains cultes comme Jean-Jacques Schuhl ou Jacques Henric), d’un premier « roman » qui n’a rien d’un roman ((L)ivre de papier), directeur des éditions Tinbad (où le livre est publié, 2022 donc) et d’une revue éponyme (que je n’ai pas encore pu consulter [3]) et spécialiste de Joyce (et de beaucoup d’autres choses, comme on va voir).
Je commencerai par le livre incontestablement le plus littéraire de tous ceux dont je vais parler. Il s’agit d’un certain Guillaume Basquin, auteur de plusieurs essais (sur le cinéma, sur des écrivains cultes comme Jean-Jacques Schuhl ou Jacques Henric), d’un premier « roman » qui n’a rien d’un roman ((L)ivre de papier), directeur des éditions Tinbad (où le livre est publié, 2022 donc) et d’une revue éponyme (que je n’ai pas encore pu consulter [3]) et spécialiste de Joyce (et de beaucoup d’autres choses, comme on va voir).
Le livre s’intitule : L’histoire splendide. De quoi s’agit-il ? Laissons parler le principal intéressé, dans le quatrième de couverture : « L’histoire splendide est (…) le titre d’un projet de livre abandonné par Arthur Rimbaud. » Lequel « passait ses journées à lire et écrire au British Museum », pour faire de ce livre « la véritable Histoire, littéralement et dans tous les sens », la dernière phrase est de Rimbaud lui-même [4]. Basquin, dans ce noble sillage, se propose donc de « raconter de façon la plus polyphonique possible les dessous réels de l’Histoire, sur plus de quarante siècles, jusqu’à l’accident global des communications instantanées que fut la crise du coronavirus, tout en mélangeant les langues de façon babélienne ».
Excité par cet alléchant programme, on ouvre donc le livre. La dédicace qui zèbre la toute première page n’y va pas par quatre chemins, et sonne un peu comme le « Vous qui entrez, laissez toute espérance » qui ouvre La divine comédie de Dante : « Pour mes amis complotistes, pas pour le public. » On continue, et voilà qu’on se trouve face à une distorsion radicale de la syntaxe, des règles typographiques, de la ponctuation courante, etc. : « j’imagine le début d’un livre / au commencement n’était ni le verbe ni l’émotion ni le sexe : au commencement était le foutre ! & le foutre était en l’hom’ ». Nous voilà sur les chapeaux de roues. D’emblée se télescopent des références qui reviendront tout du long de ce livre-monstre : le rythme de Céline, les syncopes verbales de Guyotat. Mais nous rencontrerons bien d’autres références dans ce texte-tourbillon : Dante, Rimbaud, Guyotat et Joyce bien sûr, la Bible, les auteurs grecs et romains, Hegel, Marx, Villon, Shakespeare, Sade, Chateaubriand, Lautréamont, Nietzsche, Kierkegaard, Artaud, Debord, Sollers, Daney, Canetti, Deleuze, Beckett, Schuhl, Boccace, Proust, Orwell, Huxley, Melville, Rabelais, Cervantes, Agamben, Pasolini, Genet, Hölderlin, Foucault, Burroughs, et j’en passe.
Cette avalanche d’auteurs, à quoi Basquin n’hésite pas à se mesurer pour nous montrer qu’il n’a pas le covid des yeux, sont aussi bien abondamment cités tout du long du flot textuel torrentiel qui prend le lecteur à la gorge dès la première page : mais sans jamais les moindres guillemets, et sans la plupart du temps dire de qui est ladite phrase. C’est une sorte de blind test pour lecteur lettré, une sorte de Sollers à l’encre sympathique (Sollers a exaspéré toute une partie du public de son époque en passant son temps à citer les auteurs qu’ils lisaient ; pas moi, tant son goût dans la sélection citationnelle est exquis : c’est un érudit virtuose de la plus rare espèce, comparable seulement à Borgès [5]). On songe surtout à Isidore Ducasse, vrai nom civique du comte de Lautréamont : « Le plagiat est nécessaire. Le progrès l’implique. » Et donc à Debord et aux situationnistes, grands lecteurs de Lautréamont : ce qu’ils appelaient le détournement, c’est-à-dire, en effet, extraire une phrase de son contexte et la placer ailleurs, comme du Marcel Duchamp textuel. Walter Benjamin, un écrivain-philosophe majeur qui reviendra à plus d’une reprise dans cet article, rêvait de faire un livre qui ne serait composé que de citations ; et Thomas Mann parlera de l’existence humaine comme étant une « vie dans la citation », ce qui était bien vu, surtout par les temps qui courent : certains préfèrent citer l’OMS, les gouvernements et les médias mainstream, d’autres préfèrent citer Rimbaud, Artaud ou Debord. Il y a de ça dans L’histoire splendide, mais en mode « transe ». Et donc je ferai la même chose en abyme : cet article sera en grande partie « citationnel » (mais avec des guillemets !). Plus généralement, je citerai énormément de passages des auteurs que je chronique, pour donner envie de les lire.
Le véritable atout fatal de L’histoire splendide, qui le rend irrésistible, c’est son rythme. Enivrant, varié, virtuose, c’est lui qui enveloppe toutes les autres immenses qualités du texte (style, encyclopédisme, lyrisme moderne, implacable lucidité sur l’époque). C’est pourquoi, plus qu’à Lautréamont, plus même qu’à Joyce, c’est au Tristram Shandy de Laurence Sterne (un classique injustement méconnu, dans les pays francophones, de la littérature anglo-saxonne) que L’histoire splendide fait penser le plus. Même allégresse constante du ton, même grâce aérienne de la phrase, même liberté digressive, même burlesque quasi psychédélique.
Le livre est découpé en cinq parties. Au commencement, la première, dont nous avons cité plus haut la phrase d’attaque, est une sorte d’autoprésentation hallucinée de l’auteur, doublée d’une exposition de son projet, résolument tourné, comme une machine de guerre, contre la marchandise franchouillarde vendue sous l’étiquette de « roman » : « se limiter à une seule histoire — une story — quelle surignominie ! » Plus loin dans le livre, Basquin dira que « le roman roman tel que le conçoivent la quasi-totalité de mes confrères — confrères entre guillemets que je ne peux rendre ici sans cette périphrase — est un genre moribond & usé par les redites — sans intérêt pour moi — fi de l’intrigue traditionnelle ! » Non, ce roman pour kiosques à journaux (c’est-à-dire du même niveau que l’indigeste paperasse propagandiste que contiennent ceux-ci), très peu pour Basquin (plus loin il écrira : « il n’y a pas de différence de fond entre un journal & un vomitif : quand on l’a dégueulé / on se sent mieux / & il n’y a pas d’autre traitement possible »). Ces romans faisant tout pour ménager le confort de leur lecteur, au sens ferroviaire de la liberté (« tu es libre d’aller où je te dis d’aller » nous dit en substance le système depuis deux ans et demi, c’est-à-dire depuis toujours), est ce que le tourisme de masse est à l’expédition en Amazonie. Non, car « rien n’est plus effrayant qu’un labyrinthe qui n’a pas de centre — ce livre est exactement ce labyrinthe ». Cette jungle amazonienne littéraire, ce véritable OVNI textuel dans le train-train éditorial courant, nous l’avons donc bel et bien sous la main. Les preuves de suite.
La seconde partie du livre s’intitule, à point nommé, « Mille romans ». Il se taille la part du lion livresque. Il est divisé, en effet, en mille fragments, dont les durées vont de quelques mots à quelques dizaines de phrases scandées, là encore sans ponctuation traditionnelle, et d’une poésie parfois presque insoutenable : « la connaissance a tué le soleil / & l’a transformé en une boule de gaz / semée de taches — la connaissance a tué la lune : ce n’est plus qu’une petite terre morte — criblée de volcans éteints comme par la petite vérole ». Ou encore : « je suis un avaleur non de sabres, mais de sabirs — je compile les mystères Égyptiens / les oracles grecs & Latins / les rites et les prédictions des druides ». Ou encore : « l’incantation est la forme originelle de la poésie — & voilà pourquoi Pierre Guyotat fut l’un des plus grands poètes du dernier demi-siècle : les soldats / casqués / jambes ouvertes / foulent / muscles retenus / les nouveau-nés emmaillotés dans les châles écarlates ». On s’y croirait, surtout par les temps qui courent…
Des pépites comme cela, vous en trouverez par centaines dans cette partie-fleuve, fractale, abyssale. Toute cette partie fait songer à un équivalent, dans l’expérience langagière, à la Descente dans le Maelström de Poe, mon poète de chevet, et que Basquin aurait parfaitement pu « détourner » dans sa symphonie métapoétique : « Le bord du tourbillon était bordé par une large ceinture d’écume lumineuse ; mais pas une parcelle ne glissait dans la gueule du terrible entonnoir, dont l’intérieur, aussi loin que l’oeil pouvait y plonger, n’était faite d’un mur liquide, poli, brillant et d’un noir de jais (…), tournant sur lui-même sous l’influence d’un mouvement étourdissant », et ainsi de suite. C’est exactement à ce genre de sensations vertigineuses que s’expose, mentalement, le lecteur de L’histoire splendide. Et il en redemande.
J’ai à dessein utilisé plus haut le mot de durées : tant la question de la musicalité, on l’aura compris, est essentielle pour comprendre la nature de ce livre. Il y a régulièrement, en miroir, un côté « Traité du style », et ce rythme nouveau qu’on rencontre dans l’écriture de Basquin est expliqué point par point, par exemple les raisons pour lesquelles il malmène la ponctuation : « la ponctuation c’est l’embrayage / l’embrayeur de l’écriture — l’équivalent des griffes du projecteur dans le système du cinématographe — ». Puis : « 243 : pour une nouvelle physique livresque : le livre sera quantique ou ne sera pas ! » Et Basquin tient totalement sa promesse : il est impossible, en un petit article, de ne serait-ce qu’effleurer la richesse poétique, sémantique, épistémologique et cognitive d’un tel livre. L’équivalent, en effet, d’une bombe quantique sur le cerveau. Pour faire la transition avec la troisième partie (et aussi la cinquième), citons le fragment 216 : « zombie vient du créole zombi qui désigne un mort sorti de sa tombe & rendu esclave d’un sorcier vaudou : ce sorcier s’appelle par exemple Bill Gates ». C’est ça, la poésie au sens fort : tout dire, en une seule phrase. Et, ici, l’entièreté d’une époque est résumée en une seule sentence fulgurant comme l’éclair.
Chose promise, chose due, mais il s’agit là de la chose la plus impossible à rendre dans un article : c’est la manière dont Basquin parvient à faire se télescoper des époques puisées dans quarante siècles de périples anthropologiques. Par exemple, fragment 57 : « pendant la crise internationale du covid-19 / rien ne fut plus médusant que l’ensemble du PC chinois masqué — la Gorgogne postmoderne nous apparut bien sous cette forme-là — bien peu furent ceux à lui opposer / comme Persée autrefois / un moderne bouclier magique : fermer tous les robinets tous les tuyaux / absolument infectés / des infos en continu ». Ou encore, encore plus dense et enchevêtré, fragment 639 : « dans Epidémies / vrais dangers & fausses alertes du Pr. Didier Raoult j’apprends ceci : la Grande armée de Napoléon / durant sa retraite de Russie / fut en grande partie décimée par une épidémie de typhus propagée par les poux — environ 30% des soldats furent infectés selon une étude rétrospective par prélèvements dans les dents des cadavres dans un cimetière de Vilnius — Raoult nous remet en mémoire un épisode de Guerre & Paix de Tolstoï où Pierre observe les soldats ennemis jetant leurs poux au feu / qui craque — comme quoi très souvent les épidémies jouent un rôle considérable dans l’Histoire / tuant la plupart du temps bien plus que les armes / de la Guerre du Péloponnèse à la Grande Guerre de 14–18 / en passant par les invasions des Amériques par nos aïeux — & si / dans cette crise du covid-19 / la Chine nous avait vaincus sans tirer une seule balle ? » Ou, en moins dense historiquement, mais encore plus édifiant pour aujourd’hui : « finalement / et après moult réflexions / la réaction mondiale au nouveau coronavirus ressemble par beaucoup d’aspects (CONfinements et masques pour tous) à la campagne dite des quatre nuisibles — rats / mouches / moustiques & moineaux — de 1958 à 1962 en Chine lorsque Mao décida la mise à mort de tous les oiseaux qui volaient dans le ciel de la République populaire de Chine & cela parce que les oiseaux du ciel volaient les grains de blé / de maïs & de riz qui appartenaient aux hommes — verbatim : nos camarades doivent tuer les oiseaux parce qu’ils sont des voleurs et personne ne vole impunément la nourriture des citoyens / je dis bien : pas même les oiseaux du ciel n’ont le droit de voler le pain des hommes & des bêtes qui travaillent / & si les oiseaux n’ont pas compris cela / eh bien on les tue tous / comme on tue les criminels — tout camarade chinois a le droit de tuer l’oiseau qui ose se poser sur le sol de la République populaire pour voler des grains — mais quand il n’y eut plus d’oiseaux en Chine pour manger les vers & les insectes / les criquets dévorèrent les récoltes & la terre de Chine ne produisit plus rien — toutes les récoltes furent compromises & il y eut une grande famine & le pays de Chine devint désolation et ruine : 30 millions de morts de faim — voilà ce qui arrive quand on voit les choses sous un seul angle — le manque de pensée dialectique & les grands bonds en avant engendrent bien souvent des monstres & produisent le Mal qu’on ne voulait pas faire ». Je contesterai simplement le dernier point : il n’est pas du tout sûr que Mao, qui tenait plus du sadique pervers que du psychotique « bien intentionné » à la Hitler ou Staline (car Hitler et Staline voulaient sincèrement le bien de leurs peuples respectifs, et donc « collent » bien davantage à la conclusion de Basquin que le cas de Mao), n’ait pas abattu cette calamité absolue, avec quelques autres (Révolution culturelle, etc.), sur son pays de manière tout à fait délibérée. En tout cas, on ne peut qu’apprécier la pertinence de la comparaison avec ce que nous endurons depuis deux ans et demi, et qui fait penser à la remarque du Pr Perronne : comme quoi, pour chasser une mouche de la chambre, nous avons mis le feu à la maison. C’est pourquoi la célèbre phrase de Mao, ânonnée à plus soif par ses groupies, « une étincelle peut mettre le feu à la plaine », m’a toujours semblé avoir été comprise à parfait contresens, comme un appel à la révolte qui, par quelque effet papillon chanceux, pourrait se transformer en insurrection. Elle m’appert plutôt être, à la rétrospection, comme le syllogisme pervers de l’exterminationnisme les plus convaincu et conscient de lui-même qui soit. Et si vous remplacez « Mao » par « Gates », vous ne pouvez plus avoir le moindre doute sur le caractère intentionné de ces politiques de la dévastation ; mais j’y reviendrai plus loin.
Faisons-nous plèze entre amis, en concluant la chronique de la partie la plus sismique du livre, la plus riche, la plus infinie (c’est un livre que je relirai régulièrement toute ma vie, comme tous les classiques), par cet hommage à la philosophie (mais Basquin peut avoir des mots assez durs à son sujet, cf. le fragment 384, je lui répondrai ailleurs), et une dédicace par procuration : « la philosophie nous enseigne à douter de ce qui nous paraît évident — la propagande / au contraire / nous enseigne à accepter pour évident ce dont il serait raisonnable de douter — Aldous Huxley — toute ressemblance avec la situation actuelle du covid-19 serait bien sûr tout à fait fortuite je dédie cette pensée à Jean-Dominique Michel ».
La troisième partie, donc. Elle s’intitule sobrement Terreur, et entend établir quelles sont les racines du Mal qui nous ronge depuis des décennies, et s’est exposé au grand jour depuis mars 2020. Il s’agit, bien entendu, de la Terreur révolutionnaire, initiée pendant la Révolution française et poursuive jusqu’à Pol Pot ou le Sentier Lumineux, en passant par le fascisme et le nazisme, pour culminer de manière absolue dans le covidisme, le covidiotisme, la covidarchie ou la covidocratie, comme on voudra bien l’appeler. Dès les premières lignes de cette partie (« depuis que le monde est monde & que les hommes s’entretuent jamais un crime ne s’est commis sans que son auteur n’ait trouvé un apaisement & ne se soit dit que c’était pour bien public — pour le bonheur supposé d’autrui — »), j’ai su que je rencontrerai les noms de non seulement Nietzsche, mais Joseph de Maistre, l’essayiste favori de Baudelaire, spécialisé dans la polémique contre la Révolution française, et styliste de tout premier plan (comme tous les auteur(e)s dont je parle ici). Bingo.
En tant que philosophe, j’aime dans l’art (littérature, musique, peinture, cinéma…) la force de me déporter violemment hors de ma zone de confort, pour regarder voir si mes conceptions conceptuelles sont assez robustes pour résister à de telles expériences. Je le dit en passant, car cette troisième partie est incontestablement la plus philosophique du livre.
Les aperçus sont en tout cas fulgurants : « c’est au nom de Jean-Jacques Rousseau qu’on a fini par couper le cou des jeunes prêtres & de jeunes nobles enthousiastes c’est au nom de Karl Marx que la dictature stalinienne a fait couler des torrents de sang ouvrier — & c’est au nom des boomers qu’on a détruit un an de vie de notre jeunesse en 2020–21 ». Soit ! Diagnostic impeccable, et sans appel. Mais il n’est pas à exclure qu’on ait fait dire à Rousseau ou à Marx (comme, par exemple, à Darwin) pas mal de choses qu’ils n’ont jamais dites. On y reviendra en son lieu. Ce qui compte ici, c’est la transition vers le dénouement du livre, la « crise sanitaire » : « il ne semble plus rester que la Terreur pour nous obliger à penser qu’il se passe encore quelque chose & voilà pourquoi le covid-19 a tant occupé les pages des médias : la Terreur sanitaire est le dernier combat entre les hommes ».
On approche donc du dénouement, moyennant un « entracte » (Pourquoi j’écris de si bons livres, « détournement » là encore d’un chapitre de l’Ecce homo de Nietzsche), une quatrième partie qui tient en deux pages : la cinquième partie, intitulée « Journal de CONfinement » (bien vu !), qui commence ainsi : « au début était le virus tout près du Big Bang clap ». S’ensuit un torrent, comme à la fin d’Ulysse de Joyce, de prose dénuée de la moindre ponctuation : un « monologue intérieur » sur le monde délirant et irrationnel du covid-19, et sa parodie grotesque de l’impératif catégorique kantien (« vit, pense et agis, en toute circonstance, de manière à ne pas attraper la grippe »). Même si Basquin y est allé, dans la partie antépénultième, de ses diatribes contre la Révolution française, il y a ici un petit côté « Comité de Salut public sémantique », et la guillotine nominale est pour le moins généreuse. Tout le monde de la collaboration biopolitique davosienne y passe : Macron, Buyzin, Véran, Lacombe, Preciado, Barrau, Salomon, Cohen, Thunberg, Cohn-Bendit, Zizek, Blanquer, Coccia, Bergoglio, Depraz… Les têtes roulent les unes après les autres aux pieds du lecteur, à la grande délectation de celui-ci. Je ne vais pas parler ici de la catharsis, dont je suis un spécialiste, mais enfin, je n’en pense pas moins ; et ici, c’est du très lourd, et du très bon.
On y trouve encore de nombreux vibrants hommages au Jean Moulin de la biopolitique contemporaine, nommément Didier Raoult, la personnalité publique la plus diffamée de tous les temps dans le monde francophone. Rembobinons un peu vers la deuxième partie, qui donnait le ton : « le pr Raoult invité chez Pujadas chez LCI / best of : il n’y a pas de science sans conflit intellectuel — il n’y a pas de progrès scientifique sans polémique (du grec polemos / guerre / puis polemikos / qui concerne la guerre) — le défaitisme (on ne peut rien faire / donc restez chez vous & prenez du Doliprane) / c’est la même chose que Pétain en 1940 face aux Allemands : une lâche capitulation : il n’y a plus rien à faire / on se rend : très peu pour lui — je te salue ici / vieux Raoult ! » (Le clin d’œil ici — j’ai parlé plus haut de blind test à l’encre sympathique — est aux Chants de Maldoror, où toute une séquence scande « Je te salue, vieil Océan ! »).
Revenons à la partie conclusive, qui cite Raoult lui-même : « quand l’informateur multiplie par 20 un risque de mortalité & divise par 100 un autre risque nous ne sommes plus dans une exagération nous sommes dans un autre monde putain Dr Raoult on pense tout pareil vous êtes un génie ». En face, le message est plutôt : « vous allez tous fermer fermer vot’gueule oui ou merdre (…) le rêve absolu comme aucun État totalitaire n’en avait seulement rêvé ».
Le livre se conclut par un Epilogue mordant, où la ponctuation « normale » est pour finir rétablie. On y trouve des propositions concrètes pour rendre à tous les collabos de la « crise covid » la monnaie de leur pièce, et que je laisse à la dilection du lecteur.
Car c’est bien de ça qu’il s’agit : de la première guerre civile mondiale de notre Histoire, comme je le dis à la cantonade depuis un an et demi. Basquin : « c’est comme la guérilla telle que théorisée par T.E. Lawrence dit Lawrence d’Arabie : une rébellion peut être menée par 2% d’éléments actifs & 98% de sympathisants passifs — les quelques rebelles actifs doivent posséder des qualités de vitesse / d’endurance & d’ubiquité / ainsi que l’indépendance technique nécessaire pour détruire ou paralyser les communications ennemies ». Première cible : « l’idiot en chef Bill Gates ». Si vous me trouvez enthousiaste, détrompez-vous : me relisant, je me trouve encore trop tendre avec ce chef‑d’œuvre annoncé, et absolu, de l’histoire de la littérature ; si bien sûr la terre n’a pas été transformée en cratère radioactif d’ici-là, pour que l’Ukraine puisse entrer dans l’OTAN. [...]
2. Notes sur l’annulation en cours
Trois livres fuoriclasse, comme on dit en italien, et, pour finir cette chronique, une revue. Ligne de risque est l’une des meilleures revues littéraires françaises des trente dernières années, et certainement la plus singulière. Elle se plaça, à ses débuts, sous l’invocation de Lautréamont, et sous le parrainage de Philippe Sollers (encore lui, notre Pape bien-aimé de la littérature ! [6]). De plus, elle n’a fait, chose rare, que se bonifier avec le temps (l’antépénultième numéro, Dévoilement du Messie, était de très haute volée). La preuve : le dernier numéro est tout bonnement exceptionnel (Ligne de risque nouvelle série, numéro 3, éditions Sprezzatura, Brest, 2020). Il s’intitule : Aperçus sur l’Immonde ou la route de la servitude. En seulement soixante-douze pages, on a une analyse impeccable des événements récents, et qui fournit une perspective encore différente des trois livres que nous venons de parcourir. L’Éditorial plante le décor : « D’un bout à l’autre de cet astre errant qu’est la terre, un étrange virus, à partir de mars 2020, a soudainement privé d’intérêt tout ce qui n’était pas lui. S’arrogeant un pouvoir absolu sur une bulle d’information sans cesse regonflée à son propre vide, il s’est imposé à nous sur tous les plans, à l’instar d’un souverain dominateur qui mettrait sous son joug les vaincus. On ne parlait que de lui dans les médias ; et jusque dans les conversations privées, il n’y en avait que pour lui. Sous l’égide de gouvernants à la fois pervers et absurdes, nous étions en permanence assaillis par des mots d’ordre angoissants et exposés à des recommandations contradictoires, mordant sans arrêt l’un sur l’autre. Bref, nous avons été travaillés, comme on le dit en sorcellerie. On a porté la main sur nous ; et d’abord sur notre appareil psychique. Nos idées et nos manières de sentir, on les a brassés ; on a modifié en profondeur nos conduites, et de même nos automatismes. »
Le sommaire, en plus de l’Éditorial, comprend : un texte baptisé Notes sur l’annulation en cours (sur lequel je reviens très vite), un autre Au nom de la science, signé Sandrick le Mager, qui analyse de manière très fine le déroulement des événements, et à échelle mondiale. Le troisième texte est une sélection de larges extraits du Rapport d’information n°673 du Sénat, où le programme d’installation du totalitarisme le plus délirant qui ait jamais été est avoué à chaque ligne (« si une « dictature » sauve des vies pendant qu’une « démocratie » pleure ses morts, il y a sans doute d’autres questions à se poser », genre. On appréciera l’usage des guillemets, qui détonnent comme deux lapsus). Vient ensuite un savoureux Florilège de citations de collabintellos du crétinisme covidien, d’Onfray à Badiou en passant par Glucksmann, Einthoven et bien d’autres. Enfin, un court texte de Julien Battisti contre le livre électronique, beaucoup moins hors sujet qu’il n’y paraît à première vue, comme on va très vite le comprendre.
J’ai choisi de me concentrer sur le joyau de ce numéro, Notes sur l’annulation en cours, signé par le principal animateur de la revue, François Meyronnis. Meyronnis est un auteur rare, discret, auteur d’une poignée d’essais, dont un prophétique De l’extermination considérée comme un des beaux-arts en 2007 (Gallimard, « L’infini », 2007), est de quelques romans, dont tout récemment un magnifique Le messie (Exils, 2021), dont je parlerai ailleurs. Le texte s’intitule donc : Notes sur l’annulation en cours, et commence comme suit : « Je le dis depuis longtemps, et mes contemporains se tapotaient la tempe avec l’index, ou du moins refusaient-ils de prendre au sérieux le message. Mon propos était simple, pourtant, et d’une flagrance toujours plus obscène : la fin du monde a eu lieu. Elle a déjà eu lieu. » Meyronnis date de 1914 ce début de la fin du monde, d’un processus d’autoanéantissement qui, malgré les nombreux signes d’alerte rouge surgis depuis, semble ne jamais ralentir, et au contraire aller d’accélération en accélération (de pseudo théoriciens universitaires, « de gauche » comme il se doit, s’étaient crus originaux, il y a quelques années, en se fendant d’un Manifeste accélérationniste pour soutenir que, somme toute, l’accélération technologique toujours plus intense devait être poussée jusqu’au bout, comme on appuie sur la pédale d’une voiture sans volant).
Meyronnis évoque, au sortir de la « der des der », un intellectuel viennois aussi crucial que méconnu du grand public, Karl Kraus, et qui écrit une pièce de théâtre à ce sujet. « Rien que son titre proclamait une vérité terrible, encore valable aujourd’hui — Les derniers jours de l’humanité. Évidemment seule une poignée de séditieux de l’intelligence eurent les oreilles pour saisir la portée d’une telle parole visionnaire ; parmi eux, Ludwig Wittgenstein, Walter Benjamin [tiens tiens, NDMBK] et Elias Canetti », Basquin citant souvent ce dernier dans L’histoire splendide.
Vient à nouveau sur la table la question centrale de toute cette affaire, celle qui hante décidément l’ensemble de mon travail philosophique : celle du Mal. Or, voici ce qu’écrit Meyronnis : « À considérer l’histoire mondiale du siècle précédent, une évidence s’impose — il est arrivé quelque chose au Mal. Cela s’est traduit par une mise hors de ses gonds du néfaste, dont l’étrange lumière nimbe dorénavant notre époque terminale ; une lumière laiteuse et morbide, qui tire sa radiation de ce double foyer : Auschwitz et Hiroshima. »
La phrase de Meyronnis est lente, aristocratique, précise ; elle frappe à chaque fois dans le mille. Et Meyronnis, en commençant son texte par l’évocation des atrocités du vingtième siècle, que nous sommes en passe de surpasser haut la main et de tous les côtés, nous amènent, sous couvert d’une « crise sanitaire » montée de toutes pièces, à rien de moins qu’à un gigantesque camp de concentration numérique. « Qu’on en prenne conscience ou pas, nous voilà devenus les têtes de bétail de la cybernétique. Avec la force de l’éclair, l’instant spectral des réseaux nous expulse du présent, nous privant du passé aussi bien que de l’avenir. (…) En effet, comment serions-nous assez redoutablement vivants pour contrecarrer cet énorme escamotage ? Lequel va de pair avec le raccordement de tous les lieux de la planète ; et avec l’hégémonie de la sans-distance qui s’ensuit, rivant nos corps à une possible annihilation. »
C’est sur cette toile de fond, nous dit Meyronnis, qu’il faut comprendre la soi-disant « pandémie », comme son imprescriptible condition de possibilité. Sans la toile d’araignée cybernétique numérique prenant presque toutes les mouches anthropologiques dans ses fils, pas de « pandémie » du tout (on connaît le fameux slogan des manifestations : « les médias sont le virus »). « Alors que le virus couronné commençait à nous détremper la cervelle, on ne se doutait pas que cet ennemi de l’homme régnerait bientôt du pôle boréal au pôle austral, en passant par tous les méridiens ; ni qu’on allait lui rendre un culte à l’instar d’un dieu païen, tel un vaudou omniprésent et fuligineux. » Benjamin…
Meyronnis bat alors le rappel des mesures : confinement, distanciation, fermeture de presque tout, masques, et, pour couronner le grotesque psychiatrique, « chaque Français [devait] se signer à lui-même une autorisation circonstanciée pour sortir de chez lui, sous peine d’amende ; et pire, en cas de récidive. Le ridicule absolu de cette dernière mesure, son caractère avilissant, ne provoqua aucun soulèvement, pas même un hourvari de protestations : tout juste s’exposa-t-elle aux brocards d’une poignée de récalcitrants (…). Mais loin de tempérer la servilité des conformistes, de tels sarcasmes furent accueillis avec la plus grande dureté par les relais du pouvoir ; comme si les ironistes mettaient en péril, avec leur légèreté, la précieuse santé du troupeau humain. »
Meyronnis voit parfaitement comme, sous couvert d’une inepte « guerre contre le virus », lors même qu’il est « remarquablement peu létal », nous aurons assisté, hébétés, à un glissement tectonique de paradigme civilisationnel. Témoin : l’interdiction, pendant quelques mois, des rites funéraires, l’un des sceaux les plus sacrés, depuis les néandertaliens, de ce qu’est un être humain. « Pourvu qu’on le supposât porteur du virus, le cadavre ne faisait le plus souvent l’objet d’aucunes funérailles : on traitait, ni plus ni moins, la dépouille comme un déchet. » Pour appuyer ce basculement civilisationnel majeur, le « gouvernement s’est (…) mis à mentir chaque jour avec frénésie, épaulé dans cette entreprise par la pègre volubile des médiatistes. On tournait des écrous dans nos têtes, et la fabrique du mensonge marchait à plein régime. »
« Les tourneurs d’écrou commencèrent par expliquer à chaque Terrien qu’il était à découvert, exposé au virus couronné, donc sous le coup d’une menace de mort. »
Évoquant une perspicace expression d’Huxley — le « conditionnement néo-pavlovien » —, Meyronnis entre dans le détail de quelques-unes des techniques de ce conditionnement, comme le nudge : « Ne tombant pas dans les défauts d’une propagande ordinaire, il instille dans nos esprits des liens, dicte des réponses, suscite des idées et des images que nous n’avons pas formées. » Et Meyronnis en vient très vite à la finalité qui était, dès le départ, celle de cette gigantesque mise en scène, et de ce conditionnement : les « vaccins », « confectionnés à la va-vite ». Comme le dit à peu près Reiner Fuellmich : si vous croyez que les « vaccins » ont été créés pour le virus, vous restez dans le brouillard insensé de la narration officielle. Si vous comprenez que c’est le virus qui a été créé pour les « vaccins », tout fait soudain sens, tout devient cohérent.
VOIR
Il s’agit donc bien de l’installation de ce que Meyronnis, empruntant le terme à Agamben (cité plusieurs fois dans le texte), appelle un Dispositif. Après l’instauration du pass sanitaire, le dessein poursuivi se précise, est tout près de s’avouer : « Qu’on s’en réjouisse ou qu’on s’en désole, le sésame électronique s’imposait comme le porche de toute vie sociale. À moins de l’avoir, aucun accès à une existence normalisée. » Les « non-vaccinés » devinrent des parias, la lie de la Cité ; et le « président Macron avait fini par proclamer, avec son aplomb habituel, qu’un esprit éclairé ne pouvait que lui dénier le titre de "citoyen" ». Le tout, avec le docte assentiment de nos « élites » intellectuelles (pour de rien ne dire des médias), jamais avares en sermons frappés au sceau de leur belle âme, de leur appartenance au camp du Bien, et de la veille perpétuelle au « plus jamais ça ». Avalisant par là, et en toute bonne conscience, le régime politique le plus abject à avoir régné en France depuis Vichy. De même, dans les autres pays francophones (salut aux amis belges).
« Prérogative du Dispositif : il se tient de tous les côtés à la fois. Indissociable de l’avènement du numérique, il est toujours fluide, n’occupe aucune position déterminée (…) », mais est la création de « fortes oligarchies globalisées, et celles-ci le servent, tout en se servant elles-mêmes. Ainsi, faute de commandement général, a‑t-il au moins des états-majors, connectés entre eux et efficaces. Dans le professeur Schwab, président du forum de Davos, on reconnaît ordinairement l’un des principaux syndicateurs des oligarchies planétaires. Or cet Allemand de pouvoir a publié, dès 2020, un rapport sur la crise sanitaire avec un comparse français, sous-titré dans la langue du comparse — La Grande Réinitialisation. »
La suite, on la connaît : la « pandémie » hologrammatique représente un tournant, un basculement civilisationnel inouï. « Repartir de zéro, tel est l’ordre du jour. (…) Beaucoup de choses persisteront de notre ancienne vie ; seulement, au loin, selon une "nouvelle obsession de la propreté". Certes, on échangera toujours avec des humains amis, collègues — mais par l’entremise d’un portable ou d’une console. Selon nos guides, et ils ont raison, l’emprise algorithmique s’élargira. (…) On aura peur les uns des autres : on nous repaîtra de cette peur. On portera des bracelets biométriques. On sera toujours plus grégaire, mais on se gardera des rapprochements. (…) Comme l’annonçait Bill Gates, le grand oligarque, on entrera dans l’âge de la "substitution logicielle". »
Après un nouveau récapitulé des séismes du vingtième siècle et au-delà (les deux guerres mondiales, la guerre froide, l’effondrement du mur de Berlin, le démantèlement de l’URSS, le World Trade Center, la crise des subprimes), Meyronnis serre d’encore plus près la vraie nature du coup d’État mondial de mars 2020. « Grâce à Sa Majesté le virus, le Dispositif, implacablement, organisait son espace de jeu à nouveaux frais. Rien d’autre ne compte dans ce qui arrive, tandis que les placiers en quatrième main de l’opinion, nous étouffant dans la layette de nos lâchetés, mettent l’accent sur le seul aspect sanitaire. Or celui-ci n’a qu’une incidence minuscule comparée à ce qui se passe en effet autour de nous, et qui ne cesse de prendre de l’ampleur. »
Meyronnis enchaîne en évoquant une déclaration d’Elon Musk, en même temps que le début de la « crise sanitaire », où l’on apprend que « le langage, selon le milliardaire américain, n’en avait plus que pour cinq à dix ans, au maximum », ce que relaye allégrement notre Laurent Alexandre national, le chantre officiel des dix doses pour tous. Or, tel fut bien le combat de Ligne de risque pendant vingt-cinq ans, qui l’a fait sortir du lot éditorial courant : un combat pour le dévoilement de la vérité par le langage. Combat non seulement esthétique et littéraire, donc ; mais politique et philosophique. Or, pour la seule France, c’est de longue date que le langage est mis à mal, quatre décennies au moins ; que l’installation définitive du Spectacle s’est accompagnée d’une marchandisation de la littérature, et donc d’une paupérisation de la langue, du style, de la sémantique ; dans un pays qui compte historiquement plus d’écrivains et de poètes majeurs qu’aucun autre, et qui avait donc plus à perdre qu’un autre dans cette pénurie linguistique organisée. Le Spectacle n’en a que pour son propre langage binaire, stéréotypé, qui veut encore faire se passer pour de la « démocratie » ; alors que les deux années et demie qui viennent de s’écouler ont démontré que nous n’étions plus libres de rien, sous peine d’anathème : ni de penser, ni de questionner, ni de parler dans une langue qui nous soit propre.
VOIR
Le programme du quatrième Reich transhumaniste s’épelle donc comme suit : « la démultiplication indéfinie de la puissance de calcul des ordinateurs entraîne le besoin impérieux de "fusionner" le cerveau avec les nouvelles architectures numériques. Il s’agit d’ »augmenter nos capacités en truffant neurones et synapses de composants électroniques. (…) D’où la proposition, affolante autant que niaise, de Musk : engloutir, avec le monde, la parole qui le porte. Soyons honnêtes : cela ne gêne que moyennement le petit-bourgeois réticulé. Du langage, il se fait une conception tellement indigente et minable qu’il bronche à peine quand un milliardaire cybernéticien lui annonce sa fin avec le toupet d’un représentant de commerce. » Aussi, si « la parole se résume à l’usage quelle moyenne, pourquoi ne pas se débarrasser de cet outil, si l’implant Neuralink donne de meilleurs résultats ? » Aux yeux d’un transhumaniste — qui fera passer, dans quelques années ou décennies, l’appellation « nazi » presque pour un compliment -, « traverser la parole et être traversé par elle, rien de plus superflu. Avec fougue, il choisit cette autre option : traverser le Dispositif et être traversé par lui. »
Le dessein secret de la fausse « pandémie » se montre alors sous une lumière aveuglante ; et Meyronnis, en abyme, de réaliser un tour de force performatif avec ce texte à la prose d’orfèvre, et à la pensée étincelante de lucidité : à faire advenir, à point nommé, la vérité par la parole. Puisqu’à l’évidence, la « pandémie », planifiée depuis des décennies par les « propriétaires du monde » (Debord), est une attaque sous faux drapeaux, un cheval de Troie communicationnel, qui n’aura visé qu’à aplanir le terrain pour « l’aménagement, étape par étape, de cette biocratie cybernétique prônée par les maîtres de la terre ». C’est un peu « Zorglub à l’OMS ».
« Un autre rapprochement donne à la prétendue « crise sanitaire » l’éclairage qui permet d’en saisir, l’espace d’un instant, les véritables contours : on avait cherché à les estomper sous les dehors d’un problème de santé publique, et voilà qu’ils se manifestent brusquement avec leurs bords déchiquetés, méandreux cependant, plein de coudes et de zigzags. En effet, les contours sont ceux d’un crime parfait (…). Il ne s’agit de rien d’autre que de parachever le remodelage du monde depuis le virtuel d’engouffrer ce qui persiste néanmoins d’attesté et d’observable, mais aussi de vivant ! »
La suite du programme ? Zuckerberg (qui consonne avec « Zorglub ») nous l’annonce un certain 28 octobre 2021 : l’avenir sera Meta ou ne sera pas. Le « Métavers » parachève l’installation de l’humanité dans les paradis artificiels du numérique et du virtuel : pour paraphraser Debord, quand le « Métaverse » aura été branché sur tous les “cerveaux disponibles”, tout ce qui était directement vécu se sera définitivement éloigné dans une représentation. « Le Métavers est un monde parallèle en 3D, auquel nous donne accès un visiocasque. Ce que nous y découvrons ressemble à une expérience immersive, où chaque élément de notre réalité sensorielle se trouve simulé. (…) Un programme informatique élaborera artificiellement ce pseudomonde virtualisé, où des milliards de dindons, farauds de leur duperie, pourront interagir en direct, empaumés à chaque seconde par cette mystification qui les fera vivre dans une réalité ayant pour seule consistance les algorithmes (…). Un détail encore — Meta, le nom de la holding de Zuckerberg, désigne assurément son objet : le Métavers. Mais ce mot, en hébreu, a un sens qui n’est pas anodin si l’on songe à la Terre du Milieu. En effet, il veut dire : la « Morte ». »
Apocalypse signifie étymologiquement : dévoilement, à point à nouveau nommé. Et qu’ont fait les « écrivains, les artistes, les intellectuels » en assistant à cette apocalypse littérale, à ce dévoilement de vérité sans précédent dans toute notre Histoire ? Ils se sont empressés de se couvrir de ridicule et de déshonneur, en avalant cul sec la fable de la « pandémie », et en avalisant les « mesures » en aboyant à qui mieux mieux avec la meute médiatique (ou « médiatiste », comme Meyronnis aime à l’écrire). A minima, ils « détournaient les regards ; ils recevaient des prix, des décorations, pour récompenser leur châtrage ; ils bavardaient, caquetaient, jabotaient, en général à propos de superfluités morfondantes. (…) Tels des autruchons, ils se cachaient la tête, et se la cachent encore ; parce qu’ils n’ont absolument pas les réceptacles pour accueillir l’événement qui marche sur eux, comme sur l’ensemble des êtres parlants, avec une rapidité toujours croissante. » Le foutriquet préoedipien qui nous tient lieu, en France, de président (marié, comme chacun sait, à une tortue ninja zombie), les a pourtant prévenus : “La bête de l’événement est là.”
La solution ? Pour commencer, « ne pas perdre tout aplomb devant des mots fallacieux et empoisonnés, des mots tels que "complotisme" et "conspirationnisme" ; car ils ne servent qu’à en imposer aux têtes de linotte. » Ce qui me fait songer à un autre mot de Debord, dans cet immense livre de dévoilement qu’est Commentaires sur la société du Spectacle (op. cité), paru il y a déjà 34 ans, et pourtant c’est comme si c’était hier : « Le complot est devenu si dense qu’il s’étale quasi au grand jour. » Le « complotiste », c’est celui qui a le malheur d’avoir conservé l’une des choses les plus précieuses de l’existence, son âme d’enfant ; et de pointer, comme l’enfant de la fable, lors même que les adultes ne mouftent pas, que le Roi est nu comme un ver, et le complot contre l’humanité, parfaitement transparent.
André Bercoff m’avait interrogé, dans son émission, sur le fait que, dans mon Colaricocovirus (op.cité), j’écrivisse que « Hitler ou Pol Pot, ce sont des scouts à côté de Klaus Schwab ou Bill Gates. » Je passe donc la main à Meyronnis, c’est télépathique (cette télépathie des styles, qu’aucune Intelligence artificielle n’arrivera jamais à coordonner) : « On s’éloigne des Staline, des Hitler, des Mao ; apparaissent maintenant des monstres comme Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, pour citer les plus redoutables chefs de file de la Silicon Valley. » Meyronnis répond ensuite à l’argument qu’avec ces derniers, les « Zorglub » 1, 2, 3, 4… de la Silicone Valley, nous n’avons quand même pas affaire aux dictateurs fous évoqués plus haut : « On dira peut-être : ils sont beaucoup moins sanglants que leurs devanciers. (…) leur influence s’accompagne rarement d’un déchaînement de brutalité ; tout n’est pas assassinats, tortures et sévices dans leur élévation. » Certes. Mais en un sens, c’est bien pire : Hitler ou Staline (Mao, je l’ai montré, c’est différent) ne dissimulaient pas, ou si peu, où ils voulaient en venir ; ils avançaient à visage découvert, disaient ce qu’ils faisaient et faisaient ce qu’ils disaient, et croyaient réellement bien faire. Avec nos « Zorglub », rien de tel : tout est enveloppé dans une rhétorique de la bienveillance et de l’intérêt public (en particulier, bien entendu, « sanitaire »), et même de la philanthropie. Comme le dit avec mordant un commentateur : dire que Bill Gates est un philanthrope, c’est comme dire que Jack l’Éventreur est un amateur d’anatomie. C’est pourquoi j’avais rétorqué à Bercoff : « C’est pour ça que Colaricocovirus est sous-titré : D’un génocide non conventionnel. À savoir qu’on n’utilise plus des mitrailleuses, des chambres à gaz, ou des machettes comme au Rwanda ; mais des confinements, des masques et des injections. » C’est non seulement beaucoup plus efficace, mais beaucoup plus ravageur : les confinements ont mis à genoux notre économie, plongé des centaines de millions de gens de par le monde dans la misère, traumatisé les enfants et les adolescents des couches les plus pauvres de la population. Les masques, itou : ils ont abêti et martyrisé nos ados et surtout nos gosses, tout en leur fourrant dans le cerveau que, pour la première fois de l’histoire de toutes les Civilisations et de toutes les Cultures sans une seule exception, ce n’étaient plus leurs aînés qui étaient responsables d’eux, mais eux de leurs aînés ; et que s’ils devaient mourir de culpabilité pour ça, eh bien qu’il en fût ainsi. Enfin, les injections expérimentales, faisant de la Terre un Laboratoire à ciel ouvert, ont provoqué une avalanche d’effets indésirables souvent atroces ; l’ampleur des dégâts ne fait donc pas que soutenir la comparaison avec les abominations du vingtième siècle : on s’apercevra qu’elle les aura dépassées, quand les comptes seront à peu près faits. D’où le qualificatif de « génocide non conventionnel », comme on dit « guerre non conventionnelle » : et comme l’ampleur de tout ce qui se sera passé en le minuscule tournemain de deux ans et demi saute aux yeux d’une partie de plus en plus large de la population, rien de mieux que de déclarer une bonne vieille guerre conventionnelle (à l’escalade nucléaire près, encore qu’il y ait le précédent d’Hiroshima), pour étouffer, autant que se faire se pourra, le plus grand scandale humanitaire de tous les temps, par un holocauste encore plus grand. Comme le dit la grande Véra Sharav : « Le "plus jamais ça", c’est maintenant. »
Le mot de la fin, c’est bien le moins, à Meyronnis : « De cette "crise", on retiendra un jour qu’elle fut le moment psychologique de la virtualisation ; et que ce processus ne tend lui-même qu’à une annulation des êtres et des choses, prenant d’ailleurs l’apparence d’une structure en palier. Que serait cette devise, en effet, sinon une injonction à tout enlever, à tout supprimer ; et à le faire graduellement, étape par étape. Avec froideur et méthode. Mais aussi avec une rage décuplée par sa propre violence. »
Résumons-nous : texte magistral. D’une magistralité dont nos caciques universitaires sont devenus, dans leur quasi-totalité, incapables, si l’on excepte Agamben, Esfled, Weber et quelques autres moutons noirs égarés.
Ajoutons pour finir qu’à ceux qui, du fait que je sois lié de près ou de loin à tous les auteurs ici cités, m’accuseraient dès lors de copinage et de renvoi d’ascenseur (Basquin a consacré un article magnifique à mon Colaricocovirus (op.cité), facilement accessible sur la toile), j’opposerai simplement qu’en temps de guerre totale contre les peuples, ce n’est pas simplement un luxe inestimable que d’avoir de tels camarades intellectuels de tranchée : il y va, tout simplement, désormais de survie. C’est pourquoi, à la lumière des événements des deux dernières années et demie, la phrase de Spinoza m’appert avoir été, au futur antérieur, la plus importante de toute l’histoire de la philosophie : « Seuls les hommes libres sont très reconnaissants les uns envers les autres. » Je la dédie à tous les artistes résistants, qui constituent aujourd’hui, comme aurait dit Deleuze, non pas une contraignante « école », mais un mouvement ; et assurément le plus important, de très loin, de ce début du vingt-et-unième siècle. Comme les avant-gardes artistiques dominèrent le début du vingtième siècle, et à peu près pour les mêmes raisons : elles furent une protestation enragée contre la civilisation qui avait accouché de la boucherie de la Première Guerre mondiale. Il y a toute une « culture conspi » qui est en train de se constituer, avec ses films cultes, ses musiques, ses arts, ses jeux (si si, par exemple un jeu hilarant et génial vient de sortir, État d’urgence, créé par Mickaël Dion et Jérémy Ferrari, dont je parlerai bientôt dans Kairos) et, bien sûr, ses grands livres. Bon appétit.
Mehdi Belhaj Kacem, Kairos, 23 septembre 2022.
[1] Mot clé : Coronavirus (covid 19).
[2] Tristan Edelman, Les indomptables (Talma, 2022).
Salim Laïbi, La fin du monde moderne (Fiat Lux, Marseille).
[3] Vous pouvez le faire sur Pileface. Cf. Les Cahiers de Tinbad n°12 et le nouveau théâtre des opérations. A.G.
[4] Sur l’Histoire splendide dont Rimbaud révélait le projet dans une lettre inédite à Jules Andrieu, cf. Surprise : la lettre inconnue de Rimbaud dans Désir. A.G.
[5] Je souligne : l’éloge est devenu si rare ! A.G.
[6] Idem.




 Version imprimable
Version imprimable

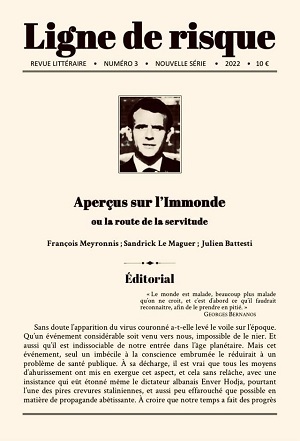
 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?


