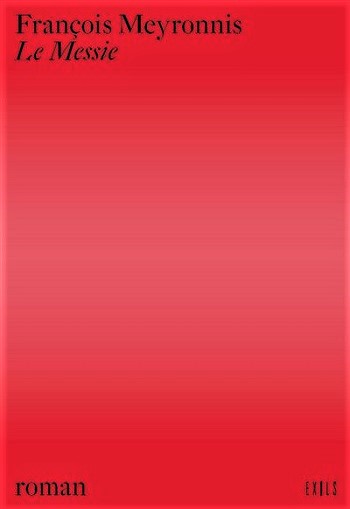 Le Messie de François Meyronnis est arrivé. L’annonciation avait eu lieu il y a déjà sept ans dans le n° 126 de la revue L’Infini de mars 2014. Son dévoilement avait pris la forme d’un détour inattendu dans le n° 2 de la nouvelle série de Ligne de risque [1]. Sous une couverture rouge Rothko ou Rodtchenko, le roman — car c’est un roman — de l’exigeant François Meyronnis est donc publié aux éditions Exils. De L’infini à l’exil. Nul n’est prophète en son pays. La presse en parlera-t-elle avec la même discrétion que celle qui a accueilli, il y a deux ans, la publication de Tout est accompli, l’essai qu’a signé Meyronnis avec ses amis Yannick Haenel et Valentin Retz [2] ? C’est probable, mais le pire n’est jamais sûr et l’avenir est aussi imprévisible que l’évolution d’une épidémie. En tout cas, quelles que soient les réserves qu’on ait par rapport à certaines de leurs thèses (la critique unilatérale des Lumières ou de la Révolution française, par exemple [3]), il serait vain de faire comme si ces livres, érudits et très bien écrits, à l’extrême pointe d’une certaine — et souvent refoulée — pensée occidentale (dans sa source juive), n’existaient pas et n’invitaient à penser à nouveau, fût-ce contre soi-même et l’esprit du temps [4].
Le Messie de François Meyronnis est arrivé. L’annonciation avait eu lieu il y a déjà sept ans dans le n° 126 de la revue L’Infini de mars 2014. Son dévoilement avait pris la forme d’un détour inattendu dans le n° 2 de la nouvelle série de Ligne de risque [1]. Sous une couverture rouge Rothko ou Rodtchenko, le roman — car c’est un roman — de l’exigeant François Meyronnis est donc publié aux éditions Exils. De L’infini à l’exil. Nul n’est prophète en son pays. La presse en parlera-t-elle avec la même discrétion que celle qui a accueilli, il y a deux ans, la publication de Tout est accompli, l’essai qu’a signé Meyronnis avec ses amis Yannick Haenel et Valentin Retz [2] ? C’est probable, mais le pire n’est jamais sûr et l’avenir est aussi imprévisible que l’évolution d’une épidémie. En tout cas, quelles que soient les réserves qu’on ait par rapport à certaines de leurs thèses (la critique unilatérale des Lumières ou de la Révolution française, par exemple [3]), il serait vain de faire comme si ces livres, érudits et très bien écrits, à l’extrême pointe d’une certaine — et souvent refoulée — pensée occidentale (dans sa source juive), n’existaient pas et n’invitaient à penser à nouveau, fût-ce contre soi-même et l’esprit du temps [4].
« Dans son nouveau roman, François Meyronnis se livre à un jeu dangereux : mettre en scène la Parole elle-même et tenter grâce à elle de sauver le monde en perdition. Il s’appuie pour cela sur plusieurs sages, un peintre de la fin du siècle dernier qui ne peignait plus, un rabbi ayant vécu au début du XIXe siècle, des femmes aussi. "Alors l’immense ouverture engloutissant le pire et le meilleur, il avait décidé de se mesurer à elle : de ne faire, toute sa vie, que cela." Ainsi commence ce roman qui vise au plus haut de l’aventure humaine. »
Je mets en ligne cet article le 28 mars 2021, dimanche des Rameaux. Ce jour-là, nous dit l’évangile de Jean (vous verrez que ce n’est pas sans rapport avec la fin du Messie) :
La foule nombreuse venue pour la fête apprit que Jésus venait à Jérusalem ; ils prirent les rameaux des palmiers et sortirent à sa rencontre et ils criaient : Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
C’est le dimanche des Rameaux qu’avait aussi choisi Philippe Sollers pour lire à haute voix La seconde vie de Shakespeare — Paradis, en 1979.
Meyronnis dit de son livre Le Messie qu’il « est l’équivalent d’une messe catholique ». Le 13 avril 1742, était donnée la première représentation du Messie de Haendel qu’on a pu appeler Le Christ des Lumières. Alleluia.



Entretiens avec François Meyronnis
Avant de lire la suite, il serait bon :
1. de relire l’entretien donné par François Meyronnis à Josyane Savigneau, en janvier 2020, quelques mois après la publication de Tout est accompli : un regard incisif sur trois siècles d’histoire.
2. d’écouter Radio Courtoisie (une fois n’est pas coutume). C’est sur cette radio que l’abbé Guillaume de Tanoüarn recevait longuement François Meyronnis le jeudi 25 mars — comme par hasard le jour du Dandeti’ — pour son roman Le Messie.
Sortir du nihilisme par le libre usage de la parole. Rabbi Nahman de Braslav

Even Frei et Vladimir Slepian (« le juif de Dionysos »)

Les personnages négatifs (Staline/Hitler/Haman/Amalek)

Le Dispositif, les transhumanistes américains.
« Trasumanar per verba » (Dante). Ava et Carlo. Les deux maisons d’Israël



La poursuite du Messie
François Meyronnis présente son livre : Le Messie (éditions Exils, 2021). Un film de Johanna Pauline Maier (14 mai 2021). Nouveau montage le 28 mai.



L’un des personnages principaux du roman s’appelle Even Frei. « Frei ». Où on entend immédiatement, ce n’est pas difficile, le mot allemand qui signifie : libre. « Even » (ou encore Eben, Aben) désigne en hébreu la pierre, nous rappelle Meyronnis. Even Frei : le libre même. La liberté, la gratuité, même. Le premier roman de Meyronnis, paru en 2000, avait pour titre Ma tête en liberté.

- Vladimir Slepian
Le personnage d’Even Frei est inspiré de la vie de l’artiste d’origine juive, Vladimir Slepian, fils d’un fonctionnaire soviétique exécuté par Staline. Né à Prague en 1930, il a vécu en URSS, à Leningrad, puis à Moscou, avant d’émigrer en France en 1958. Artiste-peintre, il inventa une sorte de « peinture transfinie », arrêta de peindre en 1963, puis se consacra à l’écriture. Son seul texte français connu est une nouvelle Fils de chien (extraits)
 , le monologue d’un homme qui décide de devenir un chien, publié dans la Revue Minuit n° 7, en 1974 [5], qu’il n’est pas inutile de relire et que, semble-t-il, seuls Gilles Deleuze et Félix Guattari, les auteurs de L’anti-Oedipe (1972), ont pris au sérieux dans Mille plateaux (1980). Plus tard, Vladimir Slepian a pris le nom d’Eric Pid. C’est un anagramme d’Oedipe, allusion à la cécité dont, expliquait-il, l’étymologie de son nom de famille russe témoigne. Étrange.
, le monologue d’un homme qui décide de devenir un chien, publié dans la Revue Minuit n° 7, en 1974 [5], qu’il n’est pas inutile de relire et que, semble-t-il, seuls Gilles Deleuze et Félix Guattari, les auteurs de L’anti-Oedipe (1972), ont pris au sérieux dans Mille plateaux (1980). Plus tard, Vladimir Slepian a pris le nom d’Eric Pid. C’est un anagramme d’Oedipe, allusion à la cécité dont, expliquait-il, l’étymologie de son nom de famille russe témoigne. Étrange.
Le 7 juillet 1998, alors que la France s’apprête à jouer sa demi-finale contre la Croatie et, peut-être, à célébrer dans la liesse la victoire de son équipe à la coupe du monde de football contre un Brésil déjà qualifié, Slepian s’effondre sur un trottoir de Saint-Germain des Prés, près du café Les Deux Magots. La cause de sa mort est attribuée à la faim. Il est enterré comme « sans-abri », aux frais des pouvoirs publics. On pouvait lire dans Fils de chien :
Pardon, je vois que je vous embête. Bon. Moi, je veux croire que je suis un homme. Je veux, je veux, mais est-ce que je veux vraiment. Oui, je suppose que je veux. Merde, ça mène à rien !
J’ai faim.
Si vous arrivez à trouver la solution, vous me direz, n’est-ce pas ?
La « solution », Meyronnis l’esquisse en imaginant que son « héros », Even Frei, serait en quelque sorte le juif de Dionysos. Question : « Que signifie cela — être un juif de Dionysos ? »

EXTRAITS
Voici le début du roman.
Paru dans le n° 126 de L’Infini (printemps 2014)

I

Les éclairs qui foudroyèrent ses parents, comment ne pas admettre qu’ils avaient aussi consacré le destin d’Even Frei ? Tout avait commencé, en ce qui le concerne, par une catastrophe : son père, un diplomate soviétique, liquidé par Staline en 1935, une balle dans la nuque, une autre dans la tempe ; sa mère, disparue dans le camp de concentration de Temnikovski, en Russie centrale, où l’on enfermait les épouses des dirigeants déchus. Ainsi avait-il compris qu’à partir d’un certain point du temps, avant même sa naissance en 1930, le monde s’était fait sauter, et que depuis il ne cessait de s’écrouler sur lui-même, n ’étant plus que cet écroulement perpétuel, sans espoir d’un terme quelconque à la chute.
Alors l’immense ouverture engloutissant le pire et le meilleur, il avait décidé de se mesurer à elle : de ne faire, toute sa vie, que cela.
Ce qui signifie — devenir artiste, et d’une telle façon qu’il ne pouvait plus demeurer dans son pays, où il n’y avait aucune place pour lui, à moins de se résigner à un dépérissement immédiat : il se retrouva donc, jeune encore, à Paris. On devait être, à peu près, en 1958.
Aujourd’hui on était quarante ans plus tard, le 7 juillet 1998, un mardi. La France trémulait depuis des semaines sous l’effet du délire sportif : un climat hystérique artificiel submergeait le pays tout entier dans l’attente de la dernière épreuve de la coupe du monde de football, annoncée pour le dimanche suivant. Mais Even Frei ne laissait que rarement tomber ses yeux sur les journaux, dont la radicale ineptie ne fournissait même plus à son divertissement ; n’écoutait que très peu la radio ; ne regardait jamais la télévision. En cette période, il relisait sans arrêt un des livres les plus étranges — aussi intempestif que lui-même —, et qui débute ainsi — Les gémissements poétiques de ce siècle ne sont que des sophismes.
Idée folle : il se demandait s’il n’était pas le premier lecteur des Poésies d’Isidore
Ducasse. Le premier qui serait prédestiné à renverser les sophismes de tous les siècles et à redresser la poésie — Comme vous êtes arrogant, M. Frei, et présomptueux, se dit-il. — Il souriait, narquois à ses dépens, quand il sentit de nouveau le piranha invisible qui lui grignotait l’estomac.
Rien mangé. Ce matin non plus il n’avait rien mangé. Trois jours maintenant qu’il ne mangeait plus. Pas une miette. En se dirigeant à pied vers la place Denfert Rochereau, il passait en revue dans son esprit ce qu’il avait avalé la semaine dernière et la semaine d’avant, et la liste l’étonna par sa brièveté. Une vie d’ascèse que la sienne, mais cette fois il forçait sur la restriction. Resserrement, le mot d’ordre grondait toujours plus fort. Grondait dans son ventre affamé... Nourrie d’elle même, sa privation enflait comme une rivière. Il se disait : « Je dépasse les bornes », et un sillon d’inquiétude lui traversait la tête. L’œuf dur du samedi, il s’en souvenait, acheté dans une boulangerie avec un sablé au beurre ; mais aussi des trois abricots du vendredi, dévorés le matin en face de la sculpture du lion, sur la place, après les goyaves et les caroubes des jours précédents ; car il avait coutume, vers les neuf heures, d’acheter des fruits rue Daguerre, et de les manger sur l’esplanade, debout, en fixant du regard le lion. Faire ainsi l’usage de ses muscles masticateurs l’aidait à accueillir les premières pensées notables de la journée, sachant que des heures qui suivraient, il ne ferait ensuite que cet emploi, accueillir des pensées, ce qu’il appelait lui-même — regarder le temps.
Mais, arrivé sur la place, ce matin-là, il n’avait pu s’acheter aucun fruit : à l’étalage de son détaillant habituel, il avait guigné avec convoitise les barquettes de fraises et de framboises ; lorgné les cerises, les prunes, les pêches blanches ; puis s’était même approché des melons, pour les sentir. A un moment, un homme aux joues dissemblables, l’une plate et jaunâtre, l’autre gonflée, tirant sur le violet, était sorti de la boutique, et l’avait scruté, la mine sévère, comme s’il eût craint un chapardage. Première fois qu’Even Frei voyait ce mufle. Nullement démonté, il le dévisagea à son tour, et des deux côtés ce fut électrique : mais sans un mot. Il s’était éloigné, pour finir, le goujat rentrant dans son échoppe avec un haussement d’épaules.
Maintenant il subissait, devant le lion, l’afflux incessant de la faim, comme une voix qui parlerait en lui à bâtons rompus —, et creuserait un vide dans sa tête. Il sentait une force mauvaise lui pincer les nerfs, agrippant chaque faisceau, émiettant les fibres, et soufflant des bourrasques à travers tout son corps. On le pliait, on le réduisait en chiffon, et la force commençait à exister en lui de manière autonome. Avec des décharges vibrantes, elle infusait des turbulences dans son sang, et rendait comme saoul celui dont elle s’emparait. Un trop-plein d’énergie, cette ivresse.
Bondissant en lui, le lion filait à travers ses artères et ses veines, revenait vers son cœur en tournoyant, éclaboussé par la lumière. Il rugissait au fond de ses vaisseaux, et c’est la faim qui criait, lâchant les rênes au vacarme.
Pas une portion du corps de Even Frei qui ne fût semée de lions rugissants. Conviction soudain que tout ce qu’il éprouvait, sentait ou pensait, à chaque batte ment cardiaque, contenait un dieu ; et qu’à force de rejeter l’ivraie, c’est-à-dire de ne pas manger, il avait fait descendre sur lui le sacré. Son estomac, le plus petit du monde, d’après ce qu’il disait, abritait une combustion perpétuelle, celle qu’allumait le violent désir des aliments. Et l’ardeur de cet incendie donnait à son minuscule viscère digestif le rôle d’un autel du feu.
Finie, toute soumission au règne utilitaire.
Du profane, que reste-t-il quand quelqu’un — une seule personne — intériorise le feu ? On pourrait s’esclaffer, n’est-ce pas ? Cette question, du moins, faisait rire Even Frei ; car il prenait conscience de l’intensité d’énergie que libère la faim, et de la possibilité pour lui de s’absorber dans cette énergie. Passé comme avenir volaient en éclats, autant que haut et bas ; quant aux échelles de proportion, elles vacillaient tellement qu’il lui semblait tout à coup que son incroyable ventre accueillît, pour tant si menu, l’univers entier.
Dionysos vaincra — cette phrase, il se la répétait sans cesse ; elle scintillait dans une houle, tiraillant son mental comme une formule sorcière — Vaincra, vaincra, vaincra... La faim, le dieu et lui ne faisaient plus qu’un — grâce à la faim. On aurait dit que le nom du dieu qui endure la détresse et la mort poussait de tous les côtés dans sa tête, et cherchait fortune le long de sa colonne vertébrale.
Mais une divinité à qui on ne sacrifie plus, à laquelle on n’adresse plus de prière, un homme peut-il encore l’invoquer en plein Paris, à la veille d’une coupe du monde de football ?
Pour être franc, cela ne semble pas trop vraisemblable.
Imaginons un Russe, dont une partie de la famille a été détruite par Staline et l’autre par Hitler, un juif de Russie, dont les ancêtres venaient d’Ouman en Ukraine, comment un tel être se rattacherait-il à Dionysos ? — Par quel miracle appellerait-il ce dieu, de préférence aux autres, à commencer par le sien ? — Et en français, de surcroît : dans une langue que ses ancêtres ignoraient, éloignés d’elle par l’espace ; et que le plus étrange des dieux grecs ignorait aussi, éloigné d’elle par le temps...
Que signifie cela — être un juif de Dionysos ?
De quelle manière un phénomène si improbable, a-t-il pu exister à Paris, entre deux dates précises, séparées par un nombre d’années égal à celui que compte de lettres l’alphabet hébraïque ?
Vingt-deux ans, en effet, que Even Frei tenait à Dionysos — qu’il le cherchait dans chaque geste.
À l’improviste et au détour d’une rue, le dieu l’avait pris. Du brasier de la foudre, il avait fait jaillir la flamme. Comme pour Nietzsche, au siècle précédent. Après un Allemand, un juif. Mais pourquoi ?
Pour quel lever de rideau ?
À cette époque Even Frei attendait qu’une décision terrible lui rendît sa vie et son bonheur — le coup heureux qu’il se sentait être, en dépit d’une histoire pleine de crimes et de confusion. En ce temps-là, il relisait Nietzsche presque chaque jour. Possible que sa communauté avec le philosophe de Dionysos ait contribué à ce qui arriva ensuite — ou du moins, lui ait pavé la voie.
Mais plus importante, une certaine défaillance chez Even Frei, intime, foncière.
Dès la Russie, son parcours est fait de poursuites et de métamorphoses. Alors que le régime des bourreaux le considérait comme un fils d’ennemis du peuple, il ne relevait à ses propres yeux d’aucun ensemble. Sournoise affinité, en revanche, avec une petite fêlure, oh, une très légère, et qui craque à peine, mais assez pour imposer un écart.
Cet écart, voilà le point vulnérable — le défaut de la cuirasse. Sans lui, son existence n’aurait pas connu le grand chavirement. N’aurait pas été transplantée dans les gouffres en 1976, un jour ensoleillé de mars, à midi, place Fürstenberg.
Frappé, oui. Dionysos l’avait frappé. Le taureau aux mille têtes, celui qui rendit fou Nietzsche à Torino, avait une nouvelle fois atteint la cible.
Peut-être les dieux se sont-ils éclipsés depuis si longtemps que l’éclipse elle même s’abroge. Peut-être... En tout cas, c’est une tempête qui déferla.
Lorsqu’il fut happé, Even Frei semblait en pleine réussite, comme on dit. Son étoile commençait à luire, et il ne dédaignait aucun effort pour qu’elle grandît. On brodait déjà sa légende. D’un seul coup, une vague ; qui emporte le roseau.
Une vague. Ou, disons, une rencontre.
En voyant l’homme, il avait ressenti que quelque chose balayait son être. Pas une peur, non. Plutôt l’évidence d’un danger. Le type était assis sur le rebord du trottoir, juste en dessous d’un grand magnolia qui envoyait deux bras vers le ciel, dessinant un ample Y au milieu de la place. Cela faisait un mois qu’il rôdaillait dans le quartier, et depuis, sans qu’il s’en rendît vraiment compte, Even Frei l’évitait, comme s’il avait flairé à quoi graviter dans son orbite, même une seconde, l’eût exposé.
Un ami peintre lui avait appris que cet homme, un Grec, probablement, répondait au nom de Ghika, et qu’un grand ouragan avait sévi en lui, renversant tout pêle-mêle. De là un coup de pistolet qui arrache la mâchoire et un bandage de momie égyptienne. Toujours seul, on le croisait souvent du côté de la place Saint Germain-des-Prés. Quand on le frôlait, il enflait la voix — je suis une comète, prévenait-il. Ou il annonçait que le monde revêtirait bientôt la livrée des catastrophes : lessivés, d’après lui, les humanoïdes ; finissant en bulles ; avant de partir avec la mousse, nappés à l’écume. Chose prévisible : les piétons s’éloignaient de lui, comme d’un lépreux ; même ceux qui l’avaient fréquenté passaient leur chemin.
A peine l’avait-il vu, Even Frei s’était douté qu’un événement considérable aurait lieu ; — en fait, qu’il s’amorçait déjà : et qu’une loi nouvelle se gravait en lui à la pointe d’acier, une autre loi, pas celle qui régit les êtres normaux. Frontal, l’homme l’examinait, un œil éteint, presque décoloré, l’autre d’autant plus en veille, comme si la mort elle-même se ranimait. Dans une sorte d’idiome, guttural et sifflant, voilà que le type se met à parler à une poupée de chiffon qu’il serre entre ses doigts et dont la figure est un masque aux fibres ligneuses, peinturluré de rouge, traversé en diagonale par une bande blanche. Il tient la poupée de telle manière qu’elle fixe, elle aussi, celui qui déboule, la face bandée de Ghika et le masque écarlate formant un ensemble, qui cisaille les nerfs du nouvel arrivant.
Lentement, le Grec bouge — se tourne vers la figurine, puis marmonne ; il lui bredouille à l’oreille en faisant clapper les mots, et en se raclant la gorge. À croire qu’il présentait Even Frei à la poupée de chiffon, et qu’il énonçait son nom dans une langue magique, pour l’offrir à un être invisible. Quel être ? Hein ? Quel être ? Un dieu ? Un démon ? En s’interrogeant, Even Frei observe Ghika, le bandage de Ghika... Sa blancheur, ce qui le captive d’abord... Elle enveloppe le menton et la bouche du Grec, jusqu’au nez. Puis le fascine le contraste de cette blancheur immaculée avec la saleté du costume, poissé de crasse aux manches, sans parler des taches de graisse et de boue. La discordance aggravait l’impression générale de déséquilibre...
Mais le Grec venait de se dresser, appuyé contre l’arbre, et levait vers son vis-à-vis le bras arborant la poupée. « C’est toi qu’elle attendait », dit-il.
Et il s’était mis à rire, avec un bruit aigre, strident. De taille haute, efflanqué, ses épaules étaient larges ; mais creuse, sa poitrine ; il portait un costume gris, avec une veste croisée, et sous elle un pull marron clair ; enfin, des bottines, dont certaines parties tenaient avec des ficelles.
Elle savait, disait-il. La poupée... Elle savait qui était le Russe. Il l’appelait ainsi
— le Russe. Il disait que quelqu’un comme lui ne pouvait pas être seul dans sa propre peau, et que cette absence de solitude venait à son tour d’une solitude... Celle de qui est étranger dans le pays. « Me comprends-tu ? demanda-t-il. Moi-même, pour comprendre, il m’a fallu... être mort. »
En proférant cette dernière phrase, il avait pincé légèrement l’avant-bras de son interlocuteur, puis tiré de sa poche un gros canif. La lumière éclaboussa l’acier. De toutes les lames repliées sous le manche, la plus longue, la plus effilée était sortie, telle une petite épée de feu.
Et puis Ghika, comme on accorde une faveur, avait murmuré : — « Toi aussi, je te ferai passer du côté où je me tiens. »
Coup sec de sa lame, de haut en bas. Crevé, le ventre de la poupée. De ses entrailles jaillissait de la charpie, avec des amas de fils, véritable hémorragie de bourre et de chiffon. Even Frei entendit bourdonner le sang à ses oreilles, comme si cette incision avait ouvert son cœur à lui. Elles cédaient, les chaînes. Et les murs s’écroulaient. Un instant-choc le précipitait dans une dimension absolument nouvelle — modifiait de fond en comble son rapport avec la réalité. Un élément qu’il n’avait jamais perçu arrivait soudain au premier plan, depuis un autre bord...
Cette expérience, comme les mots la rendent mal ! Even Frei, par la suite, voulut la retracer ; il échoua. Comment décrire, s’excusait-il, ce qui fait sauter les cadres ? Ce jour ensoleillé de mars la coquille qui l’enfermait avait explosé ; confronté brutalement à sa liberté, il avait eu, disait-il, envie de rire — de rire jusqu’à tomber par terre.
En un instant, assurance qu’un dieu le foudroyait. Plus tard, il l’avait nommé : Dionysos, c’était lui — le dieu aux cornes de taureau, couronné de serpents — celui qu’on ne peut lier.
Ce que j’avais saisi en un éclair, ajoutait-il, se résume ainsi : identité du plus ter rible et du plus rassurant.
Cela dégringole sur toi, et tout est résolu.
Il avait suffi que la lame de Ghika éventrât la poupée, et aucun obstacle ne lui barrait plus la route — qu’importe, même, l’assentiment des autres.
Even Frei renonça donc à séduire un public. Il prit en aversion les critiques, les galeristes, les commissaires d’exposition, qu’il assimila à un troupeau malfaisant de faussaires. Il refusa d’être pétri par eux ; mais le plus souvent il employait l’expression : triturer. Avec eux, on devient très vite de la poudre, disait-il, quand ils nous broient ; ou de la pâte, quand ils nous mastiquent . Sauf à quelques amis, il ne montra plus aucune œuvre.
Il était passé au delà du doute.
Mais au delà du doute, il y a la faim. Et qui approche de ce grand feu a le visage brûlé.
Face au lion de Belfort, le 7 juillet 1998, Even Frei avait la tête en flammes. On aurait dit qu’une enclume pesait sur sa poitrine, et qu’un forgeron dément lui brisait les bras à coups de marteau, ne cessant de fracturer, de rompre. A force d’être libre, son cœur battait la breloque ; affolé par pointes, par saccades. Avec des poussées de vertige, quelques décharges lui remontaient des genoux vers le haut du crâne, suivies par des ondes ; douloureuses, ou insinuantes . Ainsi s’accordait-il à la vibration du cœur de Dionysos . Et cela à chaque fois qu’il respirait, parce qu’entre l’air qui vient et celui qui sort, il insérait la faim — pile à la jonction des souffles... Par la faim le monde vibrait autour de lui, tandis que le dieu dansait sur son pied bovin, et plus il dansait, mieux le tremblement remontait des genoux vers le sinciput, avec une ivresse toujours croissante, et le cœur, lui, cafouillant de plus belle.
Vraiment, il souhaitait que ça tremble moins... Marcher un peu, juste quelques pas. Tourner le dos au lion... Voici Even Frei entre les deux pavillons d’octroi de l’ancienne barrière d’Enfer, dont l’un sert d’entrée aux Catacombes, où l’on a engouffré les restes de millions de défunts, issus de plusieurs cimetières de Paris. Des gens — en couple, en famille — font la queue pour descendre les marches qui mènent à l’ossuaire.
Lui, il pense à une phrase d’Héraclite — Dionysos et Hadès, même chose, et au fait que le premier était, autant que le second, maître des esprits et des morts. Tout à coup il se rappelle ceux du 2 septembre 1792, massacrés par les révolutionnaires aux alentours de la place Fürstenberg... Eh bien, on les avait enterrés ici, avec d’autres de la même période. Entièrement à son délire, Ghika prétendait les voir... Peut-être disait-il vrai, après tout... Peut-être les voyait-il... Aussitôt la figure du Grec reparut à son esprit, sa façon de vous toiser, la tête un peu de côté, avec les narines palpitantes ; sa façon aussi de déformer les syllabes, comme si une nouvelle raison était en train d’éclore entre chacune d’elles . . .
Toujours parmi nous, les morts — affirmait Ghika. Les rues en surabondent, disait-il. Un véritable encombrement. Chacun vaque à ses affaires, obnubilé par ses courses et ses rendez-vous, et les rangées invisibles, personne ne les remarque.... Drainant ceux qui, justement, n’ont plus de course ni de rendez-vous... À part lui, qui les apercevait ? Cependant il ne se targuait d’aucun mérite : je porte des vêtements, disait-il, et vous apparais en chair et en os ; mais je me suis déjà envolé vers le vide . . . Il prétendait que son suicide, contre toute apparence, avait réussi : ne laissant qu’une doublure (qui d’ailleurs s’effacerait très vite). On pouvait lui serrer la main, cela ne l’empêchait pas de se compter au nombre des fantômes... Je suis déjà de leur côté, disait-il. Et ce que je vois en recèle la marque.
Que voyait-il ?
En grappe, le long des murs, place Fürstenberg : les morts du 2 septembre 1792, et des jours qui ont suivi. Cela est arrivé tout près, expliquait-il. Les affaires sérieuses ont commencé sur le parvis de l’église Saint-Germain-des Prés, quand une foule de bonnets rouges a attaqué un convoi de détenus venant de l’île de la Cité. En tout, vingt-quatre prisonniers répartis dans six fiacres : pour la plupart, des prêtres réfractaires, hostiles au nouvel ordre. Durant tout le trajet on les a insultés, frappés ; mais, à un moment, une des victimes, pour se défendre, hasarde un coup de canne : alors on les a extraits des voitures, avant de les massacrer avec des sabres, des piques et des maillets. Les meurtriers occupent ensuite la prison voisine de l’Abbaye, où ils se mettent à tuer, à tuer... À la lueur vacillante des torches, on étripe, on égorge, tout en buvant. D’autres bonnets rouges, à l’appel du tocsin, forcent la prison des Carmes, puis celle du Châtelet, et reproduisent les mêmes atrocités.
En pleine action, les assassins à cocarde, d’après les témoins, répétaient la même phrase — Aujourd’hui, il faut en finir.
Toujours la grande purge.
Cette idée, Even Frei la comprenait : il l’avait lui-même subie, un siècle et demi plus tard. D’ailleurs l’engrenage dans lequel le comité de surveillance de la Commune avait mis le doigt, en suivant Marat et Danton, fournira un modèle aux amis de Lénine. Les mêmes roues dentelées...
Celui que l’on proclame de trop, malheur à lui !
En septembre 1792, cela visait les prêtres et les nobles, mais aussi les voleurs, les mendiants, les vagabonds, les prostituées -ces âmes errantes auxquelles sa déchirure avait ouvert Ghika.
Pour lui, l’air ne faisait pas de bulles, comme dans un liquide ; mais charriait des fantômes, les remuait contre les coins, les parois ; éclaboussait des nuées contre les façades de la place Fürstenberg et contre celle de brique et de pierre du palais abbatial. Étonnement de ne pas avoir discerné de tels essaims, avant de se tirer une balle dans la bouche. Ensuite l’absence des fantômes s’était imposée à lui comme la moins révocable des présences... Sans doute parce que lui-même était devenu un trou... « Si tu pouvais voir — se plaignait-il à Even Frei — comme ils vibrionnent, ballotés ici et là ; comme ils se contorsionnent... »
« Ce sont eux — lui apprenait-il — qui t’ont choisi. » Car le Grec prétendait qu’ils le lui avaient indiqué, comme un des leurs, à sa manière. À charge pour lui de l’ouvrir, avec la poupée. « Les fantômes t’ont montré » — insistait-il. Elle revenait souvent, cette déclaration — Les fantômes t’ont montré. Sur ce sujet, il semblait incapable d’en dire plus .
Deux mois encore, et on le retrouva au pied du magnolia, vers six heures du matin —, décédé.
Nous voilà à quelques jours de la grande manifestation sportive, où le pays, voué par ses dirigeants à la broutille, communiera dans un soulèvement de ferveur obligatoire. Au milieu des préparatifs, la solitude d’Even Frei le projetait vers une royauté sombre. Le magma où tout le monde s’agite sur fond de torpeur, ses sens l’appréhendaient de mieux en mieux : ce qu’un voile cache aux autres, lui le percevait, et ce matin son estomac entièrement vide rendait sa perception d’une acuité suffocante.
Il observait la troupe des visiteurs en train de se masser devant l’entrée des Catacombes. La foule s’étirait sur le trottoir comme un gros serpent, et il se disait qu’à ce moment du temps, les vivants étaient très morts et les morts, en revanche, très vivants. Soutenir cela, on ne l’aurait pu lorsqu’il était arrivé de Russie grâce à la protection lointaine de Malraux : la ville ne ressemblait pas encore à ce buvard qui absorbe l’encre.
Aujourd’hui il scrutait les visiteurs en file sur l’avenue : cette femme aux cheveux trop raides, avec des lèvres peintes en rouge vif ; cet homme corpulent en bermuda à fleurs, qui portait son mufle épanoui tel un ostensoir ; cette petite fille brune avec des tresses, qui montrait en souriant des dents irrégulières ; cet homme dégingandé qui avait passé un bras autour des épaules d’une femme littéralement couverte de taches de rousseur : ces vivants qui croyaient détenir leur corps, il les sondait, éprouvant pour eux un élan de tendresse et de miséricorde, car les somnambules ne se faisaient une idée claire ni de ce qu’on leur avait déjà volé ni de ce qu’on était en train de leur prendre, faute de regarder en face ce qui les annulait . . .
Admire, pleurait en lui-même Even Frei, comme ils prétendent rendre visite aux morts du vieux Paris... Mais distinguent-ils le furieux coup de gomme s’abattant sur eux ? Ça se croyait bien implanté de ce côté-ci de l’existence, et pas un pour deviner, oh, rien qu’un chouïa ! le mauvais sort qui les supprimait ...
On les a cousus ensemble, pleurait Even Frei, ravaudés dans la mutilation, sans aucune conscience du fil qu’on leur passe à travers le corps — Ainsi a-t-on fait perdre à leur ombre force et consistance. On les a amoindris, jusqu’à les changer en ombres de défunts . ..
« Comment les sources de vie ont-elles été asséchées ? se demandait Even Frei. Comment les affaires de cette planète ou leur mouvement ont-ils pu réduire ces gens à un tel état de faiblesse ? »
Brusquement, avec la rapidité d’un gerfaut, tomba sur lui la conviction que, parmi les visiteurs, deux, au moins, ne se laissaient pas réduire à cette misère. Quelque chose dans l’œil, le regard, à peine reconnaissable, lui était l’indice d’un éveil. Cela concernait le type dégingandé, avec des petites lunettes de métal sur les quelles le soleil scintillait ; mais aussi la fille à ses côtés, au visage criblé de taches de son, les bras, les épaules. Quelques enjambées, Even Frei s’approche d’eux, avec une tension remarquable des muscles de la face. Réprimant le désir de se jeter à leur cou — comme Nietzsche, dit-on, s’était jeté au cou de chevaux maltraités par un cocher turinois dans les premiers jours de janvier 1889, avant de s’effondrer dans la folie —, il leur adressa la parole de sa voix de halètement étouffé et leur posa une question qui le surprit lui-même. Étonnés, ils se regardaient l’un l’autre, sans comprendre ; et il lui fallut réitérer la question surprenante, alors que les jeunes gens fixaient son visage maigre et mat, marqué par le passage du temps, et accentué par la courbure royale de son nez. « Dites-moi, répéta-t-il, suis-je un homme ? À votre avis ? »
François Meyronnis. Le Messie, p. 11-24.
Première publication dans L’Infini 126, printemps 2014.

Travail réalisé par des membres du groupe Gallot, avec Morvay et Slepian.
Gallot Action à l’hôtel Colón, Barcelone, 6 octobre 1960. ZOOM : cliquer sur l’image.


Meyronnis s’intéresse à autre personnage, tristement célèbre celui-là : Staline. Il en raconte les derniers fantasmes (déporter les Juifs d’URSS), sa mort et imagine l’agitation autour de cette mort, le 4 mars 1953, le jour de la fête juive de Pourim, quarante-cinq ans avant celle de Vladimir Slepian. Le fantôme de Staline rôde-t-il encore ? Et celui d’Hitler ? A suivre l’actualité mouvementée de la planète à l’heure du « spectaculaire intégré » (Debord), on peut se poser la question.

Le texte dit : le camarade Staline est en train de crever. Vient d’ouvrir les yeux dans sa datcha de Koumsevo, non loin de Moscou. Ses vieux complices se tiennent à son chevet, alignés peureusement devant le sofa de la grande salle à manger. Il identifie à peu près Khrouchtchev, Molotov, et cette crapule de Lazare Kaganovitch. Celui-là, à gauche, ce doit être Mikoïan ; et juste à côté, avec son allure de gouape un peu blême, comment ne pas reconnaître Beria, le pourvoyeur des fosses ? « Notre Himmler », Staline aime quelquefois le présenter ainsi aux visiteurs occidentaux, avec un étrange rire sous cape. Ah, comme cet humour agaçait Roosevelt : sa stupeur pincée à Yalta !
Le dictateur met un nom sur chacune des silhouettes, mais il ne discerne qu’à peine leur visage ; celui de Beria pas plus que les autres. Les contours de leur figure s’estompent, absorbés par des dentelles de lumière ; des cascades qui semblent provenir du dedans de la tête et leur collent sur la face un masque scintillant, avec des reflets jaunes. Oui, on dirait que chacun des truands arbore un masque répulsif, aux teintes ambrées. Et leur maître, cloué sur le sofa tel un papillon épinglé sur du liège, observe cette mascarade comme un homme traqué, avec une frayeur proportionnée à sa faiblesse.
Vous êtes le 4 mars 1953, et les guérites de contrôle, à l’extérieur de Kountsevo, demeurent impuissantes face à la mort ; de même que les barrières concentriques , et les troupes de la Sécurité d’État. Le Géorgien sent qu’une faille profonde s’approche lentement pour l’avaler d’une seule bouchée.
Le 1er mars, une attaque cérébrale a fondu sur lui alors qu’il se reposait dans le petit salon du manoir. Il était étendu sur un divan, et le vautour a plongé sur l’écorce atrophiée de son cerveau. Staline s’est levé pour fuir, pieds nus, en pantalon de pyjama et maillot de corps, mais il n’a pu faire que trois pas, comme si le vautour s’emparait soudain de sa masse nerveuse. Il est tombé d’un coup sur le parquet, énucléé de sa force.
Une heure auparavant, il avait lu à sa table de travail des procès verbaux d’interrogatoire, sans se lasser de découvrir les sempiternels aveux de ses victimes. Toucher au but, il avait ce sentiment. Celui d’atteindre, enfin, le cœur battant des machinations de ses adversaires. Sous le masque de professeurs de médecine, comme le disait la Pravda en gros titre le 13 janvier de cette année, un nid de « saboteurs » et d’ « assassins » préparait un terrible bouillon de onze heures. Selon les amis de la Loubianka, ces lutins sinistres administraient des traitements nocifs à des hauts responsables du régime. Et d’abord à lui, Joseph Vissarionovitch ; même si on ne mentionnait son nom ni dans les articles ni dans les communiqués . Ces « blouses blanches », comme on les appelait, étaient presque tous juifs ; et à propos de ceux qui ne l’étaient pas, on prétendait qu’ils travaillaient pour des « cercles sionistes » et, derrière, pour une centrale de sabotage capitaliste.
Le guide du peuple soviétique avait dépouillé scrupuleusement les comptes rendus des enquêteurs de la Sécurité d’État, comme il l’avait fait la veille et l’avant veille ; mais, cette nuit-là, des nappes nébuleuses lui avaient enfoncé les synapses. Une fatigue en éventail, lancinante. Une sorte d’embrouillamini mental. Il s’était donc installé sur le divan du petit salon, persuadé que quelques heures de sommeil dissiperaient les volutes. Là, il combinait les mêmes idées qui le hantaient depuis des mois, les brassant comme on remue la glaise : il songeait aux convois nécessaires pour déporter les juifs de Moscou au Birobidjan ; et aux baraquements à construire pour entasser les autres en Sibérie orientale, sur une terre glacée qu’ils grifferaient de leur désespoir, puis sur laquelle ils se traîneraient jusqu’à la mort.
Rien ne lui plaisait davantage que l’idée d’un vaste gibet dressé sur la place Rouge, même s’il la trouvait trop éclatante pour qu’on la réalise. Trop parfaite. On suspendrait à une corde les principaux accusés, ces fameuses « blouses blanches » qui empoisonnent le peuple, lui inoculant des miasmes et des bacilles. Alors il imaginait délicieusement les soubresauts des pendus au-dessus du vide, avec une langue grotesque sortant de leur bouche. Ah ! Cela le faisait bien rire, qu’on s’agite ainsi dans l’agonie.
La tête secouée de tressaillements, il s’esclaffait. En fixant, malgré l’obscurité, les revêtements du plafond, Staline se tenait les côtes. Dehors, le vent soufflait sur les bois de pins enneigés. Que l’on transforme la place Rouge en gibet, vraiment, une telle pensée enchantait le guide. Au milieu de cette forêt de potences, suspendus eux aussi, il voyait Beria, Molotov, Kaganovitch et d’autres huiles du Parti avec les yeux de l’imagination : toute cette clique, il l’apercevait en train de gigoter au bout des fourches patibulaires en même temps que les juifs. En somme, une énorme purge, après de nouveaux procès publics. Le coup des années trente, quoi. Mais en mieux.
En fait, non. Une opération démoniaque d’une plus grande ampleur ! Hitler, son ennemi, l’avait enseigné... Si sa santé ne se détériorait pas trop vite, il allait peut-être, lui, le Géorgien, finir le travail commencé par l’Allemand ; mais de manière plus rusée, moins convulsive. Tiens, après l’ébruitement des complots, pourquoi ne pas proposer, l’air de rien, comme ça, la déportation des juifs soviétiques vers l’Est, et cela uniquement pour les mettre à couvert de la fureur de nos Russes ? Cette grosse couleuvre, on la fourrerait aux « compagnons de route » occidentaux ! Sans doute ces imbéciles goberaient-ils un tel bobard humanitaire ; et en se pourléchant, même ! On les entortillerait dans des fables, comme d’habitude. Nos bonnes vieilles méthodes...
Quant au transfert des juifs vers la Sibérie orientale, méditait le guide, on publie rait dans la Pravda une lettre ouverte d’intellectuels juifs qui l’exigerait de nous ; et, cette fois, même Ilya Ehrenbourg signerait : on ne lui permettrait pas de se défiler, comme en janvier. Il apposera sa foutue signature sur le document ; un autre choix signifierait la mort pour lui. Et surtout qu’il ne fasse pas état de ses scrupules : plus question qu’on nous amuse avec ce genre de balivernes... Les scrupules d’Ehrenbourg !
Le guide flaira, derrière les fenêtres vitragées, l’aube livide. Et le désir le prit d’écouter le concerto pour piano n° 23 de Mozart. En effet, seul ce disque lui permettait de tenir la tête au-dessus de la turbulence des complots ; de s’extraire du cercle restreint, de plus en plus serré, dans lequel le claustrait sa nouvelle manie. Laquelle était un peuple .
Haman, dans le Rouleau d’Esther, un des livres de la Bible, décrivait celui-ci, pour nuire à son étoile, comme « dispersé et à part parmi les peuples », ayant des lois différentes et n’observant point celles des autres — le calomniateur finissant bien vite par ordonner en des lettres scellées avec l’anneau du Roi, « qu’on détruise, qu’on tue et qu’on fasse périr tous les juifs » — dit la Bible — jeunes et vieux, femmes et enfants, « en un seul jour » — précise la Bible — le treizième du mois d’Adâr.
« En un seul jour » — cette expression captivait le guide, ainsi qu’elle avait captivé Hitler — l’autre guide.
Descendu en eux, comment l’esprit de Haman n’aurait-il pas enfermé leurs pensées en un roulement perpétuel, les exténuant, les happant comme dans un cylindre concasseur ? Et le guide percevait, sous une houle de rancune, le grignotement de ses nerfs crâniens ; avec la panique d’être, lui, Staline, séquestré dans un circuit exigu, et toujours plus enfiellé par l’impossibilité d’en sortir. Cherchant, tel Haman, le « seul jour » ; celui qui effacerait à jamais le peuple de la délivrance.
Et il se rappelait, étendu sur le dos, les yeux immobiles, tout grands ouverts, le subterfuge de son lointain prédécesseur : tirer au sort, en jetant les dés, la meilleure date pour détruire Israël par les fondations. Identifier ainsi le quantième du mois et de l’année où son étoile serait la plus faible ; où, donc, la conjonction astrale serait la plus favorable pour noircir le visage des juifs comme le fond d’une marmite.
Haman : deux syllabes qui l’habitaient, obsédant même ses rêves.
Un après-midi, il y a des lustres, le guide avait su par un rapport des services secrets de l’armée que Hitler disposait d’un compte bien garni dans une banque helvétique, et que ce compte sur lequel il plaçait les droits d’auteur engrangés par Mein Kampf, était ouvert au nom d’un certain Max Haman. Se fiant à une intuition, il avait alors demandé : -Cet homme de paille, à quoi rime-t-il ? Pourquoi Hitler vire-t-il chaque mois une grosse somme précisément à quelqu’un répondant à ce nom ?
Le soir même, un officier supérieur d’origine juive, depuis exécuté par la Sécurité d’État, lui avait appris que la réponse à sa question se trouvait dans le Rouleau d’Esther (en hébreu : la Meguilat Esther), Haman y figurant l’incarnation d’Amaleq, le principe inverse d’Israël ; quelque chose comme l’antimatière du peuple élu.
Nous sommes bien longtemps après ; quinze ans, peut-être. Et pourtant le guide se rappelait encore que, ce soir-là, un nuage était passé sur ses yeux. Exterminer Israël : on lui avait dit que c’était cela, le but d’Amaleq. Rien d’autre.
Trouver le « seul jour » : celui du coup de gomme.
Mais au moment précis où le souvenir du nuage le rattrapait sur le divan, il avait ressenti une violente secousse dans ses pédoncules cérébraux. Pour commencer, une arrière-douleur, telle une angoisse en écharpe ; puis une poussée fulgurante entre les lobes, mettant ses idées en pièces, les égaillant dans des brèches, d’abord étroites et bientôt se dépliant à l’infini ; brèches d’où des filaments de phrase étaient balancés à toute vitesse au fond du vide. Sautant à bas du divan, il s’était écroulé aussitôt par terre, le nez sur les lattes. Son bras et sa jambe gauches trémulaient, saccades irrépressibles empoignant sa mœlle épinière. Son côté droit semblait pris dans une mer glacée ; loin, très loin, sur une autre planète . Dans sa bouche, tordue, une paille de fer nettoyait les mots, les pulvérisait.
Quand les gardes de Kountsevo l’ont retrouvé le lendemain soir, n’ayant pas osé le chercher plus tôt, son pantalon de pyjama était trempé d’urine. Conscient, il ne pouvait plus former aucun son articulé ; ni même faire claquer sa langue contre son palais. À trois, ils ont installé son corps, lourd comme du plomb, sur le sofa de la grande salle à manger. Et c’est sur ce sofa qu’il se tient maintenant, guettant ses complices debout face à lui, tels des courtisans au pied du lit d’un monarque.
Bon, il va mourir. Il le sait, et eux aussi. De même qu’aucun de ces fumiers n’ignore que, grâce à cette hémorragie cérébrale, il s’en tire de justesse ; car tout était prêt pour eux. Le loup se disposait à les croquer à leur tour, comme il avait croqué les autres. Tous les camarades de Lénine...
Et puis, bien placé, un caillot de sang. Embolie opportune qui les mettait hors de danger . ..
Avec son visage taillé à la serpe, Molotov s’avance vers le guide, et éclate en sanglots ; imité aussitôt par Kaganovitch, jamais avare de gémissements. Est-ce sur eux qu’ils pleurent ? Quelqu’un, en retrait, débite des âneries. Solennelle, la voix de Vorochilov, ce ne pouvait être que la sienne, déverse comme à l’accoutumée un torrent de fadaises, parlant avec un ton doucereux d’« amitié fidèle » , ce qui allume un volcan chez le guide. Salopards ! rugit-il en lui-même ; flambant du désir d’étriper ces damnés.
Les yeux dilatés et fixes, il les regarde l’un après l’autre, avec le jaune de l’iris formant pour eux comme un cercle de l’enfer. Que leurs cartes soient truquées, qui en doute ? Tout de même, impossible pour le maître de les retourner à sa guise, ces cartes ; ni de prononcer la mise à mort des joueurs, afin de les faire danser avec lui dans le cortège du Mauvais. Ça, être une future dépouille, et vouloir encore se venger !
Frémissante d’effroi, une infirmière s’approche de Staline, et lui pose des sangsues derrière les oreilles ; tandis qu’une autre, avec des mains capricantes, lui fait au bras une piqûre de camphre ; chacune sentant sur elle la vigilance attentive de Beria.
Blonde avec les cheveux arrangés en tresses, une troisième apporte un potage, et entreprend de nourrir le guide à la cuillère, comme un enfant. Celui-ci, le regard dans le vide, absorbe une cuillerée, puis une autre, avant de reculer sur le sofa. Un sourire très léger lui monte aux lèvres, un sourire pensif, comme en train de s’éteindre. Bougeant légèrement la tête, il désigne de la main gauche, qui tremble, une photographie suspendue au mur, sur laquelle une petite fille blonde alimente un agneau ; puis, toujours avec cette curieuse ironie sur les lèvres, il tourne l’index vers lui comme pour établir d’un seul geste une formule d’égalité ; insinuant entre l’innocence de l’agneau et l’impureté du loup une paradoxale adéquation.
Apaisé, voilà qu’il lève vers ses complices une face où une énigme jette des feux sombres, mais non sans douceur. Khrouchtchev croit que le guide s’amuse, donnant cours à un humour retors. Ce vieux Joseph Vissarionovitch ! se dit quant à lui Molotov. Comme il apprécie la raillerie ! Voilà ce qui s’appelle mourir en bolchévique... Émus, Mikoïan et Kaganovitch ont, eux, du mal à retenir leurs larmes : que le guide se compare avant de partir à un agneau, ça les attendrit franchement, même si la moutonnerie n’est pas leur fort ; comme les touche aussi qu’à son dernier moment on nourrisse le « tsar de la faim », dispensateur de famine, de la même façon qu’on ravitaille la plus candide des bêtes.
Mais Beria, lui, fixe hardiment le guide, et il a soudain la révélation de ce qui se passe sous ses yeux : Staline vient de pénétrer un mystère. En tout cas, de l’entrevoir.
Pas encore de l’autre côté, mais déjà plus avec eux...
Qu’il y ait, de lui à l’agneau, reflet et symétrie, ça fait un drôle de signal, n’est-ce pas ?
Après, quant à déterminer de quoi, allez savoir. Beria s’en fout, d’ailleurs. S’il en était autrement, il ne serait pas là. Comment pourrait-il soupçonner ce que le guide est en train de découvrir ? — Quelle trouvaille ? — Eh bien, celle-ci : le moindre moment de sa vie, comprend-il, a été gouverné par une aversion profonde à l’endroit de l’agneau. Pas celui de la photographie, bien sûr. Non. Celui qui prend sur lui l’abîme du mal, et l’accueille en soi, pour lui retirer à jamais son pouvoir.
Logique, donc, que cette vie s’achève dans une aversion tout aussi profonde pour Israël en tant que Présence divine : Shekhinah, disent les juifs. Autre découverte, corrélative : la vie de Hitler, son grand rival, a été elle aussi entièrement mangée par cette haine, sauf que chez lui les deux haines ont toujours été indissociables. Mêlées, depuis le début.
Et, à cet égard, pense Staline, il voyait plus loin que moi. Il y a bien équivalence, à pousser les choses jusqu ’au bout, entre les deux exécrations : celle de l’agneau et celle d’Israël. Celui qui déteste, de manière conséquente et de toute son âme, un des termes, comment ne détesterait-il pas l’autre simultanément ?
Ancien séminariste, il se souvient que l’Antéchrist a deux cornes ; et même que
l’Apocalypse précise « comme un agneau ».
Hitler et moi, pense alors Staline, nous avons été les deux cornes de l’Antéchrist.
Cette idée le soulève jusqu’au délire ; le dégoûte aussi, comme s’il pelletait les asticots dans son propre cadavre.
Très tôt, il a détruit en lui la part vivante ; la massacrant, gonflé de colère, pour devenir ce reptile aux yeux de glace. Mais pourquoi un tel ravage ?
La Bible dit — Devant toi la vie et la mort, choisis la vie !
Et lui avait opté — pas même pour la mort, non — pour l’exaltation de la mort.
Bien sûr, l’amour on l’avait passé au blutoir en lui. Et la haine de soi était la mesure de celle qu’il adressait aux autres... Mais pourquoi les puissances de fumée l’avaient-elles élu, lui, Joseph Vissarionovitch ?
Ma vie, pense-t-il, ressemble à celle du scorpion et de la tarentule. Fallait sortir du monde pour le comprendre, se dit-il.
Là, les situations changent : il ne sait plus où il est. Tout s’embrouille. On dirait qu’un quadrille de démons, avec des visages comme un éclair de feu, vient de l’enfer pour l’accueillir : au bout des bras, les membres du quadrille portent, semble-t-il, des palmes. Staline jurerait que l’un des diables a l’apparence de Beria, et qu’une
exhalaison malodorante s’échappe de ses naseaux, étalée en vastes couches de puanteur. A côté de lui, un autre a une figure de poisson, avec la lèvre supérieure munie de ventouses. Préférable pour toi, murmure ce dernier, penché vers le guide, préférable de n’avoir jamais eu de chair ni de sang, et de n’avoir disposé d’aucune vie parmi les hommes ; car ton sort est pire que celui des bêtes fauves.
Craintivement, Staline s’enquiert de la sentence. Finira-t-il dans un étang de feu et de soufre, comme le faux prophète de l’Apocalypse ?
D’un air chagrin, le démon à tête de poisson répond par l’affirmative ; en effet, le Géorgien a craché à la face du monde les esprits de la famine. Et, dans son royaume, les humains se sont mordu la langue de douleur.
— Comment peux-tu affirmer cela ? demande Staline, soudain peureux comme un lièvre.
— Comment ? répond le démon en riant. Mais à cause de ceci ! dit-il en montrant du doigt une tiare de lin, comme poussée sur le front du guide, avec écrit dessus : Antéchrist.
Cette fois, Staline présente des traits communs avec Ivan le Terrible : à son instar, il a sur lui l’habit noir des moines et serre dans la main le bâton du pasteur. D’autres moines , aussi faux que lui, l’entourent en chantant , et tous portent des masques de carnaval.
Changeant continuellement de forme sans cesser d’être reconnaissable, le démon qui tient de Beria se lance alors dans une curieuse louange.
« Quel lépreux ! crie-t-il au guide. — Quel bouffon ! Regarde, dit-il : voici tes Saintes Écritures. Les seules qui te conviennent... »
Il montre une énorme boîte aux allures de livre, avec des fermoirs dorés ; et contenant, à la place des Évangiles, une grande bouteille de vodka.
Les faux moines psalmodient encore, et le guide saisit de mieux en mieux le sens de leurs paroles, chantées pourtant en slavon : « Le loup, disent-ils, habitera avec l’agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, veau et lion paîtront ensemble et un jeune garçon les conduira. »
Alors Staline rouvre de nouveau les yeux et revoit la petite bande. Deux fois par an, tout le pays défilait devant elle : interminables processions, formant leurs rangs en larges flots. Ensemble, rengorgés et dressant la tête, lui et sa camarilla, se mettaient sur le toit du mausolée de Lénine. Sous leurs pieds, la momie du fondateur ; cadavre empaillé auquel on exhibait le peuple.
Mais, pour le guide, finies les parades !
L’ange de la mort va bientôt le prendre. Dans un état comateux, la nuit du 4 au 5 mars est passée. Son teint a pris une nuance plombée, avec une pâleur crayeuse. Quel salaud ! pense le vrai Beria. Une heure, deux, peut-être, et nous serons débarrassés de lui...
Et, comme en écho à ce vœu, gargouillements étouffés : un grand jet, et deux autres à la suite, plus faibles. Du sang. Le guide en vomit des giclées.
C’est la fin ! se réjouit Beria. Oh, comme ça lui fuse de la gargoulette ! Pouah !
Allons donc, un vampire !
Une bolée d’air, arrêtée trop tôt ; et puis, bien vite, resserrement. Le guide respire avec difficulté. Spasme de la poitrine.
Kaputt ! s’enivre Beria...
D’un mouvement brusque, il s’avance vers la tête du lit, s’agenouille et baise la main de son seigneur, comme s’il n’avait pour lui qu’amour et déférence.
« Camarade Staline, dit-il à voix basse, sais-tu quel jour nous sommes ? »
Approchant sa bouche de l’oreille du dictateur, il chuchote, avec un sourire en coin : « Non, tu ne sais pas ? Eh, vieille bourrique, le jour de Pourim, figure-toi. »
Ce mot, le guide l’a entendu. Pourim. Il contracte ses mâchoires, et semble perdu
dans une hallucination.
« Oui, confirme Beria, la fête juive qui commémore le renversement du plus grand péril en délivrance. » Il continue : « Et cette fête, dit-il, tu es en train de la vivre en mourant. »
Entendant cela, le guide se rejette en arrière, comme devant une menace. Les dés se retournant sur leur face opposée, on dirait tout à coup qu’il les voit, et que cette vision le panique.
« Confiant dans les dés, dit Beria, Haman, le chef d’Amaleq, se figurait déjà détruire, égorger et massacrer ses ennemis héréditaires ; mais c’est lui, vieille bourrique, qui est more ; suspendu au bois, le misérable ; accroché à la potence dressée sur son ordre pour Mardochée, le chef des juifs. Et c’est cela, vieux croûton, qui t’arrive AUJOURD’HUI, exactement comme dans le Rouleau d’Esther. »
Une drôle d’expression perce dans les yeux de Staline, donnant à son visage l’aspect d’un loup furieux, rendu tel par la peur. Écroulement : on l’envoyait au gibet, comme dans la Bible, avec les dix fils de Haman, et pire même : au bout d’une corde, avec les dix pendus de Nuremberg. Mais n’était-ce pas la même chose ? L’un d’entre eux, Julius Screicher, le plus virulent des meneurs nazis, n’avait-il pas, avant que la trappe ne s’ouvrît sous ses pieds, gueulé ce mot et cette date, Pourim 1946 ! hurlé littéralement de toutes ses forces, comme si les barrières de son aveuglement cédaient dans cette lueur foudroyante ? Quand on lui avait rapporté ce fait, à l’époque, le guide avait senti une drôle d’électricité en lui. A croire que la vitesse de chute du corps de Streicher l’engouffrait à son tour dans la gueule du Dragon.
Pourim 1953 — Le cri du chef nazi, par l’entremise de Beria, l’a pris dans sa descente ; ensuite, perce de connaissance. Dégringolade.
Juste cette précision : sa fille, Svetlana, présente à son agonie, raconte qu’avant de passer de vie à trépas, il a ouvert une dernière fois les yeux, avec, dit-elle, un
« regard horrible, entre démence et courroux » -où se trahissait une découverte brutale de l’insoutenable.
Le destin de Staline, comment ne pas le relier avec une circonstance survenue sur un chemin poudreux d’Ukraine, le 19 juillet 1806 ? Rabbi Nahman, au mépris de la poussière, faisait route en calèche vers la ville de Medvedevka. En face de lui, un disciple, Rabbi Nathan ; un autre à ses flancs, Rabbi Naphtali. Deux autres disciples, chacun d’un côté, se tenaient debout sur les marches de la voiture à cheval, tandis que le cocher bombait le dos en laissant flotter les rênes.
À un moment, sous le coup d’une inspiration subite, le Rabbi fit descendre dans sa bouche des paroles aussi brûlantes que des charbons ardents. Comme il s’exprimait à voix très faible, les disciples sur les marches ne retinrent rien de ce feu, sauf qu’il était question d’un « arbre avec des feuilles d’or ». Mais ceux qui étaient sur les sièges de la calèche recueillirent du maître une étrange prophétie, qu’ensuite ils notèrent à la volée sur une feuille, d’où le manuscrit Meguilat Starim — le Rouleau des secrets — ce qui peut encore se traduire, comme la Meguilat Esther de la Bible : « Dévoilement du caché ».
Griffonné à la hâte, avec un système de symboles improvisé, le texte fut transmis tel quel dans la communauté de Braslav — mais à une seule personne par génération. À sa mort, Rabbi Naphtali, qui avait survécu à Rabbi Nathan, le légua à Rabbi Aharon Lipevesker ; et celui-ci, à Rabbi Avraham, lequel perdit la parole, puis mourut dans le mois qui suivit la révolution d’Octobre 1917, sans qu’on sache ce qu’est devenu après lui le dépôt.
Ce secret, qu’on fait passer de un à un, sur quoi portait il ? — On n’en sait rien, sinon qu’il concernait la Russie ; et qu’il évoquait le rapport de cette terre de sang avec le dévoilement messianique. À partir des plaines russes, disait Rabbi Nahman, une vague d’athéisme engloutira le monde, comme un nouveau déluge ; et cette absence de Dieu se retournera contre le peuple de la délivrance, vouant par ailleurs tous les êtres humains à la famine.
Mais le Messie vaincra, ajoutait le Rabbi. Sans un coup de feu !
François Meyronnis. Le Messie, p. 90-102.
Première publication dans L’Infini 144, printemps 2019.
Les lecteurs — les vrais lecteurs — des livres de Meyronnis (et de Ligne de risque) ne sont pas très nombreux. On les compte peut-être sur les doigts d’une main. Arnaud Jamin est de ceux-là. Voici ce qu’il nous propose dans diacritik du 26 mars.
François Meyronnis : une parole qui résiste à l’époque (Le Messie)
par Arnaud Jamin

- Vladimir Slepian.
L’écrivain, essayiste et cofondateur de la revue Ligne de risque François Meyronnis livre un roman lumineux inspiré par l’œuvre-vie de l’artiste russe d’origine juive Vladimir Slepian.
7 juillet 1998. Un homme meurt foudroyé par la faim devant le café des Deux Magots alors que la France s’apprête à gagner la Coupe du monde de football dans une puissante allégresse spectaculaire.
C’est Vladimir Sepian, né en 1930, fils d’un diplomate soviétique exécuté par Staline, installé à Paris à la fin des années 50, peintre, auteur de performances et d’un seul roman Fils de chien. François Meyronnis, qui l’a croisé dans les années 90 dans son propre repaire le café Le Select à Montparnasse, ressuscite le Russe dans Le Messie en lui donnant le nom de Even Frei afin qu’il poursuive son œuvre tel un prophète.
C’est bien cela, il n’est plus tout à fait mort : l’âme de Rabbi Nahman de Braslav (1772-1810) a procédé à une intervention spéciale juste au bord du trépas. Elle maintenait la sienne à la frontière, et lui interdisait de franchir le seuil. Even Frei, fantôme à la croisée de la mort et de la vie ? En exergue du troisième chapitre, cette citation du rabbin fait signe vers le sens particulièrement aigu du double fond propre aux livres de Meyronnis : Le degré de royauté de chacun est tout à la fois dévoilé et secret.
Even Frei tient du radical réfractaire qui a effectué une sortie définitive de la société : Il prit en aversion les critiques, les galeristes, les commissaires d’exposition, qu’il assimila à un troupeau malfaisant de faussaires. Il refusa d’être pétri par eux ; mais le plus souvent il employait l’expression : triturer. Avec eux, on devient très vite de la poudre, disait-il, quand ils nous broient ; ou de la pâte, quand ils nous mastiquent. Sauf à quelques amis, il ne montra plus aucune œuvre. En quoi résident en effet une vie d’artiste et son esthétique conséquente si elle ne sont pas entièrement tournées vers cette liberté absolue ? Quel horizon pour les journées de celui qui ne concède aucun terrain au monstre social ? Manquer à la société, et ne vivre que pour le miracle. Mais encore capturer la vie secrète du temps. Ou plus précisément et simplement regarder le temps. Prophète, écrivain, artiste se déploient sur le même champ de bataille.
Justement, Le Messie suit la splendide double narration d’un affrontement entre… deux agonies. Celle du démon Staline qui meurt le 5 mars 1953 le jour de Pourim, ce moment juif qui fête la victoire de la délivrance sur le plus grand péril (c’est complètement fou) et celle du sauveur Rabbi Nahman le 16 octobre 1810, son exact et éblouissant inverse.
Le livre porte aussi très loin la réflexion sur la nourriture, Frei étant littéralement mort de faim, cherchant le dieu, l’attendant comme Rimbaud dans son poème “Mauvais sang” avec gourmandise. Bien sûr on passera son chemin si on cherche un éloge bobo du jeûne ou si on a succombé à la mode du fooding. On en sera en effet très loin en lisant ce mot époustouflant écrit par Antonin Artaud à Roger Blin depuis son asile de Ville-Evrard le 14 février 1942 et cité par Meyronnis comme un appel décisif à penser : C’est en mangeant qu’on fait revenir Dieu.
Nourri par Dieu de Dieu lui-même, soutenu et armé par la sagesse du rabbin, Frei prépare une grande œuvre, un immense désenvoûtement auquel participera le couple formé par Ava et Carlo, témoins de l’artiste. Une performance inouïe qui engagera le monde entier depuis le mont du Temple à Jérusalem, en déployant la parole divine pour sensationnellement, décisivement et à grande échelle faire désaffluer les démons. Mais avant cela il aura fallu engager le combat (encore) stratégique et spirituel contre Heilman, prophète à l’envers qui annonce un avenir post-biologique. C’est cette menace presque imminente sur le présent qu’identifie parfaitement Meyronnis-Frei en opérant principalement depuis la nervure biblique.
Le Messie s’inscrit au centre de l’impressionnant halo d’une œuvre qui, entre essais (L’axe du néant, puis Prélude à la délivrance avec Yannick Haenel ainsi que Tout autre. Une confession. Gallimard, 2003, 2009 et 2012) et romans (Brève attaque du vif et Ma tête en liberté, Gallimard, 2000 et 2010) avait trouvé sa parfaite expression dans l’ouvrage collectif Tout est accompli, écrit avec Yannick Haenel et Valentin Retz (Grasset, 2019). Un parcours singulier, où l’on cherchera en vain une trace de concession. Absolument essentiel même pour notre sombre temps où l’algorithme est un roi méprisant et incontesté. Le Messie questionne de manière capitale : Où trouver une parole qui résiste à l’époque, c’est-à-dire au séisme et à l’éclipse ? Que la terre tremble, l’épidémie et la menace sourde de l’empire de la Technique le disent assez. Que les dieux se soient enfuis, qu’ils se cachent et que nous ne les appelions pas assez fort pour qu’ils reviennent, l’Histoire le crie. Mais comme ce livre existe, ils pourraient fort bien s’approcher à nouveau.
François Meyronnis, Le Messie, éditions Exils, 152 p., mars 2021, 16 €
[1] Cf. Dévoilement du Messie.
[3] J’ai rappelé ce que j’avais perçu comme une critique allusive de Sollers, il y a deux ans, dans la présentation de Discours parfait.
[4] Stéphane Zagdanski, à sa manière, nous y invite également dans son séminaire La Gestion Génocidaire du Globe ; Réflexion sur l’extermination en cours.
[5] Le numéro comportait aussi un texte de Bernard Lamarche-Vadel, Lettres à ma mère.






 Version imprimable
Version imprimable


 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?



7 Messages
Signalons, un nouveau montage de l’entretien avec François Meyronnis : La Poursuite du Messie (film de Johanna Pauline Maier)
https://youtu.be/lpksi421XSI
Voir en ligne : Chaîne Youtube de Ligne de risque
A signaler l’excellent entretien vidéo avec François Meyronnis pour la sortie de son livre : Le Messie.
https://youtu.be/PlpzO2yIpVA
Voir en ligne : Ligne de risque (chaîne YouTube)
La parole qui sauve
par Yannick Haenel
N’avez-vous pas la sensation qu’une messe noire a lieu continuellement ? Massacres, pandémie, attentats : notre monde est empoché dans un envoûtement démoniaque. Est-il encore possible de briser ce règne ?
Oui, parfois tout s’éclaire. Il suffit du sourire d’une femme aimée, d’un rai de lumière qui illumine votre journée ou d’un livre qui reprend les choses à zéro.
Aujourd’hui, c’est un livre : Le Messie de François Meyronnis, qui vient de paraître aux éditions Exils. Depuis que je l’ai lu, je ne suis plus le même. Si j’étais vous, je trouverais les 16 euros qu’il coûte et je me précipiterais dans une librairie. Vous ne pourrez pas le rater : avec sa couverture rouge qu’estompe un halo pâle, ce petit livre de magie et de guérilla existentielle semble envoyé sur terre comme la manne, pour nous sortir de l’invivable.
L’espèce humaine est intoxiquée, mais de quoi a-t-elle réellement faim ? Qu’est-ce qui nous nourrit vraiment ? C’est l’histoire d’un artiste qui a cessé de manger. Il refuse la daube que nous sert la société ; se détourne du gavage capitaliste. L’approfondissement de sa propre faim le nourrit. C’est un homme pauvre et fulgurant que vous avez peut-être croisé à Paris, vers Montparnasse. Il s’appelait Vladimir Slepian. Dans son roman, François Meyronnis le rebaptise Even Frei.
Les aventures de cet homme radical, un Juif russe d’origine ukrainienne, illuminé par Dionysos, relèvent de l’ordalie, de l’événement poétique – de ces actes spirituels qui renversent le sens du monde. Le roman raconte comment, à Paris, Rome et Jérusalem, cet artiste va minutieusement produire des gestes qui vont agir sur les fins dernières. Actionner des fils invisibles qui vont libérer les étincelles. Déplacer des entraves. Faire désaffluer les démons.
Il vous prodigue l’accès à la délivrance
Even Frei, vous allez voir, trouve mieux qu’un vaccin : par la mise en acte d’une installation théurgique dont le roman raconte l’accomplissement, il vous prodigue l’accès à la délivrance.
Il y a des pages ahurissantes, au Kremlin, sur la mort de Staline, celui qui a affamé l’Ukraine. Il y a le livre brûlé de Rabbi Nahman de Braslav. Il y a une joute terrible avec un des cerveaux du transhumanisme. Il y a une femme confrontée à sa détresse. Il y a des phrases, par dizaines, qui semblent des sésames : à vous de les faire agir dans votre propre vie.
« Nous vendons la vérité, écrit Meyronnis, au lieu de courir pour elle. Qu’un homme plonge dans les mots, et aussitôt la parole fait de la lumière. » Autrement dit : le destin du monde dépend de la manière dont chacun – vous, moi – fait se rejoindre en lui la source et la parole.
La littérature, plus forte que toute science et que toute religion, vous donne à la fois le visible et l’invisible. « Sur un certain plan, qu’une chose ait lieu dans le langage, et elle a vraiment lieu. » Vous aussi, trouvez ce plan.
Charlie Hebdo 1499 du 14 avril 2021
Dans le dernier bloc-notes de BHL, après un éloge de Bernanos et de Clémenceau :
Cf. Chevalier chrétien, héros républicain et prophète juif (Bernanos, Saint-Cricq, Meyronnis)
Vladimir Slepian, au fond du bistro des Deux Académies, faisait sur un petit cahier d’écolier des écritures mathématiques, les transfinis (de Cantor), à ce qu’il nous disait. A partir de sa pratique personnelle de la penture gestuelle qui se faisait à l’époque, il prononça un manifeste, le transfinitisme. Il ne fit jamais part à quiconque de la suture entre ses écritures ‘’mathématiques’’ et sa peinture. Nous dirions qu’il eut l’intuition de la fonction de l’infini actuel dans l’acte pictural.
Voir en ligne : L’incidence du sujet de la science sur la peinture moderne Selon les fondements du toucher dans l’acte pictural Dans Ligeia 2021/1 (N° 185-188)
Cher Jean-Pierre Salgas,
merci de votre contribution.
A.G.
VLADIMIR SLEPIAN
ENTRE ANTI-OEDIPE ET MILLE PLATEAUX
( ET AVEC KAFKA ET BACON )
LA PEINTURE SANS TABLEAU
« Vladimir Slepian : jeune peintre soviétique ayant, comme on dit, « choisi la liberté ».Vit à Paris. Essaye de trouver la galerie qui accueillera ses rouleaux peints de 20 à 40 mètres de long. Le texte que nous publions est le condensé d’une longue étude »peut-on lire dans Two Cities, une revue publiée par Jean Fanchette psychiatre et poète mauricien (1932-1992).Dans le numéro 7-8 (hiver 1961-1962) .Le titre de cette revue bilingue,-plus largement cosmopolite- est évidemment inspiré de Dickens Neuf numéros de 1959 à 1964. Point commun de tous les auteurs:presque tous sont des exilés Mentor de la revue : Lawrence Durrell. Au sommaire : Chazal et Pessoa, Ehrenbourg sur Babel, Dylan Thomas, Anais Nin. Dans le numéro 4 ,Burroughs, Gysin, Beil et Corso éditent le premier cut-up jamais publié en France. Le numéro 5 est consacré à Tagore. S’agissant de la peinture , le peintre John Forrester et un article de Charles Goerg sur Pollock. escortent à distance le manifeste de Slepian. Quatre ans auparavant, en 1957, Slepian vient d’être exposé anonymement à la galerie Daniel Cordier ouverte depuis 1956 et qui fermera ses portes en 1964,(il fera une donation de 550 oeuvres de 1983 à 1989 au Centre Pompidou).Cordier ancien secrétaire de Jean Moulin,venu à Moscou en 1956 en a rapporté ces oeuvres.L’Art transfini esquisse à grands traits une histoire de l’art, des avant-gardes russes à Georges Mathieu et fait le récit d’une performance de 1960 . Après le peintre et théoricien de l’art, l’écrivain anime dans les années 60 une agence de traduction.
MINUIT
Dix ans après , Fils de chien parait dans la revue Minuit -50 numéros de novembre 1972 à septembre 1982. « Minuit , revue périodique qui parait tous les deux mois, rassemble des textes de nos amis, textes de fiction ou textes théoriques,ainsi que des dessins. Et elle s’ouvre à une nouvelle génération de collaborateurs ; tendance qui s’accentuera, espérons-le au fil des prochains numéros ». Les éditions de Minuit furent fondées en 1942 par Vercors et Pierre de Lescure, refondées en 1949 par Jérôme Lindon ,puis en 1951 autour de Molloy de Samuel Beckett puis d’Alain Robbe-Grillet fédérateur des auteurs du Nouveau Roman .Et autrement lors de la guerre d’Algérie (Henri Alleg La question). A côté du Nouveau Roman,plusieurs collections théoriques de première importance y virent le jour : Arguments (Edgar Morin), Critique (fondée par Georges Bataille ), Le sens commun ( Pierre Bourdieu)
Pour comprendre cette revue dirigée par le romancier et théoricien gay Tony Duvert (1945-2008, prix Médicis 1973 pour Paysage de fantaisie) puis par Mathieu Lindon fils de Jérôme Lindon, et Denis Jampen (auteur en 1986 d’un seul livre Héros) à compter du numéro 16, il faut se souvenir que Samuel Beckett a eu le prix Nobel en 1969, que le Nouveau Roman après sa période formaliste (Jean Ricardou et ses colloques de Cerisy) connaitra bientôt .la consécration (en 1984,prix Goncourt de Duras, en 1985 prix Nobel de Simon).C’est la revue et la collection Tel Quel (Philippe Sollers y donne un entretien dans le numéro 17) qui domine alors les avant-gardes ( je renvoie à l’anthologie composée par moi pour les éditions Baza en 2011). Les amis ? Beckett dès le numéro 1 et continument (Foirade) et les auteurs des Editions.( Pinget,Deleuze-Guattari, Bourdieu, Robbe-Grillet, Wittig, Simon, Serres, Dubuffet, Duras, Linhart. Les nouveaux collaborateurs ? Jean Echenoz y donne ses deux premiers textes, Hervé Guibert, Eugène Savitzkaya.le dessinateur Michel Longuet .Le numéro 41 est tout entier confié au journal Libération
OEDIPE
En 1972, Vladimir Slepian écrit Premier livre du roi du Diamant. Spectacle « Les grands-parents ou le Théâtre à l’envers » ( sept exemplaires déposés dans deux bibliothèques américaines ) A l’origine d’un travail théâtral avec l’helléniste Philippe Brunet .Publié dans le numéro 7 entre Anton Pannekoek et Bernard Lamarche-Vadel, Fils de chien (une injure) donc de Slepian (un aveugle ) autour d’Oedipe .On sait qu’en référence, il prendra le pseudonyme d’Eric Pide..Je rappelle l’énigme à laquelle Le Sphinx soumet Oedipe : « Quel est l’animal qui marche le matin sur quatre pattes, à midi sur deux pattes et le soir sur trois pattes ?". Tous ceux qui échouent meurent. Mais un jour, après avoir tué un voyageur, Œdipe arrive à Thèbes. Il donne comme réponse au Sphinx, l’Homme, provoquant le suicide de celui-ci Accueilli en héros à Thèbes , Oedipe se marie avec Jocaste.accomplissant son destin : tuer son père ,épouser sa mère. Fils de chien ? un texte anti-Oedipe évidemment , celui de la tragédie devenu celui de la psychanalyse , mieux : un peu un Oedipe à l’envers qui remonte de l’homme au chien(quatre pattes.) Surement pour un lecteur russe et pour Slepian, un souvenir de Mikhail Boulgakov Coeur de chien 1925- lui aussi tenaillé par la faim- publié en France en 1971 aux éditions Champ libre trois ans auparavant (en URSS seulement en 1987) dont le narrateur a faim. Pourquoi ne pas songer aussi par anticipation aux premières performances d’Oleg Kulik (1994) .Et surtout à certains « tableaux » de Francis Bacon qui semblent donner à voir des opérations identiques sur le corps ?
DELEUZE-GUATTARI
A plusieurs reprises ,Deleuze et Guattari figurent au sommaire de Minuit (dans les numéros 2 , 5 , 10 : des chapitres du futur Mille plateaux) plus en supplément au numéro 24 en 1977 : A propos des Nouveaux Philosophes et d’un problème plus général). Et c’est dans la collection Critique que sont publiés L’Anti-Oedipe,1972 puis Mille plateaux 1980.,les deux tomes de Capitalisme et schizophrénie, sûrement la première grande oeuvre issu de l’ébranlement de mai 1968. Gilles Deleuze est historien de la philosophie et philosophe,Félix Guattari militant et psychiatre (à la clinique de La Borde). Entre les deux tomes, en 1975,Kafka et la littérature mineure.(auteur des Recherches d’un chien en 1922). Ensuite Deleuze publie un Bacon logique de la sensation en 1981 ( aujourd’hui au Seuil ).Quatre livres violemment contre-tout contre Jacques Lacan « Le signifiant on en a rien à faire ».Pour les « machines désirantes »de la libido contre le triangle du roman familial papa-maman-moi Deux volumes qui inventent un nouveau style aphrodisiaque de livre de philosophie.Aux antipodes de l’histoire de la philosophie, comme de la philosophie .Par le collage un peu comme dans les films de Godard de tout ce qui advient en cours de tournage.Par cristallisation comme l’amour selon Stendhal.Des centaines de textes les irriguent ,issus de domaines disparates. Sans aucune hiérarchie, ces livres-rhizomes plus qu’arbre sont eux aussi un « corps sans organes » comme ce dont ils parlent ,faits d’intensités ,de plateaux .L’un d’eux est donc Fils de chien « un texte tout à fait curieux », analysé dans le chapitre 10 : Devenir intense devenir animal devenir imperceptible, il est donc question de Slepian : « je ne peux devenir chien sans que le chien ne devienne lui-même autre chose ».On peut y lire le récit d’une performance ,la métamorphose d’un homme en chien, organe par organe. Contre l’anatomie autant qu’anti-Oedipe Comme le note Deleuze et Guattari : « il échoue sur la queue » (à entendre dans les deux sens sexuel et caudal).Depuis peu ,ce texte a resurgi ,devenant un petit livre aux Editions du Chemin de fer ( nées en 2005 )
LE CORPS SANS ORGANES
Dans Minuit 10, on peut lire un chapitre : « 28-11-1947. Comment se faire un corps sans organes ? » Qui deviendra le chapitre 6 de Mille plateaux. Trouvé chez Antonin Artaud, ce concept de CsO est au coeur de la pensée de Deleuze-Guattari dès le second chapitre de l’Anti-Oedipe Dans Pour en finir avec le jugement de Dieu Antonin Artaud en 1947, écrivait « L’homme est malade parce qu’il est mal construit, Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gratter cet animalcule qui le démange mortellement, dieu, et avec dieu ses organes, oui, ses organes, tous ses organes… car liez-moi si vous le voulez, mais il n’y a rien de plus inutile qu’un organe. Lorsque vous lui aurez fait un corps sans organes, alors vous l’aurez délivré de tous les automatismes et rendu à sa véritable et immortelle liberté. Alors, vous lui réapprendrez à danser à l’envers comme dans le délire des bals musette et cet envers sera son véritable endroit ».« Le corps sans organes s’oppose moins aux organes qu’à cette organisation des organes qu’on appelle organisme. C’est un corps intense, intensif. Il est parcouru d’une onde qui trace des niveaux et des seuils d’après les variations de son amplitude. Le corps n’a donc pas d’organes, mais des seuils ou des niveaux »écrit Gilles Deleuze dans son Bacon C’est de toute évidence ce que Deleuze et Guattari ont reconnu dans Fils de chien .L’expérimentation ,que condense cette phrase de Spinoza qui revient comme un leitmotiv obsédant dans toute l’oeuvre de Deleuze bien avant L’anti-Oedipe ,et bien après Mille plateaux « On ne sait pas ce que peut un corps »(Ethique III, scolie de la proposition 2)S’il parvient à se défaire ,à se libérer d’Oedipe ,celui de Freud comme celui d’Eschyle ?(comme la peinture du tableau… ?)
J-P S