Blow Up - ARTE, 8 janv. 2020
La rétrospective Jean-Luc Godard a eu lieu à la Cinémathèque Française du 8 janvier au 1er mars 2020, ce qui nous a donné envie de revoir un film de JLG façon zapping. Et pourquoi pas Pierrot le fou ?

J’ai vu Pierrot le fou trente ou quarante fois. Je connais le film par coeur. Et si je n’ai plus guère l’occasion de m’exclamer : « Au pieu, les p’tits vieux ! », il m’arrive encore d’utiliser dans la vie courante des répliques qui me viennent spontanément à l’esprit. Par exemple : « Allons-y ! Alonzo ! ».
La première fois que j’ai vu Pierrot, en novembre 1965 (le film est alors interdit au moins de 18 ans pour anarchisme, j’en ai 19), je m’en souviens très bien, c’était au Rex, un cinéma de la rue de Béthune à Lille, qui n’existe plus aujourd’hui. J’entre à la séance de 14h, il n’y a pas grand monde, je ne comprend rien, mais je suis emballé. « Qu’est-ce que le cinéma ? » demande Belmondo/Ferdinand au début du film. « Battleground, love, hate, action, violence, death, in one word emotion » répond Samuel Fuller.
Qu’est-ce que le cinéma ?

Le mot important est « émotion ».
En ce temps-là, le cinéma était permanent, on pouvait assister à plusieurs séances de suite sans même quitter son fauteuil : je suis resté. A la seconde vue, j’ai formellement et émotionnellement tout compris. Après La règle du jeu de Renoir, vu dès la première séance de sa ressortie rue Champollion à Paris, en juin 1965, je crois pouvoir dire que ce fut mon deuxième vrai choc cinématographique (pour ce qui est du cinéma français). Combien de fois, par la suite, dans combien de villes, ai-je engueulé le projectionniste ou le directeur de la salle parce qu’on tirait le rideau juste après le suicide de Pierrot/Ferdinand (chemise rouge, visage peint en bleu, tête bardée de bâtons de dynamite jaunes, puis rouges), avant le générique de fin (en lettres bleues alors que celui du début est en lettres bleues et rouges : les deux couleurs de base du film), voire avant le long panoramique silencieux sur le ciel, le soleil et la mer ponctué in fine par les mots de Rimbaud chuchotés par Marianne et Ferdinand : « Elle est retrouvée. Quoi ? L’Éternité. C’est la mer allée avec le soleil. »
Aragon
A l’époque, j’achetais chaque semaine les Lettres françaises. C’est là que j’ai lu l’article éblouissant d’Aragon : Qu’est-ce que l’art Jean-Luc Godard ? (9 septembre 1965).
Relisant divers textes de l’écrivain pour ma Défense de l’infini, j’ai retrouvé cet article sur la Toile (celle d’internet), faute de pouvoir mettre la main sur mon numéro des Lettres françaises (ma recherche m’a quand même permis de retrouver, entre autres, un article de Pleynet, de retour des États-Unis, sur la peinture américaine et le célèbre Lautréamont et nous d’Aragon). Aragon, hors de toute préoccupation idéologique ou politique propre au « réalisme socialiste » qu’il avait défendu jusque dans les années cinquante, y salue Godard qu’il compare à Delacroix, peintre dont le réalisateur, je ne crois pas me tromper, ne mentionne aucune oeuvre dans le film (c’est Velazquez qui est cité au début du film, Godard faisant lire à Belmondo/Ferdinand un beau passage de l’Histoire de l’art d’Elie Faure — qui venait d’être publié en Livre de Poche — consacré au peintre espagnol). Pierrot , « c’est donc comme Sardanapale, un film en couleur. »
Loin de l’ostracisme des situationnistes qui n’ont jamais aimé Godard et s’en prendront quelques mois plus tard, après avoir lu l’article des Lettres françaises (mais l’ont-ils vraiment lu ?) au « plus fameux renégat de l’art révolutionnaire » (concédons que ce fut longtemps le cas [1]), « Aragon-la-gâteuse » (allusion au « Moscou-la-gâteuse » du Aragon de 1924) et reprocheront bizarrement à Godard (avant de considérer qu’il était « le plus con des Suisses pro-chinois »), d’« empêcher l’expression situationniste au cinéma », avec son « emploi immédiatement conformiste du cinéma » (comme si Godard avait jamais pu ou voulu « empêcher » qui que ce soit, et notamment Debord, de tourner en rond dans la nuit et de mettre un peu de couleurs dans ses films [2]), Aragon, donc, l’affirme sans détour : l’art d’aujourd’hui c’est Jean-Luc Godard. En ce qui concerne le cinéma, malgré le magnifique In girum imus nocte et consumimur igni de Debord [3], l’avenir a donné raison à Aragon. Jusqu’à aujourd’hui. Cela fait donc un moment que ça dure (60 ans !).
Collages
L’intéressant, dans cet éloge enthousiaste de Godard, c’est la technique qu’y retient Aragon : celle de la citation et du collage qui sera souvent celle de Godard par la suite, comme d’ailleurs celle d’écrivains comme Sollers ou... Debord (de manière et dans un but évidemment fort différents). Ce n’est pas un hasard si, la même année 1965, Aragon qui vient de publier son roman La Mise à mort (Gallimard) qu’il se réjouit de voir cité par Godard (« Dans Pierrot le fou un grand bout de La Mise à mort…, bien deux paragraphes, je ne connais pas mes textes par coeur, mais je les reconnais, moi, au passage… dans la bouche de Belmondo m’apprend une fois de plus cet espèce d’accord secret qu’il y a entre ce jeune homme et moi sur les choses essentielles » écrit Aragon [4]), publie également chez Hermann Collages, un recueil de textes où l’on trouve, entre autres, un article sur les « Collages dans le roman et dans le film ». On pourrait montrer que les citations de Godard sont aussi présentes dans les derniers romans d’Aragon (Blanche ou l’Oubli, 1967 : « On se serait cru dans un film de Godard. » [5]) que le sont les citations d’Aragon dans les films de Godard (de Une histoire d’eau (1958) à Nouvelle vague, 1989). Les citations ou collages pullulent dans Pierrot le fou : citations d’écrivains ou « collages parlés » comme dit Aragon (Céline, Aragon, Poe, Chandler, Rimbaud, « un poète qui s’appelle revolver...— Robert Browning », Belmondo imitant la voix de Mauriac...), de peintres (Renoir, Picasso (dont Godard est peut-être formellement le plus proche), De Stael, Vélazquez...), de cinéastes (Lang et le fusil à lunette de La chasse à l’homme, Hawks et le filet d’Hatari !, etc...). Ils sont la matière même du film qui les consument sans retour. Aragon va même jusqu’à écrire : « il n’y a d’autre précédent que Lautréamont à Godard » (ce qui, pour être élogieux, est sans doute excessif [6]). Ceux qui ont bien perçu ça, cette importance du collage, cette parenté stylistique avec Aragon, c’est Guy Scarpetta dans un entretien radiophonique de 1997 dont je reproduis quelques extraits et Philippe Forest dans sa récente biographie d’Aragon (p. 676-677) [7].
Bon, maintenant, voilà le travail. A moins que vous ne soyez pris dans les mêmes embarras subjectifs que Pierrot/Ferdinand :
« Heureusement que j’aime pas les épinards, sans ça j’en mangerais, or je peux pas les supporter. Ben avec toi c’est pareil, sauf que c’est le contraire. »
... si vous n’aimez ni cet Aragon-là, ni ce Godard-là, souvenez-vous de cette injonction de Belmondo au spectateur dans A bout de souffle :
« Si vous n’aimez pas la mer... si vous n’aimez pas la montagne... si vous n’aimez pas la ville... allez vous faire foutre ! »


L’ABC. Velazquez

Le monde où il vivait était triste. Un roi dégénéré, des infants malades, des idiots, des nains, des infirmes, quelques pitres monstrueux vêtus en princes qui avaient pour fonction de rire d’eux-mêmes et d’en faire rire des êtres hors la loi vivante, étreints par l’étiquette, le complot, le mensonge, liés par la confession et le remords. Aux portes, l’Autodafé, le silence [l’écroulement rapide d’une puissance encore terrible, une terre où pas une âme n’avait le droit de pousser].
[...] Un esprit nostalgique flotte, mais on ne voit ni la laideur, ni la tristesse, ni le sens funèbre et cruel de cette enfance écrasée.
[...] Velazquez est le peintre des soirs, de l’étendue et du silence. Même quand il peint en plein jour, même quand il peint dans une pièce close, même quand la guerre ou la chasse hurlent autour de lui. Comme ils ne sortaient guère aux heures de la journée où l’air est brûlant, où le soleil éteint tout, les peintres espagnols communiaient avec les soirées. »
Elie Faure, Histoire de l’art. L’art moderne I
Le Livre de Poche, 1964, p. 167-168, 170, 171, 173.

 Qu’est-ce que l’art Jean-Luc Godard ?
Qu’est-ce que l’art Jean-Luc Godard ?
Louis Aragon
Qu’est-ce que l’art ? Je suis aux prises de cette interrogation depuis que j’ai vu le Pierrot le fou de Jean-Luc Godard, où le Sphinx Belmondo pose à un producteur américain la question : Qu’est-ce que le cinéma ? Il y a une chose dont je suis sûr, aussi, puis-je commencer tout ceci devant moi qui m’effraye par une assertion, au moins, comme un pilotis solide au milieu des marais : c’est que l’art d’aujourd’hui c’est Jean-Luc Godard. C’est peut-être pourquoi ses films, et particulièrement ce film, soulèvent l’injure et le mépris, et l’on se permet avec eux ce qu’on oserait jamais dire d’une production commerciale courante, on se permet avec leur auteur les mots qui dépassent la critique, on s’en prend à l’homme.
L’Américain, dans Pierrot, dit du cinéma ce qu’il pourrait dire de la guerre du Vietnam, ou plus généralement de la guerre. Et cela sonne drôlement dans le contexte – l’extraordinaire moment du film où Belmondo et Anna Karina, pour faire leur matérielle, jouent devant une couple d’Américains et leurs matelots, quelque part sur la Côte, une pièce improvisée où lui est le neveu de l’oncle Sam et elle la nièce de l’oncle Ho… But it’s damn good, damn good ! jubile le matelot à barbe rousse… parce que c’est un film en couleur, imaginez-vous. Je ne vais pas vous le raconter, comme tout le monde, ceci n’est pas un compte rendu. D’ailleurs ce film défie le compte rendu. Allez compter les petits sous d’un milliard !

Le neveu de l’oncle Sam contre la nièce de l’oncle Ho

Qu’est-ce que j’aurais dit, moi, si Belmondo ou Godard, m’avait demandé : Qu’est-ce que le cinéma ? J’aurais pris autrement la chose, par les personnes. Le cinéma, pour moi, cela a été d’abord Charlot, puis Renoir, Bunuel, et c’est aujourd’hui Godard. Voilà, c’est simple. On me dira que j’oublie Eisenstein et Antonioni. Vous vous trompez : je ne les oublie pas. Ni quelques autres. Mais ma question n’est pas du cinéma : elle est de l’art. Alors il faudrait répondre de même, d’un autre art, un art avec un autre, un long passé, pour le résumer à ce qu’il est devenu pour nous : je veux dire dans les temps modernes, un art moderne, la peinture par exemple. Pour le résumer par les personnes.
La peinture au sens moderne, commence avec Géricault, Delacroix, Courbet, Manet. Puis son nom est multitude. A cause de ceux-là, à partir d’eux, contre eux, au- delà d’eux. Une floraison comme on n’en avait pas vue depuis l’Italie de la Renaissance. Pour se résumer entièrement dans un homme nommé Picasso. Ce qui, pour l’instant, me travaille, c’est ce temps des pionniers, par quoi on peut encore comparer le jeune cinéma à la peinture. Le jeu de dire qui est Renoir, qui est Bunuel, ne m’amuse pas. Mais Godard c’est Delacroix.
D’abord par comment on l’accueille. A Venise, paraît-il. Je n’ai pas été à Venise, je ne fais pas partie des jurys qui distribuent les palmes et les oscars. J’ai vu, je me suis trouvé voir Pierrot le fou, c’est tout. Je ne parlerai pas des critiques. Qu’ils se déshonorent tout seuls ! Je ne vais pas les contredire. Il y en a pourtant qui ont été pris par la grandeur : Yvonne Baby, Chazal, Chapier, Cournot… Tout de même, je ne peux pas laisser passer comme ça l’extraordinaire article de Michel Cournot : non pas tant pour ce qu’il dit, un peu trop uniquement halluciné des reflets de la vie personnelle dans le film parce qu’il est comme tous, intoxiqué du cinéma vérité, et que moi je tiens pour le cinéma-mensonge. Mais, du moins, à la bonne heure ! voilà un homme qui perd pied quand il aime quelque chose. Et puis il sait écrire, excusez-moi, mais s’il n’en reste qu’un, à moi, ça m’importe. J’aime le langage, le merveilleux langage, le délire du langage : rien n’est plus rare que le langage de la passion, dans ce monde où nous vivons avec la peur d’être pris sans verd, qui remonte, faut croire, à la sortie de l’Eden, quand Adam et Eve s’aperçoivent nus avant l’invention de la feuille de vigne.
Qu’est-ce que je raconte ? Ah ! oui j’aime le langage et c’est pour ça que j’aime Godard qui est tout langage.
Non, ce n’est pas ça que je disais : je disais qu’on l’accueille comme Delacroix. Au salon de 1827, ce qui vaut bien Venise, Eugène, il avait accroché La mort de Sardanapale, qu’il appelait son Massacre n° 2 car c’était un peintre de massacres, et non un peintre de batailles, lui aussi. Il avait eu, dit-il, de nombreuses tribulations avec MM les très durs membres du jury. Quand il la voit au mur (ma croûte est placée le mieux du monde), à côté des tableaux des autres, cela lui fait, dit-il, l’effet d’une première représentation où tout le monde sifflerait. Cela avant que ça ait commencé. Un mois plus tard, il écrit à son ami Soulier :
Je suis ennuyé de tout ce Salon. Ils finiront par me persuader que j’ai fait un véritable fiasco ! Cependant, je n’en suis pas encore convaincu. Les uns disent que c’est une chute complète que La mort de Sardanapale est celle des romantiques, puisque romantiques il y a ; les autres comme ça, que je suis inganno, mais qu’ils aimeraient mieux se tromper ainsi, que d’avoir raison comme mille autres qui ont raison si on veut et qui sont damnables au nom de l’âme et de l’imagination. Donc je dis que ce sont tous des imbéciles, que ce tableau a des qualités et des défauts, et que s’il y a des choses que je désirerais mieux, il y en a pas mal d’autres que je m’estime heureux d’avoir faites et que je leur souhaite. Le Globe, c’est-à-dire M. Vitet, dit que quand un soldat imprudent tire sur ses amis comme sur ses ennemis, il faut le mettre hors les rangs. Il engage ce qu’il appelle la jeune Ecole à renoncer à toute alliance avec une perfide dépendance. Tant il y a que ceux qui me volent et vivent de ma substance crieraient haro plus fort que les autres. Tout cela fait pitié et ne mérite pas qu’on s’y arrête un moment qu’en ce que cela va droit à compromettre les intérêts tout matériels, c’est-à-dire the cash (l’argent)…
Rien ni le franglais n’a beaucoup changé depuis cent trente-huit ans. Il se trouve que j’avais été revoir La mort de Sardanapale il y a peu de temps. Quel tableau que ce « massacre » ! Personnellement, je le préfère de beaucoup à La liberté sur les barricades dont on me casse les pieds. Mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Il s’agit de ce que l’art de Delacroix ici ressemble à l’art de Godard dans Pierrot le fou. Ca ne vous saute pas aux yeux ? Je parle pour ceux qui ont vu le film. Cela ne leur saute pas aux yeux.
Pendant que j’assistais à la projection de Pierrot, j’avais oublié ce qu’il faut, paraît-il dire et penser de Godard. Qu’il a des tics, qu’il cite celui-ci et celui-ci là, qu’il nous fait la leçon, qu’il se croit ceci ou cela… enfin qu’il est insupportable, bavard, moralisateur (ou immoralisateur) : je ne voyais qu’une chose, une seule, et c’est que c’était beau. D’une beauté surhumaine. Physique jusque dans l’âme et l’imagination. Ce qu’on voit pendant deux heures est de cette beauté qui se suffit mal du mot beauté pour se définir : il faudrait dire de ce défilé d’images qu’il est, qu’elles sont simplement sublimes. Mais le lecteur d’aujourd’hui supporte mal le superlatif. Tant pis. je pense de ce film qu’il est d’une beauté sublime. C’est un mot qu’on emploie plus que pour les actrices et encore dans le langage des coulisses. Tant pis. Constamment d’une beauté sublime. Remarquez que je déteste les adjectifs.
C’est donc comme Sardanapale, un film en couleur. Au grand écran. Qui se distingue de tous les films en couleur par ce fait que l’emploi d’un moyen chez Godard a toujours un but, et comporte presque constamment sa critique. Il ne s’agit pas seulement du fait que c’est bien photographié, que les couleurs sont belles… C’est très bien photographié, les couleurs sont très belles. Il s’agit d’autre chose. Les couleurs sont celles du monde tel qu’il est, comment est-ce dit ? Il faudrait avoir bien retenu : Comme la vie est affreuse ! mais elle est toujours belle. Si c’est avec d’autres mots, cela revient au même. Mais Godard ne se suffit pas du monde tel qu’il est : par exemple, soudain, la vue est monochrome, toute rouge ou toute bleue comme pendant cette soirée mondaine, au début, qui est probablement le point de départ de l’irritation pour une certaine critique (ça me rappelle cette soirée aux Champs Elysées, à la première d’un ballet d’Elsa, musique de Jean Rivier, chorégraphie de Boris Kochno, décors de Brassaï, le réparateur de radios, avec le déchaînement de la salle, les sifflets à roulettes parce que l’on voyait danser les gens du monde dans une boîte de nuit, et qu’est-ce que vous voulez tout de suite, Tout Paris se sentait visé !) Pendant cette soirée-ci, le renoncement au polychromisme sans retour au blanc et noir signifie la réflexion de J.L. Godard en même temps sur le monde où il introduit Belmondo et sa réflexion technique sur ses moyens d’expression. D’autant que cela est presque immédiatement suivi d’un effet de couleur qui s’enchaîne sur une sorte de feu d’artifice, des éclatements de lumière qui vont se poursuivre sans justification possible dans le Paris nocturne où s’enflamme la passion du héros pour Anna Karina, sous la forme arbitraire de pastilles, de lunes colorées qui traversent en pluie le pare-brise de leur voiture, qui grêlent leur visage et leur vie d’un arbitraire comme un démenti au monde, comme l’entrée de l’arbitraire délibéré dans leur vie. La couleur, pour J.L. G, ça ne peut pas n’être que la possibilité de nous faire savoir si une fille a les yeux bleus ou de situer un monsieur par sa Légion d’honneur. Forcément, un film de lui qui a les possibilités de la couleur va nous montrer quelque chose qu’il était impossible de faire voir avec le noir et blanc, une sorte de voix qui ne peut retentir dans le muet de couleurs.
Dans la palette de Delacroix, les rouges, vermillon, rouge de Venise et laque rouge de Rome ou garance, jouant avec le blanc, le cobalt et le cadmium, est-ce de ma part une sorte particulière de daltonisme ? éclipsent pour moi les autres teintes, comme si celles-ci n’étaient mises là qu’afin d’être le fond de ceux- là. Ou faut-il rappeler le mot du peintre à Philarète Chasles, touchant Musset : C’est un poète qui n’a pas de couleur…etc. Moi, j’aime mieux les plaies béantes et la couleur vive du sang… Cette phrase qui m’est toujours restée me revenait naturellement à voir Pierrot le fou. Pas seulement pour le sang. Le rouge y chante comme une obsession. Comme chez Renoir, dont une maison provençale avec ses terrasses rappelle ici les Terrasses à Cagnes. Comme une dominante du monde moderne. A tel point qu’à la sortie je ne voyais rien d’autre de Paris que les rouges : disques de sens unique, Yeux multiples de l’on ne passe pas, filles en pantalons de cochenille, boutiques garance, autos écarlates, minium multiplié aux balcons des ravalements, carthame tendre des lèvres et des paroles du film, il ne me restait dans la mémoire que cette phrase que Godard a mise dans la bouche de Pierrot : Je ne peux pas voir le sang, mais qui, selon Godard, est de Federico Garcia Lorca, où ? qu’importe, par exemple dans La plainte pour la mort d’Ignacio Sanchez Mejias, je ne peux pas voir le sang, je ne peux pas voir, je ne peux, je ne.

Le sang je ne veux pas le voir...

Tout le film n’est que cet immense sanglot, de ne pouvoir, de ne pas supporter voir, et de répandre, de devoir répandre le sang. Un sang garance, écarlate, vermillon, carmin, que sais-je ? Le sang des Massacres de Scio, le sang de La mort de Sardanapale, le sang de Juillet 1830, le sang de leurs enfants que vont répandre les trois Médée furieuse, celle de 1838 et celles de 1859 et 1862, tout le sang dont se barbouillent les lions et les tigres dans leurs combats avec les chevaux… Jamais il n’a tant coulé de sang à l’écran, de sang rouge, depuis le premier mort dans la chambre d’Anna-Marianne jusqu’au sien, jamais il n’y a eu à l’écran de sang aussi voyant que celui de l’accident d’auto, du nain tué avec des ciseaux et je ne sais plus, je ne peux pas voir le sang, Que ne quiero verla ! Et ce n’est pas Lorca mais la radio qui annonce froidement cent quinze maquisards tués au Vietnam… Là, c’est Marianne qui élève la voix : C’est pénible, hein, ce que c’est anonyme… On dit cent quinze maquisards, et ça n’évoque rien, alors que pourtant, chacun, c’étaient des hommes, et on ne sait pas qui c’est : s’ils aiment une femme, s’ils ont des enfants, s’ils aiment mieux aller au cinéma ou au théâtre. On ne sait rien. On dit juste cent quinze tués. C’est comme la photographie, ça m’a toujours fasciné… Ce sang qu’on ne voit pas, la couleur. On dirait que tout s’ordonne autour de cette couleur, merveilleusement.
Car personne ne sait mieux que Godard peindre l’ordre du désordre. Toujours. Dans Les carabiniers, Vivre sa vie, Bande à part, ici. Le désordre de notre monde est sa matière, à l’issue des villes modernes, luisantes de néon et de formica, dans les quartiers suburbains ou les arrière-cours, ce que personne ne voit jamais avec les yeux de l’art, les poutrelles tordues, les machines rouillées, les déchets, les boîtes de conserves, des filins d’acier, tout ce bidonville de notre vie sans quoi nous ne pourrions vivre, mais que nous nous arrangeons pour ne pas voir. Et de cela comme de l’accident et du meurtre il fait la beauté. L’ordre de ce qui ne peut en avoir, par définition. Et quand les amants jetés dans une confuse et tragique aventure ont fait disparaître leurs traces, avec leur auto explosée aux côtés d’une voiture accidentée, ils traversent la France du nord au sud, et il semble que pour effacer leurs pas, il leur faille encore, toujours, marcher dans l’eau, pour traverser ce fleuve qui pourrait être la Loire… plus tard dans ce lieu perdu de la Méditerranée où, tandis que Belmondo se met à écrire, Anna Karina se promène avec une rage désespérée d’un bout à l’autre de l’écran en répétant cette phrase comme un chant funèbre : Qu’est-ce que je peux faire ? Je ne peux rien faire… Qu’est-ce que je peux faire ? Je ne peux rien faire…

Qu’est-ce que je peux faire...

A propos de la Loire…
Ce fleuve au moins, avec ses îlots et ses sables, j’ai pensé en le regardant que c’est celui qui passe dans le paysage à l’arrière de la Nature morte aux homards qui est au Louvre, que Delacroix a peinte, dit-on, à Beffes, dans le Cher près de la Charité-sur-Loire. Cet étrange arrangement (ou désordre) d’un lièvre, d’un faisan avec deux homards cuits vermillon sur le filet d’un carnier de chasse et un fusil devant le vaste paysage avec le fleuve et ses îles, on peut m’expliquer qu’il l’a fait pour un général habitant le Berry, il n’en demeure pas moins un singulier carnage, ce Massacre n° 2 bis, qui est à peu près contemporain de La mort de Sardanapale, et paraîtra aux côtés de ce tableau au Salon de 1827. C’était l’essai d’une technique nouvelle où la couleur est mélangée avec du vernis au copal. Toute la nature de Pierrot le fou est ainsi vernie avec je ne sais quel copal de 1965, qui fait que c’est comme pour la première fois que nous la voyons. Le certain est qu’il n’y a de précédent à La Nature morte aux homards, à cette rencontre d’un parapluie et d’une machine à coudre sur la table de dissection du paysage, comme il n’y a d’autre précédent que Lautréamont à Godard. Et je ne sais plus ce qui est le désordre, ce qui est l’ordre. Peut être que la folie de Pierrot, c’est qu’il est là à mettre dans le désordre de notre temps l’ordre stupéfiant de la passion. Peut-être. L’ordre désespéré de la passion (le désespoir, il est dans Pierrot dès le départ, le désespoir de ce mariage qu’il a fait, et la passion, le lyrisme, c’est la seule chance encore d’y échapper).
L’année où Eugène Delacroix brusquement, part pour le Maroc traversant la France par la neige et une gelée de chien… une bourrasque de vent et de pluie, 1832, il n’y avait pu avoir de Salon au Louvre à cause du choléra à Paris. Mais en mai, une exposition de bienfaisance remplace le Salon, où cinq toiles de petit format prêtées par un ami représentent l’absent. Trois d’entre elles semblent avoir été faites coup sur coup, et probablement en 1826 – 1827 : l’Etude de femme couchée (ou Femme aux bas blancs) qui est au Louvre, la Jeune femme caressant un perroquet qui est au Musée de Lyon et Le Duc de Bourgogne montrant le corps de sa maîtresse au Duc d’Orléans, qui est je ne sais où.
C’est dans le plein temps de sa liaison avec Mme Dalton, mais il est impossible de savoir qui sont au vrai les femmes nues de ces trois tableaux, si c’est la même. Sans doute, la Jeune femme au perroquet a-t-elle les paupières lourdes qu’on voit à la Dormeuse qui est, paraît-il, Mme Dalton. Mais ni l’une ni l’autre ne ressemblent au portrait de cette dame par Bonington. Dans le Journal d’Eugène, il passe beaucoup de jeunes femmes qui viennent poser, et à propos desquelles il inscrit dans son carnet une très particulière arithmétique. Quoi qu’il en soit, on tient Le Duc de B, etc.., pour la suite de ces deux études, et personne ne doute qu’il y ait coïncidence de strip-tease entre le tableau et la vie, Eugène pouvant bien être le Duc de Bourgogne et son ami Robert Soulier, le Duc d’Orleans. On sait comment Mme DALTON passa de l’un à l’autre. Mais la perversité du peintre n’est pas ici en question : dans Pierrot le fou c’est Belmondo qui joue avec un perroquet. Je ne dis tout ceci que pour montrer comment si je le voulais, moi aussi, je pourrais m’adonner au délire d’interprétation. Et d’ailleurs, n’est-ce pas là réponse à la question d’où j’étais parti ? L’art, c’est le délire d’interprétation de la vie.
Si je voulais aussi, j’aborderais J.L. G. par le rivage des peintres pour chercher origine à l’une des caractéristiques de son art dont on lui fait le plus reproche. La citation, comme disent les critiques, les collages comme j’ai proposé que cela s’appelle, et il m’a semblé voir, dans des interviews, que Godard avait repris ce terme. Les peintres ont les premiers usés du collage au sens où nous l’entendons, lui et moi, dès avant 1910 et leur emploi systématique par Braque et Picasso : il y a, par exemple, Watteau dont L’enseigne de Gersaint est un immense collage, où tous les tableaux au mur de la boutique et le portrait de Louis XIV par Hyacinthe Rigaut qu’on met en caisse sont cités comme on se plaît à dire.
Chez Delacroix, il suffit d’un tableau de 1824, Milton et ses filles, pour trouver « la citation » en tant que procédé d’expression. Il y avait quelque provocation à prendre pour sujet de peinture un homme qui ne voit point afin de nous montrer sa pensée : l’aveugle pâle est assis dans un fauteuil appuyant sa main sur un tapis de table brodé, dont ses doigts palpent les couleurs devant un pot de fleurs qui lui échappe.
Mais au-dessous de ses deux filles assises sur des sièges bas, l’une prenant la dictée du Paradise lost, la seconde tenant un instrument de musique qui s’est tu, il y a une toile non encadrée au mur où l’on voit Adam et Eve fuyant le paradis perdu devant le geste de l’Ange qui les chasse sans verd, nus et honteux. C’est un collage destiné à nous apprendre l’invisible, la pensée de l’homme aux yeux vides. Le procédé ne s’est pas perdu depuis. Vous connaissez ce tableau de Seurat, Les Poseuses, où dans l’atelier du peintre trois femmes déshabillées, l’une à droite en train d’enlever des bas noirs, se trouvent à côté du grand tableau de La Grande Jatte, « cité » fort à propos pour que ceci soit autre chose que ce que nous appelons un strip-tease. Et Courbet, quand il fait collage de Baudelaire dans un coin de son Atelier, hein ? De même, dans Pierrot, Godard avant d’envoyer la lettre l’affranchit d’un Raymond Devos : comme il avait fait du philosophe dans Vivre sa vie, Brice Parain. Ce ne sont pas là des personnages de roman, ce sont des pancartes, pour apprendre comment Adam et Eve furent chassés du paradis terrestre.

Est-ce que vous m’aimez ? [8]

Au reste, s’il y a dans ce domaine une différence entre Pierrot et les autres films de Godard, c’est dans ce qu’on ne manquera pas de considérer ici comme une surenchère. Voilà plusieurs années que ce procédé est reproché à l’auteur du Mépris et du Petit soldat comme une manie dont on attend qu’il se débarrasse. Les critiques espèrent l’en décourager et sont tout près d’applaudir un Godard qui simplement cesserait d’être Godard, et ferait des films comme tout le monde. Ils n’y réussissent pas très bien à en juger par ce film-ci. Si quelqu’un devait se décourager, c’est eux. L’accroissement du système des collages dans Pierrot le fou est tel qu’il y a des parties entières (des chapitres, comme dit Godard), qui ne sont que collages. Ainsi toute la réception mondaine du début. Eh bien, non. Ils continuent, ils ont reconnu (parce que Belmondo tient l’Elie Faure de poche en main) que le texte par quoi commence toute l’histoire, sur Velasquez, est d’Elie Faure. Ils n’ont pas très bien compris pourquoi, plus tard, Pierrot lit la récente réimpression des Pieds Nickelés. Dans une histoire où Belmondo brandit un livre de la Série Noire pour dire voilà ce que c’est qu’un roman ! Moi, je me rigole, messieurs : quand j’étais enfant on ne me disait rien si on me trouvait à lire Pierre Louys ou Charles-Henry Hirsch, mais ma mère m’interdisait les Pieds Nickelés. Qu’est-ce qu’elle m’aurait passé, si elle m’avait pincé avec l’Epatant, où ça paraissait ! Je ne sais pas de quoi ça a l’air pour les jeunes blousons noirs, nos cadets, mais, pour les gens de ma génération qui n’ont pas encore la mémoire tout à fait cartilagineuse la ressemblance entre les Pieds Nickelés et les types de « l’organisation » dans le jeu compliqué de laquelle est tombé Pierrot saute aux yeux : si bien que toute cette affaire, quand Belmondo lit les Pieds Nickelés, prend un sens légèrement plus complexe qu’il ne semble à première vue.
L’essentiel n’est pas là : mais qu’il faut bien au bout du compte se faire à l’idée que les collages ne sont pas des illustrations du film, qu’ils sont le film même. Qu’ils sont la matière même de la peinture, qu’elle n’existerait pas en dehors d’eux. Aussi tous ceux qui persistent à prendre la chose pour un truc feront-ils mieux à l’avenir de changer de disque. Vous pouvez détester Godard, mais vous ne pouvez pas lui demander de pratiquer un autre art que le sien, la flûte ou l’aquarelle. Il faut bien voir que Pierrot qui ne s’appelle pas Pierrot, et qui hurle à Marianne : Je m’appelle Ferdinand ! se trouve juste à côté d’un Picasso qui montre le fils de l’artiste (Paulo enfant) habillé en pierrot. Et en général, la multiplication des Picasso aux murs ne tient pas à l’envie que J.L.G. pourrait avoir de se faire prendre pour un connaisseur, quand on vend des Picasso aux Galeries Lafayette. L’un des premiers portraits de Jacqueline, de profil, est là pour, un peu plus tard, être montré la tête en bas parce que dans le monde et la cervelle de Pierrot tout est upside down. Sans parler de la ressemblance des cheveux peints, et des longues douces mèches d’Anna Karina. Et la hantise de Renoir (Marianne s’appelle Marianne Renoir). Et les collages de publicité (il y a eu la civilisation grecque, la civilisation romaine, maintenant nous avons la civilisation du cul…), produits de beauté, sous-vêtements.
Ce qu’on lui reproche surtout, à Godard, ce sont les collages parlés : tant pis pour qui n’a pas senti dans Alphaville (qui n’est pas le film que je préfère de cet auteur) l’humour de Pascal cité de la bouche d’Eddie Constantine devant le robot en train de l’interroger. On lui reproche, au passage, de citer Céline. Ici Guignol’s band : s’il me fallait parler de Céline on n’en finirait plus. Je préfère Pascal, sans doute, et je ne peux pas oublier ce qu’est devenu l’auteur du Voyage au bout de la nuit, certes. N’empêche que Le voyage, quand il a paru, c’était un fichument beau livre et que les générations ultérieures s’y perdent, nous considèrent comme injustes, stupides, partisans. Et nous sommes tout çà. Ce sont les malentendus des pères et des fils. Vous ne les dénouerez pas par des commandements : « Mon jeune Godard, il vous est interdit de citer Céline ! ». Alors, il le cite, cette idée.
Pour ma part, je suis très fier d’être cité (collé) par l’auteur de Pierrot avec une constance qui n’est pas moins remarquable que celle qu’il apporte à vous flanquer Céline au nez. Pas moins remarquable, mais beaucoup moins remarquée par MM les critiques, ou parce qu’ils ne m’ont pas lu, ou parce que ça les agace autant qu’avec Céline, mais n’ont pas avec moi les arguments que Céline leur donne, alors il ne reste que l’irritation, et le passé sous silence, l’irritation pire d’être muette. Dans Pierrot le fou un grand bout de La Mise à mort…, bien deux paragraphes, je ne connais pas mes textes par coeur, mais je les reconnais, moi, au passage… dans la bouche de Belmondo m’apprend une fois de plus cet espèce d’accord secret qu’il y a entre ce jeune homme et moi sur les choses essentielles : l’expression toute faite qu’il la trouve chez moi, ou ailleurs, là où j’ai mes rêves (la couverture de l’Ame au début de La femme mariée, Admirables fables de Maïakovski, traduit par Elsa, dans Les carabiniers, sur la lèvre de la partisane qu’on va fusiller). Quand Baudelaire eut dans Les phares collé un Delacroix, Lac de sang hanté des mauvais anges…, le vieux Delacroix lui écrivit : Mille remerciements de votre bonne opinion : je vous en dois beaucoup pour les Fleurs du Mal : je vous en ai déjà parlé en l’air, mais cela mérite toute autre chose… Quand, au Salon de 1859, la critique exécute Delacroix c’est Baudelaire qui répond pour lui, et le peintre écrit au poète : Ayant eu le bonheur de vous plaire, je me console de leurs réprimandes. Vous me traitez comme on ne traite que les grands morts. Vous me faîtes rougir tout en me plaisant beaucoup : nous sommes faits comme cela…
Je ne sais pas trop pourquoi je cite, je colle cela dans cet article : tout est à la renverse, sauf que oui, dans cette petite salle confidentielle, noire, où il n’y avait qu’Elsa, quand j’ai entendu ces mots connus, pas dès le premier reconnus, j’ai rougi dans l’ombre. Mais ce n’est pas moi qui ressemble à Delacroix. C’est l’autre. Cet enfant de génie.
Voyez-vous, tout recommence. Ce qui est nouveau, ce qui est grand, ce qui est sublime attire toujours l’insulte, le mépris, l’outrage. Cela est plus intolérable pour le vieillard. A soixante et un ans, Delacroix a connu l’affront, le pire de ceux qui distribuent la gloire. Quel âge a-t-il, Godard ? Et même si la partie était perdue, la partie est gagnée, il peut m’en croire.
Comme j’écrivais cet article, il m’est arrivé un livre d’un inconnu. Il s’appelle Georges Fouchard, et son roman, De seigle et d’étoiles ce qui est un titre singulier. Je l’ai lu d’une lampée. Je ne sais pas s’il est objectivement un beau livre. Il m’a touché, d’une façon bizarre qui avait trait à Delacroix. On sait de celui-ci, que tous les ans, avec deux amis (J.B. Pierret et Felix Guillemardet), depuis 1818, il fêtait, à tour de rôle chez l’un chez l’autre, la Saint-Sylvestre. On imagine ce que ces réunions périodiques, dont il nous est resté des dessins de Delacroix, supposaient d’espoirs, de projets, de confidences, de discussions… Guillemardet meurt en 1840, Pierret en 1854. Ni l’un ni l’autre ne sont devenus grand’chose. Delacroix finira seul cette vie, sans ses amis de jeunesse.
Or, dans De seigle et d’étoiles, le roman tourne autour de trois amis, Bouju, Gerlier et Frédéric, qui ont formé une sorte de groupe à trois, Mach 3, qu’ils l’appellent. Le roman, c’est ce que cela devient et ce que cela ne devient pas. Tout recommence, je vous dis. L’anecdote varie, et c’est tout. Votre jeunesse, jeunes gens, c’est toujours la mienne. Et Bouju écrira, presque pour finir, cette lettre, ce désespoir de lettre, parce qu’après tout Mach 3 c’est simplement trois pauvres types inadaptés. Drôle ce chiffre trois, pour Delacroix, pour moi. Et Bouju écrit tout de même, sans doute pour optimiser, comme il dit… quel âge a-t-il, Bouju, à cette minute là ? Et Fouchard lui, il a trente-cinq ans quand paraît son premier roman, comme dit le prière d’insérer. J’insère. Mais Bouju qui s’intitule le braillard de l’Anti-Système dit encore : Vingt, vingt-cinq bouquins, nous écrirons si c’est nécessaire pour réveiller ce petit déclic qui marque des soubresauts dans les foules de tous les pays. Si vous ne comprenez pas, allez donc faire de la bicyclette, ça vous fera les mollets…
Quel rapport, ceci qui vient après une sorte de bilan de la destinée d’un Rimbaud, quel rapport cela a-t-il avec Pierrot le fou, avec Godard ? Combien y-a-t-il déjà de films de Godard ? Nous sommes tous des Pierrot le fou, d’une façon ou de l’autre, des Pierrot qui se sont mis sur la voie ferrée, attendant le train qui va les écraser puis qui sont partis à la dernière seconde, qui ont continué à vivre. Quelles que soient les péripéties de notre existence, que cela se ressemble ou non, Pierrot se fera sauter, lui, mais à la dernière seconde il ne voulait plus. Voyez-vous tout cela que je dis paraît de bric et de broc : et ce roman qui s’amène là-dedans comme une fleur… Si j’en avais le temps, je vous expliquerais. Je n’en ai pas le temps. Ni le goût d’optimiser. Mais pourtant, peut-être, pourrais-je encore vous dire que tant pis pour ce qu’on était et ce qu’on est devenu, seulement le temps passe, un jour on rencontre un Godard, une autre fois un Fouchard. Pour la mauvaise rime. Et voilà que cela se ressemble, que cela se ressemble terriblement, que cela recommence, même pour rien, même pour rien. Rien n’est fini, d’autres vont refaire la même route, le millésime seul change, ce que cela se ressemble…
Je voulais parler de l’art. Et je ne parle que de la vie.
Les Lettres françaises, n° 1096, 9 septembre 1965 [9].

L’art, la mort


Godard, Belmondo et Karina parlent de Pierrot le fou

2 septembre 1965.

LIRE : Pierrot le fou a 50 ans : rencontre avec Anna Karina, icône de Jean-Luc Godard
Jean-Luc Godard ou Le cinéma au défi
Le film s’ouvre par une longue séquence dans laquelle Aragon développe sa théorie du collage et, quelques mois avant son retentissant article Qu’est-ce que l’art Jean-Luc Godard ?, affirme sa proximité formelle et « mentale » avec le cinéaste. A redécouvrir avec curiosité tant ce film « colle », c’est la cas de le dire, avec les propos d’Aragon et la technique de Godard.
Cinéastes de notre temps. France, 1965, 67 Min.
Réalisé par Hubert Knapp
Produit par Janine Bazin, André S. Labarthe
Avec Jean-Luc Godard, Louis Aragon, Jacques Siclier, Claude-Jean Philippe, Robert Benayoun, Éric Losfeld, Macha Méril, Anna Karina, Paul Godard, Véronique Godard.
Ce portrait mêle extraits de films (A bout de souffle, Le petit soldat, Alphaville, La femme mariée, Bande à part, Les carabiniers), interviews de proches (Anna Karina, la famille Godard, jusqu’à Louis Aragon) et reportage sur l’auteur d’À Bout de souffle. Un film fait d’amalgames, de collages, aussi éclaté dans sa construction que Pierrot le fou, sur lequel Godard s’apprêtait à travailler.
« Il y a bien des subtilités dans l’alliance, par le montage, des plans de reportages et des extraits de films. On a pris soin de semer des repères pour les non-initiés. C’est qu’il ne s’agit pas seulement d’un jeu où les "godardiens" sont priés de répondre au clin d’œil mais de la manière même dont Godard, dans ses œuvres, met en présence des fragments de réalités différentes. » — Jacques Siclier, Télérama, juillet 1965.

Pierrot à la lettre
Une conférence d’Alain Bergala enregistrée en février 2020.
Alain Bergala, critique de cinéma, ancien rédacteur aux Cahiers du cinéma, cinéaste, essayiste, auteur notamment de Godard au travail (2006), Nul mieux que Godard (1999), coordinateur des deux volumes Godard par Godard.
Dans Pierrot le Fou, la question de la lettre, du texte, de l’écrit, est explorée dans toutes les dimensions du rapport passionnel que le cinéaste entretiendra toute sa vie avec elle. Tout y est : le scénario, l’adaptation d’un roman, les jeux lettristes, les jeux de mots, le journal intime, le geste d’écrire, la graphie, la citation, les variations du copiste sur les phrases citées, les objets livres, les génériques... L’étude de la lettre dans Pierrot le Fou ouvrira des perspectives, à ce sujet, vers le Godard à venir, jusqu’à aujourd’hui.


2019. La chaîne Arte rend hommage à Anna Karina avec une soirée spéciale le mercredi 18 décembre 2019. Pierrot le fou, le chef-d’œuvre de Jean-Luc Godard avec Jean-Paul Belmondo, sera diffusé sur la chaîne franco-allemande à partir de 22h45. Suivra un documentaire, intitulé Anna Karina souviens-toi, réalisé par Dennis Berry.
2021. La chaîne Arte rend hommage à Jean-Paul Belmondo décédé le 6 septembre à l’âge de 88 ans en diffusant Le voleur de Louis Malle. Michel Frodon en retrace la carrière dans un article du Monde très complet Jean-Paul Belmondo est mort. Belmondo est mort et je m’aperçois que je suis triste... mais pas longtemps.
En 1998, Belmondo était l’invité de Bernard Pivot. Regardez, c’est très drôle.

Et en 2001 au théâtre des Variétés, son théâtre, avec Patrick Simonin.


![]() L’Internationale situationniste et...
L’Internationale situationniste et...
Le rôle de Godard
Dans le cinéma, Godard représente actuellement la pseudo-liberté formelle et la pseudo-critique des habitudes et des valeurs, c’est-à-dire les deux manifestations inséparables de tous les ersatz de l’art moderne récupéré. Ainsi tout le monde s’emploie à le présenter comme un artiste incompris, choquant par ses audaces, injustement détesté ; et tout le monde fait son éloge, du magazine Elle à Aragon-la-Gâteuse. On développe de la sorte, en dépit du vide critique que Godard trouve devant lui, une sorte de substitut de la fameuse théorie de l’augmentation des résistances en régime socialiste. Plus Godard est salué en génial conducteur de l’art moderne, plus on vole à sa défense contre d’incroyables complots. Chez Godard, la répétition des mêmes balourdises est déconcertante par postulat. Elle excède toute tentative d’explication ; les admirateurs en prennent et en laissent dans une confusion corrolaire à celle de l’auteur, parce qu’ils y reconnaissent l’expression, toujours égale à elle-même, d’une subjectivité. C’est bien vrai ; mais cette subjectivité se trouve être au niveau courant du concierge informé par les mass media. La « critique » dans Godard ne dépasse jamais l’humour intégré d’un cabaret, d’une revue Mad. L’étalage de sa culture recoupe celle de son public, qui a lu précisément les mêmes pages aux mêmes pocket books vendus à la bibliothèque de la gare. Les deux vers les plus connus du poème le plus lu du plus surfait des poètes espagnols (« Terribles cinq heures du soir — le sang, je ne veux pas le voir » dans Pierrot-le-Fou), voilà la clé de la méthode de Godard. Le plus fameux renégat de l’art révolutionnaire, Aragon, dans Les Lettres Françaises du 9 septembre 1965, a rendu à son cadet l’hommage qui, venant d’un tel expert, convient parfaitement : « L’art d’aujourd’hui, c’est Jean-Luc-Godard… D’une beauté surhumaine… Constamment d’une beauté sublime… Il n’y a d’autre précédent que Lautréamont à Godard… Cet enfant de génie. » Les plus naïfs s’y tromperont difficilement après de tels certificats.
Godard est un Suisse de Lausanne qui a envié le chic des Suisses de Genève, et de là les Champs-Élysées, et le caractère provincial de cette ascension est la meilleure marque de sa valeur éducative, au moment où il s’agit de faire accéder respectueusement à la culture — « si moderne qu’elle puisse être » — tant de pauvres gens. Nous ne parlons pas ici de l’emploi, finalement conformiste, d’un art qui se voudrait novateur et critique. Nous signalons l’emploi immédiatement conformiste du cinéma par Godard.
Certes, le cinéma, ou aussi la chanson, ont par eux-mêmes des pouvoirs de conditionnement du spectateur ; des beautés, si l’on veut, qui sont à la disposition de ceux qui ont actuellement la parole. Ils peuvent faire jusqu’à un certain point un usage habile de ces pouvoirs. Mais c’est un signe des conditions générales de notre époque, que leur habileté soit si courte, que la grossièreté de leurs liens avec les habitudes dominantes révèle si promptement les décevantes limites de leur jeu. Godard est l’équivalent cinématographique de ce que peuvent être Lefebvre ou Morin dans la critique sociale ; il possède l’apparence d’une certaine liberté dans son propos (ici, un minimum de désinvolture par rapport aux dogmes poussiéreux du récit cinématographique). Mais cette liberté même, ils l’ont prise ailleurs : dans ce qu’ils ont pu saisir des expériences avancées de l’époque. Ils sont le Club Méditerranée de la pensée moderne (voir infra : « L’emballage du “temps libre” »). Ils se servent d’une caricature de la liberté en tant que pacotille vendable, à la place de l’authentique. Ceci est pratiqué partout, et aussi pour la liberté d’expression formelle artistique, simple secteur du problème général de la pseudo-communication. L’art « critique » d’un Godard et ses critiques d’art admiratifs s’emploient tous à cacher les problèmes actuels d’une critique de l’art, l’expérience réelle, selon les termes de l’I.S., d’une « communication contenant sa propre critique ». En dernière analyse, la fonction présente du godardisme est d’empêcher l’expression situationniste au cinéma.
Aragon développe depuis quelque temps sa théorie du collage, dans tout l’art moderne, jusqu’à Godard. Ce n’est rien d’autre qu’une tentative d’interprétation du détournement, dans le sens d’une récupération par la culture dominante. Pour le compte d’une éventuelle variante togliattiste du stalinisme français, Garaudy et Aragon s’ouvrent à un modernisme artistique « sans rivages », de même qu’ils passent avec les curés « de l’anathème au dialogue ». Godard peut devenir leur theilardisme artistique. En fait le collage, rendu fameux par le cubisme dans la dissolution de l’art plastique, n’est qu’un cas particulier (un moment destructif) du détournement : il est déplacement, infidélité de l’élément. Le détournement, primitivement formulé par Lautréamont, est un retour à une fidélité supérieure de l’élément. Dans tous les cas, le détournement est dominé par la dialectique dévalorisation-revalorisation de l’élément, dans le mouvement d’une signification unifiante. Mais le collage de l’élément simplement dévalorisé a connu un vaste champ d’application, bien avant de se constituer en doctrine pop’ art, dans le snobisme moderniste de l’objet déplacé (la ventouse devenant boîte à épices, etc.).
Cette acceptation de la dévalorisation s’étend maintenant à une méthode d’emploi combinatoire d’éléments neutres et indéfiniment interchangeables. Godard est un exemple particulièrement ennuyeux d’un tel emploi sans négation, sans affirmation, sans qualité.
« De l’aliénation. Examen de plusieurs aspects concrets »
Internationale situationniste n° 10, mars 1966, Fayard, p. 470.
Nouvelle critique de Godard et annonce d’un film de Debord trois ans plus tard...
Le cinéma et la révolution
« Dans Le Monde du 8 juillet 1969, J.-P. Picaper, correspondant du Festival du film de Berlin, admire que désormais « Godard pousse son autocritique salutaire dans Le Gai Savoir, coproduction de !’O.R.T.F. et de Radio-Stuttgart — interdit en France —, jusqu’à projeter des séquences tournées clans l’obscurité ou même à laisser le spectateur durant un laps de temps à peine supportable devant un écran vide ». Sans chercher à mesurer ce que ce critique appelle « un laps de temps à peine supportable », on voit que, toujours en pointe, l’œuvre de Godard culmine dans un style destructif, aussi tardivement plagié et inutile que tout le reste, cette négation ayant été formulée dans le cinéma avant même que Godard n’ait commencé la longue série de prétentieuses fausses nouveautés qui suscita tant d’enthousiasme chez les étudiants de la période précédente. Le même journaliste rapporte que le même Godard, dans un court métrage intitulé L’Amour, avoue, par le truchement d’un de ses personnages, que l’on ne peut « mettre la révolution en images » parce que « le cinéma est l’art du mensonge ». Le cinéma n’a pas plus été un « art du mensonge » que tout le reste de l’art, qui était mort dans sa totalité longtemps avant Godard ; lequel n’a même pas été un artiste moderne, c’est-à-dire susceptible de la plus minime originalité personnelle. Le menteur prochinois termine donc son bluff en essayant de faire admirer la trouvaille d’un cinéma qui n’en serait pas, tout en dénonçant une sorte de mensonge ontologique, dont il aurait participé comme les autres, mais pas plus. En fait, Godard a été immédiatement démodé par le mouvement de mai 1968, comme fabricant spectaculaire d’une pseudo-critique d’un art récupéré, pour rafistolage, dans les poubelles du passé (cf. Le rôle de Godard, dans I.S. 10). Godard, à ce moment, a fondamentalement disparu en tant que cinéaste, de même qu’il a été insulté et ridiculisé à plusieurs reprises, personnellement, par des révolutionnaires qui le trouvaient sur leur chemin. Le cinéma, comme moyen de communication révolutionnaire, n’est pas intrinsèquement mensonger parce que Godard ou Jacopetti y ont touché ; de même que toute analyse politique n’est pas condamnée à la fausseté parce que les staliniens ont écrit. Actuellement, en différents pays, plusieurs nouveaux cinéastes essaient d’utiliser les films comme instruments d’une critique révolutionnaire, et certains y parviendront partiellement. Seulement, les limites qu’ils subissent dans leur reconnaissance même de la vérité révolutionnaire, aussi bien que dans leurs conceptions esthétiques, les empêcheront encore assez longtemps, à notre avis, d’aller aussi loin qu’il faut. Nous estimons qu’en ce moment seules les positions et les méthodes des situationnistes, selon les thèses formulées par René Viénet dans notre précédent numéro, ont un accès direct à un présent usage révolutionnaire du cinéma — les conditions politico-économiques, bien sûr, pouvant encore faire problème.
On sait qu’Eisenstein souhaitait de tourner Le Capital. On peut d’ailleurs se demander, vu les conceptions formelles et la soumission politique de ce cinéaste, si son film eût été fidèle au texte de Marx. Mais, pour notre part, nous ne doutons pas de faire mieux. Par exemple, dès que possible, Guy Debord réalisera lui-même une adaptation cinématographique de La Société du Spectacle, qui ne sera certainement pas en-deçà de son livre. »
« La pratique de la théorie. Le cinéma et la révolution »,
Internationale situationniste, n° 12, septembre 1969, Fayard, p. 672.
Pour voir ce qui rapproche, malgré les différences évidentes, le cinéma de Debord et celui de Godard, on lira avec intérêt Le cinéma de Godard et de Debord. Mémoires du siècle et expérience de la discontinuité du temps d’Alexandre Trudel (Université de Montréal).
Sur Guy Debord, lire : Giorgo Agamben, Le cinéma de Guy Debord (1995).
LIRE AUSSI : Godard et Debord, faux frères d’armes
 (14 septembre 2022)
(14 septembre 2022)
Aragon 1965
En 1965, au moment où il écrit Qu’est-ce que l’art Jean-Luc Godard ?, Aragon publie Les collages, recueil de textes souvent anciens ayant pour thème le collage : « Max Ernst peintre des illusions » (1923), « La peinture au défi » (1930), « John Heartfield et la beauté révolutionnaire » (1935), « Collages dans le roman et dans le film [10] ». Il publie également un roman La mise à mort. Guy Scarpetta revient sur ces deux oeuvres (extraits de Aragon, une voix sans mesure, France Culture, 1997).


[2] « Debord n’est jamais arrivé à la couleur », « Vous n’entrez pas dans Venise sans couleurs », « La Venise de In girum est absolument invisible » dit Sollers dans un entretien avec Yan Ciret (2001).
[3] Cf. Debord au cinéma.
[4] On remarquera le souci d’Aragon de revendiquer une certaine jeunesse, ou de se rappeler sa jeunesse, dans cet « accord secret », souci qu’il réaffirmera deux ans plus tard, toujours dans Les Lettres françaises, dans son Lautréamont et nous, long article écrit à l’occasion de la publication du Lautréamont par lui-même de Marcelin Pleynet (1967).
[5] Oeuvres Romanesques Complètes, t. 37, p. 67.
[6] Godard a-t-il lu Lautréamont ? Et si oui, comment ?
[7] Je renvoie aussi aux essais d’Alain Bergala : Godard au travail et Nul mieux que Godard (Cahiers du cinéma/Collection Essais) Nul mieux, on l’a remarqué, est l’anagramme parfait de lumineux.
[8] C’est la question que pose Raymond Devos dans cette magnifique séquence de Pierrot le fou (1965). N’en dit-elle pas plus que l’on ne croit sur les personnages masculins chez Godard et leur solitude fondamentale ? Sur Godard lui-même ? « Vous entendez, cette musique ? » Cette plainte ? Cette folie toujours menaçante (« Est-ce que je suis fou ? ») ? La réponse, en tout cas, est (même si on l’entend à peine) : « vous entendez ? vous n’avez rien compris ! »
[10] Réédition Paris, Hermann, coll. « Savoir : sur l’art », 1993.




 Version imprimable
Version imprimable











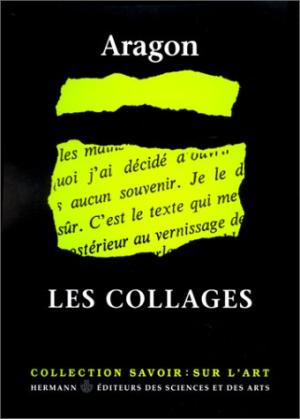

 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?



3 Messages
Dans cet essai détaillé sur le film de 1965 "Pierrot Le Fou" et son réalisateur Jean-Luc Godard, Matthew Risley, rédacteur en chef de A&E, tente de saisir et d’expliquer l’essence romantique du film, tout en explorant les philosophies cinématographiques de Godard et en mettant en lumière sa vaste filmographie et l’impact qu’elle a eu sur Godard et sur lui-même. LIRE ICI .
.
Entre Janvier et Mars 2020, la Cinémathèque française organisait une rétrospective intégrale des films de Jean-Luc Godard.
À cette occasion, de nombreuses séances étaient suivies de discussions avec des spécialistes de l’œuvre du cinéaste.
À la suite de la projection de Pierrot le fou (1965), c’est le critique, réalisateur et essayiste Alain Bergala qui évoquait ce film.
Alain Bergala est l’auteur, entre autres, de nombreux ouvrages consacrés au cinéma de Jean-Luc Godard.
Discussion avec Alain Bergala, animée par Bernard Benoliel.
Alain Bergala est réalisateur, critique et essayiste, auteur de nombreux ouvrages sur le cinéma. Ancien rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, il est aussi commissaire d’expositions de cinéma (Victor Erice / Abbas Kiarostami : correspondances au Centre Pompidou, Brune/Blonde et Pasolini Roma à la Cinémathèque française). Il a consacré plusieurs ouvrages au cinéma de Jean-Luc Godard, dont : Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard (2 volumes, 1998), Nul mieux que Godard (1999) et Godard au travail : les années 60 (éditions Cahiers du cinéma, 2006).
Bernard Benoliel est directeur de l’action culturelle et éducative à la Cinémathèque française.
Jean-Luc Godard ou Le cinéma au défi. Visionnant quelques archives suite à la mort d’André S. Labarthe, je redécouvre ce film de 1965 tourné par Hubert Knapp pour la série "Cinéastes de notre temps" avant que Godard ne réalisât Pierre le fou. Le film s’ouvre par une longue séquence dans laquelle Aragon développe sa théorie du collage et, avant son retentissant article Qu’est-ce que l’art Jean-Luc Godard ?, affirme sa proximité formelle avec le cinéaste. A redécouvrir avec curiosité ici tant ce film colle, c’est la cas de le dire, avec les propos d’Aragon et la technique de Godard.