Jean Genet est mort le 15 avril 1986 à l’âge de 75 ans. Une exposition lui rend hommage au MuCEM de Marseille, jusqu’au 18 juillet, tandis qu’un hors-série du Monde lui est consacré.
Présentation de l'exposition Jean Genet.

« Jean Genet, l’échappée belle », MuCEM, 1, esplanade J4, 13002 Marseille. Tél. : 04-84-35-13-13. Du mercredi au lundi, de 11 heures à 19 heures, le vendredi jusqu’à 22 heures.
Entrée : de 5 € à 9,50 €. Jusqu’au 18 juillet. www.mucem.org

![]() Dans L’Humanité 3 mai 2016...
Dans L’Humanité 3 mai 2016...

Une œuvre d’Ernest Pignon-Ernest, qui a exceptionnellement accepté de venir coller à l’intérieur de l’exposition.
Photo : Adagp/Paris/2016/Banque d’images de l’Adagp [1]. Zoom : cliquez l’image.


À Marseille, l’échappée belle de Jean Genet
par Christophe Deroubaix
Le Mucem de Marseille consacre une exposition à l’écrivain et poète dont la Méditerranée aura constitué le « bain » de toute son œuvre.
D’un fort à l’autre. Jean Genet a connu la geôle au fort Saint-Nicolas de Marseille en 1938 pour désertion. Depuis le 16 avril, de l’autre côté du Vieux-Port, le fort Saint-Jean, partie du Mucem, lui consacre une exposition : « l’Échappée belle ». Les deux forts ont la particularité de tourner leurs fortifications vers la ville, non vers le large. Le danger, c’est le peuple de Marseille, pas l’envahisseur. C’est dire si les lieux siéent à l’écrivain qui a passé sa vie à incarner le danger, à cultiver la marge, comme le rappellent les éléments de vie que les commissaires, Emmanuelle Lambert, écrivain, et Albert Dichy, directeur littéraire de l’Institut mémoires de l’édition contemporaine (Imec), ont tenu à placer, sous forme de chronologie, en introduction de l’exposition. « La vie de Genet a nourri son œuvre et son œuvre a nourri sa vie », justifie la première. « Genet n’est pas un auteur comme les autres, donc ce n’est pas une exposition littéraire comme les autres », poursuit le second. Il est rare en effet de trouver dans une exposition de ce genre des documents de l’Assistance publique, une fiche des RG, des documents de l’administration pénitentiaire ou de la justice militaire.
L’aventure du voleur, du dramaturge et du politique
L’exposition a pris place dans le bâtiment Georges-Henri-Rivière, où la scénographie a été conçue en trois salles, chacune placée sous les auspices d’une œuvre majeure de l’écrivain. C’est d’abord une sculpture qui accueille le visiteur : L’homme qui marche de Giacometti, œuvre majeure du XXe siècle par un artiste que Genet considérait comme son seul ami et qui a confectionné un Portrait de Jean Genet, également présent. « Placer la relation unique de Genet à Alberto Giacometti au cœur de l’exposition, c’est rappeler que les trois espaces de l’œuvre ici présentés, reflétant l’aventure du voleur, du dramaturge et du politique, ne sont articulés, nourris, reliés que par une relation profonde à l’art, soulignent les concepteurs de l’exposition. C’est en artiste et en poète que Genet traverse délinquance, théâtre, ghettos noirs d’Amérique et camps palestiniens de Jordanie et du Liban. »
La première salle est consacrée au Journal du voleur, non une autobiographie, mais « une cosmogonie sacrée », selon la formule de Sartre. On peut y lire les lettres originales par lesquelles la mère de Genet abandonne son fils à l’Assistance publique, y retrouver traces des fugues et y admirer une œuvre d’Ernest Pignon-Ernest, qui a exceptionnellement accepté de venir coller à l’intérieur de l’exposition.
« Statufié », selon sa propre expression, par Cocteau et Sartre, Genet prend « l’oblique » du théâtre, avec les Nègres et les Paravents. C’est l’objet de la salle 2. « Les Paravents furent l’un des plus grands scandales théâtraux du siècle », rappelle Albert Dichy. Face à l’Odéon, les militants d’extrême droite, parmi lesquels Jean-Marie Le Pen, manifestent. Sur un écran de télévision, on revoit Jean-Louis Barrault répondre aux questions de Michel Droit et dire que c’est la guerre qui insulte les morts, pas une pièce, pas une défense des opprimés [2]. Après les Paravents, Genet n’écrira plus pour le théâtre. Il n’écrira plus du tout pendant vingt-cinq ans. « Genet n’a jamais été un manager littéraire avisé », glisse Albert Dichy.
Vingt-cinq ans avant de reprendre la plume – il ne l’a jamais vraiment lâchée, y compris dans ses textes pour l’Humanité – et de se consacrer à un manuscrit que l’on retrouvera dans sa chambre d’hôtel aux côtés de son cadavre. Publié à titre posthume sous le titre : Un captif amoureux. « Je n’aurai raconté ma vie que pour réciter une histoire des Palestiniens », lit-on sur un panneau de la troisième salle. Sur l’un des petits écrans, Leïla Shahid dit à propos de Hamza, un jeune Palestinien qui avait impressionné Genet : « Les révoltés ont une beauté intrinsèque. » À sa suite, Angela Davis parle de l’engagement de l’écrivain français auprès des Noirs américains et des Black Panthers.

Toujours comme en fuite de la France, Genet. Même pour reposer éternellement. L’expo se ferme sur une photo de sa tombe dans le petit cimetière espagnol de Larache, au nord du Maroc, puis sur une interview accordée à Antoine Bourseiller, depuis la Grèce, près de la Méditerranée, son « bain ». D’une rive à l’autre.
Christophe Deroubaix, L’Humanité, 3 mai 2016.
Ernest Pignon-Ernest et Jean Genet à Marseille

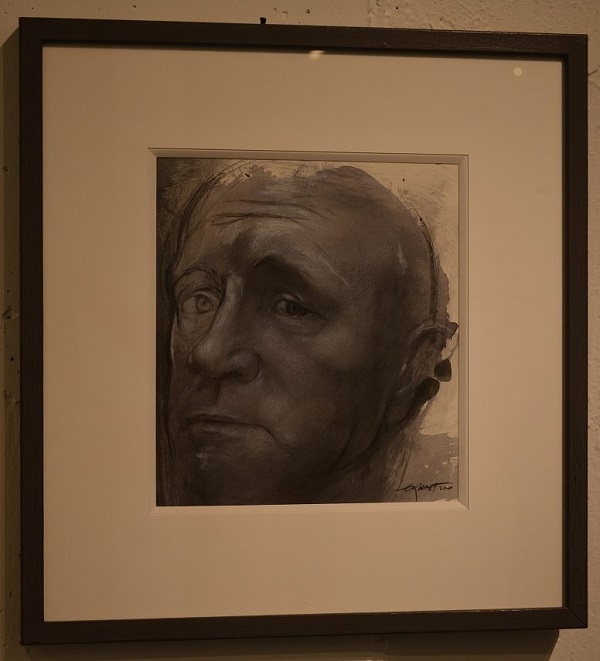
Ernest Pignon-Ernest, Jean Genet.
Photo A.G., août 2015. Exposition au musée Rimbaud, Charleville. Zoom : cliquez l’image.

![]() Dans Le Monde du 11 mai...
Dans Le Monde du 11 mai...
Jean Genet, sanctifié à Marseille
par Philippe Dagen
L’exposition « Jean Genet, l’échappée belle », se tient au MuCEM, jusqu’au 18 juillet.
Pour rendre hommage à Jean Genet (1910-1986), les commissaires de l’exposition qui se tient au MuCEM, Emmanuelle Lambert et Albert Dichy, ont choisi trois œuvres de l’écrivain. Le Journal du voleur, paru en 1949, dit l’enfance et la jeunesse de Genet, abandonné par sa mère à l’Assistance publique, les hôpitaux et les fugues, l’armée et la désertion, les vols et les prisons. Ces années sont évoquées par quantité de documents médicaux ou judiciaires, dont certains n’ont été extraits des archives administratives qu’après la mort de Genet, bien qu’il ait fait de nombreuses tentatives pour en savoir plus sur sa naissance.
Deuxième chapitre : la pièce Les Paravents, publiée en 1961, créée la même année à Berlin. Reprise à l’Odéon en 1966, elle suscite la fureur des anciens de l’Algérie française et des agités du mouvement Occident. Jean-Louis Barrault résiste. André Malraux s’oppose à un amendement déposé à l’Assemblée nationale en vue de réduire les subventions accordées au Théâtre de l’Odéon, où l’on aurait attenté à l’honneur de l’armée française et de la patrie. Des entretiens font l’essentiel de cette partie, dont un entre Michel Droit et Barrault, grand moment de télévision façon ORTF, du temps où Alain Peyrefitte était ministre de l’information.
Un hommage qui s’autorise des silences
La troisième section, à partir du Captif amoureux, paru en 1986 après la mort de Genet, traite de ses engagements politiques, Black Panthers et Palestiniens. Le principal est à écouter, là encore : un entretien avec Angela Davis, un autre avec Leïla Shahid, qui parlent avec sobriété de leur ami. En 1970, Genet donne des conférences dans les universités américaines pour y défendre l’action des militants afro-américains et, la même année, se range du côté de l’OLP. Suivent des séjours au Proche-Orient. En septembre 1982, il est à Beyrouth. Les 18 et 19 septembre, des miliciens chrétiens commettent les massacres des camps palestiniens de Sabra et Chatila. Le 19, Genet est l’un des premiers à entrer dans Chatila, avec Leïla Shahid. Quatre heures à Chatila paraît en janvier 1983, premier texte de Genet publié après une interruption de près de deux décennies.
Entre ces trois parties, une allée centrale largement ouverte fait office d’axe : elle est consacrée aux portraits de Genet par Alberto Giacometti, les deux hommes étant liés par une amitié dont témoigne L’Atelier d’Alberto Giacometti, publié en 1958, en un temps où le sculpteur était loin de bénéficier de la reconnaissance universelle qui l’entoure désormais. Dans un angle est diffusé un remarquable entretien de Genet avec Antoine Bourseiller, enregistré peu avant sa mort, récit autobiographique entre autodérision et provocation.
Servi par sa scénographie légère, l’hommage est réussi. Mais c’est trop un hommage, justement, et il s’autorise des silences. L’auteur du Journal d’un voleur est aussi celui de Pompes funèbres, édité anonymement par Gallimard en 1947, où soldats nazis et miliciens français sont décrits comme d’émouvants jeunes gens. On ne relit pas non plus aujourd’hui sans malaise « Violence et brutalité », texte publié par Le Monde le 2 septembre 1977, qui présente les terroristes de la Fraction armée rouge, la « bande à Baader », comme des défenseurs des peuples opprimés, capables de « sacrifices surhumains ».
Antisionisme et antisémitisme supposés
Si l’on ne peut que l’approuver quand il dénonce « l’usage du secret empêchant une connaissance d’intérêt général, l’inutilité de la gifle dans les commissariats, le tutoiement policier envers qui a la peau brune », il est plus difficile de le suivre quand il affirme que « ce que l’URSS a fait, ce qu’elle aurait fait de négatif – sans être escamoté – cède à ce qu’elle a fait, qu’elle fait de positif ». Escamoter, pour rependre son verbe, ce texte et les réactions qu’il déclencha n’est pas, du point de vue de l’histoire, défendable. Il ne l’est pas plus d’oublier que, dans Le Captif amoureux, la défense de la cause palestinienne va jusqu’à des phrases telles que : « La lutte métaphysique, impossible de l’ignorer, se poursuit entre les valeurs judaïques et (…) les révoltes vivantes. » Les « valeurs judaïques » ? Que faut-il comprendre par là ? Des débats ont eu lieu sur l’antisionisme et l’antisémitisme supposés de Genet. Il a été souvent rappelé que, dans son Saint Genet, comédien et martyr, Jean-Paul Sartre écrit, en 1952 : « Genet est un antisémite. » Ni l’exposition ni son catalogue ne mentionnent ces faits. Ils préfèrent l’hagiographie de Jean Genet, saint et martyr. Sartre avait écrit « comédien », et non saint.
« L’exposition est placée sous le signe de cet “Homme qui marche”, en symbole du chemin consumé de Genet vers le Sud comme en souvenir de l’amitié ayant lié deux des plus grands artistes du XXe siècle. »

Alberto Giacometti : « Homme qui marche II », 1960 – bronze
Zoom : cliquez l’image [3].


Philippe Dagen, Le Monde du 11.05.2016.
La critique de L’Humanité et la critique du Monde, dont l’approche est fort différente, montrent bien la difficulté ou l’embarras où se trouve encore aujourd’hui celui qui tente de cerner l’oeuvre et la vie de Jean Genet... au point que Philippe Dagen, juste après avoir cité le titre du livre de Sartre de 1952, Saint Genet, comédien et martyr (« SAINT GENET » est en gros caractères, « comédien et martyr » est le sous-titre), peut conclure son article en bafouillant : « Sartre avait écrit "comédien", et non saint [4] » !
Un numéro Hors-série du Monde tente de rendre compte, à travers de nombreux témoignages, de la complexité de ce que François Mauriac appellera, dès 1949, « le cas Jean Genet ». Je ne peux qu’en recommander la lecture.
Un écrivain sous haute surveillance
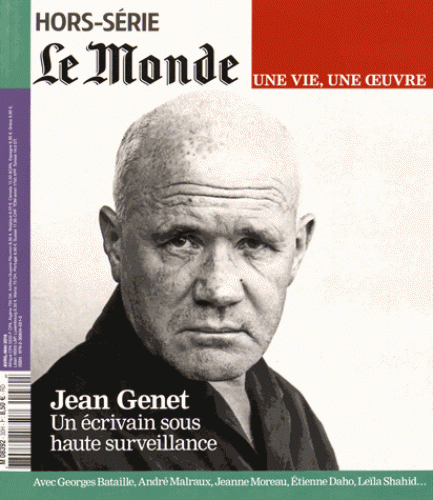 Hors-série Jean Genet du Monde : Conseiller éditorial du numéro : Albert Dichy [5]
Hors-série Jean Genet du Monde : Conseiller éditorial du numéro : Albert Dichy [5]
120 pages, 8.50 euros
Un entretien entre Albert Dichy et Josyane Savigneau revient sur la question politique et sur la polémique sur le soi-disant antisémitisme de Genet.
De larges extraits de l’oeuvre et plusieurs articles sur Genet proposent un panorama assez complet de la vie et surtout de l’oeuvre de Genet.
Des articles inédits ou repris signés René de Ceccatty, Eric Marty, Philippe Sollers, Bruno Blanckeman, Leïla Shahid, Domnique Eddé, Emmanuelle Lambert, Jacques Derrida, Malraux, Bataille entre autres. Tous célèbrent le renversement des valeurs, le verbe créateur et le la flamboyance de Genet. Description.
Le Hors-série du Monde publie de courts extraits d’un texte de Sollers initialement paru en 1993.
En 1993, Philippe Sollers écrit Physique de Genet, une préface à une réédition de trois romans de Jean Genet — « Le Journal du voleur », « Querelle de Brest », « Pompes funèbres » [6]. C’est loin d’être une simple préface.
Physique de Genet
par Philippe Sollers
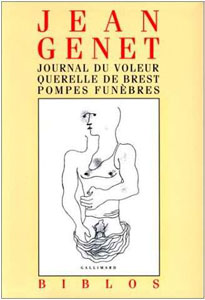 Comment se débarrasser de ce que des écrivains gênants ont écrit ? Voilà une question de tous les temps, un travail éminemment social. Autodafés, saisies, interdictions, tribunaux, scandales à rebondissements, tout cela relève cependant de la préhistoire, quand la Loi n’avait pas l’air de soupçonner qu’elle servait le désir et la connaissance en les réprimant. Or voici la nouvelle : la Loi a compris. Quoi ? Que dites-vous ? Impossible. La Loi est bête et refoulée par définition, je lui tends un chiffon rouge, elle fonce. Erreur. Le rêve maudit est terminé, renvoyé aux oubliettes médiévales, arrêtez d’appeler les procès de Flaubert et de Baudelaire à la rescousse, la Loi sait consciemment de quelle perversion elle est l’organe, elle l’exhibe, elle l’aime, elle avoue une fois sur deux sa complicité avec lui, elle a constaté qu’elle ne pouvait plus se tromper, elle a les moyens officiels et occultes de cette mutation génétique. Si vous voulez continuer à l’ignorer, bonne chance dans la rumination marginale et sans conséquence pour le futur, puisqu’il n’y aura plus de futur. Le Maître a tout simplement décidé qu’il n’était plus en dialectique avec l’Esclave. Quoi ? Répétez ? Vous affirmez que la Loi a enfin reconnu sa propre nature intrinsèquement perverse ? Qu’elle est en mesure de jouer simultanément sur les deux tableaux, donc de prévenir et de noyer tout discours qui n’est pas dans sa norme, en même temps qu’elle évacue, en connaissance de cause, la mémoire de tous ceux qui l’ont dérangée ? Oui. Plus de passé, plus d’événements, plus de ruptures, plus de révolutions (c’est bien le moins), plus de subversion, plus de transgression. La bouche sera fermée avant de s’ouvrir, le texte sera caviardé ou évaporé avant d’être imprimé. Allons plus loin. La censure s’en prenait traditionnellement à un objet, quel qu’il soit. Produisez donc maintenant le corps du délit : inutile, c’est dans le système nerveux de ceux qui sont là que la négation préalable opère. Vous pouvez accumuler des blasphèmes ou des obscénités inouïes, pousser des grognements à peine articulés pendant trois heures, publier une montagne de vice ou de scatologie, même résultat de torpeur, même indifférence. Pour boucler la boucle, il suffira de traiter le premier qui dira ce que je viens de dire de paranoïaque. Le pauvre Rushdie, par exemple, n’a nullement diffamé le Prophète : le Prophète fonctionne désormais comme paravent local du crime organisé, lequel se moque pas mal du sacré sous toutes ses formes. La condamnation à chaque instant du racisme ou de l’antisémitisme, pour sincère qu’elle soit, relève d’un détournement d’attention identique, de même que la prétendue lutte contre la drogue ou la séduction des mineurs. Sade est en vente libre ? Et alors ? Le Pape va nous ramener à l’obscurantisme ? Allons donc. Quand on contrôle directement la physiologie et les cerveaux, à quoi bon s’inquiéter des livres ? Il suffit d’organiser la non-lecture en visant sur la vente massive et la paresse mégalomaniaque du narcissisme humain. Chaque différence est taboue, aucun effort à faire. Êtes-vous « politiquement correct » (PC) ? vous demande t-on déjà à tout propos aux États-Unis. C’est-à-dire : êtes-vous un bon homosexuel, une bonne femme, un bon malade, un bon Noir ? Prônez-vous ouvertement tout ce que la Loi falsifiée, hypocrite et ancienne sanctionnait ou ignorait ? Bien, vous êtes dans l’ordre. Et ne nous parlez pas d’une hiérarchie des valeurs ou d’un classement quelconque. Platon et Aristote, par exemple, sont de vieilles lunes (Aristote était misogyne, il n’en sera plus question dans nos cours). Des écrivains ? Lesquels ? Joyce, Kafka, Hemingway ? Dites plutôt : « Des auteurs mâles, hétérosexuels, blancs, morts. » Et ainsi de suite. Le Bien veille, on ne peut vouloir que ce Bien qui récuse l’autorité et l’oppression, tout est donc pour le mieux dans la meilleure des sociétés automatiques possibles.
Comment se débarrasser de ce que des écrivains gênants ont écrit ? Voilà une question de tous les temps, un travail éminemment social. Autodafés, saisies, interdictions, tribunaux, scandales à rebondissements, tout cela relève cependant de la préhistoire, quand la Loi n’avait pas l’air de soupçonner qu’elle servait le désir et la connaissance en les réprimant. Or voici la nouvelle : la Loi a compris. Quoi ? Que dites-vous ? Impossible. La Loi est bête et refoulée par définition, je lui tends un chiffon rouge, elle fonce. Erreur. Le rêve maudit est terminé, renvoyé aux oubliettes médiévales, arrêtez d’appeler les procès de Flaubert et de Baudelaire à la rescousse, la Loi sait consciemment de quelle perversion elle est l’organe, elle l’exhibe, elle l’aime, elle avoue une fois sur deux sa complicité avec lui, elle a constaté qu’elle ne pouvait plus se tromper, elle a les moyens officiels et occultes de cette mutation génétique. Si vous voulez continuer à l’ignorer, bonne chance dans la rumination marginale et sans conséquence pour le futur, puisqu’il n’y aura plus de futur. Le Maître a tout simplement décidé qu’il n’était plus en dialectique avec l’Esclave. Quoi ? Répétez ? Vous affirmez que la Loi a enfin reconnu sa propre nature intrinsèquement perverse ? Qu’elle est en mesure de jouer simultanément sur les deux tableaux, donc de prévenir et de noyer tout discours qui n’est pas dans sa norme, en même temps qu’elle évacue, en connaissance de cause, la mémoire de tous ceux qui l’ont dérangée ? Oui. Plus de passé, plus d’événements, plus de ruptures, plus de révolutions (c’est bien le moins), plus de subversion, plus de transgression. La bouche sera fermée avant de s’ouvrir, le texte sera caviardé ou évaporé avant d’être imprimé. Allons plus loin. La censure s’en prenait traditionnellement à un objet, quel qu’il soit. Produisez donc maintenant le corps du délit : inutile, c’est dans le système nerveux de ceux qui sont là que la négation préalable opère. Vous pouvez accumuler des blasphèmes ou des obscénités inouïes, pousser des grognements à peine articulés pendant trois heures, publier une montagne de vice ou de scatologie, même résultat de torpeur, même indifférence. Pour boucler la boucle, il suffira de traiter le premier qui dira ce que je viens de dire de paranoïaque. Le pauvre Rushdie, par exemple, n’a nullement diffamé le Prophète : le Prophète fonctionne désormais comme paravent local du crime organisé, lequel se moque pas mal du sacré sous toutes ses formes. La condamnation à chaque instant du racisme ou de l’antisémitisme, pour sincère qu’elle soit, relève d’un détournement d’attention identique, de même que la prétendue lutte contre la drogue ou la séduction des mineurs. Sade est en vente libre ? Et alors ? Le Pape va nous ramener à l’obscurantisme ? Allons donc. Quand on contrôle directement la physiologie et les cerveaux, à quoi bon s’inquiéter des livres ? Il suffit d’organiser la non-lecture en visant sur la vente massive et la paresse mégalomaniaque du narcissisme humain. Chaque différence est taboue, aucun effort à faire. Êtes-vous « politiquement correct » (PC) ? vous demande t-on déjà à tout propos aux États-Unis. C’est-à-dire : êtes-vous un bon homosexuel, une bonne femme, un bon malade, un bon Noir ? Prônez-vous ouvertement tout ce que la Loi falsifiée, hypocrite et ancienne sanctionnait ou ignorait ? Bien, vous êtes dans l’ordre. Et ne nous parlez pas d’une hiérarchie des valeurs ou d’un classement quelconque. Platon et Aristote, par exemple, sont de vieilles lunes (Aristote était misogyne, il n’en sera plus question dans nos cours). Des écrivains ? Lesquels ? Joyce, Kafka, Hemingway ? Dites plutôt : « Des auteurs mâles, hétérosexuels, blancs, morts. » Et ainsi de suite. Le Bien veille, on ne peut vouloir que ce Bien qui récuse l’autorité et l’oppression, tout est donc pour le mieux dans la meilleure des sociétés automatiques possibles.
Genet parlait de lui-même comme d’un pédé, mais il ne lui serait pas venu à l’idée de se présenter comme un pédé convenable. Il aurait trouvé ahurissant de vouloir être garanti ou respecté par la Loi, sauf pour la tourner davantage en dérision. Les revendications des installés de l’homosexualité, comme d’ailleurs de n’importe quelle sexualité ; l’exhibition bourgeoise ou le militantisme petit bourgeois à ce sujet (la simple manie de dire « nous ») l’auraient fait hurler de rire (on peut aussi imaginer le sourire de Proust). Une société prétendant avoir absorbé son négatif (ce qui est très exactement la définition du Spectacle) ne l’aurait pas convaincu une seconde (pendant que j’écris ces lignes, un directeur de prison français vient d’être suspendu pour avoir fait subir à des détenus des « fouilles rectales poussées »). Comédien peut-être, mais ni saint ni martyr, encore moins candidat à une commémoration quelconque [7], il se serait rendu compte que personne, en définitive, ne connaissait plus ses récits. Oui, oui, le conte détaillé, concret, des aventures d’où il est sorti, et dans lequel il raconte sa vie sensible. Mais justement : le monde physique, désormais en cours d’expropriation, n’était vérifiable autrefois, avec son poids, son modelé, ses figures, son horizon de perceptions et de souvenirs, sa liturgie intime, sa présence réelle, que dans des récits et leur sens. Pour cette raison, le sens lui-même est devenu la cible de la censure (vous prétendez avoir accès au sens de votre existence ? allez donc le découvrir chez votre psychanalyste). Il n’est plus question que vous déteniez, seul, les clés de votre biographie. J’avance donc tranquillement que personne ne lit plus Notre-Dame-des-Fleurs, Miracle de la rose, Pompes funèbres, Querelle de Brest ou Journal du voleur. J’ai essayé d’en parler un jour en public. Quel froid ! Quel malaise ! Quelle consternation ! Chacun était avide de renseignements sur l’image de Genet, la façon dont il se comportait, par exemple pendant un enregistrement de télévision. Mais ce qu’il a écrit sur la prison, les macs, le meurtre, ses amants ; l’électricité du vol, de la prostitution, de la trahison ? Une autre fois, s’il vous plaît, du tact. Genet était un homme de théâtre, un pur poète, un défenseur de bonnes causes (pour les uns) ou, malheureusement, de mauvaises (pour les autres). Ses romans ? Écoutez, nous sommes pressés. Comment vit quotidiennement un écrivain ? Comment s’habille-t-il ? Et surtout : pense-t-il bien ou mal ? C’est ainsi que tout le monde se met à répéter des fiches de police, et peu importe qu’elles soient vraies ou fausses, le meilleur écrivain de l’avenir étant bien entendu le plus sage, le plus conforme, le plus photographié, le plus rentable a priori, le plus vendu d’avance, le plus soumis à sa femme, le plus désemparé, le plus appliqué, le plus moribond, voire le plus gâteux. « On me châtre, on m’opère de l’infamie. »
Genet insiste beaucoup auprès de Sartre (que cela intrigue) sur le fait que « les mots d’une œuvre littéraire ne sont susceptibles d’aucune transposition visuelle ». Ou bien ceci, dans Miracle de la rose : « À peine ce souvenir des fleurs m’eut-il visité que se précipitèrent aux yeux de mon esprit les scènes que je vais dire » (c’est moi qui souligne). Sartre souligne toujours l’ambition poétique de Genet plutôt que le romanesque de ses romans (« de faux romans ») avec, pour finir, cette déclaration de taille : « Pourquoi voudrais-je, moi, l’enterrer ? Il ne me gêne pas. » Mais bien sûr que si, Sartre, Genet vous gêne ; l’enterrement dans les formes est la grande obsession thérapeutique de votre vie ; la littérature est une névrose grave, elle a éloigné les meilleurs de la réalité historique (les familles pensaient de même, sauf qu’elles n’avaient pas le sens de l’Histoire) : il faut guérir rétrospectivement ces individus doués, comme vous avez su vous guérir vous même. Pour une telle théologie protestante en action (confession publique), Genet est le merveilleux ingénu d’une rédemption sociale. Il est malheureusement trop tard pour traiter à chaud Baudelaire, Mallarmé ou Flaubert (que d’efforts à froid, pourtant), mais voici, en chair et en os, le cas idéal. À la fin du Saint Genet, le patient va d’ailleurs nettement mieux, il a relu ses propres livres et les a trouvés « très mauvais », on le voit plus calme, plus sociable, s’intéressant à la vie de ses petits amis, devenu presque conjugal, en somme. Sartre prophétisant, dès les années cinquante, le paternalisme psychiatrique du marché actuel égalisateur ? Sombre ironie. Et voici, en prime, le retour des familles. Après une longue période de réprobation ou de franche bouderie par rapport aux agités de l’écrit, l’heure de la réconciliation a sonné. La famille Sade ouvre généreusement ses archives. La famille Artaud revendique son oncle halluciné. La famille Lacan s’affaire. La famille Foucault et la famille Barthes se concertent latéralement. Sartre et Beauvoir eux-mêmes ont leur syndicat sourcilleux. Bien entendu, la palme revient au naufrage du pauvre Althusser récupéré illico par le sémillant aïeul Jean Guitton, ami de Paul VI et nostalgique de Pétain, dont le dernier ouvrage Dieu et la Science a pulvérisé les records d’adhésion. Dieu et la Science ! Qui l’eût cru ! On pensait qu’ils étaient brouillés ! Divine surprise ! Jean-Paul II souhaite à Jean Guitton un bon quatre-vingt-dixième anniversaire (je me permets d’en faire autant) et le remercie de ce livre « écrit en collaboration avec deux savants russes » (qui connaît les charmants frères Bogdanov ne se plaindra pas que les secrétariats du Saint-Siège soient un peu débordés en ce moment). Bien : tout le monde est-il rentré dans le rang ? Ce Georges Bataille, là, n’était-il pas un peu fasciste ? Oh non, commissaire, nous le défendrons de gauche ! Et Céline ? Ah non, pas celui-là, passons. Bref, la Restauration bat son plein, les Émigrés sont de retour, les Familles sont sûres d’elles mêmes. Pendant leur absence, certes, des esprits courageux et lucides ont su louer et adopter ces génies tourmentés et trop libres, mais il est grand temps de rendre les clés aux propriétaires légitimes. Pourquoi, nous, les familles, qui avons été tellement choquées autrefois par toutes ces attitudes et ces pages sulfureuses, le serions-nous encore aujourd’hui ? Pourquoi s’opposer au sens puisqu’il a été déconstruit, pilonné, aboli ? Vous apercevez ces rangées de livres noirs sur ces étagères ? Eh bien, c’est nous. Et ces manuscrits pleins de sperme ou de sang séché, de concepts tordus, de cris étouffés, combien valent-ils à votre avis ? N’est-ce pas finalement ce qui compte ? « La Société, écrivait Sartre, s’accommode plus facilement d’une mauvaise action que d’une mauvaise parole. » C’était encore le temps, si proche et incroyablement lointain, où la Société n’était pas ouvertement celle de la corruption généralisée, laquelle doit noyer d’abord les mauvaises paroles. La mafia dégouline de bonne pensée, et pour cause : la mort est sa loi, qui se passe de toute narration. Genet avait eu cette perception étrange en passant par l’Allemagne nazie : dans « un camp organisé par des bandits », « chez un peuple de voleurs », le scandale était impossible, « je volais à vide », dit-il. Plus tard, c’est d’écrire à vide qu’il a sûrement eu l’impression. L’ambition de la nouvelle Loi, j’en sais quelque chose, n’est rien d’autre, à la limite, que de vous faire oublier à vous-même ce que vous avez écrit. Les familles, autrefois, étaient au moins tenues en respect par le sentiment confus de leur ignorance. Mais si tout le monde, y compris dans la représentation du savoir, est devenu ignorant ? Pourquoi se gêner ? Quelle sanction redouter ?
La passion qui consiste à vouloir désenchanter, désacraliser, laïciser à tout prix, n’a rien de désintéressé, on s’en doute : elle annonce simplement, avec nervosité et à son insu, une transformation de l’économie politique. Là où les formes traditionnelles s’effondrent (par exemple, ces temps-ci, au Japon), la criminalité légale prospère immédiatement (en revanche, dans une Italie décomposée, la vitalité du Vatican, elle, est logique). Or les livres de Genet sont des livres enchantés. Ce voleur vivant pauvrement, même devenu riche, est le contraire d’un truand financier. Ce pédé est à l’opposé de l’homosexuel institutionnel. Ce traître définitif n’a rien de commun avec un diplomate à contrats. Il doit donc être oublié, lui et sa prose, comme tant d’autres. Comme tous ceux qui ont vécu dans leur style ce qu’ils ont écrit, ou, pire, qui sont allés jusqu’à vivre certaines situations dans la seule perspective de leur style. Dire en faisant, faire en disant d’une certaine façon ? Une telle activité sera de plus en plus incompréhensible. Comment, vous soutenez que ces gens ont joui dans le langage ? Dans son intérieur même ? Nous ferons en sorte que cela ne se renouvelle plus. Ce que Genet a de particulièrement choquant ? La prolifération, dans son écriture, des métaphores eucharistiques (même si c’est pour en retourner la signification). Fontevrault ? « Ses murs conservaient — la custode conservant le pain — la forme même du futur. » Le tube de vaseline du Journal du voleur ? C’est l’objet d’abjection et de gloire qui, comme un ostensoir, révèle non pas l’absurdité du monde mais le triomphe caché de celui qui y est jeté. « J’étais en cellule. Je savais que toute la nuit mon tube de vaseline serait exposé au mépris — l’inverse d’une Adoration Perpétuelle — d’un groupe de policiers beaux, forts, solides... J’étais sûr que ce chétif objet si humble leur tiendrait tête, par sa seule présence il saurait mettre dans tous ses états toute la police du monde, il attirerait sur soi les mépris, les haines, les rages blanches et muettes, un peu narquois peut-être — comme un héros de tragédie amusé d’attirer la colère des dieux — comme lui indestructible, fidèle à mon bonheur et fier. » La morale voluptueuse de Genet est lisible dans chacune de ses phrases :« Un temps je vécus du vol, mais la prostitution plaisait davantage à ma nonchalance. » « De la beauté de son expression dépend la beauté d’un acte moral... Quelquefois la conscience avec laquelle nous aurons pensé un acte réputé vil, la puissance d’expression qui doit le signifier, nous forcent au chant. » Genet décrit l’opposé d’une nausée mélancolique, une extase permanente, au contraire, sorte de messe, d’action de grâces ou d’absolution gratuite. Un extrême bonheur respire dans sa façon d’être et de se parler, un frisson qui, dit-il chaque fois, signe sa rupture avec l’humanité entière. Le voici, et c’est sans doute l’explication de tout, entrant dans son nom :
« Quand je rencontre dans la lande des fleurs de genêt, j’éprouve à leur égard une sympathie profonde. Je les considère gravement, avec tendresse. Mon trouble semble commandé par toute la nature. Je suis seul au monde, et je ne suis pas sûr de n’être pas le roi — peut-être la fée — de ces fleurs. Elles me rendent au passage un hommage, s’inclinent sans s’incliner mais me reconnaissent. Elles savent que je suis leur représentant vivant, mobile, agile, vainqueur du vent. Elles sont mon emblème naturel, mais j’ai des racines, par elles, dans ce sol de France nourri des os en poudre des enfants, des adolescents enfilés, massacrés, brûlés par Gilles de Rais. » La France de Genet, comme celle de Villon, est le lieu d’une transsubstantiation invisible, radioactive, irrécupérable. Déjà, à propos du tube de vaseline : « Je voudrais trouver les mots les plus neufs de la langue française afin de le chanter. » On comprend qu’il faille vite guérir cette clarté musicale illuminant jusqu’à l’acte le plus sale, le plus condamnable ; qu’il soit urgent d’enterrer ce geste d’approbation suspect : « J’arrivai la nuit à Alicante. Je dus m’endormir dans un chantier et vers le matin j’eus la révélation du mystère de la ville et du nom : au bord d’une mer tranquille et s’y plongeant, des montagnes blanches, quelques palmiers, le port et, dans le soleil levant, un air lumineux et frais (à Venise je retrouverai un moment pareil). Le rapport entre toutes choses était l’allégresse. » Assez ! Coupez le son ! Allons, Genet, au trou ! Dirai-je, moi, d’ailleurs, comment je l’ai connu et ce qu’il m’a dit ? Mais non, je préfère de beaucoup le lire, puisque tout se ramène désormais à cette incitation clandestine : « La France est une émotion qui se poursuit d’artistes en artistes, sortes de neurones de relais. »
Dans une note très importante de son Saint Genet, Sartre écrit : « Ou la morale est une faribole ou c’est une totalité concrète qui réalise la synthèse du Bien et du Mal. Car le Bien sans le Mal, c’est l’Être parménidien, c’est-à-dire la Mort ; et le Mal sans le Bien, c’est le Non-Être pur. » Cette identification de « l’être parménidien » avec la mort est stupéfiante. On pourrait montrer, en cascade, pourquoi elle constitue un contresens fondamental sur l’enjeu de toute la métaphysique (l’être, le néant et le reste). En vérité, on est au cœur du problème que pose Genet (ou la littérature en général) au clergé philosophique. Genet n’est pas dialectique comme il conviendrait de l’être ? En effet. Il s’oppose, par principe, à toute société ? Bien sûr, mais ni plus ni moins que les écrivains conscients de chaque siècle, et, au vingtième siècle, ni plus ni moins que Proust, Kafka, Joyce, Artaud, Céline. Le Non-Être, pour eux, est la Société elle-même, quelle qu’elle soit, et surtout lorsque, devenue Spectacle intégral, elle a la bonne idée de nous renseigner enfin sur sa nature. Dire, à la Parménide, que le non-être n’est pas, est donc, pour ces expérimentateurs de la pensée et du langage de l’être une nécessité radicale. « À vrai dire, écrit Sartre, les collectivités se défendent aussi longtemps qu’elles le peuvent contre les images : on charge des spécialistes nommés "critiques" de retarder leur admission. » Du moins en allait-il ainsi dans l’ancien système, avant la tentative actuelle de liquidation. Mais, pour Sartre, la Société est le seul lieu envisageable de l’être, et, d’ailleurs, que serait un philosophe, fût-il Heidegger, qui ne parlerait pas en fonction d’une communauté ? En revanche, l’écrivain, même s’il a la ruse de le dissimuler, est seul. Il est dans la solitude d’une Passion (c’est Sartre, avec justesse, qui insiste sur cette dimension christique). Il peut aller jusqu’à démontrer qu’il a « raison d’avoir tort ». Vous ne le prendrez pas au piège d’une dialectique communautaire, et pour cause, puisqu’il construit des « tourniquets » où le vrai et le faux, la vie et la mort, le bien et le mal, Dieu et le Diable, échangent sans cesse leurs fonctions et leurs places. En quoi, loin d’être une auto-négation (Sartre ne fait que reprendre ici Blanchot et toutes les théories terroristes du langage), la littérature reste au plus près de la description du non-être social en train de faire semblant d’être. Il s’ensuit qu’elle est très surveillée, ou, pour parler comme Hamlet, « terriblement suivie ». Sartre le reconnaît à propos de Pompes funèbres : on se trouve « embarqué dans le plus extraordinaire mélange de tragique et de pitrerie, de tendresse et de sadisme ». Sur quoi, il conclut : « Résultat : zéro. L’ouvrage s’annule : il n’y avait que des feuilles mortes. » Bien entendu, il n’en est rien, et c’est peut-être en repensant à ce jugement que Genet a écrit plus tard à propos des Frères Karamazov : « Il me semble, après cette lecture, que tout roman, poème, tableau, musique qui ne se détruit pas, je veux dire qui ne se construit pas comme un jeu de massacre dont il serait l’une des têtes, est une imposture. » Cela dit, Sartre perçoit bien le danger : Genet, contrairement aux romanciers du dix-neuvième siècle (Tolstoï, par exemple), n’invente pas pour écrire, il « écrit pour inventer », pour « se recréer ». Le pacte social, son contrat de représentation, risque donc d’être rompu, et du même coup retardée la réconciliation de la Société avec elle-même. Cette réconciliation pourra-t-elle d’ailleurs avoir lieu un jour ? Le marxisme nous l’a dit, mais on connaît les résultats. Pourtant, c’est ce que toute métaphysique doit affirmer (y compris celle se voulant « finale » du Spectacle) sous peine de contredire sa propre logique. Un écrivain, lui, manifeste exactement le contraire : c’est un élément de discorde, non récupérable, par définition, par le non-être social. La Société ? Elle est fondée sur un crime commis en commun, dit Freud, et le reste s’ensuit. Totem et tabou est un livre à relire, ne serait-ce que pour éclairer ce que peut être un fils qui ne joue pas le jeu des frères par rapport au père, ce qui lui vaudra, de leur part (comme de leurs femmes auxquelles, finalement, la Société les réduit), une leçon constante de paternalisme. Un écrivain radical (Proust, Joyce, Kafka, Artaud, Céline, Genet) est toujours un criminel qui révèle le crime enfoui commis en commun (c’est le « bond hors des meurtriers » de Kafka), un criminel quant au crime. C’est un père suspect, un fils ayant absorbé sa mère, un très mauvais frère, un perturbateur-né de filles ou de sœurs. Un expert de la mort en vie, ni vivant ni mort, trop vivant, trop mort, bref quelqu’un qui, comme par hasard, prouve que l’Être n’a rien à voir avec le Non Être. Platon et Hegel ne s’y retrouvent pas ? Tant pis. Et chaque fois qu’une incarnation littéraire un peu forte et complexe aura lieu, on peut parier qu’il y aura un fonctionnaire philosophe qui surgira sur la scène pour expliquer — sans toujours avoir, hélas, le génie de Sartre — que ladite incarnation est conjoncturelle, transitoire, symptomatique, et qu’on peut la réincarner en problématique sociale, morale ou métaphysique, c’est-à-dire la comprendre pour la surplomber. Un écrivain dérègle les axiomes, les évidences de contradiction et d’identité. Chez lui, le même est l’autre ; l’autre est le même ; une chose peut être elle-même, et son contraire ; rien n’est jamais à sa place, ni figé, ni exclu ; les situations, les personnages, les discours peuvent s’échanger, se compénétrer, se détruire pour exister davantage ; en somme, dans cette étrange substance, la féminité circule, mais est-elle fausse, vraie ; ni fausse, ni vraie ? L’identité en jeu n’est pas ici celle de la Métaphysique, et c’est pourquoi elle ne cessera pas d’inquiéter : elle vient de plus loin et de plus près ; elle va plus loin et plus près.
En 1949, Cocteau et Sartre demandent la grâce de Genet au président de la République. La référence à Villon n’est pas oubliée. Sont pour la grâce, entre autres : Colette, Picasso, Claudel (oui, Claudel, vous avez bien lu). Sont contre : Camus, Aragon, Eluard. Genet sera gracié et préfacé par Sartre. À Cocteau, à qui il doit tant, il écrira un jour qu’au fond lui, Cocteau, ne s’est occupé que de cinéma industriel. De Sartre, si attentif, il mettra une sorte d’obstination à dire qu’il ne compte plus en politique. Quel est alors l’homme que Genet a le plus admiré ? Giacometti. Le seul ? lui demande-t-on. Oui, répond-il, le seul [8]. Un écrivain, un sculpteur. Beaucoup de silence. Le silence plastique de fond, en trois dimensions, atteint directement la question de l’Être (comme j’ai essayé de le montrer au sujet de Rodin). Mais dans une Société, la nôtre, où l’expérience intérieure est de plus en plus interdite et où l’art n’est plus que décoration ou animation culturelle, l’approche de son propre corps, de tous les côtés à la fois, deviendra de plus en plus une rareté sensationnelle. C’est pourquoi les romans de Genet, avec leur ralenti spécifique, leur insistance sur les détails, les attitudes, les gestes, les démarches, les situations-limites, sont déjà sous censure presque complète. Ce n’est pas le sujet du récit qui est en cause (la pornographie homosexuelle, etc.) mais la dilatation précise du récit lui-même. « Genet écrit pour inventer » : en effet, il ne fait pas semblant de ne pas écrire, il rappelle sans cesse que son corps est là, en train de tracer ces mots. Or c’est cette invention simultanée d’un volume physique et verbal — cette incarnation — qui, dans le spectacle en deux dimensions permanent (publicité, feuilleton, magazine) représente l’insupportable lui-même. Incarnation dans l’invisible, que seule l’écriture voit et touche. Il s’agit d’un acte poursuivi jusque dans la contemplation. Les romans de Genet sont, de part en part, des romans d’actions. Les souvenirs, les fantasmes, les hallucinations, les fascinations pour telle ou telle apparence physiologique sont immédiatement agis dans les phrases conçues comme des mises en scène. Ce sont les situations de Genet qui sont importantes, non pas leurs conséquences morales (mais il y a une morale incessante des situations).
La littérature réellement engagée du vingtième siècle, il faut le répéter, a donc pour noms Proust, Kafka, Joyce, Artaud, Céline, Genet. L’invention corporelle est sa loi, ce qui revient à refuser tout dogme fondé sur un mannequin préalable. Sa nouveauté formelle est pourtant classique. Sa modernité s’inscrit au cœur de la tradition. Ses équivalents plastiques, avec les mêmes caractéristiques, s’appellent Picasso, Giacometti ou Francis Bacon. Cette littérature produit, par contrecoup, ses doublures puritaines évacuant d’un même mouvement — ou atténuant au maximum — l’effervescence sexuelle, le sens, le lyrisme et l’Histoire (par exemple, ce qu’on aura appelé le « nouveau roman »). C’est dans cette littérature-là, et non dans les productions réalistes socialistes, naturalistes, surréalistes, bourgeoises, mondaines ou formalistes, qu’on pourra indéfiniment lire la geste de notre temps, ses prétentions, ses répressions, ses camouflages sociaux, économiques, politiques. Par la seule force des situations et des images, nous aurons, sur nos mensonges et nos dissimulations, l’instruction qui convient. Par rapport à cet immense champ de vérité, que d’inhibitions ou de phobies déguisées en minimalisme, que de légèretés maniérées, que d’angoisses et de mélancolies futiles, quelle pruderie de base, quel conformisme. Misère de la littérature, disent certains. Mais ce sont précisément les mêmes qui ne veulent ou ne peuvent pas lire Proust, Céline, Genet, etc. Par crainte du futur révélant le présent, on organise ainsi, dans l’affairement et la fausse plainte, l’oubli sourdement désiré du passé.
Déjà, dans l’analyse de Sartre, le romanesque propre à Genet a tendance à s’évaporer. Il est surtout question du Bien, du Mal, de l’Être, du Non-Être, de leur dialectique affolée par une écriture. D’autres docteurs sont venus, toujours aussi nihilistes : la littérature aurait pour essence sa propre disparition, la vérité ne pourrait pas toute se dire (mais pourquoi ?), ou encore, pour finir, dérobade précieuse : je vous dirai plus tard, peut-être (mais ce ne sera jamais vraiment le moment), ce que tout cela veut dire. La pensée a peur de cette pensée. Par défaut, on recherchera donc la correction sociale et politique, Genet, de son côté, n’ayant pas manqué, bien entendu, de se montrer incorrect jusqu’au bout. Il y a différentes façons d’être dans son tort, chacun son style. D’ailleurs, le style suffit, il est déjà une trahison de la bonne pensée sociale, il vous fait presque aussitôt passer pour un imposteur ou un salaud. Inversement, il ne suffit pas d’être un salaud pour avoir du style, contrairement à ce que croit la bonne pensée sociale toute prête à accorder du crédit littéraire (ça l’arrange) à des salauds au langage boursouflé et nul. Il faut que votre mauvaise réputation soit la conséquence de vos écrits et non de vos actes, débrouillez-vous. Sartre le voit bien : l’existentialisme de Genet n’est pas un humanisme, mais une variante insolite de la Théologie en mouvement, et, qui plus est, catholique : grâce incongrue, miracles bizarres, convocation et jugement des corps. Si les romans de Genet sont occultés, peu lus, mal étudiés, c’est aussi à cause de ce spectre qui, sans arrêt, les hante.
Mais voilà : les vertus antithéologales de Genet — le vol, la trahison, l’homosexualité — sont aussi impartageables, comme telles, par des criminels professionnels, que la foi, l’espérance et la charité le seraient entre l’écrivain qui les pratiquerait et un dévot ou une dévote. D’où l’intérêt de la démonstration. Il s’agit du vol pour Genet, de la trahison pour lui, de l’homosexualité pour lui, et lui seul. Foi, espérance, charité, vol, trahison, homosexualité, quel brouillard. « L’homosexualité », surtout, est trompeuse, comme s’il n’y en avait qu’une, ce qui permet d’imaginer qu’il n’y aurait qu’une hétérosexualité. Bavardages que Proust, déjà, dérègle, et que Genet interrompt brutalement, c’est le moins que l’on puisse dire. Quoi qu’il en soit, Dieu, dont les voies sont, comme on sait, impénétrables, peut donc se manifester à l’envers (c’est une mauvaise nouvelle pour les croyants de l’endroit sans envers, ou de l’envers sans endroit). « Le secret de la Providence, écrit Sartre, n’est rien d’autre que la sentence du Groupe, mais à l’envers... Genet et M. Mauriac sont d’accord : Dieu visait Genet à travers la condamnation sociale. » Dieu a même, c’est évident, une préférence pour Genet, et c’est cela, surtout, qui parait étrange à Sartre. Le Groupe, en effet, peut être très indulgent pour le marginal ou le turbulent à condition que ses écrits soient finalement sentimentaux ou conventionnels. Il sera, en revanche, troublé jusqu’à la moelle s’il constate que le Bien se promène dans le Mal sous forme d’éthique sévère de la composition esthétique. Sartre encore : « Le Mal veut l’échec du méchant, le Mal veut du mal au Mal... C’est ce qu’il faut entendre par la formule de Claudel : "Le Mal ne compose pas". » Bien vu. Or Genet compose, c’est même un virtuose de la composition, raison pour laquelle le Bien et le Mal de la religion laïque sont en grand péril : « Genet vole le nom que se donne la Société sacrée et la retourne contre la Société laïque. » Cela consiste sans doute, comme le dit Genet lui-même, à avoir « une certaine disposition naturelle à la féerie ».
Écoutons Genet : « La nuit, je sifflais. La mélodie était religieuse . Elle était lente. Le rythme en était un peu lourd. Par lui je croyais me mettre en communication avec Dieu : c’est ce qui se produisait, Dieu n’étant que l’espoir et la ferveur contenus dans mon chant. Par les rues, mes mains dans les poches, la tête penchée ou levée, regardant les maisons ou les arbres, je sifflais mes hymnes maladroits, non joyeux, mais pas tristes non plus, graves. Je découvrais que l’espoir n’est que l’expression qu’on en donne. La protection, de même. Jamais je n’eusse sifflé sur un rythme léger. Je reconnaissais les thèmes religieux : ils créent Vénus, Mercure ou la Vierge. » Ou encore : « Accroupi dans mon coin d’ombre, j’étais stupéfait d’être sous le ciel étoilé qu’avaient vu Alexandre et César, quand je n’étais qu’un mendiant et un voleur paresseux. J’avais traversé l’Europe avec mes moyens qui sont l’envers des moyens glorieux, pourtant je m’écrivais une secrète histoire, en détails aussi précieux que l’histoire des grands conquérants. » Il y a une Europe de Genet (Espagne, Pologne, Tchécoslovaquie, Slovénie, Hollande, Belgique, Italie, Autriche), qui n’est autre que celle des Illuminations de Rimbaud en train d’être engloutie par une barbarie dont nous voyons encore les effets. C’est une Europe des frontières, des exclus, des prisons, de la marche au hasard dans des paysages métamorphosés en tapisseries merveilleuses ; une Europe « des objets et des circonstances », où la misère, le vice, les complicités passagères, la lutte pour la survie se déploient dans une expérience dont les nantis n’auront jamais l’idée. Voilà pourquoi je m’obstine à parler d’une physique de Genet, minutieuse, instantanée, gravée, mélodieuse ; d’une pratique de l’espace et du temps en fonction du corps contraint de s’y recréer. Le vol ? « Je me pense du talon à la nuque. J’accompagne l’onde. » Ou bien : « Quels gestes pour aller plus vite ? Les plus lourds, les plus lents. » Ou encore : « Ce n’est plus mon cœur mais tout mon corps qui bat. Je ne suis qu’une immense tempe, la tempe bourdonnante de cette chambre pillée. » Genet, sur la pointe des pieds, opère à cerveau ouvert. Le mot tempe est admirablement choisi pour dire sa position d’effraction. D’un garçon qui ne saurait être voleur, il dira que sa nature n’est pas religieuse, que son allure n’est pas furtive, bref qu’il est pudique. Le corps qui s’éprouve en situation limite est spontanément religieux. En Espagne, pour se reposer, Genet entre dans les églises que, très jeune, nous dit-il, il rêvait de cambrioler. « À la messe du matin, en état de péché mortel, je communiai. » Mais le voici d’habitude : « Pour conserver la limpidité, l’acuité de mon regard, ma conscience doit effleurer tout acte afin que je puisse vite le corriger, changer sa signification. Cette inquiétude me tient en éveil. Elle me donne l’attitude étonnée du chevreuil arrêté dans sa clairière. » Si la propriété est un vol caché, le vol et la lettre volée ramènent au corps propre, par l’opération d’une animalité chassée qui chasse à son tour. Nier l’animalité capable de savamment se parler telle est la fonction sociale. On échappe à cette négation en se laissant couler tout en bas de l’échelle, en trahissant, en s’évadant, en inventant sa propre contre nature, en passant, en pensant : « Trop de gens, me disais-je, pensent et qui n’en ont pas le droit. Ils ne l’ont pas payé d’une entreprise telle que penser devient indispensable à votre salut. » On doit attendre de la pensée qu’elle vous sauve et, à vrai dire, il n’y a pas de raison plus raisonnable d’ouvrir un livre : que l’auteur nous raconte donc comment il s’est sauvé, et cela suffit (Journal du voleur est un de ces livres).
Sartre a donc raison : Genet « parle de sa vie comme un évangéliste, en témoin émerveillé ». Ou encore il est « le Saint-Simon d’une cour des miracles ». Mais la position de l’évangéliste et celle du chroniqueur aristocratique du cancer social ne sont pas incompatibles, au contraire. C’est même la définition d’un rapport romanesque décisif à la vérité : révélation d’une complicité de nature entre Loi et Mensonge, Police et Crime. Notre siècle en a produit une figure monstrueuse et inédite : « Les Allemands seuls, à l’époque de Hitler, réussirent à être à la fois la Police et le Crime. Cette magistrale synthèse des contraires, ce bloc de vérité étaient épouvantables, chargés d’un magnétisme qui nous affolera longtemps. » Et ceci :« Policiers et criminels sont l’émanation la plus virile de ce monde. On jette sur elle un voile. Elle est ses parties honteuses qu’avec vous, cependant, j’appelle les parties nobles. » Un Évangéliste, Saint-Simon, Proust, Kafka, Artaud, Céline, Genet... Eux ne font pas comme si le diable n’existait pas. « Mercure, m’a-t-on dit, chez les anciens était le dieu des voleurs qui savaient ainsi quelle puissance invoquer. Mais nous, nous n’avons personne. Il paraîtrait logique de prier le diable, aucun voleur ne saurait le faire sérieusement. Pactiser avec lui serait profondément s’engager, tant il s’oppose à Dieu qu’on sait être le vainqueur définitif. L’assassin lui-même n’oserait prier le diable. » Dieu et le diable sont des réalités physiques en situation. La « sainteté » variable de Genet est d’abord « un endroit au fond de mon corps où je veille, où j’épie sous forme de petite flamme ». On peut se souvenir de Rimbaud, dans Une saison en enfer : « Les saints ! des forts ! des anachorètes, des artistes comme il n’en faut plus ! »
Tout homme aura peut-être éprouvé cette sorte de chagrin, sinon la terreur, de voir comme le monde et son histoire semblent pris dans un inéluctable mouvement, qui s’amplifie toujours plus et qui ne paraît devoir modifier, pour des fins toujours plus grossières, que les manifestations visibles du monde. Ce monde visible est ce qu’il est, et notre action sur lui ne pourra faire qu’il soit absolument autre. On songe donc avec nostalgie à un univers où l’homme, au lieu d’agir aussi furieusement sur l’apparence visible, se serait employé à s’en défaire, non seulement à refuser toute action sur elle, mais à se dénuder assez pour découvrir ce lieu secret, en nous-même, à partir de quoi eut été possible une aventure humaine toute différente. Plus précisément morale sans doute. Mais, après tout, c’est peut-être à cette inhumaine condition, à cet inéluctable agencement, que nous devons la nostalgie d’une civilisation qui tâcherait de s’aventurer ailleurs que dans le mensurable. C’est l’œuvre de Giacometti qui me rend notre univers encore plus insupportable, tant il semble que cet artiste ait su écarter ce qui gênait son regard pour découvrir ce qui restera de l’homme quand les faux-semblants seront enlevés. Mais à Giacometti aussi peut-être fallait-il cette inhumaine condition qui nous est imposée, pour que sa nostalgie en devienne si grande qu’elle lui donnerait la force de réussir dans sa recherche. Quoi qu’il en soit, toute son œuvre me paraît être cette recherche que j’ai dite, portant non seulement sur l’homme mais aussi sur n’importe lequel, sur le plus banal des objets. Et quand il a réussi à défaire l’objet ou l’être choisi, de ses faux-semblants utilitaires, l’image qu’il nous en donne est magnifique. Récompense méritée, mais prévisible."
Jean Genet, L’atelier d’Alberto Giacometti, 1963.

Je revois les livres que j’avais sur ma table en écrivant Portrait du Joueur : Le Joueur de Dostoïevski, Portrait de l’artiste de Joyce, Journal du voleur. Je revois aussi le visage de Genet tel que Giacometti l’a saisi : boule d’énergie angélique, effrontée, lancée comme de l’intérieur d’elle-même. On entend immédiatement ange dans Jean Genet, négation d’un côté (je n’ai, je n’est), naissance de l’autre (je nais). Tête de boxeur soulevée, donc, riante, douce, sarcastique, s’avalant par petits coups vers le haut, diction comme des séries de crochets du gauche. Une grande obstination, une grande concentration. Une grande volonté dansante. Ce n’est pas par hasard si l’on trouve dans ses livres les plus belles pages de la littérature sur le corps masculin, si interdit, au fond, si peu traité par les écrivains sinon par les sculpteurs et les peintres. Pourquoi cette absence ? Cette timidité ? Les hommes, finalement, sont les grands inconnus du roman (il faut faire une exception pour Melville, dont Genet, souvent, est si proche). Leur sexualité est rarement décrite, comme si nous savions a priori de quoi il retourne. Genet est parfois direct (« il banda »), mais la plupart du temps précautionneux, en attente, précis et complexe dans son observation, son dessin, ses couleurs. De même que Braque aurait été dans l’embarras pour peindre une femme nue, voyez Matisse : pas d’homme, ou alors une simple planche verticale (La Conversation), ou encore une stylisation symbolique (saint Dominique). L’incarnation est difficile. Elle est tellement repoussée, scandaleuse, qu’il faut la reprendre de très bas, mendiants, forçats, voleurs, marins, marginaux ou déchets sociaux, comme on dit. Giacometti savait cela. C’est pourquoi Genet l’aime. Et, de Genet, on ne peut oublier ses portraits de Stilitano, Armand, Guy, Lucien, Java (Journal du voleur), Érik, Paulo, Riton (Pompes funèbres), Querelle, Robert, Nono (Querelle de Brest). On dit que ce ne sont pas de vrais « personnages » mais des projections de Genet lui-même : cela est très faux. Ses récits sont peuplés de portraits différenciés. Chacun a son détail central (le crachat de Stilitano, les mains d’Armand, etc.), l’attention de Genet est extrême (« Toute grimace, si on l’observe avec minutie, se révèle composée d’une multitude de sourires, comme la couleur de certains visages peints contient une multitude de teintes »). Mimiques, cristaux d’attitudes, radiographies, pénétrations à l’intérieur des sujets pour dire ce qu’ils sentent et sont incapables de penser, Genet travaille en modeleur, le roman est pour lui un art, la prétendue « liberté des personnages » n’est pas son affaire, il serait plutôt d’avis, contre Sartre, que Dieu est un artiste à qui le diable prête main forte pour les reliefs saisissants. Ses comparaisons sont toujours inattendues (« De Java, Stilitano avait la démarche en bloc, un peu chaloupée, fendant la bise, et s’il se lève pour partir, si Java se déplace, j’ai cette émotion que j’éprouve quand sous mes yeux passe, démarre en silence et en douceur une automobile de grand luxe »). C’est cette attention extralucide qui permet à Genet d’éclairer la bouffonnerie d’horreur qu’est notre tragédie historique. Qui, à part Chaplin (Le Dictateur) et Picasso (Songes et mensonges de Franco) a mieux révélé de quoi se nourrit inconsciemment le fascisme ? Quoi ? La sinistre machinerie hitlérienne se résoudrait à un accouplement sexuel réversible entre une vieille folle et un voyou ? La clé diabolique et cloacale du monde serait celle de ce coït anal ? Nous voilà loin de Corydon, mais de nouveau tout près de Sade, avec une dimension de grotesque qui n’appartient qu’à Genet (mais qui lui vient aussi de Proust). C’est d’ailleurs cette dimension clownesque qui rend la narration plus terrible.
Céline, à chaque instant, veut subjuguer son lecteur, le submerger, le convaincre, l’entraîner avec lui : le lecteur est un abruti, soit, mais l’auteur et lui appartiennent à la même espèce. Avec Genet, rien de tel, pas de convivialité. Le lecteur, c’est vous, là-bas, toujours de l’autre côté du mur infranchissable. Vous n’y êtes pas, vous n’y serez jamais, car vous ne pouvez que refuser une incarnation aussi dérangeante. Vous aspirez au Pouvoir, donc à l’abstraction, à l’élimination des corps singuliers, à leur enfermement. Genet, lui, ne croit pas à la mort, il ne s’y résigne pas. La mort n’est pas une loi universelle, c’est un crime que la Société veut, entretient, maquille. Il s’en fera donc l’ordonnateur inversé, le metteur en scène vampirique et lyrique. « Le coït, remarque Sartre, est la mort de l’être aimé systématiquement poursuivie. » Oui, mais le Pouvoir réalisé n’aime personne, c’est la mort à l’œuvre qui n’a plus besoin d’aucun corps. « Je me demande pourquoi, écrit Genet, la Mort, les stars de cinéma, les virtuoses en voyage, les reines en exil, les rois bannis, ont un corps, un visage, des mains. » En effet, ils pourraient aussi bien s’incarner dans une boîte d’allumettes. Hitler sodomisé, c’est ce qu’il y a de plus vrai à en dire et, dès lors, sa sarabande infernale s’effondre. Le pape, lui, est plus fort. Ainsi dans la pièce de Genet, Elle : « Le pape (psalmodié) : En effet, me dis-je, s’il suffit que notre intervention — et la plus anodine — sanctifie n’importe quelle image, n’importe quoi sera notre image... Soit. J’établis que n’importe quel objet pourrait me représenter. Si n’importe quel visage, épaule, tempe, peuvent être du Pape, n’importe quoi le sera tout entier. Je cherchai quel objet donnerait de nous et de notre auguste absence une idée juste. Je songeai d’abord à un dé à coudre, à une girafe en peluche, à une brosse à habit, — notre humilité ne le dédaignant pas — à ce mégot caché — oui, nous eûmes l’idée que dès qu’un mégot est foutu en l’air, il devient le Pape et a droit aux égards pontificaux. Nous allâmes plus loin, et jusqu’à cette idée que nous-même n’étant pas, c’est un rien qui nous représenterait le mieux. » Telle est la révélation existentielle de Genet, il en parle dès Journal du voleur : « Découvrant le sens singulier de chaque chose, l’idée de numération m’abandonnait [c’est moi qui souligne]... Ainsi crois-je me souvenir que j’eus la révélation d’une connaissance absolue en considérant, selon le détachement luxueux dont je parle, une épingle à linge fixée sur un fil de fer. L’élégance et la bizarrerie de ce petit objet connu m’apparurent sans m’étonner. Les événements eux-mêmes, je les perçus dans leur autonomie [je souligne encore]. Le lecteur devine comme une telle attitude pouvait être dangereuse dans la vie que je menais, où je devais veiller chaque minute, risquant d’être pris si je perdais de vue le sens usuel des objets. » Ici, Genet s’amuse, il fait comme si le lecteur comprenait ce qu’il veut dire, alors qu’évidemment il n’y comprend rien. Il est peu probable qu’un voleur se perde dans une extase devant une épingle à linge, et d’ailleurs un voleur ne lit pas. Quant au lecteur, qui n’est pas un voleur, à supposer qu’une épingle à linge lui donne accès à une expérience de l’Être, il ne saura que faire de cette illumination, à moins de la transformer en vague évocation poétique. L’épingle à linge de Genet est une métamorphose active de la madeleine de Proust, ou encore un exercice spirituel à la Rimbaud, mosquée à la place d’une usine. Genet, c’est l’évidence, et c’est la raison du trouble qu’il provoque, continue le plus naturellement du monde le roman rimbaldien : « Encore tout enfant, j’admirais le forçat intraitable, sur qui se referme toujours le bagne ; je visitais les auberges et les garnis qu’il aurait sacrés par son séjour ; je voyais avec son idée le ciel bleu et le travail fleuri de la campagne ; je flairais sa fatalité dans les villes. Il avait plus de force qu’un saint, plus de bon sens qu’un voyageur — et lui, lui seul ! pour témoin de sa gloire et de sa raison » (Une saison en enfer). Il est étrange que Sartre ne relève pas cet enchaînement avec Rimbaud (mais aussi avec Lautréamont et Baudelaire). Avec désinvolture, Genet parle bien de « connaissance absolue ». Notons qu’il s’agit de la perte de la signification usuelle des objets et de la suite des événements, d’une discontinuité éprouvée non dans l’absurde ou le non-sens mais dans une « éclatante lucidité ». Genet est déconditionné par rapport au Spectacle, il ne cesse de s’en flatter, comme il ne cesse de s’étonner de la passivité humaine et de la haine somnambulique qu’elle entraîne contre le mâle incarné, surtout s’il apparaît humilié (c’est-à-dire christique). Genet volera donc à son secours, contre tous. Ainsi dans la scène capitale vécue au cinéma dans Pompes funèbres : nous sommes en 1944, à la libération de Paris, le jeune ami communiste de Genet, Jean Decarnin, vient d’être tué sur une barricade. Genet, en pleine dérive lyrique et hallucinée de deuil, entre dans un cinéma, regarde les actualités et voit sur l’écran l’image d’un jeune milicien arrêté : « Aux yeux féroces de la foule, désarmé, sale, éperdu, titubant, ébloui, vidé, lâche (c’est étonnant comme certains mots arrivent vite sous la plume afin de définir certaines natures et le bonheur que l’auteur lui-même éprouve à pouvoir parler ainsi de ses héros), las, le gamin était ridicule. » Le roman se construit ici immédiatement contre la salle de cinéma, on pourrait dire : contre le cinéma lui-même. Devant cette image du traître arrêté, une femme, non loin de Genet, hurle à la mort (à quelle mort hurlait-elle deux ans avant ?) : « La salle ressemblait à la femme. Elle haïssait mal. » Genet va donc aimer ce qui est mal haï : le personnage de Riton est né. Pompes funèbres, roman qu’on ne lâche pas, puisqu’il est à chaque instant une opération de « sorcellerie », de « magie » (magie noire contre magie noire), nous apprend bien des choses sur la France de ce temps-là, donc d’aujourd’hui ; sur son secret de polichinelle et son refoulé national. Genet sait donc ce qu’il fait en racontant comment, après avoir sodomisé Decarnin, il lui trace, avec le sang qui s’en est suivi, dans un geste d’espièglerie et de tendresse, une croix gammée sur la joue gauche, et, sur la joue droite, une faucille et un marteau. Voilà qui va plus loin que de longs discours au sujet du pacte germano-soviétique ou du dépeçage de la Pologne. Le nazisme, le stalinisme, c’était donc cela ? Un énorme truc ? Un pays entier, à quelques rares exceptions, y aurait souscrit sans vouloir le savoir, sous prétexte de travail, de famille, de patrie, d’ordre ? La suite au prochain numéro ? En réalité, les miliciens français exhibent la honte en plein jour : « Ils furent plus réprouvés que les filles, plus que les voleurs et les vidangeurs, les sorciers, les pédérastes, plus qu’un homme qui, par inadvertance ou par goût, aurait mangé de la chair humaine. Ils ne furent pas seulement haïs mais vomis. Je les aime. » Les nazis étaient le « peuple délégué par Satan », mais les miliciens, leurs aides, ont été plus coupables encore de s’être faits, contre leur propre peuple, les alliés de ce peuple. Nul doute que, pour Genet, la France méritait ce châtiment, cette dégradation. Il ne reviendra jamais là dessus. Le Français, la Française ont été les jouets érotiques du pouvoir homosexuel nazi ou stalinien. Comment ne pas vouloir l’oublier et « rayer » ces quatre années (1940-1944) de notre histoire ? Comment s’étonner que la littérature qui suit soit débilitée par cette dénégation forcenée ? La queue allemande était celle de « l’or blond », celle « du plus formidable des guerriers, du seigneur de la guerre, de l’ange exterminateur », etc. Genet n’y va pas de main morte. La France s’est travestie pour son occupant, pourtant minable, si l’on considère Hitler au moment du coït avec son voyou français : « Se pouvait-il qu’une simple moustache composée de poils raides, noirs et peut-être teints par l’Oréal, possédât le sens de : cruauté, despotisme, violence, rage, écume, aspics, strangulation, mort, marches forcées, parade, prison, poignards ? » Et pourtant, c’est ainsi. La Société tout entière obéit à son émanation de fond : une vieille tante, une folle. Enculé par Paulo, pénétré jusqu’à l’os dans son « œil de bronze », Hitler laisse entendre « la plainte heureuse de Madame ».
« Le Führer, écrit Genet, râlait doucement. » Toutes les figures de Pompes funèbres, Jean, Érik, le bourreau de Berlin, Paulo, Riton, Genet lui-même (en scribe ironique), convergent vers cette identité fulgurante de la police et du crime, du diable et de l’homosexualité généralisée. Proust, dans son grand finale du Temps retrouvé, avait annoncé la couleur. Et Genet : « Arracher les racines du mal eût consisté à détruire le monde... Le monde était inoculé, le mal était dans le sang et la police n’y pouvait rien puisqu’elle-même faisait partie du monde. » Voilà donc décrit, comme il convient, le Prince de ce monde, avec ce qu’il faut de sarcasme pour que la description produise son effet de démystification : « Ce livre est sincère, et c’est une blague. » L’histoire après la Seconde Guerre mondiale ?
« La délation était dans l’air du temps avec la trahison, le pillage et le meurtre. En effet, depuis les plus illustres chefs d’État (Hitler, Staline) jusqu’au plus simple journaliste, en voulant imiter sottement les hommes de la Renaissance, l’Arétin et les princes de Machiavel, on transforma la morale privée en apportant dans la morale publique les éléments destinés à la détruire. » Et, cependant, la France... « Ce jeu m’amuse de marquer ici la honte d’un pays auquel j’appartiens par la langue et par ces fils mystérieux qui me relient en son cœur et qui font monter au bord de mes yeux les larmes quand il souffre. »
« Le poète, écrit Genet, s’occupe du mal. C’est son rôle de voir la beauté qui s’y trouve, de l’en extraire (ou d’y mettre celle qu’il désire, par orgueil ?) et de l’utiliser. L’erreur intéresse le poète, puisque l’erreur seule enseigne la vérité. » Et ceci : « Tuer un homme est le symbole du Mal. Tuer sans que rien compense cette perte de vie, c’est le Mal. C’est le Mal absolu. Rarement j’emploie ce dernier mot car il m’effraie, mais il me paraît s’imposer. Or, et les métaphysiciens le diront, les absolus ne s’ajoutent pas. Atteint une fois grâce au meurtre — qui en est le symbole — le Mal rend soudainement inutiles tous autres actes mauvais. Mille cadavres ou un seul, c’est pareil. C’est l’état de péché mortel dont on ne se sauvera plus. On peut aligner les corps si l’on a les nerfs assez forts, mais la répétition les calmera. C’est alors que l’on peut dire que la sensibilité s’émousse comme chaque fois qu’un acte se répète sauf dans l’acte de créer. » Ici, Genet se trompe : le meurtre ne conduit pas à un état de péché mortel dont on ne se sauvera plus. En bonne théologie, seul le mystérieux péché contre l’Esprit a cette conséquence définitive. Mais, au fond, il le sait : d’où la conclusion sur la répétition et l’acte de créer.
Encore : « Le seul crime serait de se détruire soi-même car du coup c’est tuer la seule vie qui compte, celle de son esprit. Je connais mal les théologiens, mais je les soupçonne d’être profondément de mon avis sur ce point. » Et encore : « Est-il vrai que le mal a des rapports intimes avec la mort et que c’est avec l’esprit de pénétrer les secrets de la mort que je me penche avec tant de ferveur sur les secrets du mal ? » Oui.
L’erreur seule enseigne la vérité : le récit est donc nécessaire.
Le style de Genet, sa force de frappe et de basculement, finalement, tout est là : « Je suis soudain seul parce que le ciel est bleu, les arbres verts, la rue calme, et qu’un chien marche, aussi seul que moi, devant moi. J’avance lentement, mais fortement. Je crois qu’il fait nuit. » Mais aussitôt après : « J’encule le monde. » Dans l’extraordinaire séquence de la fin de Pompes funèbres, Érik et Riton (le deuxième va tuer le premier) sont sur les toits de Paris :
« Leurs bouches s’écrasèrent l’une sur l’autre, reliées comme par un trait d’union par un sexe de vide, sans racine, vivant seul et allant d’un palais à l’autre » (jeu sur le double sens du mot palais).
« Écrire, dit Genet, — et avant d’écrire entrer dans la possession de cet état de grâce qui est une sorte de légèreté, d’inadhérence au sol, à ce qu’on nomme habituellement le réel —, écrire m’oblige à une espèce de loufoquerie dans l’attitude, dans les gestes et même dans les mots. »
Voici la première phrase de Querelle de Brest : « L’idée de meurtre évoque souvent l’idée de mer, de marins. Mer et marins ne se présentent pas alors avec la précision d’une image, le meurtre plutôt fait en nous l’émotion déferler par vagues. » Étudiez cette phrase, laissez-la résonner et se développer dans son mouvement, notez les assonances, la place du mot émotion. Pourquoi est-elle si juste ? N’est-elle pas elle-même une vague ? Expliquez, commentez.
Ou encore, dans le même roman, la description des couvreurs : « Les couvreurs travaillent sur les toits des bâtiments de l’Amirauté. Ils sont à plat, couchés comme sur une vague, dans la solitude d’un ciel gris, loin des hommes qui marchent sur le sol. On ne les entend pas. Ils sont perdus en mer. Chacun sur un versant du toit, ils se font face, ils rampent, ils se mesurent du buste dressé, ils échangent du tabac. »
Le matelot Querelle, dans Querelle de Brest, est une des plus grandes inventions physiques de Genet (le roman lui même est probablement son chef-d’œuvre). On peut dire qu’il est un prétexte à la conscience nerveuse et cellulaire de soi, une leçon d’anatomie en mouvement, respiration, haleine, sens du terrain et des végétaux, crime et mortification, espace ressenti mètre par mètre, rôle de troubleur fondamental d’identités, « joker » : « Il sentait la présence silencieuse de chaque muscle s’accordant avec tous les autres pour instaurer une statue de houleux silence... »
« Ses dix doigts avaient des yeux au bout. Tous ses muscles même en avaient. Il fut bientôt le mur et le demeura un moment, sentant vivre en soi tous les détails des pierres. »
Pour Genet, contrairement à l’imagerie courante, la virilité se caractérise par « la négligence, l’indifférence aux hommages, l’attente détachée du corps, qu’on lui offre du plaisir ou qu’on l’obtienne de lui ». Racontez ce qui vous paraît justifier cette proposition. Donnez des exemples.
Grande lenteur de l’écriture, grande vitesse :
« Comment surprendre le secret de la disparition des choses ? En se retournant très vite ? Non. Mais plus vite ? Plus vite que tout ?... Non, c’était inutile. Les choses ne sont jamais en défaut. Il faudrait tourner sur soi avec la vitesse d’une hélice d’avion. On s’apercevrait alors que les choses ont disparu, et soi-même avec elles. »
Philippe Sollers. Repris dans La guerre du goût, Gallimard, 1994, p. 172-201.

Trois autres textes de Sollers sur Genet
Le rebelle
En 1943, dans la France glauque de l’Occupation, un poète français est en prison. On connaît de lui quelques vers étranges. Cocteau dit de lui : « Élégance, équilibre, sagesse, voilà ce qui émane de ce maniaque prodigieux. » À peine enfermé, ce poète écrit à Picasso pour lui demander où se trouvait, à la Santé, la cellule où a été bouclé Apollinaire. C’est Jean Genet, dont on lira les Lettres au petit Franz (1943-1944). Il a besoin de nourriture et de papier, Genet, il écrit sans cesse, il veut sortir de là tout en restant voleur, par vocation et passion. Cambrioleur, c’est le goût de l’ivresse, comme on peut vouloir être aviateur, marin, explorateur. Il travaille à Miracle de la rose. Il écrit : « Un Prince seul pourrait lire mes livres sans être tenté de cracher dessus. Un Prince ou un Pontife. Où sont-ils tous ? » Bonne question. Et, dans la foulée : « J’emmerde tous ces cons qui croient me tenir parce qu’ils ont des flics et des barbelés. »
Genet, bien entendu, est un moraliste. Au « petit Franz » (François Sentein), il dit : « Ne commets jamais de gestes sans beauté. On en souffre trop de vivre dans la laideur des gestes étriqués. » La vie en prison, au milieu du bruit et des bagarres, n’est pas en effet la tour d’ivoire rêvée. « Maintenant, si dans un mois je ne suis pas sorti, je déchire ou brûle le livre que j’écris et qui devrait être un des plus beaux livres de la littérature française. Je ne donnerais pas mon livre à une chiée de cons qui me laissent crever en se regardant dans le blanc des yeux et en agitant leurs gants au bout de leurs mains molles. » Ou encore : « Je ne sais pas si je ne vais pas bouffer mon livre pour leur recracher à la gueule. »
Voilà. Genet est parti pour quelques chefs-d’œuvre. Style fleuri et direct. Une phrase, parfois, suffit : « C’est rare les types qui sont bien grands. »
Philippe Sollers, Le JDD, dimanche 29 octobre 2000.
Dans Fleurs
Genet
Le genêt (latin genesta) est un arbrisseau à fleurs jaunes, commun dans certaines landes, et formant de nombreuses espèces, parfois épineuses (famille des papillionacées).
Et voici comment Jean Genet vient habiter son nom :
« Quand je rencontre dans la lande des fleurs de genêt, j’éprouve à leur égard une sympathie profonde. Je les considère gravement, avec tendresse. Mon trouble semble commandé par toute la nature. Je suis seul au monde, et je ne suis pas sûr de n’être pas le roi et peut-être la fée de ces fleurs. Elles me rendent au passage un hommage, s’inclinent sans s’incliner mais me reconnaissent. Elles sont mon emblème naturel, mais j’ai des racines, par elles, dans ce sol de France nourri des os en poudre des enfants, des adolescents, enfilés, massacrés, brûlés par Gilles de Rais. »
Genet associe immédiatement son nom de fleur au crime. Ses fleurs du mal sont des mâles de l’assassinat considéré comme un des beaux-arts.
Il vient de loin, Genet, entre Notre-Dame de Paris, Villon et le quai aux Fleurs. Il a lu en profondeur Baudelaire, Rimbaud, Proust. Ses titres sont explicites : Miracle de la Rose, Notre-Dame-des-Fleurs. Mais voilà : il écrit en prison (Fresnes, 1942), et sa Notre-Dame n’est pas une église, mais un jeune assassin de charme dont le surnom dit tout.
Les fleurs du Bien et de la poésie étant devenues introuvables, les nouvelles fleurs du Mal incarneront un autre Bien arraché au Mal. En tout cas, elles déplâtrent. Les assassins guillotinés sont des héros, et on peut voir en eux une « merveilleuse éclosion de belles et sombres fleurs ». Se révèle ainsi « rien que le vide dressé, sensible et fier comme une haute digitale » (empreinte génitale, empreinte digitale).
Genet découpe dans les journaux les photos de ces sombres fleurs, dont la tête a été, par la suite, tranchée.
« Les journaux arrivent mal jusqu’à ma cellule, et les plus belles pages sont pillées de leurs plus belles fleurs, ces macs, comme jardin en mai : les grands macs inflexibles, stricts, sexes épanouis, dont je ne sais plus s’ils sont des lys ou si lys et sexes ne sont pas totalement eux, au point que le soir, à genoux, j’ embrasse de mes bras leurs jambes. »
Genet, dans sa cellule, parle comme une religieuse au couvent. C’est sainte Genet, pas du tout comédienne et encore moins martyre ; ses extases, emprisonnées, mais libres, visent un rien, un vide, une fleur de mort (comme « la fleur de lys sur l’épaule des voyous d’autrefois »).
Ajoutez à cela que Genet lit beaucoup. Je suis sur un lit, je lis, je suis un lys. Ce thème de royaume (de France), même inversé (Gilles de Rais), est constant chez lui.
Macs, assassins bizarrement « innocents », tantes aux noms célestes ou floraux (Divine, Mimosa, Première-Communion), toute la féerie de Genet agace le militant protestant Sartre. Le protestantisme est toujours un puritanisme plus ou moins déguisé, alors que le catholicisme, même pudibond, est pervers, c’est connu, et c’est bien ce qui le rend insupportable.
Comportement de Divine :
« Elle croit, au milieu de tous nos gestes, jeter, les semant autour d’elle, des pétales de roses, de rhododendrons et de pivoines, comme, dans le village, les petites filles en jetaient sur les routes de la Fête-Dieu. »
Après quoi, Divine montre à Mimosa une petite photo du jeune assassin de Notre-Dame-des-Fleurs, et Mimosa la pose sur sa langue et l’avale : « Je l’adore ta Notre-Dame, je la communie. »
Ailleurs, Genet évoque « les candélabres dorés, les lys d’émail blanc, les nappes brodées d’argent, les chasubles vertes, violettes, blanches, noires, en moire ou en velours, les aubes, les surplis raides, les hosties nouvelles... »
Cet écrivain est une fleur, une sainte, un enfant de chœur, un voleur rapide et viril, un mac par projection, un marin, une tante, un assassin, un policier, un procureur, un vieillard, un voyou, un ange. C’est le grand charme transversal et transmoral de son art. À un moment, il se demande d’où il a tiré tous ces noms liturgiques :
« Ces noms ont entre eux une "parenté ", une odeur d’encens et de cierge qui fond , et j’ai quelquefois l’impression de les avoir recueillis parmi les fleurs artificielles ou naturelles dans la chapelle de la Vierge Marie, au mois de mai, sous et autour de cette statue en plâtre goulu, derrière quoi, enfant, je cachais la fiole contenant mon foutre. »
Voilà donc le plâtre dix-neuviémiste vivifié et transsubstantié de la plus étrange façon. C’est une évasion.
Nature enchantée de Genet. Ainsi du visage de Pilorge (autre assassin raccourci) : « visage pareil aux pins les soirs d’orage, survol aux jardins où je passais la nuit ». Ou bien (et on peut entendre ici l’accent de Rimbaud) :
« Mon enfance, comme un Sahara, tout minuscule ou immense — on ne sait pas —, abrité par la lumière, le parfum et le flux de charme personnel d’un gigantesque magnolia fleuri qui montait dans un ciel profond comme une grotte, par-dessus le soleil invisible et pourtant présent. »
Cette expérience du magnolia est à faire très tôt : je vois très bien celui que je veux dire.
Mais je ne savais pas, et vous non plus, que le nom de magnolia a été donné par Linné à cet arbre originaire d’Amérique et d’Asie en hommage au botaniste français Pierre Magnol (1638-1715) qui eut l’idée du classement des fleurs par « familles ». Être transformé en arbre à fleurs splendides est, on en conviendra, un destin peu banal.
Genet donne toute sa mesure dans ce passage où Notre Dame-des-Fleurs tue :
« J’écoute avec lui dans sa tête comme un carillon qui doit être fait de toutes les clochettes du muguet, des clochettes des fleurs du printemps, des clochettes en porcelaine, en verre, en eau, en air. Sa tête est un taillis qui chante. Lui-même, il est une noce enrubannée qui dévale, violon en tête et bouton d’oranger sur le noir des vestons, un chemin creux d’avril. Il croit bondir, l’adolescent, de vallon fleuri en vallon fleuri, jusqu’à la paillasse où le vieux enfouissait son magot. Il la tourne, la retourne, l’éventre, la vide de sa laine, mais il ne trouve rien, car rien n’est plus difficile à trouver comme l’argent après un meurtre commis exprès. »
Parole de professionnel.
Philippe Sollers, Fleurs, Hermann, 2006, p. 97-103.
Jean Genet aristocrate
Extrait d’un entretien avec la revue Mettray.
D.M. Pour terminer cet entretien, j’aimerais que l’on parle de Genet. Vous l’avez rencontré, vous l’avez invité à Tel Quel, rue de Rennes ?
PH.S. Oui.
D.M. C’était pour parler des Palestiniens ?
PH.S. Oui, on s’est vus assez souvent, soit chez Paul Thévenin, où vous pouviez voir des gens très particuliers quand même : Michel Leiris, Jean Genet, etc.
La séance rue de Rennes, c’était au moment de septembre noir [9]. C’était en présence de Mahmoud Hamchari qui était le représentant de la Palestine en France, qui n’a pas été tué au revolver, mais qui, en décrochant son téléphone, a explosé : attentat professionnel [10]. Et je le revois, c’était un type très sympathique, et on a fait le tour de la mosquée de Paris, parce que le recteur ne voulait pas laisser entrer le cercueil. Alors, on a tourné autour de la mosquée de Paris.
Genet était, bien entendu, très impliqué, déjà. Ça n’allait pas de soi du tout. La preuve. Ça, c’était un assassinat en plein Paris.
Mais j’aimerais bien mettre les choses au point. Genet est pour moi — je l’ai un peu connu — le type même de l’aristocrate spontané. Donc pas d’erreur là-dessus. C’est tout le fond retourné de l’aristocratie française qui a parlé à travers Genet.
C’est ça qui est très intéressant. À travers son nom même : la nature, les marches... enfin, j’ai écrit là-dessus : Physique de Genet ! C’est un écrivain du royaume, c’est-à-dire quelque chose qui dépasse de très loin toutes les catégories ultérieures, bourgeoises et petites bourgeoises... Vous savez que la France a été un royaume, puis est devenue une grande nation, comme l’appelaient les Allemands du temps de Napoléon, puis ensuite une nation, et maintenant c’est une municipalité. Donc Genet, je l’ai toujours envisagé comme ça, comme quelqu’un qui essaye de retrouver des lieux où il peut vivre ou respirer dans son aristocratie native. Un Captif amoureux n’est rien d’autre que ça [11]. Et il faudrait aussi relire tous ses livres. C’est un aristocrate.
D.M. C’était un homme de goût ? Erudit, même ?
PH.S. J’ai publié des textes de lui comme son Rembrandt [12]. Un goût tout à fait étonnant.
Proust, bien sûr, illumination ! Et Proust qu’est-ce que c’est d’autre, sinon un désir fou de rentrer dans Saint-Simon, c’est-à-dire au sommet de ce qu’il peut y avoir de plus élevé dans l’art d’écrire, du royaume. Je crois que c’est très simple. Toute autre interprétation m’a toujours parue réactionnaire.
D.M. Dans Un Captif amoureux, les collines du Morvan, où il a passé son enfance dans cette famille d’accueil qui lui réapparaissent en Jordanie...
PH.S. Imaginez-vous ce qu’ont pu être les marches de Genet à travers l’Europe. C’est exactement du même ordre que celles de Rimbaud qu’on a peine à imaginer. Mais enfin, voilà des gens qui marchaient. Très souvent, et longtemps.
Lieux et formules. Entretien réalisé le 2 et 3 avril 2014
dans le bureau de Philippe Sollers aux éditions Gallimard.
Bataille à propos de Genet
Dans Physique de Genet, Philippe Sollers revient longuement sur l’essai de Sartre Saint Genet, comédien et martyr qui fut publié en 1952 comme le premier volume des « Oeuvres complètes de Jean Genet » (Gallimard). Trente ans ont passé. Sollers prend la défense de Genet contre Sartre. Il peut paraître étonnant que Sollers ne parle pas de Georges Bataille, du Bataille qui, en 1949, défendait Genet dans un article consacré à Haute surveillance, « D’un caractère sacré des criminel », mais qui, surtout, après avoir lu l’essai de Sartre, dans un article de 1952, repris en 1957 dans La littérature et le Mal, reprochait à Genet son refus de « communiquer » et sa « trahison de la souveraineté ». Sollers fait donc silence sur les positions de Bataille, un Bataille qu’il ne cesse de relire et de citer, de livre en livre. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne lui répond pas de manière indirecte... « Que serait un philosophe, fût-il Heidegger, qui ne parlerait pas en fonction d’une communauté ? » se demande Sollers (en 1993). Bataille, qui n’était pas philosophe, a souvent parlé de communauté (ou en a rêvé, à en perdre presque la tête, avec l’expérience d’Acéphale, « communauté élective contre toute communauté de sang, de sol ou d’intérêts » [13]), « mais sur un mode absolument singulier » (« communauté des amants », « ma vie en compagnie de Nietzsche est une communauté ») [14]. « Avec Genet [...] pas de convivialité » écrit encore Sollers. Oui. Mais la « communauté », la « communication » ou « souveraineté », au sens de Bataille, n’est pas la « convivialité » (que Bataille aurait sans doute appelés « communication basse »), encore moins le « vivre ensemble » dont on nous rebat aujourd’hui les oreilles. Profondément asociales, elles en sont même la négation. « La communication forte est première, c’est un donné simple, apparence suprême de l’existence, qui se révèle à nous dans la multiplicité des consciences et dans leur communicabilité. » Négation de la négation — avec le temps retrouvé(e).
![]() Le premier texte de Bataille sur Genet, rarement cité, est paru dans le n°35 de la revue Critique (avril 1949). C’est la seconde partie d’un article consacré à « La question coloniale » que Bataille a signé du pseudonyme de « Elie Chancelé » (la chance fait-elle chanceler ?). Il y est, déjà, question de « morale » mais : « il n’est pas de morale possible à vouloir ignorer les vertus du mal. » (je souligne)
Le premier texte de Bataille sur Genet, rarement cité, est paru dans le n°35 de la revue Critique (avril 1949). C’est la seconde partie d’un article consacré à « La question coloniale » que Bataille a signé du pseudonyme de « Elie Chancelé » (la chance fait-elle chanceler ?). Il y est, déjà, question de « morale » mais : « il n’est pas de morale possible à vouloir ignorer les vertus du mal. » (je souligne)
D’UN CARACTÈRE SACRÉ DES CRIMINELS
JEAN GENET, Haute surveillance, Gallimard, 1949, in-8°, 136 4

- Haute surveillance
Tony Taffin, Robert Hossein et Claude Romain
(photo DR)
Collection A.R.T.
Comment (malgré les réserves qu’il formule) ne pas savoir gré à François Mauriac de rappeler (dans le Figaro littéraire du 26 mars) au sujet de Haute surveillance — à ceux qui « comme lui lui ne le connaissent pas par cœur » — ce passage d’Une Saison en enfer : « Encore enfant j’admirais le forçat intraitable sur qui se referme toujours le bagne ; je visitais les auberges et les garnis qu’il aurait sacrés par son séjour... » On ne saurait mieux situer l’énigme morale que pose insidieusement le drame de Genet.
Nulle considération de prudence ne saurait faire en effet que la lumière du crime ne baigne l’assassin d’un halo sacré. Inutile d’invoquer le désordre de Rimbaud, ou la préciosité de Jean Genet : la voix populaire est d’accord. Et cet accord n’étonne que dans la mesure où nous nous sommes rendus étrangers au mystère qui est le fondement de toute religion. Nécessairement le sacrifice, où nous accédons au tremblement, où le trouble divin nous suffoque, est de même nature que le crime. François Mauriac, rappelant le sentiment qu’inspirait Haute surveillance à Jean-Jacques Gautier, parle de « dégoût », de « haut-le-cœur ». Seul l’oubli où nous maintenons les arcanes de la religion nous empêche à ce signe de connaître la présence du divin. Le temps est un lieu d’horreur, un abattoir malodorant ; l’exécration du criminel touche à la consécration des victimes. Nous avons cessé d’être à la mesure de nos vérités premières, mais elles ne cessent pas d’être pour autant.
Comment d’ailleurs ferait-on pour ne pas voir que, dans la cellule de Jean Genet, la tragédie trouve un lieu d’élection ? Il n’est pas de tragédie sans personnes sacrées, qu’une horreur divinise. Mais les jeunes voyous de Haute surveillance, malades de la gloire infâme que confère le crime, jaloux du malheur sans lequel il n’est pas de charme atroce, sont seuls à parvenir dans leur prison au point même où les divinités des rois grecs situèrent la tragédie. À cette fin, les bourgeois ou les autres personnages du temps présent ne sont pas assez hors du monde : la démesure n’est jamais le lieu de leur vertu. Le baroquisme de Genet et ses précieuses suavités achèvent d’éclairer sans les affadir ces figures que déjette infiniment le goût d’une fangeuse poésie. Sans doute il faut la nuit de la prison, et l’approche de l’exécution, pour apercevoir comme il convient le héros Yeux-Verts pérorant : « Mais si vous m’aviez vu avant, les mains dans les poches, avec mes fleurs, avec toujours une fleur entre les dents ! » Parfois les images de cette poésie maudite touchent à une déliquescence espagnole, et donnent au héros l’air exsangue d’un Greco dévoyé : « Les choses se sont mises à vivre, avoue-t-il. Il n’y avait plus rien à faire. Et pour cela, il avait fallu que je tue quelqu’un. J’ai fini. Je repars à zéro pour le monde des chapeaux de paille et des palmiers. Recommencer une vie, c’est facile, vous verrez. Moi, je me suis rendu compte dès le moment que j’ai eu détruit la fille. J’ai vu le danger. Vous me comprenez ? Le danger de me trouver dans la peau d’un autre gars. Et j’ai eu peur, j’ai voulu revenir en arrière, macache ! Pourtant on peut dire que j’ai fait des efforts. Je courais à droite et à gauche. Je me tortillais. J’essayais toutes les formes pour ne pas devenir un assassin. Essayé d’être un chien, un chat, un cheval, un tigre, une table, une pierre ! Une fois j’ai essayé d’être une rose. Vous n’allez pas rigoler, non, les gars ! J’ai fait ce que j’ai pu. Je me contorsionnais. On m’aurait cru en caoutchouc. Les gens disaient que j’étais convulsionnaire. Mais je voulais remonter le temps, défaire mon travail, revivre jusqu’avant le crime. Remonter a l’air facile, c’est mon corps qui ne passait pas. Je faisais ce que je pouvais : impossible. On se moquait de moi autour de moi. On ne se doutait pas du danger, jusqu’au jour où on s’est inquiété. Ma danse ! Si tu avais vu ma danse ! J’ai dansé, les gars, j’ai dansé ! » Le scandale de cette expérience est que le meurtre seul donne à l’âme du meurtrier cette suavité suffocante.
Bien entendu, sans l’indéfendable vulgarité de tout ceci, le scandale ne serait pas entier et le défi — le défi : Genet lui même, des pieds à la tête défi — n’aurait pas cette valeur libératoire. La réprobation et le haut-le-cœur qui répondent sans manquer à ce renversement, sont eux-mêmes partie dans l’incantation, qui devient dans la nuit ce spasme sans espoir, seul assez tordu pour exhaler la force du cœur. C’est même en un sens un échec d’être joué et d’être défendu ! cela détend le mouvement qui perd en raideur ce qu’il gagne en pouvoir de rayonnement. :j
Il s’agit à la fin d’une prise de position si parfaite qu’on ne l’entamerait d’aucune façon. On touche ici l’irréductible, enclave insolite, intangible, au sein du monde légal. Mais ce n’est une subversion en aucune mesure. Jean Genet et Yeux-Verts appellent, ils ne contestent pas la rigueur des lois. À ce degré de tension hors du monde, il est vain de crier au danger de contagion : cette exhalaison de la vérité ne menace pas l’ordre sans lequel elle ne pourrait être.
Mais elle pose subtilement la question d’un fondement des valeurs morales : puis-je ici répéter que la morale, en rapport nécessaire avec les catégories du monde sacré, ne peut plus demeurer cette méconnaissance des vérités intimes qui la fonde. En ce sens, Genet la sert mieux que ne font ceux qu’enferme un formalisme : il n’est pas de morale possible à vouloir ignorer les vertus du mal.
Georges Bataille, Oeuvres complètes, tome XI, Gallimard, 1988, p. 468-471.
![]()
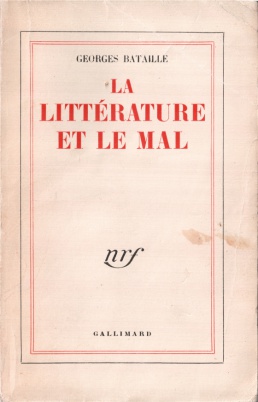 Trois ans plus tard, la position de Bataille change. Sartre vient de publier Saint Genet, comédien et martyr. Bataille qui, quelques mois auparavant, a déjà polémiqué avec Sartre (et Breton) à propos du livre de Camus L’homme révolté, en écrivant dans Critique Le temps de la révolte, écrit, cette fois, « Jean-Paul Sartre et l’impossible révolte de Jean Genet ». Le texte est publié dans les numéros 65 et 66 de la revue Critique (oct.-nov. 1952). Il sera repris en 1957 dans La Littérature et le Mal, sous le titre de « Genet » [15]. La Littérature et le Mal est un livre capital. Dès l’avant-propos que j’ai reproduit il y a quelques années (cf. Faire parler le trou), Bataille expose ses thèses fondamentales : « la littérature est l’essentiel, ou n’est rien », « la littérature est communication ». « Elle exige une "hypermorale" ». L’avant-propos, s’il on excepte une note importante sur les Poésies de Lautréamont, se termine par ces phrases sans appel qui surprennent aujourd’hui : « Quel que soit l’enseignement qui découle des livres de Genet, le plaidoyer de Sartre pour lui n’est pas recevable. A la fin la littérature se devait de plaider coupable. »
Trois ans plus tard, la position de Bataille change. Sartre vient de publier Saint Genet, comédien et martyr. Bataille qui, quelques mois auparavant, a déjà polémiqué avec Sartre (et Breton) à propos du livre de Camus L’homme révolté, en écrivant dans Critique Le temps de la révolte, écrit, cette fois, « Jean-Paul Sartre et l’impossible révolte de Jean Genet ». Le texte est publié dans les numéros 65 et 66 de la revue Critique (oct.-nov. 1952). Il sera repris en 1957 dans La Littérature et le Mal, sous le titre de « Genet » [15]. La Littérature et le Mal est un livre capital. Dès l’avant-propos que j’ai reproduit il y a quelques années (cf. Faire parler le trou), Bataille expose ses thèses fondamentales : « la littérature est l’essentiel, ou n’est rien », « la littérature est communication ». « Elle exige une "hypermorale" ». L’avant-propos, s’il on excepte une note importante sur les Poésies de Lautréamont, se termine par ces phrases sans appel qui surprennent aujourd’hui : « Quel que soit l’enseignement qui découle des livres de Genet, le plaidoyer de Sartre pour lui n’est pas recevable. A la fin la littérature se devait de plaider coupable. »
Le chapitre « Genet » clôt le livre [16]. Il commence par un éloge du « chef-d’oeuvre de Sartre », « un des livres les plus riches de ce temps » (« un temps de décomposition et d’attente » précise Bataille). Vous verrez que les « plaidoyers » de Sartre et de Bataille ne sont pas sans quelques fleurs, couronnes, réserves ou contradictions. Genet gêne.
GENET
Genet et l’étude de Sartre sur lui
« Un enfant trouvé, dès son plus jeune âge, fait preuve de mauvais instincts, vole les pauvres paysans qui l’ont adopté. Réprimandé, il persévère, s’évade du bagne d’enfants où il a bien fallu le mettre, vole et pille de plus belle et, par surcroît, se prostitue. Il vit dans la misère, de mendicité, de larcins, couchant avec tout le monde et trahissant chacun, mais rien ne peut décourager son zèle : c’est le moment qu’il choisit pour se vouer délibérément au mal ; il décide qu’il fera le pire en toute circonstance et, comme il s’est avisé que le plus grand forfait n’était point de mal faire, mais de manifester le mal, il écrit en prison des ouvrages qui font l’apologie du mal et tombent sous le coup de la loi. Précisément à cause de cela, il va sortir de l’abjection, de la misère, de la prison. On imprime ses livres, on les lit, un metteur en scène décoré de la Légion d’honneur monte dans son théâtre une de ses pièces, qui excite au meurtre. Le président de la République lui fait remise de la peine qu’il devait purger pour ses derniers délits, justement parce qu’il se vante dans ses livres de les avoir commis ; et lorsqu’on lui présente une de ses dernières victimes, elle lui dit : « Très honorée, Monsieur. Prenez seulement la peine de continuer [17] ».
Sartre poursuit : « Vous taxerez cette histoire d’invraisemblable : et c’est pourtant ce qui est arrivé à Genet. »
Rien n’est mieux fait pour étonner que la personne et l’œuvre de l’auteur du Journal du voleur. Jean-Paul Sartre, aujourd’hui, leur consacre un très long travail et j’en dirai sans attendre davantage qu’il en est peu de plus dignes d’intérêt. Tout concourt à faire de ce livre un monument : son étendue d’abord et l’excessive intelligence que l’auteur y montre, la nouveauté et l’intérêt renversant du sujet, mais aussi l’agressivité qui étouffe, et le mouvement précipité que le ressassement accentue, qui parfois en rend pénible l’assurance. A la fin, le livre laisse un sentiment de désastre confus et d’universelle duperie, mais il met en lumière la situation de l’homme actuel, refusant tout, révolté, hors de lui.
Certain d’une domination intellectuelle dont l’exercice, en un temps de décomposition et d’attente, a peu de sens, même à ses yeux, nous donnant Saint Genet, Sartre vient d’écrire enfin le livre qui l’exprime. Ses défauts n’ont jamais été plus marqués : jamais il n’ânonna sa pensée plus longuement, jamais il ne se voulut plus fermé à ces ravissements discrets, que ménage la chance, qui traversent la vie et l’éclairent furtivement : le parti pris de peindre l’horreur avec complaisance accuse cette humeur. Le ressassement est en partie, l’effet d’une démarche qui éloigne des voies tracées. J’imagine d’autre part injustifiée la raideur inhibant les moments de bonheur naïfs, mais celui que limite la naïveté est à l’opposé de l’éveil. En ce sens, bien que je m’étonne parfois, même en riant, je ne me refuse pas à la contagion d’exigences amères, détachant l’esprit de la tentation du repos. Finalement, je n’admire rien plus, dans les développements de Saint Genet, qu’une rage de « nullité », de négation des valeurs les plus attirantes, à laquelle la peinture sans cesse renouvelée de l’abjection confère une sorte d’achèvement. Même de la part de Jean Genet, parlant du plaisir qu’il y trouva, le récit de ces souillures a de quoi confondre, mais de la part d’un philosophe ? ... Il s’agit, me semble-t-il, — et du moins est-ce en partie vrai — de tourner le dos au possible et de s’ouvrir à l’impossible sans plaisir.
Je ne vois pas seulement dans cette interminable étude un des livres les plus riches de ce temps, mais encore le chef-d’œuvre de Sartre, qui n’a rien écrit de si sortant, rien qui échappe avec tant de force à l’ensablement ordinaire de la pensée. Les livres monstrueux de Jean Genet furent un point de départ favorable : ils lui permirent d’utiliser pleinement une valeur de choc et une turbulence dont l’issue lui est mesurée. A travers l’objet de son étude, il a su mettre en jeu le plus brûlant. Cela devait être dit, car Saint Genet est loin de se présenter comme l’œuvre importante d’un philosophe. Sartre en a parlé de telle façon que nous serions en droit de nous tromper. Genet, nous dit-il [18], « a permis de publier ses œuvres complètes au grand jour avec une préface biographique et critique comme on a fait pour Pascal et Voltaire dans la collection des Grands Ecrivains Français »... Je passe sur l’intention que Sartre eut de placer sur le pavois un écrivain qui pour être singulier, doué sans doute, humainement angoissant, est loin d’être à tous les yeux l’égal des plus grands : Genet est peut-être la victime d’un engouement ; dépouillé du halo dont l’entoure un snobisme littéraire, Genet seul est plus digne d’intérêt. Je n’insisterai pas. Il serait de toute façon injustifié de voir, dans la volumineuse étude de Sartre, une simple préface. A supposer qu’il n’ait pas répondu à une plus lointaine intention, ce travail littéraire n’en est pas moins l’investigation la plus libre, la plus aventureuse qu’un philosophe ait vouée au problème du Mal.
La consécration sans réserve au mal
Cela tient tout d’abord (mais ne tient pas seulement) à l’expérience de Jean Genet, qui en est la base. Jean Genet s’est proposé la recherche du Mal comme d’autres celle du Bien. C’est là une expérience dont l’absurdité est sensible à première vue. Sartre l’a bien marqué ; nous cherchons le Mal dans la mesure où nous le prenons pour le Bien. Fatalement, une telle recherche est déçue ou tourne en farce. Mais pour être vouée à l’échec, elle n’en a pas moins d’intérêt.
C’est tout d’abord la forme de la révolte chez celui que la société a exclu. Abandonné par sa mère, élevé par l’Assistance Publique, Jean Genet eut d’autant moins de chance de s’intégrer à la communauté morale qu’il avait le don de l’intelligence. Il vola et la prison, en premier lieu la maison de correction, devint son lot. Mais les exclus d’une société justicière, s’ils n’ont pas « les moyens de renverser l’ordre existant..., n’en conçoivent point d’autres » et ils n’admirent rien tant que « les valeurs, la culture et les mœurs des castes privilégiées... : simplement, au lieu de porter leur marque d’infamie dans la honte, ils s’en parent avec orgueil ». « Sale nègre, dit un poète noir. Eh bien ! oui, je suis un sale nègre et j’aime mieux ma négritude que la blancheur de votre peau [19] » Sartre voit dans cette réaction première le « stade éthique de la révolte [20] » : elle se borne à la « dignité ». Mais la dignité dont il s’agit est à l’opposé de la dignité commune, la dignité de Jean Genet est la « revendication du Mal ». Il ne pourrait donc dire, avec la coléreuse simplicité de Sartre, « notre abjecte société ». Pour lui, la société n’est pas abjecte. On peut la qualifier de cette manière si l’on fait passer un mépris justifiable avant le souci de la précision ; de l’homme le plus soigné, je puis toujours me dire : « c’est un sac plein d’excréments », et, si elle n’était impuissante, la société rejetterait ce qui est abject à ses yeux. Pour Genet, ce n’est pas la société qui est abjecte, c’est lui-même : il définirait justement l’abjection par ce qu’il est, par ce qu’il est passivement — sinon fièrement. D’ailleurs, l’abjection dont la société est chargée est peu de chose, étant le fait d’hommes superficiellement corrompus, dont toujours les actions ont un « contenu positif ». Si ces hommes avaient su parvenir aux mêmes fins par les moyens honnêtes, ils les auraient préférés : Genet veut l’abjection, même si elle n’apporte que la souffrance, il la veut pour elle-même, au-delà des commodités qu’il y trouve, il la veut pour une propension vertigineuse à l’abjection, dans laquelle il ne se perd pas moins entièrement que le mystique en Dieu dans son extase.
La souveraineté et la sainteté du mal
Le rapprochement peut être inattendu, mais il s’impose si bien que Sartre, citant une phrase de Jean Genet, s’écrie [21] : « Ne dirait-on pas les plaintes d’un mystique dans les moments de sécheresse ? » Cela répond à l’aspiration fondamentale de Genet à la sainteté, mot dont il dit, mêlant à celui du sacré le goût du scandale, qu’il est « le plus beau de la langue française ». Cela éclaire le titre que Sartre donne a son livre : « Saint » Genet. Le parti pris du Mal suprême se lia en effet à celui du Bien suprême, l’un et l’autre liés par la rigueur à laquelle l’autre prétend. Mais nous ne pouvons nous tromper à l’énoncé de cette rigueur ; jamais la dignité ou la sainteté de Jean Genet n’eurent d’autre sens : l’abjection en est la seule voie. Cette sainteté est celle d’un pitre, fardé comme une femme, ravi d’être un objet de dérision. Genet s’est représenté misérable, portant perruque et se prostituant : entouré de comparses qui lui ressemblent et paré d’un tortil de baronne en perles fausses. Le tortil venant à tomber, les perles à se répandre, il sort de sa bouche un dentier ; le met sur la tête et s’écrie, les lèvres rentrées : « Eh bien, Mesdames ! Je serai reine quand même ! [22] » C’est que la prétention à une horrible sainteté se lie au goût d’une souveraineté dérisoire. Cette volonté exaspérée du Mal se démontre en révélant la profonde signification du sacré, qui jamais n’est plus grande que dans le renversement. Il y a un vertige et une ascèse dans cette horreur que Genet lui même a tenté d’exprimer : « Culafroy et Divine, aux goûts délicats, seront toujours contraints d’aimer ce qu’ils abhorrent et cela constitue un peu de leur sainteté, car c’est du renoncement [23]. » Le souci de la souveraineté, d’être souverain, d’aimer ce qui est souverain, de le toucher et de s’en imprégner envoûte Genet.
Cette souveraineté élémentaire a des aspects variés et trompeurs. Sartre en donne un côté grandiose, allant à l’opposé de la pudeur de Genet, qui, n’étant que l’envers de la pudeur, est cependant la pudeur même. « L’expérience du Mal, dit Sartre, est un cogito princier qui découvre à la conscience sa singularité en face de l’Etre. Je veux être un monstre, un ouragan, tout ce qui est humain m’est étranger, je transgresse toutes les lois qu’ont établies les hommes, je foule aux pieds toutes les valeurs, rien de ce qui est ne peut me définir ou me limiter ; cependant j’existe, je serai le souille glacé qui anéantira toute vie [24]. » Cela sonne creux ? Sans doute ! mais ne peut être séparé de la saveur plus forte, et plus sale, que lui donne Genet : « J’avais seize ans... dans mon cœur, je ne conservais aucune placé où pût se loger le sentiment de mon innocence. Je me reconnais le lâche, le traître, le voleur, le pédé qu’on voyait en moi... Et j’avais la stupeur de me savoir composé d’immondices. Je devins abject [25]. » Sartre a bien vu et bien compris ce caractère royal inhérent à la personne de Jean Genet. Si, dit-il, « il compare si souvent la prison à un palais, c’est qu’il se voit monarque pensif et redouté, séparé de ses sujets, comme tant de souverains archaïques, par des murailles infranchissables, par des tabous, par l’ambivalence du sacré [26] ». L’imprécision, la négligence et l’ironie de ce rapprochement répondent à l’indifférence de Sartre à l’égard du problème de la souveraineté [27]. Mais Genet, qui se lie à la négation de toute valeur, n’en est pas moins dans l’envoûtement de la valeur suprême, de ce qui est saint souverain et divin. Au sens simple du mot, il n’est peut-être pas sincère — sincère, il ne l’est jamais, jamais il ne parvient à l’être — mais il est obsédé s’il dit le panier à salade habillé d un « charme de malheur hautain », de « malheur royal », s’il y voit « un wagon chargé de grandeur, fuyant lentement, lorsqu’il (le) transportait, entre les rangs d’un peuple courbé de respect [28] ». La fatalité de l’ironie — mais cette ironie, Genet l’a subie plus qu’il ne l’a voulue — ne saurait empêcher de voir le lien tragique de la punition à la souveraineté : Genet ne peut être souverain que dans le Mal, la souveraineté elle-même est peut être le Mal, et le Mal n’est jamais plus sûrement le Mal que puni. Mais le vol a peu de prestige à côté du meurtre, la prison, près de l’échafaud. La véritable royauté du crime est celle de l’assassin exécuté. L’imagination de Genet s’efforce de la magnifier d’une façon qui pourrait sembler arbitraire, mais si, dans la prison, il brave la punition du cachot et s’écrie : « je vis à cheval..., j’entre dans la vie des autres comme un grand d’Espagne dans la cathédrale de Séville [29] », sa bravade serait-elle fragile et chargée de sens. Sa tristesse si la mort est en jeu de tous côtés, si le criminel l’a donnée et attend de la recevoir, prête à la souveraineté qu’il imagine une plénitude ; c’est encore une duperie sans doute, mais au delà d’un donné sans charme et sans bonheur, le monde de l’homme n’est-il pas tout entier l’effet d’une imagination, d’une fiction ? Effet bien souvent merveilleux, plus souvent angoissant. Socialement, la magnificence d’Harcamone dans sa cellule, plus subtile, impose moins que celle de Louis XVI à Versailles, mais elle est fondée de la même façon. Le clinquant verbal, dont Genet se passe rarement, est voilé malgré tout de gravité s’il évoque Harcamone, dans l’ombre du cachot, « pareil à un Dalaï-Lama invisible [30] »... Qui éviterait le malaise apporté par cette petite phrase, allégorie la mise à mort du meurtrier : « On le pavoisait de noir plus qu’une capitale dont le roi vient d’être assassiné [31]. »
Non moins que celle de la sainteté, cette obsession de la dignité royale est un leitmotiv de l’œuvre de Genet. Je multiplierai les exemples. D’un « colon » de la maison de correction de Mettray, Genet écrit : « Il disait un seul mot, qui le dépouillait de son état de colon, mais le vêtait d’oripeaux magnifiques. C’était un roi [32] » Il parle ailleurs [33] « des gars qui sifflent en vache et sur la tête de qui, en auréole, on pourrait voir une couronne royale ». De Mignon les Petits-Pied, qui vend ses amis, il écrit [34] : « Les gens qu’il croise... sans le connaître... accordent une sorte de souveraineté discontinue et momentanée à cet inconnu, de qui tous ces fragments de souveraineté feront tout de même qu’à la fin de ses jours il aura parcouru la vie en souverain. » Stillitano, auquel, un jour où un pou s’engageait sur son col, un autre disait : « j’en vois un beau qui t’escalade », est roi, lui aussi, c’est un « monarque faubourien [35] ». Entre tous, Métayer, colon de Mettray, c’était royal à cause de l’idée souveraine qu’il se faisait de sa personne [36] ». Âgé de dix-huit ans, laid, couvert d’abcès rouges, Métayer disait « aux plus attentifs, et surtout à moi, qu’il était le descendant des rois de France... ». « Personne, ajoute Genet, n’a étudié l’idée royale chez les enfants. Je dois dire pourtant qu’il n’est pas un gosse ayant eu sous les yeux l’Histoire de France de Lavisse ou de Bayet, ou n’importe quelle autre, qui ne se soit cru dauphin ou quelconque prince de sang. La légende de Louis XVII évadé d’une prison donna surtout prétexte à ses rêveries. Métayer avait dû passer par là. » Mais l’histoire de Métayer aurait peu de chose à voir avec la royauté des criminels, s’il n’avait été accusé, peut-être à tort, d’avoir vendu la mèche d’une évasion. « Vraie ou fausse, dit Genet, une accusation de ce genre était terrible. On punissait cruellement sur des soupçons. On exécutait. Le prince royal fut exécuté. Trente gosses plus acharnés sur lui que les Tricoteuses sur son ancêtre l’entouraient en hurlant. Dans un de ces trous de silence comme il s’en forme souvent dans les tornades, nous l’entendîmes murmurer : — On fit aussi cela au Christ. Il ne pleura pas, mais il fut sur ce trône revêtu d’une si soudaine majesté qu’il s’entendit peut-être dire par Dieu lui-même : "Tu seras roi, mais la couronne qui te serrera la tête sera de fer rougi." Je le vis [37]. Je l’aimai. » La passion, affectée mais vraie, de Genet unit dans la même lumière, et le même mensonge, cette royauté de comédie (ou de tragédie) à celle de la reine Divine, qu’un dentier couronna. Il n’est pas jusqu’ à la police que le mysticisme dévoyé de Genet ne pare de cette dignité sinistre et souveraine : la police, « organisation démoniaque, aussi écœurante que les rites funèbres, les ornements funéraires, aussi prestigieuse que la gloire royale [38] ».
Le glissement à la trahison et au mal sordide
La clé de ces attitudes archaïques (archaïques, elles le sont, mais dans la mesure où le passé, mort en apparence, est plus vivant que l’apparence actuelle) nous la trouvons dans cette partie, la plus déjetée, du Journal du voleur, où l’auteur a parlé d’une liaison amoureuse, qu’il eut avec un inspecteur de police. (« Un jour, dit-il [39], il me demanda de lui "donner" des copains. En acceptant de le faire, je savais rendre plus profond mon amour pour lui, mais il ne vous appartiendra pas d’en savoir davantage à ce propos. » Sur ce point, Sartre n’a pas voulu laisser de doute : Genet aime la trahison, il voit dans la trahison le meilleur et le pire de lui-même.) Une conversation de Genet avec Bernardini, son amant, éclaire le fond du problème. « Bernard, dit-il, connaissait ma vie, qu’il ne me reprocha jamais. Une fois pourtant, il essaya de se justifier d’être flic, il me parla de morale. Du seul point de vue de l’esthétique considérant un acte, je ne pouvais l’entendre. La bonne volonté des moralistes se brise contre ce qu’ils appellent ma mauvaise foi (à l’instant, Genet fait peut-être allusion à des conversations qu’il eut avec Sartre, son ami). S’ils peuvent me prouver qu’un acte est détestable par le mal qu’il fait, moi seul puis décider, par le chant qu’il soulève en moi, de sa beauté, de son élégance ; moi seul peux le refuser ou l’accepter. On ne me ramènera plus dans la voie droite. Tout au plus pourrait-on entreprendre ma rééducation artistique, au risque toutefois, pour l’éducateur, de se laisser convaincre et gagner à ma cause, si la beauté est prouvée par, de deux personnalités, la souveraine [40]. »
Genet n’hésite pas sur l’autorité devant laquelle s’incliner. Il se sait lui-même souverain. Cette souveraineté dont il jouit ne pourrait être cherchée (elle ne peut résulter de l’effort), elle est, comme la grâce, révélée. Genet la reconnaît au chant qu’elle soulève. La beauté qui soulève un chant est l’infraction à la loi, c’est l’infraction à l’interdit, qui est aussi l’essence de la souveraineté. La souveraineté est le pouvoir de s’élever, dans l’indifférence à la mort, au-dessus des lois qui assurent le maintien de la vie. Elle ne diffère de la sainteté qu’en apparence, le saint étant celui qu’attire la mort, tandis que le roi l’attire au dessus de lui. Jamais d’ailleurs nous ne devons oublier que le sens du mot « saint » est « sacré », et que sacré désigne l’interdit, ce qui est violent, ce qui est dangereux, et dont le contact seul annonce l’anéantissement : c’est le Mal. Genet n’ignore pas qu’il a de la sainteté une représentation inversée, mais il la sait plus vraie que l’autre : ce domaine est celui où les contraires s’abîment et se conjuguent. Ces abîmes, ces conjugaisons, nous en donnent seuls la vérité. La sainteté de Genet est la plus profonde, qui introduit le Mal, le « sacré », l’interdit sur la terre. Une exigence souveraine en lui le laisse à la merci de tout ce qui révèle une force divine au-dessus des lois. En quelque sorte en état de grâce, il entre ainsi dans les chemins malaisés où le conduisent son « cœur et la sainteté ». « Les voies de la sainteté, dit-il, sont étroites, c’est-à-dire qu’il est impossible de les éviter et, lorsque, par malheur, on y est engagé, de s’y retourner et de revenir en arrière. On est saint par la force des choses qui est la force de Dieu [41] ! » La « morale » de Genet tient au sentiment de fulguration, de contact sacré, que lui donne le Mal. Il vit dans l’envoûtement, dans la fascination de la ruine qui en résulte ; rien ne compenserait à ses yeux cette souveraineté, ou cette sainteté, rayonnant de lui même ou des autres. Le principe de la morale classique se lie à la durée de l’être. Celui de la souveraineté (ou de la sainteté) à l’être dont la beauté est faite d’indifférence à la durée, même d’attrait pour la mort.
Il n’est pas facile de trouver en défaut cette position paradoxale.
Il aime la mort, il aime la punition et la ruine... Il aime ces voyous souverains auxquels il se donne en jouissant de leur lâcheté. « Le visage d’Armand était faux, sournois, méchant, fourbe, brutal... C’était une brute... Il riait peu et c’était sans franchise... En lui-même, dans ses organes que j’imaginais élémentaires mais de tissus solides et de teintes diaprées très belles, dans des tripes, chaudes et généreuses, je crois qu’il élaborait sa volonté d’imposer, d’appliquer, de les rendre visibles, l’hypocrisie, la sottise, la méchanceté, la cruauté, la servilité et d’en obtenir sur sa personne tout entière la plus obscène réussite. » Cette figure détestable a peut-être fasciné Genet plus qu aucune autre. « Armand peu à peu devenait, dit-il, la Toute-Puissance en matière de morale [42]. » Robert dit à Genet, qui se prostituait à des vieillards et les volait : « T’appelles ça du boulot ?... Tu t’attaques aux vieux qui tiennent encore debout grâce à leurs faux cols et à leurs cannes. » Mais la réplique d’Armand devait amener « en morale une des révolutions les plus hardies ». « Qu’est-ce que tu crois ? dit Armand. Quand c’est utile, moi, tu m’entends, c’est pas aux vieux que je m’attaque, c’est aux vieilles. C’est pas aux hommes, c’est aux femmes. Et je choisis les plus faibles. Ce qui me faut c’est le fric. Le beau boulot, c’est de réussir. Quand t’auras compris que ce n’est pas dans la chevalerie qu’on travaille, t’auras compris beaucoup [43]. » Ayant l’appui d’Armand, « le code de l’honneur particulier aux voyous... parut risible » à Jean Genet. Un jour, cette « volonté dégagée de la morale par la réflexion et l’attitude d’Armand », il l’appliquera dans sa façon de « considérer la police » : il s’enfoncera dans la sainteté et la souveraineté, il n’y aura plus d’abjection, jusqu’à la trahison, qui ne lui donne, dans un émoi vertigineux, une majesté angoissante.
Il y a ainsi malentendu : à sa façon, Armand est bien souverain ; il démontre par la beauté la valeur de son attitude. Mais la beauté d’Armand réside dans le mépris de la beauté, dans la préférence pour l’utile, sa souveraineté est une servilité profonde : une rigoureuse soumission à l’intérêt. Cela va tout d’abord à l’encontre de la divinité moins paradoxale d’Harcamone, dont, en aucune mesure, les crimes n’ont l’intérêt pour mobile (le second même, le meurtre d’un gardien dans la prison, n’a de sens apparent que le vertige du châtiment). Mais l’attitude d’Armand a une vertu que n’ont pas les meurtres d’Harcamone, elle est impardonnable, rien n’en rachète l’ignominie. Armand lui-même refuserait la moindre valeur à ses actes en dehors du motif le plus bas, de l’argent : c’est pour cela que Genet confère à sa personne la valeur incomparable et la souveraineté authentique. Cela suppose deux personnages — au moins deux points de vue opposés. Genet exige le Mal approfondi, radicalement opposé au Bien, ce Mal parfait qui est la beauté parfaite : Harcamone est appelé à le décevoir relativement ; Armand est à la fin plus étranger aux sentiments humains, il est plus sordide et plus beau. Armand n’est qu’un calculateur exact, il n’est pas un lâche, mais il a recours à la lâcheté parce qu’elle paye. La lâcheté d’Armand serait-elle une esthétique qui se dissimule, aurait-il pour la lâcheté une préférence désintéressée ? Il serait alors en faute devant lui-même. Genet seul, qui le contemple, peut envisager sa lâcheté du point de vue de son esthétique. Genet s’extasie devant lui comme devant une œuvre d’art admirable : il cesserait néanmoins d’admirer dès qu’il apercevrait en lui la conscience d’être une œuvre d’art. Armand a gagné l’admiration de Genet pour avoir écarté de lui toute possibilité d’admiration : même Genet perdrait la face devant lui s’il avouait son esthétisme.

Sartre a mis en lumière le fait que, recherchant obstinément le Mal, Genet s’est enfermé dans une impasse. Dans cette impasse, il semble qu’il ait trouvé, en l’espèce de la fascination d’Armand, la position la moins tenable, mais il est clair de toute façon qu’il voulait l’impossible. Une misère certaine résulta, pour Genet, de la souveraineté majeure, qu’apparemment le moins souverain de ses amants eut à ses yeux ; ce que Sartre a justement représenté [44] : « Le méchant doit vouloir le Mal pour le Mal, et... c’est dans son horreur du Mal qu’il doit découvrir l’attirance du Péché, (telle est la notion du Mal radical que, selon Sartre, ont fabriqué les « honnêtes gens »). Mais si le Méchant « n’a point horreur du Mal, s’il le fait par passion, alors... le Mal devient un Bien. Par le fait, celui qui aime le sang et le viol, comme le boucher de Hanovre, celui-là est un fou criminel, mais ce n’est pas un vrai méchant [45] ». Je doute personnellement que le sang eût eu pour le boucher la même saveur s’il n’avait pas été celui du crime, qu’interdit la loi première, opposant l’humanité qui observe des lois, à l’animal qui ignore toute loi. J’admets que, pour Genet, ses forfaits se soient librement affirmés « contre sa sensibilité », pour la seule attirance du Péché. Sur ce point, et sur d’autres, il n’est pas facile de trancher, mais Sartre le fait. Genet a ressenti ce vertige de l’interdit, familier et élémentaire, fermé à vrai dire à la pensée moderne : c’est pourquoi il dut « puiser ses raisons de (mal faire) dans l’horreur que la (mauvaise action) lui (inspirait) et dans son amour original du Bien ». Ceci n’a pas l’absurdité que Sartre lui prête : il n’est pas nécessaire d’en rester à cette représentation abstraite. Je puis partir d’une réalité commune, l’interdit de la nudité, qui ordonne aujourd’hui la vie sociale. Même si l’un de nous n’est pas attentif à cette décence, qui pour la plupart a le sens du Bien, la mise à nu d’une partenaire excite en lui l’impulsion sexuelle : dès lors le Bien qu’est la décence est la raison qu’il a de faire le Mal : une première violation de la règle l’incite par un effet de contagion à violer la règle davantage. Cet interdit auquel nous obéissons — du moins passivement — n’oppose qu’un léger obstacle à une volonté de Mal mineur qu’est éventuellement la mise à nu d’un autre ou d’une autre : dès lors le Bien qu’est la décence est justement (ce que l’auteur de L’Etre et le Néant juge absurde) la raison même que nous avons de faire le Mal. Cet exemple ne peut être donné pour une exception et même, à l’encontre, il me semble qu’en général, la question du Bien et du Mal se débat sur ce thème fondamental, pour reprendre un nom que Sade lui donna, celui de l’irrégularité. Sade a bien vu que l’irrégularité était la base de l’excitation sexuelle. La loi (la règle) est bonne, elle est le Bien lui-même (le Bien, le moyen par lequel l’être assure sa durée), mais une valeur, le Mal, découle de la possibilité d’enfreindre la règle. L’infraction effraie — comme la mort ; elle attire néanmoins, comme si l’être ne tenait à la durée que par faiblesse, comme si l’exubérance appelait au contraire un mépris de la mort exigé dès que la règle est rompue. Ces principes sont liés à la vie humaine, ils sont à la base du Mal, à la base de l’héroïsme ou de la sainteté. Mais la pensée de Sartre en est la méconnaissance [46]. Pour une autre raison, ces principes tombent devant la démesure de Genet. Ils supposent en effet une mesure (une hypocrisie) que Genet refuse. L’attrait de l’irrégularité maintient celui de la règle. Mais dans la mesure où Armand le séduisit, Genet se priva de l’un et de l’autre : l’intérêt seul resta. L’argumentation de Sartre retrouve un sens devant cette avidité de forfait. La volonté de Genet n’est plus la volonté furtive du premier venu (du premier « pécheur » venu) qu’une irrégularité minime apaise : elle exige une négation généralisée des interdits, une recherche du Mal poursuivie sans limitation, jusqu’au moment où, toutes barrières brisées, nous parvenons à l’entière déchéance. Genet est dès lors dans l’inextricable difficulté que Sartre a bien vue : tout motif d’agir lui manque. L’attrait du péché est le sens de sa frénésie, mais s’il nie la légitimité de l’interdit, si le péché lui fait défaut ? S’il fait défaut, « le Méchant trahit le Mal » et « le Mal trahit le Méchant », un désir de néant qui ne voulut pas recevoir de limite est était la vaine agitation. Ce qui est vil est glorifié, mais le parti pris du Mal est devenu vain : ce qui se voulut Mal n’est plus qu’une sorte de Bien, et puisque son attrait tenait à son pouvoir d’anéantir, ce n’est plus rien dans l’anéantissement achevé. La méchanceté voulait « transformer le plus d’être possible en Néant. Mais comme son acte est réalisation, il se trouve en même temps que le Néant se métamorphose en Etre et que la souveraineté du méchant se tourne en esclavage [47] ». En d’autres mots, le Mal est devenu un devoir, ce qu’est le Bien. Un affaiblissement illimité commence ; il ira du crime désintéressé au calcul le plus bas, au cynisme ouvert de la trahison. Nul interdit ne lui donne plus le sentiment de l’interdit et, dans l’insensibilité des nerfs qui le gagne, il achève de sombrer. Rien ne lui resterait s’il ne mentait, si un artifice littéraire ne lui permettait de faire valoir à d’autres yeux ce dont il a reconnu le mensonge. Dans l’horreur de n’être plus dupe, il glisse à ce dernier recours, duper autrui, afin de pouvoir, s’il se peut, se duper lui-même un instant.
La communication impossible
Sartre a marqué lui-même une étrange difficulté à la base de l’œuvre de Genet. Genet, qui écrit, n’a ni le pouvoir ni l’intention de communiquer avec ses lecteurs. L’élaboration de son œuvre a le sens d’une négation de ceux qui la lisent. Sartre l’a vu sans en tirer la conclusion : que dans ces conditions, cette œuvre n’était pas tout à fait une œuvre, mais un ersatz, à mi-chemin de cette communication majeure à laquelle prétend la littérature. La littérature est communication. Elle part d’un auteur souverain, par delà les servitudes d’un lecteur isolé, elle s’adresse à l’humanité souveraine. S’il en est ainsi, l’auteur se nie lui-même, il nie sa particularité au profit de l’œuvre, il nie en même temps la particularité des lecteurs, au profit de la lecture. La création littéraire — qui est dans la mesure où elle participe de la poésie — est cette opération souveraine, qui laisse subsister, comme un instant solidifié — ou comme une suite d’instants — la communication, détachée, en l’espèce de l’œuvre, mais en même temps de la lecture. Sartre le sait (qui semble, je ne sais pourquoi, associer au seul Mallarmé, qui l’exprima clairement, l’universel primat de la communication sur les êtres qui communiquent) :
« Chez Mallarmé, dit Sartre, lecteur et auteur s’annulent en même temps, s’éteignent réciproquement pour que, finalement, le Verbe seul existe [48] ». Je ne dirai pas : « chez Mallarmé » ; je dirai : « partout où la littérature est manifeste ». Quoi qu’il en soit, même si une absurdité apparente résulte de l’opération, l’auteur était là pour se supprimer dans son œuvre, et il s’adressait au lecteur, qui lisait pour se supprimer (si nous voulons : par cette suppression de son être isolé, se rendre souverain). Sartre, assez arbitrairement, parle d’une forme de communication sacrale, ou poétique, dans laquelle assistants ou lecteurs « se sentent mués en chose [49] ». S’il y a communication, la personne à laquelle s’adresse l’opération, en partie, dans l’instant, se mue elle-même en communication (le changement n’est ni entier ni durable, mais, à la rigueur, il a lieu, sinon, il n’y a pas de communication) ; de toute façon, la communication est le contraire de la chose, qui se définit par l’isolement qu’il est possible d’en faire. Mais en effet, il n’y a pas de communication entre Genet et ses lecteurs à travers son œuvre, et, malgré cela, Sartre assure que cette œuvre est valable : il rapproche l’opération à laquelle elle se ramène de la sacralisation, puis de la création poétique. Genet se serait fait, selon Sartre, « sacrer par le lecteur ».
« A vrai dire, ajoute-t-il aussitôt ; celui-ci n’a pas conscience de ce sacre [50]. » Ceci l’amène à avancer que « le poète... exige d’être reconnu par un public qu’il ne reconnaît pas ». Mais il n’est pas de glissement recevable : j’en arrive à dire avec fermeté que l’opération sacrale, ou la poésie, est communication ou rien. L’œuvre de Genet, quoi qu’on puisse en dire qui en montre le sens, n’est immédiatement ni sacrale ni poétique parce que l’auteur la refuse à la communication.
L’idée de communication est difficile à saisir dans tout le possible qu’elle désigne. Je m’efforcerai plus loin de rendre sensible une richesse dont il est commun de n’avoir jamais conscience, mais je veux dès l’abord insister sur le fait que l’idée de communication, qui implique la dualité, mieux la pluralité, de ceux qui communiquent, appelle, dans les limites d’une communication donnée, leur égalité. Non seulement Genet n’a pas l’intention de communiquer s’il écrit, mais, dans la mesure où, quelle que soit son intention, une caricature ou un ersatz de communication s’établirait, l’auteur refuse à ses lecteurs cette similitude fondamentale que la vigueur de son œuvre risquerait de révéler.
« Son public, écrit Sartre [51], s’abaisse devant lui en acceptant de reconnaître une liberté dont il sait fort bien qu’elle ne reconnaît pas la sienne. » Genet lui-même se place, sinon au-dessus, en dehors de ceux qui sont appelés à le lire. Il prévient, en prenant les devants, le mépris possible (qui pourtant n’est que rarement le fait de ses lecteurs) : « Je reconnais, dit-il, aux voleurs, aux traîtres, aux assassins, aux fourbes une beauté profonde — une beauté en creux — que je vous refuse [52]. » Genet ne connaît pas de règle d’honnêteté : il n’a pas formé le propos de se moquer de son lecteur, mais en fait il s’en moque. Cela ne m’offusque pas, mais j’entrevois l’étendue incertaine où se défont les meilleurs mouvements de Genet. C’est en partie l’erreur de Sartre de le prendre au mot. Nous ne pouvons que rarement — dans le cas de thème lancinants — nous appuyer sur ce qu’il dit. Même alors nous devons nous rappeler l’indifférence avec laquelle il parle au hasard, prêt a nous abuser. Nous arrivons à ce lâchez-tout des règles de l’honnêteté auquel dada ne put parvenir, car l’honnêteté de dada voulait que jamais rien ne prit un sens, que très vite une proposition, paraissant cohérente, perdît une apparence trompeuse. Genet nous parle une fois d’un « adolescent... assez honnête pour se souvenir que Mettray était un paradis [53] ». Nous ne pouvons dénier un caractère pathétique à cet usage ici du mot honnête : la maison de correction de Mettray était un enfer ! à la dureté de la direction s’ajoutaient les violences des « colons » entre eux. Genet lui-même a l’« honnêteté » de revendiquer ces bagnes d’enfants comme le lieu où il trouva le plaisir infernal qui en fit pour son compte un paradis. Mais la maison de correction de Mettray n’était pas très différente de la centrale de Fontevrault (où Genet justement retrouva l’« adolescent » de Mettray) : à bien peu près, le peuplement des deux bagnes est le même. Or Genet, qui souvent exalta les prisons, et ceux qui les hantent, finit par écrire [54] : « Dévêtue de ses ornements sacrés, je vois nue la prison et sa nudité est cruelle. Les détenus ne sont que de pauvres gens aux dents rongées par le scorbut, courbés par la maladie, crachant, crachotant, toussant. Ils vont du dortoir à l’atelier dans d’énormes sabots lourds et sonores, ils se traînent sur des chaussons de drap, percés et rigides d’une crasse que la poussière a composée avec la sueur. Ils puent. Ils sont lâches en face de gâfes, aussi lâches qu’eux. Ils ne sont plus que l’outrageante caricature des beaux criminels que j’y voyais quand j’avais vingt ans et, de ce qu’ils sont devenus, je ne dévoilerai jamais assez les tares, les laideurs, afin de me venger du mal qu’ils m’ont fait, de l’ennui que m’a causé leur inégalable bêtise. » La question ne peut être de savoir si le témoignage de Genet est véridique, mais s’il a fait œuvre littéraire, au sens où la littérature est poésie, où profondément, non formellement, elle est sacrée. Je crois devoir insister à cette fin sur l’intention informe d’un auteur qui n’est jamais porté que par un mouvement incertain, du moins par un mouvement dès l’abord dissocié, tumultueux, mais, dans le fond, indifférent, ne pouvant parvenir à l’intensité de la passion, qui impose, dans l’instant, la plénitude de l’honnêteté.
Genet lui-même ne doute pas de sa faiblesse. Faire œuvre littéraire ne peut être, je le crois, qu’une opération souveraine : c’est vrai dans le sens où l’œuvre demande à l’auteur de dépasser en lui la personne pauvre, qui n’est pas au niveau de ses moments souverains ; l’auteur, autrement dit, doit chercher par et dans son œuvre ce qui, niant ses propres limites, ses faiblesses, ne participe pas de sa servitude profonde. Il peut alors nier, par une réciprocité inattaquable, ces lecteurs sans la pensée desquels son œuvre n’aurait pu même exister, il peut les nier dans la mesure où il s’est lui-même nié. Cela signifie qu’à l’idée de ces êtres indécis qu’il connait, alourdis de servilité, il peut désespérer de l’œuvre qu’il écrit, mais toujours, au delà d’eux-mêmes, ces êtres réels le renvoient à l’humanité jamais lasse d’être humaine, qui jamais ne se subordonne jusqu’au bout, et qui toujours l’emportera sur ces moyens dont elle est la fin. Faire œuvre littéraire est tourner le dos à la servilité, comme à toute diminution concevable, c’est parler le langage souverain qui, venant de la part souveraine de l’homme, s’adresse à l’humanité souveraine. Obscurément (souvent même d’une manière oblique, embarrassée de prétentions), l’amateur de littérature a le sens de cette vérité. Genet lui-même en a le sens, qui précise [55] : « L’idée d’une œuvre littéraire me ferait hausser les épaules. » C’est aux antipodes d’une représentation naïve de la littérature, qui peut être tenue pour pédante, mais qui, malgré son caractère inaccessible, est valable universellement, que l’attitude de Genet se situe. Non que nous devions nous arrêter si nous lisons : « ... j’écrivis pour gagner de l’argent ». Le « travail d’écrivain » de Genet est l’un des plus dignes d’attention. Genet même est soucieux de souveraineté. Mais il n’a pas vu que la souveraineté veut l’élan du cœur et la loyauté, parce qu’elle est donnée dans la communication. La vie de Genet est un échec et, sous les apparences d’une réussite, il en est ainsi de ses œuvres. Elles ne sont pas serviles, elles dominent la plupart des écrits tenus pour « littéraires » : mais elles ne sont pas souveraines, étant dérobées à l’exigence élémentaire de la souveraineté : la loyauté de dernier ressort sans laquelle l’édifice de la souveraineté se défait. L’œuvre de Genet est l’agitation d’un homme ombrageux, dont Sartre put dire [56] : « si on le pousse trop loin dans ses retranchements il éclatera de rire, il avouera sans difficulté qu’il s’est diverti à nos dépens, qu’il n’a cherché qu’à nous scandaliser davantage : s’il s’est avisé de baptiser Sainteté cette perversion démoniaque et sophistiquée d’une notion sacrée... » etc.
L’échec de Genet
L’indifférence à la communication de Genet est à l’origine d’un fait certain : ses récits intéressent, mais ne passionnent pas. Rien de plus froid, de moins touchant, sous l’étincelante parade des mots, que le passage vanté où Genet rapporte la mort d’Harcamone [57]. La beauté de ce passage est celle des bijoux, elle est trop riche et d’un mauvais goût assez froid. Sa splendeur rappelle les éblouissements qu’Aragon prodiguait dans les premiers temps du surréalisme : même facilité verbale, même recours aux facilités du scandale. Je ne crois pas que ce genre de provocation cesse un jour de séduire mais l’effet de séduction est subordonné à l’intérêt d’un succès extérieur, à la préférence pour un faux-semblant, plus vite sensible [58]. Les servilités dans la recherche de ces réussites sont les mêmes chez l’auteur et chez les lecteurs. Chacun de leur côté, auteur et lecteur évitent le déchirement, l’anéantissement, qu’est la communication souveraine, ils se bornent l’un et l’autre aux prestiges de la réussite.
Cet aspect n’est pas le seul. Il serait vain de vouloir réduire Genet au parti qu’il sut tirer de ses dons brillants. A la base, il y eut en lui un désir d’insubordination, mais ce désir, fût-il profond, n’a pas toujours emporté le travail de l’écrivain.
Le plus remarquable est que la solitude morale — et l’ironie — où il s’enlise l’ont maintenu en dehors de cette souveraineté perdue dont le désir l’engagea aux paradoxes dont j’ai parlé. En effet, la recherche de la souveraineté par l’homme aliéné du fait de la civilisation d’une part est à la base de l’agitation historique (qu’il s’agisse de religion, ou de lutte politique, entreprise, selon Marx, en raison de l’« aliénation » de l’homme) ; la souveraineté, d’autre part, est l’objet qui se dérobe toujours, que personne n’a saisi, et que personne ne saisira, pour cette raison définitive : que nous ne pouvons la posséder comme un objet, que nous sommes réduits à la chercher. Une pesanteur aliène toujours dans le sens de l’utilité la souveraineté proposée (jusqu’aux souverains célestes, que pourtant l’imagination aurait pu libérer de toute servitude, se subordonnent à des fins utiles). Dans La Phénoménologie de l’Esprit, Hegel, poursuivant cette dialectique du maître (du seigneur, du souverain) et de l’esclave (de l’homme asservi au travail), qui est à l’origine de la théorie communiste de la lutte des classes, mène l’esclave au triomphe, mais son apparente souveraineté n’est alors que la volonté autonome de la servitude ; la souveraineté n’a pour elle que le royaume de l’échec.
Ainsi ne pouvons-nous parler de la souveraineté manquée de Jean Genet comme si une souveraineté réelle s’y opposait, dont il serait possible de montrer la forme accomplie. La souveraineté à laquelle l’homme n’a jamais cessé de prétendre, n’a jamais été même accessible, et nous n’avons pas lieu de penser qu’elle le deviendra. A la souveraineté dont nous parlons, il nous est possible de tendre... à la grâce de l’instant, sans qu’un effort semblable à celui que nous faisons rationnellement pour nous survivre ait le pouvoir de nous en rapprocher. Jamais nous ne pouvons être souverain. Mais nous faisons la différence entre les moments où la chance nous porte et, divinement, nous éclaire des lueurs furtives de la communication, et ces moments de disgrâce où la pensée de la souveraineté nous engage à la saisir comme un bien. L’attitude de Genet, soucieux de dignité royale, de noblesse et de souveraineté dans le sens traditionnel est le signe d’un calcul voué à l’impuissance. Que l’on songe à ceux, qui jusqu’à nos jours sont légion, qui font de la généalogie leur occupation élective. Genet a sur eux l’avantage d’une démarche en même temps capricieuse et · pathétique. Mais il y a la même maladresse chez l’érudit qu’imposent les titres et chez Genet écrivant ces lignes, qui se réfèrent au temps de ses vagabondages d’Espagne [59] :
« Les carabiniers ni les agents des polices municipales ne m’arrêtaient. Ce qu’ils voyaient passer, ce n’était plus un homme, mais le curieux produit du malheur, auquel on ne peut appliquer les lois. J’avais dépassé les bornes de l’indécence. J’eusse pu, par exemple, sans qu’on s’en étonnât, recevoir un prince du sang, grand d’Espagne, le nommer mon cousin et lui parler le plus beau langage. Cela n’eût pas surpris.
_ » — Recevoir un grand d’Espagne. Mais dans quel palais ? .
_ » Pour vous faire comprendre mieux à quel point j’avais atteint une solitude me conférant la souveraineté, si j’utilise ce procédé de rhétorique, c’est que me l’imposent une situation, une réussite qui s’expriment avec les mots chargés d’exprimer le triomphe du siècle. Une parenté verbale traduit la parenté de ma gloire avec la gloire nobiliaire. Parent des princes et des rois je l’étais par une sorte de relation secrète, ignorée du monde, celle qui permet à une bergère de tutoyer un roi de France. Le palais dont je parle (car cela n’a pas d’autre nom) c’est l’ensemble architectural des délicatesses, de plus en plus ténues, qu’obtenait le travail de l’orgueil sur ma solitude. »
S’ajoutant à d’autres, déjà cités, ce passage ne précise pas seulement la préoccupation dominante d’accéder à la part souveraine de l’humanité. Il souligne le caractère humble et calculateur de cette préoccupation, subordonnée à cette souveraineté dont autrefois l’apparence était historiquement tenue pour réelle. Il souligne en même temps la distance qui sépare le prétendant que désigne sa pouillerie des réussites de surface des grands et des rois.
Consommation improductive et société féodale
Sartre ne méconnaît pas la faiblesse de Genet, qui est de n’avoir pas le pouvoir de communiquer. II représente Genet condamné à se vouloir un être, un objet saisissable pour lui-même, analogue aux choses, non à la conscience — qui est sujet, et pour autant ne peut sans se ruiner se regarder elle-même comme une chose. (D’un bout à l’autre de son étude, il ne cesse d’y insister.) Genet se lie à ses yeux à cette société féodale dont les valeurs désuètes ne cessent pas de l’imposer. Mais cette dernière faiblesse, loin d’amener Sartre à douter de l’authenticité de l’écrivain, lui procure un moyen de le défendre. Il ne dit pas textuellement que seule la société féodale, la société du passé, fondée sur la propriété foncière — et la guerre —, est coupable, mais Genet lui semble justifié devant cette société archaïque, qui eut besoin de lui, de ses méfaits et de son malheur pour répondre à sa propension à gaspiller (pour réaliser cette fin qu’est la destruction des biens, la consommation). Le seul tort de Genet est d’être moralement la créature de cette société, qui n’est pas morte, mais condamnée (qui est seulement en voie de disparition). C’est de toute façon le tort qu’a la société vieillissante à l’égard de la société nouvelle, qui tente politiquement de l’emporter. Sartre développe généralement l’opposition de la société condamnable, qui est la « société de consommation », et de la société louable, qu’il appelle de ses vœux, qui est la « société de productivité », qui répond à l’effort de l’U.R.S.S. [60] Autant dire que le Mal et le Bien se lient au nuisible et à l’utile. Bien entendu, nombre de consommations sont plus utiles que nuisibles, mais ce ne sont pas de pures consommations, ce sont des consommations productives, qui sont à l’opposé de cet esprit féodal de consommation par goût de consommer que Sartre condamne. Sartre allègue Marc Bloch [61], parlant d’ « une singulière compétition de gaspillage dont fut un jour le théâtre une grande « cour » tenue en Limousin. Un chevalier fait semer de piécettes d’argent un terrain préalablement labouré, un autre, pour sa cuisine, brûle des cierges ; un troisième, « par jactance » , ordonne de brûler vif tous ses chevaux [62] ». Devant ces faits, la réaction de Sartre ne peut surprendre : c’est l’indignation commune qui, la part faite à la rigueur à la détente, a généralement pour objet toute consommation qu’une utilité ne justifie pas. Sartre ne comprend pas que, justement, la consommation inutile s’oppose à la production comme le souverain au subordonné, comme la liberté à la servitude. Il condamnera sans hésiter ce qui relève de la souveraineté, dont j’ai moi-même admis le caractère « fondamentalement » condamnable. Mais la liberté ?
La liberté et le mal
Révéler dans la liberté le Mal est à l’opposé d’une manière de penser conventionnelle, conformiste, et si générale, que la contestation n’en est pas concevable. Sartre au premier chef niera que la liberté doive nécessairement être le Mal. Mais il donne à la « société de productivité » la valeur, avant d’en avoir reconnu la nature relative : pourtant, cette valeur est relative à la consommation, essentiellement même à la consommation improductive, c’est-à-dire à la destruction. Si nous cherchons la cohérence de ces représentations, il apparaît vite que la liberté, même une fois réservés des rapports possibles avec le Bien, est, comme Blake le dit de Milton, « du côté du démon sans le savoir ». Le côté du Bien est celui de la soumission, de l’obéissance. La liberté est toujours une ouverture à la révolte, et le Bien est lié au caractère fermé de la règle. Sartre lui-même en arrive à parler du Mal en termes de liberté : ...« rien de ce qui est, dit-il [63], parlant à propos de Genet de l’« expérience du Mal », ne peut me définir ou me limiter ; cependant j’existe, je serai le souffle glacé qui anéantira toute vie. Donc je suis au-dessus de l’essence : je fais ce que je veux, je me fais ce je veux... ». En tout cas, nul ne peut aller — comme Sartre veut le faire apparemment — de la liberté à la conception traditionnelle du Bien conforme à l’utile [64].
Une seule voie mène du refus de la servitude à la libre limitation de l’humeur souveraine : cette voie que Sartre ignore est celle de la communication. C’est seulement si la liberté, la transgression des interdits et la consommation souveraine, sont envisagées dans la forme où elles sont données en fait que se révèlent les bases d’une morale à la mesure de ceux que la nécessité n’incline pas entièrement et qui ne veulent pas renoncer à la plénitude entrevue.
La communication authentique, l’impénétrabilité de tout « ce qui est »
et la souveraineté
L’intérêt de l’œuvre de Jean Genet ne vient pas de sa force poétique, mais de l’enseignement qui résulte de ses faiblesses. (De même la valeur de l’essai de Sartre découle moins d’une parfaite mise en lumière que d’un acharnement à chercher là où règne l’obscurité.)
Il y a dans les écrits de Genet je ne sais quoi de frêle, de froid, de friable, qui n’arrête pas forcément l’admiration mais qui suspend l’accord. L’accord, Genet lui-même le refuserait, si par une erreur indéfendable, nous voulions le lui apporter. Cette communication se dérobant quand le jeu littéraire en apporte l’exigence peut laisser. une sensation de grimace, il importe peu si le sentiment d’un manque renvoie en nous à la conscience de la fulguration qu’est la communication authentique. Dans la dépression résultant de ces échanges insuffisants, où une cloison vitreuse est maintenue qui nous sépare, lecteurs, de cet auteur, j’ai cette certitude : l’humanité n’est pas faite d’êtres isolés, mais d’une communication entre eux ; jamais nous ne sommes donnés, fût-ce à nous-mêmes, sinon dans un réseau de communications avec les autres : nous baignons dans la communication, nous sommes réduits à cette communication incessante dont, jusque dans le fond de la solitude, nous sentons l’absence, comme la suggestion de possibilités multiples, comme l’attente d’un moment où elle se résout en un cri que d’autres entendent. Car l’existence humaine n’est en nous, en ces points où périodiquement elle se noue, que langage crié, que spasme cruel, que fou rire, où l’accord naît d’une conscience enfin partagée [65] de l’impénétrabilité de nous mêmes et dumonde.
La communication, au sens où je voudrais l’entendre, n’est en effet jamais plus forte qu’au moment où la communication au sens faible, celle du langage profane (ou, comme dit Sartre, de la prose, qui nous rend à nous-mêmes — et qui rend le monde — apparemment pénétrables) s’avère vaine, et comme une équivalence de la nuit. Nous parlons de diverses façons pour convaincre et chercher l’accord [66]. Nous voulons établir d’humbles vérités qui coordonnent à celles de nos semblables nos attitudes et notre activité. Cet incessant effort visant à nous situer dans le monde d’une manière claire et distincte serait apparemment impossible si nous n’étions d’abord liés par le sentiment de la subjectivité commune, impénétrable pour elle-même, à laquelle est impénétrable le monde des objets distincts. A tout prix, nous devons saisir l’opposition entre deux sortes de communications, mais la distinction est difficile : elles se confondent dans la mesure où l’accent n’est pas mis sur la communication forte. Sartre lui-même a laissé là-dessus une confusion : il a bien vu (il y insiste dans La Nausée) le caractère impénétrable des objets : en aucune mesure les objets ne communiquent avec nous. Mais il n’a pas situé de façon précise l’opposition de l’objet et du sujet. La subjectivité est claire à ses yeux, elle est ce qui est clair ! Il est d’une part enclin, me semble-t-il, à minimiser l’importance de cette intelligibilité des objets que nous apercevons dans les fins que nous leur donnons, et dans leur usage à ces fins. D’autre part, son attention ne s’est pas suffisamment portée sur ces moments d’une subjectivité qui, toujours et immédiatement, nous est donnée dans la conscience des autres subjectivités, où la subjectivité justement apparaît inintelligible, relativement à l’intelligibilité des objets usuels et, plus généralement, du monde objectif. Cette apparence, il ne peut évidemment l’ignorer, mais il se détourne des moments où nous en avons également la nausée, parce que, dans l’instant où l’inintelligibilité nous apparait, elle présente à son tour un caractère insurmontable, un caractère de scandale. Ce qui est, en dernier lieu pour nous, est scandale, la conscience d’être est le scandale de la conscience, et nous ne pouvons
— même nous ne devons pas — nous en étonner. Mais nous ne pouvons pas nous payer de mots : le scandale est la même chose que la conscience, une conscience sans scandale est une conscience aliénée, une conscience, l’expérience le montre, d’objets clairs et distincts, intelligibles ou crus tels. Le passage de l’intelligible à l’inintelligible, à ce qui, n’étant plus connaissable, soudain ne nous semble plus tolérable, est certainement à l’origine de ce sentiment de scandale, mais il s’agit moins d’une différence de niveau que d’une expérience donnée dans la communication majeure des êtres. Le scandale est le fait — instantané — qu’une conscience est conscience d’une autre conscience, est regard d’un autre regard (elle est de cette manière intime fulguration, s’éloignant de ce qui d’habitude attache la conscience à l’intelligibilité durable et apaisante des objets).
On voit, si l’on m’a suivi, qu’il existe une opposition fondamentale entre la communication faible, base de la société profane (de la société active — au sens où l’activité se confond avec la productivité) et la communication forte, qui abandonne les consciences se réfléchissant l’une l’autre, ou les unes les autres, à cet impénétrable qui est leur « en dernier lieu ». On voit en même temps que la communication forte est première, c’est un donné simple, apparence suprême de l’existence, qui se révèle à nous dans la multiplicité des consciences et dans leur communicabilité. L’activité habituelle des êtres — ce que nous appelons « nos occupations » — les sépare des moments privilégiés de la communication forte, que fondent les émotions de la sensualité et des fêtes, que fondent le drame, l’amour, la séparation et la mort. Ces moments ne sont pas eux-mêmes égaux entre eux : souvent, nous les recherchons pour eux-mêmes (alors qu’ils n’ont de sens que dans l’instant et qu’il est contradictoire d’en concerter le retour) ; nous pouvons y parvenir à l’aide de pauvres moyens. Mais il n’importe : nous ne pouvons nous passer de la réapparition (fût-elle douloureuse, déchirante) de l’instant où leur impénétrabilité se révèle aux consciences qui s’unissent et se pénètrent d’une manière illimitée. Plutôt tricher en vue de ne pas être définitivement ou trop cruellement déchiré : nous maintenons avec le scandale qu’à tout prix nous voulons soulever, auquel néanmoins nous tentons d’échapper — un lien indéfectible, mais le moins douloureux que nous pouvons, en l’espèce de la religion ou de l’art (de l’art qui hérita une partie des puissances de la religion). La question de la communication est toujours posée dans l’expression littéraire : celle-ci est en effet poétique ou n’est rien (n’est que la quête d’accords particuliers, ou l’enseignement de vérités subalternes que Sartre désigne [67] en parlant de prose).
La souveraineté trahie
Il n’y a nulle différence entre la communication forte ainsi représentée et ce que j’appelle souveraineté. La communication suppose, dans l’instant, la souveraineté de ceux qui communiquent entre eux, et réciproquement, la souveraineté suppose la communication ; elle est, en intention, communicable, sinon elle n’est pas souveraine. Il faut dire en insistant que la souveraineté est toujours communication, et que la
communication, au sens fort, est toujours souveraine. Si nous nous tenons à ce point de vue, l’expérience de Genet est d’un intérêt exemplaire. ·
Pour donner le sens de cette expérience, qui n’est pas seulement celle d’un écrivain, mais d’un homme qui transgressa toutes les lois de la société — tous les interdits sur lesquels la société se fonde — je devrai partir d’un aspect proprement humain de la souveraineté et de la communication. En tant qu’elle diffère de l’animalité, l’humanité découle de l’observation d’interdits, dont certains sont universels ; tels sont les principes qui s’opposent à l’inceste, au contact du sang menstruel, à l’obscénité, au meurtre, à la consommation de la chair humaine ; en premier lieu, les morts sont l’objet de prescriptions variant suivant le temps et les lieux, auxquelles personne ne doit contrevenir. La communication ou souveraineté sont données dans le cadre de vie déterminé par les interdits communs (auxquels s’ajoutent localement de nombreux tabous). Ces diverses limitations contreviennent sans nul doute, encore qu’à divers degrés, à la plénitude de la souveraineté. Nous ne pouvons nous étonner si la recherche de la souveraineté se lie à l’infraction d’un ou de plusieurs interdits. Je donnerai pour exemple le fait qu’en Egypte le souverain était excepté de la prohibition de l’inceste. De même, l’opération souveraine qu’est le sacrifice a un caractère de crime ; mettre à mort la victime est agir à l’encontre le prescriptions valables en d’autres circonstances. Plus généralement, dans le « temps souverain » d’une fête, des conduites contraires aux lois du « temps profane sont admises ou commandées. Ainsi la voie de création d’un élément souverain (ou sacré) — d’un personnage institutionnel ou d’une victime offerte à la consumation — est-elle une négation de l’un, de ces interdits dont l’observation générale fait de nous des êtres humains, non des animaux. Cela veut dire que la souveraineté, dans la mesure où l’humanité s’efforce vers elle, nous demande de nous situer « au-dessus de l’essence » qui la constitue. Cela veut dire aussi que la communication majeure ne peut se faire qu’à une condition, que nous recourrions au Mal, c’est-à-dire à la violation de l’interdit [68].
L’exemple de Genet répond exactement à l’attitude classique en ce qu’il chercha la souveraineté dans le Mal, et que le Mal, en effet, lui donna ces moments vertigineux où il semble qu’en nous, l’être est disjoint, et où, bien qu’il survive, il échappe à l’essence qui le limitait. Mais Genet se refuse à la communication.
C’est pour se refuser à la communication que Genet n’atteint pas le moment souverain — où il cesserait de tout ramener à ses préoccupations d’être isolé, ou, comme dit Sartre, d’« être » tout court ; c’est dans la mesure où il s’abandonne sans limite au Mal que la communication lui échappe. Tout s’éclaire à ce point : ce qui enlise Genet tient à la solitude où il s’enferme, où ce qui subsiste des autres est toujours vague, indifférent : c’est en un mot qu’il fait à son solitaire profit le Mal auquel il eut recours afin d’exister exige est nécessairement limité : la souveraineté elle-même le limite. Elle s’oppose à ce qui l’asservit dans la mesure où elle est communication. Elle s’y oppose avec ce mouvement souverain qui exprime un caractère sacré de la morale.
J’admets que Genet voulut devenir sacré.
J’admets qu’en lui le goût du Mal dépassa le souci de l’intérêt, qu’il voulut le Mal pour une valeur spirituelle, et qu’il mena son expérience sans fléchir. Aucun motif vulgaire ne rendrait compte de son échec, mais comme en une prison mieux fermée que les prisons réelles un sort néfaste l’enferma en lui-même, au fond de sa méfiance. Jamais il ne se livra sans réticences aux déraisonnables mouvements qui accordent les êtres en vertu d’un grand désordre, mais les accordent à cette condition, que ne veille pas en eux un regard louche, rivé à la différence de soi-même et des autres. Sartre a parlé remarquablement de cette tristesse sournoise qui noue Genet.
Une admiration littéraire, en partie surfaite, n’a pas empêché Sartre — elle lui a même permis — d’exprimer sur Genet des jugements dont la sévérité, tempérée par une sympathie profonde, est souvent cinglante. Sartre insiste sur ce point : Genet, qu’agitent les contradictions d’une volonté vouée au pire, encore qu’il cherche
« l’impossible Nullité [69] », revendique finalement l’être pour son existence. Il veut saisir son existence, il lui faut parvenir à l’être, il lui faut se donner à lui-même l’être des choses... Il faudrait que « cette existence pût être sans avoir besoin de jouer son être : en soi [70] ». Genet veut se « pétrifier en substance » et s’il est vrai que sa recherche vise, comme le dit Sartre, ce point, qu’a défini Breton en cette formule, l’une des meilleures approches de la souveraineté, « d’où la vie et la mort, le réel et l’imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l’incommunicable, le haut et le bas cessent d’être perçus contradictoirement... », cela ne peut aller sans une altération fondamentale. En effet, Sartre ajoute : « ...le surréel, Breton espère, sinon le "voir", du moins se confondre avec lui dans une indistinction où vision et être ne font, qu’un... » Mais « la sainteté de Genet », c’est « le surréel de Breton saisi comme le revers inaccessible et substantiel de l’existence... » [71], c’est la souveraineté confisquée, la souveraineté morte, de celui dont le désir solitaire de souveraineté est trahison de la souveraineté.
Georges Bataille, La littérature et le mal, Gallimard, 1957, p. 185-226.
Pour qui sonne le glas ?
C’est dans Glas de Jacques Derrida (Galilée, 1974) qu’on peut lire la « critique » de la lecture que Bataille fait de Genet dans La littérature et le mal (vingt ans ont passé). Impossible de reproduire ici (l’ordinateur et, surtout, mon incompétence ne le permettent pas [72]) l’architecture complexe d’un texte comme Glas dont Derrida dira plus tard : « ce livre n’est pas lu ». Le « prière d’insérer » (inséré sous la forme d’une feuille volante dans mon édition originale, couverture grise, forme carrée) prévient :
D’abord : deux colonnes. Tronquées, par le haut et par le bas, taillées aussi dans leur flanc : incisés, tatouages, incrustations. Une première lecture peut faire comme si deux textes dressés, l’un contre l’autre ou l’un sans l’autre, entre eux ne communiquaient pas. Et d’une certaine façon délibérée, cela reste vrai, quant au prétexte, à l’objet, à la langue, au style, au rythme, à la loi. Une dialectique d’un côté, une galactique de l’autre, hétérogènes et cependant indiscernables dans leurs effets, parfois jusqu’à l’hallucination. Entre les deux, le battant d’un autre texte, on dirait d’une autre « logique » : aux surnoms d’obséquence, de penêtre, de stricture, de serrure, d’anthérection, de mors, etc.
Pour qui tient à la signature, au corpus et au propre, déclarons que, mettant en jeu, en pièces plutôt, mon nom, mon corps et mon seing, j’élabore d’un même coup, en toutes lettres, ceux du dénommé Hegel dans une colonne, ceux du dénommé Genet dans l’autre. On verra pourquoi, chance et nécessité, ces deux-là. La chose, donc, s’élève, se détaille et détache selon deux tours, et l’accélération incessante d’un tour-à tour. Dans leur double solitude, les colosses échangent une infinité de clins, par exemple d’œil, se doublent à l’envi, se pénètrent, collent et décollent, passant l’un dans l’autre, entre l’un et dans l’autre. Chaque colonne figure ici un colosse (colossos), nom donné au double du mort, au substitut de son érection. Plus qu’un, avant tout.
Deux colonnes : Jean Genet, dans Tel Quel n°29 (avril 1967), avait présenté en double colonne son texte « Ce qui est resté d’un Rembrandt déchiré en petits carrés bien réguliers, et foutu aux chiottes ». Glas commence par s’y référer (deuxième colonne, p. 7).
Exemple : la page 242 où commence à s’inscrire (colonne de droite) la lecture que Derrida fait du texte de Bataille, « un contemporain (le fait importe beaucoup) », sur Genet, tandis que la colonne de gauche discourt sur Freud, le tabou, l’Impératif Catégorique (IC), Kant et « l’obscure philosophie hegelienne ».

Feignons d’oublier la colonne de gauche, Hegel et la dialectique. Qu’écrit Derrida dans la colonne de droite ?
Qu’est-ce que la poésie ? Qu’est-ce qui bande : ce texte, séduit et trouble le discours doctoral introduit un écart (un « Grand Carré ») dans la pièce où le patient se déshabille, se couche, ne dit finalement rien, fait en revanche bégayer le maître. Quelques jours après, celui-ci envoie un manuscrit dédicacé à l’écrivain patient : avec mon admiration. C’est bon, n’est-ce pas ? C’est un peu comme ce que vous faites, non. L’écrivain ne répond pas. Il n’est surtout pas assez puceau pour dire qu’il occupe la place de l’autre.

Le texte est grappu.
D’où la nervosité perméable et séduite, agenouillée, de qui voudrait le prendre, le comprendre, se l’approprier.
Il y est traité de l’ersatz, en langue étrangère de ce qu’on pose et rajoute à la place.
La thèse (la position, la proposition, Satz) protège ce qu’elle remplace, cependant.
Or voici qu’un contemporain (le fait importe beaucoup) que tout, sinon son propre glas, aurait dû préparer à lire la scène, se démonte, ne veut plus voir, dit le contraire de ce qu’il veut dire, part en guerre, monte sur ses grands chevaux.
L’ersatz, dit-il, ce n’est pas bien [73].
Alliance difficilement explicable avec Sartre. Et pourtant : « Sartre a marqué lui-même une étrange difficulté à la base de l’œuvre de Genet. Genet, qui écrit, n’a ni le pouvoir ni l’intention de communiquer avec ses lecteurs. L’élaboration [visiblement pas fait exprès] de son œuvre a le sens d’une négation de ceux qui la lisent. Sartre l’a vu sans en tirer la conclusion : que dans ces conditions, cette œuvre n’était pas tout à fait une œuvre, mais un ersatz, à mi-chemin de cette communication majeure à laquelle prétend la littérature. La littérature est communication.
Elle part d’un auteur souverain, par delà les servitudes d’un lecteur isolé, elle s’adresse à l’humanité souveraine. [...]
« Non seulement Genet n’a pas l’intention de communiquer s’il écrit, mais, dans la mesure où, quelle que soit son intention, une caricature ou un ersatz de communication s’établirait, l’auteur refuse à ses lecteurs cette similitude fondamentale
que la vigueur de son œuvre risquerait de révéler. [...]
« Genet lui-même ne doute pas de sa faiblesse.
Faire œuvre littéraire ne peut être, je le crois, qu’une opération souveraine : c’est vrai dans le sens où l’œuvre demande à l’auteur
de dépasser en lui la personne pauvre, qui n’est pas au niveau de ses moments souverains. [...]
« Non que nous devions nous arrêter si nous lisons : "... j’écrivis pour gagner de l’argent."
et pourquoi ne pas nous y arrêter ? Qui a dit qu’il n’était pas convenable d’écrire pour de l’argent ? Qui a pu le dire ? L’argent, c’est mal ? C’est quoi au juste ? Et pourquoi ne pas se demander comment on a pu écrire ça ? Qui ? pour qui ? pourquoi ?
"Je m’écoute" s’égale, en grec, à "je suis mon premier client".Critique du jugement : « l’art est aussi distingué du métier ; le premier s’appelle libéral (freie), le second peut aussi s’appeler mercenaire [...] le bel art doit être un art libre en deux sens : il ne doit pas être, comme une activité rémunérée, un travail dont l’importance serait évaluée selon une mesure déterminée, que l’on pourrait imposer ou rétribuer ; d’autre part il faut que l’esprit se sente occupé, mais satisfait et excité sans considérer un autre but (indépendamment de tout salaire). »
Par qui, et de quoi, l’« auteur » est-il alors payé ? nourri ? Par une instance économique (libérale), représentée par un marché éditorial (libéral), un ministère de la culture (libéral), voire par Frédéric le Grand, poète et monarque libéral.
A moins qu’il ne vole ? Est-ce encore pire ou autre chose qu’écrire « pour de l’argent » ? Est-ce changer de système ? En tous cas, l’esthète libéral n’aime pas ça. Mais on voit une fois de plus qu’il suffit d’un rien pour que le motif de la dépense pure et hors circulation se laisse réinscrire dans l’échange de l ’économie restreinte (ici libérale). Mais que se passe-t-il quand un rien suffit ? Le risque (la confortable compromission aussi) habite le risque. Le maître peut toujours habiter chez le souverain
"Le "travail d’écrivain" de Genet est l’un des plus dignes d’attention. Genet même est soucieux de souveraineté.
Mais il n’a pas vu que la souveraineté veut l’élan du cœur et la loyauté, parce qu’elle est donnée dans la communication. [...]


L’indifférence à la communication de Genet est à l’origine d’un fait certain : ses récits intéressent mais ne passionnent pas. Rien de plus froid, de moins touchant, sous l’étincelante parade des mots, que le passage vanté où Genet rapporte la mort d’Harcamone. La beauté de ce passage est celle des bijoux, elle est trop riche et d’un mauvais goût assez froid. [...] il y a la même maladresse chez l’érudit qu’imposent les titres et chez Genet écrivant ces lignes qui se réfèrent au temps de ses vagabondages d’Espagne [citation du « palais
il faudrait, entre autres constructions du même genre, circuler à travers tous les palais, dans le labyrinthe, oui, entre tous les palais (le Palais de justice de Notre-Dame, le palais du grand d’Espagne, où nous sommes, le « voile du palais » de Stilitano, « cette toile d’araignée précieuse » où s’élaborent les les gl’s. On s’apercevrait alors, à y séjourner un peu et à y faire un peu travailler sa langue, que le palais est ce précisément dont je parle. Beaucoup. J’argotise, je jargonne, j’ai l’air de produire des mots nouveaux, un nouveau lexique. Un argot seulement, un jargon. Ils sortent tous deux du fond de la gorge, ils séjournent, un certain temps, comme un gargarisme, au fond du gosier, on racle et on crache.L’argot est un mot d’argot. Comme tous les mots d’argot, Littré ne le mentionne pas. Argotiser c’est travailler contre le lexique. Mais en argumentant, en élaborant, en alléguant, depuis le dedans de son corpus. Argot est un très vieux mot, enraciné dans la langue et dans la littérature. Comme jargon. Et pourtant, son usage est d’abord argotique, limité à une bande ou à une école

le cœur, vraiment n’y est pas
dont je parle (car cela n’a pas d’autre nom) »]. L’intérêt de l’œuvre de Jean Genet ne vient pas de sa force poétique, mais de l’enseignement qui résulte de ses faiblesses. [...]
Il y a dans les écrits de Genet je ne sais quoi de frêle, de froid, de friable, qui n’arrête pas forcément l’admiration mais qui suspend l’accord. »
A quoi, malgré tout, reconnaît-on ici qu’il s’agit d’un texte de Bataille ? Malgré tout, malgré le Langage des fleurs [74], malgré (?) Le glas, malgré
« Le glas
Dans ma cloche voluptueuse
le bronze de la mort danse
le battant d’une pine sonne
un long branle libidineux. »Elaborations.
« Le ciel
1. Le bronze de l’amour sonne
Le battant rouge de ta pine
dans la cloche de mon con2. Le battant chauve de ton glas
dans la cloche (biffé : de mon vagin
de mon urine) du con
le bronze de l’amour sonne
le long branle voluptueux3. Le bronze de l’amour danse
le long branle voluptueux
et le battant chauve du glas
sonne et sonne et sonne et sonne
dans ma cloche libidineuse4. Dans ma cloche libidineuse
le bronze de la mort sonne
le battant de la verge danse
le long branle voluptueux. »
G. Bataille
ce qui aurait dû, suivant la logique générale de sa
pensée (le simulacre, la souveraineté comme limite intenable, la transgression, la perte, etc.), l’induire à une autre lecture ? Si ce qu’il faut bien appeler l’académisme sentencieux de ce discours édifiant n’est pas tout à fait un accident, s’il y a là un effet logique d’aveuglement, de dénégation, d’inversion négative (comme on dit — et ce n’est pas simplement, ici, une figure — que la névrose est le négatif de la perversion) c’est peut-être que le système le permet. Tout peut y virer à chaque instant vers la prédication la plus policée — sinistre, morale et dérisoirement réactive. Limite instable, inaccessible, la souveraineté, avec tout son système (simulacre, expropriation, perte, rire majeur, etc.) est toujours en train de basculer dans la métaphysique (vérité, authenticité, propriété, maîtrise). Elle peut toujours se lire dans le code qu’elle renverse, qu’elle fait plus que renverser mais doit aussi renverser. Il suffit, pour que la lecture métaphysique s’impose, d’un rien, d’un rien logique ou linguistique ou discursif :
l’affect d’une identification intolérable (de quoi a-t-il peur ? de quoi est-il incapable ?) provoque une décision interprétative. Le négatif rentre alors en scène. La décision n’est pas ici un acte de liberté souveraine. C’est une position. Qui ne peut pas se voir, en peinture, inversée. Mais se laisse, dès lors, observer, signer, assigner, affecter, depuis la place de Rembrandt.
Rappelez-vous, c’est lui qui vous lit.
Les docteurs, en son temps, sont donc venus vers lui et ne l’ont pas reconnu.
Jacques Derrida, Glas, Galilée, 1974, p. 242-248.

Rembrandt, Jésus s’entretenant avec les docteurs.
Photo (C) RMN-Grand Palais / Thierry Le Mage. Zoom : cliquez l’image.


Laissons provisoirement le dernier mot à Bernard Sichère. Dans Le Dieu des écrivains (Gallimard, coll. L’infini, 1999), l’un de ses plus beaux livres, le philosophe commence son texte sur « l’athéologie de Jean Genet » par un retour sur cet étrange scène triangulaire qui réunit et opposa, en 1952, Sartre, Bataille et Genet (ce dernier à son corps défendant). Presque cinquante ans ont passé...
L’athéologie de Jean Genet
par Bernard Sichère
Extraits.
La parution, en 1952, du Saint Genet de Sartre aura décidément représenté un événement de grande ampleur, dont tout indique qu’il est important d’y revenir aujourd’hui afin d’en prendre l’exacte mesure et de mieux comprendre ce qui a pu se jouer là, à une date finalement assez récente, d’une longue histoire passionnelle entre la philosophie et la littérature ou le poème. Livre passionnant, révélant la violence de la guerre engagée entre philosophie et littérature, en tout cas entre une certaine philosophie et ce qui dans la littérature moderne manifeste une proximité énigmatique à la dimension de la sainteté, jusque-là principalement définie dans notre culture par le discours et le dogme de l’Eglise chrétienne. Quelque chose d’essentiel, visiblement, se joue là entre une philosophie qui ne veut rien savoir de la religion et de la théologie et cette puissance nouvelle d’une littérature prenant en charge cette dimension de la subjectivité, du sujet au destin, jusque-là commandé par le discours chrétien où s’assurait l’entrelacs complexe et savant du désir, de la jouissance et de l’amour : autant dire que le débat, toujours actuel, entre la philosophie et la littérature est aussi le débat de la philosophie avec ce qu’elle entend et ce qu’elle ne veut pas entendre de la théologie jusque dans la littérature. Nous avons vu comment cette vérité venait au jour dans l’intervention singulière de Bataille, de « saint Bataille » [75] jouant ensemble la philosophie, l’expérience érotique, la fiction et la théologie ou la mystique, dans le moment où Heidegger de son côté déplace l’ensemble du socle philosophique à partir de Nietzsche et du poème de Hölderlin. A cet égard, le livre de Sartre sur Genet est un révélateur passionnant, un énorme symptôme qui en dit long sur le refoulé de la raison philosophique moderne, un discours, en somme, qui parle sans savoir et qui dit vrai tout le temps surtout là où il ne le sait pas, dans la violence de ses attaques, dans ses ratés, dans la complexité de ses ruses. Un symptôme au reste surdéterminé si nous restituons l’espace d’ensemble à l’intérieur duquel il prend place.
Il se trouve en effet qu’il s’agit finalement d’un règlement de comptes à trois pôles, entre Sartre, Genet et Bataille [76]. En 1952, Bataille est loin d’être inexistant, et même si la gloire de Sartre est alors à son sommet, lui-même est en train de rédiger le manuscrit de L’érotisme et demeure le directeur de la puissante revue Critique. C’est d’ailleurs à ce titre qu’il se saisit de l’occasion inespérée que représente pour lui la publication du livre de Sartre pour s’expliquer à la fois avec la philosophie en la personne de Sartre, et avec une certaine définition de la littérature en la personne de Genet. Intervention polémique mais qui laisse entendre l’importance, à ses yeux, de l’enjeu : « Tout concourt à faire de ce livre un monument : son étendue d’abord et l’excessive intelligence que l’auteur y montre, la nouveauté et l’intérêt renversant du sujet, mais aussi l’agressivité qui étouffe et le mouvement précipité que le ressassement, accentue, qui parfois en rend pénible l’assurance. A la fin, le livre laisse un sentiment de désastre confus et d’universelle duperie, mais il met en lumière la situation de l’homme actuel, refusant tout, révolté, hors de lui [77]. » Curieux texte, aussi passionnel finalement à l’égard de Sartre qu’à l’égard de Genet : chaque mot porte dans une explication entre deux pensées majeures qui ne fut jamais aussi directe, qui l’est même plus que dans le moment où Sartre dénonçait L’expérience intérieure et où Bataille répliquait en conviant Sartre à sa conférence sur le péché, tout en sachant parfaitement, non seulement que Sartre n’aurait avec lui aucun point d’accord, mais tout simplement ne le comprendrait pas. Cette fois, ripostant à Sartre parlant de Genet, Bataille entend faire d’une pierre deux coups en intervenant au nom de sa propre conception de la pensée et de la littérature que condense le mot « souveraineté ». Sartre a en un sens raison de parler de l’échec de Genet mais, parce que sa philosophie est fermée à une telle notion, il ne voit pas que cet échec tient à ce que l’œuvre de Genet ne saurait incarner la souveraineté en tant que « communication majeure » et dépense sans compter. Sartre a raison, mais Sartre a tort en ne pensant pas l’échec de Genet jusqu’au bout, d’où le diagnostic particulièrement sévère : « mouvement précipité », « ressassement », « désastre confus », enfin « universelle duperie » dont on ne sait s’il faut l’attribuer à Sartre, à Genet déteignant sur Sartre ou plus généralement à cet homme « révolté » et « refusant tout » qui serait le signe de l’époque (« l’impasse d’une transgression illimitée »). Il est à regretter, en somme, que cette démonstration, qui souvent touche juste, soit aussi longue et embarrassée (« jamais il n’ânonna sa pensée plus longuement ») et surtout aussi haineuse (« agressivité qui étouffe »).
Si les propres motivations de Bataille demandent à être à leur tour éclaircies (à l’égard de Genet comme à l’égard de Sartre), il est manifeste qu’il tombe juste, en particulier sur le dernier point, sur le ressort passionnel du livre de Sartre, qui s’annonçait comme un éloge et qui est tout de même, dès les premières pages, un enterrement de première classe comme on en a rarement vus. On connaît les circonstances : Sartre faisant entrer l’œuvre de Genet chez Gallimard par la grande porte moyennant le caviardage de quelques passages jugés trop ouvertement sexuels avec l’approbation de Genet, mais sous la forme des Œuvres complètes, ce qui veut bien dire que Genet n’écrira plus, et avec cette condition supplémentaire que l’essai de Sartre constituera le premier tome de ces Œuvres, procédé littéralement sans précédent. Voici donc Genet dans la pénible situation de voir paraître comme premier volume de ses propres œuvres un livre de Sartre expliquant noir sur blanc que Genet est mort et que lui, Sartre, est venu prononcer son éloge funèbre [78]. Un éloge bien étrange, puisqu’il s’agit finalement de montrer que cette œuvre est une œuvre manquée. Un doute évidemment nous prend : si cela était vrai, est-il bien vraisemblable qu’il ait fallu à Sartre près de six cents pages pour s’expliquer avec une œuvre ratée ? C’est donc que cette œuvre n’est pas ce qu’il en dit, qu’elle est vertigineuse et que Sartre le premier est pris dans ce vertige à son corps défendant, pris dans ce mouvement violent d’amour et de haine qu’on appelle une passion... ou un transfert. Aveugle à sa propre passion sans doute, Bataille a vu juste sur celle de Sartre et, le premier, il donne à lire le Saint Genet comme un symptôme : que ce gros livre soit la « passion » de Sartre veut dire à la fois qu’il y trouve son propre chemin de croix et qu’il n’aura jamais été aussi loin, grâce à Genet, dans son explication avec lui-même, dans l’exploration des conditions inconscientes de sa propre pensée. Ce qui littéralement l’affole, en effet, dans l’œuvre de Genet comme hier dans celle de Bataille, c’est très exactement ce point de nouage, dérobé à toute philosophie de la conscience, entre la vérité sexuelle et la vérité théologique. Sartre bien sûr n’est pas sans le savoir, comme déjà l’étrangeté de son titre le démontre : ce titre renvoie à la fois à l’inscription au cœur du texte de Genet du mot « sainteté » (« saint » Genet) et à la figure tragique du comédien Genest dans la pièce homonyme de Rotrou, tragédie qui s’achève, rappelons-le tout de même pour prendre toute la mesure de l’ambivalence des sentiments de Sartre à l’égard de Genet, par le supplice du comédien sur l’ordre de l’empereur. Donc Genet acteur comme son quasi-homonyme Genest, Genet vrai faux chrétien (nous avons vu que cette question obsède littéralement Sartre face à Bataille dans « Un nouveau mystique »), Genet jouant à la sainteté (mais qu’est-ce donc qu’un vrai saint ?), à la fois personnage dans le texte et signature au cœur d’un théâtre labyrinthique et baroque. À la condition d’ajouter encore cette dimension que le titre n’indique pas : c’est ouvertement et d’emblée que Genet, tout comme Jouhandeau, place son œuvre sous le signe de la singularité sexuelle, de l’homosexualité. Or c’est là le point essentiel dans le débat violent et mortel, le mot n’est pas trop fort, entre Sartre affolé par Genet et Genet enterré vivant par Sartre sous les fleurs, un combat dont il n’est pas certain d’ailleurs que Genet soit en dernière instance le vaincu. La démonstration de Sartre est forte, en effet, et ses intuitions souvent tombent juste, mais dès lors que sa singularité sexuelle affichée conduit Genet à une rébellion déclarée face à toute norme et à tout ordre social, il est clair qu’à son tour il met Sartre dans la position délicate d’avoir à s’expliquer sur sa propre relation à l’ordre et à la norme, à l’ordre social et à la norme sexuelle et morale comme il ne l’avait précisément jamais fait. S’il est vrai que Sartre est le philosophe de la liberté radicale définie comme négation de toute finitude, de toute limite factuelle, de toute valeur présupposée, s’il est vrai qu’il est le philosophe de la révolte, comment ne se reconnaît-il pas dans celui qui clame avec une telle force les droits de la révolte face à cet ordre des ordres qu’est l’ordre bourgeois défini par Sartre lui-même comme triomphe des « salauds » ? La révolte de Genet ne serait donc pas la bonne ? Faut-il entendre que Genet serait « trop libre » et que sa liberté elle non plus ne serait pas la bonne ? Répondre à ces questions, ce n’est pas se contenter de dire que Sartre aurait tort ou raison, c’est plutôt prolonger cet impossible et passionnant dialogue de sourds, c’est dire comment Sartre dit souvent vrai au-delà de ce qu’il croit dire, c’est préciser ce qu’on doit entendre par révolte et par liberté, montrer ce que l’œuvre de Genet donne à penser d’une liberté identifiée à la réclamation sans conditions d’une singularité sexuelle, érotique, revendiquée comme telle, et c’est lire, dans cette œuvre complexe, les métamorphoses successives de la rébellion, de la sainteté et de l’amour.
Bernard Sichère, « L’athéologie de Jean Genet », in Le Dieu des écrivains, Gallimard, p. 131-137.
Il n’est pas sûr que nous en ayons fini avec cette scène où se jouent toujours, in fine, les rapports à la fois complices et conflictuels entre littérature et philosophie.
QUELQUES ARCHIVES SUR GENET

Un télégramme attestant de la reconduction de Jean Genet
alors âgé de 16 ans à l’Assistance publique après une fugue.
© Archives de Paris-1926. Zoom : cliquez l’image.


Journal du voleur
Jean Genet lit le début de son oeuvre autobiographique "Journal du voleur" (Gallimard, 1949).

« Je suis né à Paris le 19 décembre 1910. Pupille de l’Assistance Publique, il me fut impossible de connaître autre chose de mon état civil. Quand j’eus vingt et un ans, j’obtins un acte de naissance. Ma mère s’appelait Gabrielle Genet. Mon père reste inconnu. J’étais venu au monde au 22 de la rue d’Assas. - Je saurai donc quelques renseignements sur mon origine, me dis-je, et je me rendis rue d’Assas. Le 22 était occupé par la Maternité. On refusa de me renseigner. Je fus élevé dans le Morvan par les paysans. Quand je rencontre dans la lande, et singulièrement au crépuscule, au retour de ma visite des ruines de Tiffauges où vécut Gilles de Rais, des fleurs de genêt, j’éprouve à leur égard une sympathie profonde. Je les considère gravement, avec tendresse. Mon trouble semble commandé par toute la nature. Je suis seul au monde, et je ne suis pas sûr de n’être pas le roi, peut-être la fée de ces fleurs. Elles me rendent au passage un hommage, s’inclinent sans s’incliner, mais me reconnaissent. Elles savent que je suis leur représentant vivant, mobile, agile, vainqueur du vent. Elles sont mon emblème naturel, mais j’ai des racines, par elles, dans ce sol de France nourri des os en poudre des enfants, des adolescents enfilés, massacrés, brûlés par Gilles de Rais. Par cette plante épineuse des Cévennes, c’est aux aventures criminelles de Vacher que je participe. Enfin par elles dont je porte le nom le monde végétal m’est familier. Je peux sans pitié considérer toutes les fleurs, elles sont de ma famille. Si par elles je rejoins aux domaines inférieurs — mais c’est aux fougères arborescentes et à leurs marécages, aux algues, que je voudrais descendre — je m’éloigne encore des hommes. De la planète Uranus, paraît-il, l’atmosphère serait si lourde que les fougères sont rampantes ; les bêtes se traînent écrasées par le poids des gaz. À ces humiliés toujours sur le ventre, je me veux mêlé. Si la métempsycose m’accorde une nouvelle demeure, je choisis cette planète maudite, je l’habite avec les bagnards de ma race. Parmi d’effroyables reptiles, je poursuis une mort éternelle, misérable, dans les ténèbres où les feuilles seront noires, l’eau des marécages épaisse et froide. Le sommeil me sera refusé. Au contraire, toujours plus lucide, je reconnais l’immonde fraternité des alligators souriants. » Journal du voleur.
Un Chant d’Amour
En 1950, Jean Genet réalise son unique film : Un chant d’amour. Le film érotique d’une durée de 25 minutes se déroule dans le milieu carcéral.

Les Paravents

- Portrait de Jean Genet par Roger Blin
Publiée dès 1961, la dernière grande œuvre dramatique de Jean Genet, Les Paravents, dut attendre 1966 avant d’être présentée à Paris, grâce à l’intervention d’André Malraux. C’est à Roger Blin que Jean-Louis Barrault, alors directeur de l’Odéon-Théâtre de France, confie le soin de monter la pièce, qu’interprètent entre autres Maria Casarès, Madeleine Renaud, Jean-Louis Barrault, Marie-Hélène Dasté, Tania Torrens, Jean-Pierre Granval, Jacques Alric. Le spectacle fait scandale par l’ampleur et la violence des réactions qu’il suscite. De fait Les Paravents, où s’exprime une cinglante satire du colonialisme, ne se contente pas de raviver les plaies de la guerre d’Algérie. Elle fait vaciller, comme l’ensemble de l’œuvre de Genet, tous les piliers de l’ordre, de la morale et de l’esthétique bourgeois. Cette fresque foisonnante en seize tableaux, où apparaissent une centaine de personnages, met en scène des destins croisés où s’entremêlent hommes et femmes arabes, familles de colons français, prostituées, officiers, soldats et légionnaires, peuple des morts revenus parmi les vivants. Loin de s’en tenir au cadre historique du conflit algérien, Genet généralise son propos. Sans opposer les Arabes aux Européens, les pauvres aux riches, les vertus aux vices, il poursuit sa réflexion sur l’hypocrisie des sociétés, l’omniprésence de la misère, la sanctification par le mal, l’érotisme, et réitère son apologie de la révolte contre l’oppression.
Voici le résumé du spectacle que publie alors Bertrand Poirot-Delpech, critique au Monde : « Scènes et répliques rivalisent d’horreur. On a écouté les prostituées vanter vertement leurs travaux. On a entendu l’amour parler le langage de la haine et du mépris. On a vu les plus déshérités vautrés dans leur pouillerie ou s’abandonnant avec jubilation à la rage de tuer. On a surpris des officiers parlant de la guerre comme de la plus haute volupté, rêvant tout haut à la virilité de leurs soldats et salués à leur mort par un concert de pétomanes [...]. Les cris obscènes se sont mêlés aux gestes réputés les plus nobles et aux mots les plus respectés. » [79] On comprend que la pièce, programmée par un théâtre officiel et subventionné, ait choqué le public de l’époque (voir ce document). C’est Jean-Jacques Gautier, le célèbre critique du Figaro cité dans le documentaire, qui se fait le porte-parole des indignés, en traitant le style de Genet de « langue excrémentielle » et en émettant cet avis définitif : « Une œuvre n’a pas le droit au titre d’œuvre d’art lorsqu’elle est coulée dans une forme si incivile et si fétide. » [80]
Car Genet ne se contente pas d’attaquer sur le fond, il bouleverse aussi la forme, s’en prenant à tous les codes de la représentation théâtrale, rejetant toute illusion réaliste. Les paravents qui donnent leur titre à la pièce sont manipulés à vue, et servent à symboliser un lieu ou à remplacer un récit. Genet joue également du théâtre dans le théâtre, du travestissement, de l’exhibition des conventions. Les comédiens doivent porter des masques ou des maquillages excessifs, les costumes sont conçus comme des décors permettant de situer les personnages : les colons sont juchés sur des cothurnes et les Arabes sont vêtus de haillons magnifiques. L’auteur porte en effet une extrême attention à la mise en scène, et accompagne la création de la pièce de commentaires qui paraissent sous le titre Lettres à Roger Blin en marge des « Paravents ». Ce texte constitue un apport fondamental à la théorie du théâtre contemporain.
Marion Chénetier-Alev.

Transcription
Journaliste : Avant tout contre tout, Les Paravents de Genet qui ont déplu à Jean-Jacques Gautier, marquent l’année théâtrale. Et l’interprétation de Maria Casarès est inoubliable.
Maria Casarès [Rires !]
Roger Blin : Il faut des comédiens qui transposent autant le texte que rejettent [inaudible]. Il est certain que Maria Casarès a atteint ça.
Comédien : En scène...
Maria Casarès : La nuit, les arbres respirent, les fleurs sont plus belles, les couleurs plus chaudes, ha ! Et le village dort. Il se mélange dans sa fraternité. Foutez le camp ! Accompagnez la douceur au cimetière. Mais moi, je vous parle, et je vous dis que ce soir, la nuit venue, si vous ne [ inaudible] pas sur la place, j’irais en boitant et cassée en deux, sous la lune dans chacune de vos demeures ; et si vous dormiez, je vous obligerais à voler des escalopes et des poules en rêve toutes les nuits. Je vous réciterais 127 fois 127 injures et chaque injure sera si belle que vous en serez illuminés. Mais même… Je crois que je n’ai jamais eu en main, si vous voulez, un texte aussi vivant, aussi en même temps qui demande autant de l’acteur ; qui exige autant de lui. Parce qu’il faut, c’est un texte qu’on ne peut pas dire, qu’on ne peut pas arranger d’une manière plus ou moins rhétorique, jamais ! Il faut sans cesse que chaque mot vive, que chaque objet prenne son poids et que chaque, je ne sais pas, s’il y a une lune, que la lune existe. Mais qu’il existe pour le comédien qui parle d’elle. On ne peut pas l’inclure dans une phrase. Mais en même temps, cette espèce d’exigence vous met dans un état incessant de goût d’invention avec lui. Alors, c’est terriblement vivant sous la main. C’est comme si on avait une matière qui bouge sans arrêt. Et qu’il faut en même temps prendre avec soi bien entendu pour l’inclure en soi. Mais en même temps qui vous porte.
DIDASCALIE
(Silence)
Maria Casarès : Je t’ai pas tué dis ! Réponds ! Réponds, ça suffit réponds-moi ! Petit soldat de bronze, amour, mon amour, ma chatte, ma mésange, relève-toi et debout saloperie ! Elle est bien morte, la charogne, qu’est-ce qu’on fait de ces trucs là ? Comme un geyser, jusqu’au ciel le sang n’a pas jailli, pourtant d’un bord à l’autre du monde, que la nuit est rouge, aha !
DIDASCALIE
(Bruit)

Jean Louis Barrault sur Les Paravents

Madeleine Renaud sur Les Paravents

Entretien avec Jean Genet
Réalisé par Bertrand Poirot-Delpech. Enregistré en janvier 1982 et publié dans Le Monde du 21 avril 1986, huit jours après la mort de Genet, cet entretien devait s’intégrer dans un documentaire produit par Danièle Delorme qui sera finalement diffusé en mai 1986.
Extraits : La France a supprimé la peine de mort, j’aimerais savoir l’effet que ça vous a fait d’apprendre qu’on ne couperait plus les têtes en France ?
Jean Genet : Ça m’a laissé complètement indifférent parce que la suppression de la peine de mort est une décision politique. La politique française, je m’en fous, ça ne m’intéresse pas. Tant que la France ne fera pas cette politique qu’on appelle Nord-Sud, tant qu’elle ne se préoccupera pas davantage des travailleurs immigrés ou des anciennes colonies, la politique française ne m’intéressera pas du tout. Qu’on coupe des têtes ou pas à des hommes blancs, ça ne m’intéresse pas énormément. Les règlements de comptes entre ceux qu’on appelait les voyous et les juges, pour moi, c’est sans intérêt.
Qu’on essaie de réduire ou de supprimer les châtiments ne vous intéresse pas vraiment ?
En France, non, je m’en fous.
Si on arrivait à créer une société où on ne punit pas, vous ne seriez pas davantage satisfait ?
Faire une démocratie dans le pays qui était nommé autrefois métropole, c’est finalement faire encore une démocratie contre les pays noirs ou arabes. La démocratie existe depuis longtemps en Angleterre, entre Anglais probablement. Je connais mal l’histoire anglaise, mais je crois que depuis longtemps la démocratie était florissante en Angleterre, quand l’empire colonial anglais était florissant, mais qu’elle s’exerçait contre les Hindous.
Vous pensez que les luxes économiques ou politiques des pays riches se paient toujours sur le dos du tiers-monde ?
Pour le moment je ne vois que ça [81].

Jean Genet est mort dans la nuit du 14 au 15 avril 1986 (un jour après la mort de Simone de Beauvoir).
« Comme il en avait exprimé le souhait, Jean Genet devait être enterré vendredi 25 avril, à Larrache, ville côtière marocaine située à 86 kilomètres au Sud de Tanger, où il possédait une maison... Son corps avait été transporté jeudi par avion dans cette localité. » (Le Monde du 26 avril 1986)
La Passion selon Saint-Genet
Un siècle d’écrivains », numéro 8, diffusée sur France 3, le 22 février 1995, et réalisée par Michel Van Zele.
LIRE AUSSI :
 Jean Genet ou Le Combattant anarchiste et poète par Geneviève Latour
Jean Genet ou Le Combattant anarchiste et poète par Geneviève Latour
 Jean Genet, tabou, par Éric Marty (in Les Temps Modernes, 2005/4-5-6 (n° 632-633-634))
Jean Genet, tabou, par Éric Marty (in Les Temps Modernes, 2005/4-5-6 (n° 632-633-634))
 Mon ami Jean Genet, par Juan Goytisolo
Mon ami Jean Genet, par Juan Goytisolo
 Extrait de Genet à Barcelone par Juan Goytisolo
Extrait de Genet à Barcelone par Juan Goytisolo
 Une communication sans échange : Georges Bataille critique de Jean Genet, par François Bizet
Une communication sans échange : Georges Bataille critique de Jean Genet, par François Bizet
 Les lectures paradoxales de Genet par Bataille par Myriam Bendhif-Syllas
Les lectures paradoxales de Genet par Bataille par Myriam Bendhif-Syllas
 Genet, l’homme aux semelles de temps, par Thomas Ravier
Genet, l’homme aux semelles de temps, par Thomas Ravier
 Catherine Millot, Gide Genet Mishima. Intelligence de la perversion
Catherine Millot, Gide Genet Mishima. Intelligence de la perversion
 Bernard Sichère, Le Dieu des écrivains
Bernard Sichère, Le Dieu des écrivains
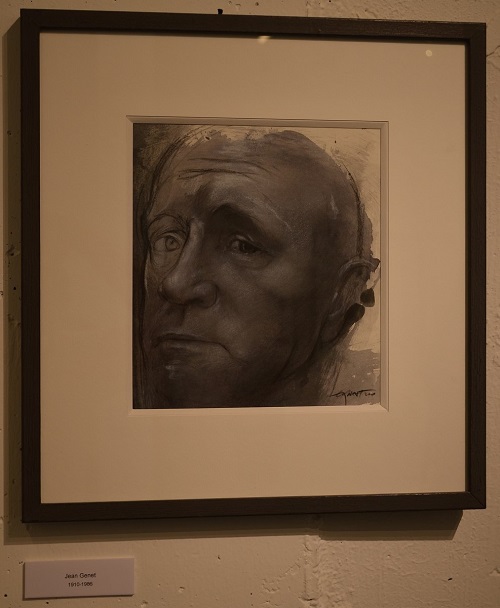
Ernest Pignon-Ernest, Jean Genet (1910-1986).
Photo A.G., Exposition au Musée Rimbaud, Charleville. Août 2015.
Zoom : cliquez l’image.


Montage A.G., 15-20 mai 2016.
PS : Je n’ai pas traité ici directement les problèmes posés par l’antisémitisme réel ou supposé de Genet, pas plus que ceux de son engagement politique et les réactions qu’ils suscitèrent. Ils mériteraient un dossier à part. Le hors-série du Monde les aborde dans ses pages "débats" (p. 82-91).
[1] Cette photo a été prise lors du « parcours Jean Genet », Brest, 2006. Voir le site de Ernest Pignon-Ernest. A.G.
[2] Voir
 Les Paravents.
Les Paravents.
[3] Voir aussi : L’homme qui marche.
[4] Je souligne.
[5] Albert Dichy est directeur littéraire de l’IMEC. Cf. Sur les archives de Jean Genet : interview d’Albert Dichy.
[6] Biblos Gallimard.
[7] Rions un peu : « Télérama, hebdomadaire au tirage chiffré à 620 000 exemplaires, lance la campagne "André Breton, la beauté convulsive" avec la couverture et un dossier de 9 pages dans son numéro du 24 avril 1991. Il réalise un tiré-à-part de 16 pages tiré à 400 000 exemplaires qui sera distribué gratuitement aux visiteurs de l’exposition. Télérama soutient en publicité le déroulement de la campagne de l’exposition. »
[8] Cf. le Genet d’Edmund White, Gallimard, 1993.
[9] « Septembre noir est un conflit qui eut lieu le 12 septembre 1970, lorsque le royaume hachémite du roi Hussein de Jordanie déclencha des opérations militaires contre les fedayins de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), dirigée par Yasser Arafat, pour restaurer la légitimité de la monarchie dans le pays à la suite de plusieurs tentatives palestiniennes de renverser Hussein, avec l’aide dans une certaine mesure de l’armée syrienne.
La violence des combats fit plusieurs milliers de morts de part et d’autre, en majorité des civils palestiniens. » Cf. wikipedia.
[10] La séance de Tel Quel rue de Rennes. J’étais à cette séance (automne 1970). Beaucoup de monde. Grand moment. Jean Genet, invité, céda rapidement la parole à Mahmoud Hamchari, premier représentant de l’OLP en France. Sur ce point, se reporter à « Histoire de Tel Quel » de Philippe Forest (Seuil, p. 338-339). Tel Quel soutenait alors la lutte du peuple palestinien et le « Bulletin du mouvement de juin 1971 » jusqu’en 1972 (n°4, octobre 1972) relaiera volontiers les positions « anti-sionistes » de « Fath informations » dont le directeur de publication était Hamchari.
Après l’attentat de Munich (JO de 1972), Hamchari s’exprimait à la télévision :

C’était peu avant son assassinat par les services secrets israéliens. Cf. Le Monde du 8 décembre 1972 : « Après l’explosion et l’incendie qui ont détruit, le 8 décembre, a 8 heures 30, l’appartement de M. Mahmoud El Hamchari, 177, rue d’Alésia (14e), M. Gaimiche, premier juge d’instruction, a été chargé d’une information ouverte contre X... pour tentative de meurtre et destruction d’édifice par substances explosives.
M. Hamchari, trente-trois ans, représentant à Paris de l’Organisation pour la libération de la Palestine, est actuellement soigné pour ses graves blessures et brûlures des jambes et de l’abdomen. L’examen médical de la victime et les investigations faites sur les lieux démontrent, selon les enquêteurs, qu’il s’agit bien d’un attentat. »
Mahmoud Hamchari est mort le 9 janvier 1973 des suites de ses blessures. Il est enterré au cimetière du Père Lachaise. A.G.
[11] Écoutez le témoignage de Leïla Shaid, ancienne déléguée générale de l’Autorité palestinienne en France (1994-2005), aujourd’hui ambassadrice de la Palestine auprès de l’Union européenne, qui a bien connu Jean Genet :

Lire aussi, a contrario : Éric Marty, « Jean Genet à Chatila » dans Bref séjour à Jérusalem, Gallimard, coll. L’infini, 2003.
[12] Jean Genet, « Ce qui est resté d’un Rembrandt déchiré en petits carrés bien réguliers, et foutu aux chiottes », in Tel Quel 29 (printemps 1967). Tel Quel a aussi publié « L’étrange mot d’... » dans son numéro 30 (Été 1967). Cf. extraits dans Où en sommes-nous avec le temps ?.
[14] Cf. Bernard Sichère, « Saint Bataille », in Le Dieu des écrivains, Gallimard, coll. L’infini, 1999, p. 50.
[15] Tous les chapitres portent en titre le nom propre d’un écrivain.
[16] Gallimard, 1957, p. 183-226. « Folio-Essais », 1994, p. 125-154.
[17] JEAN-PAUL SARTRE, Saint Genet, comédien et martyr, Gallimard, 1952, p. 253 (Oeuvres complètes de JEAN GENET, t. I). Sartre introduit par ces mots cette sorte de biographie résumée : « Voici un conte pour une anthologie de l’Humour noir. »
[18] J.-P. SARTRE, Saint Genet, comédien et martyr, p. 528.
[19] J.-P. SARTRE, Saint Genet, comédien et martyr,
pp. 59-60.
[20] Ibid., p. 60.
[21] J.-P. SARTRE, Saint Genet, comédien et martyr
p. 108.
[22] Dans Notre-Dame des Fleurs. Œuvres complètes, t. II. Sartre analyse longuement cette manière de couronnement.
[23] Ibid., p. 79.
[24] S. G., p. 221.
[25] Cité par SARTRE, S. G., p. 79.
[26] S. G., p. 343.
[27] La souveraineté l’irrite moins que la sainteté dont il lie l’odeur à celle des excréments. Il en voit l’ambivalence, mais il l’englobe dans le dégoût que lui inspirent, « quoi qu’on en dise, les matières fécales. Il parle même de la souveraineté en termes incontestables. « Si le criminel, dit-il (p. 223), a la tête solide il voudra jusqu’au bout demeurer méchant. Cela veut dire qu’il bâtira un système pour justifier la violence : seulement du coup celle ci perdra sa souveraineté. » Mais il n’est pas préoccupé par le problème de la souveraineté (que chacun, pour son compte, doit atteindre) pose généralement pour tout homme.
[28] Miracle de la Rose, Œ. C., II, pp. 190-191.
[29] Ibid., p. 212.
[30] Voilé de gravité... mais toujours clinquant. Voici l’ensemble de la phrase : « C’est au fond de cette cellule, où je l’imagine pareil au Dalaï-Lama invisible, puissant et présent, qu’il émettait sur toute la Centrale ces ordres de tristesse et de joie mêlées. C’était un acteur qui soutenait sur ses épaules le fardeau d’un tel chef-d’œuvre qu on entendait des craquements. Des fibres se déchiraient. Mon extase était parcourue d’un léger tremblement, d’une sorte de fréquence ondulatoire qui était ma crainte et mon admiration alternées et simultanées. » (lbid., p. 217.)
[31] Miracle de la Rose, p. 390.
[32] Ibid., p. 329.
[33] Notre-Dame des Fleurs, Œ. C., II, p. 143.
[34] Ibid., p. 141.
[35] Journal du voleur, p. 378.
[36] Miracle de la Rose, Œ. C., II, pp. 349-350.
[37] Souligné par Genet.
[38] Journal du voleur, p. 200-201.
[39] Ibid., p. 207-208.
[40] Souligné par moi.
[41] Miracle de la Rose, Œ. C., II, p. 376
[42] Journal du Voleur, p. 199.
[43] Ibid., p. 198.
[44] S. G., p. 148.
[45] S. G., p. 148.
[46] Je me rappelle une discussion à la suite d’une conférence au cours de laquelle Sartre me reprocha ironiquement de me servir du mot « péché » : je n’étais pas croyant, et, à ses yeux, son usage de ma part était inintelligible.
Voir sur Pileface le péché (A.G.).
[47] S. G., p. 221.
[48] S. G., p. 509, n. 2.
[49] S. G., p. 508. Sartre à ce propos n’en donne pas moins une excellente définition du sacré : « le subjectif se manifestant dans et par l’objectif, par la destruction de l’objectivité ». En effet, la communication, dont l’opération sacrale est la forme suprême, porte nécessairement sur des choses, mais niées, mais détruites en tant que telles : les choses sacrées sont subjectives. Sartre a le tort de glisser à des représentations dialectiques sans système dialectique, si bien qu’il arrête à chaque instant, arbitrairement, le flot dialectique qu’il a mis en jeu. Il n’en est pas moins profond, mais il déçoit. Serait-il possible d’aborder une réalité aussi glissante que le sacré si nous ne la lions au lent mouvement qui englobe à la fois notre vie et la vie historique. Sartre a perdu dans la faculté d’improviser le bénéfice de sa rapidité. Il éblouit, mais il ne reste de l’éblouissement qu’une vérité qui doit être contestée, et lentement digérée. Ses aperçus sont toujours significatifs, mais ils ne font jamais qu’ouvrir la voie.
[50] S. G., p. 508.
[51] Journal du Voleur, p. 117.
[52] Ibid.
[53] Miracle de la Rose, Œ. C., II, p. 220.
[54] Ibid., p. 208.
[55] Journal du Voleur, p. 115.
[56] S. G., p. 225.
[57] A la fin du Miracle de la Rose, Œ. C., t. II.
[58] Bataille se trompait-il ? On l’a dit. Le soutien de Genet, en 1977, aux membres de la Fraction Armée Rouge et à l’URSS (cf. Violence et brutalité et les réactions que son article suscita (cf. Jacques Henric, Politique) lui donnent plutôt raison. (A.G.)
[59] Journal du Voleur, p. 184-185.
[60] Sur cette opposition, voir entre autres S. G., pp. 112-116 et surtout pp. 186-193. Bien que ces idées soient proches de celles que j’ai moi-même exprimées dans La Part Maudite. La Consumation (Ed. de Minuit, 1949), elles en diffèrent essentiellement (je mettais l’accent sur la nécessité du gaspillage, et sur le non-sens de la productivité comme fin). Je dois dire cependant que la valeur reconnue comme étant le privilège de la société de productivité, la société de consommation étant insoutenable, ne représente pas à tel point le jugement nécessaire et définitif de Sartre qu’il ne puisse employer, cent cinquante pages plus loin (p. 344), par deux fois, les termes de « société de fourmis » pour désigner évidemment cette « société de productivité », qu’il donne plus haut comme un idéal. La pensée de Sartre est plus flottante qu’il ne semble parfois.
[61] La Société féodale. Cité dans S. G., pp. 186-187.
[62] Sartre aurait pu, dans La Part maudite, trouver d’autres exemples d’une impulsion dont j’ai montré l’universalité.
[63] S. G., p. 221. Les mots soulignés le sont par Sartre.
[64] La difficulté la plus grande que Sartre ait rencontrée dans ses études philosophiques tient à coup sûr à l’impossibilité pour lui de passer d’une morale de la liberté à la morale commune, qui lie les individus entre eux dans un système d’obligations. Seule une morale de la communication — et de la loyauté — que fonde la communication, dépasse la morale utilitaire. Mais pour Sartre, la communication n’est pas un fondement ; s’il en voit la possibilité, c’est à travers une vue première de l’opacité des êtres les uns pour les autres (pour lui, l’être isolé est fondamental, non la multiplicité des êtres en communication). Aussi bien nous fait-il attendre un ouvrage sur la morale annoncé depuis la guerre. Seul l’honnête et immense Saint Genet pourrait donner idée de l’état de ce travail. Mais le Saint Genet, d’une étonnante richesse, est bien le contraire d’un aboutissement.
[65] Dont le partage est du moins possible. Je dois laisser ici de côté l’aspect le plus profond de la communication, qui tient à la signification paradoxale des larmes. Je ferai cependant observer que les larmes sans doute représentent le sommet de l’émotion communicative et de la communication, mais que la froideur de Genet est à l’opposé de ce moment extrême.
[66] Voir S. G., p. 509.
[67] S. G., p. 509.
[68] Je suis revenu à plusieurs reprises sur le thème essentiel de l’interdit et de la transgression. La théorie de la transgression est due dans son Principe à Marcel Mauss, dont les essais dominent actuellement l’évolution de la sociologie. Marcel Mauss, peu porté à donner une forme définitive à sa pensée, s’est borné à l’exprimer épisodiquement dans ses cours. Mais la théorie de la transgression a été l’objet de l’exposé magistral d’un de ses élèves. Voir ROGER CAILLOIS, L’Homme et le Sacré. Edition augmentée de trois appendices sur le Sexe, le Jeu, la Guerre, dans leurs rapports avec le Sacré (Gallimard, 1950). Malheureusement l’ouvrage de Caillois n’a pas encore l’autorité qu’il mérite, en particulier à l’étranger. Dans le présent livre, j’ ai montré que l’opposition de la transgression et de l’interdit ne dominait pas moins la société moderne que la primitive. Il apparaîtra vite que la vie humaine, dans tous les temps et dans toutes ses formes, alors qu’elle est fondée sur l’interdit, qui l’oppose à la vie animale, en dehors du domaine du travail, est vouée à la transgression, qui décide du passage de l’animal à l’homme. (Voir l’exposé que j’ai donné de ce principe dans Critique, 1956, n°111/112, août-septembre 1956, pp. 752-764.)
[69] L’expression est de Genet, cité par Sartre (S, G., p. 226), Selon moi la recherche de l’« impossible Nullité » est la forme que prit en Genet la recherche de la souveraineté.
[70] S. G., p. 226. Les mots soulignés le sont par Sartre.
[71] S. G., p. 229-230. Un mot souligné par moi.
[72] Comment Derrida a-t-il procédé ? Par collage ? Sans doute.
[73] « il », c’est Bataille qui n’a pas encore été nommé et qui partage ici le point de vue de Heidegger rappelé par Sollers dans L’école du mystère : « Cela dit, il [Heidegger] diagnostique comme personne le règne planétaire de la Technique et l’avènement de l’ersatz.
L’énorme quantité étant devenue qualité, l’ersatz (mot allemand) pullule. Un écrivain existe s’il a vendu 100 000 exemplaires (ou plus), sinon, c’est un marginal paresseux, un rêveur, un assisté, une créature de musée. Être, désormais, c’est être remplaçable, a justement pronostiqué le penseur, et les remplaçants, dans le Spectacle mondial, affluent de toute part, en peinture, en musique, en littérature. » (Gallimard, 2015, p. 63). Cf. Tombeau de Heidegger. A.G.
[74] Georges Bataille, « Le langage des fleurs », Documents, n° 3 (juin 1929). (A.G.)
[75] « Saint Bataille » est le premier chapitre du Dieu des écrivains. (A.G.)
[76] Sur le livre de Sartre et sur l’étrange triangle qui va se constituer entre Sartre écrivant sur Genet, Genet commenté par Sartre et Bataille commentant le livre de Sartre, je renvoie à mon article « Sartre et Genet : une scène », in Les Temps modernes, n°351-353, octobre-décembre 1990, t. l. Par ailleurs, l’ensemble de ce chapitre reprend en les modifiant et en les développant deux autres articles : d’une part « Jean Genet : l’écriture du fantasme », Elseneur, n°9, Presses Universitaires de Caen, 1994 ; d’autre part « L’athéologie de Jean Genet », L’infini, n° 16-17, automne 1986-hiver 1987.
[77] Bataille, La littérature et le mal, Œuvres complètes, t. IX, Gallimard, 1979, p. 288.
[78] Voir Sartre, Saint Genet comédien et martyr, Gallimard, 1952 :
« Il y a eu mort, c’est tout. Et Genet n’est rien d’autre qu’un mort » (p. 9). C’est ce qu’on peut appeler une exécution capitale. Plus fort encore et plus pervers : « Le vrai, c’est qu’un certain Genet vient de mourir et que Jean Genet m’a prié de prononcer son oraison funèbre. » Une chose au moins paraît claire dans cette opération quasiment unique dans le champ philosophique et littéraire : Genet a mis Sartre « hors de lui » et Sartre le lui fait payer.
[79] Bertrand Poirot-Delpech, Au soir le soir, théâtre 1960-1970, Paris, Mercure de France, 1969, texte daté du 23 avril 1966.
[80] Jean-Jacques Gautier, Théâtre d’aujourd’hui, Paris, Julliard, 1972, texte daté du 24 avril 1966.
[81] D’autres extraits sont publiés dans le Hors série du Monde.




 Version imprimable
Version imprimable


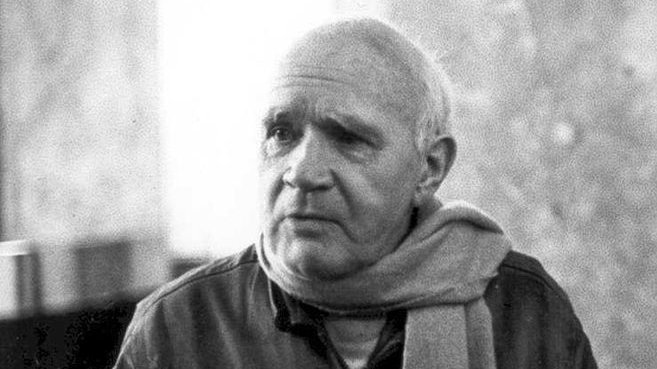




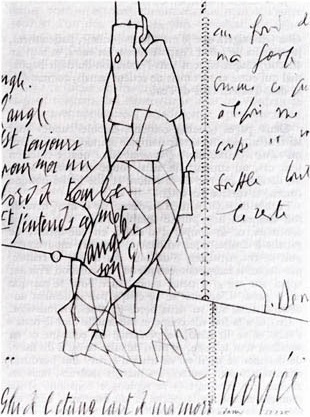


 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?



2 Messages
30 octobre 2020 - 31 janvier 2021 | 14:00
IMEC, abbaye d’Ardenne, 14280 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe
Les valises de Jean Genet
Une exposition proposée par Albert Dichy
Que contiennent les valises d’un écrivain ? Après les malles légendaires de Fernando Pessoa, Raymond Roussel ou Antonin Artaud, voici les valises de Jean Genet, écrivain vagabond, sans domicile, sans bureau, sans bibliothèque.
Entré par effraction en poésie avec la publication du Condamné à mort, en 1942, Jean Genet rédige ses premiers livres en prison mais se retire de la scène littéraire au moment même où son théâtre le fait connaître dans le monde entier. Il dit alors avoir renoncé à écrire. Et pourtant, durant près de vingt ans, d’une chambre d’hôtel à l’autre, du camp de Chatila à la Goutte d’Or, des ghettos noirs d’Amérique à la petite ville de Larache au Maroc, il transporte dans ses minces bagages les matériaux d’une œuvre rêvée où sa vie entière est consignée, de sa jeunesse perdue à ses dernières péripéties politiques.
En avril 1986, quelques jours avant sa mort, Jean Genet confie à Roland Dumas, son avocat rencontré pendant la guerre d’Algérie, deux valises de manuscrits. Un mois plus tard paraît son ultime chef-d’œuvre, Un captif amoureux. Durant trente-quatre ans, ces valises ont dormi dans le secret du cabinet de l’avocat avant que celui-ci ne décide d’en faire don à l’IMEC.
Brouillons, manuscrits inédits, notes éparses… le dernier atelier de l’écrivain est aujourd’hui révélé au public.
IMEC, abbaye d’Ardenne
du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021
Du mercredi au dimanche, de 14h à 18h
Visites guidées les samedis et dimanches à 16h
Fermé du 24 décembre 2020 à 18h au 6 janvier 2021 à 14h
Entrée libre et gratuite
Port du masque obligatoire
Le 29 octobre 2020 | 20:00
Les Grands Soirs | L’atelier du dernier Genet
Pour évoquer l’auteur de Journal du Voleur et d’Un captif amoureux, Albert Dichy reçoit trois témoins essentiels de sa dernière aventure littéraire et politique : Lydie Dattas, poète et proche amie de Jean Genet, Roland Dumas, ancien ministre, avocat et donateur des valises, et Leïla Shahid, ex-ambassadrice de la Palestine auprès de l’Union européenne, qui a assisté à l’écriture du dernier livre de l’écrivain.
Cette soirée est organisée dans le cadre de l’exposition « Les valises de Jean Genet » présentée à l’abbaye d’Ardenne du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021.
Réservation indispensable : reservation@imec-archives.com
Une soirée en partenariat avec la librairie Eureka Street
LIRE : Jean Genet, ses écrits secrets enfin révélés.
Matthieu Garrigou-Lagrange, France Culture, La compagnie des auteurs. 4 au 7 février 2019.
Cette semaine est consacrée à l’oeuvre de Jean Genet (1910-1986), dont la vie fut marquée par le scandale et le succès, offrant un regard sur un XXe siècle déchiré et engagé.
Le rapport de Genet avec les arts plastiques, dans un dialogue avec Giacometti et Rembrandt.
Isaku Yanaihara - [Alberto Giacometti et Jean Genet dans l’atelier]
Tirage argentique sur papier, 14 octobre 1956
Fondation Giacometti. ZOOM : cliquer sur l’image.