Au départ de la création de ce site, il y avait une question et un objectif : comprendre comment fonctionnait Sollers, comment cet homme arrivait à concilier ses différentes vies parallèles... et en faire œuvre littéraire.
...Comment il arrivait à concilier son concubinage très marital avec Julia Kristeva et son libertinage, sa concurrence littéraire avec Julia, qui grandissait en notoriété tandis que lui piétinait dans sa période expérimentale, son expérience des limites, une œuvre sans fin, son Paradis, soutenu certes, par un noyau de fidèles, mais petit noyau qui ne débordait pas les frontières nationales, tandis que Julia les franchissait allègrement, et professait dans des universités américaines... On peut aussi imaginer qu’au plan matériel, la revue Tel Quel, malgré son impact intellectuel, nourrissait mal son homme, tandis que Julia, outre une reconnaissance intellectuelle, avait un statut matériel plus installé. Jamais Sollers n’évoque ces considérations dans son œuvre. Seul transparaît un certain mal-être et la tentation du suicide. Il faut bien les chercher mais ils sont entre les lignes de son livre d’entretiens avec avec David Hayman : Vision à New York, entretiens : Visions à New York. Sollers le libertin est aussi un grand pudique qui ne dévoile pas son intime et ses blessures.
Sous leur pression, il a pourtant opéré un changement de cap radical dans son écriture avec Femmes, en 1983. Il lui fallait absolument sortir de son isolement et atteindre la consécration du public. Et il l’a eue avec ce roman. Peut-être faut-il trouver aussi dans ce conflit intérieur, ce besoin qu’a développé Sollers de se répandre dans les media audio-visuels. Il avait besoin de la lumière. Besoin vital. Affirmé dès les premiers mots de Paradis :
Ce changement radical n’a pas dû être facile à admettre pour lui. C’était aussi trahir, en quelque sorte, son idéal de jeunesse et littéraire. Ce déchirement et virage à 180° n’est pas sans parallèles avec l’évolution que subit aujourd’hui le Parti Socialiste gouvernemental, face à la dure loi de la réalité. Idéal et pragmatisme. Vivre en marginal ou pas, vivre ou se suicider. Vivre et goûter les plaisirs de la vie dans la proximité des femmes et le libertinage, et en faire une œuvre littéraire propre et une œuvre de critique littéraire et d’art, un voyage d’une vie en compagnie de ces grands Voyageurs du temps qui ont laissé leur empreinte, mérite aussi considération.
Et l’essai de Pierre MARLIÈRE, Variation sur le libertinage. Ovide et Sollers en apportant son propre éclairage à mon questionnement initial ne pouvait que retenir mon attention. Extrait présenté ici, la section intitulée : « Sollers et l’ŒUF spectaculaire ». Que ce livre soit publié chez Gallimard dans la collection L’Infini de Sollers, lui confère en outre la force de l’imprimatur autorisé et officiel. « Bon pour publication ! ».
Lisez et croyez ...au pouvoir des mots et de l’écriture. Ils suffisent à justifier une vie.
« Le reste vous sera donné par surcroît ».
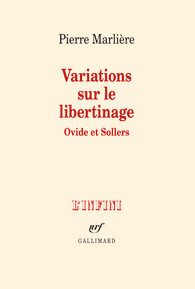
Pierre MARLIÈRE
Variations sur le libertinage
Ovide et Sollers
Collection L’Infini, Gallimard
Parution : 05-05-2014
« L’étymologie latine du nom a le mérite de nous renseigner sur l’essence du libertinage. On découvre en son cœur l’idée directrice de liberté qui implique le passage d’un état à un autre, celui d’esclave à homme libre. Il y a à la racine du libertinage le principe premier d’affranchissement, un libertin serait donc avant tout un individu qui a su briser les chaînes qui l’entravaient. Le dérèglement des mœurs qu’on lui attribue de nature n’est en fait que la conséquence directe de cette double libération, autant de corps que d’esprit. Pour reprendre le mythe épicurien du clinamen, on pourrait comparer le libertin à cet atome libre dont la course dérivée contredit la pluie régulière et ordonnée de la matière. »
EXTRAITS :
Sollers et l’ŒUF spectaculaire
Rappelons-le, à la racine du libertinage, il y a l’idée directrice d’écart et d’affranchissement d’un individu devant la règle dictée par un ordre politique et social. C’est précisément dans l’espace de divergence ouvert par l’écart que le libertin fonde et prouve sa qualité d’esprit libre.

- Philippe Sollers à Prague, 1997, devant un magasin de mode Casanova
Cependant, cette volonté de liberté par rapport à la règle n’est pas un choix aveugle. Elle requiert au préalable l’identification du discours idéologique érigé en conduite morale par le pouvoir. Transgresser la règle n’a de sens que si le sujet parvient à la démasquer et à en reconnaître l’existence. C’est pourquoi le libertin est toujours, d’un point de vue historique, le sujet négatif de la règle ; sans elle il n’est rien, ou plutôt c’est lui qui la révèle en tant que norme extérieure régulatrice établie par la société, lieu de concentration des instances de légitimation que sont la politique, la religion, l’économie et l’État. Le libertin a besoin de la loi et des interdits pour exister. Sachant que la permissivité totale ne rend pas heureux, la liberté et la jouissance ne peuvent s’affirmer que dans la transgression. Il ne s’agit pourtant pas d’un acte qui vise la destruction radicale de la règle. Comme le rappelait Bataille, « lever l’interdit sans le supprimer [1] » est le principe moteur de l’érotisme. Toute la subtilité du libertinage s’organise dans la pointe de ce chas : savoir faire travailler la règle pour soi en vue de l’émulation de son désir. Sade est sur ce point d’une clairvoyance sans appel : « La vraie façon d’étendre et de multiplier ses désirs est de vouloir lui imposer des bornes [2]. » Si le libertin devait faire l’éloge de la règle, ce serait soit de sa propre règle intérieure, éthique personnelle qui fonde sa conduite, soit de la règle extérieure comme loi appelée à être transgressée.

- Fresque murale du temps d’Ovide
Ovide ironisait sur la politique pseudo-restauratrice de son temps en la parodiant. Sollers, quant à lui, se trouve face à une situation historique où la structure politique et économique est très différente de celle de l’Antiquité. À l’époque d’Auguste, l’idéologie normative était clairement énoncée par la puissance politique et défendue par elle à l’intérieur d’un espace, certes en expansion, mais clos en tant que fait culturel. Or, le XXème siècle marque l’entrée irréversible des pays dits « libéraux » dans la société marchande et spectaculaire à l’échelle mondiale. Il ne s’agit plus d’un royaume physique conquis par la force des armes, mais d’un empire dématérialisé régi par la technique et l’inquisition financière. C’est l’idée d’un capitalisme souverain, indifférent aux frontières naturelles et culturelles, n’ayant d’autre limite que lui-même, aujourd’hui rebaptisé pudiquement « mondialisation ».
Dès 1967, Guy Debord affirmait dans La Société du Spectacle que le principe actif de la société spectaculaire est l’illusion. Dans la mesure où, instaurant entre l’individu et le monde un écran, elle ravit au sujet la possibilité d’accéder directement au vécu autrement que par l’image et la marchandise. Dans l’aphorisme 21, Debord écrit : « Le spectacle est le mauvais rêve de la société moderne enchaînée, qui n’exprime finalement que son désir de dormir. Le spectacle est le gardien de ce sommeil [3]. » Autrement dit, la passivité de l’être humain enchaîné à sa fonction de consommateur docile est assurée par le spectacle qui sert de garde-fou au capitalisme. En ce sens, l’idéologie de la société moderne est celle du somnambulisme et de l’énervement (au sens premier du terme). La différence fondamentale avec la situation du poète de Sulmone est qu’Ovide se heurtait à une idéologie pleine et solaire dans l’énonciation de son discours, tandis que celle de la société moderne à laquelle se confronte Sollers grime sa face à la manière de la lune. Jamais elle ne se présente telle qu’elle est mais toujours sous les oripeaux du vrai et de l’authenticité.
Le libertinage dont nous parle Sollers dans ses romans intervient précisément à ce niveau ; lorsque le fard de l’imposture est identifié et refusé. Dans cette fronde contre le faux, la forme romanesque se révèle, selon Sollers, le fleuret le plus efficace dans la mesure où le roman se présente lui-même comme art de l’imposture : « Il s’en sert, il dévoile qu’il n’y a qu’elle à la racine de tous les corps en transit... Toute imposture redoute le roman comme la peste... C’est une peste... Balzac, Proust sont de redoutables bubons [4]... » On peut s’étonner que le roman, forme littéraire portée en triomphe par le XIXe et le XXe siècle, soit ainsi qualifié de peste et l’écrivain de bubon. Toutefois, il faut réintégrer cette considération dans le système de dévoilement qu’il forme et dirige. On retrouve ici l’idée que le roman se sert de la fiction des mots, autrement dit du mensonge, pour s’occuper du vrai. C’est pourquoi il est un véritable fléau pour tout mensonge qui prétend incarner l’authenticité. Il l’infiltre comme un virus pénètre les cellules (d’où la comparaison entre le roman et l’activité bubonique de la peste) et le combat avec ses propres armes. Ainsi, les narrateurs de Sollers sont les intercesseurs d’un libertinage dont le principe martial est l’éveil contre le sommeil, l’éternité du midi contre la nuit et la non-vie. En un mot, ils refusent de boire le philtre morphinique prescrit par l’idéologie moderne. Là où la société murmure sournoisement : « Continuez de dormir », ils répliquent : « Réveillez-vous ! » Sollers ajoute : « Un roman est réussi dans l’exacte proportion où il fait sentir, à un moment donné du temps [...] cet infini tissage des narcissismes où personne n’écoute personne, où chaque parcelle vivante participe d’un somnambulisme généralisé [5]. » Dès Femmes on trouvait, présente en creux dans le texte comme antimatière, l’étreinte répressive et vampirique de la société spectaculaire-marchande à laquelle tous les narrateurs tentent d’échapper. Ils se placent toujours dans une situation de fuite et de clandestinité transgressive par rapport à la structure régulatrice organisée par les pouvoirs concentrés, que Sollers appelle l’ŒUF dans Portrait du Joueur. Le roman s’ouvre d’ailleurs ainsi :
Eh bien, croyez-moi, je cours encore... Un vrai cauchemar éveillé... Avec, à mes trousses, la horde de la secte des bonnets rouges... Ou verts... Ou marron... Ou caca d’oie... Ou violets... Ou gris... Comme vous voudrez... [...] Un paquet de sorciers et sorcières ; un train d’ondes et de vibrations... Moi, pauvre limaille... j’ai cru que je n’en sortirais jamais, j’ai pensé mille fois devenir fou comme un rat dans les recoins du parcours... Ils ont tout, ils sont partout, ils contrôlent tout, ils avalent tout...Mais qui ça, ils ?
Ah, voilà !
Tout simplement, eux
[6]
Nous découvrons, dès l’ouverture du livre, un ego en pleine réaction cinétique. L’entrée in medias res du narrateur sur la scène littéraire se fait sous le signe de la fuite. Fuite qui semble d’ailleurs antérieure à l’espace intérieur du roman. L’adverbe « encore » mérite toute notre attention. Il a bien entendu son sème habituel de « à nouveau » mais on peut aussi lui attribuer ici son sens plus fort de « toujours ». Tout se passe comme si le sujet était pris dans une course perpétuelle contre ses poursuivants, comme dans un rêve qui sans cesse recommence, à ceci près que ce n’est plus un rêve. En effet, un « vrai cauchemar éveillé » consomme la rupture entre l’état de veille et l’état onirique. Le cauchemar topique de la poursuite, qui révèle chez le sujet une angoisse profonde d’être rattrapé et absorbé, se voit ici annulé dans sa qualité d’activité inconsciente par l’encadrement « vrai » et « éveillé ». Le cauchemar s’est fondu dans la réalité et la réalité devenue cauchemar en a pris le langage. Elle a revêtu la langue de l’inconscient, dont une des voies de manifestation est le rêve et sa structure métonymique. Dépersonnalisés par l’emploi de la métonymie « bonnet », les poursuivants se voient niés en tant qu’individu. Ils prennent la forme d’une « horde » et d’une « secte » uniquement définie par et comme des couvre-chefs, d’où la nuance d’humour qui se dégage du texte. Ils se coagulent en une masse diffuse et bariolée aux couleurs plutôt repoussantes : « caca d’oie », « verts », « marron ». De plus, « horde » et « secte » sont à prendre dans leur sens péjoratif. Ils ramènent les poursuivants à une armée de barbares fanatiques. Ainsi, deux principes élémentaires s’opposent ici. D’un côté un ego en fuite, c’est-à-dire un être singulier qui essaie d’échapper au système, de l’autre « ils » et « eux », émissaires et vampires qui traquent les éventuels fugueurs. Nous avons donc un je qui cherche à rester au singulier et à se soustraire à la menace du eux et de son pluriel anonyme qui écime. Ce ils est une force centrifuge et mystificatrice (sorciers, sorcières) en expansion, et la gradation : « Ils ont tout, ils sont partout, ils contrôlent tout, ils avalent tout... » confère à cette horde un statut universel d’hyperpuissance inquisitoriale. L’accent est certes mis sur l’encadrement « ils... tout » placé en anaphore, mais il ne faut pas non plus oublier le mouvement verbal : « ont... sont... contrôlent... avalent... » qui nous informe sur la nature de la « menace ». L’avoir est syntaxiquement placé avant l’être. Autrement dit, elle, la menace,aavant d’être, ce qui en dit long sur sa nature de colosse aux pieds d’argile. Vient ensuite le contrôle, composant essentiel de tout pouvoir égalisateur dans lequel se dissimule aussi la surveillance, qui lui assure sa pérennité en gardant un œil sur d’éventuels dissidents. Et pour finir, arrive en toute logique l’engloutissement : « ils avalent tout ». En véritable Charybde ou char de Jaggernat, ils ne laissent rien derrière eux si ce n’est le néant. On se retrouve donc dans une géométrie circulaire infernale. On roule irrémédiablement de l’avoir au néant et du néant à la possession, l’être n’étant plus au sein de la horde qu’une étape transitoire et évanescente. Debord écrit d’ailleurs que dans cette société contrôlée par la marchandise et le secret : « le vrai [devient] un moment du faux [7] ».
Toutefois, la fuite du narrateur mise en scène par Sollers n’est pas celle d’un pleutre qui fuit devant le danger, mais au contraire une tentative de survie pour réinventer l’équation de l’être ; celle où l’individu et le monde sont liés par la volupté dans un temps extra-spectaculaire. C’est pourquoi on retrouve très vite le narrateur dans un espace pur et inaltéré :
Je lève les yeux. Mon refuge est parfait. Chambre et jardin. Les hauts acacias remuent doucement devant moi. Je sens les vignes tout autour, à cent mètres, comme un océan sanguin. C’est la fin de l’après-midi, le moment où le raisin chauffe une dernière fois sous le soleil fluide. [...] Je suis arrivé en voiture il y a deux heures... J’ai pris un bain, j’ai mis mon smoking pour moi seul, je me suis installé sous la glycine, pieds nus... Premier whisky, cigarettes... J’ai sorti ma machine à écrire, mon revolver, mes papiers [8]...
La situation présente est l’exacte symétrie positive de la situation de départ où le narrateur courait au bord du précipice humain qui risquait de l’engloutir. La fuite introductive s’est faite dans un dessein bien précis : celui d’atteindre un abri qui échappe aux instances de contrôle. Tel est le « refuge parfai t » où Sollers nous invite. Havre de paix où l’ego se recentre sur lui-même, bercé par une nature parfumée et un crépuscule caressant. Sollers reprend ici le principe de l’« arrière-boutique » énoncé par Montaigne dans ses Essais : « Il se faut réserver une arrière-boutique toute nôtre, toute franche, en laquelle nous établissons notre vraie liberté et principale retraite et solitude. » D’ailleurs, cette retraite sur soi est l’occasion d’une sauterie silencieuse et solitaire : le narrateur a mis son « smoking », non plus pour les projecteurs du monde mais pour lui-même ; manière indirecte de montrer que la véritable fête n’est pas à rechercher dans le bourdonnement mondain mais dans la solitude du « je » retrouvé. Plus, il s’agit d’un asile de repos et de calme où le transfuge, qui n’a juré allégeance qu’à lui-même, prépare sa « contre-attaque ». En effet, quoiqu’on puisse dans un premier temps prendre l’information « mon revolver » dans son sens matériel, on ne peut négliger son entourage direct et voir alors dans « mon revolver » non plus un syntagme autonome, mais une apposition déterminative de « ma machine à écrire ». Autrement dit, l’arme de guerre du narrateur contre l’ŒUF, c’est la littérature et l’écriture.
Sollers métaphorise ainsi la concentration des pouvoirs de surveillance, de contrôle et de répression : « Police, parti, armée, banque, syndicat, université, médias, famille, église, école : appelons ça l’ŒUF. L’Œil Unifié Fraternel [9]. » Il faut d’abord souligner que l’emploi détourné du sigle, exercice auquel Sollers aime se livrer [10], vise à parodier la science sans cesse en expansion de l’acronyme. La réduction de termes et d’expressions entières à des sigles est la preuve flamboyante d’une anémie progressive du langage, lequel se voit réduit à sa fonction cursive et fonctionnelle de communication immédiate. C’est au souci de rapidité, de facilité et d’économie de temps de parole que les acronymes répondent. Et cette tendance se répand, en se spécialisant, dans toutes les sphères de l’activité humaine : droit [11], politique [12], médecine, sciences sociales, etc. Paradoxalement, de par sa nature endogamique [13], la logique du sigle poussée à l’excès en vient à contredire sa fonction première et à verser dans le non-sens. En effet, les individus qui n’appartiennent pas au groupe sectoriel employant un acronyme spécifique peuvent difficilement en comprendre la signification ; et par là même s’en voient exclus de fait. Loin de faciliter la communication, l’acronyme peut aussi l’empêcher.
Certes, Sollers fait rentrer le sigle dans le champ dont il semble a priori exclu de droit : celui de la littérature. Mais cette intégration n’est pas une simple transposition de la méthode. Il arrache le sigle à sa fonction utilitaire pratique pour en faire un tour de langage qui se pense lui-même. C’est le cas avec l’ŒUF. Œuf est un mot de la langue courante aisément identifiable et compréhensible par tous. Toutefois, Sollers le fait passer de la catégorie du nom commun à celui d’acronyme dont il nous donne le sens : l’Œil Unifié Fraternel, signifiant par là que la principale fonction de l’ŒUF est la surveillance. Autrement dit, qu’il y a unification et concentration des pouvoirs sociaux, politiques et économiques en vue d’un panoptisme [14]systématique. Ce qui n’est pas sans rappeler le Big Brother de George Orwell. Cependant, contrairement aux sigles communs qui sont aveugles en dehors de leur déploiement, celui de Sollers fait sens en lui-même en tant que signifiant. Un œuf est un espace clos où le futur être vivant est plongé dans un « sommeil » biologique jusqu’à sa naissance. Aussi, la symbolique qui s’en dégage, et que Sollers convoque dans son roman, est celle de l’enfermement de l’individu dans un milieu léthargique où il est réduit à la passivité et à l’ignorance. D’où la métaphore de la course et de la fuite affichée dans l’incipit comme affranchissement du libertin par rapport à la société et à son nid cajoleur.
La dissidence et le libertinage comme écart par rapport à la règle est un véritable fil rouge dans l’œuvre de Sollers. Trente-cinq ans après Portrait du Joueur, dans Les Voyageurs du Temps, il reprend cette thématique en introduisant le rapport pathologique Parasites/Bête :

- Peintre parasité, « Les Paraistes vivent sur la Bête » vus par Benoît Monneret.
- Crédit illustration : benoit.monneret@gmail.com
Les Parasites « vivent sur la Bête », c’est leur expression favorite entre eux. Au moindre signe de fatigue ou de vulnérabilité, ils accentuent leur pression, ils deviennent gonflants, arrogants, ils ne vous laissent plus finir vos phrases, vous coupent, lèvent les yeux au ciel, regardent leur montre, vous contredisent sur n’importe quoi, vous font comprendre qu’ils ont bouclé leur dossier sur votre compte. [...]Y a-t-il des pilules ou des vaccins anti-Parasites ? C’est toute la question. [...] Quelle attitude adopter ? Surtout, ne pas consulter [...]. Les Parasites ont la loi pour eux, ils sont légitimes, alors que la Bête est là en surplus, par hasard, et sa solitude le prouve.
Pour survivre, la Bête parasitée se rendra donc le plus possible inlocalisable (la meilleure solution étant le plein jour), augmentera ses décalages intérieurs, se mettra en état de contre-espionnage, créera son propre centre de renseignement et sa logistique, et, surtout, se méfiera constamment d’elle-même puisque c’est elle qui nourrit ses Parasites en s’intéressant à eux
[15].
Déjà Nietzsche, profondément libertin dans sa recherche philosophique de l’esprit libre, écrivait dans le Zarathoustra : « Où cesse la solitude commence le marché ; et où commence le marché, commencent aussi le vacarme des grands comédiens et le bourdonnement des mouches venimeuses [16] », assimilant le peuple à des drosophiles chargées de venin qui s’agglutinent sur le créateur et l’arrachent à sa grande solitude. Elles le pressent, l’accablent, demandant sans cesse du spectaculaire et de la mise en scène. D’où la recommandation : « Fuis dans ta solitude : je te vois harcelé par les mouches venimeuses. » On peut constater une filiation entre Nietzsche et Sollers : le rapport entre la Bête et les Parasites n’est pas sans faire écho à celui entretenu entre les créateurs et les mouches venimeuses. C’est pourquoi il est intéressant de faire dialoguer ici deux auteurs qui partagent la même volonté d’affranchissement devant l’esprit de pesanteur [17]. Chez Sollers, les Parasites sont les agents de l’ŒUF, la horde de couvre-chefs, plus ou moins conscients de leur condition d’infiltrés, chargés de s’accrocher à toute Bête et de l’affaiblir, c’est-à-dire à toute personne qui vit en dehors de l’ŒUF. Les parasites sont des organismes qui n’existent qu’aux dépens des autres, desquels ils puisent leur nourriture et leur force, à la manière des vampires ou des goules. Ils forment ainsi l’archétype de la masse diffuse qui vit par procuration « sur le dos des autres ». Sollers inscrit cette situation pathologique dans un monde métaphorique extrahumain, établissant une mise à distance ironique qui appelle un décodage : aux Parasites répond la Bête, qui incarne toujours, aussi bien dans son sens propre, figuré, que religieux, l’anormalité et le danger. Derrière la Bête il faut bien entendu comprendre l’écrivain, l’équivalent du créateur chez Nietzsche.
De plus, l’auteur du Zarathoustra et celui de Femmes se rejoignent en ce qu’ils préconisent tous deux la solitude et la retraite intérieure comme curatif contre les Parasites. Sollers fait intervenir le travail du négatif dans cette quête. Pour devenir un contre-espion « inlocalisable », bref pour entrer dans la clandestinité, il propose la stratégie suivante : « la meilleure solution [est] le plein jour ». Autrement dit, c’est en se plaçant au cœur du vacarme spectaculaire, en tant qu’apparence, qu’on se ménage l’espace de liberté intérieure le plus conséquent ; que l’on devient, comme dirait Nietzsche, « clandestins sous des manteaux de lumière [18] ». C’est sous les projecteurs que l’anonymat [19] est atteint, tandis qu’en parallèle la Bête développe, en elle et pour elle, une discipline martiale de survie. Le vocabulaire militaire dont le texte est imprégné illustre très bien cette attitude : « contre-espionnage, renseignement, logistique ». Enfin, le rapport entre la Bête et les Parasites ne s’arrête pas au simple dualisme, il est plutôt dialectique dans la mesure où le libertin, tel que l’envisage Sollers, en « s’intéressant à ses ennemis », les fait travailler, à la fois pour lui et contre lui : la clandestinité est un art de la guerre.
L’Art d’aimer selon Ovide
Ce n’est pas un hasard si, dans la société romaine phallocratique, le premier à avoir pris en compte le point de vue féminin dans les affaires sexuelles fut un libertin : Ovide. Dans l’Art d’aimer, il nous propose la séquence suivante :
Odi concubitus qui non utrumque resoluunt [...]Odi quae praebet, quia sit praebere necesse,
Siccaque de lana cogitat ipsa sua ;
Quae datur officio, non est mihi grata voluptas [...]
Me voces audire juvat sua gaudia fassas ;
Atque, morer, me, me sustineamque, roget.
Adspiciam dominae victos amentis ocellos ;
Langueat et tangi se vetet illa diu [20].
Je hais les étreintes qui ne comblent pas les deux amants [...]. Je hais la femme qui se livre parce qu’elle doit se livrer, et qui, n’éprouvant rien, songe à son tricot. Le plaisir qu’on m’accorde par devoir ne m’est pas agréable [...]. Je veux entendre des paroles avouant la joie qu’elle éprouve ; qu’elle me demande d’aller moins vite et de me retenir. Que je voie les yeux vaincus d’une maîtresse qui se pâme et qui, abattue, ne veut plus, de longtemps, qu’on la touche.

Le poète nous livre ici un manifeste pour la satisfaction du désir féminin. Il clame ouvertement sa détestation pour le coït forcé. Par deux fois il place en tête de vers, c’est-à-dire en position forte, le verbeodirequi signifie haïr, abhorrer. Le devoir (officio) se présente ici comme une détestable entrave au bonheur (gaudia) et au plaisir (voluptas) sexuels. Cette manière de considérer l’acte sexuel peut paraître plutôt normale à nous autres Modernes, mais dans le cadre antique elle s’avère très audacieuse. En effet, en fonction de leur rang social, les femmes étaient plus ou moins soumises à des restrictions sexuelles. La jouissance féminine étant vue comme incontrôlable, voire dangereuse, la bienséance voulait, par exemple, qu’une matrone ne témoignât aucun signe de plaisir pendant l’acte et restât immobile. Mais le poète assène un violent coup de marteau à ce carcan. Il renverse la hiérarchie sexuelle ; de la place de dominant satisfait, l’homme devient partenaire à l’écoute des désirs de sa maîtresse. Casanova, libertin notoire et non moins grand « féministe », ne défend pas une autre position lorsqu’il déclare dansHistoire de ma vie : « Le plaisir que je donnais composait toujours les quatre cinquièmes du mien. » D’autre part, Ovide n’hésite pas, dans cette scène, à renforcer son idée en lui donnant un cadre expérimental. Sa description, quoique hallucinée, produit un effet de réel électrique où l’empoignade des deux amants s’impose à notre esprit.
En outre, dans lesMétamorphoses, Ovide exploite le mythe de Tirésias, devin qui a eu l’opportunité de changer de sexe et de goûter les deux orgasmes, pour accorder aux femmes la suprématie du plaisir érotique [21]. Ce qui représente un véritable coup de force dans le monde romain phallocentrique, où la place laissée au désir féminin est une peau de chagrin. De même, dans lesAmores, il nous raconte qu’il s’est introduit en catimini à une cérémonie consacrée à Isis dont le culte avait été interdit un temps par Auguste. L’introduction de cette déesse égyptienne était mal vue par le Prince car elle faisait rejaillir le souvenir de Marc Antoine et de Cléopâtre, devenus le symbole du couple vaincu par la luxure. Dans l’imaginaire collectif, Cléopâtre a été et restera la figure de la reine débordante de sensualité. Quinze siècles plus tard, Shakespeare fera dire à Enobarbus sur l’Égyptienne, dans sa pièce consacrée au célèbre couple : « Les autres femmes finissent par écœurer les appétits qu’elles satisfont, mais elle, plus elle a rassasié, plus elle affame. » Par ailleurs, la célébration d’Isis se présentait comme un culte ouvert à toutes dont la symbolique valorisait la femme au sein de la société [22].
Ovide introduisait les femmes comme les égales de l’homme dans la liberté d’accéder à la jouissance sexuelle. Sollers poursuit l’œuvre d’Ovide en établissant son libertinage autour de la notion d’athéisme sexuel. Il s’agit pour lui de démythifier la relation sexuelle et de la disjoindre de lareligionà base de discours social, religieux et biologique dont elle est entourée. Les intérêts économiques du marché, les interdits religieux et laprovidence nataliste dressent un barrage invisible entre les corps, que seule l’incrédulité matérialiste en sexualité peut faire disparaître. Il convient, pour libérer le désir, et en premier lieu celui des femmes car elles sont les cibles prioritaires de la répression, de refuser la sacralisation de la sexualité. Ainsi, l’acte doit se présenter comme un échange libre de muqueuses entre deux individus qui recherchent ensemble le plaisir. C’est pourquoi, dans Portrait du Joueur, les séances érotiques entre le narrateur et Sophie sont élaborées comme un jeu, dont la préparation est une liaison épistolaire, à la manière des libertins du XVIIIe siècle. La précision chirurgicale avec laquelle ces scènes sont décrites [23]a pour fin la désacralisation et l’effacement du sérieux entourant l’acte sexuel qui a pour conséquence fatale la mélancolie. Au contraire, le narrateur et sa partenaire chassent la pesanteur métaphysique qui entoure la sexualité en la considérant comme un jeuen profondeur. En profondeur, car il ne s’agit pas d’un simple divertissement, mais davantage d’un jeu au sens ancien de ludus. Comme le narrateur le rapporte dans le roman : « Elle marque qu’elle a choisi librement le jeu, et ce que ce jeu lui apprend sur elle et au-delà d’elle [24]. » Dans cet échange sexuel libéré, Sophie peut laisser ses désirs les plus refoulés surgir et s’épanouir. D’une certaine manière, c’est une partie de son être qui se révèle à elle au cours des entrevues ludiques qu’elle a avec le narrateur. La violence de leur sexualité transgressive est une estocade sifflante portée à la sexualité permissive téléguidée par l’idéal féminin. C’est en ce sens que le narrateur libertin mis en scène dans le roman assure son rôle d’émancipateur du désir féminin et de la condition des femmes.
En refusant le mythe de l’Éternel féminin, les libertins, tels que les représentent Ovide et Sollers, se voient immédiatement mis sous caution et surveillance, voire tout simplement écartés par les pouvoirs établis ; les enjeux qui gravitent autour des femmes sont trop cruciaux pour qu’on laisse ces aventuriers naviguer librement. Néraudau écrit à juste titre à propos de l’exil du poète : « Le Prince châtiait officiellement l’immoralité de l’Art d’aimer[...] mais à la vérité, il éloignait le représentant d’un mouvement d’opinion qui défiait sa politique morale [25]. » Au contraire, dans Le Cœur Absolu, Sollers met en scène des conjurés libertins qui fondent une société secrète proposant un modèle d’union libre guidé par l’athéisme sexuel.En voici la charte :
LE CŒUR ABSOLU
I. La Société a été fondée le 8octobre 1984, à 18heures, à Venise, par très beau temps. [...]
II. La Société a pour but le bonheur de ses membres. Par bonheur, on entend, dans l’ordre qu’on veut, le plaisir et la connaissance. Pour l’instant, la Société comprend trois femmes et deux hommes. [...] Les membres de la Société sont rigoureusement égaux. Ils ont tous les droits et aucun devoir.
III. Le secret de la Société est absolu. Aucun membre n’a de comptes à rendre à aucun autre. Chaque membre est seulement tenu de n’être pas ennuyeux.
IV. Les activités sexuelles des membres de la Société sont libres à l’intérieur comme à l’extérieur. Il est permis de les raconter. Il est interdit de s’y sentir obligé. [...]
V. Un candidat qui ne serait pas amateur de musique sera automatiquement récusé.
VI. Les considérations de race, de nationalité, de politique, de classe sociale ou de secte sont étrangères à la Société. [...]
VII. Par définition, les membres de la Société sont heureux. Ils se disent pourquoi. Sinon, ils se taisent. Tout membre peut cesser de l’être quand il lui plaît [26]
À la manière de la Déclaration des droits de l’Homme, l’acte fondateur de la société du Cœur Absolu se présente sous une forme juridique, Sollers empruntant à la langue des juristes son style concis et ramassé. Véritable déclaration du droit au bonheur, on remarque que la structure de la société s’articule autour de trois pôles : la liberté, l’égalité et le bonheur. De même qu’Ovide donnait aux femmes des armes égales aux hommes en composant un livre uniquement dans leur intérêt, la charte est élaborée dans l’unique dessein de créer une cellule clandestine au sein de laquelle les femmes jouissent des mêmes droits que les hommes dans leur conduite amoureuse. L’aliénation des femmes, liée au contrat social et au carcan qui en découle, est ici évacuée. Les membres de la Société sont des êtres absolus. Ils ne forment pas un groupe humain relatif national, responsable devant une instance supérieure comme le sont par exemple les citoyens français vis-à-vis de l’État, ils n’ont pas de nationalité. Ce qui réunit les membres du Cœur Absolu, c’est une certaine idée du bonheur, coagulation du savoir et du plaisir libre. Enfin, la nécessité du secret est la pierre angulaire de la Société, car il faut passer de l’autre côté du miroir où rutilent les édifices idéologiques pour rencontrer l’au-delà de la censure et la jouissance.
Le Verrou sur pileface (1)
Le Verrou sur pileface (2)
Libertinage et langage
Le dire
Balzac, qui avait très bien compris le poids érotique des mots, écrivait : « parler de l’amour c’est faire l’amour ». Autrement dit, parler d’amour c’est déjà, par la verbalisation même, commencer l’acte charnel. Il est reconnu que les mots portent en eux-mêmes une puissance sensuelle admirable. Enivrer l’esprit d’une femme avec des paroles lascives se révèle au moins aussi efficace que les caresses les plus audacieuses. D’ailleurs, dans l’Antiquité, on attribuait à la parole une vertu quasi magique de réalisation, au sens fort du terme. Le mythe de la pomme de Cydippe [27]l’illustre très bien.
Ovide et Sollers, en explorateurs libres et passionnés des chimies amoureuses, ne cessent de rappeler la nécessité du verbe dans les affaires amoureuses, du fait même de sa portée charnelle. La volupté ne se goûte que dans la chaleur des mots. Leur œuvre est ponctuée par des rappels motivés et récurrents à l’exercice de la parole. Dans l’Art d’aimer, Ovide écrit : Quis sapiens blandis non misceat oscula verbis [28] ?(Quel connaisseur ne mêlerait pas des paroles caressantes aux baisers ?), et Sollers dansUne vie divine : « Il faut mêler la parole à cet élan, ceux qui ne parlent pas en baisant s’illusionnent. » On retrouve bien la même idée chez nos deux poètes : la parole est consubstantielle à l’acte. Le verbe « mêler », qui figure dans les deux extraits, le confirme. Il présente le baiser comme un échange positif où verbe et chair se déversent l’un dans l’autre, produisant une solution homogène : le baiser verbal. Ainsi, embrasser une femme sans lui parler serait en quelque sorte amputer la sensualité même du rapport en le réduisant à un mouvement mécanique. Le terme médical est dans ce cas tout à fait adapté, pour peu qu’on s’enfonce dans l’épaisseur des mots. Le baiser n’est-il pas défini comme unrapport oral ? Et Sollers poursuit en ces termes : « Le baiser-cascade est en même temps un hommage hyperverbal : on embrasse le langage de l’autre. » L’auteur nous laisse clairement entendre que la jointure entre les corps se situe davantage dans les mots que dans la vie biologique. Le baiser est à la fois offrande de sa proprelangueet dévouement pour celle de l’autre, suivant l’heureuse équivoque que le motlanguesoulève.
Bataille rappelait justement dans son essaiL’érotismeque la différence fondamentale entre les animaux et les hommes se situe précisément au niveau de la sexualité : « L’érotisme de l’homme diffère de la sexualité animale en ceci justement qu’il met la vie intérieure en question. » Autrement dit, l’homme devient homme parce qu’il parvient à intérioriser sa sexualité, donc à interroger son propre désir. Or le moindre embryon de questionnement, le premier germe de pensée, la plus petite amorce de rationalité trouve sa source dans le langage. Les recherches linguistiques, philosophiques et analytiques des XIXe et XXe siècles ont parachevé cette vérité en ruinant la thèse selon laquelle le langage ne serait qu’un média pour exprimer une pensée qui lui préexisterait. Heidegger écrivait à ce titre : « Ce n’est qu’autant que l’homme parle qu’il pense, et non l’inverse, comme la métaphysique le croit encore. »
Le libertin, tel qu’il est mis en scène par Ovide et Sollers, est en quelque sorte un professionnel du langage. La parole est une seconde nature pour lui ; le prolongement oral de son désir. Le séducteur est avant tout un excellent orateur. Dans cette perspective, c’est grâce au langage que le coït quitte le sentier animal de la pulsion pour pénétrer dans le vase humain de la jouissance. Dans le livre II de l’Art d’aimer, on trouve une séquence poétique particulièrement voluptueuse :
Adspicies oculos tremulo fulgore micantes,Ut sol a liquida saepe refulget aqua ;
Accedent questus, accedet amabile murmur
Et dulces gemitus aptaque verba joco [29].
Tu verras alors les yeux de ton amie palpiter d’un éclat tremblant, pareil à la lumière souvent reflétée par une eau transparente ; viendront les gémissements ; viendra un murmure amoureux et de tendres plaintes, puis les paroles qui conviennent à l’amour.
Cet extrait figure dans la section « Pratiques des choses de l’amour » du traité.A priori, on la penserait justement réservée aux conseils pratiques. Mais, comme le rappelle R. Martin, « l’Ars amatoria n’est pas le Kama Sutra ; il en est même aux antipodes, et il n’est guère de livre plus pudique [30] » ; on ne rencontre en effet aucune description obscène, ni de véritables recommandations pour l’activité sexuellein medias res, si cen’est pour trouver la position la moins fatigante... Plus, là encore, la parole occupe une place de premier plan. Le cadre de la scène est donné aux vers précédents. Il s’agit de découvrir les horizons où sa partenaire aime à se faire caresser et ne pas avoir honte de s’y attarder. Alors, les yeux commencent par trahir fidèlement l’expansion tempétueuse du plaisir. Puis voici surgir les sons, comme en écho. Cependant, en observant le mouvement de la séquence, on peut remarquer une gradation lexicale qui place le terme de la jouissance dans la parole. En effet, il y a une métamorphose linguistique du plaisir. D’abord les questus (gémissements) puis le murmur(voix basse et confuse), lesgemitus(plaintes) et enfin les verba (les mots, la parole). Plus le vers se dévide, plus le miroir sonore du plaisir mute vers le langage. On part du simple son, proche de l’animalité, pour s’élever vers la voix et enfin s’épanouir lumineusement dans la parole, c’est-à-dire l’humain. Mouvement ascensionnel qui est amplifié par le redoublement anaphorique accedent/accedet ; accedere signifiant en latin : aller vers, mais aussi pénétrer dans, se mêler à.
La jouissance est humaine car elle traverse le langage.On retrouve une idée similaire dans l’élégie 1 du livre III des Amores où la Poésie légère (l’Élégie), personnifiée en muse, s’adresse en ces termes à son alter ego épique, la Tragédie :Rustica sit sine me lascivi mater Amoris /Huic ego proveni lena comesque deae [31] (Rustique serait sans moi la mère du voluptueux Amour /Je suis née pour servir de pourvoyeuse et de compagne à cette déesse). Il se dégage de ces deux vers l’idée d’un don civilisateur de la poésie. L’amour quitte le monde sauvage et mal dégrossi des champs pour s’adoucir et se raffiner à travers le prisme de la poésie. L’Élégie se considère comme pourvoyeuse (lena) et compagne (comes) d’Aphrodite. Les substantifs employés sont lourds de significations. Ils intronisent la langue poétique comme entremetteuse gratuite du fluide amoureux entre les êtres. Sollers, dans toute son œuvre, défend encore plus explicitement l’indissociable combinaison érotique des deux langages : le corps et la parole. Dans son recueilÉloge de l’infini, il consacre plusieurs articles à cette question et va encore plus loin qu’Ovide. Il écrit notamment : « On fait plutôt l’amour avec des voix qu’avec des volumes [32] », ou encore : « Les expériences dites érotiques, avant d’être le contact de deux physiologies, c’est dans le dire que ça surgit [33]. » Sollers renverse l’équation qui veut que la jouissance trouve son exultation dans le spasme organique. La jouissance en dehors des mots est une illusion car elle est aveugle.

In L’Infini N° 88, Automne 2004
Il ne faut pas en conclure pour autant que le corps ne joue plus rien dans cette affaire. Bien au contraire, l’entreprise verbale telle qu’elle est envisagée par les libertins vise à la réappropriation des corps. Un interdit, plus ou moins fort selon l’époque, frappe toute parole trop précise sur les affaires charnelles. Elle est alors généralement taxée d’obscénité. Mais cette même obscénité peut s’avérer être un poison curatif puissant, à la manière du pharmakon grec : à la fois antidote et poison. C’est envisagée sous cet angle que l’obscénité, en tant que remède pour l’individu et venin pour la société, procède comme une pierre fondatrice dans l’œuvre de Sollers. Mais encore faut-il s’entendre sur le sens qu’on lui accorde. On peut dégager deux grands versants d’obscénité. Le premier, diamétralement opposé à l’érotisme, est la dégradation de la sexualité dans la laideur et le mauvais goût, proche cousin de la pornographie moderne. Le second est la transgression volontaire et poétique de l’idéologie régnante sur l’amour. L’obscénité telle que la met en scène Sollers dans ses romans relève du second versant. C’est très sensible dans les lettres que Sophie envoie au narrateur dans Portrait du Joueur :
IV. - « Comme j’ai senti ta queue me mettre hier ! Ma voix est restée colorée par ton foutre : douce et délicieusement langoureuse. J’ai retrouvé un détachement digne et sournois pour l’après-midi. J’ai joué mon rôle très simplement. Enterrement traditionnel. J’ai entendu la messe et suis allée au cimetière. Il faisait froid. [...]Prépare ta queue,elle va avoir du travail demain. J’aimerais, d’ailleurs, te trouver travaillant dans la cuisine. Je me tords en pensant à ton affairement servile. [...]
Tu me baiseras ensuite sur le lit. Je te donnerai mon cul à genoux. Tu pourras alors m’insulter pour te venger. Tu me donnerastout ton foutreen m’appelantpute, salope, garce, pourriture.
Tu éjaculeras, en entendant ces mots : « Finis ton travail ordure ! »
À lundi,
Sophie. »
[...]
J’admire toujours comment elle arrive, sèche et froide, mais mentalement décidée, absolument pas excitée, sauf, et encore, par le projet en lui-même... Ce sont seulement les mots et la voix qui l’échauffent peu à peu, de telle façon qu’il faut comme retraverser chaque fois tout le barrage social, la censure spontanée [34].
On retrouve ici la fonction érotique fondamentale des mots. Sans le prologue littéraire de la lettre, qui pose le cadre futur de la scène sexuelle, et le recours à la parole, il ne peut y avoir d’excitation. Les corps sont comme englués dans une poix neutralisante. Seul le langage permet à Sophie d’accéder à l’au-delà de la censure. Le « barrage social » et « la censure spontanée » évoqués par le narrateur, c’est-à-dire l’idéologie,dressent une barrière entre le sujet et son corps que seuls « les mots et la voix » peuvent lever. Et l’obscénité affichée de la lettre (Sophie emploie un vocabulaire que l’on qualifierait spontanément de « grossier et dégoûtant ») n’a pas d’autre fonction. Déchirer la bure sociale par le scandale et la violence des mots afin de redonner au sujet la propriété de son corps. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, il s’agit bien de lettres d’amour, mais d’un amour bien particulier. Un amour où la masse idéalisatrice, autrement dit répressive, des rapports entre un homme et une femme est balayée par le pouvoir profondément obscène contenu dans le langage. Le scandale des mots est d’autant plus fort que Sollers s’amuse à les placer dans la bouche de Sophie/Sophia. C’est-à-dire de la sagesse en personne. Par ailleurs, cette parole obscène se dessine sur une toile textuelle teintée de poésie. On voit très bien que Sophie n’est pas une bête primaire. Elle sait jouer avec les ressources et la richesse du langage. On peut relever notamment la métaphore « ma voix colorée » qui, une fois associée à l’âpreté du substantif « foutre », déclenche un prodigieux court-circuit ; mariage scandaleux entre une image délicate et un mot pornographique. Le lexique le plus cru est entouré par un cadre littéraire qui le contamine et le sauve de la vulgarité. Le ton général des lettres place les deux amants (le narrateur et Sophie) dans un cadre théâtral où ils sont à la fois acteur et spectateur de la pièce qu’ils vivent.
Mais cet interdit qui frappe la parole érotique, en plus d’être un effet de mœurs sur la sexualité ainsi que le prétendu signe d’une « pudeur instinctive » devant la scène primordiale, est peut-être aussi le symptôme d’une angoisse plus profonde, plus abyssale, tellement visible qu’elle aveugle, une peur radicale des mots. Une terreur ontologique devant le pur néant qui se déploie entre le signe verbal et la chose désignée.
[...]
Dans ce rapport tendu au langage érotique, il existe trois attitudes : l’angoisse, l’aveuglement, le rire. Le libertin choisit le rire et le jeu, au sens ancien de lusus (le mot latin possède plusieurs sens qui appartiennent tous à sa nébuleuse sémantique : jeu, divertissement, badinage, ébats amoureux). Le poète libère les mots de l’angoisse et du tabou. L’espace littéraire se transforme en festin verbal. Autrement dit, le libertinage se traduit par un rapport décomplexé et libéré au langage de l’amour. L’érotisme étant un jeu perpétuel sur les dits et les non-dits, les codes et les signes, l’écrivain danse sur les mots et leur sémantisme. Il invente un système. Sollers le fait en recourant à l’obscénité affichée et scandaleuse du lexique sexuel (lettres de Sophie). Il puise à la source tellurique et hyperbolique du langage. Ovide emprunte une autre voie en recourant à l’allusion génératrice de l’équivoque. Dans l’élégie 4 du livre I, un simple repas devient le théâtre électrique d’un échange muet entre l’amant-poète et sa maîtresse, sous les yeux de l’hôte et mari :
Cum premet ille torum, vultu comes ipsa modestoIbis ut accumbas, clam mihi tange pedem ;
Me specta nutusque meos vultumque loquacem,
Excipe furtivas et refer ipsa notas.
Verba superciliis sine voce loquentia dicam ;
Verba leges digitis, verba notata mero.
Cum tibi succurrit veneris lascivia nostrae
Purpureas tenero pollice tange genas ;
[...]
Cum tibi, quae faciam, mea lux, dicamue, placebunt,
Versetur digitis anulus usque tuis [35]
Lorsqu’il [le mari] aura pris place sur le lit du festin, et que toi, sa compagne, l’air modeste, tu iras t’allonger à son côté, touche discrètement mon pied avec le tien. Regarde-moi, regarde les mouvements de mon visage et le langage de mes traits. Épie mes signes furtifs et réponds-y. Des mots seront exprimés par mes sourcils, sans que je parle ; tu liras des paroles tracées avec mes doigts, paroles écrites sur la table avec le vin. Lorsque l’ardeur de nos étreintes surgira dans ton esprit, touche de ton doigt délicat tes joues rougissantes. [...] Quand mes paroles ou mes gestes, lumière de ma vie, te plairont, roule longtemps ta bague le long de tes doigts.
On voit très bien s’organiser ici un monde tout entier de langage. Il ne s’agit plus d’un langage de mots mais de signes. Les mots n’ont pas de contour sonore mais un contour physique, dicam verba superciliis (des mots seront exprimés avec mes sourcils), et pourtant ils ont un sens. L’échange est fondé sur un code crypté de signes qui permet la communication entre les deux amants sous le nez même du dragon et mari. Chaque petite manifestation physiologique volontaire est appelée à être transcrite comme le serait une langue étrangère. La clef de la transcription, seuls les amants la possèdent. L’instant prodigieusement érotique de cette scène repose sur ce double langage, certes muet, mais physiquement très éloquent. Le code caché de la bague recèle sur ce point une équivoque remarquable : Versetur digitis anulus usque tuis (Roule longtemps ta bague le long de tes doigts). Est-ce juste un code innocent pour affirmer ou infirmer les paroles et les gestes de l’amant ? Ou bien ne possède-t-il pas une signification plus dérobée, directement en prise avec l’atmosphère luxurieuse et diffuse de la scène : l’aveu bouillant d’un désir charnel ? Vu sous cet angle, le code de l’anneau peut s’interpréter comme le miroir sensible de pratiques sexuelles bien connues, à savoir la pénétration et la masturbation. En effet, le terme latin versetur doit se comprendre par opposition au prosus. Le versus, c’est une action de retour sur elle-même, contrairement au prosus qui est une action en ligne droite (d’où la distinction vers/prose en écriture). De même, l’anneau et les doigts portent en eux une symbolique liée à la sexualité. L’espace vide central de la bague comme orifice et les doigts comme préfiguration phallique. Cependant, l’écriture positivement allusive du poète ne nous permet pas de trancher. Le lecteur est seul juge.
En somme, l’ancienne métaphore anglaise pour désigner l’adultère convient merveilleusement bien à la prose furieuse de Sollers et aux vers licencieux d’Ovide. Ils s’adonnent l’un comme l’autre à une prolifique conversation criminelle.
[1] G. Bataille, L’érotisme, Minuit, « Reprise », 2011.
[2] Sade,Les 120 journées de Sodome, 10/18, 1998.
[3] G. Debord,La Société du Spectacle, Gallimard, « Folio », 2011, p.24-25.
[4] Ph. Sollers,Femmes, Gallimard, 2007, p.161-162.
[5] Ibid., p.161-162.
[6] Ph.Sollers, Portrait du Joueur, Gallimard, « Folio », 2001, p.13.
[7] La Société du Spectacle,op. cit., p.19.
[8] Portrait du Joueur, p.14-15.
[9] Ibid., p. 59.
[10] Ibid., v.349.
[11] Par exemple, la L.O.L.F. : Loi Organique relative aux Lois de Finances.
[12] Le débat présidentiel du 2 mai 2012 entre Nicolas Sarkozy et François Hollande a été à cet égard un feu d’artifice de chiffres et d’acronymes.
[13] Endogamique car son sens et sa réalité se bornent au groupe social qui l’emploie.
[14] Michel Foucault s’est intéressé à ce concept dans son essaiSurveiller et punir, d’où il ressort qu’au terme de la logique de surveillance il y a celle de la normalisation des conduites.
[15] Ph.Sollers,Les Voyageurs du Temps, Gallimard, 2009, p.40-41.
[16] Nietzsche,Ainsi parlait Zarathoustra, Paris, Le Livre de poche, 2008, 1ère partie : « Des mouches du marché ».
[17] Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, Paris, Le Livre de poche, 2008, 1ere partie : « Des mouches du marché ».
[18] Nietzsche,Par-delà bien et mal, Gallimard, « Folio essais », 2012. aphorisme.
[19] C’est dans la méthode pour atteindre cet anonymat que Sollers et Guy Debord s’opposent radicalement : « Je n’ai pas choisi, comme lui, la position du retrait, plutôt celle de l’utilisation à haute dose de la technique médiatique, mais le but est le même », explique Sollers dans un entretien avec Télérama pour l’exposition consacrée à Debord à la BNF (2013).
[20] Art d’aimer, II, v. 683, 685-687, 689-693.
[21] Voir Ovide, les Métamorphoses, livre III.
[22] Comme le rappelle J.-P. Néraudau : « Le culte, en effet, s’était surtout répandu chez les femmes de toutes les classes sociales qui étaient sensibles à la suprématie que la déesse avait conquise sur son mari Osiris et à l’égalité que les rites établissaient entre les hommes et les femmes, autant qu’entre les courtisanes et les femmes mariées » (Introduction aux Amores d’Ovide, Les Belles Lettres, « Classiques en poche », 2009).
[23] Voir l’extrait d’une des lettres de Sophie rapporté dans la troisième partie de cette étude : « Libertinage et langage ».
[24] Portrait du Joueur.
[25] Introduction aux Amores d’Ovide.
[26] Sollers, Le Coeur Absolu, Gallimard, « Folio », 2002, p. 52-53.
[27] Acontios tombe amoureux de Cydippe lors d’un voyage à Délos pour célébrer une fête en l’honneur d’Artémis. Afin que la jeune fille devienne sa femme, il cueille une pomme et grave sur la peau du fruit : « Je jure par le temple d’Artémis de me marier avec Acontius. » Il lance la pomme près de Cydippe, qui la ramasse et lit à haute voix l’inscription... près du temple de la déesse. Le temps de réaliser son erreur, il est trop tard. La verbalisation orale a valeur d’acte et de serment. (On trouve le mythe de Cydippe chez Callimaque et dans les Héroïdesd’Ovide, lettres 20-21.)
[28] Art d’aimer, I, v. 661.
[29] Art d’aimer, II, v.721-724.
[30] InHommages à Jozef Veremans,op. cit.
[31] Amores, III, 1, v.44-45.
[32] Éloge de l’infini, « Le nouveau code amoureux », p.711.
[33] Éloge de l’infini, « Le nouveau code amoureux », p.711.
[34] Portrait du Joueur, p.147-146, 155.
[35] Amores, I, 4, v. 15-21, 25-26.




 Version imprimable
Version imprimable



 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?


