« Nous avons besoin du sud à tout prix,
d’accents limpides, innocents,
joyeux, heureux et délicats. »
« Sud innocent, accueille-moi !
Mais aller pas à pas — ce n’est pas une vie,
Pied à pied, cela rend germanique et lourdaud.
J’ai demandé au vent de m’élever bien haut,
J’ai appris à voguer aux côtés des oiseaux, —
Vers le Sud, sur la mer, j’ai volé, moi aussi. »
En 1989, dans un entretien avec Alain Kirili, Philippe Sollers déclarait : « Les vrais différences ne sont pas est-ouest, mais nord-sud. Un Nord et Sud qui sont poétiques, non pas géographiques. Les Français vivent une sorte de polémique incessante, une guerre civile incessante entre le Nord et Sud. Ce Sud n’est pas un lieu ensoleillé, un Club Méditerranée. C’est une sorte de coagulation de pratiques symboliques dans un certain nombre de pays [1]. » C’est en ce sens poétique et musical que Nietzsche pouvait affirmer, un siècle plus tôt, à propos de Mozart (et contre Wagner) : « Le bon vieux temps est passé, en Mozart il a fait entendre son dernier chant. Estimons-nous heureux que son rococo nous parle encore, que son bon ton, sa passion délicate, son plaisir d’enfant aux chinoiseries et aux fioritures, sa politesse qui part du coeur, son goût de la grâce, de la tendresse et de la danse, sa sensibilité proche des larmes, sa foi dans le sud touchent encore quelque chose en nous [2]. » Ces considérations philosophiques n’ont jamais empêché l’écrivain français et le Dionysos philosophos de privilégier, lors de leurs voyages ou dans leurs écrits poétiques ou romanesques, la Grèce, l’Espagne, la Suisse (Sils Maria) et l’Italie.
On doit à Pierre Parlant, écrivain, poète et éditeur qui vit et travaille dans le sud de la France, un essai Les courtes habitudes – Nietzsche à Nice et, tout récemment, le choix et la traduction des Lettres d’Italie de Nietzsche, précédées d’une importante préface. Ces lettres permettent, à partir de récits de voyages et de séjours incessants — de Nice à Turin, en passant par Gênes et Venise —, de considérations météorologiques et de réflexions sur une santé préoccupante et fragile, une nouvelle approche d’un Nietzsche, à la recherche, improbable et, pourtant, nécessaire et définitive, du lieu et de la formule.
NIETZSCHE À NICE
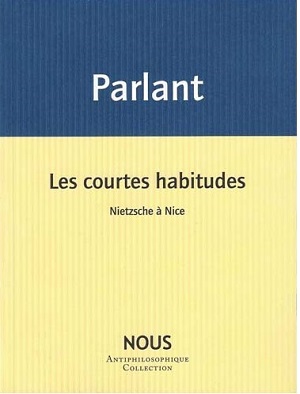 Entre 1883 et 1888, Nietzsche séjourne plusieurs fois à Nice, en hiver, où il emploie son temps entre écriture et promenades en bord de mer. Ce texte, sorte d’hommage, procède de la lecture de sa correspondance et articule poésie versifiée et prose pour lui donner la parole en évoquant la succession des faits, les noms et les lieux, l’aléa des circonstances et des suites d’impressions.
Entre 1883 et 1888, Nietzsche séjourne plusieurs fois à Nice, en hiver, où il emploie son temps entre écriture et promenades en bord de mer. Ce texte, sorte d’hommage, procède de la lecture de sa correspondance et articule poésie versifiée et prose pour lui donner la parole en évoquant la succession des faits, les noms et les lieux, l’aléa des circonstances et des suites d’impressions.
Les uns voyagent parce qu’ils se cherchent ; les autres parce qu’ils voudraient se perdre. »
Nietzsche

la matinée va prendre fin
je suis assis au beau milieu d’un froissement de feuilles
et je lis un courrier composé
ce sont des lettres et des cartes postales
une affaire qui ne m’est pas adressée
l’ensemble couvre une période
de vingt-trois ans
pour s’interrompre en 1888
Pierre Parlant pour « Les courtes habitudes – Nietzsche à Nice »
France Culture, « ça rime à quoi », par Sophie Nauleau, 7 décembre 2014.

Musique
Extraits de l’album One dark night I left my silent house par Marilyn Crispell et David Rothenberg (Ecm, 2010)
Rencontre avec l’écrivain, poète et éditeur Pierre Parlant
par Philippe Chauché
Extrait d’un entretien pour La Cause littéraire (2017)
[...] Parlons enfin de vous : écrivain, essayiste, passionné d’art et de philosophie, que vous enseignez (ou que vous avez enseignée ?), passion de Nietzsche, « Les Courtes Habitudes », penseur mal compris, mal lu ? Qu’en direz-vous ?
 Avant d’avoir récemment suspendu mon activité, j’ai en effet enseigné assez longtemps la philosophie ; d’abord en Lycée – j’en garde le souvenir de moments passionnants – puis à l’Université. Vous faites allusion ici à un livre, Les courtes habitudes, publié aux éditions Nous en 2014. Je l’ai composé à partir de ma lecture de la correspondance de Nietzsche lors de ses séjours niçois. Ce livre de poésie a rejoint une des collections de ces éditions qui se nomme « Antiphilosophie ». Ça m’a semblé très pertinent puisque Nietzsche, comme Pascal, Kierkegaard ou Wittgenstein, doivent aussi être considérés dans leur rapport polémique avec non seulement la tradition philosophique mais avec les prétentions de son exercice.
Avant d’avoir récemment suspendu mon activité, j’ai en effet enseigné assez longtemps la philosophie ; d’abord en Lycée – j’en garde le souvenir de moments passionnants – puis à l’Université. Vous faites allusion ici à un livre, Les courtes habitudes, publié aux éditions Nous en 2014. Je l’ai composé à partir de ma lecture de la correspondance de Nietzsche lors de ses séjours niçois. Ce livre de poésie a rejoint une des collections de ces éditions qui se nomme « Antiphilosophie ». Ça m’a semblé très pertinent puisque Nietzsche, comme Pascal, Kierkegaard ou Wittgenstein, doivent aussi être considérés dans leur rapport polémique avec non seulement la tradition philosophique mais avec les prétentions de son exercice.
Sur la question de la réception de Nietzsche, il suffit de rappeler ce qu’il écrivait lui-même, « Tout profond penseur craint plus d’être compris que d’être mal compris » (Par-delà le bien et le mal, § 290), pour s’apercevoir qu’elle suppose un travail à ce jour inachevé ou, plutôt, toujours à reprendre. En l’occurrence, il faut y insister, la lecture de Nietzsche n’est ni facile ni apaisante. Elle peut autant stimuler que déconcerter. On trouve dans ses pages de quoi enclencher l’enthousiasme ou provoquer la désapprobation. Cette œuvre recèle cependant de quoi nous tenir en éveil pour orienter la pensée, particulièrement sous le rapport de ce nihilisme qui caractérise notre époque et que Nietzsche avait parfaitement diagnostiqué.
Les courtes habitudes de Pierre Parlant
par Arno Bertina
A LA FAÇON D’UN FAUVE EN PROSE
L’œuvre de Pierre Parlant a pris un nouveau tour au début de l’été avec la parution des Courtes habitudes.
Jusque-là, cette œuvre semblait faite de deux ensembles : à côté de livres comme Modèle habitacle [3], Régime de Jacopo [4] et Pas de deux [5] (des textes « consacrés à » ou « nourris par » la peinture, ou le rapport à l’image), on trouvait quantité de livres courts qui, s’ils mettent encore en jeu le regard, portent aussi sur des faits de langue, cherchant une phrase (juste ou rapide) ou sur la nécessité pour le poème de se porter au point d’incandescence de visions débarrassées de leurs cadres a priori (Précis de nos marqueurs mobiles [6], Prenez le temps d’aller vite [7], etc.).
Sous-titré « Nietzsche à Nice », Les Courtes habitudes semblait inaugurer un troisième ensemble (où se retrouverait aussi Une cause dansée, un livre à paraitre sur Aby Warburg).
Mais à l’examen cette partition n’en est pas une et ces ensembles n’en font qu’un : chacun de ces livres se mesure à la peinture comme à ce médium qui naît du voir, ou donne à voir, éprouvant la perception (comme dans Le rapport signal-bruit [8]) ou lui jetant un défi. Dans chacun de ces livres de poésie, l’écriture se mesure à cette effraction du sujet par ce qu’il perçoit, y cherchant un tranchant qui est toujours à affûter. L’œuvre de Pierre Parlant en est donc venue presque naturellement à convoquer ses héros : Pontormo, Duccio, Warburg… Et Nietzsche donc, qu’on rapproche toujours de la musique (Wagner, Bizet) mais dont la correspondance (et singulièrement ici celles de ses lettres qui auront été écrites à Nice) élabore une météorologie de l’écriture. Si Montesquieu voyait dans les climats la possibilité d’expliquer l’adéquation entre un territoire et un régime politique, le Nietzsche de Pierre Parlant aiguise ses perceptions au soleil de la côte d’Azur, tissant un lien entre marches, déménagements, pensées et forme poétique.
Et ces lettres (« une affaire qui ne m’est pas adressée ») sont, dans le texte de Pierre Parlant, presque invisibles. Quelques guillemets, quelques italiques, mais assez peu en somme. Les deux expériences (un hôtel à Nice dans les deux cas) se confondent, en fait, superposées, entremêlées (« J’y vois la preuve de l’existence d’un narrateur unique ») quand Parlant ne va pas plus loin, poussé par l’exemple du philosophe allemand à « afficher sa condition d’auteur indépendant ». Cette valse, cette hésitation ne change rien à la polarité du livre, conditionné par « l’insistance fragile / d’une aventure ». « Il me semble que je vais habiter ici / à peu près de la même façon qu’il écrit / ne plus connaître son adresse” ».
Cette horreur du domicile est en fait une propédeutique : « (…) il dit changer de quartier, de chambre, d’étage, de régime, / histoire de demeurer sensible aux variations » ; « il vaut mieux le savoir, la victoire s’organise ». Ce que Pierre Parlant trouve dans les lettres de Nietzsche, et l’historique de ces emménagements, c’est « l’aventure d’une vie rendue par éclairs à elle-même », c’est l’histoire d’un homme cherchant par tous les moyens « le point parfait de maturation et de succulence ». Se penchant sur cette matière pour amorcer son propre texte, Pierre Parlant s’inscrit dans ce vaste mouvement qui a soulevé la littérature française ces quinze ou vingt dernières années : la prose romanesque ou le poème n’hésitent plus à s’abâtardir au contact de référents assumés, de figures pleines de panaches ou dérisoires. Autant d’icônes que le texte rend à leur mouvement originel au lieu d’inviter à se prosterner devant elles, patinées par le temps et les touchi-toucha de leurs thuriféraires – c’est en tout cas ce que fait Pierre Parlant avec l’auteur du Zarathoustra dans ce livre court, un Nietzsche qu’il sert et utilise tout à la fois, donc ; un Nietzsche dressé contre Heidegger qui disait des philosophes qu’ils n’ont pas de biographie (et on devine là un bien suspect désir de dissimulation) ; un Nietzsche attentif – comme Pontormo, dont le journal et la peinture ont fait l’objet d’un autre livre de Pierre Parlant – aux moindres variations de lumière, de qualité de l’air : « il cherche les signes pour rendre compte » « d’un excédent d’état d’âme, d’une rareté et d’une nouveauté qui outrepassent toute norme. » Percevoir ces signes, écrit Pierre Parlant, « et cesser de se nuire / sont une seule et même chose ».
Mais le poète français va devoir inventer une forme capable de supporter ces « signes » et ces « éclairs ». Ce qui revient à s’éloigner le plus possible de cette grande forme molle, pernicieuse, qu’est la biographie ; par fidélité à l’éclair, il faut éviter que l’individu (Nietzsche en l’occurrence) devienne l’argument d’une narration (biographique) car ce type de récit fait à son objet, traditionnellement, une carapace semblable à toutes les autres, où le temps d’une vie se trouve réduit à une série d’anecdotes canalisées voire étranglées par les liens logiques. Il faut désarticuler toutes les connections mesquines, il faut un poème, en somme, et les raccourcis foudroyants et obscurs (ou aveuglants) qu’il s’autorise.
Arno Bertina, Sitaudis, 5 décembre 2014.
Le Chemin de Nietzsche à Eze
Nietzsche effectuera cinq séjours à Nice qui alterneront avec l’Engadine et l’Italie. Lors de son premier séjour, du 2 décembre 1883 au 20 avril 1884, il loue une petite chambre meublée 38 rue Ségurane dans le quartier du port, s’installant ensuite villa Marroleni, quartier Saint-Philippe puis en centre ville à la Pension de Genève, rue Rossini. Il écrit à son ami Peter Gast, « 220 jours parfaitement sereins dans l’année ont fini de me décider : cette magnifique plénitude de lumière a sur moi, mortel "très supplicié", une action quasi miraculeuse. La partie "française" de Nice m’est insupportable… mais il y a une ville italienne — c’est là dans les quartiers anciens que j’ai loué — où l’on est comme dans une banlieue de Gêne. » C’est non loin de là, sur le chemin d’Eze, que Nietzsche pensera la troisième partie d’Ainsi parlait Zarathoustra.
A Nice, ainsi parlait Friedrich Nietzsche.
Avec Florence Albrecht, professeur de philosophie, Pierre Parlant, écrivain et Philippe Granarolo, professeur de philosophie.
Arte, 18 mars 2021.

Lettre à Overbeck du 5 janvier 1884 (?)
Le Docteur Paneth est venu avant-hier me rendre une nouvelle visite. Il m’a prié de le suivre à Villefranche pour passer quelques jours chez lui, et j’ai accepté son invitation. Hier matin, il m’a vanté le site d’Eze, et sa description a été si séduisante que j’ai pris ce matin même le train pour Eze.
Depuis le littoral un chemin escarpé s’élève jusqu’au nid d’aigle sur lequel sont perchées les maisons les plus élevées du village. Arrivé en gare d’Eze en milieu de matinée, j’ai aussitôt entrepris l’escalade, que mon ami m’avait présentée comme très pénible, craignant qu’une telle ascension soit incompatible avec la piètre santé dans laquelle il m’avait retrouvé. Il ignorait que pour moi marcher est tout sauf une activité épuisante. Depuis des années je marche entre quatre et six heures par jour, parfois davantage encore, ce qui est pour moi une absolue nécessité. Quitter à intervalles réguliers la position assise de l’intellectuel pour arpenter les chemins environnants fait partie de mon hygiène de vie : comment pourrais-je demeurer assis à ma table de travail pendant des heures sans être assailli par les plus terrifiantes migraines ? Mes promenades ne sont jamais celles d’un touriste, elles font partie intégrante de mon travail du jour. Au cours de mes marches, mon cerveau continue à poursuivre le travail commencé assis : qu’il s’agisse d’une réflexion sur un ouvrage dont je viens d’entamer la lecture, de l’élaboration d’un raisonnement, de la formulation d’une idée.
Mes plus belles idées ont toujours surgi inopinément au cours de mes marches solitaires, un peu comme si l’effort physique stimulait mon cerveau et lui donnait accès à des dimensions que je recherchais sans pouvoir les atteindre alors que j’étais assis à mon bureau. Mais ce que j’ai vécu hier en grimpant jusqu’au petit village d’Eze dépasse de très loin toutes mes expériences antérieures. Légèrement essoufflé pendant la première moitié de l’escalade, je m’arrêtai régulièrement et me retournai vers la mer qui scintillait en contrebas. Mais à mi-parcours j’ai retrouvé mon souffle et j’ai cessé de regarder en arrière. J’ai concentré mon attention sur le doux bruissement que faisait le vent en glissant à travers les branches des oliviers dont la plupart des terrains qui bordaient le chemin étaient plantés. Le chant des oiseaux se mêlait harmonieusement au bruit du vent, et cette symphonie a animé mon corps d’une vigueur exceptionnelle.
Depuis la mi-décembre mon cerveau était en quête de ce qui devrait être un passage essentiel de mon futur Zarathoustra : un moment consacré aux nouvelles valeurs que les plus libérés parmi les hommes devront pouvoir inventer et assimiler pour s’arracher à la stagnation, ou pire, à la régression qui menace notre espèce. Il me faudra, en ce chapitre du Zarathoustra, opposer les anciennes tables morales qui ont guidé l’humanité depuis des millénaires, aux tables nouvelles qui nous permettront de reprendre le chemin de notre évolution. Ces tables, j’en suis encore bouleversé, m’ont été entièrement soufflées par je ne sais quel démon entre la gare et le nid d’aigle du village d’Eze. Arrivé au sommet, j’étais en possession de la totalité du texte qui sera un moment décisif de mon Zarathoustra.
En rentrant à Villefranche, j’ai immédiatement couché sur le papier les phrases dont le destin m’avait fait l’inattendu cadeau. Je n’ai pu raconter dans le détail au Docteur Paneth ce qui m’était arrivé. Il m’aurait fallu pour cela le faire pénétrer dans les arcanes de mon Zarathoustra, et je n’en avais ni le désir, ni l’énergie. Même s’il en avait été autrement, aurait-il été capable de m’accompagner dans ces nouveaux territoires que les humains ne sont pas encore prêts à habiter ? Il m’a cependant été tout à fait possible de lui faire comprendre les relations entre mon corps et mon esprit que j’expérimente en marchant. Je lui ai expliqué que c’est quand l’inspiration créatrice coule le mieux en moi que mes muscles fonctionnent à merveille. C’est moins la qualité de mes réflexions qui dépend du mouvement de mes muscles (même s’il en bien ainsi), c’est plutôt ma performance physique qui se trouve facilitée par la richesse de mon travail intellectuel. Quand une idée nouvelle s’impose à moi, je suis transporté dans une sorte d’état second qui me fait oublier toute fatigue.
Ce que je n’ai pu avouer à mon ami, c’est que les pensées décisives qui ont envahi mon cerveau sur le chemin pentu conduisant au nid d’aigle d’Eze, ce « renversement des valeurs » que je situerai au cœur de mon Zarathoustra, ont trouvé une sorte de preuve de leur pertinence dans l’effet qu’elles ont eu sur mon corps. Cette « preuve par le corps » fut probablement envisagée par nos ancêtres grecs, puis fut perdue de vue par les « hommes théoriques » héritiers de Socrate. J’ai su la ressusciter sur le chemin d’Eze [9].

Dans Ecce Homo, écrit en décembre 1888, Nietzsche revient sur son expérience niçoise (folio essais 137, §4, p. 165) :
En été, retourné aux lieux sacrés où le premier éclair de la pensée de Zarathoustra avait brillé à mes yeux, je trouvai le second Zarathoustra. Dix jours suffirent : en aucun cas, ni pour le premier, ni pour le troisième et le dernier, il ne m’en a fallu davantage. L’hiver suivant, sous le ciel alcyonien de Nice, qui, alors, illuminait pour la première fois ma vie, je trouvai le troisième Zarathoustra, — et j’avais fini. A peine un an pour le tout. Bien des endroits cachés, bien des hauteurs des environs de Nice sont pour moi sanctifiés par d’inoubliables instants ; cette partie capitale intitulée « D’anciennes et de nouvelles tables » fut composée au cours de la très pénible montée de la gare au merveilleux nid d’aigle maure d’Eze, — l’agilité des muscles a toujours été chez moi d’autant plus vive que la force créatrice débordait avec plus d’impétuosité. C’est le corps qui connaît l’enthousiasme : laissons l’« âme » hors de tout cela... On aurait souvent pu me surprendre en train de danser ; à cette époque, je pouvais, sans trace de fatigue, marcher sept ou huit heures en montagne. Je dormais bien, je riais beaucoup —, j’étais plein de vigueur et d’une patience à toute épreuve.


Le sommet du chemin de Nietzsche. Sa Montagne Sainte Victoire.
ZOOM : cliquer sur l’image.


Vue du sommet du chemin de Nietzsche.
Photo A.G, 24 août 2020. ZOOM : cliquer sur l’image.


Vue du sommet du chemin de Nietzsche.
Photo A.G, 24 août 2020. ZOOM : cliquer sur l’image.


Vue du sommet du chemin de Nietzsche.
Photo A.G, 24 août 2020. ZOOM : cliquer sur l’image.


La baie de Villefrance-sur-mer et la presqu’île de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Photo A.G, 24 août 2020. ZOOM : cliquer sur l’image.

LIRE sur Pileface : le Chemin de Nietzsche à Eze

Friedrich Nietzsche
Collection VIA
Choix et traduction de
Florence Albrecht et Pierre Parlant
Préface de Pierre Parlant
240 pages
Paru en 2019
20 euros
éditions NOUS
Ce livre propose un choix de lettres de la correspondance de Nietzsche dans lesquelles il est question de l’Italie. Écrites de différentes villes italiennes entre 1876 et 1889, elles font apparaître le philosophe sous un angle inattendu : voyageur, marcheur (« Je suis au moins huit heures par jour sur les chemins : c’est à ce prix que je supporte la vie »), « médecin et patient en une seule personne », homme qui aime le Sud, qui cherche et trouve l’endroit où le travail est enfin porté par une force vitale débordante.
Ce n’est qu’en Italie — aimée pour son climat, sa lumière, ses villes — que Nietzsche trouvera les conditions d’une vie désirable, conforme à « ce que nous sommes et ce que nous voulons ». Soit : « du calme, de la grandeur, du soleil ». C’est cette « grande trinité de la joie » qui le guidera dans ses errances, à la recherche d’« une nouvelle nourriture, un nouveau soleil, un nouvel avenir ». De Sorrente à Venise, où il fera de nombreux séjours et dont il appréciera la sereine beauté, puis Gênes, où il se construira l’existence la plus clandestine, jusqu’à Turin, ultime séjour paradoxal et tragique, moment de sa plus grande créativité et lieu de son effondrement.
« En toutes choses, je trouve qu’ici la vie vaut la peine d’être vécue. »
Si le séjour de Nietzsche à Sils Maria, en Suisse, est notoire, y compris parmi ceux qui s’intéressent de façon distraite et épisodique à la philosophie, en revanche ses nombreux voyages et ses longues permanences au sud des Alpes ne sont connus que d’un public plus averti. Et pourtant, c’est justement à l’occasion de l’un de ces voyages, à Rome, que le philosophe rencontra son grand amour malheureux, Lou Salomé, et c’est au cours de son séjour à Turin qu’il écrivit ses dernières grandes œuvres.
La transcription des lettres du philosophe allemand est précédée par une longue préface de Pierre Parlant, qui permet au lecteur d’apprécier les missives de Nietzsche à leur juste valeur. Ces lettres, en tant que telles, sont un matériel brut. Elles ne peuvent pas êtres lues comme un texte organique, cohérent, car, tout en couvrant une longue période, de 1872 à 1888, elles présentent des sauts temporels et des périodes plutôt étendues de silence. Sans compter que nous n’avons que les lettres écrites par Nietzsche, donc un seul versant du dialogue avec ses correspondants.
Cette deuxième partie du livre acquière donc toute sa valeur après la lectures du texte de Pierre Parlant qui crée une sorte de « tissu conjonctif » essentiel. Les différentes lettres du philosophe allemand deviennent ainsi intelligibles. Nietzsche se réfugia en Italie à la recherche d’un peu de répit, d’un lieu où apaiser ses maux de têtes et ses troubles digestifs. Le Sud pour lui, c’est « la trilogie de la joie (...) du calme, de la grandeur, du soleil ». A chaque nouvelle étape ses lettres expriment son illusion d’avoir trouvé le lieu idéal. Cette âme agitée ne sut se poser nulle part de façon définitive. Par ailleurs, grand marcheur (« j’ai besoin de mes 6-8 heures de marche en pleine nature »), il a fait de son nomadisme une règle de vie.
Les dernières lettres coïncident avec la dernière période de la vie du grand philosophe. A Turin, ville qui lui convenait particulièrement (« en toute chose, je trouve qu’ici la vie vaut la peine d’être vécue ») il écrivit Le Cas Wagner, Crépuscule des Idoles, L’antéchrist, Ecce Homo, Nietzsche contre Wagner… et ce fut à Turin début 1889 qu’il sombra dans la folie.
C’est aussi à Turin que Nietzsche a promulgué sa Loi contre le christianisme.
NIETZSCHE À TURIN
La ville d’élection n’est pas Gênes, ni même Venise [10], mais Turin. La lettre qui témoigne le mieux de l’enthousiasme de Nietzsche pour cette ville est celle qu’il envoya à son ami Heinrich Köselitz (Peter Gast) en avril 1888.

Turin. Nietzsche vécut au 6 rue Carlo Alberto (au 3ème étage).
ZOOM : cliquer sur l’image.

à Heinrich Köselitz à Venise
Turin, vendredi 20 avril 1888
Lettres, comme jusqu’à présent, ferma in posta
Cher ami,
Comme tout cela est étrange ! Que l’étoile puisse encore se lever au-dessus de Berlin ! Que l’espoir puisse de nouveau battre un peu des ailes ! — En vérité, la diversion que vous avez connue ces derniers temps, et dont vous parlez, appartient aux choses les plus invraisemblables et inattendues qui soient possibles sur cette Terre. On croit de nouveau au miracle : un grand progrès dans l’art de vivre ! ... Que vous ayez rencontré sur votre chemin quelque chose de gai et de coloré, cela me rend tout heureux, cher ami : car c’est précisément cela qui devait vous arriver — mais nous autres, quels ânes sinistres nous sommes tous, et quels oiseaux de malheur ! ... Pour une fois, on avait affaire à la philosophie de Krause et non à celle de Nietzsche ! ...
À ce propos, il doit vraiment y avoir quelque chose de cette sorte, si l’on en croit un journal danois que j’ai reçu récemment. Il annonce qu’à l’Université de Copenhague se tiendra un cycle de conférences publiques « om den tüzke Filosof Friedrich Nietzsche ». De qui est l’annonce ? Devinez ! ... Comme on est redevable à ces messieurs les Juifs ! — Songez donc à mes amis de Leipzig, à l’Université : et à combien de milles ils sont de me lire ! —
Turin, cher ami, est une découverte capitale. J’en dis quelques mots avec l’arrière-pensée que vous pourriez vous aussi, éventuellement, en tirer profit. Je suis de bonne humeur, au travail de bon matin jusqu’au soir — un petit pamphlet sur la musique occupe mes doigts je digère comme un demi-dieu, je dors, malgré les voitures qui passent la nuit en cliquetant : tout cela est le signe d’une adaptation éminente de Nietzsche à Turin. C’est l’air qui fait cela : sec, stimulant, agréable ; nous eûmes des journées où l’air avait la marque éclatante de l’Engadine. Quand je pense à mes printemps ailleurs, p. ex. dans votre incomparable coquillage magique, comme le contraste est grand : le premier endroit dans lequel je sois possible ! ... Et avec cela, tout est accueillant, les gens sont sympathiques et pleins de vaillance. On vit à bon marché : 25 F service compris la chambre dans le centre historique de la ville, face au grandiose falazzo Carignano de 1780 : à cinq pas des grands portici et de la Piazza Castello, de la poste, du Teatro Carignano ! — Dans ce dernier, depuis que je suis arrivé, Carmen : naturellement !!! successo piramidale, tutto Torino carmenizzato ! Le même chef d’orchestre qu’à Nice. Sinon, Lala Roekh de Félicien David, maître de Bizet. Un jeune compositeur dirige une opérette, dont il a lui même écrit le texte, Monsieur Miller junior. Dans l’annuaire des adresses, on trouve 21 compositeurs, 12 théâtres, une accademia philarmonica, un lyceum de musique et un nombre énorme de professeurs de tous les instruments. Moralité : presque un lieu fait pour la musique ! — Les vastes et hauts portici sont une fierté : ils s’étendent sur 20 020 mètres, c’est-à-dire deux bonnes heures de marche. De grandes librairies trilingues. Je n’ai encore rien rencontré de semblable. La firme Loscher, très attentionnée à mon égard. Leur chef actuel, M. Clausen, m’instruit en beaucoup de choses (— je réfléchis en secret à la possibilité d’un hiver ici-même). Une excellente trattoria, où l’on traite le professeur allemand avec une civilité extrême : je paie pour chaque repas, pourboire compris, r F 25 c (minestra ou risotto, un bon morceau de rôti, légumes et pain — le tout, savoureux !) L’eau, excellente ; le café, dans les premiers Cafés 20 c le petit pot ; la glace, sommet de la culture, 30 c. Tout cela vous donne une idée. —
Aujourd’hui, le ciel est couvert et pluvieux. Mais il ne me paraît pas que je sois chagrin. On me dit qu’en été, il n’y a que 4 heures par jour de vraie chaleur. Le matin et le soir, ça se rafraîchit. Depuis le centre de ville, on voit directement dans un monde enneigé : il semble qu’il n’y ait rien entre lui et nous, que les rues donnent directement sur les Alpes. L’automne doit être la plus belle période. Enfin, il doit y avoir dans l’air, ici, un élément qui donne de l’énergie : quand on est chez soi ici, on devient roi d’Italie...
Tant et tant, mon cher vieil ami ! Je vous salue de tout mon cœur.
Votre N.
Voici ma morale : vous avez besoin d’un lieu où vous pourriez vivre toute l’année, mais sous d’autres influences météorologiques qu’à Venise, peut-être aussi plus proche de la musique, de ce qui peut être joué... Et nous devrions nous fixer sur l’Italie !!!!!!
Parlez-moi encore un peu de votre quatuor. À quoi il aboutit.
(Lettres d’Italie, p. 170-172)

C’est à Turin que Nietzsche rédige ses dernières grandes oeuvres. C’est aussi à Turin qu’il basculera dans la « folie ». La légende veut que ce soit après avoir vu un cheval battu par son maître. Sur cet épisode, Pierre Parlant apporte des éclaircissements de manière inédite. C’est la conclusion de son excellente préface.
voilà jusqu’où doit aller la philosophie
Oui, l’arrière-saison à Turin fut heureuse, la correspondance en atteste. Comparée à Venise, à Rome ou même à Gênes, cette ville accorda comme jamais à Nietzsche les conditions les plus favorables pour vivre et poursuivre son aventure. Le climat était idéal, le logement agréable, la nourriture adaptée à son envie comme à sa diététique, la noblesse de la ville exprimée dans la beauté de l’architecture et l’urbanité des habitants. Et si la réception de sa pensée rencontrait des résistances, notamment en Allemagne [11], « ce plat pays de l’Europe », Nietzsche n’en prenait pas forcément ombrage. Mieux, quelquefois il s’en amusait : « Il faut que je l’avoue, je suis encore plus content de ceux qui ne me lisent pas, de ceux qui n’ont jamais entendu ni mon nom ni le mot de philosophie ; où que j’aille, ici à Turin, par exemple, tout visage s’épanouit et s’adoucit à ma vue. Ce qui m’a le plus flatté jusqu’ici, c’est que toutes les marchandes n’ont de cesse qu’elles ne m’aient choisi les plus mûrs de leurs raisins. Voilà jusqu’où doit aller la philosophie [12]... »
Reste que Turin est aussi le nom qui signe la fin de la vie consciente de Nietzsche. Apparemment, tout se joue en un rien de temps. Le 3 janvier 1889, sur la place Carlo Alberto, ayant vu un homme rouer de coups son cheval, Nietzsche en sanglots se précipite pour enlacer l’animal avant de s’effondrer sur le pavé. Des passants s’attroupent. Intrigué, Davide Fino, l’homme qui lui loue sa chambre, reconnaît Nietzsche. Il l’aide à se relever et le conduit dans une auberge où ce dernier reste un moment prostré et silencieux, étendu sur un sofa. Puis il s’endort. Un peu plus tard, à son réveil, Nietzsche déclare être le Christ ou Dionysos. Il est devenu l’autre de lui-même. La scène est saisissante. Largement reprise et colportée, elle a fait l’objet de commentaires nombreux et inspiré certains artistes [13]. On est cependant en droit de se demander si l’épisode du cheval a effectivement eu lieu ou s’il ne relève pas, comme on l’estime désormais, de la légende. Une chose est sûre cependant, ce jour froid de janvier est celui du basculement soudain d’un « esprit libre » dans ce qu’on aura nommé, souvent hâtivement, la « folie ».
S’agissant des circonstances et des protagonistes de l’épisode turinois, une des lettres écrites au cours de cette période mérite qu’on s’y arrête. Moins d’un an avant ce 3 janvier 1889, donnant de ses nouvelles à son ami Reinhart von Seydlitz, Nietzsche décrit en effet d’une manière inattendue en quelques phrases un étrange spectacle. Qu’on se figure, suggère-t-il en citant Diderot, quelque chose comme « un tableau d’une "moralité larmoyante" ». Un tableau qu’il a « imaginé » la veille, précise-t-il aussi. Dans une ambiance hivernale, apparaît « un vieux charretier qui, avec le cynisme le plus brutal, plus dur encore que l’hiver alentour, refuse son eau à son propre cheval. Le cheval, pauvre créature éreintée, regarde autour de lui, reconnaissant, très reconnaissant [14] ». Image glaçante, crépusculaire, digne d’un roman de Dostoïevski. La vie, en ce qu’elle a de plus sensible et vulnérable, n’a d’autre choix, lorsque survient et se déchaîne une brutalité absolue, que celui de supporter et d’accepter. À ceci près que la reconnaissance que manifeste ici l’animal indique, au contraire de l’acceptation passive, un acquiescement, un oui inconditionnel au « monde tel qu’il est, sans rien en ôter, en excepter, en sélectionner [15] » ; attitude conforme à « l’amor fati [16] » dont Nietzsche avait fait sa maxime de vie. Sans prétendre à une quelconque interprétation, comment ne pas être frappé autant qu’ému par la similitude troublante entre ce tableau, « imaginé » par Nietzsche, proche de l’auto-prophétie, et le prétendu « épisode de Turin » ?
Nietzsche, on l’a dit, fut heureux dans la capitale piémontaise. Il y connut cette « grande trinité de la joie » si désirée et un plaisir de vivre dont il avait perçu qu’il ne saurait être éprouvé sans envelopper quelque douleur [17]. C’est pourtant à Turin, à deux pas de chez lui, qu’advint ce qui devait sceller l’existence d’un homme sûr depuis toujours qu’il était un « destin [18] ». Les jours qui suivent ce 3 janvier 1889, Nietzsche fait montre d’une agitation extrême. La nuit, il se barricade dans sa chambre. Surexcité, il réveille les autres locataires de la pension. Il chante, improvise au piano, se lance dans de longs monologues à tue tête. Entre le 3 et le 7 janvier, il écrit plusieurs lettres — les « billets de la folie ». Certains sont adressés au roi d’Italie, d’autres au Pape ou à des amis. Les mots « Dionysos » ou « Le Crucifié » servent de paraphes. En quelques jours, le délire emporte tout son être. Overbeck, que Burkhardt a alerté, arrive à Turin. D’abord désemparé, avec l’aide d’un certain Miescher, dentiste allemand qui habite là, il organise le rapatriement de Nietzsche à Bâle où ce dernier va être admis dans une clinique psychiatrique avant de séjourner dans un autre établissement spécialisé, à Iena. Apaisé, il sombre peu à peu dans un profond silence, entrecoupé de quelques mots. Jusqu’à sa mort en 1897, sa mère s’occupe de lui à Naumbourg. Puis c’est sa sœur qui le prend en charge à Weimar. Le 25 août 1900, à l’âge de 55 ans, Nietzsche s’y éteint.
Une heure s’écoula, peut-être deux,
Ou bien même une année ? — Alors sombrèrent
Soudain mes sens et mes pensées
Dans une éternelle indifférence,
Et un abîme sans borne
S’ouvrit : — c’était fini.
Vint le matin : sur de noires profondeurs
Se tient une barque qui repose et repose...
Que s’est-il passé ? Ainsi on criait, ainsi crièrent
Bientôt des centaines de voix : Qu’y a-t-il ? du sang ?
Rien ne s’était passé ! Nous dormions, dormions
Tous — Ah ! si bien, si bien [19] !
(p. 45-48)

Note de lecture de Nathalie Riera
Nietzsche, Lettres d’Italie, paru aux éditions Nous, nous livre un choix de plus de 100 lettres écrites par Nietzsche durant ses différents séjours dans le sud de l’Europe, principalement en Italie, de 1872 à 1888. La traduction de ces correspondances est assurée par Florence Albrecht et Pierre Parlant.
Mener une vie de « Fugitivus errans » – terme employé par Nietzsche dans une lettre à Paul Rée, fin juillet 1879 – répond avant tout du souci d’être rentable à soi-même. Volonté assurément guidée par son état de santé fluctuant mais aussi par l’impératif de s’assurer la tranquillité d’esprit : « vivre des aventures durant quelques années, pour donner à mes pensées du temps, du silence et un terreau frais ».
Le philosophe a quitté l’université de Bâle pour une vie de solitude et de voyage, se contentant de vivre dans de modestes pensions et hôtels, avec l’Italie comme nouveau territoire. Chiavenna, Gênes, Sorrente, Lugano, Venise, Recoaro, Messine, Rapallo, Rome, Florence, Ruta en Ligurie, Cannobio et Turin : autant « de nouveaux territoires, c’est-à-dire de nouvelles hypothèses de vie » (Pierre Parlant). Une vie en ermitage pour se procurer une santé, mais aussi pour éviter d’éveiller en soi « le mauvais génie de l’impatience ». Un tel choix n’est cependant jamais signe d’immobilisme chez Nietzsche. Marcher de longues heures comme à Sorrente, sur les « chemins tranquilles dans la pénombre » ou comme à Venise, là où « rien que des ruelles ombragées »… « Je vais ! Oui, je marche beaucoup ! Et je grimpe aussi ! »… « – j’ai besoin de mes 6-8 heures de marche en pleine nature ».
Toujours l’importance du chemin chez Nietzsche, le chemin vers la santé. S’il doit supporter des migraines intempestives et des troubles de la vue, ce sera « sans pour autant perdre nécessairement le goût de vivre ». Endurer mais non sans le dessein de « ramener à l’équilibre mon bateau de vie »… « c’est un tour de force et non des moindres : vivre et ne pas s’aigrir ».
Des séjours entrecoupés à Gênes, la grande ville marine va offrir à Nietzsche une proximité avec lui-même. Heureux enthousiasme aussi à l’idée de « continuer de vivre sous la protection de mes saints patrons du lieu, Colomb, Paganini et Mazzini ». L’étendue ouverte devant lui et sa chambre « très claire, très haute », tout est réuni pour avoir bon effet sur son humeur, mais la cité génoise ne sera pas promesse à recouvrer meilleure santé. Il ne suffit pas d’un ciel lumineux pour influer sur elle et sur son humeur. Il lui faut alors poursuivre son errance sur le littoral italien, la Suisse, et la Côte d’Azur. À Messine, le 8 avril 1882 : « je suis arrivé à mon “bout du monde” où, selon Homère, le bonheur doit habiter »… « Rome n’est pas un endroit pour moi »… La Spezia, le 13 octobre 1883 : « je ne sais toujours pas où demeurer ». La ville de Florence ne lui convient pas davantage, « elle est bruyante, pavée de manière inégale et les routes sont pleines de dangers pour moi ». À partir de 1881 jusqu’en 1888, tous ses étés se passeront à Sils-Maria, en Haute-Engadine.
Si Gênes, ville toute « débordante de force vitale » est ce qui lui est arrivé de mieux, sa reconnaissance pour la ville de Turin sera sans précédent. Ville qui lui sera « infiniment sympathique (…) Un paradis pour les pieds, pour mes yeux aussi ! »… « Turin ? C’est une ville selon mon cœur ». Son séjour dans la capitale du Piémont se passera sans accrocs, la ville produit sur lui « l’effet d’un flux de vie certain »… rien d’oppressant mais plutôt « un grand luxe d’espace partout » et où même les vents du nord ne sauraient le déchanter. L’enjouement et l’engouement au rendez-vous, Turin comptera parmi sa troisième résidence après Sils-Maria et Nice.
On sait aussi de son séjour turinois son incroyable productivité : Le cas Wagner, Crépuscule des idoles, L’Antéchrist, Ecce Homo et Nietzsche contre Wagner. 1888 sera l’année la plus féconde, dans une chambre via Carlo Alberto, n°6, piano quarto, avec pour vis-à-vis le sublime Palazzo Carignano : « Tout avance continûment dans un tempo fortissimo de travail et de bonne humeur »… À son ami Henrich Köselitz (de son surnom Peter Gast ou Pietro Gasti), le vendredi 20 avril 1888 : « Turin, cher ami, est une découverte capitale (…) Dans l’annuaire des adresses, on trouve 21 compositeurs, 12 théâtres, une accademia philarmonica, un lycéum de musique et un nombre énorme de professeurs de tous les instruments. Moralité : presque un lieu fait pour la musique ! -– Les vastes et hauts portici sont une fierté : ils s’étendent sur 20 020 mètres, c’est-à-dire deux bonnes heures de marche. De grandes librairies trilingues. Je n’ai encore rien rencontré de semblable. »
Parmi ses correspondants les plus importants, nous retiendrons le compositeur Henrich Köselitz et le théologien Franz Overbeck. Plusieurs lettres également à sa mère Franziska et sa sœur Elisabeth qu’il n’épargnera pas dans un célèbre passage d’Ecce Homo : « Quand je cherche mon plus exact opposé, l’incommensurable bassesse des instincts, je trouve ma mère et ma sœur, – me croire une parenté avec cette canaille serait blasphémer ma nature divine ».
La traîtrise familiale sera sans précédent. L’œuvre même de Nietzsche déformée par la sœur qui, mariée avec Bernhard Föster, un « idéologue pangermaniste et antisémite », profitera de son internement pour monter les Archives Nietzsche et sous sa seule autorité donner naissance à la première grande édition des œuvres de son frère. Il s’ensuivra, comme on le sait, une récupération par les nazis dont il faudra attendre en France le travail de réhabilitation de l’œuvre mené par Georges Bataille : montrer que Nietzsche n’avait que profond dégoût pour ces « maudits groins d’antisémites ». « Les gens comme ma sœur sont nécessairement les ennemis irréductibles de ma pensée et de ma philosophie ».
En parallèle à ces lettres et avant d’apporter une conclusion à cette note, j’aimerais citer Clément Rosset qui dans La force majeure regrettait que les « préoccupations » des commentateurs de Nietzsche soient « complètement étrangères à ce qui intéresse Nietzsche ». Il leur reprochera en effet d’effacer l’originalité et la portée de la pensée nietzschéenne « en assimilant ce que pense Nietzsche à ce qui les préoccupe eux-mêmes »…
« Cette manière moderne d’ignorer Nietzsche par le biais d’un commentaire enthousiaste soit du fait que Nietzsche ne pense pas, soit du fait qu’il pense dans le sillage d’une modernité post-hégélienne, équivaut évidemment à une fin de non-recevoir (…) Il y aurait sans doute à s’interroger sur les causes d’une telle fin de non-recevoir, qui persiste près d’un siècle après la mort de Nietzsche. La raison fondamentale de ce rejet me paraît résider en ceci que tout discours totalement affirmateur, comme l’est celui de Nietzsche ou comme le sont ceux de Lucrèce et de Spinoza, est et a toujours été reçu comme totalement inadmissible. Inadmissible non seulement aux yeux du plus grand nombre, comme l’insinuait Bataille dans son livre sur Nietzsche, mais aussi, et je dirais plus particulièrement, aux yeux du petit nombre de ceux qu’on appelle les "intellectuels" » [20].
Nathalie Riera, Les Carnets d’Eucharis, avril 2020.
[1] Cf. L’athéisme sexuel.
[2] Cf. Par-delà le bien et le mal, fragment 245.
[3] Modèle habitacle, éditions Le Bleu du Ciel, 2003.
[4] Régime de Jacopo, éditions Contre-Pied, 2009. Mais ces 40 pages publiées sont en fait un extrait d’un ensemble nettement plus important (encore à paraitre) Ma durée Pontormo.
[5] Pas de deux, éditions MF, 2005.
[6] Précis de nos marqueurs mobiles, éditions de l’Attente, 2006.
[7] Prenez le temps d’aller vite, éditions de l’Attente / Contre-Pied, 2004.
[8] Le rapport signal-bruit, éditions Le Bleu du Ciel, 2006.
[9] Source : Philippe Granarolo, iPhilo « Nietzsche, philosophe de la Méditerranée ».
[10] Sur Nietzsche à Venise, cf : Chroniques vénitiennes.
[11] Lettre à Franziska Nietzsche, Venise, le 10 octobre 1887.
[12] Ecce homo, « Pourquoi j’écris de si bons livres », II.
[13] On songe en particulier au très bon film de Béla Tarr, Le cheval de Turin (Ours d’argent au Festival de Berlin 2011).
[14] Lettre à Reinhart von Seydlistz, Turin, le 13 mai 1888.
[15] Fragments posthumes, XIV, 16, [32].
[16] Formule héritée du stoïcisme romain qui signifie littéralement l’« amour du destin » et s’oppose à toute forme de fuite ou de volonté de nier la réalité. L’amor fati est pour Nietzsche le trait majeur de la grandeur et de la probité d’un homme en tant qu’il se montre capable de « ne pas se contenter de supporter l’inéluctable, et encore moins de le dissimuler — tout idéalisme est une manière de se mentir devant l’inéluctable — mais l’aimer » (Ecce homo, op. cit.
« Pourquoi je suis si avisé », § 10).
[17] Fragments posthumes, XI, 35 [15].
[18] Lettre à Georg Brandes, Turin, le 20 octobre 1888.
[19] Le Gai Savoir, Appendice. « Chansons du prince hors-la loi », « La barque mystérieuse ».
[20] Clément Rosset, La force majeure, Les Éditions de Minuit, 1983 in « Notes sur Nietzsche », pp. 33/34.




 Nietzsche à Nice et à Turin
Nietzsche à Nice et à Turin
 Version imprimable
Version imprimable


 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?



1 Messages
Une Cause dansée : Warburg à Oraibi
Paru en 2021
« écrire ce qui est arrivé est sans doute la meilleure façon de se persuader qu’il peut toujours arriver quelque chose »
Empreinte de fantôme
Si l’auteur est une fiction produite par l’écriture, le lecteur s’en forge une figure dont il peut se rapprocher. Mieux, la trace de réel que l’écriture retient, pour qu’on la comprenne pleinement, appelle une telle proximité, et plus encore une reprise, un prolongement, une ekphrasis. Pierre Parlant, ainsi, a commencé par refaire, ainsi qu’il l’a accompli avec Nietzsche puis Pontormo, le voyage qui a mené Aby Warburg en territoire Hopi en 1896. Mais de même que l’historien de l’art a mis vingt-sept ans à en rendre compte en partie, dans une conférence elle-même décalée — elle est de seconde main en ce qui concerne la danse du serpent, mais surtout l’environnement insolite de la clinique de Binswanger a contribué à la disparition du « babil de soutenance » (p. 73) —, le poète a pris, lui aussi, son temps, « en retard sur ce qui est » (p. 75). De fait, « on ne prend pas de vitesse l’expérience vitale, fût-ce en zigzag ; on l’éprouve, vois-tu » (p. 76). Ce qui en 2010 constituait le voyage de celui que Parlant nomme son « narrateur » est devenu l’œuvre poétique parue en février 2021 chez Nous, sous le titre Une Cause dansée : Warburg à Oraibi, sous l’égide du « souvenir par procuration » freudien.
Afin de conjoindre ces éléments anachroniques, une organisation se dessine, ponctuée par des photographies en pleine double page. Des quatre moments se dégage une deuxième section restituant la danse avec le serpent, en poèmes de trois tercets chacun — un peu ce que tentait Ponge dans un moment de son Carnet du bois de pins, cherchant à relancer l’opération poétique en s’imposant une forme versifiée. Ici Parlant approche le rituel comme ce dernier convoque les éclairs. Chacun des autres moments tourne autour de mots (de passe) et de questions également cruciales, qui résonneront aussi ailleurs. La première partie s’organise ainsi d’abord autour du parcours vers le « pueblo » et la « mesa », en voiture de location, véhicule qui donne son rythme à la traversée du paysage coloré, démesuré, presque immobile : une telle toile est indispensable, dans la mesure où le pare-brise est une page à venir, un écran rafraîchi d’ordinateur – cependant que l’historien médite en parallèle sa conférence et reprend la mémoire de son périple. L’attente, la lenteur sont ainsi traversées d’événements qui surgissent, tandis qu’insiste le fil ténu des « maïs, pêches, piments ». La troisième partie, elle, parcourt librement les Ricordi de Warburg (tel est le titre qu’il donna à son activité diariste) en les augmentant d’un poème combinatoire en langue hopi. La quatrième s’appuie sur la collection photographique pour en décrire certains instants décisifs, prend des notes dans l’autre biographie, et finit explicitement par confondre « souvenir et avenir ». Un bilan, enfin, s’évertue à remettre un certain ordre, numérique, dans les points abordés.
Il s’agit donc de rattraper Warburg, sans ignorer que la coïncidence sera forcément compliquée, pour l’ambigu « suiveur que je suis pas à pas » (p. 87) : le revenant tourne le dos, puis surgit de manière impromptue, pour donner son avis, converser, ou regarder le narrateur via une photographie. Parlant essaie surtout les possibilités du regard de biais, « d’une certaine manière, c’est-à-dire de travers » (p. 62). Être « amblyope » devient une méthode poétique : l’imbrication imparfaite des deux époques provoque le tremblé souhaité. Dans ces conditions, les études sur Warburg ainsi que sa vie psychique (cf. Philippe-Alain Michaud aux éditions Macula ; Georges Didi-Huberman ; La Guérison infinie chez Rivages) n’occupent jamais le centre de l’attention, puisqu’il faut préférer « un savoir qu’aucun livre […] ne pourra ressaisir comme là-bas » (p. 89). Ce sont donc plutôt des clins d’œil — par exemple, les crises de colère d’Aby, désormais adressées (p. 159) au narrateur. En passant la main, et le témoin, à celui qui la traverse de nouveau, par sa « reprise, pas la répétition », la vie de l’autre est rendue à la fois à sa discontinuité, à son intuition, aux éclats de la pensée en train de gambader ; voilà aussi une manière de s’approprier une part de son style, ce qu’invente de facto l’écriture qui se fie au hasard.
Il est d’ailleurs tentant de donner à chaque poème le statut d’une des quarante-huit diapositives sélectionnées par l’orateur, ou des reproductions de l’atlas Mnémosyne futur. Car il s’agit bien de se conformer à « l’infinie souplesse de cette pensée » (p. 132) qui influe aussi sur le parcours et les annotations qui le ponctuent. La « vision différée » (p. 83) du récit après-coup constitue ce que Warburg confiera à l’association des images afin d’en soulever la « survivance ». Quelque chose en effet arrive quand on renonce aux liens controuvés, aux logiques éprouvées, aux causalités : le poème liminaire de la troisième section (p. 127) évoque ainsi la pratique warburgienne des « tremblements d’espace » et des « fronces de temps », et invite le phrasé du poème à provoquer des rapports a priori incongrus, mais animés par un « trait d’affection » (p. 86). Enfin, l’aveu de la page 77 de recourir à un « placebo » pour écrire, à partir d’un détail (chiens de prairie, maïs, colibri, rhubarbe, cinémascope, orage… : bref, l’Ouest étatsunien – au même titre que le buggy d’autrefois), fait de tous ces faits vrais les étais d’un propos qui n’est ni en souffrance, ni déceptif, dans la mesure où seule la contiguïté des éléments du réel lui confère du sens.
En somme, « on ne va nulle part, autrement dit on danse » (p. 62) : à l’instar de la danse du serpent qui pour Warburg saisit des causalités inaccessibles, le livre de poèmes orchestre une chorégraphie, pour faire se toucher plusieurs événements, merveilleux ou infra-ordinaires, dans une phrase accidentée — « je chéris-dégrade sans le vouloir les phrases qui me viennent », p. 77 —, mais si accueillante qu’elle sinue parmi tous les signes que le réel affolé lui envoie.
sitaudis.fr