
Pour manifester leur sympathie à l’égard de la Révolution soviétique,
des ouvriers parisiens manifestèrent, le 01/05/1919, avec des couteaux entre leurs dents.
© Selva/Leemage - AFP. Zoom : cliquez l’image.

1917-2017 : 100 ans que la révolution d’Octobre a eu lieu. Avant de devenir le spectre de l’un des totalitarismes les plus sanglants du XXe siècle (Staline fut, comme on le sait, le précurseur d’Hitler, et non le contraire), cette révolution a fait rêver les uns et cauchemarder les autres (photo). Elle fut sans doute l’un des ferments les plus sûrs de ce que Jean-Claude Milner appelle, dans Relire la révolution, la « croyance révolutionnaire ». Nul doute que les commémorations de la révolution bolchevique ne vont pas manquer, avec quelques discrets nostalgiques et, bien plus nombreux, ses bruyants contempteurs. Les commémorations sont l’un des moyens les plus efficaces que la société du spectacle (y compris, bien sûr, dans la Russie de Poutine ! [1]) a trouvé pour oublier de penser l’Histoire, son mouvement, ses contradictions. Heureusement, la radio peut aussi nous inviter à comprendre comment l’Histoire se fabrique et nous faire entendre, par exemple, la révolution russe par ceux qui l’ont vécue [2].
La révolution russe, la première, a, sinon produit, du moins promu à une échelle sans précédent, pendant une dizaine d’années, au milieu de mille difficultés, une notion, celle d’« avant-garde », d’« avant-garde révolutionnaire » et d’« avant-garde artistique », notion qui marquera le siècle, des surréalistes au « groupe Tel Quel » et au « groupe Dziga Vertov » (Godard), pour ne parler que de la France. Au début des années 70, Marcelin Pleynet s’est intéressé à cette « exacerbation des avant-gardes » et, plus particulièrement, aux avant-gardes cinématographiques dont deux noms sont les plus représentatifs : Eisenstein et Vertov. Ce cinéma — et les théories qu’il reflétait (sur le montage notamment) — en vaut bien d’autres et je regarde toujours L’homme à la caméra de Dziga Vertov (1929) — et même, en noir et blanc, certains KinoPravda — avec le même intérêt.
Voici le dossier que je consacrais aux uns et aux autres il y a quelques années.
A.G., 21 février 2017.

Première mise en ligne le 25 avril 2013.
« L’un des procédés de Mi-En-Leh consistait à dénicher la contradiction dans les choses qui présentaient l’apparence de l’unité. »
« Afin que le public ne soit surtout pas invité à se jeter dans la fable comme dans un fleuve pour se laisser porter ici ou là au gré du courant, il faut que les événements s’enchaînent de manière à ce que les chaînons restent bien visibles. »
Bertold Brecht, Me-ti, livre des retournements (L’Arche, 1968).
Privas, 11 Janvier 2013 . Après la projection du film Vita Nova, discussion à bâtons rompus avec Marcelin Pleynet et David Grimberg, l’opérateur du film, surnommé « Dziga Vertov » par l’équipe de tournage, à qui j’apprends que c’était le pseudonyme que s’était donné Denis Kaufmann (dziga vertov voulant dire en ukrainien « toupie qui tourne »). Nous évoquons L’homme à la caméra ; je raconte mon émotion quand, le 23 décembre 1970, j’ai pu voir le film à la Cinémathèque de Lausanne, grâce à Freddy Buache, dans une version non tronquée [3]. Puis nous évoquons Godard et le groupe Dziga Vertov que Godard créa avec Jean-Pierre Gorin après mai 68... La discussion dévie sur le génie contradictoire d’Eisenstein... Je constate une fois de plus la parfaite connaissance, toujours fraîche, qu’a Pleynet des « avant-gardes soviétiques », notamment cinématographiques.
Ce n’est pas un hasard. Sur le retour, je me remémore plusieurs textes que Pleynet a écrit sur le cinéma au début des années 70. Le premier sur la caméra comme « appareil de base » dans ses rapports à la perspective monoculaire dans le premier numéro de Cinéthique, le second dans un entretien du numéro 3 dont j’ai déjà publié des extraits (titre : « économique, idéologique, formel », 1969), le troisième sur la place d’Eisenstein dans la culture soviétique et en France, « Le front gauche de l’art » (Cinéthique 5), le quatrième enfin, dans les Cahiers du cinéma de janvier-février 1971 « Sur les avant-gardes révolutionnaires ». Numéro des Cahiers qui portait, lui aussi, sur Eisenstein — et faisait suite à un autre numéro sur la « Russie, années vingt » [4] — dans lequel Pleynet analysait longuement les contradictions spécifiques propres aux avant-gardes de l’époque.
Quoi ? En plus d’être poète et romancier, en plus de ses écrits sur l’art et la littérature, Pleynet a écrit aussi sur le cinéma ? Eh oui. Vous n’êtes pas au bout de vos surprises.
L’entretien de Pleynet avec Jean Narboni et Pascal Bonitzer a été « relu et récrit par Marcelin Pleynet », est-il précisé. C’est dire qu’il ne s’agit pas d’un interview improvisé comme on en lit tant de nos jours (« sous la forme de l’intervention anecdotique »). De quoi est-il question ? Des avant-gardes. Non pas d’une « apologie » des avant-gardes (pas plus d’un dénigrement), mais, vous le verrez, d’une interrogation et d’une mise en perspective complexes, dialectiques, de ce qui s’est joué ou pensé sous cette enseigne, en Russie, puis en URSS, depuis le début du XXe siècle à travers les différentes pratiques artistiques dans leur rapport étroit — leur impensé aussi — à la pratique politique révolutionnaire (une certaine conception de la politique donc, et une certaine conception de la révolution). Ici, une citation de l’entretien doit permettre d’éviter tout malentendu. Pleynet :
Comme l’écrit Lautréamont : « les phénomènes passent je cherche les lois », or nous sommes toujours en état de nous laisser prendre aux phénomènes, de devenir les représentants de la loi, d’où le constant aplatissement les uns sur les autres des divers champs constituant le tout social, et les constantes rectifications théoriques qui s’imposent.
Strictement contemporain d’un autre entretien, « cinéma : pratique analytique/pratique révolutionnaire », accordé par Julia Kristeva à la revue Cinéthique (n° 9/10) et qui portait lui aussi, en partie sur Eisenstein, ce texte de Marcelin Pleynet, daté (c’est-à-dire à relire en situation : deux ans après mai 68), prend en considération non seulement Vertov et Eisenstein (principalement), mais aussi Jean-Luc Godard (dont on vient de publier, en 2012, un gros coffret — « Godard politique » — avec, entre autres, tous les films introuvables, non vus, du groupe Dziga Vertov [5], j’ai donc ajouté les versions vidéo de certains films de ces réalisateurs et des textes-manifestes fondamentaux de Vertov et Eisenstein sur leurs conceptions (divergentes) du montage, dont on sait à quel point elles furent déterminantes par et pour la suite (même si ce fut dans les marges du système) [6].
Comme, aujourd’hui, tout le monde fait preuve d’une amnésie historique et moralisante généralisée sur cette époque refoulée (ces époques) et vit dans « le présent perpétuel » (Debord) d’où est absente toute pensée (regardez ce que sont devenues les revues de cinéma), j’ai peur d’être quelque peu intempestif, mais bon... Pileface perdrait sa vocation de « vieille taupe » (« le temps, cette taupe ») s’il s’en tenait toujours à l’actualité [7]...

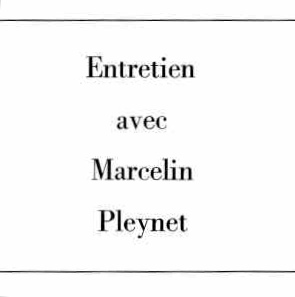
CAHIERS — Revenir aujourd’hui sur le travail d’un cinéaste comme Eisenstein impose, si ce retour se veut lui-même productif, un certain nombre de précautions. Les deux pièges à éviter nous paraissent être : 1) la manie archiviste et empiriste, à tout moment menacée de se nourrir et de se perdre dans les connexions culturelles et les stratifications historiques multiples que le nom d’Eisenstein implique et met à jour ; 2) la tentation, mécaniste, de s’y conformer comme à un « modèle » (l’exhumation pieuse). Comment un tel travail vous paraît-il pouvoir se développer ? Plus généralement : une théorie et une pratique de l’écriture sont aujourd’hui à l’œuvre. Théorie se construisant sur la base du marxisme-léninisme, écriture matérialiste susceptible de « traverser » diverses pratiques signifiantes (théâtre, cinéma, peinture, et bien sûr ce qui s’est pensé sous le nom aujourd’hui dépassé de « littérature »). Sans tenter leur unification ni leur synthèse (mythe idéaliste), sans perdre de vue leurs différences spécifiques. Dans la mesure où vous participez d’une part à ce travail, et où d’autre part vous avez été amené à intervenir à propos du cinéma. (et plus particulièrement de la période qui nous occupe ici), quelle place la pratique cinématographique vous paraît-elle pouvoir occuper dans ce champ ?
Eisenstein, « Sur quoi je travaille ». Photo prise aux Etats-Unis. Inscriptions de Eisenstein :
En haut : « Pathos » et « extase ». A gauche : « Mouvement expressif ».
A droite : « Dramaturgie de la forme cinématographique ».

L’exacerbation des avant-gardes au XXe siècle
MARCELIN PLEYNET — Si vous voulez, il me semble que dans un projet qui tend à définir la pratique d’un cinéaste comme Eisenstein, il convient d’abord de prendre en considération tout ce dont cette pratique se réclame, mais encore le champ culturel social et historique qui en produit la greffe. Lorsqu’aujourd’hui nous nous arrêtons à diverses pratiques cinématographiques, que ce soit celle d’Eisenstein, Vertov, Lang, Dreyer, etc., nous faisons implicitement référence au caractère avancé de ces pratiques, nous en soulignons implicitement, en quelque sorte une cohérence (la cohésion) « d’avant-garde ». Certains cinéastes ont eux-mêmes souligné, Eisenstein entre autres, le caractère de lutte avancé de leur travail et leur appartenance à une avant-garde cinématographique et culturelle. On peut dire que le climat culturel qui prend acte de la naissance du cinéma russe, dans les années 20, est celui d’une exacerbation des avant-gardes. Je pense qu’il ne faut, non plus, jamais perdre de vue la forme « paroxystique » que prend parfois l’avant-garde russe, dans les premières années de la révolution — il lui en restera, de toute façon, toujours quelque chose et dans cette perspective ces excès sont, eux aussi, à analyser. Ce que, de toute façon, nous devons noter dans cette perspective d’inscription du cinéma dans le cadre d’une avant-garde culturelle, c’est, de prime abord, tout ce que cette notion « d’avant-garde » peut avoir de vague, et surtout lorsque nous l’employons pour définir un certain travail cinématographique. Il est bien évident qu’un certain type de travail avancé, dans un contexte commercial (et économique défini), disons si vous voulez dans le cadre de ce qu’il convient d’appeler l’industrie cinématographique —, il est bien évident que dans ce contexte un certain type de travail, en fait occulté, a aussi pour fonction de justifier la valeur (sert de plus-value) au produit académique et/ou réactionnaire. C’est aussi dans ce sens que cette notion « d’avant-garde » doit être maniée avec prudence. Il ne s’agit pas, bien entendu, de se laisser paralyser par une telle situation, mais il convient de ne jamais l’oublier. En ce qui concerne le cinéma, cette notion d’avant-garde fait le plus souvent implicitement référence (évoque implicitement) ce qui s’est trouvé marqué par l’avant-garde littéraire ou picturale. Il arrive même que l’avant-garde cinématographique utilise les acquis de l’avant-garde littéraire, cela est sensible par exemple dans un certain cinéma surréaliste, ou encore dans l’utilisation d’Antonin Artaud par Germaine Dulac (utilisation désavouée par Artaud).
On cherche semble-t-il à trouver des exemples de cela dans le cinéma russe avec la collaboration de Maïakovski et de Chklovski à la réalisation de certains scénarios. Ce qui est à craindre là, c’est l’écrasement de diverses pratiques avancées spécifiques (littéraires, picturales, cinématographiques, musicales, etc.) les unes sur les autres. Il ne me semble pas que cette notion « d’avant-garde » puisse être appliquée également à toutes ces pratiques. Il y a une avant-garde littéraire, une avant-garde picturale, une avant-garde cinématographique, une avant-garde musicale, distinctes les unes des autres, quoique se situant les unes par rapport aux autres, quoique formant inévitablement un front commun. Et il faudrait penser dans quelle mesure, justement, elles se situent les unes par rapport aux autres, il faudrait penser cette « mesure » qui n’en est pas une ; voir très précisément comment fonctionne l’articulation commune afin que celle-ci démultiplie ses forces productives et déjoue les diverses tentatives de réduction et d’écrasement. Un texte comme le texte de Jean-Paul Fargier sur Méditerranée, « Vers le récit rouge » (Cinéthique n° 7, voir extraits), peut être considéré comme un apport important à un tel type de travail. Toujours dans la perspective de cette définition des avant-gardes propres aux pratiques plus directement articulées sur le champ idéologique, il ne faut pas oublier, en effet, que lorsque l’avant-garde « littéraire » opère une mutation en tout point révolutionnaire, c’est-à-dire dans la seconde moitié du XIXe siècle, le cinéma existe à peine. C’est une chose très très importante à noter — on peut je crois situer vers 1895 les premiers balbutiements du cinéma dans ses rapports avec la fiction, et il est alors tout à fait exclu que le cinéma ait la moindre idée de ce qui va constituer son impact d’avant-garde. Quant à la pratique picturale, dans ce même moment, elle se trouve par rapport à ses possibilités d’articulation théorique dans une situation beaucoup plus ambiguë que la littérature. En effet, ce qui caractérise la transformation du champ idéologique à la fin du XIXe siècle, c’est d’abord, pour chaque discipline inscrite dans ce champ, un retour sur l’ordre de sa production signifiante. Cette transformation, conditionnée à la la révolution industrielle, déplace l’ordonnance des appareils idéologiques, et les oblige en somme à se recycler. Inutile de dire que ce « passage » est le plus souvent empirique, et que les disciplines qui nous préoccupent prennent le plus souvent un retour mécaniste sur leur matériau de base pour un effet théorique conséquent. Lénine, dans les Cahiers philosophiques, a noté les dangers du matérialisme métaphysique dont, dit-il, « le principal malheur est d’être incapable d’appliquer la dialectique à la Bilder théorie [8], au processus et au développement de la connaissance ». Ainsi, plus la discipline que l’on peut prendre en considération a à faire dans la transformation d’un matériau de base et plus elle se laissera prendre au « réalisme » mécaniste de ses transformations. Nous retrouvons ici, mais renversée, la vieille querelle moyenâgeuse des peintres et des sculpteurs, le travail du peintre étant plus noble parce que moins manuel. Cela explique d’une certaine façon comment la littérature, en liaison directe avec l’histoire du langage, l’histoire de la pensée, l’histoire de la connaissance, s’est trouvée en quelque sorte privilégiée (Isidore Ducasse en témoigne) sur, par exemple, la peinture. Le travail théorique qu’implique inévitablement toute tentative de définition de cette notion « d’avant-garde » passe par ce double mouvement, retour sur l’oblitération mécaniste, ou formaliste, si vous préférez, et position dialectique d’un travail spécifique dans le champ de la théorie de la connaissance. La position de référence historique de ce travail passe inévitablement par la seconde moitié du XIXe siècle, dans la mesure où la révolution industrielle qui marque ce siècle laisse alors apparaître ses conséquences dans le champ des pratiques idéologiques. Comme l’écrit Marx : « La bourgeoisie ne peut exister, sans révolutionner constamment les instruments de production, donc les rapports de production, c’est-à-dire tout l’ensemble des rapports sociaux. » C’est, pour nous, aujourd’hui, à partir de ce bouleversement de l’existence sociale des hommes, qu’il convient d’opérer un retour théorique sur les disciplines qui se sont développées dans l’empirisme « révolutionnariste » que signale Marx. Et, quelle que soit la discipline que l’on prenne en considération dans ces implications avant-gardistes, c’est ce retour seul qui peut transformer l’empirisme « révolutionnariste » en théorie révolutionnaire d’avant-garde.
CAHIERS — L’étude des « décalages » et l’évaluation des effets — mécanistes/formalistes — ou théoriques conséquents, produits par le geste de retour de certaines disciplines sur leur production signifiante, se trouvent d’ailleurs considérablement compliquée dans le cas où ce geste ne s’effectue pas seulement dans et à travers cette pratique, mais par l’intermédiaire de textes écrits quand il s’agit de gens travaillant sur d’autres signifiants. C’est le cas pour les peintres, les musiciens par exemple qui ont écrit sur leur pratique. C’est le cas aussi bien sûr pour les cinéastes — Eisenstein, Vertov — qui ont produit des écrits et des manifestes. On pourrait donc parler d’un autre ordre de « décalages » (sans commune mesure avec celui entre un texte de fiction et un texte théorique écrits), non plus « intérieur » à la pratique signifiante elle-même, mais articulant cette pratique à sa réflexion dans des textes. A cet égard, il faudrait se garder de deux erreurs complices : prendre, si l’on ose dire, pour « argent comptant » tout ce que des cinéastes, des peintres, des musiciens, des sculpteurs ont pu écrire sur leur production, ou bien rejeter toute considération théorique sur une production signifiante pour ne prendre en compte que celle-ci. Par exemple, on a pu voir quelqu’un comme Umberto Barbaro rejeter les écrits d’Eisenstein ainsi : « L’artiste Eisenstein est considérable, le théoricien est inexistant quia talis », pour ne pas parler de formulations comme celles-ci : « (Avec) la mentalité dogmatique et apodictique des artistes, et son hégélianisme confus de « motocycliste », Eisenstein a complaisamment étalé ses coquetteries culturelles, révélant outre l’ampleur d’une curiosité avide d’autodidacte les modestes limites de la compréhension de tout ce qu’il parcourait précipitamment » (« Bianco e Nero », juin 1951). La seule façon d’échapper à ces deux sortes de mécanisme serait donc penser à chaque instant un ordre double de décalages articulés, et par exemple d’étudier de très près, en rapport avec ses films, les écrits d’Eisenstein (date, déterminants historiques, évolution, et dans chaque texte l’importation des concepts et des termes, leur provenance, la pertinence ou non de leur application, le mouvement d’écriture du texte, sa composition, sa disposition spatiale, etc.).
Retour sur la naissance du cinéma à la fin du XIXe siècle
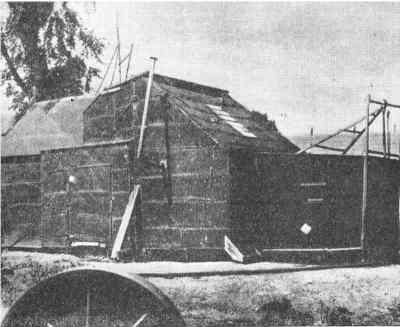
La Black Maria, le premier studio de cinéma, construit en février 1894.
Doit son sobriquet au fait qu’il ressemblait aux fourgons
cellulaires alors utilisés par la police américaine [9].

PLEYNET — Justement, j’ai insisté à plusieurs reprises, et le plus souvent d’une façon délibérément polémique, sur cette naissance du cinéma à la fin du XIXe siècle [10]. Si j’ai cru devoir le faire ainsi, c’est d’abord parce que, commençant à travailler sur le cinéma, j’ai été amené, comme vous tous je suppose, à parcourir la volumineuse bibliothèque consacrée aux études cinématographiques, et que nulle part je n’ai trouvé la moindre investigation conséquente concernant l’origine idéologique de cette invention. Je voudrais ici ouvrir une parenthèse, pour insister sur les positions qui sont les miennes, à savoir que lorsque je travaille sur, par exemple, Sade ou Lautréamont, je suis objectivement amené à exclure quelqu’un comme disons André Maurois de ce que je nomme pratique littéraire, et que de la même façon lorsque je travaille Octobre, le travail qu’Octobre peut produire exclut, cela va sans dire, un film comme Borsalino de la pratique cinématographique. On peut être amené à étudier les effets académiques. régressifs et réactionnaires de certaines productions, mais cela ne peut se faire qu’en fonction (à partir et avec) des travaux les plus avancés d’une théorie conséquente. Toute autre détermination et tout autre objectif est inévitablement amené à redoubler le confusionnisme inhérent à l’idéologie bourgeoise de la modernité. Dans la mesure où, notamment en qui concerne le cinéma, on peut considérer que les bases d’une pratique théorique ne sont pas encore posées, il convient bien entendu de s’entourer certaines précautions. C’est en somme ce qui explique le long détour que nous prenons maintenant pour aborder l’objet de cette discussion. Ces précautions toutefois doivent être pensées dans la perspective d’un travail progressif, c’est-à-dire, sous le prétexte d’une « sagesse », qui n’est le plus souvent qu’une des caractéristiques bornées de la bêtise, ne pas venir barrer ou écraser, avant qu’elles aient produit le travail qu’elles doivent produire, les questions et les suggestions mettant en évidence de nouveaux aspects du champ cinématographique. Par exemple en ce qui concerne la construction de la caméra. Je suis intervenu brièvement sur ce point une fois ou deux dans Cinéthique [11]... et c’est quelque chose que je continue à prendre sérieusement en considération. Il n’est pas question bien entendu pour moi de réduire la pratique cinématographique à cette problématique mécaniste — la pratique littéraire ne se réduit pas au code linguistique, il n’empêche qu’elle ne peut pas ne pas le prendre en considération. Toute proportion gardée, le problème que pose la programmation du matériau de base par la caméra ne peut être écartée de l’ordre des préoccupations de la pratique cinématographique. Je ne sais pas s’il est utile ici de revenir sur la distinction à établir entre le cinéma d’avant-garde et les films documentaires destinés aux vétérinaires, aux médecins, aux dentistes, aux soldats de deuxième classe, voire à divers champs de la recherche scientifique. Le cinéma est alors un instrument destiné à véhiculer, dans un langage aussi rationnel que possible, une information déterminée. Ce qui m’intéresse dans la pratique cinématographique, comme dans la pratique littéraire, ce n’est évidemment pas la rationalité du code qui programme les conversations d’épicier — ni celle qui programme les échanges, que je n’entends pas, entre biochimistes.
Ce qui m’intéresse dans la pratique cinématographique, ce sur quoi me semble-t-il nous intervenons aujourd’hui et ce sur quoi je sois jamais intervenu, c’est le caractère spécifique et productif d’un certain type d’irrationalité signifiante [12]. C’est à mon avis ce qui constitue aujourd’hui, dans le champ cinématographique entre autres, le point de départ et l’horizon théorique. Depuis près d’un siècle, et dans la phase théorique où la bourgeoisie est amenée à révolutionner constamment ses instruments de production, depuis l’invention du cinématographe, un certain nombre de disciplines à caractères scientifiques (dont la naissance et le développement sont aussi à questionner), telles que la linguistique, la psychanalyse, la sémiologie, ont réalisé un travail permettant d’intervenir, et souvent avec efficacité, dans les champs qui nous requièrent. C’est sur ce front et sur la base transformationnelle de la théorie marxiste-léniniste qu’il faut accepter la discussion. Tout le reste peut s’analyser ! Au demeurant, voudrait-on ignorer cette base théorique, que la prise en considération de l’essor du cinéma soviétique viendrait inévitablement, d’une façon ou d’une autre, nous la rappeler. En ceci d’abord que nous ne pouvons en aucune façon prendre l’essor du cinéma russe comme un phénomène que nous parviendrions parfaitement à isoler, il fait aujourd’hui partie de notre histoire, j’entends aussi bien de l’histoire russe de ces cinquante dernières années. Je veux dire par là que les précautions de tous caractères qu’il nous faut prendre avec ce phénomène impliquent inévitablement un recours aux travaux théoriques les plus avancés. Le stalinisme, qui marque toute une partie de cette histoire, n’a pas été sans conséquence dans le champ des pratiques idéologiques, entre autres, et ces conséquences supposent de notre part la nette prise de conscience d’un double registre de travail. Investigation historique et déconstruction idéologique mettant en évidence les effets producteurs de la discipline envisagée, et d’autre part recadrage, recentrement de ce travail spécifique par rapport aux diverses tentatives de réduction académique, d’écrasement « moderniste », d’intimidation politique. Un exemple significatif de ce dernier point est illustré par le frisson scandalisé qui a atteint certain milieu intellectuel à la lecture dans un de mes textes du nom de Jdanov, présenté, entre Trotsky et Staline, comme un des dirigeants soviétiques ayant eu une importance politique au cours de ces cinquante dernières années. Cette sotte tentative d’intimidation, qui s’est largement répandue dans les organes de presse français et suisse, a curieusement servi d’alliance au mariage idéologique de ce que j’appellerai le dogmatisme-réformisme et l’éclectisme-modernisme. Il va de soi que je n’ai jamais été jdanovien, ce qui n’est pas forcément le cas de ceux qui ont tenté d’en publier la nouvelle, pour mieux faire passer de côté et d’autre leur marchandise frelatée. Je crois que cette anecdote illustre assez bien le double registre dont je parlais tout à l’heure ; on en rencontrera les symptômes partout et à tout moment. Mais ce sur quoi, avant même d’abord l’essor du cinéma soviétique, il faut revenir, c’est le caractère tardif de la naissance du cinématographe et plus encore du cinéma d’avant-garde, par rapport à la révolution industrielle et à ses conséquences dans le champ idéologique. La question se pose ainsi de la place du cinématographe en tant qu’appareil idéologique [13]. Si on le situe dans le cadre de la production dite artistique, il est bien évident que sur un certain plan le cinéma apparaît comme un instrument venant révolutionner cette production. Une telle position relève évidemment d’une analyse des structures de ladite production artistique comme instrument de domination au service des classes dominantes. Pour expliciter cela, il suffit à établir dans l’histoire de la connaissance la position respective de la science et de l’art, pour voir combien l’art s’est toujours trouvé investi d’un caractère religieux propre à le mettre aux services de toutes les exploitations. L’apparition, somme toute tardive, du cinéma, porté à sa naissance par l’idéologie positiviste du progrès et la mission de vulgarisation artistique qui lui est très vite confiée, expliquerait qu’il n’enregistre pas, comme certaines autres disciplines artistiques, directement les effets de déplacement et de décentrement idéologiques dus au bouleversement économique de la révolution industrielle. Ces effets, qui dans certaines disciplines se limitent parfois à une volonté disons de recyclage dans l’ordre des instruments idéologiques de domination, n’atteindraient alors le cinéma qu’indirectement.
Sans tomber dans l’analyse sociologique, il est évident que le cinéma répond très vite à une nouvelle demande, pour une nouvelle clientèle, dans l’ordre de la production symbolique, à prix réduit (d’où le nom de certaine chaîne de salles de projection, les Nickel Odeons). Il ne faut pas oublier, peu de temps avant, l’invention du roman feuilleton, parent pauvre du roman noir, le « progrès » a ses exigences et s’il exige l’alphabétisation, il implique de savoir encore utiliser celle-ci à des fins de domination. Sur ce plan l’analyse que fait Marx des Mystères de Paris dans La Sainte Famille est magistrale. Cela reviendrait en somme banalement à dire qu’à son origine le cinéma est un instrument comme tant d’autres aux mains de la bourgeoisie qui s’emploie à l’utiliser comme instrument de domination (si on y regarde de plus près, on s’aperçoit que le cinéma de fiction est à l’origine aux mains de la petite-bourgeoisie). Et je dirai que, tant qu’elle n’est pas pensée comme telle, la structure du cinéma se prête facilement à ce type d’utilisation, dans la mesure où elle est une manifestation semi-publique (salle obscure), où elle touche une grande masse, pas forcément toujours critique dans l’ordre de la consommation d’une production symbolique, dans la mesure où elle travaille un tissu inconscient — spécularité ; identification, etc. — très chargé idéologiquement, pour ne pas oublier son caractère de production devenant très vite industriel et dont le prix de revient permet d’une façon certaine un surcroît de contrôle. Il n’est bien entendu pas question d’établir l’étanchéité du cinéma par rapport aux autres disciplines dites artistiques (c’est précisément son rapport à ces autres disciplines qui d’une certaine façon produit dans son champ une avant-garde), mais ce que je voudrais c’est noter la différence d’inscription dans son articulation au tout social. Au moment où la plupart des disciplines « artistiques » sont, implicitement, en conflit avec l’idéologie positiviste du progrès, le cinéma est un art porté par cette idéologie. Ainsi, curieusement, cette discipline, de plus en plus liée à un type de production industrielle et avec les conséquences économiques que cela suppose, n’opérera pas ses sauts qualitatifs en liaison avec les transformations du champ économique (comme c’est par exemple le cas pour la littérature et la peinture en cette fin du XIXe siècle), mais en liaison avec les transformations (les révolutions) politiques et les transformations (les révolutions) dans le domaine de la théorie de la connaissance.
CAHIERS — Ce qui est évidemment très net dans le cas de l’avant-garde cinématographique russe, en liaison directe avec la révolution politique. Il faut rappeler je crois l’existence en Russie pré-révolutionnaire d’un capitalisme fortement non-national — et c’est un élément déterminant en ce qui concerne les thèses de Lénine quant à la possibilité pour ce pays d’éviter une révolution bourgeoise prolongée —, et très concentré. Dans le champ propre de l’industrie cinématographique par exemple, on peut noter la forte domination de capitaux étrangers (Gaumont, Pathé, etc.). Donc, importation massive de films étrangers, mais aussi production nationale non négligeable. Tous films mystifiants, pessimistes, abrutissants (cf. sur quel type de rôles l’acteur Mosjoukine a fondé sa carrière avant d’émigrer), Lénine avait évidemment très tôt perçu le danger politique que constituait un tel cinéma. En 1907, conversation entre Lénine et Bogdanov, rapportée par Bontch-Brouévitch : (Lénine) « se mit à développer l’idée que le cinéma, tant qu’il se trouvait entre les mains de vulgaires mercantis, apportait plus de mal que de bien, en corrompant fréquemment les masses par le contenu ignoble de ses œuvres. Mais que, naturellement, quand les masses s’empareraient du cinéma et quand il serait aux mains de véritables militants de la culture socialiste, il apparaîtrait comme l’un des plus puissants moyens d’instruction des masses. » Egalement révélateur de l’importance pour Lénine, en tant que dirigeant politique, du cinéma : le « Projet de programme du PC(b)R » (1919), le cinéma y étant mentionné comme moyen d’éducation et de formation des ouvriers et des paysans, au même titre que les bibliothèques, les écoles pour adultes, les universités populaires, les conférences... Rappelons aussi la célèbre « proportion léniniste », à laquelle Vertov se réfère fréquemment dans ses textes, à forte majorité de films documentaires et éducatifs, et à minorité de films de fiction, Sans oublier bien sûr les exigences multiples du moment (1920 : 33 % des Russes d’Europe savent lire et écrire, 28 % dans le Caucase du Nord, 21,8 % en Sibérie occidentale...).
Dziga Vertov, le Kinodelia.
Lénine à l’inauguration du monument Marx-Engels (7 novembre 1918).

Le caractère déterminant du politique
PLEYNET — Plusieurs champs d’activité de la pratique sociale sont en effet à envisager dès que l’on prend en considération le saut qualitatif révolutionnaire qu’est l’essor du cinéma soviétique. Il me semble pourtant que ce qui domine là, tout d’abord, c’est, comme Narboni vient de le souligner, le caractère politique déterminant. En ce qui concerne Eisenstein, mais aussi bien Vertov, les interventions de Lénine en 1919 prennent un relief saisissant, si l’on sait que les premières réalisations de Vertov (le Kinonedelia) couvrent la fin de l’année 1918 et toute l’année 1919 (la KinoPravda ne commence qu’en 1922) ; et c’est en 1923 qu’Eisenstein publie dans la « Lef » [14] le Montage-attraction, qu’il réalise La Grève en 1924 et Le Cuirassé Potemkine en 1925. L’intervention politique de Lénine est de ce point de vue incontestablement déterminante, et à un tel point qu’elle donnera lieu à de graves malentendus — à savoir le déplacement des interventions politiques de Lénine présentées comme appréciation, comme dogme appréciatif de phénomènes esthétiques. Qu’il s’agisse de cinéma ou de littérature les interventions de Lénine ne peuvent être considérées, prises à la lettre, que comme des interventions politiques.
CAHIERS — Ce qui ne manque pas d’entraîner des interprétations, voire des « prolongements » ou « développements » de sa pensée, surprenants. En tout cas non-dialectiques. Soit en reprenant ses positions indépendamment de tout contexte historique et géographique, économique et politique, et en les appliquant de façon aveugle. Soit, plus souvent, de façon liquidatrice et révisionniste. Tant en ce qui concerne ses interventions, toujours déterminées de façon politique, en littérature, que « sur » l’art en général. Et donc bien sûr, dans le champ cinématographique. Il serait intéressant de relever systématiquement comment on a pu se servir (pour justifier n’importe quel formalisme, n’importe quelle position « cinéphilique ») de cette phrase (le cinéma) « de tous les arts, pour nous le plus important ». En général, le nous tombe curieusement. Ne s’agissant sans doute pas d’un pluriel de majesté, il ne peut en effet renvoyer qu’à la Russie en pleine édification socialiste, révolutionnaire, aux masses russes en lutte et à leur avant-garde politique, le Parti bolchevik. Amputation et utilisation, donc, révélatrices.
PLEYNET — En fonction des communications plus spécifiquement théoriques de Kristeva et Sollers, je suis intervenu au dernier colloque de Cluny (Littérature et idéologies [avril 1970], à paraître dans La Nouvelle Critique [15]), à propos des articles de Lénine sur Tolstoï. J’aimerais toutefois pouvoir revenir, et je crois que c’est indispensable dans le cadre qui est aujourd’hui le nôtre, j’aimerais pouvoir revenir sur l’utilisation qui a été faite des interventions de Lénine dans le champ culturel. A partir de ces interventions, nous voyons en effet se créer une suite de prises de positions toutes plus paradoxales les unes que les autres. Si l’on considère l’attitude dogmatique, on s’aperçoit qu’elle « gèle » la situation politique qui a déterminé l’intervention léniniste — autrement dit qu’elle dénie toute transformation et toute évolution politique, l’intervention de Lénine se transformant dès lors en dogme esthétique. Dans ce cas, le paradoxe — utilisation politique réactionnaire d’une « loi » esthétique — a objectivement pour but de masquer une contradiction : écrasant « l’idéologique » sous « le politique », il oblitère délibérément le caractère dialectique de la pratique léniniste — sa lecture des textes de Lénine est une lecture mécaniste (Lénine devient un homme politique qui, à des occasions diverses, a écrit une suite de dogmes), la théorie à l’œuvre dans cette pratique est tout à fait barrée. Nous avons là en quelque sorte une structure typique d’un déplacement objectivement régressif, qu’il faut en tout cas se garder de reproduire. Le retour qu’il nous faut opérer aujourd’hui sur les textes de Lénine et sur les diverses spéculations auxquelles ils ont donné lieu, doit se garder de reproduire à l’envers cette structure. Ce qui donnerait quelque chose comme : les interventions de Lénine sur la littérature et sur l’art sont des interventions politiques, or l’art n’a que faire de la politique — les interventions de Lénine sont donc essentiellement à prendre en considération d’un point de vue historique. Le paradoxe, produit ici par un grossissement phantasmatique du « gauchisme » en France, consiste à réduire à la pratique politique l’intervention de Lénine et, en utilisant le miroir déformant du gauchisme, à dénier toute possibilité de production dialectique entre les diverses manifestations du tout social. Sous le mode de l’objectivité historiciste, c’est encore une utilisation politique, dans le champ esthétique, qui est faite des textes de Lénine sur l’art. Le refoulé restant toujours le caractère dialectique de la pratique de Lénine : la théorie léniniste. Le prélèvement dans l’œuvre de Lénine de fragments où apparemment Lénine parle de littérature ou de cinéma est certes en soi étonnant, mais non moins étonnant est le fait que cette pratique puérilement mécaniste investisse tout le champ de préoccupation théorique des intellectuels.
Si l’on y regarde d’un peu près, on s’aperçoit que par exemple Lénine n’hésite pas à citer Tolstoï dans le cadre d’un article sur la production agricole (on comprend bien pourquoi et l’on comprend bien quel rôle Tolstoï est alors appelé à jouer) — mais aussi que Lénine s’entretient avec Gorki des problèmes philosophiques qui le préoccupent et des rapports que ces problèmes peuvent poser à la pratique politique ; n’oublions pas enfin qu’avec Matérialisme et empiriocriticisme, Lénine intervient dans le champ de la théorie de la connaissance. Tout ceci afin de souligner, non pas l’addition des diverses activités de Lénine, mais la pratique théorique que suppose l’investissement dialectique de ces activités. De ce point de vue, les lettres à Gorki sont plus intéressantes que les articles sur Tolstoï (qu’il n’est bien entendu pas question pour autant de négliger). Parce que moins officielles et adressées à un « sujet » écrivain, elles sont, au-delà (et avec) leurs détours rhétoriques (refus de textes, etc.), plus lisibles comme témoignage de la « méthode » léniniste. Ces lettres ont en outre le grand avantage d’être en partie écrites au moment où Lénine travaille à Matérialisme et empiriocriticisme, c’est-à-dire de renvoyer directement à la complexité irréductible de la théorie marxiste qu’élabore Lénine. Je dirai que l’écrasement dogmatique, qu’il soit de type stalinien ou réformiste, des textes de Lénine sur la littérature et sur l’art, se signale d’abord par l’absence de toute référence philosophique. De ce point de vue les rapports de Lénine avec Gorki à travers leur correspondance — ou si vous préférez les rapports de Lénine avec la littérature (telle qu’alors Gorki en est pour Lénine le représentant) — ces rapports, cette correspondance, pourraient être utilement analysés ; on y lirait, au moins dans les lettres datées autour de 1908, que Lénine cherchait à entraîner Gorki sur le terrain de la philosophie marxiste. Comme l’écrit Boris Bialik en préface à ces lettres :
« Lénine voulait aider Gorki à secouer l’influence de la philosophie idéaliste de Bogdanov, il explique combien sont réactionnaires et nuisibles toute religion, toute tentative de créer une religion « nouvelle », « prolétarienne » comme le prétendaient un certain temps Gorki et Lounatcharski. »

- Gorki est-il en train de battre Lénine aux échecs ?
Cette suite de lettres se veut effectivement introductive à la théorie marxiste dans le domaine philosophique et, au-delà des implications historiques qui ont déterminé les interventions de Lénine, elle signale (à un écrivain) le travail à effectuer s’il veut élaborer une théorie matérialiste. Mais je pense qu’ici la citation un peu longue d’une de ces lettres sera beaucoup plus parlante que tout ce que je pourrais en dire. Lénine écrit à Gorki le 25 février 1908 :
« Nous eûmes assez peu l’occasion de nous occuper de philosophie dans le feu de la révolution. Se trouvant en prison au début de l’année 1906 Bogdanov écrit encore une chose, le troisième fascicule de L’Empiriomonisme, me semble-t-il. Il m’en fit cadeau en été 1906, et je le lus avec attention. Mais cette lecture me mit dans une rage et une fureur extrême : plus clairement que jamais, il s’avérait que Bogdanov était engagé dans une voie profondément erronée, et nullement marxiste. Je lui écrivis alors une « déclaration d’amour », petite lettre philosophique remplissant trois cahiers. Je lui expliquai que bien entendu, en matière de philosophie j’étais un marxiste ordinaire, mais que précisément ses travaux, clairs, populaires, remarquablement écrits, avaient achevé de me convaincre que c’est lui qui avait foncièrement tort, et que Plekhanov avait raison. Je montrais ces cahiers à quelques amis (dont Lounatcharski) et je pensais les publier sous le titre « Notes d’un marxiste ordinaire sur la philosophie », mais je ne le fis point. Je regrette à présent de ne pas les avoir publiés sur-le-champ. J’ai récemment écrit à Pétersbourg pour qu’on recherche ces cahiers et qu’on me les renvoie. Maintenant viennent de paraître les Essais de philosophie marxiste. J’ai lu tous les articles hormis celui de Souvorov (que je suis en train de lire) et chaque article m’a fait franchement bondir d’indignation. Non ce n’est pas du marxisme ! Et nos empiriocriticistes, empiriomonistes et empiriosymbolistes s’enlisent dans un marécage. Convaincre le lecteur que la « foi » dans la réalité du monde extérieur est une « mystique » (Bazarov), confondre de la façon la plus révoltante matérialisme et Kantisme (Bazarov et Bogdanov), prêcher une variété d’agnosticisme (empiriocriticisme) et d’idéalisme (empiriomonisme), enseigner aux ouvriers l’« athéisme religieux et l’« adoration » des plus hautes facultés humaines (Lounacharski), assimiler à une mystique l’enseignement d’Engels sur la dialectique (Berman), puiser à la source nauséabonde je ne sais quel « positivisme » français agnostique, métaphysique, le diable les emporte, avec une « théorie symbolique de la connaissance » (Jouchkevitch). Non c’est vraiment trop. Bien entendu, nous sommes des marxistes ordinaires, des gens peu versés en philosophie, mais quand même pourquoi nous offenser au point de nous servir cela pour de la philosophie marxiste ! Je me ferais plutôt écartelé que d’accepter de participer à un organe ou à un collège prônant des choses semblables. »
Cette lettre, comme on voit, peut avoir pour nous toutes sortes d’utilité. Adressée à Gorki, elle lui suggère qu’il pourrait, lui aussi, penser en marxiste (fût-il « ordinaire »). Elle illustre d’autre part assez bien le contexte idéologique dans lequel se déplace l’avant-garde russe — on sait que le Proletkult fondé en septembre 1917 a, entre autres, Bogdanov pour théoricien [16]. Enfin, si puis dire, elle illustre quelques noms, comme celui de Lounatcharski, que nous retrouverons à des postes de responsable culturel. Ce qu’il faut ajouter ici c’est que la situation historique et politique des interventions de Lénine expliquer la façon dont ses écrits « réservent » certains domaines esthétiques en marge de la théorie — mais absolument pas le fait que la théorie marxiste-léniniste ne s’applique à ces domaines. D’autre part, le fait que la Russie soviétique manque d’intellectuels, est forcée d’utiliser autant que possible ceux qu’elle a, et de faire appel, sans chercher trop à y regarder de près, aux émigrés, n’est pas pour clarifier les choses. L’exemple le plus connu étant sans doute celui de l’invitation de Kandinsky par Lounatcharski — Kandinsky dont on sait qu’avec Du spirituel dans l’art, avait publié quelques années avant un livre anti-matérialiste et que, quelques années plus tard, il interviendra personnellement auprès des autorités de Weimar pour faire chasser un communiste du Bauhaus. Tout cela dessine je crois assez bien à la fois la « toile de fond » sur laquelle s’inscrit l’essor du cinéma soviétique et les décalages par lesquels nous devons passer, pour prendre en considération le saut qualitatif officiellement marqué par Eisenstein et Vertov, dans leur pratique spécifique.
CAHIERS — Pour tenter de prendre en considération aussi leur opposition, et éviter les attitudes mécanistes consistant jouer définitivement l’un contre l’autre. Ici intervient un autre ordre de décalages quant à leur polémique. Quand on relit de près un texte d’Eisenstein comme celui que nous avons publié dans le numéro 220/221, « Sur la question d’une approche matérialiste de la forme » [17], texte d’une importance théorique considérable, on se demande dans quelle mesure la cible — à savoir Vertov — n’est pas perdue de vue en chemin au profit d’un développement tout à fait propre à Eisenstein. Quand on lit également les textes de Vertov, on se pose la question de savoir si le démontage qu’il fait d’un certain type de cinéma, souvent rigoureux, peut s’appliquer de part en part à Eisenstein. En tout cas, on reste sceptique sur la possibilité qu’avait chacun des deux, au moment où il travaillait, de repérer lucidement les « décalages » propres à l’autre.
Eisenstein, héros du cinéma soviétique
PLEYNET — La situation historico-politique telle qu’on a être amené à la définir brièvement fait très vite d’Eisenstein une « personnalité ». La grande réussite du Cuirassé Potemkine fait d’Eisenstein un héros du cinéma soviétique et c’est une chose importante à prendre en considération lorsqu’on rapproche Eisenstein et Vertov. Du point vue de l’importance accordée à leur travail réciproque ce rapprochement est en fait, toutes proportions gardées, du même ordre que celui de Tolstoï et Dostoïevski. Le succès du Potemkine et du travail d’Eisenstein est tel qu’à peine deux ans après la première représentation du film, la Paramount laisse supposer qu’elle pourrait lui proposer un contrat. D’où le départ d’Eisenstein, Tissé et Alexandrov via l’Europe pour les Etats-Unis. Ainsi, dès qu’on s’arrête au travail d’Eisenstein, il y a toutes sortes de décalages à enregistrer ; ce qui, et nous ne sortons pas de ce que nous ayons avancé. suppose une double lecture. Lecture des textes dans leurs effets progressifs en fonction des divers décalages qui viennent inévitablement détourner ces textes de leur pleine efficacité théorique. Je me demande si l’on ne pourrait pas lire, dans le travail théorique, dans la production cinématographique et dans la biographie d’Eisenstein, la même situation paradoxale, à savoir que ce sont les mêmes circonstances historico-politiques qui font de lui un héros du cinéma soviétique, qui, d’autre part, expliquent les divers décalages qui limitent un travail doublement inadapté à la situation qui est la sienne. Pour définir cela plus précisément, il faut inscrire ici tout ce que l’on sait de la situation économique et internationale des origines de la Russie soviétique. L’obligation objective où se trouve Lénine de poser comme surdéterminants les problèmes économiques et politiques — d’où les rectifications idéologiques du type Proletkult, les interventions sur le cinéma, etc. Tout cela au demeurant parfaitement et inévitablement progressif dans le cadre de la théorie léniniste. Mais il faut aussi poser en janvier 1924 la mort de Lénine (année où Eisenstein entreprend de tourner La Grève) ; de 1924 à 1929 les luttes de Staline, Trotsky, Boukharine (1929 étant d’autre part l’année où Eisenstein entreprend son voyage en Europe). Il serait évidemment absurde d’établir des événements historiques à la biographie d’Eisenstein un l’apport direct de cause à effet ; ceux-ci et celle-là sont à comprendre dans la mesure de la diffusion du marxisme et du léninisme, en U.R.S.S. et dans le monde. Nous savons à quoi nous en tenir quant à la diffusion du marxisme en Russie soviétique, il serait intéressant dans cette même perspective de savoir quelle fut alors la diffusion de la pensée de Lénine et notamment les rapports qu’ont pu entretenir les diverses avant-gardes avec la pensée de Lénine.
On ne peut pas se contenter là de phénomènes du genre poèmes de Maïakovski et d’autres sur Lénine, films consacrés à Lénine par Vertov (entre autres le Kinopravda de Lénine, La Sixième partie du monde, La Onzième année, Trois chants sur Lénine), ou du passage plus bref d’un acteur représentant Lénine dans Octobre. La question ici est de savoir quelle lecture Vertov et Eisenstein, par exemple, pouvaient alors faire d’un livre comme Matérialisme et empiriocriticisme, ou encore à quelle date le matériel théorique considérable qu’apportent les Cahiers Philosophiques, put être connu — je pense ici notamment à cette note Sur la dialectique où figure la précision sur la Bilder théorie que je citais tout à l’heure, et que Eisenstein, dans ses textes plus tardifs, paraît avoir tenté de faire sienne. Ce dernier point implique d’autre part un travail minutieux sur la chronologie des textes d’Eisenstein, sur son évolution en tant que théoricien du cinéma, sur ses emprunts conceptuels, sur les diverses définitions qu’il donne aux concepts qu’il utilise, etc. Mais pour en rester dans la perspective de la diffusion de la pensée de Lénine, il ne faut pas passer sous silence le problème fondamental du rapport de la théorie léniniste à ce qu’il est convenu d’appeler le stalinisme. C’est par rapport à ce problème que des décalages manifestes dans les textes d’Eisenstein sont lisibles. Le caractère avancé du travail théorique d’Eisenstein rencontre inévitablement la résistance du « gel politique » (moins négatif pourtant que l’impérialisme américain). Certains déplacements trouvent ainsi leur justification, par exemple l’évolution de la théorie du montage dans le rapport qu’elle entretient avec le formalisme — ou encore l’utilisation des théories de Pavlov, etc. Le texte que cite Bonitzer, et qui est un texte assez tôt (1925) [18], illustre magnifiquement le conflit que je tente ici de définir. Eisenstein fait la preuve, dans le cadre de la théorie de la connaissance, d’admirables intuitions théoriques ; et la critique qu’il fait des travaux de Vertov comme mécanistes pourrait se justifier dans l’absolu, mais certainement pas (dans le cadre cinématographique) au moment où il la formule, et peut-être même pour d’autres raisons pas encore absolument aujourd’hui. Cela tient d’ailleurs aussi pour une grande part à l’ambiguïté des formulations, à partir desquelles on pourrait lui retourner le reproche « d’impressionisme primitif » qu’il adresse à Vertov.
Cette presque constante ambiguïté des formulations, comme la forme des textes, entretient autour du discours un flou, disons « poétique », « artiste », que la situation à l’intérieur de laquelle se produisent ces textes peut à la rigueur en partie justifier négativement, mais seulement en partie, je pense qu’un autre type de décalage est à lire là — un décalage plus particulièrement d’ordre biographique. Il faudrait déchiffrer cette pression biographique qui pèse sur la plupart des textes théoriques — soit sous la forme du plaidoyer, défense, ou justification a posteriori de ses films — soit plus nettement sous la forme de l’intervention anecdotique.
Le texte que vous m’avez passé (Le Mal voltairien) et qui est sans doute assez tardif [19], est de ce point de vue très intéressant, notamment en ce qui concerne le lapsus d’Eisenstein, quant à ses origines juives — cela, entre autres, pourrait je crois être un élément biographique important. Ce texte est d’ailleurs une sorte de condensé de la méthode d’Eisenstein, on y retrouve tout, le style désinvolte, la notation biographique, la défense a posteriori d’Octobre, et ces fulgurantes intuitions théoriques qui ouvrent déjà les champs sur lesquels nous sommes loin d’avoir énormément progressé, je pense ici entre autres a cette notation sur le système de la pensée matérielle prélogique des Mayas et à cette autre sur « l’inimitable matérialité des effets d’écriture » chez Joyce [20]. Tout cela mériterait une longue analyse mais il faudrait être en possession de documents biographiques plus rigoureux que ceux que l’on peut trouver. De ce point de vue le livre de Mary Seton est un désastre, il en dit trop et pas assez, ne justifie jamais ses dires, et laisse le plus souvent supposer un manque d’information que l’interprétation abusive (et significative) supplée.
CAHIERS — Vous parliez tout à l’heure de la nécessité d’éviter tout écrasement, toute réduction d’une avant-garde (littéraire, picturale, musicale, cinématographique) à l’autre. Là non plus, sans jouer l’une contre l’autre, et en ce qui concerne la Russie révolutionnaire, ne pourrait-on dire que l’inscription de l’« avant-garde » cinématographique dans le processus d’édification socialiste, dans la pratique sociale de cette période, a été plus conséquente que celle d’autres disciplines (je pense ici moins à la pratique poétique qu’à la pratique picturale par exemple), et justement à cause de ce fait que la naissance tardive du cinéma, sa détermination économique massive l’amenaient à opérer ses sauts qualitatifs moins en fonction des transformations du champ économique que des transformations politiques et idéologiques ?
L’actualisation de la théorie cinématographique
PLEYNET — Je crois qu’on peut retrouver ici ce que j’avançais tout à l’heure sur l’articulation spécifique du cinéma aux différentes pratiques du tout social. A savoir que ce qui produirait dans le champ cinématographique réflexion théorique et saut qualitatif tiendrait davantage à une révolution politique et idéologique qu’à une révolution de type industriel. Il ne s’agit pas bien entendu d’isoler aucune de ces pratiques, mais de marquer celle où principalement s’accentuent, pour une discipline donnée, les contradictions productives. Dans le cadre des problèmes de l’avant-garde qui nous préoccupent plus particulièrement, cela est évidemment sensible pour le grand cinéma soviétique et pour ses deux représentants les plus prestigieux Eisenstein et Vertov. Dans un tout autre contexte et toute proportion quantitative gardée, je dirai pour ma part que c’est également ce que je lis comme déterminant dans la production de Méditerranée, à savoir l’apport théorique de Sollers, qui peut se définir comme une intervention scientifique tranchante dans le champ idéologique, et dans la production des derniers films de Godard. J’ai dit, je crois dans le numéro 3 de Cinéthique (voir ici), que s’il le voulait, Godard pourrait un jour réaliser des films théoriquement conséquents — il faut dire aujourd’hui qu’avec un film comme Pravda, Godard se révèle comme le plus important et le plus conséquent des cinéastes d’avant-garde [21].

- Le "groupe Dziga Vertov" (1969-1972) : Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Gorin.
Mais, et sans que cela joue en aucune façon comme réserve, ici encore je distinguerai soigneusement entre la pratique cinématographique de Godard et les propos théoriques qu’il peut être amené à tenir. Leblanc a fait un travail sur ce problème précis. Disons que si vous voulez que si je ne considère pas Godard comme un théoricien (autant que je sache il n’a jamais produit de textes théoriques), je le considère aujourd’hui incontestablement comme tout à fait maître de sa pratique. A partir de là, il y a évidemment chez Godard des contradictions, semblables en bien des points à celles qu’on peut trouver chez Eisenstein ou chez Vertov, et qui relèvent des mêmes niveaux d’inscription idéologique, politique, économique et biographique. A mon avis, Godard a été quelqu’un qui, pendant très longtemps, s’est trouvé aveuglé par des préoccupations formalistes dans des films historiquement datés mais qui ont exercé une pression qu’on ne peut pas ignorer sur l’histoire du cinéma, c’est-à-dire qu’ils ont remise à l’ordre du jour, dans le cinéma français, une accentuation formelle d’ordre moderniste qui n’est pas négligeable, loin de là — quoique ces films restent limités par un horizon idéologique dont le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il est sans grand intérêt. Puis il y a eu Mai 1968, qui a été à plus ou moins longue échéance déterminant pour Godard. Je crois que c’est dans cette perspective qu’il faut comprendre le saut qualitatif qu’avec Pravda on enregistre aujourd’hui dans la pratique du cinéaste. D’une toute autre façon ce qui m’a arrêté dans les premiers numéros de Cinéthique, ce fut l’accent mis par les responsables de la revue sur le caractère surdéterminant de la pratique politique. Je ne veux pas dire, bien entendu, que le fait qu’un film soit politique suffit à en faire un film d’avant-garde (les exemples ne manquent pas du contraire), mais que dans le champ : contradiction principale / contradiction spécifique / aspect principal de la contradiction [22], on a forcement pour chaque discipline des variantes dialectiques au même moment historique. Ne pourrait-on pas dire que la révolution industrielle déplace des disciplines comme la peinture et la littérature des positions de force qui les constituent et qui constituent leur histoire dans la pratique idéologique ? La naissance tardive du cinéma et sa position historique lui donnent inévitablement à ce même moment une autre posture idéologique. Il suffit de voir comment le plus grand nombre des histoires du cinéma se déplace à l’intérieur d’une idéologie technocratique du « progrès ». La question serait donc de savoir si ce n’est pas ce qui risque de déloger le cinéma de ce type d’idéologie, à savoir une révolution politique et idéologique (autrement dit l’actualisation d’une théorie cinématographique dans le champ de la théorie de la connaissance) qui produirait le saut qualitatif dont témoignent l’avant-garde soviétique, la pratique et les textes d’Eisenstein.
De ce point de vue, mais il y en a d’autres, je ne pense pas qu’on puisse, en quoi que ce soit, établir d’analogie entre l’avant-garde cinématographique et littéraire et le travail des formalistes russes, il y eut contact, échange, circulation de travail, mais les développements respectifs ne peuvent en aucun cas être confondus. Il convient en effet, d’autre part, de distinguer entre « une écriture répétitive » et « des écritures transformatives », entre des disciplines prises dans le code fini d’un savoir, et des pratiques dont on peut penser avec Eisenstein qu’elles relèvent du système de la pensée matérielle prélogique. Cette distinction est d’importance, elle a le plus souvent été écrasée sous la notion plus ou moins religieuse d’art. Et ce point-là, lui aussi, est à déterminer et à repérer dans la terminologie d’Eisenstein. Sans doute, d’une certaine façon l’emploi de cette notion est alors pratiquement inévitable ; dans la mesure notamment où certains retards scientifiques font barrage à l’intelligence des concepts qu’elle recouvre. Mais je pense que si on s’arrête un moment à l’utilisation qu’Eisenstein fait de cette notion d’art, dans sa polémique avec Vertov, on ne peut pas ne pas s’apercevoir qu’elle sert dans son discours à recouvrir un certain type « d’irrationalité » productive, l’emploi d’un langage non fini (poétique) qu’il entend opposer à un code fini, étroitement rationnel. Mais il faut renvoyer sur ce point aux travaux de Kristeva réunis dans Sémiotikè [23].
Vertov, Eisenstein et la notion d’art
CAHIERS — Vous avez parlé du caractère inévitable, historiquement, de cet emploi de la notion d’« art », de ce recours à la notion d’art. Or, très précisément à ce moment, Vertov et Eisenstein s’opposent sur ce point. « L’irrationalité » déterminante dans la production signifiante d’Eisenstein s’opposerait-elle à une volonté de rationalité (qu’il faudra d’ailleurs bien se garder de croire « sur paroles ») de Vertov ? Il est par exemple significatif que cette notion d’« art », qui en quelque sorte indiquerait le défaut d’une science, absente, et comblerait son manque, se trouve rejetée chez Vertov, mais au profit d’une autre notion, d’autres termes dont il faudrait savoir aujourd’hui la place de quel manque ils désignaient aussi. C’est-à-dire « la vie » et la « vérité ». Ce qui, non plus, n’est pas rien.
PLEYNET — Quand je dis que l’emploi de cette notion d’art est alors inévitable, je ne veux pas dire qu’à ce moment-là, il ne se trouve pas des écrivains, des cinéastes et des peintres pour la refuser, puisque c’est alors effectivement le cas de Vertov, de certains futuristes et de pas mal d’autres. Et ce refus d’une autre façon est aussi significatif. Il est un des phénomènes propres au Proletkult, les écrivains, les peintres se déclarent prolétaires, on trouverait des déclarations de Maïakovski encore beaucoup plus radicales que cela.
Nous reconnaissons qu’au cours de notre lutte contre les subdivisions pompeuses des partisans du cinéma joué (art-non art, film artistique-film non artistique) nous avons mis ces expressions entre guillemets et tourné en dérision « le soi- disant art », « le soi-disant film artistique ».
Cela ne contredisait en aucune manière l’estime que nous nourrissions pour certains échantillons (à vrai dire fort rares) du film d’acteurs. Bien sûr, nous ne disions pas : c’est un bon film en général. Nous précisions toujours un bon film d’acteurs, un bon film joué.
Nous reconnaissons qu’au cours de notre lutte pour le droit de progrès et d’épanouissement du film documentaire, nous ne nous sommes pas abrités derrière des termes largement répandus mais diversement interprétés, tels que : « art », « artistique ». A ce moment-là au contraire, nous avons vivement et obstinément souligné le caractère inventif, pathético-révolutionnaire (de par leur forme et leur contenu) des films documentaires réalisés par les Kinoks, Nous avons présenté ces films documentaires comme l’épopée des faits, l’enthousiasme des faits. Aux attaques des critiques, nous avons répliqué en disant que le film documentaire du Ciné-Oeil n’est pas uniquement un procès-verbal documentaire, mais plutôt un phare révolutionnaire qui se dresse sur le fond des poncifs théâtraux de la production cinématographique mondiale.
Aujourd’hui encore, nous estimons que la méthode du film documentaire est la méthode fondamentale du cinématographe prolétarien, la fixation des documents fournis par notre offensive socialiste, notre plan quinquennal, qu’elle constitue la tâche fondamentale du cinéma soviétique.
Cela ne signifie nullement que le théâtre, ou le cinéma joué proche de ce dernier, soient dispensés dans quelque mesure que ce soit de participer aux combats pour le socialisme. Au contraire, plus tôt le cinéma théâtral joué tournera le dos à la falsification de la réalité, à l’imitation stérile du film documentaire, pour s’engager sur le jeu franc, à cent pour cent, plus ses actions sur le front socialiste seront honnêtes et puissantes. [24]
La lecture à faire de ce refus écartera très vite la justification d’un enthousiasme puéril, elle est à programmer dans le sens d’une profonde transformation sociale, d’une rationalisation des rapports sociaux telle que « l’artiste » théologique n’y trouve plus sa place. Nous avons très généralement là, dans le champ historique que nous prenons en considération, mais aussi bien aujourd’hui, deux attitudes invariables, celle d’une acceptation réactionnaire, anachronique, académique et celle d’un refus injustifié (alors injustifiable théoriquement) qui prend la forme d’un volontarisme « engagé ». Je dirais que dans un cas comme dans l’autre l’acceptation ou le refus (du genre « dieu est mort ») de cette notion d’art vient remplir un vide, celui d’un défaut de science où se précipite l’idéologie. Pour revenir a la polémique Eisenstein/Vertov, il est évident que la position d’Eisenstein n’a rien d’académique, et que tout son travail théorique consiste à donner une définition de sa pratique qui ne soit pas enfermée dans la forme théologique de l’art. Mais le caractère mal défini de ses formulations, la façon dont il écarte l’articulation dialectique : pratique théorique/pratique signifiante (dans la forme « poétique » de ses interventions théoriques), le défaut de science (entre autres, très logiquement, freudienne) ; tout cela laisse le champ libre aux investissements métaphysiques que nous avons aujourd’hui les moyens de repérer. La position « théorique » de Vertov me paraît dans son refus des implications irrationnelles de sa pratique moins dialectique (au niveau de sa pratique signifiante) et plus dominée par l’idéologie « moderniste » de ce début de siècle, idéologie qu’on peut définir comme mécaniste et positiviste (Kinoglaz, 1924-1926-1928. Pour ne pas parler de la « radio-oreille »). Mais dans un cas comme dans l’autre, il faut se garder d’utiliser mécaniquement la lecture que l’on peut faire aujourd’hui des limites de telle ou telle pratique théorique historiquement déterminée. Il est évident que les positions « théoriques » de Vertov ne réduisent pas pour autant l’irrationalité productive de sa pratique signifiante, et que prendre en considération les premières en ignorant la seconde reviendrait inévitablement à verser au compte de l’académisme réactionnaire un travail riche en implications théoriques progressives. L’attitude inverse ne serait d’ailleurs pas moins négative. Si la pratique d’Eisenstein mobilise un investissement culturel beaucoup plus vaste et stratifié que celle de Vertov, il ne faut pas oublier non plus que leur objectif premier n’est pas le même. Plus immédiatement didactique, la pratique de Vertov fait intervenir dans le cadre du reportage, de la propagande, de l’actualité, des éléments « narratifs » et des effets de signifiants, qui donnent à un discours « utilitaire » une dimension qui ne peut, pratiquement, excéder certaines limites. Dans l’ensemble, la programmation d’Eisenstein est inverse. Ses références quittent le champ de l’actualité, qui ne figure jamais chez lui que sous forme d’emprunt versé au dossier de l’histoire. Fût-elle toute récente (Octobre, Potemkine) cette histoire entre dans un système d’interprétation dont l’épaisseur sémantique suppose une lecture pluridimensionnelle : l’objectif est tout autre. Je dirai, trop brièvement, que Vertov mobilise la « connaissance » au service de l’actualité là où Eisenstein la « mobilise » au service de l’histoire et qu’en conséquence les champs référentiels sont tout autres. Les deux pratiques sont complémentaires, elles ne peuvent être, se trouver opposées, hier comme aujourd’hui, qu’à partir d’un défaut, d’un manque de travail théorique au niveau des articulations des divers champs qui constituent le tout social — gel politique (pratique non dialectique gauchiste ou droitière — déviation par rapport à la théorie marxiste-léniniste).
Eisenstein, Octobre, Séquence « des dieux », 1927 (extraits).

CAHIERS — Comment vous paraît-il possible d’intégrer de façon active, productive, révolutionnaire, les acquis théoriques de la période dont nous avons parlé ? Mais aussi bien d’autres cultures, d’autres civilisations ? A un moment où les résistances ne viennent pas seulement et toujours de la part de l’Etat bourgeois et de ses agents officiels, mais de tous les obscurantistes qui en font le jeu, objectivement ?
PLEYNET — Dans la perspective d’un retour théorique sur les soixante premières années de ce siècle, je crois qu’il faut prendre garde de ne pas confondre les symptômes avec la maladie. C’est dire que de toute façon une préparation théorique s’impose, qu’une pratique sociale rectifie et développe. Cette articulation dont les deux termes sont inséparables peut seule permettre d’affronter d’inévitables effets de décentrements politiques ou idéologiques dans une discipline spécifique donnée — comme par exemple ce qui s’est marqué en Russie soviétique avec « l’agit-prop », Prise du Palais d’Hiver, etc., conditions inévitables de la prise du pouvoir par les bolchéviks. Comme l’écrit Lautréamont : « les phénomènes passent je cherche les lois », or nous sommes toujours en état de nous laisser prendre aux phénomènes, de devenir les représentants de la loi, d’où le constant aplatissement les uns sur les autres des divers champs constituant le tout social, et les constantes rectifications théoriques qui s’imposent. Nous avons là une forme, une structure de déchiffrement particulièrement efficace, productive. Pour prendre un exemple, si vous voulez, on peut montrer comment le refus de la notion « d’art » dans un certain contexte historique donné, répond, face à une transformation sociale et à l’idéologie régressive qui la masque, à un besoin de science. Mais on peut aussi prendre en considération et montrer comment le recours à des systèmes relevant d’autres civilisations, d’autres modes de pensée, répond, non pas à un goût de l’exotisme, mais à une progression théorique due à une transformation sociale mettant en évidence certaines contradictions difficilement pensables dans le cadre culturel qui les produit. Si l’on pense au caractère dominant de la pensée idéaliste en Occident, à la pression qu’elle a exercé au cours des siècles et qu’elle continue à exercer à travers les divers appareils, idéologiques et autres, qu’elle a investis — il est bien évident que la pression nouvelle, toute nouvelle, exercée par la pensée matérialiste, ne peut pas ne pas faire surgir des conflits que les structures du savoir ne sont pas forcément préparées à rendre productifs. Le recours à des systèmes relevant d’autres civilisations serait alors le signe d’un manque de la science allant chercher le travail productif là où il se trouve. Pour ce qui est du texte d’Eisenstein que vous publiez (Le Mal voltairien), au Mexique [25] et en Chine ; une citation de ce texte éclairera ce que je cherche à définir :
« ... ici se ferme d’une façon singulière le cercle de la connaissance. La pensée chinoise — mon Dieu, mais c’est précisément ce que je n’avais pu maîtriser en piochant le japonais ! L’une comme l’autre langue a conservé comme moyen d’expression ce mode prélogique du langage matériel, dont soit dit en passent, nous nous servons lorsque nous nous parlons « à nous-mêmes » — dans le discours intérieur. Ce discours intérieur m’avait déjà captivé auparavant — mais encore sans que je fasse le lien immédiat avec les problèmes qui devaient m’occuper totalement par la suite, sur le plan purement scientifique. »
C’est là une note qui a la plus grande importance et qu’il conviendrait de travailler, en rectifiant tout ce que peut charrier la notion de « discours intérieur ». Le caractère spontané du refus de « l’art », qui n’est au fond que la forme embryonnaire de la conscience d’un plus à produire, et le caractère forcément réfléchi de l’emprunt culturel (extérieur) répondent en un double mouvement, et chacun à leur façon, à un des objectifs que Lénine donne à la « théorie de la connaissance ». Lénine écrit :
« Des philosophies antérieures, il [le matérialisme dialectique] garde « l’étude de la pensée et de ses lois, la logique formelle et la dialectique » — mais la dialectique dans la pensée de Marx, d’accord en cela avec Hegel, comprend ce qu’on appelle aujourd’hui la théorie de la connaissance, la gnoséologie qui doit également considérer son objet historiquement, en étudiant et en définissant l’origine et le développement de la connaissance, le passage de la non-connaissance à la connaissance. »
Lénine note ce que le matérialisme dialectique garde, nous n’allons pas nous étendre sur ce qu’il met en question, ce qui nous arrête et nous intéresse ici étant le vaste champ d’investigation qu’il ouvre et où nous avons à travailler, travail au demeurant largement ouvert aux critiques positives. Reste à s’entendre sur ce point, pour ma part je ne démordrai pas de ce qu’écrivait déjà (!) Lucrèce : « Certains penseurs estiment que toute science est impossible, or ceux-là ignorent également si toute science est possible... Je n’accepte point de débat avec quiconque prétend marcher la tête en bas. » Que dire d’autre des interventions obscurantistes, style Lebel, dont l’ignorante puérilité le dispute à la mauvaise foi ? Que dire d’autre des philistins de la « lisibilité » ? Nous sommes en 1971, nous disposons d’un matériel scientifique et théorique considérable qui est loin d’être maîtrisé et dont une importante partie se trouve aujourd’hui en France à la disposition de tout intellectuel qui s’en inquiète tant soit peu — mais s’il est vrai que l’existence sociale des hommes détermine leur pensée, on comprend bien que ne soit pas très grand le nombre des intellectuels préparés à penser leur travail en fonction des acquis de la théorie marxiste-léniniste.
Ceci pour ce qui nous concerne aujourd’hui. En ce qui concerne Vertov et Eisenstein le problème est plus complexe dans la mesure où, comme le signalait tout à l’heure Narboni, l’alphabétisation était loin d’être terminée en URSS dans les années 20. C’est une chose qui est soigneusement à distinguer que cette « lisibilité » liée à l’alphabétisation — elle est d’autant plus à distinguer que Vertov a tenté de la prendre en considération, et que certains de ses films jouent un rôle éducatif précis dans ce sens. L’autre aspect du problème est, hier comme aujourd’hui, évidemment politique et eut être marqué par diverses formes de déviations (gauchisantes ou droitières — dogmatiques ou réformistes de la théorie marxiste-léniniste) ceci étant à entendre aussi bien au niveau des individus qu’au niveau des institutions. A partir de là, si vous voulez, en ce qui concerne les attitudes réciproques de Vertov ou d’Eisenstein, nous abordons les déterminations biographiques qui permettent à tel ou tel sujet (à tel ou tel être de classe) de prendre plus ou moins conscience de la réalité des contradictions qui sont les siennes et de pouvoir les rendre plus ou moins productives dans tel contexte historique déterminé. Pour Vertov, comme pour Eisenstein, ce travail reste à faire, il est d’ailleurs d’une certaine façon inévitable si l’on veut pouvoir disposer de tous les effets des discours que produisent ces deux cinéastes. Alors pourra, peut-être, être posée la question de l’élément moteur déterminant, au niveau de l’économie sexuelle, de la pratique cinématographique. Mais nous entrons là dans un tout autre débat.
Entretien réalisé avec Pascal Bonitzer et Jean Narboni,
relu et récrit par Marcelin Pleynet.
Cahiers du cinéma 226/227, janvier-février 1971.

Eisenstein
par Julia Kristeva
Extrait de « cinéma/pratique analytique/pratique révolutionnaire » Cinéthique 9/10 (avril 71).
Cet extrait fait suite à celui que j’ai déjà publié sous le titre Méditerranée (une analyse).
[...] On pouvait supposer que l’invention de la caméra comme technique de projection-représentation devait empêcher cette intervention analytique, en vouant le film à la représentation seule, et c’est en effet ce qui se produit dans la grande majorité des films actuels.
Pourtant, la faute n’en est pas, me semble-t-il, au système même de la caméra comme procédé technique. J.L. Baudry l’a rappelé ici-même, Freud a comparé le fonctionnement du rêve au mécanisme de l’appareil photographique, tout en rectifiant, par la suite, cette comparaison [26].
Plus spécifiquement, l’écran offre à la caméra la possibilité d’une inscription spatiale et dynamique, à la façon d’un hiéroglyphe mobile en formation. L’avantage en est moins de nous donner une « représentation complète de la réalité » que de restituer à nos habitudes linéaires de penser, la logique d’un rêve ou d’un idéogramme. Ayant été construit selon les principes idéologiques de la représentation, mais parce qu’il est une technique (un appareil), le cinéma peut déconstruire ces principes en reproduisant le mouvement propre de son fonctionnement. Ceci ne veut pas dire que le cinéma quitte la représentation ; au contraire, c’est à lui d’en assurer la durée lorsque la littérature semble se frayer un autre espace... Mais c’est lui qui, à cause de sa logique technique, a la possibilité de démonter la représentation — de la démontrer. De nous montrer que ce que nous nous représentons dans la ratio de la communication à sujets, se produit dans un espace à quatre dimensions, la quatrième étant la couleur selon Eisenstein.
Dès ses débuts, donc, le cinéma cherche sa spécificité dans un langage autre que celui de la communication linéaire, langage nouveau, dépaysant, analysant, dissolvant les formes et les idéologies de notre culture.
Eisenstein apprenant le japonais, s’intéresse aux formes hyper-sémiotiques de l’art indien et compare la logique du montage à celle de l’idéogramme. Parallèlement — et ce parallélisme est une loi pour un « art » qui se vit comme « pratique » — il déconstruit les dogmes de la société bourgeoise (cf. l’article de M. Pleynet sur la place d’Eisenstein dans la culture soviétique et en France aujourd’hui, « Le front gauche de l’art », Cinéthique 5) : rappelons les scènes de l’église dans le Pré de Béjine ou bien le film qu’il projetait de faire sur Giordano Bruno (1939-1940) ; simultanément Eisenstein porte à l’écran des civilisations « autres » (« Viva Mexico », le projet de film sur Lawrence d’Arabie, etc.). Ne pas comprendre cette simultanéité et ce parallélisme (subversion formelle et idéologique en même temps qu’intérêt pour les pratiques sémiotiques de l’Orient) révèle non seulement une pensée bornée (dont fait preuve telle « autorité » en exercice traitant de « parisien » le dernier livre de Roland Barthes sur le Japon [27]), mais constitue un geste répressif contre le mouvement même de l’ « art » contemporain.
Les positions d’Eisenstein étaient la conséquence d’une connaissance profonde des possibilités logiques que contient la technique cinématographique dans les trois phases qu’il lui dégageait :
1. cinéma « uniponctuel » qui suppose une composition plastique ; phase pour Eisenstein dépassée et sans intérêt historiquement rénovateur ;
2. cinéma « pluriponctuel » qui suppose une « composition de montage » : c’est ici qu’il va développer ses idées sur le montage hiéroglyphique et sur sa logique qui « laboure » l’idéologie superficielle des individus de notre civilisation ;
3. cinéma de ton (« tonfilm ») fondé sur une composition musicale (cf. « Le montage dans le cinématographe... » (1937), in Œuvres choisies en 6 vol., vol. II, Moscou, 1965).
Pourtant, le souci d’Eisenstein de tirer des possibilités de sémiotisation nouvelle à partir de la logique du cinéma, est indissociable de son souci de situer ce travail dans le matérialisme dialectique et dans le matérialisme historique. Le cinéma révolutionnaire découle des possibilités logiques de la production du film (qui sont, dirons-nous, les possibilités logiques de démontage de la représentation) pour briser l’ancienne idéologie au nom d’une nouvelle conception du monde laquelle, en même temps, exerce sur ses « possibilités logiques » une action rétroactive :
« La forme révolutionnaire est la production de procédés techniques justes pour concrétiser une nouvelle conception et une nouvelle approche des objets et des phénomènes — une nouvelle idéologie de classe, pour un véritable renouveau non seulement de la portée sociale mais aussi de la nature matérielle et technique du cinéma recouvert par ce qu’on appelle un "contenu bien à nous" »...
Non pas « recherche » de formes correspondant au nouveau contenu, mais prise de conscience logique de toutes les phases de la production technique en correspondance avec le « nouveau type d’énergie » — la nouvelle idéologie dominante —, voilà ce qui donnera ces formes révolutionnaires de l’art que jusqu’à présent on veut encore « deviner » de manière spiritualiste.
« Dans notre conception, l’œuvre d’art (au moins dans les deux domaines où je travaille, le théâtre et le cinéma) est avant tout un tracteur qui laboure le psychisme du spectateur dans la situation de classe donnée » (« A propos d’une approche matérialiste de la forme ». La Grève, 1924) [28].
Cette action violente du cinéma comme transformateur du psychisme, Eisenstein la fondait sur le matérialisme dialectique :
« La visée d’un contact de plus en plus intime avec la révolution définit la tendance vers une introduction plus profonde dans les bases dialectiques du matérialisme militant en ce qui concerne le domaine de l’art » (« Par la révolution vers l’art, par l’art vers la révolution », ibid.).
Schéma d’Eisenstein.

C’est dans le sens d’Eisenstein, enrichi par les découvertes des sciences de la signification, que nous pouvons donc employer aujourd’hui le terme de matérialisme pour l’« art » (comme le fait Fargier, La parenthèse et le détour, Cinéthique 5) : matérialisme parce qu’analyse, selon la logique concrète de pratique signifiante (ici la logique technique du cinéma), des problèmes idéologiques d’un moment historique précis (société bourgeoise) et d’une société précise (Europe occidentale, civilisation européenne). Ceci n’a rien à voir avec un matérialisme du matériau (il y aurait du matérialisme parce que le cinéma reproduit ses propres conditions matérielles de fonctionnement), Il s’agit d’un matérialisme analytique, dialectique, à partir bien sûr des possibilités matérielles des pratiques (ici le cinéma) mais — et c’est ce qui est déterminant — dans une théorie nouvelle, matérialiste-dialectique de la signification, des idéologies, de la pratique humaine à tous ses niveaux.
Le schéma eisensteinen (ci-dessus) explique bien cette position que certaines activités de substitution, souvent même sous étiquette marxiste, essaient de rayer : en effet, quand elles se voulaient matérialistes elles n’étaient que dogmatiques (non dialectiques), et quand elles refoulent aujourd’hui leur dogmatisme il ne leur reste que l’éclectisme conformiste.
Le cinéma révolutionnaire d’Eisenstein, le cinéma analytique de la société capitaliste moderne (Méditerranée), différents car séparés par quarante ans d’histoire matérielle et signifiante aussi bien que par les conditions de deux sociétés différentes — participent, au fond, d’une stratégie commune et en soulignent deux axes fondamentaux selon lesquels se cherchent actuellement, me semble-t-il, la pratique du cinéma et sa théorie.
Julia Kristeva, Janvier 1971.
ARCHIVES
Dziga Vertov, le Kinodelia. « Le train du Comité central » (1921) .

Manifestes de Dziga Vertov
NOUS (1922)
Nous, afin de nous différencier de la meute de cinéastes ramassant pleinement la saleté des poubelles, nous nommons les " Kinoks ".
Il n’y a aucune ressemblance entre le " cinéma réaliste des Kinoks " et le cinéma des petits vendeurs de pacotilles.
Pour nous, le cinéma dramatique psychologique Russe-Allemand lourd de souvenir infantile ne représente rien d’autre que de la démence.
Nous proclamons les films théâtralisés, romanisés à l’ancienne ou autres, ensorcelés.
— Ne les approchez pas !
— N’y touchez pas des yeux !
— Il y a danger de mort !
— Ils sont contagieux !
Nous pensons que l’art du cinéma de demain doit être le reflet du cinéma d’aujourd’hui.
Pour que l’art du cinéma survive, la "cinématographie " doit disparaître. Nous voulons accélérer cette fin.
Nous sommes opposés à ceux que beaucoup appelle le cinéma de "synthèse", mélangeant les différents arts.
Même si les couleurs sont choisies avec soin, le mélange de couleurs affreuses donnera une couleur affreuse, on ne peut obtenir le blanc.
La véritable union des différents arts ne pourra se faire que quand ceux-ci auront atteint leur apogée.
Nous nettoyons notre cinéma de tout ce qu’y s’y est insinué, littérature et théâtre, nous lui cherchons un rythme propre, un rythme qui n’ait pas été chapardé ailleurs et que nous trouvons dans le mouvement des choses.
Nous exigeons :
A la porte
— Les étreintes exquises des romances
— Le poison du roman psychologique
— Les griffes du théâtre amoureux
— Le plus loin possible de la musique
Avec un rythme, une évaluation, une recherche d’outils propres à nous même, gagnons les grandes étendues, gagnons un espace à quatre dimensions (3 + le temps) [29].
L’art du mouvement qu’est le cinéma ne nous empêche en aucun cas de ne pas porter toute notre attention sur l’homme d’aujourd’hui.
Le désordre et le déséquilibre des hommes autant que celui des machines nous font honte.
Nous projetons de filmer l’homme incapable de maîtriser les évolutions.
Nous allons passer du lyrisme de la machine à l’homme électrique irrécusable.
En dévoilant l’âme de la machine, nous allons faire aimer le lieu de travail de l’ouvrier, le tracteur de l’agriculteur, la locomotive du machiniste...
Nous allons rapprocher l’homme et la machine.
Nous formerons des hommes nouveaux.
Cet homme nouveau, épuré de ses maladresses et aguerri face aux évolutions profondes et superficielles de la machine, sera le thème principal de nos films.
Il célèbre la bonne marche de la machine, il est passionné par la mécanique, il marche droit vers les merveilles des processus chimiques, il écrit des poèmes, des scénarios avec des moyens électriques et incandescents.
Il suit le mouvement des étoiles filantes, des évènements célestes et du travail des projecteurs qui éblouissent nos yeux.
Dziga Verov, Version du manifeste conforme au texte de la revue Kinophot, n° 1, 1922.
Premier programme publié dans la presse par le groupe des Kinoks documentalistes, fondé par Vertov en 1919.
Dziga Vertov, KinoPravda


- Le Ciné-oeil.
Le Ciné-oeil
Je suis un oeil.
Un œil mécanique.
Moi, c’est-à-dire la machine, je suis la machine qui vous montre le monde comme elle seule peut le voir.
Désormais je serai libéré de l’immobilité humaine. Je suis en perpétuel en mouvement.
Je m’approche des choses, je m’en éloigne. Je me glisse sous elles, j’entre en elles.
Je me déplace vers le mufle du cheval de course.
Je traverse les foules à toute vitesse, je précède les soldats à l’assaut, je décolle avec les aéroplanes, je me renverse sur le dos, je tombe et me relève en même temps que les corps tombent et se relèvent...
Voilà ce que je suis, une machine tournant avec des manœuvres chaotiques, enregistrant les mouvements les uns derrière les autres les assemblant en fatras.
Libérée des frontières du temps et de l’espace, j’organise comme je le souhaite chaque point de l’univers.
Ma voie, est celle d’une nouvelle conception du monde. Je vous fais découvrir le monde que vous ne connaissez pas.
— Le cinéma dramatique est l’opium du peuple.
— A bas les rois et les reines immortels du rideau. Vive l’enregistrement des avants-gardes dans leur vie de tous les jours et dans leur travail !
— A bas les scénarios-histoires de la bourgeoisie.
Vive la vie en elle-même !
— Le cinéma dramatique est une arme meurtrière dans les mains des capitalistes ! Avec la pratique révolutionnaire au quotidien nous reprendrons cette arme des mains de l’ennemi.
— Les drames artistiques contemporains sont les restes de l’ancien monde. C’est une tentative de mettre nos perspectives révolutionnaires à la sauce bourgeoise.
— Fini de mettre en scène notre quotidien, filmez-nous sur le coup comme nous sommes.
— Le scénario est une histoire inventée à notre propos, écrite par un écrivain. Nous poursuivons notre vie sans avoir à la régler au dire d’un bonimenteur.
— Chacun de nous poursuit son travail sans avoir à perturber celui des autres. Le but des Kinoks est de vous filmer sans vous déranger.
— Vive le ciné-oeil de la Révolution ! (1923)
Vertov, L’homme à la caméra, 1929.

[...] Au début, de 1918 à 1922, les Kinoks existaient au singulier, c’est-à-dire qu’il n’y en avait qu’un seul.
De 1923 à 1925, ils étaient déjà trois ou quatre. Dès 1925, les idées du « Ciné-Œil » ont été très largement diffusées. Tandis que s’accroissait le groupe initial, le nombre de ceux qui popularisaient ce mouvement augmentait. A présent, on peut parler non seulement du groupe, non seulement de l’école du « Ciné-Œil », non seulement d’une portion du front. mais encore de tout un front de cinématographe documentaire non joué.
[...] « L’a.b.c. des Kinoks définit le « Ciné-Œil » par la formule concise « Ciné-Œil » = ciné-enregistrement des faits ».
« Ciné-Œil » = Ciné-vois (je vois avec la caméra) + Ciné- écris (j’enregistre avec la caméra sur la pellicule) + Ciné-organise (je monte).
La méthode du « Ciné-Œil » est la méthode d’études scientico-expérimentale du monde visible :
a) sur la base d’une fixation planifiée des faits de la vie sur la pellicule,
b) sur la base d’une organisation planifiée des ciné-matériaux documentaires fixés sur la pellicule.
Donc, le « Ciné-Œil » n’est pas seulement le nom d’un groupe de cinéastes. Pas seulement celui d’un film (« Ciné-Oeil » ou « La Vie à l’Improviste »). Et pas non plus un certain courant dans le soi-disant « art » (de gauche on de droite). Le « Ciné-Œil », c’est un mouvement, qui s’intensifie sans cesse, en faveur de l’action par les faits contre l’action par la fiction, si forte que soit l’impression produite par cette dernière.
Le « Ciné-Œil », c’est le ciné-déchiffrage du monde visible aussi bien qu’invisible par l’œil nu de l’homme.
Le « Ciné-Œil », c’est l"espace vaincu, c’est le lien visuel établi entre les gens du monde entier, fondé sur un échange incessant de faits vus, de ciné-documents, qui s’oppose à l’échange de représentations ciné-théâtrales.
Le « Ciné-Œil », c’est le temps vaincu (le lien visuel entre des faits éloignés dans le temps). Le « Ciné-Œil », c’est la concentration et la décomposition du temps. Le « Ciné-Œil », c’est la possibilité de voir les processus de la vie dans tout ordre temporel inaccessible à l’œil humain, clans toute vitesse temporelle inaccessible à l’œil humain.
Le « Ciné-Œil » utilise tous les moyens de tournage à la portée de la caméra ; ainsi, la prise de vue rapide, la micro-prise de vues, la prise de vues à l’envers, la prise de vues d’animation la prise de vues mobile, la prise de vues avec les raccourcis les plus inattendus, etc. ne sont pas considérées comme des trucages, mais comme des procédés normaux, à employer largement.
Le « Ciné-Œil » utilise tous les moyens de montage possibles en juxtaposant et en accrochant l’un à l’autre n’importe quel point de l’univers dans n’importe quel ordre temporel, en violant, s’il le faut, toutes les lois et coutumes présidant à la construction du film.
En s’enfonçant dans le chaos apparent de la vie le « Ciné- Œil » vise à trouver dans la vie même la réponse au sujet traité. A trouver la résultante parmi les millions de faits - qui présentent un rapport avec ce sujet. A monter, à arracher, grâce à la caméra, ce qu’il y a de plus caractéristique, de plus utile, à organiser les bouts filmés, arrachés à la vie dans un ordre rythmique visuel chargé de sens, dans une formule visuelle chargée de sens, dans un extrait de « je vois ».
Monter — La théories des intervalles
Monter, cela signifie organiser les bouts films (les images) en un film, « écrire » le film au moyen des images tournées, et non choisir des bouts filmés pour faire des « scènes » (déviation théâtrale) ou des bouts filmés pour faire des sous-titres (déviation littéraire).
Tout film du « Ciné-Œil » est en montage depuis le moment où l’on choisit le sujet jusqu’à la sortie de la pellicule définitive, c’est-à-dire qu’il est en montage durant tout le processus de fabrication du film.
Dans ce montage continu, nous pouvons distinguer trois périodes :
Première période. Le montage est l’inventaire de toutes les données documentaires ayant un rapport, direct ou non, avec le sujet traité (que ce soit sous forme de manuscrits, sous forme d’objets, sous forme de bouts filmés, de photographies, de coupures de presse, de livres, etc.). A la suite de ce montage, — inventaire au moyen de la sélection et de la réunion des données les plus précieuses — le plan thématique se cristallise, se révèle, « se monte ».
Seconde période. Le montage est le résumé des observations réalisées par l’œil humain sur le sujet traité (montage de ses propres observations ou bien montage des informations fournies par les ciné-informateurs ou éclaireurs). Le plan de tournage résultat de la sélection et du triage des observations réalisées par l’œil humain. En effectuant cette sélection, l’auteur prend en considération aussi bien les directives du plan thématique que les propriétés particulières de la « machine-œil », du « ciné-œil ».
Troisième période. Montage central. Résumé des observations inscrites sur la pellicule par le « Ciné-Œil ». Calcul chiffré des groupements de montage. Association (addition, soustraction, multiplication, division et mise entre parenthèses) des bouts filmés de même nature. Permutation incessante de ces bouts-images jusqu’à ce que tous ceux-ci soient placés dans un ordre rythmique où tous les engrenages des significations coïncideront avec les engrenages visuels. Comme résultat final de tous ces mélanges, déplacements, coupures, nous obtenons une sorte d’équation visuelle, une sorte de formule visuelle. Cette formule, cette équation, obtenue à l’issue d’un montage général des ciné-documents fixés sur la pellicule, c’est le film à cent pour cent, l’extrait, le concentré de « je vois », le « ciné-vois ».
Le « Ciné-Œil » c’est :
je monte lorsque je choisis mon sujet (en choisir un parmi les milliers de sujets possibles),
je monte lorsque j’observe pour mon sujet (réaliser le choix utile parmi mille observations sur le sujet),
je monte lorsque j’établis l’ordre de passage de la pellicule filmée sur le sujet (s’arrêter, parmi mille associations possibles d’images, sur la plus rationnelle (’n tenant compte aussi bien des propriétés des documents filmés que des impératifs du sujet à traiter).
L’école du « Ciné-Œil » exige que le film soit bâti sur les « intervalles », c’est-à-dire sur le mouvement entre les images, sur la corrélation visuelle des images les unes par rapport aux autres. Sur les transitions d’une impulsion visuelle à la suivante.
La progression entre les images (« intervalles », visuel, corrélation visuelle des images) est (pour le « Ciné-Œil ») une unité complexe. Elle est formée de la somme de différentes corrélations dont les principales sont :
1. corrélation des plans (gros, petits, etc.).
2. corrélation des raccourcis,
3. corrélation des mouvements à l’intérieur des images,
4. corrélation des lumières, ombres,
5. corrélation des vitesses de tournage.
Sur la base de telle ou telle association de corrélations. l’auteur détermine :
1. l’ordre de l’alternance, l’ordre de succession des bouts filmés ;
2. la longueur de chaque alternance (en mètres), c’est-à-dire le temps de projection, le temps de vision, de chaque image prise séparément. De plus, parallèlement au mouvement entre les images (« intervalle »), on doit tenir compte entre deux images voisines du rapport visuel de chaque image en particulier avec toutes les autres images qui participent à la « bataille du montage » à ses débuts.
Trouver l’« itinéraire » le plus rationnel pour l’œil du spectateur parmi toutes ces interactions, interattractions, interrepoussages des images, réduire toute cette multitude d’« intervalles » (mouvements entre les images) à la simple équation visuelle, à la formule visuelle qui exprime le mieux le sujet essentiel du film, telle est la tâche la plus difficile et capitale qui se pose à l’auteur-monteur. Cette « théorie des intervalles » avait été présentée par les Kinoks dans la variante du manifeste « Nous » rédigée en 1919. La réalisation de La Onzième année et surtout de L’Homme à la caméra est l’illustration la plus éloquente de la thèse des « intervalles » défendue par le « Ciné-Œil ». [...]
Extraits des thèses d’un article rédigé le 19 février 1929.
Première publication en... 1966.

Le montage d’attractions
par S. M. Eisenstein
Additif à la mise en scène de la pièce d’Ostrovsky : Assez de simplicité chez chaque homme sage au Proletkult de Moscou.
Extraits
[...] Ce terme est employé pour la première fois et demande à être éclairci...
Les moyens fondamentaux du théâtre naissent du spectateur lui-même — et du fait que nous menons le spectateur dans la direction que nous voulons (ou dans l’atmosphère que nous voulons), ce qui est la tâche primordiale de tout théâtre fonctionnel d’agitation, de propagande, (pamphlet, éducation, etc.).
Les moyens d’action, dans ce but, peuvent être trouvés dans tous les accessoires négligés du théâtre (Le « bagout » d’Ostuzhev aussi bien que la couleur du maillot de la prima donna, un roulement de tambours, aussi bien que le monologue de Roméo, le grillon du foyer autant que les coups de feu tirés au-dessus des têtes des spectateurs).
Car chacun d’eux, à sa façon, est ramené à une même unité qui légitime leur existence et qui est leur qualité commune d’attraction.
L’attraction (dans notre diagnostic du théâtre) en est chaque moment agressif — c’est-à-dire tout élément théâtral qui fait subir au spectateur une pression sensorielle ou psychologique — tout élément qui peut être mathématiquement calculé et vérifié de façon à produire telle ou telle émotion choc.
Celle-ci sera située à sa place convenable dans l’ensemble de l’ouvrage. Ce sont là les seuls moyens grâce auxquels il est possible de rendre compréhensible le message, la conclusion idéologique de l’oeuvre. (Ce chemin de la connaissance — « à travers le jeu vivant des passions » — s’applique spécialement au théâtre).
Naturellement, aussi bien sensuel que psychologique, dans le sens de l’action la plus efficace, — aussi directement actif qu’au théâtre du Grand Guignol de Paris, sur la scène, où l’on arrache un oeil à un acteur, ou bien l’on ampute un bras ou une jambe sous les yeux mêmes du public ; ou bien, où l’on introduit dans l’action un coup de téléphone, pour décrire une action particulièrement effroyable qui a lieu à quelques dix kilomètres de là ; ou bien où l’on introduit une situation où un ivrogne sent sa fin proche et dont on prend les supplications et l’appel au secours pour de la folie.
Plutôt donc dans ce sens que dans cette branche du théâtre psychologique où l’attraction ne réside que dans le thème lui-même, existe et agit en dehors de l’action, même si le thème est suffisamment d’actualité (l’erreur commise par la plupart des théâtres « d’agitation » est de se contenter de telles attractions dans leurs mises en scène).
Je considère l’attraction comme étant un élément indépendant et initial dans la construction d’une production théâtrale — une unité moléculaire — c’est-à-dire une composante de l’efficience du théâtre, du théâtre en général.
Cela est en tous points semblable au « magasin d’images » qu’utilise George Grosz, ou aux éléments d’illustration photographique (photo-montage) qu’emploie Rodchenko.
Aussi difficile que cela puisse être de délimiter une composante, celle-ci s’achève très certainement avec le héros noble, fascinant (le moment psychologique), et commence au moment où se concentre son charme personnel (c’est-à-dire son activité érotique) ; l’effet lyrique de certaines scènes de Chaplin est indissociable des attractions qu’exercent la mécanique bien définie de ses mouvements ; il est tout aussi difficile de préciser la frontière à partir de laquelle le pathétique religieux se transforme en satisfaction sadique, au moment des scènes de tortures des représentations du théâtre de mystères, etc.
L’attraction n’a rien à voir avec le truc. Les trucs sont réalisés et achevés sur le plan de pur « métier » (surtout les trucs acrobatiques), et ne constituent que l’un des genres d’attraction lié au processus par lequel on se donne (ou, dans le jargon du cirque, « on se vend »).
Comme cette expression de cirque, l’indique bien, dans la mesure où il s’agit clairement du point de vue de l’exécutant, le truc est à l’opposé de l’attraction — qui est uniquement basée sur la réaction du public.
Une approche authentique montre que l’attraction change fondamentalement les principes de construction et rend possible le développement d’une mise en scène active.
Au lieu du « reflet » statique d’un événement où toutes les possibilités d’expression sont maintenues dans les limites du déroulement logique de l’action, apparaît une nouvelle forme — le montage libre d’attractions indépendantes et arbitrairement choisies indépendantes de l’action proprement dite (choisies toutefois selon la continuité logique de cette action) — le tout concourant à établir un effet thématique final, tel est le montage des attractions. [...] (Publié dans LEF n° 3, juin-juillet 1923)
Le montage d’attractions par Jacques Aumont
Jacques Aumont enseigne l’esthétique du cinéma et des images en général à l’université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et à l’École nationale supérieure des beaux-arts. Derniers ouvrages parus : Montage Eisenstein (Albatros, 1979, rééd. Images Modernes, 2005), Moderne ? (Éd. Cahiers du cinéma, 2007), L ‘OEil interminable (Éd. de la Différence, 2008), Matière d’images, Redux (Éd. de la Différence, 2009). Il est aussi l’éditeur de certains écrits d’Eisenstein.
Cours de cinéma : S.M Eisenstein, le “montage d’attration
par forumdesimages
Rapport du cours de Jacques Aumont.
Voir aussi : Le cours de Gilles Deleuze (22-02-1983).
En 1924 Eisenstein tourne La Grève. Le film sort en 1925.
Eisenstein, La Grève, 1925

Eisenstein explicite ses positions et polémique avec Vertov.
« La Grève est l’Octobre du cinéma.
Un Octobre qui a même eu son Février : qu’est-ce qu’en effet que l’oeuvre de Vertov, sinon le « renversement de l’autocratie » du cinéma d’art, et... rien de plus ? »
Sur la question d’une approche matérialiste de la forme
par Eisenstein
Extraits
L’accueil chaleureux et unanime fait à La Grève par la presse et la nature même des jugements exprimés par celle-ci nous autorisent à considérer La Grève non seulement comme une victoire révolutionnaire en soi, mais aussi comme une victoire idéologique dans le domaine de la forme. Ceci est particulièrement significatif en un moment comme celui-ci, où l’on est prêt à persécuter fanatiquement tout travail dans le domaine de la forme, en l’accusant de « formalisme » et en lui préférant... le totalement informe. Avec La Grève, au contraire, nous avons le premier exemple d’art révolutionnaire où la forme se montre plus révolutionnaire que le contenu.
Et la nouveauté révolutionnaire de La Grève ne résulte absolument pas de ce que son contenu — le mouvement révolutionnaire — a été historiquement un phénomène de masse, et non pas individuel — c’est tout cela, dit-on, absence d’intrigue, de protagonistes, etc., qui caractérise La Grève comme « premier film prolétarien » —, mais au contraire de ce que le film propose un processus formel bien déterminé pour affronter la découverte d’une immense quantité de matériel historico-révolutionnaire dans son ensemble.
Le matériel historico-révolutionnaire, c’est-à-dire le passé « productif » de la réalité révolutionnaire contemporaine, a été pris en examen, pour la première fois, sous un angle visuel correct : ses moments caractéristiques ont été examines comme autant de phases d’un processus unique du point de vue de leur nature « productive ». Découvrir la logique productive et exposer une technique des méthodes d’une lutte entendue comme processus « vital » et variable, qui ne connaît pas de normes inviolables en dehors de l’objectif final, méthodes qui sont modifiées et façonnées à chaque moment donné, selon les conditions et les rapports de force existant à chaque phase donnée de la lutte, montrant cette dernière dans toute son immense richesse de vie : telle est l’exigence formelle énoncée par moi devant le Proletkult au stade de la détermination du contenu des sept parties du cycle Vers la Dictature.
Il est évident que la spécificité du caractère même (de masse) de ce mouvement ne joue encore aucun rôle dans la construction du principe logique formulé, et qu’elle ne l’a pas déterminé. La forme de l’élaboration du contenu en fonction du sujet — dans notre cas le procédé, appliqué pour la première fois, de montage du scénario (c’est-à-dire le fait de construire le scénario non pas sur la base de quelques lois dramatiques universellement reconnues comme valables, mais en exposant le contenu à travers des procédés qui déterminent la construction du montage en tant que tel, par exemple dès l’organisation du matériel d’actualités) [30], et le choix juste lui-même de l’angle visuel par rapport au matériel — se sont avérés être dans notre cas une conséquence de la compréhension formelle fondamentale du matériel proposé, c’est-à-dire de l’« artifice » fondamental, formellement novateur, que la mise en scène apporte à la construction du film, artifice qui a été déterminé (historiquement) en premier.
En affirmant une nouvelle forme de cinéma comme conséquence d’un nouveau type de mandat social (pauvrement formulé : la « clandestinité »), la mise en scène de La Grève a parcouru la voie propre à toute affirmation révolutionnaire du nouveau dans le domaine artistique — c’est-à-dire la voie qui mène à intégrer dialectiquement, dans une série de matériaux, des méthodes d’élaboration qui ne sont pas propres à cette série mais appartiennent à une série différente, voisine ou opposée. C’est ainsi que le « révolutionnement » esthétique des formes théâtrales qui ont alterné sous nos yeux au cours des 25 dernières années a vu l’intégration des caractéristiques extérieures des arts « voisins » (dictatures successives : de la littérature, de la peinture, de la musique et des théâtres exotiques à l’époque du théâtre conventionnel ; du cirque, des truquages cinématographiques de caractère extérieur et d’autres choses encore, par la suite). Il s’est ainsi produit la fécondation d’une série de faits esthétiques à partir d’une autre série (à l’exception peut-être du rôle qu’ont eu le cirque et le sport dans l’œuvre de renouvellement de l’art de l’acteur). Le caractère révolutionnaire de La Grève est dû au fait que le film tire son principe novateur non pas de la série des « phénomènes artistiques », mais de celle des phénomènes immédiatement utilitaires — en particulier, le principe structural consistant à présenter dans le film les processus de production — choix important dans la mesure où il dépasse les limites de la sphère esthétique (chose en soi assez logique dans mes travaux, toujours et en tout cas orientés, dans leurs principes, non vers l’esthétique mais vers le « hache-viande »), mais encore plus important dans la mesure où, du point de vue matérialiste, c’est justement cette sphère qui a été sondée, dont les principes sont les seuls à pouvoir déterminer l’idéologie des formes d’un art révolutionnaire, de même qu’ils ont aussi déterminé l’idéologie révolutionnaire en général, c’est-à-dire l’industrie lourde, la production en usine et les formes du processus productif.
En parlant de la forme de La Grève, seules des personnes très ignares peuvent commenter les « contradictions entre les exigences idéologiques et les déviations formelles du metteur en scène » ; il est temps que certains comprennent que la forme est déterminée à un niveau très profond et non pas à travers quelque petit « truc » superficiel plus ou moins heureux.
On peut et on doit ici parler désormais non pas d’un « révolutionnement » des formes — dans notre cas, cinématographiques — puisqu’il s’agit d’une expression dépourvue de sens commun du point de vue productif — mais d’un cas de forme cinématographique révolutionnaire dans un sens général, parce qu’elle n’est en rien le résultat de « recherches » charlatanesques, mais plutôt une « synthèse d’une bonne maîtrise de la forme avec notre contenu » (comme l’a écrit Pletnev dans le « Nouveau Spectateur »). La forme, révolutionnaire est le produit de méthodes techniques justes, qui aboutissent à la concrétisation d’une nouvelle vision et d’une nouvelle approche des choses et des phénomènes — la nouvelle idéologie de classe, qui est l’authentique rénovatrice non seulement de la signification sociale, mais aussi de la nature matérielle et technique du cinéma, qui se manifeste dans ce qui est appelé « notre contenu ». La locomotive a été le fruit non d’un « révolutionnement » des formes d’une vieille voiture, mais du calcul technique exact des possibilités pratiques d’une nouvelle et non d’une ancienne forme d’énergie : la vapeur. Ce n’est pas une « recherche » de formes, correspondant à un contenu nouveau, mais la compréhension logique de toutes les phases de la production technique d’une œuvre d’art correspondant a une « nouvelle forme d’énergie » — l’idéologie dominante — qui donnera cette forme d’art révolutionnaire qu’encore aujourd’hui on veut « deviner de manière spiritualiste.
Ainsi le principe d’approche que j’ai exposé et l’angle visuel que j’ai choisi pour l’emploi cinématographique du matériel historico-révolutionnaire s’est avéré correct du point de vue matérialiste, et a été reconnu comme tel par la « Pravda » par la voix — comme on pouvait s’y attendre — d’un communiste, lequel va jusqu’à définir mon approche (formelle !) comme « bolchévique », mais, bien sûr, pas par les critiques cinématographiques professionnels (qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, c’est-à-dire, dans ce cas, que mon « excentrisme »). Il a été reconnu comme tel en dépit de la faiblesse du film sur le plan programmatique et sur celui du sujet — c’est-à-dire en dépit de l’absence de matériel illustrant de manière exhaustive la technique de l’action clandestine des Bolchéviks et les prémisses économiques de la grève, ce qui, assurément, constitue un grave défaut du contenu sur le plan du sujet et de l’idéologie, bien que dans ce cas tout cela soit considéré seulement comme « exposition non complète du processus de production » (c’est-à-dire du processus de la lutte). Mon principe a déterminé des raffinements superflus dans une forme en soi simple et rigoureuse.
L’esprit de masse — le second truc de mise en scène conscient — comme on voit par ce qui précède, n’est pas du tout indispensable sur le plan logique : en effet, des sept parties de Vers la Dictature, deux seulement sont sans protagoniste — celles de masse. Et ce n’est pas par hasard que La Grève — une de ces deux et la cinquième de la série — a été choisie en premier. Le matériel de masse est proposé comme le plus apte par son relief à confirmer le principe idéologique déjà mentionné d’approche de la forme en vue d’un résultat déterminé, et en tant qu’élément complémentaire à l’opposition dialectique de ce principe par rapport au matériel fictionnel individuel propre au cinéma bourgeois. Le matériel « de masse » a été choisi de manière consciente également sur le plan formel, créant une antithèse logique à l’Occident bourgeois, avec lequel nous n’entendons aucunement nous mesurer, mais auquel nous nous opposons.
L’esprit de masse produit une intensification extrême de l’emprise émotive sur le public, ce qui est pour l’art en général, et pour l’art révolutionnaire encore plus décisif.
Cette analyse cynique de l’édification de La Grève, analyse qui peut-être déprécie quelque peu les belles paroles sur le caractère « spontané » ou « collectif » de sa « création », donne cependant au film, en échange de ce qu’elle lui enlève, une base bien plus sérieuse et concrète, et confirme qu’une conception de la forme fondée sur des bases authentiquement marxistes amène à des résultats idéologiquement valables et socialement nécessaires.
Tout ceci nous autorise à attribuer à La Grève le nom qui pour nous indique habituellement tout tournant révolutionnaire dans le domaine de l’art : Octobre.
La Grève est l’Octobre du cinéma.
Un Octobre qui a même eu son Février : qu’est-ce qu’en effet que l’oeuvre de Vertov, sinon le « renversement de l’autocratie » du cinéma d’art, et... rien de plus ? Ce discours s’applique uniquement à mon unique prédécesseur, la Kinopravda. Par contre, le Kinoglaz, sorti quand le tournage et une partie du montage de La Grève étaient déjà terminés, n’a pas pu exercer d’influence — et d’ailleurs n’aurait pu en aucun cas exercer d’influence en ceci que le Kinoglaz est une reductio ad absurdum de méthodes techniques valables pour les actualités — en dépit des prétentions de Vertov, pour qui ses méthodes auraient été suffisantes à créer un cinéma nouveau. En pratique, il s’agit seulement d’un acte de négation d’un aspect partiel de la cinématographie, filmé avec une « caméra emballée ».
Sans nier l’existence d’un rapport génétique partiel avec la Kinopravda (les mitrailleuses ont tiré aussi bien en février qu’en octobre, mais il faut voir contre qui !) — d’ailleurs celle-ci, comme La Grève, dérive des actualités de la production — je n’en estime que plus nécessaire de souligner une différence radicale de principe, à savoir la diversité des méthodes entre les deux oeuvres. La Grève ne « développe » les « méthodes de la Kinopravda » (Kherov). Et si on ne peut trouver, dans la forme extérieure, une certaine ressemblance, dans sa partie la plus essentielle par contre — dans la méthode formelle de construction — La Grève s’avère être l’exact opposé du Kinoglaz.
Dire avant tout que La Grève ne prétend pas sortir de l’art, et que là est sa force.
Telle que nous la concevons, l’oeuvre d’art (du moins dans les limites des deux genres dans lesquels je travaille, le théâtre et le cinéma) est avant tout un tracteur, qui laboure à fond le psychisme du spectateur, dans une orientation de classe donnée.
Les productions des Kinoks ne possèdent pas une semblable propriété ni une semblable orientation, et je pense que cela est la conséquence de cette belle trouvaille — pas trop en harmonie avec l’époque où nous vivons — de leurs auteurs : nier l’art au lieu d’en comprendre, sinon l’essence matérialiste, du moins ce qui en est la validité, toujours matérialiste, sur le plan utilitaire.
Une telle légèreté met les Kinoks dans une position assez ridicule en ceci que, si on analyse leur travail du point de vue de la forme, on est contraint de reconnaître que leurs oeuvres appartiennent sans aucun doute à l’art, mais seulement à l’une de ses expressions idéologiquement les moins valides : l’impressionnisme primitif.
A travers le montage, opéré sans calculer les effets, de fragments de vie authentique (de tonalités authentiques, diraient les impressionnistes), Vertov a tissé la trame d’un tableau pointilliste. [...] Vertov prend du monde qui l’entoure ce qui l’impressionne, lui, et non ce par quoi, en impressionnant le spectateur, il labourera à fond son psychisme.
En quoi consiste pratiquement la différence entre nos approches, on peut le voir plus encore en évidence là où une partie, pas très grande, du matériel de La Grève, coïncide avec celui du Glaz, ce que Vertov considère pratiquement comme un plagiat (comme si dans La Grève, le matériel était trop rare et qu’on courre le prendre dans le Kinoglaz !) et particulièrement dans la scène du massacre, qui dans le Kinoglaz est sténographiée, tandis que dans La Grève celle est sanguinairement impressionnante. (C’est justement cette extrême virulence des impressions suscitées par La Grève, « sans gants blancs », qui a valu au film cinquante pour cent de ses ennemis).
En bon impressionniste, le Kinoglaz, son gentil petit bloc-notes à la main (!), court derrière les choses telles qu’elles sont, sans se déchaîner dans un élan rebelle contre l’inévitable staticité de leur rapport de causalité, sans le dépasser au nom d’un motif impérieux d’organisation sociale, mais au contraire en se soumettant à la pression « cosmique » de ce rapport. En fixant la dynamique extérieure de ce dernier, Vertov dissimule ainsi le caractère statique du panthéisme (qui, en politique, est la position qui caractérise l’opportunisme et le menchevisme) sous la dynamique, à travers les procédés de l’a-logique (ici purement esthétisante : l’hiver-été dans la Kinopravda n° 19, ou simplement à travers celui de la brièveté des morceaux de montage, et il la reproduit docilement, morceau par morceau, dans l’impassible plénitude de son équilibre [31].
Au contraire, La Grève arrache des fragments du milieu ambiant, selon un calcul conscient et volontaire, préconçu pour conquérir le spectateur, après avoir déchaîné sur lui ces fragments en une confrontation appropriée, en l’associant de manière appropriée au motif idéal final.
Ce qui ne signifie en rien que je ne me prépare pas à éliminer de mes prochains travaux ces résidus à éléments théâtraux, qui ne se concilient pas organiquement avec le cinéma, ni peut-être avec l’apogée même du calcul volontaire : la « réalisation », parce que la chose la plus importante, la mise en scène, organisation du spectateur par un matériel organisé — dans, ce cas, celui du cinéma — est rendue possible par une organisation pas seulement matérielle des phénomènes effectivement filmés, mais aussi optique — à travers la prise de vues. Et si au théâtre le metteur en scène, par l’interprétation, transforme la dynamique potentielle (statique) du dramaturge, de l’acteur, etc., en une construction socialement opérante, au cinéma, au contraire, l’interprétant par le choix qu’il accomplit, il transforme par le montage la réalité et les phénomènes réels, dans le cadre de la même orientation.
Celle-ci reste toujours mise en scène, et n’a rien de commun avec l’impassible figurativisme des Kinoks, c’est-à-dire avec le système de fixer les phénomènes, qui réussit tout au plus à fixer l’attention du spectateur, et rien de plus [32].
Le Kinoglaz n’est pas seulement le symbole d’une vision, mais aussi d’une contemplation. Mais nous ne devons pas contempler mais agir.
Il ne nous faut pas un « Ciné-oeil », mais un « Ciné-poing ».
Le cinéma soviétique doit fendre les crânes. Et ce n’est pas par le regard de réuni de millions d’yeux que nous lutterons contre le monde bourgeois (Vertov) — ils nous planteront tout de suite des millions de lampions sous ces millions d’yeux !
Fendre les crânes avec un ciné-poing, y pénétrer jusqu’à la victoire finale, et maintenant, devant la menace de contamination de la révolution par l’esprit « quotidien » et petit-bourgeois, fendre plus que jamais !
Vive le ciné-poing !
(Œuvres choisies d’Eisenstein, publiées sous la direction de S. Youtkévitch aux Editions « Isskoustvo », Moscou, Tome 1, pp. 109-116. Traduit du russe par B. Eisenschitz et J. Aumont).
S.M. Eisenstein, Kino-Journal ARK n° 4/5, 1925
(Cahiers du cinéma 200-221, p.35-36)
Eisenstein, Le Cuirassé Potemkine, 1925
Le Cuirassé « Potemkine » est un film soviétique muet réalisé par Sergueï Eisenstein, sorti en 1925. Il traite de la mutinerie du cuirassé Potemkine dans le port d’Odessa en 1905, de l’insurrection et de la répression qui s’ensuivirent dans la ville.
Eisenstein, Octobre, 1927

Dziga Vertov, L’homme à la caméra, 1929
Dziga Vertov au montage de L’homme à la caméra, 1929.


Dans ce film sans acteur, le cinéaste russe parcourt un espace quotidien qu’il transfigure et réinvente en un chef d’oeuvre inoubliable.
L’homme à la caméra parcourt en toute liberté la vie quotidienne d’une grande cité soviétique tout en inventant le langage filmique. « Je suis le ciné-oeil. Je suis l’oeil mécanique. Moi, machine, je vous montre le monde comme seul je peux le voir. (...) C’est là que nous travaillons, nous Maîtres de la vue, organisateurs de la vie visible (...), Maîtres des mots et des sons, les virtuoses du montage de la vie. » Dziga Vertov (littéralement « la toupie qui tourne ») est le pseudonyme choisi par Denis Kaufman, qui débutera sa carrière artistique par la poésie et la littérature et s’inscrira d’emblée dans le mouvement futuriste. Menant des études de médecine, il se passionnera très vite pour la relation entre le son et l’image, menant des expériences bruitistes associant graphie, mots et sons. L’Homme à la caméra est un aboutissement, celui d’une réflexion essentielle sur le rapport que le cinéma entretient avec le réel et sur le pouvoir de l’image en tant qu’outil idéologique mais aussi en tant qu’art à part entière, émancipé des arts "bourgeois" et développant sa propre syntaxe. Il influencera toute une génération de cinéastes et d’artistes à commencer par Buñuel et Vigo qui feront leurs propres expérimentations.
Le film original est muet. Une version existe avec une musique réalisée en 1995 sur la base des indications de Dziga Vertov. Elle n’est plus disponible dans sa continuité sur la toile.
Voici une autre version restaurée en 2006.

Le principe : un film sur le cinéma
L'Homme à la caméra, un film sur le cinéma from Ciclic on Vimeo.

"L’Homme à la caméra" analysé par Bamchade Pourvali
Bamchade Pourvali termine une thèse de doctorat sur l’essai filmé. Il est l’auteur de Chris Marker (Éd. Cahiers du cinéma, 2003), Godard neuf zéro (Éd. Séguier, 2006), Wong Kar-wai (Éd. Amandier, 2007), ainsi que d’un dossier sur L’Homme à la caméra (site du CNDP, 2010). Ce film est l’aboutissement des réflexions de Dziga Vertov sur le documentaire qu’il résume à travers les néologismes Ciné-oeil, Kinok ou Kinoglaz. Un manifeste d’avant-garde, également porteur d’une utopie sociale qui met l’accent sur le cinéma comme instrument d’enregistrement et de déchiffrement du monde.

LIRE AUSSI : « L’Homme à la caméra » annonce "l’ère de l’individu"
Jean Douchet : Eisenstein et Vertov
Une autre histoire du cinéma, France Culture, 30 juillet 2007.

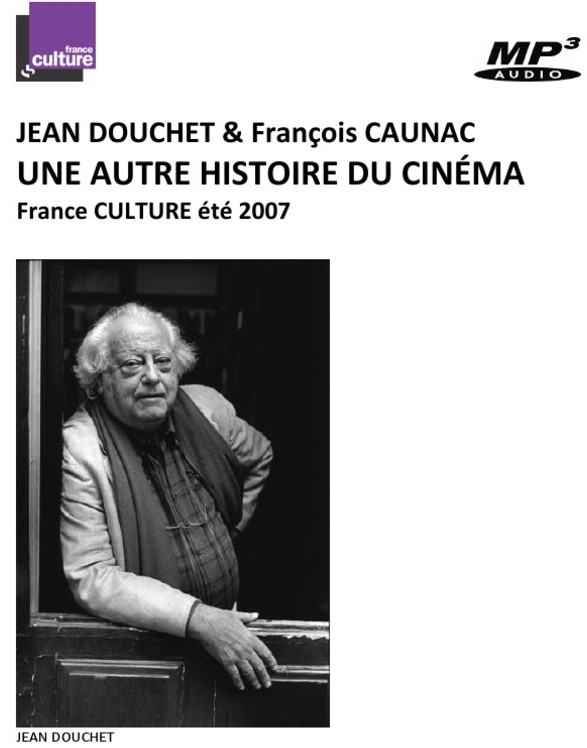
Jean Douchet sur France Culture.
Zoom : cliquez l’image.

LIRE AUSSI : Jean-Luc Mouvement Godard par Jean Douchet et Fernando Ganzo
Godard, Pravda (1969)
Le terme Pravda signifie en russe « vérité » et c’est aussi bien sûr le titre du journal officiel de l’URSS. Jean-Luc Godard et Jean-Henri Roger [33] partent de ce double sens et, à partir d’images tournées en Tchécoslovaquie (speakerine de la télévision tchèque, paysannes et ouvrières tchèques, scènes de la vie quotidienne), s’interrogent sur le mensonge des images et du son et montre que le capitalisme est toujours très présent dans les pays de l’Est.

Godard sur Pravda (1970)
Trois parties, ou plutôt, trois étapes ont caractérisé la réalisation du film.
1) Un tournage soi-disant « politique » en fait, du « tourisme politique », ni plus moins ; des images et des sons enregistrés un peu au hasard : les cadres, les ouvriers, étudiants, les rapports de production, l’américanisme, le révisionnisme, etc., bref des images et des sons enregistrés selon la bonne vieille classification de l’idéologie bourgeoise à laquelle on prétend pour s’opposer.
2) Mais ce n’est pas si simple. Au montage, en face de cet amas « documentaire », on découvre que l’on a tourné un film politique au lieu de tourner politiquement un film.
Le montage va donc consister à faire, après, ce qui aurait dû être fait avant, à faire pendant le montage, le montage qui aurait dû être fait avant et pendant le tournage (cf. Vertov), bref, à rattraper le retard, à limiter des dégâts. Négative, en ce qui concerne l’étude, la brochure, sur la Tchécoslovaquie, cette opération de sauvetage est positive par rapport aux réflexions qu’elle permettra après le montage, sur un plus juste emploi du cinéma comme arme politique, c’est-à-dire sur un plus juste, politiquement, emploi politique du cinéma.
3) Monter le film consistait donc d’abord, à avoir les idées justes sur ce qu’on était en train de faire (faire un film sur la Tchécoslovaquie, et comment le faire) c’est-à-dire, à partir d’où l’on était : des documents « réels », « vécus », à organiser politiquement sur une ligne anti-révisionniste. Là, de nouveau, le « politiquement » a été escamoté, et l’anti-révisionniste s’est caractérisé par une débauche de citations mal employées. Ces trois étapes dans la réalisation du film se sont donc retrouvées normalement dans le montage final qui se compose lui aussi de trois parties :
A) Enquête banale en Tchécoslovaquie. Les petits faits vrais. Un pays socialiste qui fait de la publicité pour Panam et Olivetti, etc. Bref, un pays malade.
B) Le nom de cette maladie : le révisionnisme. Taylor = Stakhanov ; Chytilova = Zanuck et Paramount ; Ota Sik = J.J. Servan-Schreiber ; socialisme tchèque = socialisme yougoslave ; etc.
C) Le moyen de guérir cette maladie : le marxisme-léninisme. Notre tâche de cinéastes marxistes-léninistes : commencer à mettre des sons déjà justes sur des images encore fausses.
Des sons déjà justes parce qu’ils viennent des luttes révolutionnaires.
Des images encore fausses parce que produites dans le camp de l’idéologie impérialiste.
Conclusion
Aspects négatifs : tournage hâtif, opportuniste, petit-bourgeois. Tournage qui n’est pas du « montage avant le montage » (Vertov). Montage qui n’est que du montage avant le montage, au lieu d’être du « montage dans le montage » (Vertov).
Aspects positifs : ne pas avoir abandonné purement et simplement le film comme d’autres camarades. Dans cette lutte encore trop individuelle d’organisation finale du montage, avoir appris deux ou trois choses :
1) A dégager quelques images simples qui devront être la base des prochains films ; les rapports de production ; la lutte idéologique installée par la collaboration révisionnisme idéalisme quant à perpétuer ces rapports de production dans la tête des gens, c’est-à dire, en dégageant ces rapports de production, en sachant les re-produire en images en sons, par des nouveaux rapports d’images et de sons, le cinéma marxiste-léniniste pourra s’en servir comme arme, d’abord dans la lutte idéologique (théorie) puis dans les luttes concrètes de la classe ouvrière et de ses alliés (pratique).
2) Dégager des images simples (et ce n’est pas si simple, c’est là qu’il s’agit de faire politiquement) comme ici les plans de la rose = classe ouvrière tchèque et slovaque, et les plans de production toujours les mêmes ; dégager des images simples c’est refuser de faire des images du monde trop complètes, c’est faire que la même image (ou son) soit une image de et en lutte, qu’elle ne soit jamais la même image (ou son) mais qu’elle soit image (ou son) de et en lutte critique, transformation.
— (Texte diffusé l’ARC - musée d’Art Moderne de Paris - en février 1970, à l’occasion d’une projection du film).
Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, réalisé par Alain Bergala,
Cahiers du cinéma-Éditions de l’étoile, 1985, p. 338-340.
Dialogue entre Jean Douchet et Jean-Luc Godard
Au Fresnoy, 2004. Autour de Vent d’est.

[3] Surtout la séquence où Vertov a placé la caméra entre les jambes d’une jeune femme en train d’accoucher (d’expulser le fruit de ses entrailles !), séquence alors coupée dans la version de la Cinémathèque française que j’avais projetée peu de temps avant.
[4] Cahiers du cinéma n° 220-221, mai-juin 1970 où on trouvaient plusieurs textes ou manifestes de Vertov, de Lénine, d’Eisenstein et des formalistes russes.
[5] Coffret qui comprend tous les films « politiques » de Godard (8 DVD), de La Chinoise (1967) à... Film socialisme (2010), mais dont on se demande bien comment le consommateur contemporain peut s’en approprier la signification en l’absence de toute analyse historique et théorique, excepté dans certains interviews publiés en « bonus ».
[6] Je me suis limité aux textes "fondateurs" des années 20.
[7] Sauf mention contraire, toutes les notes sont de mon fait. Les illustrations aussi (source principale : les Cahiers du cinéma).
Précisions (« d’où tu parles ? ») :
1. Après mai 1968, est créée la revue Cinéthique qui, très vite, vient perturber le ron-ron de la critique cinématographique en entrant en conflit avec des revues historiques comme Positif et les Cahiers du cinéma. Un rapprochement de Cinéthique avec Tel Quel s’effectue. Rapidement, les Cahiers opèrent un changement stratégique et se rapprochent aussi de Tel Quel (dont, rappelons-le, ils ont publié les textes sur Méditerranée de Pollet-Sollers en février 1967). Tel Quel favorise le rapprochement entre Cinéthique et les Cahiers. Un texte commun — « cinéma/littérature/politique » — est rédigé par les trois revues le 21 décembre 1970. Il sera publié dans Tel Quel 44 (hiver 71) et Cinéthique 9/10 (avril 71), numéro dans lequel on trouve un entretien avec Julia Kristeva — « cinéma : pratique analytique/pratique révolutionnaire » — où celle-ci "applique" sa sémanalyse des « pratiques signifiantes » à deux "objets" spécifiques : Méditerranée (voir ici) et... Eisenstein (voir plus bas). C’est dans ce même numéro de Cinéthique, juste après ces textes, que nous publierons, Michel Cegarra et moi, une analyse des conditions d’une pratique de diffusion d’un « cinéma différent » et nos premiers textes sur Dziga Vertov (les citations de Brecht en exergue de ce dossier sont repris de ces textes).
C’est dans ce contexte que j’ai lu pour la première fois le texte de Marcelin Pleynet « sur les avant-gardes révolutionnaires ». Pourquoi ?
2. De janvier 1968 à 1971, j’anime un ciné-club étudiant à Lille. En octobre 1968, je crée un « Groupe d’études cinématographiques » à la fac de Lettres (des étudiants et des enseignants y participent : il n’y a pas encore d’enseignement de la filmologie, nous ouvrons la voie, certains en profiteront et feront carrière). Avec quelques amis, nous décidons de programmer des films dits d’avant-garde (d’hier et d’aujourd’hui). Longue discussion, un mois de juillet, avec Henri Langlois, étonné mais curieux, que nous finissons par convaincre de nous prêter gracieusement (merci à ce grand Monsieur) des films de Vertov, d’Eisenstein, Poudovkine, etc... Parallèlement, programmation de Méditerranée et, avec Cinéthique, de plusieurs films du groupe Dziga Vertov (Godard militant les fait circuler) : Pravda, Un film comme les autres, Vent d’est, Luttes en Italie (je me souviens avoir vu Luttes en Italie sur la table de montage de Godard, boulevard du Maine, en avril 1970, avec Jean-Paul Fargier et Gérard Leblanc, rédacteurs de Cinéthique, et un « militant m-l » qui énerva beaucoup Godard), etc.
Étrange gratuité de cette époque où tout semblait possible (la régression spectaculaire sera pour plus tard, mais elle ne tardera guère)... A.G.
[8] La théorie du reflet.
[9] Source : Georges Sadoul, L’invention du cinéma, Denoël, 1948
[10] On peut se reporter à Histoire du cinéma sur wikipedia.
[11] Dans le n° 1 de la revue Cinéthique (1969), Pleynet analysait le lien entre la caméra comme « matériel de base » et la « perspective monoculaire ».
[12] Je souligne. A.G.
[13] Je souligne.
[14] LEF (en russe ЛЕФ), ou Levyi Front Iskusstv (en russe Левый фронт искусств, Front gauche des Arts), est une revue d’avant-garde soviétique cofondée en 1923 par le poète Vladimir Maïakovski qui en était le rédacteur en chef, et par Ossip Brik. Y participèrent des écrivains (Nikolai Aseev, Semion Kirsanov, Serge Tretiakov), des cinéastes (Sergueï Eisenstein, Dziga Vertov), des metteurs en scène (Vsevolod Meyerhold) et des théoriciens de la littérature (Victor Chklovski). Chaque couverture était réalisée par Alexander Rodchenko. La publication de LEF cessa en 1925 (wikipedia).
[15] Voir cette note de mon dossier « Derrida tel quel ».
[16] Cf. PROLETKULT.
[17] Cahiers du cinéma 220/221, mai-juin 1970, p. 32. Voir plus bas.
[18] « A propos d’une approche matérialiste de la forme ». Voir plus bas.
[19] Il s’agit — on l’ignorait en 1971 — d’un chapitre de l’autobiographie d’Eisenstein dans lequel celui-ci revient sur un article inédit, rédigé en octobre 1928, et publié pour la première fois dans Znamia en 1960, douze ans après sa mort.
[20] Eisenstein évoque sa lecture de La pensée chinoise de Marcel Granet — « "La Pensée chinoise" — mon dieu, mais c’est précisément ce que je n’avais pas pu maîtriser en piochant le japonais ! » — et sa découverte quasi-simultanée d’Ulysse de Joyce :
« Et cet a-syntaxisme de son écriture, qui procède des principes du discours intérieur, que chacun de nous parle à sa manière, mais dont le seul génial écrivain Joyce a fait la base de sa méthode littéraire. Dans l’ensemble, Joyce s’attaque, dans le laboratoire linguistique de la littérature, à la même chose à quoi vont mes efforts dans le domaine du langage cinématographique. »
Le 1er novembre 1934, Eisenstein fera un cours sur James Joyce. On conviendra qu’il s’agit là d’événements non négligeables ! J’y reviendrai.
[21] Film réalisé par Godard et Jean-Henri Roger (décédé en décembre 2012), avec qui Godard tournera également British Sounds. Les autres films du groupe Dziga Vertov (créé fin 1969) ont été réalisés avec Jean-Pierre Gorin.
D’où vient le nom de ce groupe ? Godard a répondu à cette question lors d’un interview fait en 1970 par Kent E. Carroll :
Question : Pourquoi avez-vous pris le nom de Groupe Dziga-Vertov ?
Godard : Il y a deux raisons. La première est le choix de Dziga Vertov, la seconde le choix du nom Groupe Dziga Vertov.
Le nom du groupe n’est pas pris pour élever une personne, mais pour brandir un drapeau, pour indiquer un programme.
Pourquoi Dziga Vertov ? Car au début du siècle il était un véritable cinéaste marxiste. En faisant des films, il contribuait à la Révolution Russe. Il n’était pas uniquement un révolutionnaire.
C’est un artiste progressiste ayant participé à la révolution et il est devenu un artiste révolutionnaire à l’intérieur de la lutte. Il a dit : « Le devoir d’un cinéaste — kinoki — n’est pas de faire des films — en fait kinoki ne veut pas dire cinéaste mais ouvrier du cinéma —, mais de faire des films au nom de la Révolution Prolétarienne Mondiale. » (Plus ici).
Le programme est clair.
[22] Pleynet reprend ici les "concepts" de Mao étudiés par Sollers dans Sur la contradiction.
[23] Cf. L’étrangère.
[24] Réponses au journal Kinofront, 1930.
[25] Cf. Les dessins mexicains d’Eisenstein .
[26] Lire aussi : Jean Louis Baudry, Le dispositif .
[27] L’empire des signes, Skira, 1970.
[28] Voir plus bas.
[29] Je souligne.
[30] A ce propos, il est intéressant de remarquer que, la narration étant exposée à travers la technique même de La Grève et des autres parties de Vers la dictature, le moment du scénario proprement dit manque, et il se produit un saut du thème à la feuille de montage, chose parfaitement logique du point de vue du montage même (note de S.M.E.).
[31] En ce qui concerne ce qui est indubitablement la staticité de Vertov, il est intéressant de citer un exemple, parmi les plus heureux, de montage dans un sens abstraitement mathématique : le lever du drapeau dans un camp de pionniers (je ne me souviens plus dans quelle Kinopravda). Il s’agit ici d’un exemple très évident de solution non pas dans la direction d’une dynamicité émotionnelle, du fait même du drapeau qui monte, mais d’une statique de l’observation de ce processus. En plus de cette caractérisation immédiatement perceptible, symptomatique est ici, dans la technique même du montage, l’emploi dans la plupart des morceaux de métrage court, de gros plans statiques, et de plus contemplatifs, qui naturellement, étant composés de trois ou quatre photogrammes, ont une faible capacité dynamique à l’intérieur du plan. Mais ici, dans ce cas particulier (et il faut d’ailleurs noter que les exemples de ce type sont très fréquents dans la « manière" de Vertov), nous pouvons voir, concentrés au maximum, élevés au rang de « symboles », ce que sont les rapports réciproques de Vertov et du monde qu’il prend en examen. On peut de plus observer un « truquage » du montage, qui tend à dynamiser les morceaux statiques.
Il faut aussi considérer qu’il s’agit d’un cas de matériel de montage tourné personnellement, et donc d’une combinaison de montage dont on est personnellement responsable. (S.M.E.)
[32] Il faut dire, pour être juste, que Vertov a accompli une tentative pour organiser le matériel de manière différente, c’est-à-dire active, en particulier dans la deuxième partie de la Leninskaïa Kinopravda (janvier 25). En fait, cette organisation différente du matériel se manifeste ici, pour le moment, presque seulement comme une marche à tâtons sur le chemin d’une « titillation » émotive et de la création d’« états d’âmes », mais sans une claire intention d’en faire usage. Quand Vertov aura dépassé ce premier niveau de maîtrise de l’action, et aura appris à susciter chez ses spectateurs les états d’âme qui lui serviront et, en montant ces derniers, à communiquer à ce public une impulsion préétablie, alors... il sera bien difficile que des divergences se produisent encore entre nous deux, mais alors Vertov aura cessé d’être un Kinok et sera devenu un metteur en scène, et même, peut-être... un « artiste ».
Alors on pourra soulever la question de l’emploi par l’un des méthodes de l’autre (mais qui est l’un ? et qui est l’autre ?), parce qu’alors seulement il sera possible de parler sérieusement d’une méthode de Vertov, laquelle se réduit simplement pour l’instant au procédé intuitif dérivant de la pratique de ses constructions (il est d’ailleurs probable que Vertov est conscient de celles-ci de manière toute relative). On ne peut pas définir comme une méthode ce qui n’est qu’un en semble de procédés dérivant d’une bonne connaissance pratique du métier. D’un point de vue théorique,la doctrine de la « vision sociale » n’est autre qu’un montage décousu de phrases ronflantes et de lieux communs, qui est de beaucoup inférieur, en ce qui concerne le montage, à la simple « manipulation » du montage qu’il s’efforce, parfaitement stérilement, de motiver « sur le plan social » et d’exalter. (S.M.E.)
[33] Le film sera plus tard attribué au groupe Dziga Vertov.




 Version imprimable
Version imprimable





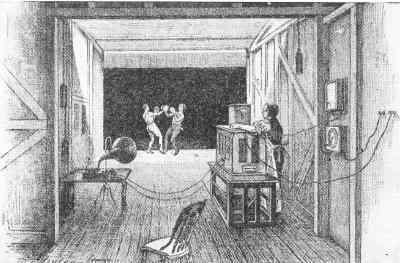






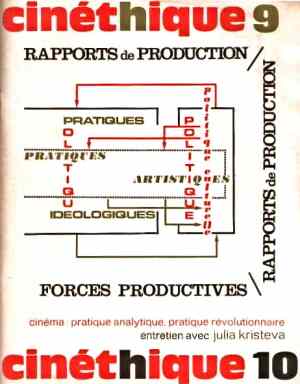
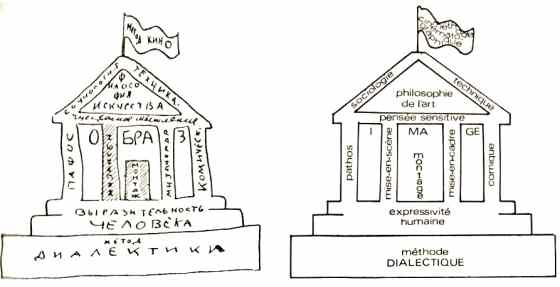

















1 Messages
France Culture, 16 octobre. Nuit spéciale : Il y a 100 ans, la révolution russe. La révolution fut une catastrophe et, pourtant, elle vit naître un grand art. Contradiction ? Ecoutez Ciné club - Les pionniers du cinéma soviétique par Alexis Ipatovstev (1ère diffusion : 05/11/1997).