
 Jacques Derrida : « L’avenir est aux fantômes »
Jacques Derrida : « L’avenir est aux fantômes »  Benoît Peeters : « Derrida », la biographie
Benoît Peeters : « Derrida », la biographie Une rencontre avec Sollers |
Une rencontre avec Sollers |
 Derrida et Tel Quel
Derrida et Tel Quel
 Extraits de la biographie de Benoît Peeters « Derrida »
Extraits de la biographie de Benoît Peeters « Derrida »
 Jacques Derrida : radios et télévision
Jacques Derrida : radios et télévision  Philippe Sollers, « Un pas sur la lune »
Philippe Sollers, « Un pas sur la lune »  Jacques Derrida dans Tel Quel
Jacques Derrida dans Tel Quel 
 Virginie Linhart et Benoît Peeters, « Derrida — le courage de la pensée » (2014)
Virginie Linhart et Benoît Peeters, « Derrida — le courage de la pensée » (2014)Version complétée de quelques notes le 29-11-13.
Ajout vidéo le 08-10-14.
Ajouts :
Entretiens avec Benoît Peeters : sur France Culture, le 14 octobre 2010 — sur France Inter, le 8 novembre 2010
Entretien avec Jacques Derrida sur les années 1964-1968 (France Culture, 1998)
Entretien de Jacques Derrida avec Alain Veinstein (21-12-01)
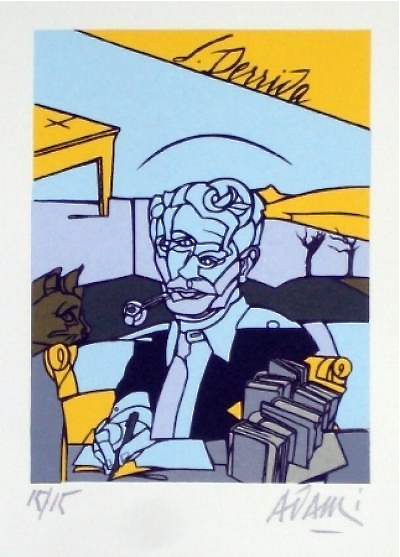
- Valerio Adami - Jacques Derrida, "portrait allégorique", 27.1.04
« Comme soudain, à force de coups de gomme et de coups de crayon, le visage, dans les portraits d’Adami, sait se faire oublier ! [...] Les traits s’y font anguleux, la peau se parchemine. Au fond, sont-ce bien toujours des traits ? Ne seraient-ce pas plutôt, ne seraient-ce pas déjà des lettres ? Visage de Derrida sur lequel on ne peut plus accommoder, visage que menace le flou et qui se couvre de cendre, cependant qu’un rayon d’or emporte son nom dans la nuée. »
Philippe Bonnefis, Valerio Adami. Portraits littéraires, Éd. Galilée, octobre 2010.
« L’avenir est aux fantômes »
« Entrée des fantômes », « Sympathie pour le fantôme », « Exit le fantôme », « The ghost writer » : les fantômes seraient-ils de retour ? Ne l’ont-ils pas toujours été ? N’est-ce pas le propre d’un fantôme d’être toujours un revenant ? En 1983 Jacques Derrida, dix ans avant Spectres de Marx — livre intempestif —, s’en expliquait face à l’actrice Pascale Ogier (disparue l’année suivante [1]) dans un film de Ken McMullen, Ghost dance. « Le fantôme, c’est moi », « Je laisse un fantôme ventriloquer à ma place », « l’avenir est aux fantômes », « la technologie décuple le pouvoir des fantômes », disait-il. Regardez ce court extrait.

« Je ne sais pas si je crois ou si je ne crois pas aux fantômes, mais je dis : Vive les fantômes ! Et vous, est-ce que vous y croyez aux fantômes ? »
« Derrida », la biographie
Benoît Peeters, l’auteur, entre autres, de Hergé, fils de Tintin, vient de publier la première biographie de Jacques Derrida, six ans après la mort du philosophe. Achetez-là sans attendre. « Derrida » est un livre passionnant, très documenté (740 pages, index compris), qui se lit comme un roman et nous livre, à travers le portrait aux multiples facettes — comme le dessin d’Adami — d’un homme "en guerre" (et pas seulement comme il le dira « en guerre avec lui-même » [2]), un homme secret (ses rencontres, ses amitiés, ses ruptures, les controverses et bien, stricto sensu, des malentendus), un tableau très précis de l’histoire intellectuelle — et ses scènes multiples (française, internationale, philosophique et autres) — de ces soixante dernières années. Parallèlement à cette somme, Benoît Peeters publie « Trois ans avec Derrida », Les carnets d’un biographe qu’il a tenus pendant son travail d’enquête et la rédaction de son ouvrage. Journal dans lequel il livre ses « impressions », évoque « les rencontres avec les témoins », « les à-côté de la conversation » et « le lien étrange qui s’établit entre le biographe et son sujet » (c’est le plus intéressant).
Il présentait ces deux livres, avant leur publication, sur le blog créé à cette intention :
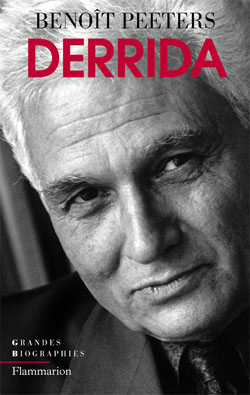
Extraits :
« Mon livre n’est ni un essai philosophique, ni une nouvelle introduction à l’oeuvre de Derrida déguisée en « biographie intellectuelle ». Il s’agit d’une véritable biographie, fondée bien entendu sur une lecture intégrale de l’oeuvre, mais aussi sur un considérable travail de recherches, dans plusieurs pays et de nombreux lieux, ainsi que sur des rencontres avec une centaine de témoins. »
Les archives
L’archive était pour Jacques Derrida une véritable passion et un thème constant de réflexion. Comme il le déclara dans une ses dernières interventions publiques : « Je n’ai jamais rien perdu ou détruit. Jusqu’aux petits papiers, quand j’étais étudiant, que Bourdieu ou Balibar venait mettre sur ma porte (...) j’ai tout. Les choses les plus importantes et les choses apparemment les plus insignifiantes. »
Derrida était conscient de l’importance de cette archive et souhaitait qu’elle soit analysée. Dans un entretien accordé en 2001 à la revue Genesis, il expliquait aussi : « Le grand fantasme (...), c’est que tous ces papiers, livres ou textes, ou disquettes, me survivent déjà. Ce sont déjà des témoins. Je pense tout le temps à ça, à qui viendra après ma mort, qui viendrait regarder par exemple ce livre que j’ai lu en 1953, et demandera : “pourquoi a-t-il coché ça, mis une flèche-là ?”. Je suis obsédé par la structure survivante de chacun de ces bouts de papiers, de ces traces. » [...]
Qui découvrira-t-on ?
* Un individu sensible, angoissé, attachant, dont la correspondance, d’une grande qualité littéraire, permet d’accompagner la trajectoire même sans connaissances philosophiques. Le Derrida que révélera ma biographie sera beaucoup plus accessible et impliqué dans son siècle qu’on ne le croit généralement.
* Des préoccupations éthiques et politiques présentes depuis le début, bien avant de trouver une place à l’intérieur de son oeuvre. La trajectoire humaine et intellectuelle de Jacques Derrida se place sous le signe de deux traumatismes de jeunesse : l’exclusion de l’école à 12 ans en tant qu’enfant juif, les déchirements nés de la guerre d’Algérie.
* Une exceptionnelle série d’amitiés avec des écrivains et penseurs de premier plan, parmi lesquels Louis Althusser, Emmanuel Levinas, Paul Ricoeur, Maurice Blanchot, Francis Ponge, Jean Genet, Hélène Cixous, Jean-Luc Nancy et Avital Ronell.
* Une non moins longue série de polémiques, riches en enjeux mais souvent brutales avec des philosophes comme Claude Lévi-Strauss, Michel Foucault, Jacques Lacan, John R. Searle ou Jürgen Habermas. Plusieurs « affaires » qui débordèrent largement les cercles académiques, dont les plus fameuses concernèrent Heidegger et Paul de Man.
* Une carrière internationale sans équivalent qui fit d’un petit Juif d’Alger le philosophe le plus traduit dans le monde. La déconstruction derridienne a eu un impact considérable, bien au-delà du monde philosophique, influençant en profondeur la littérature, l’esthétique, le droit, les sciences politiques, la théologie et quantité d’autres domaines. Ses liens avec le féminisme, les queer studies, les postcolonial studies ne sont pas moins fondamentaux.
Benoît Peeters parle de « Derrida »

1. sur France Culture, le 14 octobre 2010 lors de l’émission Le Rendez-Vous, avec Philippe Lançon (22’ + illustration musicale en final)
Crédit : France Culture.
2. sur France Inter le 8 novembre 2010 lors de l’émission animée par Kathleen Evin L’humeur vagabonde (53’50).
Avec la voix de Jacques Derrida
et une rencontre de Lucie Akoun avec le photographe
Carlos Freire.
Crédit : France Inter
3. Sur les archives de Jacques Derrida
Une rencontre avec Sollers
On aura noté que, dans cette présentation, Benoît Peeters ne mentionne ni le nom de Philippe Sollers, ni celui de la revue Tel Quel, que ce soit au titre des « amitiés » ou au titre des « polémiques ». Qu’on ne s’y trompe pas : le livre ne comporte pas moins de quarante entrées au nom de Sollers, juste après ceux de Husserl, Heidegger, Althusser ou, pour les vivants, de Jean-Luc Nancy. C’est dire l’importance que les relations entre Derrida et Sollers, quoique brèves au regard d’une vie (huit ans de 1964 à 1972), ont revêtue sur le plan de l’« amitié » comme celui de l’« écriture ». C’est qu’à partir du milieu des années soixante, la transformation du « champ idéologique » (philosophique, littéraire) passe, en grande partie, par ce qui se joue et s’écrit à travers ces deux noms. J’ai toujours été frappé qu’après la rupture survenue en 1972, les deux hommes n’ont guère engagé de polémiques directes (quelques allusions parfois), comme si chacun prenait garde de ne pas rouvrir des « blessures » personnelles (blessures sans doute plus profondes chez Derrida que chez Sollers, mais allez savoir). Ce qui semble confirmé par la lecture du récit de leurs relations que fait Benoît Peeters dans sa biographie et dont vous lirez des extraits plus loin.
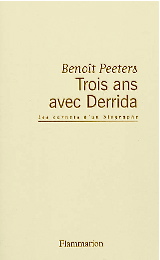
A la date du 15 janvier de ses Carnets, il mentionne le témoignage de Michel Deguy : « Autre figure centrale selon lui : Philippe Sollers. Leur amitié fut comme un coup de foudre réciproque, au point que Deguy, éphémère membre du comité de rédaction de Tel Quel, en fut un moment agacé et vaguement jaloux » (p. 42-43) [3] Benoît Peeters a rencontré Sollers le 28 janvier 2008. Il semble en avoir gardé une impression curieuse dont il rend compte dans ses Carnets (p. 50) :
Rendez-vous avec Philippe Sollers dans son minuscule bureau chez Gallimard. Il est sympathique en diable, quelque prévention qu’on puisse avoir. Je l’ai beaucoup lu dans ma jeunesse ; c’est l’un des témoins que j’avais le plus envie de rencontrer.
Sollers parle très librement, sans réticence, de celui avec qui il reconnaît volontiers avoir été intime. Mais curieusement pour un romancier, il semble n’avoir aucun plaisir à raconter. À l’inverse de Genette, il n’entre pas dans le récit. Tout de suite, il commente. Ce qui me manque dans ses propos, c’est le détail, le petit fait révélateur. Il va trop vite, dans sa conversation comme dans Un vrai roman, son livre de mémoires. Tirant sur sa cigarette, riant beaucoup, il poursuit son monologue presque indépendamment de mes propos. Plus d’une fois, j’ai l’impression qu’il n’a pas entendu ma question.
Je lui demande pourquoi, au contraire de Barthes, Lacan ou Althusser, il n’a pas fait de Derrida un des personnages de Femmes. C’est que, répond-il, l’homme avait quelque chose de coincé, que son « mode d’existentialité » n’était pas à la hauteur de sa pensée (à moi de prouver le contraire) [4]. Une expression revient à plusieurs reprises : Larvatus prodeo (j’avance masqué).
Sollers qui, le 17 mai 2009, lors d’un « très aimable coup de téléphone » par lequel il autorise Benoît Peeters à citer des fragments de ses lettres, tient, semble-t-il, à ajouter qu’il a « revu Derrida une dernière fois, à un dîner en l’honneur de Toni Morrison, alors qu’il était déjà malade » et qu’« ils se seraient embrassés "comme si de rien n’était". » (B. Peeters, Trois ans avec Derrida, p. 240). Il est vrai que Sollers avait déjà parlé de cette ultime rencontre, pratiquement dans les mêmes termes, dans Un vrai roman, ses mémoires, en 2007 (« on s’est quand même embrassés, Derrida et moi, avant sa disparition, un soir, chez Christian Bourgois, lors d’une réception donnée pour la bouillante Toni Morrison. »). « Pulsion réconciliatrice », comme le dit Peeters [5] ? Quoiqu’il en soit, je ne peux imaginer cette scène sans une certaine émotion [6].
Derrida et Tel Quel
Jusqu’ici seul Philippe Forest, dans son incontournable « Histoire de Tel Quel », publiée au Seuil en 1995, s’était penché avec empathie et rigueur sur l’aventure de la revue et de ses protagonistes, qu’ils aient été ou non membres de son comité de rédaction. Le « Derrida » de Benoît Peeters ne contredit pas fondamentalement l’approche de Forest (à laquelle il se réfère souvent) et même, en bien des points, la confirme à partir d’un autre angle de vue. L’intérêt majeur est qu’il s’appuie sur des documents nouveaux (correspondances, archives de Derrida à l’IMEC, à Irvine, etc.). Peeters avait pensé consacrer un chapitre aux relations entre « Derrida et Tel Quel » ou à d’autres thématiques (Trois ans avec Derrida, p. 117). Il a finalement choisi l’ordre chronologique, ce qui rend la lecture incontestablement plus « fluide ». Il est cependant possible de lire son livre en alliant « le mode thématique » et le mode chronologique. On peut ainsi reconstituer une autre histoire, non plus celle d’un groupe (Tel Quel, avec ses singularités et ses contradictions), mais celle d’un individu singulier dans ses relations avec d’autres singularités (qui, tant bien que mal, font groupe) — et leurs contradictions. Les personnages « principaux » et les personnages « secondaires » restent les mêmes. L’éclairage y gagne-t-il ? Ou l’obscurité ? Dans « Curriculum vitae » (in Geoffrey Bennington et Jacques Derrida, Jacques Derrida, p. 305-306), Geoffrey Bennington, à propos de la rupture finale avec Tel Quel, écrit :
« Sur le sens et les conditions de la rupture, j’ai souvent entendu J. D. inviter d’une part à « lire les textes », y compris les siens, et notamment ceux de la collection et de la revue dans les années 65-72, jusqu’à Tel Quel — mouvement de Juin 71 — Informations du 30 avril 1972 inclus ; et d’autre part à ne se fier "en rien" aux interprétations-reconstructions ("grossièrement falsificatrices") de cette séquence finale par certains membres du groupe Tel Quel ». (c’est moi qui souligne. A.G.)
« Lire les textes », tous les textes (de 1964 à 1973 inclus — vous verrez pourquoi), sans oublier le contexte : quelque jugement qu’on porte — s’il le faut — c’est la meilleure méthode. Et la seule qui puisse rendre justice — il le faut — aux divers protagonistes, que vous croyiez ou non aux fantômes.
Un peu d’histoire
Entretien avec Jacques Derrida sur les années 1964-1968
Avant de commencer à lire, écoutez Derrida revenir sur ses premières publications. En 1998, dans une série d’entretiens avec Catherine Paoletti, il évoquait sa préface à L’origine de la géométrie de Husserl (5’) :
et les « conditions favorables » qu’il trouva dans son rapprochement avec Philippe Sollers et la revue Tel Quel de 1964 à 1968 (4’20) :
Extraits de la biographie de Benoît Peeters, « Derrida »
Vous lirez ci-dessous l’histoire des relations entre Jacques Derrida et la revue Tel Quel telle que la raconte Benoît Peeters. Le "montage" des extraits cités, les intertitres, les illustrations, les documents d’archives, les "encadrés" intégrés dans le corps de l’article et les divers entretiens (du Monde et du Matin, etc.) ont été réalisés et ajoutés par mes soins. Les notes, sauf indication contraire, sont de Benoît Peeters (lequel m’écrit généreusement le 9 novembre 2010 :
« Je suis épaté par votre article, votre érudition, et les documents que vous avez conservés.
Un grand merci pour cette lecture de mes deux livres. »
« Je n’ai jamais rien perdu ou détruit. Jusqu’aux petits papiers, quand j’étais étudiant... », disait Derrida. J’ai instinctivement retenu la leçon. Cela a fait ses preuves.) — A.G.
1964 : le début des relations avec Sollers
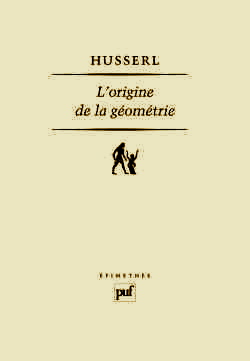
- 1963. Introduction de Jacques Derrida.
 C’est en 1964 que débutent les relations de Jacques Derrida et de Philippe Sollers. Même s’il est de six ans plus jeune que Derrida, Sollers, depuis la publication de son premier roman, Une curieuse solitude, jouit d’une vraie réputation. En 1958, l’ouvrage a été salué par Mauriac et Aragon peu avant que Sollers fonde la revue Tel Quel avec Jean-Edern Hallier. En 1961, il a obtenu le prix Médicis pour Le Parc, son deuxième roman, et a résolument opté pour la modernité. Depuis un moment, il se passionne pour la philosophie. Lorsque parait L’origine de la géométrie, il est plongé dans les Recherches logiques de Husserl. En lisant l’introduction de Derrida, Sollers est donc très frappé par le parallèle entre Husserl et Joyce ; il consacre une courte note à l’ouvrage dans le n° 13 de Tel Quel, au printemps 1963 [7]. Touché, Derrida lui envoie des tirés à part de « Force et signification » et de « Cogito et Histoire de la folie ». Le ton de la première lettre de Sollers, le 10 février 1964, est extrêmement chaleureux ; il assure que les deux textes l’ont intéressé au plus haut point, même si son « incompétence philosophique » lui impose de procéder intuitivement dans le débat avec Foucault. « Il est frappant de constater, en tout cas, qu’une fois de plus — et sans le moindre hasard — pensée et "littérature" (authentiques) communiquent radicalement. Cette sorte d’interrogation mutuelle est assez révélatrice, n’est-ce pas ? » [8] Au même moment, Gérard Genette, qui vient d’être nommé assistant à la Sorbonne et a déjà publié dans Tel Quel, convie les Derrida à « un dîner de grosses têtes avec Sollers et peut-être Barthes », le 2 mars 1964, dans son appartement de Savigny-sur-Orge, en Seine-et-Oise. Sollers et Derrida se revoient au mois de juin, chez Michel Deguy cette fois. Entre les deux hommes, la sympathie est immédiate ; et l’écrivain ne tarde pas à demander au philosophe un article pour Tel Quel, sur le sujet de son choix. Derrida promet d’y réfléchir dès qu’il sera libéré de la lourde période des examens.
C’est en 1964 que débutent les relations de Jacques Derrida et de Philippe Sollers. Même s’il est de six ans plus jeune que Derrida, Sollers, depuis la publication de son premier roman, Une curieuse solitude, jouit d’une vraie réputation. En 1958, l’ouvrage a été salué par Mauriac et Aragon peu avant que Sollers fonde la revue Tel Quel avec Jean-Edern Hallier. En 1961, il a obtenu le prix Médicis pour Le Parc, son deuxième roman, et a résolument opté pour la modernité. Depuis un moment, il se passionne pour la philosophie. Lorsque parait L’origine de la géométrie, il est plongé dans les Recherches logiques de Husserl. En lisant l’introduction de Derrida, Sollers est donc très frappé par le parallèle entre Husserl et Joyce ; il consacre une courte note à l’ouvrage dans le n° 13 de Tel Quel, au printemps 1963 [7]. Touché, Derrida lui envoie des tirés à part de « Force et signification » et de « Cogito et Histoire de la folie ». Le ton de la première lettre de Sollers, le 10 février 1964, est extrêmement chaleureux ; il assure que les deux textes l’ont intéressé au plus haut point, même si son « incompétence philosophique » lui impose de procéder intuitivement dans le débat avec Foucault. « Il est frappant de constater, en tout cas, qu’une fois de plus — et sans le moindre hasard — pensée et "littérature" (authentiques) communiquent radicalement. Cette sorte d’interrogation mutuelle est assez révélatrice, n’est-ce pas ? » [8] Au même moment, Gérard Genette, qui vient d’être nommé assistant à la Sorbonne et a déjà publié dans Tel Quel, convie les Derrida à « un dîner de grosses têtes avec Sollers et peut-être Barthes », le 2 mars 1964, dans son appartement de Savigny-sur-Orge, en Seine-et-Oise. Sollers et Derrida se revoient au mois de juin, chez Michel Deguy cette fois. Entre les deux hommes, la sympathie est immédiate ; et l’écrivain ne tarde pas à demander au philosophe un article pour Tel Quel, sur le sujet de son choix. Derrida promet d’y réfléchir dès qu’il sera libéré de la lourde période des examens.
Au début du mois d’août 1964, alors que Derrida est encore épuisé par le surmenage des mois précédents, Sollers lui redit à quel point il serait désireux de publier un article de lui un prochain numéro de Tel Quel. Derrida, qui a « une grande sympathie pour Tel Quel », songe depuis quelques mois à texte qui pourrait s’intituler « L’écriture (ou la lettre) de Hegel à Feuerbach ». Mais, il craint que le texte ne soit trop long pour une revue [9]. Le sujet plaît à Sollers, qui serait heureux de publier ce texte en deux numéros, s’il n’excède pas une cinquantaine de pages. Mais il demande aussi à Derrida s’il n’aurait pas « quelque chose à dire sur Artaud » pour un dossier qu’il prépare. Le 30 septembre, de retour à Paris, Derrida doit annoncer que le texte sur l’écriture s’est hélas paralysé au moment où il est arrivé à Nice. Il vient seulement de s’y remettre, mais craint de ne pouvoir le boucler avant un bon moment. Pour ce qui est d’Artaud, la lettre de Sollers a réveillé en lui le désir de le relire, ce qu’il n’a pas fait depuis l’adolescence, et peut-être d’écrire à son propos : « Mais ici encore, il me faudrait du temps. Le métier va bientôt me reprendre [10]. — Deux mois plus tard, malgré les nombreux cours et les autres obligations professionnelles, l’article sur Artaud est bien avancé ; il s’appellera « La parole soufflée ». Derrida espère l’achever pendant les congés de fin d’année [11].

1965 : « Drame », Artaud
 Derrida a été profondément touché par Drame, son nouveau livre : il lui adresse une longue lettre, timide et presque embarrassée, en s’excusant de « faire des phrases » :
Derrida a été profondément touché par Drame, son nouveau livre : il lui adresse une longue lettre, timide et presque embarrassée, en s’excusant de « faire des phrases » :
Au-delà de tout ce que Drame atteint en moi d’attente, au-delà de tout ce par quoi vous me précédez sur un chemin qu’il m’a semblé reconnaître, d’outre-mémoire, au-delà de tout ce que pourrait dire mon commentaire s’enroulant autour de votre livre qui déjà se commente lui-même, c’est-à-dire s’efface en s’écrivant (...) et écrit en se retirant (...), au-delà de ce commentaire que je n’ose entreprendre ou arracher à son mouvement qui en moi se continue, j’ai admiré — est-ce permis ? — l’écrivain, la merveilleuse sûreté qu’il garde au moment même où il se tient sur la première ligne et l’ultime péril de l’écriture (...) [12].
Le ton se fait plus personnel, lorsque Derrida avoue à quel point le livre de Sollers réveille en lui l’amour d’une littérature face à laquelle il se sent fragile et comme intimidé :
« M’en voudrez-vous si je vous dis que vous avez encore écrit un très beau livre ? Moi, en tout cas, j’en suis très heureux, car — je n’oserais jamais le dire en public — j’aime encore les beaux livres et j’y crois. J’ai encore, je garde de ma jeunesse, un peu de dévotion littéraire. »
Le post-scriptum montre à quelle hauteur il place le livre de Sollers :
« Avez-vous lu L’Attente l’oubli de Blanchot ? Il vient de me l’envoyer, je ne sais pas pourquoi, deux ans après sa parution. Je l’ai lu juste avant Drame. À travers d’infinies différences, il y a quelque chose de fraternel qui passe de l’un à l’autre. »
Sollers est, comme on l’imagine, très touché par la générosité de cette lecture. Heureux de cette « communication sans réserves [13] » et de cette pensée qui l’accompagne, il se rapproche beaucoup de Derrida durant les mois suivants. Leur correspondance est d’une grande richesse et leurs rencontres sont fréquentes. De la part de Derrida, on devine le désir d’une amitié quasi fusionnelle, comme celle qu’il avait connue avec Michel Monory.
L’article sur Artaud est publié en mars dans le numéro 20 de Tel Quel ; dans le même dossier, paraissent un texte de Sollers, un autre de Paule Thévenin et onze lettres inédites d’Artaud à Anaïs Nin. Premier essai de Derrida consacré à Artaud, « La parole soufflée » propose une lecture novatrice d’un auteur alors mal connu. En 1965, seuls les cinq premiers tomes des oeuvres complètes sont sortis chez Gallimard. Dans ce superbe article, Derrida commence par s’interroger sur la difficulté particulière de tenir un discours à propos d’Artaud. Trop de commentaires ne font que l’enfermer dans des catégories convenues, niant une nouvelle fois « l’énigme de la chair qui voulut s’appeler proprement Antonin Artaud [14] ». Même les belles pages que Maurice Blanchot lui a consacrées ont tendance à le traiter comme un cas, sans que la « sauvagerie » de son expérience soit réellement prise en compte.
Si Artaud résiste absolument — et, croyons-nous, comme on ne l’avait jamais fait auparavant — aux exégèses cliniques ou critiques, c’est par ce qui dans son aventure (et par cc mot nous désignons une totalité antérieure à la séparation de la vie et de l’oeuvre) est la protestation elle-même contre l’exemplification elle-même. Le critique et le médecin seraient ici sans ressource devant une existence refusant de signifier, devant un art qui s’est voulu sans oeuvre, devant un langage qui s’est voulu sans trace. [...]
Artaud a voulu détruire une histoire, celle de la métaphysique dualiste qui inspirait plus ou moins souterrainement les essais évoqués plus haut : dualité de l’âme et du corps soutenant, en secret, bien sûr, celle de la parole et de l’existence, du texte et du corps [...]. Artaud a voulu interdire que sa parole loin de son corps lui fût soufflée [15].
Dès la parution du numéro de Tel Quel, Derrida reçoit un coup de téléphone de Paule Thévenin, la responsable de l’édition des oeuvres complètes, qu’il n’avait jamais rencontrée jusqu’alors. Elle tient à lui dire combien l’article l’a enthousiasmée. Elle le lui redit par une longue lettre, marquant toute l’importance que ce texte revêt à ses yeux :
Je vous en remercie parce que au fond c’est la presque première fois que quelque chose me parait m’être donné. Si j’excepte les articles de Blanchot, une ou deux phrases de Michel Foucault dans l’Histoire de la folie, j’avais depuis quinze ans l’impression de travailler dans le vide, de ne jamais trouver de réponse. Il est bien entendu que je ne fais pas d’identification. Simplement, je croyais que l’oeuvre d’Antonin Artaud était l’une des plus importantes de notre époque, qu’elle valait et bien au-delà le temps que je lui consacre, et jusqu’à présent je n’avais rencontré personne qui me dît que je ne me trompais pas. C’est en ce sens que je vous remercie, comme je remercie Philippe Sollers. Mais lui, je savais depuis longtemps ce qu’il pensait à ce sujet [16].
Ils ne tardent pas à se rencontrer et à se lier d’amitié. Dès lors, Paule Thévenin tient Derrida au courant de ses recherches et lui communique régulièrement des textes encore inédits d’Artaud. Elle a récupéré les papiers d’Artaud le jour même de sa mort, dans des circonstances controversées, et elle les décrypte avec autant de passion que de patience pour l’édition d’ ?uvres complètes qui ne cessent de prendre de l’ampleur.

Note. Fin 1965 Derrida publie De la grammatologie. Dans le numéro 24 de Tel Quel (hiver 1966), on peut lire une courte note de Sollers : « Dans les numéros de déc. 55 [sic] et janv. 66 de Critique un très important essai de Jacques Derrida De la grammatologie sur lequel nous ne serons assurément pas les seuls à revenir. » C’est François Wahl qui publie, dans La Quinzaine littéraire du 1er mai 1966, le premier article significatif — « L’écriture avant la parole ? » — sur l’essai de Derrida.
1966 : l’amitié
 Au début de l’été 1966, Derrida se sent abattu et comme hors de lui-même. Il éprouve un immense besoin de vacances et de retraite, tout en voulant consacrer ces mois sans enseignement il faire avancer les textes en chantier. Mais après quelques semaines de travail solitaire à Fresnes, puis un colloque « irrespirable » sur la mort et la tragédie dans les Dolomites, il est sur le point de craquer :
Au début de l’été 1966, Derrida se sent abattu et comme hors de lui-même. Il éprouve un immense besoin de vacances et de retraite, tout en voulant consacrer ces mois sans enseignement il faire avancer les textes en chantier. Mais après quelques semaines de travail solitaire à Fresnes, puis un colloque « irrespirable » sur la mort et la tragédie dans les Dolomites, il est sur le point de craquer :
« J’ai dû passer par une période d’épuisement "nerveux" à laquelle le "désespoir" n’est pas étranger. J’ai dû quitter Paris contre mes intentions, pour me reposer ici avec Marguerite, Pierre et deux neveux que mon beau-frère, malade, nous a confiés [17]. »
Parmi les choses qui le soutiennent, il y a l’amitié avec Philippe Sollers et la proximité avec Tel Quel ; cette revue permet à Derrida, dans des conditions de complicité très favorables, de faire tenir ensemble les questions philosophiques, anthropologiques et littéraires qui lui importent. Il est heureux que Sollers l’associe à son travail en lui donnant à lire en primeur ses articles « Sade dans le texte » et « Littérature et totalité ». Derrida les trouve « magnifiques », assurant que celui sur Mallarmé lui a « beaucoup appris ». Il en est sûr : avec ces deux textes et celui de Pleynet sur Lautréamont, « fort et juste » lui aussi, « le prochain Tel Quel va résonner, faire résonner. Ce sera le happening de l’automne. Car l’unité de tout ça est flagrante, déflagrante [18] ».
Du côté de Sollers, l’enthousiasme n’est pas moins grand. En cette année 1966, Derrida est pour lui le penseur majeur, celui qui permet de donner un cadre philosophique à la question de la « textualité ». À ses yeux, il devient urgent de rassembler ces articles qui sont pour lui une source « de réflexions sans fin » et de préparer un volume pour la collection « Tel Quel ». Il en est persuadé, seul un livre sera en mesure d’imposer une pensée aussi neuve. Souvent, Sollers a l’impression que Derrida dit quelque chose que personne ne comprend vraiment, « que personne ne peut comprendre » et qu’il a lui-même bien du mal « à rendre évident à autrui ». Cette résistance n’est pas étrangère à sa propre admiration, alors qu’il vient de se lancer dans l’aventure difficile d’une nouvelle fiction qui devrait s’intituler Nombres. Il voudrait faire imaginer à Derrida un texte « qui porterait ce que nous "pensons" au niveau du mythe, qui en serait la trace insensée... Je ne vous apprendrai rien, à vous, en disant (sans me plaindre) que c’est une drôle de marmite [19] ».

1967 : « De la grammatologie »
 Jean Piel [Directeur de la revue Critique fondée par Georges Bataille], qui apprécie de plus en plus Derrida, lui demande régulièrement son avis sur l’un ou l’autre article qu’on lui soumet pour Critique. Consulté à propos d’un des premiers textes d’Alain Badiou, un article sur Althusser, Derrida répond de manière franche et ouverte à la fois :
Jean Piel [Directeur de la revue Critique fondée par Georges Bataille], qui apprécie de plus en plus Derrida, lui demande régulièrement son avis sur l’un ou l’autre article qu’on lui soumet pour Critique. Consulté à propos d’un des premiers textes d’Alain Badiou, un article sur Althusser, Derrida répond de manière franche et ouverte à la fois :
Je viens de lire le texte de Badiou. Comme vous-même et comme Barthes, je le trouve au moins irritant par le ton, les airs que l’auteur s’y donne, les « notes » qu’il distribue à chacun comme au jour de l’inspection générale ou du jugement dernier. Il ne m’en paraît pas moins important. [...] Je ne crois pas qu’on puisse en douter, et je lui reconnais d’autant plus volontiers cette importance que je suis loin de me sentir « philosophiquement » prêt à le suivre dans ses cheminements ou ses conclusions [20].
De façon très naturelle, Piel propose bientôt à Derrida d’entrer au conseil de rédaction de la revue, aux côtés de Deguy, Barthes et Foucault. Les prises de décision restent informelles : les réunions ont souvent lieu chez Piel, à Neuilly, s’accompagnant d’un déjeuner ou d’un dîner. Mais si Critique ne veut afficher aucune « ligne », la revue est, ces années-là en tout cas, remarquablement vivante et en prise sur son temps. La collection de livres qui commence à l’accompagner, en 1967, accroîtra encore son rayonnement et son prestige. Même si la dactylographie du texte est plus longue et plus difficile que prévu, Derrida et Piel espèrent toujours voir paraître De la grammatologie avant l’été, en même temps que L’écriture et la différence dont Sollers prépare la publication aux éditions du Seuil dans la collection « Tel Quel ». Pour De la grammatologie, les questions de calendrier sont compliquées : l’ouvrage doit être imprimé d’ici le début du mois de mai, de façon à être remis officiellement aux trois membres du jury, mais sa sortie en librairie ne doit en aucun cas avoir lieu avant la soutenance, prévue en juin. Derrida avise bientôt Sollers que De la grammatologie ne pourra finalement paraître qu’en septembre. Il se demande s’il ne faudrait pas aussi retarder L’écriture et la différence, afin que les deux ouvrages ne soient pas séparés. Il craint un effet d’émiettement et redoute que les nombreux jeux de références d’un volume à l’autre ne tombent à plat. Pour lui, le mieux serait même de publier à la même date le « petit Husserl » dont il attend les épreuves :
« Je suis de plus en plus tenté de penser que tout le monde aurait tout intérêt à ce que tout sorte en septembre [21]. »
Tel n’est pas l’avis de Sollers : il préfère ne pas toucher à ce qui a été convenu et publier L’écriture et la différence dès le printemps.

1967 : une première anicroche
 Avec Philippe Sollers, la correspondance reste régulière et amicale. « Je pense toujours à vous, lui assure l’écrivain, comme à l’une des seules "instances" à qui j’ai envie de montrer ce qui passe par moi — et s’écrit [22]. » Derrida aurait voulu lui écrire plus tôt, mais le temps est passé très vite, entre « un peu d’étouffement familial, d’engourdissement général » et les « "Noces" renouvelées avec la Méditerranée ». « Dans le désoeuvrement où je suis, que je n’avais pas connu depuis de longs mois, un nouveau travail se fait peut-être en silence et de nouvelles mesures se prennent [23]. »
Avec Philippe Sollers, la correspondance reste régulière et amicale. « Je pense toujours à vous, lui assure l’écrivain, comme à l’une des seules "instances" à qui j’ai envie de montrer ce qui passe par moi — et s’écrit [22]. » Derrida aurait voulu lui écrire plus tôt, mais le temps est passé très vite, entre « un peu d’étouffement familial, d’engourdissement général » et les « "Noces" renouvelées avec la Méditerranée ». « Dans le désoeuvrement où je suis, que je n’avais pas connu depuis de longs mois, un nouveau travail se fait peut-être en silence et de nouvelles mesures se prennent [23]. »
Cet été-là, l’amitié de Sollers et Derrida va connaître une première anicroche, directement liée à une nouvelle venue : Julia Kristeva. Arrivée de Bulgarie en décembre 1965 pour poursuivre un doctorat de littérature comparée, Julia Kristeva a rencontré Goldmann, Genette et Barthes, et peu après Philippe Sollers. La beauté, l’intelligence et le charisme de la jeune femme, son prestige d’« étrangère [24] » font immédiatement sensation. Les nouvelles références qu’elle apporte — Mikhaïl Bakhtine, les formalistes russes —, les concepts qu’elle forge à vive allure — l’intertextualité, le paragrammatisme — lui permettent de s’imposer en quelques mois sur la scène intellectuelle parisienne, publiant d’abord dans la revue marxiste La Pensée, puis, dès le printemps 1967, dans Critique et dans Tel Quel. Au début, les relations de Julia Kristeva et de Derrida sont excellentes. Elle éprouve une vraie fascination pour la manière très neuve qu’a Derrida de relire Husserl. Et surtout, il lui paraît comme le seul philosophe capable de lier une phénoménologie déjà filtrée par la psychanalyse avec l’expérience littéraire [25]. Mais un premier incident survient bientôt : Sollers reproche vivement à Derrida d’avoir montré à François Wahl l’article de Julia Kristeva « Le Sens et la mode » (consacré au « Système de la mode » de Barthes) avant sa publication dans Critique. Comme Derrida s’avoue surpris et blessé par ce reproche, Sollers lui présente aussitôt ses excuses ; rien, dit-il, ne lui est plus insupportable que l’idée d’un malentendu entre eux. Mais il veut apporter quelques compléments d’information :
Kristeva : la question, ici, est plus grave que vous ne semblez l’imaginer. Il y a eu, au sujet de l’apparition, aussi soudaine que décisive, de cette pensée, bien des remous, bien des discussions, bien des petites choses. Je revois F. Wahl me disant que l’article sur Bahktine, paru dans Critique, c’était « délirant » ; je revois tel ou tel argument du fait que Miller et Badiou avaient prononcé une condamnation radicale du texte que Tel Quel a publié ; je revois tel psychanalyste se lancer dans une violente diatribe contre de tels écrits ; je revois se former, comme en éprouvette, tous les symptômes de ce qu’on appelait autrefois une cabale du plus bel effet [26].
La vérité, dissimulée dans cette lettre comme dans les rencontres des mois suivants, c’est que Derrida a été tenu dans l’ignorance d’une donnée essentielle : l’histoire d’amour de Julia Kristeva et Philippe Sollers, puis leur mariage dans la plus stricte intimité, le 2 août 1967. À cette époque, ils tiennent l’un comme l’autre au secret, sinon à la clandestinité [27].

1967 : « De la grammatologie » (suite)
 Le livre, qui était très attendu, vaut à son auteur un abondant courrier, Philippe Sollers, qui a lu le manuscrit complet dès l’été, l’a aussitôt qualifié de « texte décidément génial [28] ». Julia Kristeva est très touchée d’avoir reçu le livre dédicacé, en « signe de complicité » ; elle remercie Derrida de tout ce qu’elle doit déjà à son travail et de tout ce qu’elle continuera d’y puiser [29]. Bientôt, elle lui enverra une série de questions auxquelles il répondra longuement par écrit, sous le titre « Sémiologie et grammatologie [30] », Quant à Roland Barthes, c’est depuis Baltimore qu’il remercie chaleureusement Derrida : De la grammatologie est ici « comme un livre de Galilée en pays d’Inquisition, ou plus simplement un livre civilisé en Barbarie ! ». Une appréciation qui, rétrospectivement, ne manque pas de sel.
Le livre, qui était très attendu, vaut à son auteur un abondant courrier, Philippe Sollers, qui a lu le manuscrit complet dès l’été, l’a aussitôt qualifié de « texte décidément génial [28] ». Julia Kristeva est très touchée d’avoir reçu le livre dédicacé, en « signe de complicité » ; elle remercie Derrida de tout ce qu’elle doit déjà à son travail et de tout ce qu’elle continuera d’y puiser [29]. Bientôt, elle lui enverra une série de questions auxquelles il répondra longuement par écrit, sous le titre « Sémiologie et grammatologie [30] », Quant à Roland Barthes, c’est depuis Baltimore qu’il remercie chaleureusement Derrida : De la grammatologie est ici « comme un livre de Galilée en pays d’Inquisition, ou plus simplement un livre civilisé en Barbarie ! ». Une appréciation qui, rétrospectivement, ne manque pas de sel.

1968 : « Nombres »
 À la fin d’une soirée, Philippe Sollers a confié à Derrida les manuscrits de ses deux nouveaux livres, Logiques et Nombres. Derrida connaissait déjà la plupart des essais rassemblés dans Logiques, mais Nombres l’impressionne au plus haut point. Il ne tarde pas à s’immerger profondément dans « cette machine arithmétique et théâtrale », « cette numération implacable et ces semences en nombre innombrable [31] ». Très vite, il exprime le désir d’écrire quelque chose tout en mesurant la résistance particulière de cette étrange fiction, tout empreinte de réflexivité :
À la fin d’une soirée, Philippe Sollers a confié à Derrida les manuscrits de ses deux nouveaux livres, Logiques et Nombres. Derrida connaissait déjà la plupart des essais rassemblés dans Logiques, mais Nombres l’impressionne au plus haut point. Il ne tarde pas à s’immerger profondément dans « cette machine arithmétique et théâtrale », « cette numération implacable et ces semences en nombre innombrable [31] ». Très vite, il exprime le désir d’écrire quelque chose tout en mesurant la résistance particulière de cette étrange fiction, tout empreinte de réflexivité :
Je rêve d’un coup de génie — mais je n’ai pas de génie — ou d’écriture qui me permette de « m’y prendre » de telle sorte que, dans les dimensions d’un article, je puisse à la fois écrire un texte, maîtriser votre machine et cependant la donner à lire s’enroulant consumée. Je n’ai jamais eu de tâche aussi difficile, à la fois nécessaire et aventureuse. Et si j’en viens à bout, tout aura été dit, par vous d’abord, dans Nombres déjà et dans cette remarquable à tous égards interview de La Quinzaine [32].
lire la suite : 1968 : difficultés avec Jean-Pierre Faye

1968 : « Mai »
Photo Les Lettres françaises, 8 juin 1972 (archives A.G.)

 Dans un entretien avec François Ewald, Derrida reconnaîtra pour sa part qu’il n’a pas été « ce qu’on appelle un soixante-huitard » :
Dans un entretien avec François Ewald, Derrida reconnaîtra pour sa part qu’il n’a pas été « ce qu’on appelle un soixante-huitard » :
Bien que j’aie à ce moment-là participé aux défilés ou organisé la première assemblée générale du moment à la rue d’Ulm, j’étais réservé, inquiet même devant une certaine euphorie spontanéiste, fusionniste, anti-syndicaliste, devant l’enthousiasme de la parole enfin « libérée », de la « transparence » restaurée, etc. Je ne crois jamais à ces choses. (...) Je n’étais pas contre mais j’ai toujours du mal à vibrer à l’unisson. Je n’avais pas le sentiment de participer à un grand ébranlement. Mais je crois maintenant que dans cette liesse pour laquelle j’avais peu de goût, quelque chose d’autre arrivait [38].
Admettant qu’il entrait sans doute dans sa distance « une sorte d’héritage crypto-communiste », Derrida précisera son attitude à l’égard du mouvement étudiant dans ses entretiens avec Maurizio Ferraris :
Je n’ai pas dit non à « 68 » : j’ai défilé dans la rue, j’ai organisé la première assemblée générale de l’École normale, mais mon coeur n’était pas sur les barricades, à tort ou à raison. (...] Ce qui me gênait [...), ce n’était pas la spontanéité apparente à laquelle je ne crois pas, mais l’éloquence politique spontanéiste, l’appel à la transparence, à la communication sans relais et sans délais, la libération par rapport à toute sorte d’appareil parti ou syndicat. (...) Le spontanéisme, comme l’ouvriérisme, le paupérisme, me semblait une chose dont il fallait se méfier. Je ne dirais pas que j’ai bonne conscience à ce sujet et que ce soit si simple. Aujourd’hui [...), je serais plus prudent pour formuler cette critique du spontanéisme [39].
Derrida n’est pas le seul à ne pas avoir pris la pleine mesure des événements. Althusser, qui a poussé beaucoup de ses étudiants vers la radicalité politique et le maoïsme, est tout à fait désemparé par ce qui arrive : il passe le printemps et une partie de l’été enfermé dans une clinique. Robert Linhart, le fondateur de l’UJCml, entre en cure de sommeil, victime lui aussi de problèmes psychiques. Quant à Sollers, mai 1968 est le moment qu’il choisit pour s’aligner sur les positions du parti communiste, globalement très hostiles au mouvement étudiant : selon les textes collectifs qui paraissent dans le numéro d’été de Tel Quel, mai 1968 ne correspond qu’à l’émergence sans lendemain d’un gauchisme non marxiste, voire « contre-révolutionnaire ».

1968 : « Nombres » et « la dissémination »
 [...] Derrida songe à écrire un livre complet sur Platon, Mais dans l’immédiat, c’est surtout Nombres qui l’occupe. Son enthousiasme pour le roman de Sollers est toujours aussi intense et il regrette, après tous ces mois, de ne pas encore avoir achevé le texte qu’il veut lui consacrer :
[...] Derrida songe à écrire un livre complet sur Platon, Mais dans l’immédiat, c’est surtout Nombres qui l’occupe. Son enthousiasme pour le roman de Sollers est toujours aussi intense et il regrette, après tous ces mois, de ne pas encore avoir achevé le texte qu’il veut lui consacrer :
Ce livre est extraordinaire et je ne me sens pas de taille à m’y mesurer, surtout dans un "article". "La dissémination" avance néanmoins, elle est déjà trop longue et, comme je le prévoyais, il faudra se résoudre à deux livraisons de Critique [40]
Après avoir lu cet article, presque aussi long que la fiction qui l’inspire, Sollers remerciera une nouvelle fois Derrida, si dérisoire que cela puisse sembler après un tel cadeau « J’insiste pour une raison simple : vous me permettrez, si j’en ai la force, d’avancer plus loin dans l’obscurité. Ce que vous m’apportez est vraiment une aide insensée et inespérée [41]. »
La réalité est plus ambiguë. Car ce moment d’extrême proximité marque aussi une forme subtile de rivalité entre la fiction et son commentaire. Mêlant de manière quasi indissociable son propre texte et celui de Sollers, le philosophe a pu donner à l’écrivain le sentiment d’une « osmose carnivore [42] ». La parade ne tardera pas.
Tchécoslovaquie :
- On lit dans TQ 47 (automne 1971) :
« L’analyse est que l’intervention soviétique est exploitée par la droite et, précisément, par l’opposition à Tel Quel (c’est-à-dire par ceux qui s’opposent à Tel Quel sur le plan de sa pratique spécifique pour des raisons réactionnaires spécifiques au champ de notre pratique). Le combat qui prime les autres est celui de la consolidation du groupe et de la revue. Silence. Positions "étroites". Incompréhension des positions chinoises d’alors (justes). Doctrine de "l’unité du camp anti-impérialiste" avant tout, etc. »
Au début du mois d’août, Derrida rejoint Marguerite et les enfants aux Rassats. Très désireux de revoir Sollers et Krisleva au calme, après « toutes les secousses et tous les silences » qui les ont tenus éloignés depuis le printemps, il profite de ce bref séjour en Charente pour aller passer une journée en leur compagnie, à l’île de Ré. Mais peu après cette rencontre, un nouvel événement va secouer leurs relations. Le 20 août, les troupes du pacte de Varsovie envahissent la Tchécoslovaquie pour mettre fin au « Printemps de Prague ». Si Aragon et Les Lettres françaises prennent clairement parti contre l’intervention soviétique, les telqueliens campent sur une ligne plus dure et s’y disent plutôt favorables. Sollers l’écrit à son ami Jacques Henric : « Il ne faut pas compter sur moi pour désarmer, ne fût-ce qu’une seconde, l’armée Rouge (sans parler des tanks bulgares pour lesquels j’éprouve même une coupable passion). Les relents d’humanisme sordidement intéressés qui se développent achèvent de m’exaspérer [43]. » Lors d’un dîner, Paule Thévenin elle-même se lance « dans une violente diatribe, dénonçant les contre-révolutionnaires tchèques et faisant l’éloge de l’Union soviétique », ce qui jette un sérieux froid [44]. On s’en doute : Marguerite Derrida, dont la famille maternelle vit à Prague, porte sur la situation un regard pour le moins différent.

lire la suite ; 1968 encore : des États-Unis

1968-1969 : le « G.E.T. » de Tel Quel.
« Nombres », « L’engendrement de la formule », « La dissémination »
 À la rentrée 1968, tandis que Derrida se trouvait à Baltimore, a commencé une série de conférences que le « Groupe d’études théoriques » de Tel Quel organise au c ?ur de Saint-Germain-des-Prés. Ces soirées, qui s’inscrivent dans le sillage encore brûlant des événements de Mai, attirent énormément de monde. C’est Philippe Sollers qui ouvre le cycle, le 16 octobre. Les deux séances suivantes sont assurées par Jean-Joseph Goux, un jeune chercheur que Derrida apprécie beaucoup depuis la publication dans Tel Quel de « Marx et l’inscription du travail » et de « Numismatiques ».
À la rentrée 1968, tandis que Derrida se trouvait à Baltimore, a commencé une série de conférences que le « Groupe d’études théoriques » de Tel Quel organise au c ?ur de Saint-Germain-des-Prés. Ces soirées, qui s’inscrivent dans le sillage encore brûlant des événements de Mai, attirent énormément de monde. C’est Philippe Sollers qui ouvre le cycle, le 16 octobre. Les deux séances suivantes sont assurées par Jean-Joseph Goux, un jeune chercheur que Derrida apprécie beaucoup depuis la publication dans Tel Quel de « Marx et l’inscription du travail » et de « Numismatiques ».
Fasciné par De la grammatologie, Goux étend audacieusement la pensée derridienne à plusieurs nouveaux champs. « C’est ce que j’ai lu de plus intéressant sur Marx », lui a dit Derrida après la publication de son premier article. Et s’il n’a pu assister à la double conférence « Or, père, phallus, langue », c’est avec le plus vif intérêt qu’il prend connaissance de ce texte [46]. Goux incarne à merveille l’esprit du volume collectif Théorie d’ensemble que « Tel Quel » publie à ce moment : il s’agit de transcender les disciplines traditionnelles pour construire, sinon une unification, au moins de vraies passerelles entre le marxisme le plus radical, un freudisme revu par Lacan et la théorie de l’écriture [47]. Il n’est sans doute pas abusif de voir une sorte d’inflexion « gouxo-derridienne » dans un concept comme le phallogocentrisme que Derrida va préférer de plus en plus à celui de logocentrisme, dès le début des années 1970.
VOIR SUR PILEFACE
-
Jean-Michel Lou, L’emprise des signes
En janvier 1969, quelques semaines après le retour en France de Derrida, trois soirées du Groupe d’études théoriques sont consacrées à « L’engendrement de la formule » par Julia Kristeva. Il s’agit d’une lecture de Nombres de Sollers, aussi ample que « La dissémination » de Derrida qui parait presque au même moment dans Critique, en deux livraisons [48]. Mais la perspective de Kristeva, distinguant géno-texte et phéno-texte pour mettre en place une « sémanalyse », est très différente de celle de Derrida. « À propos de Nombres, reconnait aujourd’hui Sollers, on peut dire qu’il y a eu une compétition théorique entre Derrida et Kristeva [49]. » Telle est aussi l’impression de Goux, qui était alors proche des trois protagonistes :
« Il y a sans doute eu une crainte de Sollers que l’empreinte de Derrida sur Tel Quel et sur son propre travail ne devienne trop forte. Par-delà l’hommage, il a dû lire son immense article sur Nombres comme une tentative d’appropriation. Sollers a été flatté et effrayé à la fois par ce texte qui était bien plus qu’un commentaire. Et le prestige grandissant de Derrida a dû lui paraître dangereux, à un moment où il s’agissait surtout de favoriser l’ascension de Julia Kristeva comme théoricienne principale de la revue [50]. »
Mais dans l’immédiat, le conflit demeure feutré, sinon virtuel, et tout semble se passer pour le mieux.
Le 26 février et le 5 mars 1969, Derrida présente devant une salle comble une conférence qui ne s’annonce sous aucun intitulé, mais sera publiée dans Tel Quel sous le titre « La double séance ». Au fil des ans, Derrida a pris beaucoup d’assurance : ce qu’il propose pendant ces deux soirées relève de la performance plus que du discours classique. Comme le lui écrira peu après Catherine Clément :
Ce que vous faites tient de l’incantation, et s’en différencie par l’appel à l’écriture ; du mime, et s’en différencie par le non-représentable ; de l’opéra-alliance voix-geste-corps-décor et s’en différencie par l’absence de distance ; du clown [...], et s’en différencie par l’indifférence entre les signifiants : aucun n’est privilégié pour être plus fécond en dé/lecture qu’un autre [51].
L’"affaire" Lacan (2)
« Dans les années 1970, la normalisation bat son plein, elle ne deviendra définitive que dans les années 1980, avec l’arrivée de Mitterrand au pouvoir. On admet Foucault et Barthes au Collège de France, mais Lacan, lui, est chassé de l’Ecole normale par des CRS, l’arme au pied. J’occupe, avec quelques amis, le bureau du directeur, il faut vite dégager la place. J’accompagne Lacan dans sa grande solitude d’alors (personne ne veut prendre sa défense, il est atterré par une lettre de Lévi-Strauss qui lui dit « voilà, cher ami, ce qui arrive quand on manque aux usages »). Je le revois téléphoner partout, impossible d’obtenir un article. Ah, vous vouliez danser sur l’inconscient sexuel ? Comploteur ! Fauteur de troubles ! Socrate fâcheux ! Avouez que votre public venait de n’importe où, pas de vrais étudiants, des têtes d’orgies, trop de femmes... Quant à vos disciples, on les connaît, ils sont « maoïstes », ils risqueraient d’empêcher la remise en ordre de l’Université où le parti communiste, à ce moment-là, occupe une position centrale. Tenez, il y a un endroit pour surveiller les plus enragés : Vincennes. Les alliés de cette technique de reprise de pouvoir ? Althusser et Derrida, trop contents de récupérer leurs locaux et leur influence. Althusser est déjà très fou, j’essaie en vain de lui dire que les électrochocs n’amélioreront pas son état, on connaît la suite. Derrida, lui, se faufile, déteste Lacan, et ne voit pas d’inconvénient à ce que les communistes assurent la sécurité générale. Et voilà comment on se retrouve, Lacan et moi, invités par Françoise Giroud dans une salle à manger de L’Express. Elle est charmante avec lui (bon souvenir de divan), il aura son article de magazine. »
Un vrai roman, folio, p. 152.
1969 : l’"affaire" Lacan (1)
 Rue d’Ulm, un départ va agiter les esprits, plus encore que celui du général [De Gaulle] : celui de Jacques Lacan. Depuis 1964, tous les mercredis peu avant midi, les trottoirs de la rue d’Ulm sont envahis de voitures de luxe et de jolies femmes. Lacan lui-même arrive dans son coupé Mercedes 300 SL. avant d’entrer dans la salle Dussane où une foule compacte s’entasse pour assister à son séminaire. On y fume d’autant plus que le maître lui-même ne s’en prive pas ; la fumée est si dense qu’elle passe à travers le plafond et envahit l’étage supérieur, suscitant des plaintes régulières. Aux yeux du directeur de l’École, Lacan n’est qu’un conférencier mondain doublé d’un facteur de désordre. Depuis un bon moment, il cherche un prétexte pour se débarrasser de lui. Dominique Lecourt s’en souvient :
Rue d’Ulm, un départ va agiter les esprits, plus encore que celui du général [De Gaulle] : celui de Jacques Lacan. Depuis 1964, tous les mercredis peu avant midi, les trottoirs de la rue d’Ulm sont envahis de voitures de luxe et de jolies femmes. Lacan lui-même arrive dans son coupé Mercedes 300 SL. avant d’entrer dans la salle Dussane où une foule compacte s’entasse pour assister à son séminaire. On y fume d’autant plus que le maître lui-même ne s’en prive pas ; la fumée est si dense qu’elle passe à travers le plafond et envahit l’étage supérieur, suscitant des plaintes régulières. Aux yeux du directeur de l’École, Lacan n’est qu’un conférencier mondain doublé d’un facteur de désordre. Depuis un bon moment, il cherche un prétexte pour se débarrasser de lui. Dominique Lecourt s’en souvient :
« Un matin de 1969. Robert Flacelière m’a convoqué dans son bureau, ce qui n’était pas courant, et m’a dit : "M. Lecourt, vous qui êtes philosophe, j’ai vu que vous aviez assisté à la leçon de Lacan sur la vérité et j’aimerais savoir ce que vous en pensez... À votre avis, c’est du sérieux ? Personnellement, toutes ces histoires de phallus, je trouve ça obscène... Je vous interroge parce que M. Derrida et M. Althusser me disent que c’est sérieux." La scène était ubuesque. J’essayais d’argumenter, ignorant qu’il avait déjà décidé de le chasser. Flacelière trouvait que ces mondanités et ces provocations n’avaient rien à voir avec les missions de l’École. Mais quand il a voulu passer à l’acte et mettre Lacan à la porte, cela a créé beaucoup d’agitation [52]. »
Le 26 juin 1969, Lacan rend publique la lettre d’exclusion que lui a envoyée « Flatulencière » : une nouvelle fois, il se sent traité comme un proscrit. Aussitôt après la fin de la séance, plusieurs fidèles auditeurs, dont l’artiste Jean-Jacques Lebel, Philippe Sollers, Julia Kristeva et Antoinette Fouque — figure majeure du féminisme français — improvisent une occupation du bureau du directeur. La situation s’envenime rapidement : Philippe Castellin — qui a déjà conduit la fronde contre Jean Beaufret, l’automne précédent — se met à fumer les cigares de Flacelière avant de le gifler [53]. Sollers se contente pour sa part d’emporter une pile de papier à en-tête, dont il se servira avec jubilation pendant les mois suivants. Toute cette affaire est pourtant loin d’être anecdotique.

- Séminaire de Lacan (1971)
« La question de Lacan a contribué à m’éloigner de Derrida, reconnaît Sollers. Comme Althusser, il restait à certains égards un homme d’institution. L’un comme l’autre, ils n’ont soutenu Lacan que mollement, alors qu’il était à cette époque dans une solitude effrayante, lâché par sa fille Judith comme par son gendre. C’est le moment où j’ai commencé à me rapprocher de lui [54]. »

1969 : nouvelles difficultés avec J.-P. Faye
 En France, la période est marquée par plusieurs polémiques, devenues quelque peu obscures. Maintenant que le parti communiste a perdu l’essentiel de son prestige et de son poids, il est difficile de se représenter son importance dans l’immédiat après-68, au moment où beaucoup de jeunes intellectuels choisissent de rejoindre le PC pour contrer la pression gauchiste. Alors rédacteur en chef de La Nouvelle Critique et membre du Comité central depuis 1970, Antoine Casanova reconnaît qu’il est aujourd’hui presque impossible de comprendre « les avancées, limites, opacités et difficultés à s’extraire des cadres antérieurs de pensée, d’action, de raisonnements » qui occupent alors les communistes 20. Loin d’être monolithique, le Parti est traversé par de nombreux courants intellectuels, qui s’affrontent autour d’enjeux parfois étranges.
En France, la période est marquée par plusieurs polémiques, devenues quelque peu obscures. Maintenant que le parti communiste a perdu l’essentiel de son prestige et de son poids, il est difficile de se représenter son importance dans l’immédiat après-68, au moment où beaucoup de jeunes intellectuels choisissent de rejoindre le PC pour contrer la pression gauchiste. Alors rédacteur en chef de La Nouvelle Critique et membre du Comité central depuis 1970, Antoine Casanova reconnaît qu’il est aujourd’hui presque impossible de comprendre « les avancées, limites, opacités et difficultés à s’extraire des cadres antérieurs de pensée, d’action, de raisonnements » qui occupent alors les communistes 20. Loin d’être monolithique, le Parti est traversé par de nombreux courants intellectuels, qui s’affrontent autour d’enjeux parfois étranges.
Le 12 septembre 1969, L’Humanité publie un long article de Jean-Pierre Faye intitulé « Le camarade Mallarmé ». Même si Sollers et Tel Quel sont ses cibles principales, Faye s’en prend implicitement à Derrida. Il proteste avec vigueur contre l’idée que toute l’histoire de l’Occident serait fondée sur « l’"abaissement" de l’écriture, son refoulement par la parole ». À l’en croire, certains en viendraient même « très sérieusement à assimiler la parole à la bourgeoisie et l’écriture au prolétariat ». Faye ne se contente pas de cette caricature. À coup de références cryptées à Heidegger et à la notion de mythos, il essaie de jeter le soupçon politique sur Derrida, suggérant un lien entre son travail et la « révolution rétrograde » qui porta Hitler au pouvoir.
Derrida se garde bien de réagir. Mais la semaine suivante, une double réponse paraît dans L’Humanité. L’une est due à Claude Prévost, membre du comité de rédaction de La Nouvelle Critique. L’autre à Philippe Sollers :
Faisant allusion à la théorie de l’écriture que nous pensons scientifiquement fondée par le livre inaugural de Jacques Derrida, De la grammatologie (1967), M. Faye, qui n’en retient d’ailleurs qu’un aspect très fragmentaire interprété à contresens, affirme péremptoirement qu’il s’agit là de la continuation d’une idéologie nazie. Cette proposition est d’une extrême gravité. Non seulement Derrida critique Heidegger en plusieurs endroits, mais insinuer que ce travail puisse avoir le moindre point commun avec le nazisme, c’est de la diffamation. Visant à la fois Derrida à travers Tel Quel et Tel Quel à travers Derrida, M. Faye prétend (toujours par insinuation) que nous aurions « assimilé la parole à la bourgeoisie et l’écriture au prolétariat » ; que nous soutiendrions que « l’histoire n’aurait cessé de reculer en Occident », etc. Or de tels énoncés seraient rigoureusement introuvables, tant chez Derrida que dans Tel Quel [55].
De manière assez curieuse, Jean-Pierre Faye écrit à Derrida que les propos qui lui sont attribués, le concernant, « constituent un mensonge grossier. Ceux qui l’ont avancé en portent la responsabilité. Quant à moi, je dirai clairement, et publiquement, que votre nom n’a pas à être mêlé à tout cela, et sur ce ton. Je dirai également l’estime et l’admiration que j’ai pour votre démarche, vous ne l’ignorez pas, depuis plusieurs années ». Il aimerait d’ailleurs avoir avec lui « cette conversation amicale » projetée depuis plusieurs mois. Faye demande toutefois à Derrida, « provisoirement » et « pour éviter toute déformation nouvelle », de ne pas faire état de cette lettre [56]. Le 10 octobre, il fait paraître dans L’Humanité une « mise au point » où il assure n’avoir qu’estime et admiration pour Derrida et sa pensée.
Cela n’empêche pas la polémique de se prolonger dans Tel Quel et dans Change, en s’envenimant de plus en plus. Dans La Gazette de Lausanne, Faye, qui travaille depuis quelque temps sur les racines philosophiques du nazisme, attaque Derrida de manière explicite, affirmant qu’il y a dans sa démarche « une sorte de point aveugle marqué par l’influence de la philosophie de Heidegger et par ce qui en elle précisément est un point aveugle déjà, une tache idéologique provenant de ce qu’il y a de plus régressif dans l’idéologie allemande de l’entre-deux-guerres [57] ». Désormais, les liens entre Derrida et Faye ne cesseront plus d’être conflictuels, ce qui aura des conséquences non négligeables, une bonne dizaine d’années plus tard.
 (p.266-268) [58]
(p.266-268) [58]
avril 1970. Le colloque de Cluny II : « Littérature et idéologies »
 A l’occasion de ces sombres affaires, Derrida s’est rapproché de Jean-Louis Houdebine. Membre du parti communiste, animateur de la revue Promesse et ami de Sollers et de Julia Kristeva, il publie régulièrement dans La Nouvelle Critique, soucieux de l’ouvrir davantage à la modernité. La tâche n’est pas toujours simple : alors que se prépare une nouvelle rencontre à Cluny, Houdebine écrit à Derrida combien « l’occultation, le refoulement » de son discours restent importants au sein du Parti. « Cela tient il des résistances très profondes, très difficiles à vaincre », dont Sollers l’a averti [59].
A l’occasion de ces sombres affaires, Derrida s’est rapproché de Jean-Louis Houdebine. Membre du parti communiste, animateur de la revue Promesse et ami de Sollers et de Julia Kristeva, il publie régulièrement dans La Nouvelle Critique, soucieux de l’ouvrir davantage à la modernité. La tâche n’est pas toujours simple : alors que se prépare une nouvelle rencontre à Cluny, Houdebine écrit à Derrida combien « l’occultation, le refoulement » de son discours restent importants au sein du Parti. « Cela tient il des résistances très profondes, très difficiles à vaincre », dont Sollers l’a averti [59].
Le deuxième colloque de Cluny, qui se tient du 2 au 4 avril 1970, a pour thème « Littérature et idéologies ». Derrida n’y participe pas plus qu’au premier, mais il est souvent question de son travail dans cette rencontre qui voit s’affronter avec une grande violence Tel Quel et Action poétique, la revue d’Henri Deluy, liée au PC elle aussi mais beaucoup plus éclectique. Les tensions sont si palpables que l’un des participants s’évanouit. La jeune linguiste Mitsou Ronat, amie intime de Jean-Pierre Faye, est chargée d’attaquer Julia Kristeva et le fait de manière virulente. Élisabeth Roudinesco s’en prend pour sa part à Derrida, comparant son travail à celui de Jung, ce qui le laissera pantois.
Élisabeth Roudinesco a gardé un souvenir précis de ces affrontements : « Le soir, les telqueliens se sont plaints auprès des organisateurs de la violence des attaques. Mitsou Ronat et moi-même, nous avons reçu un blâme et avons dû négocier pendant une bonne partie de la nuit pour qu’il ne soit pas rendu public. Christine Buci-Glucksmann et Catherine Clément ont été désignées pour nous répondre le lendemain. En apparence, nous étions minoritaires, mais en réalité Tel Quel avait perdu la bataille pour le contrôle intellectuel et littéraire du Parti. Ils auraient voulu imposer une "ligne", une théorie unique et rigide, chose dont ne nous voulions absolument pas. C’est en bonne partie à cause de cet échec que Sollers s’est radicalisé vers le maoïsme l’année suivante [60]. »
Même s’il arrive qu’elles le mettent en cause, ces querelles ne sont pas vraiment celles de Derrida et restent très éloignées des questions qui le passionnent.

1971 : Marx ou pas ?
 Comme bon nombre de ses contemporains, Gérard Granel a vécu une grande crise intellectuelle depuis mai 1968. Lui qui semblait jusqu’alors se soucier assez peu de la politique la place désormais à l’avant-plan. Il adresse à Derrida les textes qu’il a récemment publies et l’interroge sur plusieurs points. à commencer par « l’énigme de son mutisme sur Marx ». Il n’est certes pas le premier à le faire, mais il est le seul auquel Derrida prend la peine de répondre aussi longuement que franchement. « Si j’avais vu où se tient le "principal" chez Marx et dans tout ce qui est en jeu sous son nom, si j’avais pu faire de tout ce champ une lecture qui ne fût pas en régression par rapport à ce que "je" tente ailleurs [...], j’aurais pris la parole sur Marx », écrit-il à Granel [61].
Comme bon nombre de ses contemporains, Gérard Granel a vécu une grande crise intellectuelle depuis mai 1968. Lui qui semblait jusqu’alors se soucier assez peu de la politique la place désormais à l’avant-plan. Il adresse à Derrida les textes qu’il a récemment publies et l’interroge sur plusieurs points. à commencer par « l’énigme de son mutisme sur Marx ». Il n’est certes pas le premier à le faire, mais il est le seul auquel Derrida prend la peine de répondre aussi longuement que franchement. « Si j’avais vu où se tient le "principal" chez Marx et dans tout ce qui est en jeu sous son nom, si j’avais pu faire de tout ce champ une lecture qui ne fût pas en régression par rapport à ce que "je" tente ailleurs [...], j’aurais pris la parole sur Marx », écrit-il à Granel [61].
[...] Reconnaissant que son attitude « peut donner à tort le sentiment d’un apolitisme, ou plutôt d’une "apraxie" », Derrida achève cette longue lettre par une quasi annonce de ce qui, vingt-deux ans plus tard, deviendra Spectres de Marx :
Je n’en sortirai, de ce silence, que quand j’aurai fait le travail. Et le travail, je le pressens, connaissant ma manière et mes rythmes, ne donnera jamais lieu il une « conversion », mais à des incisions obliques, à des déplacements de biais, suivant telle ou telle veine inaperçue du texte marxiste ou de la « révolution » dont il est le discours. [...] En attendant, que faire d’autre que de travailler dans la limite de la rigueur dont on est capable [...] et d’agir « à gauche » chaque fois qu’on le peut, dans le champ qu’on perçoit ou domine, quand la situation est assez claire pour cela, sans se faire grande illusion sur la portée microscopique d’une telle « action ».
« Agir "à gauche" chaque fois qu’on le peut » : telle est, dès cette époque, la ligne de conduite de Jacques Derrida, injustement accusé par certains de ne s’être engagé que sur le tard [...]

1971 : « Positions »
J.-L. Houdebine
Métro Parmentier, une terrasse en plein soleil. Jean-Louis Houdebine : un acteur secondaire de l’histoire intellectuelle — et qui sait l’être. Mais plusieurs années durant, il s’est trouvé au carrefour d’événements importants, assurant le lien entre le PCF, le groupe Tel Quel, Derrida et quelques autres. S’étant volontairement aligné sur les positions des « telqueliens » , avec sa revue Promesse, il a joué dans certains événements de la période 1968-1973 le rôle d’un « commissaire du peuple » (l’expression est de lui). Pour suivre Sollers, Houdebine me raconte avoir rompu en 1972 avec « le Parti » et tout son entourage à Poitiers. Il a changé de vie, d’amis, de femme, et n’en garde aucune amertume, bien au contraire. Mais il reste choqué d’être apparu dans Les Samouraïs, le roman à clés de Julia Kristeva, comme un passionné de karaté plutôt que de judo. « Il faut vraiment ne rien y connaître pour confondre les deux, me dit-il. Ce détail me semble révélateur de bien d’autres approximations. »
[...] Houdebine me rappelle. Il a retrouvé la dédicace de Derrida dans le livre Positions et rient à me la lire : « À Jean-Louis Houdebine, ces marges partagées. » J’aime ces effets d’après-coup. C’est comme si j’avais réveillé la machine à souvenirs.
B. Peeters, Trois jours avec Derrida, p.58-59.
 [...] Dans l’immédiate proximité de Derrida, certains sont encore plus impatients que Gérard Granel de le faire réagir sur les questions théoriques qui leur semblent les plus brûlantes, à commencer par celle du marxisme-léninisme. C’est le cas de Jean-Louis Houdebine et Guy Scarpetta, les animateurs de Promesse. À l’origine, il s’agissait d’une revue de poésie de Poitiers, mais Houdebine et Scarpetta l’ont transformée peu à peu en satellite de Tel Quel. Lorsqu’en mai 1971 ils demandent à Derrida de réaliser un entretien de fond avec lui, l’auteur de « La double séance » sait d’emblée à quoi s’en tenir. « Quelle situation idéologique depuis quelques mois ! Et quelle violence dans les affrontements », lui a récemment écrit Houdebine [62]. À cette violence, Derrida accepte de se confronter. L’entretien a lieu dans son bureau de Normale Sup l’après-midi du 11 juin 1971 [63]. Même si la discussion est serrée, le ton reste des plus courtois. Tant Houdebine que Scarpetta ont une grande admiration pour lui. Et Derrida, qui dit avoir accepté pour la première fois « la loi de l’entretien et du mode déclaratif », n’a pas l’intention de se dérober.
[...] Dans l’immédiate proximité de Derrida, certains sont encore plus impatients que Gérard Granel de le faire réagir sur les questions théoriques qui leur semblent les plus brûlantes, à commencer par celle du marxisme-léninisme. C’est le cas de Jean-Louis Houdebine et Guy Scarpetta, les animateurs de Promesse. À l’origine, il s’agissait d’une revue de poésie de Poitiers, mais Houdebine et Scarpetta l’ont transformée peu à peu en satellite de Tel Quel. Lorsqu’en mai 1971 ils demandent à Derrida de réaliser un entretien de fond avec lui, l’auteur de « La double séance » sait d’emblée à quoi s’en tenir. « Quelle situation idéologique depuis quelques mois ! Et quelle violence dans les affrontements », lui a récemment écrit Houdebine [62]. À cette violence, Derrida accepte de se confronter. L’entretien a lieu dans son bureau de Normale Sup l’après-midi du 11 juin 1971 [63]. Même si la discussion est serrée, le ton reste des plus courtois. Tant Houdebine que Scarpetta ont une grande admiration pour lui. Et Derrida, qui dit avoir accepté pour la première fois « la loi de l’entretien et du mode déclaratif », n’a pas l’intention de se dérober.
S’il n’a pas réagi publiquement depuis les attaques de Jean-Pierre Faye et d’Élisabeth Roudinesco, il le fait ici avec netteté, de manière vive et parfois ironique. Tout en réaffirmant son soutien à Tel Quel et à Sollers, il refuse de se laisser enrôler sous la bannière du matérialisme dialectique, assurant qu’il n’y aurait « aucun bénéfice, théorique ou politique, à précipiter les contacts ou les articulations tant que les conditions n’en sont pas rigoureusement élucidées ». Entre le travail de déconstruction qui est le sien et la conceptualité marxiste, « l’ajointement ne peut pas être immédiatement donné [64] ». Ce qui lui a paru « nécessaire et urgent », dans la situation historique qui est la leur, « c’est une détermination générale des conditions d’émergence et des limites de la philosophie, de la métaphysique ». Répondant implicitement à Faye, Derrida maintient que le texte de Heidegger est pour lui d’une extrême importance, « qu’il constitue une avancée inédite, irréversible et qu’on est encore très loin d’en avoir exploité toutes les ressources critiques ». Cela ne l’empêche pas d’avoir marqué, « dans tous les essais » qu’il a publiés, « un écart par rapport à la problématique heideggérienne [65] ».
Le lendemain, Houdebine remercie chaleureusement Derrida de sa patience à répondre à leurs questions. Mais quelques jours plus tard, lorsqu’il rend compte à Sollers de l’entretien, il évoque « une position plus défensive qu’offensive », beaucoup de « précautions » et de « prudence [66] ». Les choses sont loin d’être terminées. Le 1er juillet, Houdebine envoie à Derrida la transcription, l’accompagnant d’une lettre d’inspiration très léniniste, dont une partie sera reprise à la suite de l’entretien. Quant à Derrida, il ne se contente pas de revoir minutieusement ses propos : il ajoute une très longue note d’une extrême vigueur à propos de Lacan, un autre sujet sur lequel « certains de [s]es amis, pour des raisons parfois contradictoires, ont regretté [s]a neutralité ».
Dans les textes que j’ai publiés jusqu’ici, l’absence de référence à Lacan est en effet presque totale. Cela ne se justifie pas seulement par les agressions en forme ou en vue de réappropriation que, depuis la parution de De la grammatologie dans Critique (1965) (et même plus précocement, me dit-on), Lacan a multipliées, directement ou indirectement, en privé ou en public, dans ses séminaires et, depuis cette date, je devais le constater moi-même, dans presque chacun de ses écrits. [...] Cette crispation du discours — que j’ai regrettée — n’était pas insignifiante et elle appelait, là aussi, une écoute silencieuse [67].
Lorsque Derrida a écrit ses premiers articles, déclare-t-il, il ne connaissait encore que deux ou trois textes de Lacan, même s’il était déjà « assuré de l’importance de cette problématique dans le champ de la psychanalyse ». Depuis, en lisant minutieusement les Écrits, Derrida assure y avoir repéré quelques motifs majeurs, parmi ceux qu’il s’efforce lui-même de mettre en question : « un telos de la parole pleine dans son lien essentiel [...] avec la Vérité », « une référence allègre à l’autorité de la phonologie et plus précisément de la linguistique saussurienne », doublée d’une absence d’interrogation spécifique quant « au concept d’écriture ». Il annonce qu’il s’est beaucoup intéressé au « Séminaire sur La Lettre volée » et y reviendra bientôt [68]. Ce qu’il fera effectivement dès le mois de novembre 1971, lors d’une conférence à l’université Johns Hopkins de Baltimore, sans doute reprise à Yale [69]. Le 30 juillet, Houdebine accuse réception de l’entretien corrigé et complété. L’ensemble constitue selon lui « un texte important, une série de marques très productives dans le champ idéologique de la rentrée » ; il ne doute pas qu’il va « faire quelque bruit [70] ». Derrida insiste pour que le texte ne soit montré à personne avant la parution du numéro, prévue pour le mois de novembre. Cela n’empêchera pas Houdebine d’évoquer en détail le contenu de l’entretien — note sur Lacan comprise — lors d’une rencontre avec Sollers et Julia Kristeva à l’île de Ré.

« 1971 : De la Chine »
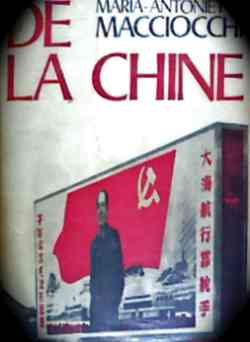
- 1ère édition
 La « rentrée » s’annonce effectivement empreinte de radicalité. Du côté de Tel Quel, la pression maoïste se fait de plus en plus insistante. Au mois de juin 1971, Sollers a fait publier au Seuil De la Chine, le reportage plus qu’enthousiaste d’une amie d’Althusser, Maria Antonietta Macciocchi. Mal à l’aise, Derrida a demandé à son vieil ami Lucien Bianco ce qu’il en pensait. L’auteur d’Aux origines de la révolution chinoise ne lui a pas caché son exaspération face à cette lourde propagande pour une Révolution culturelle dont les Européens veulent ignorer la sanglante brutalité. Comme Derrida le dira dans un texte tardif, la fréquentation de Bianco l’a très tôt mis en garde contre « la terreur obscurantiste qui bavardait alors dans certains quartiers », surtout « au moment où les sommeils dogmatiques les plus inquiétants, les plus menaçants, parfois les plus comiques aussi dominaient la scène d’une certaine "culture" parisienne [71] ». Pour l’heure, il évite de son mieux le sujet. Malgré les durcissements politiques, le dialogue avec Sollers reste très amical, tout comme avec Julia Kristeva qui vient de faire son entrée officielle au comité de rédaction de la revue [72]. La sortie de La dissémination se prépare et il semble aller de soi que Derrida participera l’été suivant au colloque « Artaud / Bataille » que Tel Quel organise à Cerisy.
La « rentrée » s’annonce effectivement empreinte de radicalité. Du côté de Tel Quel, la pression maoïste se fait de plus en plus insistante. Au mois de juin 1971, Sollers a fait publier au Seuil De la Chine, le reportage plus qu’enthousiaste d’une amie d’Althusser, Maria Antonietta Macciocchi. Mal à l’aise, Derrida a demandé à son vieil ami Lucien Bianco ce qu’il en pensait. L’auteur d’Aux origines de la révolution chinoise ne lui a pas caché son exaspération face à cette lourde propagande pour une Révolution culturelle dont les Européens veulent ignorer la sanglante brutalité. Comme Derrida le dira dans un texte tardif, la fréquentation de Bianco l’a très tôt mis en garde contre « la terreur obscurantiste qui bavardait alors dans certains quartiers », surtout « au moment où les sommeils dogmatiques les plus inquiétants, les plus menaçants, parfois les plus comiques aussi dominaient la scène d’une certaine "culture" parisienne [71] ». Pour l’heure, il évite de son mieux le sujet. Malgré les durcissements politiques, le dialogue avec Sollers reste très amical, tout comme avec Julia Kristeva qui vient de faire son entrée officielle au comité de rédaction de la revue [72]. La sortie de La dissémination se prépare et il semble aller de soi que Derrida participera l’été suivant au colloque « Artaud / Bataille » que Tel Quel organise à Cerisy.
Il n’empêche : comme en 1968, partir aux États-Unis est à bien des égards un soulagement. [...]
[...] Tout au long de son séjour américain, Pautrat et Althusser donnent à Derrida des nouvelles de la rue d’Ulm. Le nouveau directeur est arrivé, Jean Bousquet, un ancien condisciple de Pompidou. un « vieux beau un peu démagogue », mais « nettement plus subtil et poli que le prédécesseur [73] ». Derrida ne doit pas se faire « l’ombre d’un souci pour l’École et ses philosophes [74] » : tout se passe pour le mieux sur ce plan. Mais ses deux collègues et amis tiennent surtout à l’informer des turbulences parisiennes : elles ne sont pas moindres que pendant l’automne 1968, lors de son précédent séjour à Baltimore. Sollers a certes félicité Bernard Pautrat pour son livre, Versions du soleil. Figures et système de Nietzsche, récemment publié au Seuil. Mais il lui a surtout exposé en détail la grande affaire du moment, celle qui concerne De la Chine. En septembre 1971, l’interdiction à la Fête de L’Humanité du livre de Macciocchi a précipité la rupture de Sollers avec le parti communiste.

Le Monde du 11 septembre 1971.
« J’avais accepté, comme tous les ans, de participer à la fête de L ’Humanité, qui se présente, on le sait, comme une grande fête populaire et démocratique. Devant l’étonnement de quantité de lecteurs, sur le fait que le livre de Maria-Antonietta Macciocchi, De la Chine, ne soit pas annoncé à cette vente, j’ai, très surpris moi- même, demandé des explications. Il en ressort que la présence de ce livre est considérée, parlons net, comme indésirable par les autorités de cette manifestation. Aucun intellectuel d’avant-garde et plus encore aucun marxiste ne peut, me semble-t-il, rester indifférent devant cette mesure. De la Chine représente aujourd’hui non seulement un admirable témoignage sur la Chine révolutionnaire, mais encore une source d’analyses théoriques qu’il serait illusoire de croire refoulées. De la Chine, c’est la puissance et la vérité du « nouveau » lui-même. Son absence, sa censure dans une manifestation d’union de la gauche sont le symptôme grave d’un aveuglement navrant. C’est pourquoi je n’irai pas cette année coudoyer des « écrivains » — dont certains notoirement réactionnaires — à la fête de L’Humanité. Les livres ne sont pas des produits ménagers. De la Chine est l’un des très rares livres d’aujourd’hui, de demain. Le travail de Maria-Antonietta Macciocchi a devant lui toute l’histoire. »
 Derrida doit donc, d’ici son retour, s’habituer à la nouvelle situation, car « le qualificatif "révisionniste" se manie désormais avec un naturel, une aisance, une innocence pleins d’aplomb [75] ».
Derrida doit donc, d’ici son retour, s’habituer à la nouvelle situation, car « le qualificatif "révisionniste" se manie désormais avec un naturel, une aisance, une innocence pleins d’aplomb [75] ».
Dans les locaux des éditions du Seuil, rue Jacob, le bureau de Tel Quel s’est couvert de « dazibaos », dont beaucoup sont dus à Marcelin Pleynet. Le plus savoureux est peut-être celui-ci « Deux conceptions du monde, deux lignes, deux voies : Aragon ou Mao Tsé-toung ? Camarades, il faut choisir [76] ! »
De son côté, Althusser mène un jeu complexe. Même s’il n’est pas question pour lui de quitter le Parti. il a rencontré récemment Houdebine qui veut lui consacrer un numéro spécial de Promesse. Ce qu’il a entendu de l’entretien à paraître avec Derrida l’a beaucoup alléché :
« Je pense qu’il me le passera avant publication, si tu le veux bien. J’aimerais, tu le sais, comprendre ce que tu écris, et ne pas me contenter de quelques éclairs et fragments. »
Peut-être cet entretien lui servira-t-il de porte d’entrée dans la pensée de son ancien élève.
« Ce qui est frappant, c’est que jusqu’ici personne de ceux que tu gênes n’ait été en mesure de présenter une critique qui soit à la hauteur de ce que tu écris [77]. »
Le numéro de Promesse contenant le grand entretien avec Derrida paraît le 20 novembre, peu avant le nouveau Tel Quel « afin de bénéficier d’un laps de temps de vente exclusive [78] ». Comme Houdebine l’imaginait, il ne passe pas inaperçu et les ventes sont plus fortes que d’habitude. Mais un nouvel incident se produit : sans prévenir Derrida, qui sera ulcéré par le procédé, Jean-Louis Houdebine envoie immédiatement le numéro à Lacan, en lui expliquant que la longue note le concernant a été ajoutée après coup : « C’est ce qui explique, dans l’entretien tel qu’il est publié, l’absence de réaction de notre part quant aux remarques critiques formulées par Derrida, avec lesquelles nous sommes loin d’être toujours d’accord. Mais nous n’avons pas caché ce désaccord à Derrida [...], sans envisager pour autant de le censurer. » Dans sa lettre, Houdebine assure aussi Lacan que sa réponse éventuelle sera publiée dans la revue [79].
Derrida revient des États-Unis le 7 décembre. Pendant les deux semaines suivantes, il est pris dans une espèce d’avalanche, « en particulier à cause de l’agitation actuelle de notre petit cirque parisien [80] ». Il se sent écartelé entre sa lucidité intellectuelle et sa volonté de ne pas rompre avec un ami cher et un milieu qui continue de lui importer. Dans la perspective de la prochaine sortie de La dissémination dans la collection « Tel Quel », Sollers rédige un texte de présentation enthousiaste : « La dissémination, c’est à la fois, dans le coup d’une inscription sans réserves, le risque, la dispersion et la plus stricte contrainte. La pensée la plus difficile, la plus abrupte et la plus enjouée. » De son côté, Derrida a donné plusieurs gages de complicité à l’intérieur du futur livre : non seulement un quart du volume est consacré à Nombres, mais il fait quelques allusions louangeuses à Julia Kristeva, Marcelin Pleynet et Jean-Joseph Goux ; et il lui arrive de citer Marx, Lénine, Althusser et même les Écrits de Mao Tsé-toung. Tout cela, pourtant, ne va pas suffire.

La rupture de 1972
 En cette période de voeux, habitude à laquelle il restera longtemps fidèle, Derrida adresse à Henry Bauchau, qu’il regrette de ne pas avoir revu depuis longtemps, une longue lettre à la tonalité mélancolique :
En cette période de voeux, habitude à laquelle il restera longtemps fidèle, Derrida adresse à Henry Bauchau, qu’il regrette de ne pas avoir revu depuis longtemps, une longue lettre à la tonalité mélancolique :
La vie que je mène, que nous sommes hélas beaucoup à mener, devient de plus en plus triste et absurde, en particulier à cause de notre agitation stérile, distraite, abstraite qui emporte chaque jour, le pire, bien sûr, dans le monde, et le meilleur aussi. Je supporte de moins en moins ce qui empêche de voir les amis, de leur parler, de partager avec eux le temps. Et ce qui m’en empêche s’accroît, s’accumule régulièrement, me rapproche sûrement d’une espèce de suffocation intolérable et mortelle. [...] La « scène parisienne » est asphyxiante — vainement de surcroît [81].
Quelques jours plus tard, il envoie à Sollers une lettre chaleureuse bien qu’un peu embarrassée à propos du manuscrit de Lois, son nouveau roman :
Excusez mon retard. C’est qu’aussi j’ai voulu relire. Et il faudra le faire encore, bien sûr, plus d’une fois. [...] Difficile, impossible à la limite d’écrire sur Lois. Texte trop piégé. À chaque instant, on risque [...] de tomber dans une mauvaise case du jeu (prison, puits, labyrinthe, etc.). Mais quel jeu [82] !
On est loin de l’enthousiasme qu’il avait immédiatement manifesté après sa première lecture de Nombres. Dans les jours suivants, les choses vont se précipiter. Le 18 janvier, Derrida annonce à Houdebine qu’il a répondu à l’invitation d’Antoine Casanova, le rédacteur en chef de La Nouvelle Critique, et ce, en dépit de la rupture désormais totale des liens entre Tel Quel et le parti communiste. Mais cette rencontre, tient-il à préciser, n’est en rien un ralliement :
Les prévisions que je vous avais confiées à ce sujet se sont pleinement confirmées. J’ai rappelé des "positions" connues et j’ai très fermement, très clairement, exprimé mon désaccord avec l’interdiction du livre De la Chine à la fête de L’Humanité. Ce qui a occupé la plus grande partie de l’entretien. Rien de marquant autrement [83].
Le même soir, Jacques et Marguerite sont invités à dîner chez Paule et Yves Thévenin, en compagnie de Sollers, Julia Kristeva et Pleynet. Mais les heures passent et les trois telqueliens ne se montrent pas. Derrida et Thévenin apprennent bientôt qu’il s’agit d’« un coup de semonce », en guise de représailles contre le rendez-vous avec Antoine Casanova [84]. Ulcérés par cette attitude, Paule Thévenin et Derrida en tirent des conséquences immédiates. Dès le lendemain, ils informent chacun de son côté les responsables de Cerisy qu’une « rupture » étant intervenue dans leurs rapports avec Sollers et le groupe Tel Quel, ils ne participeront pas à la décade annoncée sur Artaud et Bataille. « Je le regrette, mais ma décision étant définitive, j’ai cru devoir vous en faire part aussitôt pour vous permettre, si vous le jugez opportun, de la rendre publique [85]. » Prenant acte de la situation, Sollers tente de sauver ce qui peut l’être, en faisant mine de distinguer l’attitude de Derrida de celle de Paule Thévenin :
Jacques,
Il me semble que tout peut se passer sans trop de remous, n’est-ce pas ?
Vous savez que j’ai considéré et que je pense devoir m’engager à fond dans l’affaire Macciocchi.
Pouvez-vous, je vous prie, dire :
1) à Paule : qu’il me semble inutile de laisser entendre que nous allons l’attaquer (sur son travail etc.) ce que nous ne ferons, bien entendu, jamais.
2) à Yves : que nous lui gardons, Julia et moi, quoi qu’il arrive, notre amitié reconnaissante.
Merci de ce service. Amitiés à Marguerite.
Pour vous, tout ce que vous savez par ailleurs (c’est écrit).
Sollers ajoute en post-scriptum : « Est-il absolument nécessaire que Paule dise désormais partout qu’elle et Derrida ont rompu avec Tel Quel ? [86] »
La réalité est qu’il n’y a plus rien à sauver, même si La dissémination doit paraître quelques semaines plus tard dans la collection « Tel Quel ». Derrida espère garder des liens amicaux avec quelques outsiders du groupe, notamment avec Jacqueline Risset — elle vit en Italie loin de toutes ces péripéties —, mais il ne veut plus entendre parler de Sollers, ni de Julia Kristeva, ni de Pleynet, qui pour leur part ne vont pas se priver de l’attaquer.

- Manifestation lors des obsèques de Pierre Overney
La brutalité qui va bientôt prévaloir n’est pas seulement individuelle, elle correspond aussi à la période. Le 25 février 1972, soit un peu plus d’un mois après ces événements, le militant maoïste Pierre Overney est assassiné par un vigile devant les portes de l’usine Renault de Billancourt, alors qu’il distribue un tract appelant à commémorer le massacre du métro Charonne, dix ans auparavant. Le samedi 4 mars, jour de ses obsèques, près de deux cent mille personnes traversent Paris, de la place de Clichy au cimetière du Père-Lachaise. Jean-Paul Sartre se tient près du cercueil. Michel Foucault et bien d’autres personnalités sont dans la foule. Et l’on dit qu’Althusser aurait déclaré ce jour-là : « C’est le gauchisme qu’on enterre [87]. » Rétrospectivement, la mort de Pierre Overney marque un moment essentiel : celui où l’extrême gauche française évite de basculer dans une violence qui ne serait plus seulement verbale.
Très affecté par la rupture avec Philippe Sollers, à qui le liait une profonde amitié depuis 1964, Derrida refusera toujours d’en reparler, invitant
« d’une part à "lire les textes", y compris les siens, et notamment ceux de la collection et de la revue dans les années 65-72, [...] et d’autre part à ne se fier "en rien" aux interprétations-reconstructions publiques ("grossièrement falsificatrices") de cette séquence finale par certains membres du groupe Tel Quel [88] ».
Ce long silence de Derrida donne d’autant plus d’intérêt à son échange de lettres avec le jeune philosophe belge Éric Clémens, proche de Goux et de Pautrat, et membre du comité de rédaction de la revue TXT.

lire la suite : Une mise au point — Les liens avec le PC

Pour Jacques Derrida André Masson (avec les initiales de J. D.)
Les Lettres françaises du 29 mars 1972. (archives A.G.)

1972 : Un « acte de guerre »
 C’est Jean Ristat qui conçoit et coordonne le numéro spécial que la revue Les Lettres françaises consacre à Derrida, le 29 mars 1972. La liste des contributeurs de ces douze pages de grand format est prestigieuse. Après une couverture originale d’André Masson, on y trouve notamment les noms de Roland Barthes, Catherine Backès-Clément, Hubert Damisch, Jean-Joseph Goux, Roger Laporte, Claude Ollier, Paule Thévenin et Jean Genet. [...]
C’est Jean Ristat qui conçoit et coordonne le numéro spécial que la revue Les Lettres françaises consacre à Derrida, le 29 mars 1972. La liste des contributeurs de ces douze pages de grand format est prestigieuse. Après une couverture originale d’André Masson, on y trouve notamment les noms de Roland Barthes, Catherine Backès-Clément, Hubert Damisch, Jean-Joseph Goux, Roger Laporte, Claude Ollier, Paule Thévenin et Jean Genet. [...]
Aux yeux de Sollers et des telqueliens, se rapprocher de Jean Ristat, c’est-à-dire aussi d’Aragon, apparaît comme un acte de guerre. Le 30 avril, sort le deuxième numéro du Bulletin du mouvement de juin 1971, une petite publication artisanale dirigée par Marcelin Pleynet. Dans ce fascicule, qui s’ouvre et se ferme sur un poème de Mao Tsé-toung, Derrida est attaqué à deux reprises. Le titre du premier texte restera fameux « Ô mage à Derrida ». Maladresses comprises. L’article lui-même est un morceau d’anthologie :
Un numéro spécial des Lettres françaises contre les gauchistes et le « voyou » Overney ? Non, un numéro spécial pour le philosophe Jacques Derrida. Le torchon aragonien ne serait donc pas une éponge politique ? La philosophie, c’est bien connu, n’a rien à faire avec la politique, à moins, bien entendu, que l’ésotérisme ne fasse désormais partie de l’arsenal idéologique du pcr [sic] [94]. Et comment en douter quand on voit Jean Ristat, fil(s) spirituel d’Aragon-Cardin, servir les changes. [...] Ce numéro n’en est pas à un paradoxe prêt [sic], qu’on apprécie celui-ci : le livre de Derrida La dissémination, qui sert de prétexte à ce rassemblement d’intellectuels plébiscitant la politique du pcfr, tient son litre d’un essai de cent pages (un tiers du livre) que Derrida a consacré au roman de Philippe Sollers, Nombres. Est-il besoin de dire qu’on ne trouve pratiquement pas trace du travail de Sollers, voire même du travail de Derrida sur Sollers, dans ce numéro des Lettres françaises [95] ?
Le deuxième article, signé « Front de lutte idéologique » s’intitule quant à lui « Derrida ou l’anti-péril jaune ». L’attaque est à la fois brutale et embarrassée. Après tout, l’auteur de L’écriture et la différence a été longtemps un des piliers de Tel Quel :
29 mars — Lettres françaises — Hommage à Derrida. [...] Le révisionnisme s’émerveille des textes du philosophe idéaliste Derrida publiés il y a plus de deux ans. Délires éclectiques. Fourre-tout d’intellectuels réviso (la mondaine backès-clément et le marxiste Jean Genet). Décidément, dès que l’on se réfère à la Chine révolutionnaire, tout devient beaucoup plus clair. Derrida, moment précis dans l’histoire de l’avant-garde, philosophe qui ne se constitue que du honteux abandon de toute lutte philosophique par le révisionnisme. Mais l’idéalisme intelligent, 1000 fois supérieur au matérialisme bête. Derrida aujourd’hui intégré, dépassé par l’avant-garde dans une théorie scientifique des idéologies. Le révisionnisme acculé portant aux nues des miettes. Magouilles : le révisionnisme ne vit qu’en exploitant les acquis passés de cette avant-garde qui le dénonce [96].
La participation de Barthes à ce numéro des Lettres françaises est bien entendu passée sous silence. [...]

Les Lettres françaises, 11 octobre 1972 (archives A.G.)

L’article de Jean-Joseph Goux
J.-J. GOUX
B. Peeters, Trois ans avec Derrida, p. 84.
Depuis Kandinsky et Malévitch, la peinture ne « représente » plus rien. Les romanciers les plus lucides, depuis Lautréamont et Joyce, ne racontent plus d’histoires. Les musiciens renoncent, depuis Webern, Berg, Boulez, à la phrase mélodique. Crise de la représentation, crise du continu, crise du sens, Mais 1es mots d’éclatement, de dislocation, que l’on emploie volontiers à ce propos, restent superficiels. Par un mouvement qui se laisse partout, de mieux en mieux, percevoir, de nouvelles pratiques de la signification sont nées et continuent de naître, non plus miroir d’un réel indubitable et supposé préexistant, mais opérations constructives, produisant leurs axiomes et leurs lois de compositions, engendrant et organisant leurs matières, au lieu de mimer et de refléter une nature extérieure constituée. Le moyen de production d’un effet esthétique ou d’un effet de signification, c’est-à-dire le médium de l’expression lui-même, n’est plus un simple instrument subordonné, comme il l’était encore au début du siècle dernier, il devient l’objet ou le sujet de l’activité esthétique ou signifiante.
Or à sa manière, la philosophie, elle aussi, dans l’un de ses courants, cesse d’être purement « représentative » des contradictions du réel, pour se retourner sur « la pratique de la langue » qui la permet. Deux ou trois mots stratégiques ont marqué depuis quelques années l’une des voies originales, et qui n’est pas la moins insidieuse, de ce déplacement : écriture, texte, gramme. On savait que la philosophie était aussi langage, on avait réfléchi sur l’expression philosophique comme discours, agencement raisonné de concepts. Mais jamais le travail d’écriture la texture des écrits philosophique n’avaient été explorés comme tels. Jamais sans doute on n’avait menacé et éclairé, comme le fait aujourd’hui Jacques Derrida, le langage philosophique comme production textuelle.
La pharmacie de Platon
Entre discours écrit et production textuelle, la différence est décisive. Elle change notre perception à l’égal de la révolution qui nous fait passer de la peinture figurative à la peinture abstraite. Qui nous fait passer de la simple re-présentation picturale d’un monde extérieur, stable et objectif, rassemblé sous l’unité d’un point de vue, à une productivité nouvelle, un engendrement créatif ayant ses lois propres. Discours écrit : c’est une pensée transparente à elle-même, qui s’exprime dans un discours, lequel se transcrit secondairement en écriture. Production textuelle : un renversement de perception s’effectue ; prise dans le corps et la matière d’une langue en partie opaque à ses propres opérations, c’est une texture qui détermine, certes, des effets de sens, de contenu et même de thèse et de thème, mais n’est jamais réductible à eux seuls ; elle les dépasse comme un organisme vivant n’est pas réductible à l’ensemble de ses fonctions. Les contraintes spécifiques d’une langue travaillent l’organisation textuelle à l’insu de l’auteur reconnu du texte.
Le système de Platon, par exemple, est tissé dans le système de la langue grecque qui lui impose certaines de ses trames et certains de ses fils. Il est trop peu dire que Platon n’a exprimé sa pensée que dans une certaine langue. Nous le savions. C’est sa langue, avec ses contraintes, sa structure, ses chaines lexicales spécifiques qui s’est exprimée par l’intermédiaire d’un certain Platon.
Derrida le montre à partir du mot pharmakon. Pharmakon : remède, drogue, philtre, charme, potion, poison. Le mot n’a rien d’un concept-clé du platonisme ; il n’est pas une catégorie immédiatement repérable, et qui soutient la machinerie consciente du discours du philosophe. Pas besoin de cette chaîne pharmaceutique pour exposer la différence entre le monde sensible et le monde des idées. Et pourtant, radiographions le texte de Platon. « Le mot pharmakon y est pris dans une chaîne signifiante. Le jeu de cette chaîne semble systématique. Mais le système n’est pas ici, simplement, celui des intentions de l’auteur connu sous le nom de Platon. Ce système n’est pas d’abord celui d’un vouloir dire. » La machine textuelle dans laquelle fonctionne le pharmakon déborde, ni inconsciente, ni consciente, les intentions philosophiques de Platon. Elle transgresse les repérages conceptuels reconnus. Davantage même, les fonctions nombreuses de ce mot, permettent et soutiennent, à partir de son sens ambivalent (remède/ poison) le jeu des oppositions philosophiques majeures. Et jusqu’à l’activité philosophique elle-même, qui est, si l’on déchiffre le texte inaperçu et actif sous le texte de Platon, la plus secrète et dangereuse, la plus ambivalente des « drogues ».
Nous savions avec Marx, différemment avec Freud, — et nous avons besoin de l’apprendre encore — que les discours des philosophes ne disent pas seulement ce qu’ils ont conscience et volonté de dire : qu’il ne faut pas les prendre pour argent comptant. Extériorité agissante des forces économiques, extériorité agissante et décentrée du désir subjectif. Ici, avec Derrida, c’est le moyen même de production linguistique, le système de la langue. qui contestent au plus près de l’opération conceptuelle les titres à une maîtrise philosophique.
La machine textuelle née de la collaboration du cerveau de Platon et de la langue grecque, le texte-Platon en écrit plus, et plus long, que ce ce que voulait dire le philosophe nommé Platon. Si le contenu latent d’un rêve est plus riche que son contenu manifeste, il y a aussi une sorte de latence, mais bien différente, qui n’est pas celle d’un désir inconscient chiffré, mais de tout un fonds textuel (de culture et de langue).
« Écrire veut dire greffer »
Mais on devine déjà qu’à contester le discours philosophique non plus concept contre concept, mais en le révélant à lui-même sous une lumière radiale qui en éclaire le lexique et la texture, Derrida ne pouvait que rencontrer le travail textuel dans l’épaisseur de la langue qu’accomplit une certaine « littérature » depuis surtout Lautréamont et Mallarmé, Loin de toute confusion entre littérature et philosophie, mais dans un double mouvement croisé à la stratégie circonspecte, Derrida nous montre, d’une part que les écrits philosophiques sont des textes de « littérature » puisqu’ils en ont, forcément, en tant que production de langage, l’épaisseur « poétique », — à l’encontre même du désir d’élucidation théorique complète qui serait l’idéal classique des philosophes —, et qu’inversement certains des textes dits « littéraires » ont une décisive puissance de formalisation et d’organisation, insoupçonnée, enveloppée.
Car c’est à travers eux que « se démonte la représentation ». Parce que le texte, comme chez Mallarmé est redoublé, mimé, dans un dispositif scénique, dans un théâtre de l’idée, ou bien violemment disséminé, d’un coup de dés, jouant de l’importance des blancs, des écarts, de l’espacement. Le texte n’est plus ce déroulement linéaire fidèle à la chaîne parlée, qu’un titre a par avance résumé et surplombé, qu’une introduction a déjà anticipé, mais constellation, voie lactée, « compte total en formation ». Greffe, semence, germination, régénération : le tissu du texte ne sera dès lors saisi, c’est-à-dire récrit, que par une nouvelle « biologie » de l’écriture, sans rapport avec un commentaire thématique.
Dans un texte de Ph. Sollers (Nombres) que Derrida lit (ou récrit), se découvre une fiction qui n’est pas commandée par la puissance créatrice et unifiante de la parole, mais par le pouvoir séminal et disséminant d’une écriture plurielle, pratiquant le prélèvement et la transplantation. La structure atomique et génétique du roman organise une textualité non figurative, une permanente prolifération cellulaire qui, au sens classique ne « représente » ou ne « réfléchit » rien. « L’hétérogénéité des écritures, c’est l’écriture elle-même, la greffe ».
Les pouvoirs du « joker »
Au point de confrontation, de la philosophie, de la sémiologie et de la littérature, Jacques Derrida occupe une place originale ; ou plutôt il la traverse et il la creuse. Les pattes de colombe de sa critique philosophique ont plus fait pour bouleverser radicalement, depuis plusieurs années, ce que l’on peut penser de l’écriture, du texte, du sens, de la littérature, que certaines lourdes artilleries, logicistes ou empiristes, qui font volontiers parade de leur « scientificité » sans critiquer les présupposés culturels dont sont surchargés leurs objets.
Ce qui frappe chez Derrida, c’est une nouvelle manière de philosopher. Plurielle, distributive, par jonction d’emplacements espacés, groupements. Sous une rigueur sans défaut, c’est l’absence calculée d’une volonté de maîtriser le jeu conceptuel. Et de faite tenir toutes les mises dans la tête spéculative. Laissant des blancs, des réserves, des marges, des renvois. Il ne s’agit donc pas seulement d’une philosophie du texte, mais d’une philosophie qui est conformée comme un texte. A l’ordre du discours philosophique qui commande à la pensée philosophique, un enchaînement logique linéaire, une plasticité et une fluidité organique, une autre stratégie, que les mots de différence, de dissémination, de trace, d’écriture, de greffe de germe, de réserve, de marque s’exercent à pratiquer. Ces mots ne sont pas des concepts qui saisissent et enferment. Ils sont plutôt comparables à cette figure énigmatique dont parle Derrida en passant, à propos du dieu Thot inventeur mythologique de l’écriture, le jocker : signifiant disponible, carte neutre, donnant du jeu au jeu... Si Marx disait de Hegel qu’il avait fondé un « empire métaphysique », aucune métaphore donc que celle de « l’empire » ne conviendrait plus mal à Derrida. Il sème et découvre entre Platon, Hegel, Mallarmé, Husserl, Artaud, des germes d’accords ou de discordes, et peut-être des graines de violence ; il opère sur le lourd contentieux que les rapports entre 1a philosophie et la littérature, sur un territoire balkanisé, laissent en suspens. Travail de « déconstruction » patiente, infinie. il le sait : car un texte « régénère indéfiniment son propre tissu derrière la trace coupante, la décision de chaque lecture... »
Jean-Joseph Goux, Les Lettres françaises du 11 octobre 1972.
1973 : l’hommage du Monde et de... Sollers
 À la veille de l’été 1973, Le Monde a consacré une double page à « Jacques Derrida, le déconstructeur », avec une caricature de Tim, qui le présente en scribe égyptien pourvu d’une impressionnante chevelure. Lucette Finas, l’instigatrice de ce dossier, insiste sur le fait que « l’accueil reçu par Derrida à l’étranger est dans l’ensemble bien supérieur à celui qui lui est réservé en France ». La plupart de ses ouvrages sont traduits en une dizaine de langues, affirme-t-elle de manière un peu excessive, avant de présenter de manière brève et aussi pédagogique que possible des concepts comme la trace, la différance, le supplément, le pharmakon, l’hymen...
À la veille de l’été 1973, Le Monde a consacré une double page à « Jacques Derrida, le déconstructeur », avec une caricature de Tim, qui le présente en scribe égyptien pourvu d’une impressionnante chevelure. Lucette Finas, l’instigatrice de ce dossier, insiste sur le fait que « l’accueil reçu par Derrida à l’étranger est dans l’ensemble bien supérieur à celui qui lui est réservé en France ». La plupart de ses ouvrages sont traduits en une dizaine de langues, affirme-t-elle de manière un peu excessive, avant de présenter de manière brève et aussi pédagogique que possible des concepts comme la trace, la différance, le supplément, le pharmakon, l’hymen...
Christian Delacampagne, un ancien normalien devenu collaborateur régulier du Monde, tente pour sa part de définir ce qu’est la déconstruction. Puisque « l’ensemble de la métaphysique, c’est-à-dire en fait l’ensemble de notre culture », doit être considéré comme un texte, il s’agit avant tout d’un acte de lecture. Déconstruire, « ce n’est pas démolir, attaquer naïvement une forteresse à coups de poing. Depuis le milieu du XIXe siècle, la mort de la philosophie est à l’ordre du jour, mais la sentence est difficile à appliquer : la mort de la philosophie doit être philosophique ».
De manière assez étrange, Philippe Sollers participe lui aussi à cet hommage, sur un mode bien éloigné des attaques parues dans le Bulletin du mouvement de juin 1971. L’apport de Derrida à la littérature lui semble « d’une importance absolument décisive : avec la "grammatologie" s’est fondé un nouveau rapport entre pratique littéraire et philosophie ». Derrida a formulé une question que la philosophie avait toujours échoué à se poser et qui vise à transformer le statut même de la littérature. Si Sollers ne fait aucune allusion directe à la brouille de l’année précédente, il marque tout de même quelques réserves, de façon un peu paternaliste :
La crise, le débordement que Derrida a produit peut être productif, mais seulement s’il n’est pas à son tour encerclé par une utilisation universitaire. Car il faut distinguer entre le travail considérable accompli par Derrida et le "derridisme" qui s’est développé à une allure galopante. [...] Je crois que lui-même aura à surmonter la façon dont son discours peut devenir rassurant [97].
Note. C’est plus clair encore si on lit l’intégralité de l’interview. Sollers y fait bien la différence entre Derrida et le « derridisme », mais y précise aussi ce qui différencie la « pratique » du philosophe et celle de l’écrivain (et qui est sans doute autre chose, et bien plus, que la différence entre la « théorie » et la pratique littéraire), la « double corporalité » à l’oeuvre :
« Transformer le statut même de la littérature »
La pensée de Jacques Derrida est au centre d’une réflexion sur la littérature. Interrogeant certaines oeuvres « limites » (Antonin Artaud, Georges Bataille), ses analyses, de 1965 à 1969, rencontrent et recoupent celles de la revue Tel Quel, où il publie plusieurs textes. La Dissémination, en 1972, consacre aux romans de Philippe Sollers une longue analyse. Nous avons donc demandé à ce dernier quel était l’apport de Derrida à la littérature.
Cet apport est d’une importance absolument décisive : avec la « grammatologie » s’est fondé un nouveau rapport entre pratique littéraire et philosophie. Derrida a formulé une question que la philosophie avait toujours échoué à se poser, et qui vise à transformer le statut même de la littérature.
Il a compris que le geste de la littérature, aujourd’hui, ne peut plus être centré sur ce que la philosophie avait cru pouvoir déceler dans l’acte littéraire. Et il a accordé, sur le terrain même de la philosophie en cassant de l’intérieur son discours, une attention de lecture à tout ce qui excédait le concept philosophique traditionnel de littérature et de langage.
Cela a conduit Derrida, et encore une fois à l’intérieur du champ philosophique, à l’exhumation de gestes comme ceux d’Artaud et de Bataille. Cela a été pour nous très important, dans la mesure où nous pensons que la pensée pratique et la plus profondément philosophique de l’époque était déposée non pas dans la tradition philosophique classique, depuis Marx et Freud, mais précisément dans des tentatives comme celle d’Artaud.
Et, en même temps, le préjugé dominant à combattre, c’est de s’imaginer que ces pratiques les plus avancées (Mallarmé, Bataille, Joyce...) seraient dominables, réductibles, récupérables par un commentaire. Derrida est justement venu dire le contraire.
Par là, il a permis une sortie définitive de l’empirisme, du psychologisme, du naturalisme,
de toutes les idéologies qui hypothèquent l’interprétation de la littérature.
La déconstruction du discours logocentrique par Derrida permet-elle un autre discours, un langage différent ?
La crise, le débordement que Derrida a produit peut être productif mais seulement s’il n’est pas à son tout encerclé par une utilisation universitaire. Car il faut distinguer entre le travail considérable accompli par Derrida et le « derridisme » qui s’est développé à une allure galopante.
Si ce « derridisme » stéréotypé s’amplifiait, il pourrait conduire conduire à méconnaître la question même qu’a posée Derrida. Il est venu pour dire qu’il n’y a pas de maîtrise sur le langage, en tant qu’il inclut le sujet de sa pratique. Mais il ne faudrait pas dire : « Bon, on sait maintenant ce qu’il en est de l’écriture, puisqu’il y a « Derrida ». Je crois que lui-même aura à surmonter la façon dont son discours peut devenir rassurant.
Peut-on parler d’une influence de Derrida sur vos oeuvres littéraires ?
Non, car entre la théorie et la pratique littéraire, le langage ne part pas du même lieu, ce n’est pas la même posture du corps : il y a une double corporalité de ces deux langages. Ce qui est déterminant c’est la pratique. [98] Et je ne pense pas avoir été influencé le moins du monde par la rythmique ou le travail sur la langue de Derrida.
Croire à une même causalité entre ces deux langages (théorique et littéraire), c’est croire que ce que je fais, ma pratique, serait une illustration de la « théorie » de Derrida entre autres.
Tout le monde a tendance à le croire, parce que c’est le préjugé dominant, traditionnel, universitaire : un écrivain, c’est un « artiste », quelqu’un de naïvement gentil qui découvre des tas de choses, mais qui demeure surplombé, je dis bien surplombé par la pensée, qui, elle, s’élabore dans des endroits « sérieux ». Mais cela (d’un côté on pense, de l’autre il y a l’art) n’est plus possible. Qu’au contraire la littérature dans son excès soit une pensée en train de se faire dans l’excès c’est aussi ce que Derrida est venu dire.
Propos recueillis par Roger-Pol Droit.
Le Monde du 14 juin 1973.
1982 : Après « la nuit de Prague »
Le Matin du 4 janvier 1982 (archives A.G.)

Le récit de Jacques Derrida
Dès mon arrivée à Prague, raconte Jacques Derrida, je me suis aperçu que j’étais suivi pas à pas. Naïvement, j’ai d’abord cru que j’avais semé les suiveurs. Je me suis rendu au domicile de Ladislav Hedjanek, organisateur du séminaire de philosophie auquel je devais me rendre, et j’ai averti que je serais présent à l’heure dite. Hedjanek n’était pas là. Le soir, le séminaire s’est déroulé sans incidents : mais, en sortant, je suis tombé sur deux policiers en uniforme qui m’attendaient dans l’immeuble. Ils m’ont demandé mon passeport, et m’ont laissé partir. Je commençais à comprendre que tout cela tournait mal, et je décidai alors de ne pas rentrer à l’hôtel : j’ai dormi chez des amis.
C’est à l’aéroport que les douaniers m’ont demandé d’ouvrir mes bagages. Ils avaient un chien qui cherchait de la drogue, et flairait ; mais ils ont mis du temps à trouver les fameux sachets dont je ne soupçonnais pas l’existence. Ils m’ont demandé de déchirer moi-même la doublure de ma valise métallique, et là, il y avait quatre petits sachets de terre brune, probablement du haschisch, qui a été analysé très vite. Très vite aussi — tout était combiné d’avance — il y eut un avocat commis d’office et une traductrice. J’ai été emmené au poste de police, et l’interrogatoire a commencé.
Il y avait un premier personnage que je n’ai pas pu identifier, qui a commencé à m’interroger ; au bout de quelques heures, le procureur lui-même a pris le relais. J’ai tout de suite dit que tout cela, pour moi, n’avait aucune valeur et que je ne signerais rien sans avoir pris contact avec mon ambassade. On m’a répondu que c’était au ministère des Affaires étrangères de prévenir l’ambassade. Je voulais dire aussi que tout cela était un scénario classique, et que, sans contacts avec l’ambassade, je ferais la grève de la faim, mais l’avocat m’a conseillé de n’en rien faire, parce que, disait-il, cela pouvait me nuire. J’ai donc retiré cela, et j’ai accepté de répondre à l’interrogatoire, puisque je n’avais rien à me reprocher !
On m’a demandé les raisons de mon séjour à Prague. J’en avais, et de multiples : d’abord, le tourisme ; ensuite, un travail sur Kafka, j’avais même un ordre de mission de l’École normale supérieure portant ces mots : "Recherches sur Kafka". On m’a questionné sur ma famille, mes amis, il y avait même un aspect parfaitement bouffon lorsque, sur le conseil de l’avocat, j’ai été amené à dire ce que j’avais publié... Je leur ai dit : " Tout cela va se terminer par un incident diplomatique, cela ne va pas passer inaperçu." L’avocat m’a alors conseillé de dire qui j’étais ; et donc, dans ce rapport, figurent les titres de mes livres. On m’a demandé si Hedjanek était un kafkologue ! Mais tout cela n’y a rien fait : le procureur, après m’avoir inculpé, m’a dit : "Vous avez le droit de déposer plainte contre votre inculpation."
Je l’ai fait, immédiatement. "Votre plainte est refusée", m’a-t-il répondu. C’était une simple formalité, une procédure sans doute classique. "Vous aurez le droit de demander votre mise en liberté tous les huit jours." Il m’a dressé la liste de mes droits de prisonnier et on m’a embarqué. C’est étrange, parce qu’on reconnaît des choses que l’on a lues ailleurs, on voit se dérouler un scénario connu et infernal. Je reconnaissais les personnages, comme des clichés : les fonctionnaires d’une bureaucratie légaliste, formaliste, prudente néanmoins : ils se surveillaient les uns les autres. Aucun d’entre eux ne laissait passer le moindre signe de l’interprétation réelle des faits. A la fin, j’ai dit au commissaire en chef : "Est-ce que vous croyez vraiment qu’un type comme moi, professeur, père de famille, peut s’amuser à cacher de la drogue dans ses valises ?" Il m’a répondu en riant : "Ce sont apparemment des gens irréprochables, acteurs, chanteurs, diplomates, qui trafiquent la drogue".
Il m’a rappelé l’affaire Paul McCartney au Japon. "Il est invraisemblable que de la drogue soit mise dans votre valise sans votre complicité. " J’avais répondu : "Ce n’est pas vraisemblable, mais c’est vrai."
Mais à la relecture du rapport, j’ai changé cette phrase, qui est devenue "C’est vraisemblable et vrai."
On m’a conduit alors à la prison de Ruzin, à 30 km à peu près de Prague, une prison "dure" de 2000 prisonniers. On ne m’a pas mis les menottes, bien que je les ai vues apparaître. Le gardien chef, quand il a vu le papier et su que je ne parlais pas le tchèque, m’a fait retourner contre le mur en hurlant : ça, je comprenais. On m’a mis dans un tout petit cachot de 2,50 m sur 1 m de large, très sale ; deux heures après, ils ont jeté là un vieux tzigane, un très brave type qui avait trop bu sans doute. Au matin, il y eut les formalités d’usage : on m’a mis à poil, et on m’a donné l’uniforme de prisonnier. Tout cela est terrifiant, et c’est le sort de milliers d’anonymes, je me garderai bien de m’apitoyer sur mon sort. Puis, pour une raison que j’ignore, on m’a fait monter dans l’après-midi à un étage supérieur dans une cellule où il y avait cinq jeunes détenus. Leur présence m’a fait du bien. Et c’est vers le soir, à minuit — on devait dormir à 9 heures —, que le gardien a ouvert la porte et dit : "Domu." J’étais libre, je pouvais rentrer "à la maison". M’attendaient dans la prison les mêmes que la veille, plus les autorités françaises, consul et vice-consul, qui m’ont fait monter dans la voiture de l’ambassade, territoire français. Le changement de décor était irréel : je me suis retrouvé à l’ambassade, c’était la fin du réveillon, avec le luxe de la chambre et le champagne... Mais je ne pouvais plus oublier les jeunes détenus, le vieux tzigane, et j’y pense sans cesse.
Ils ont imprimé en moi, dès mon arrivée à Prague, une espèce de peur constante que le pire arrive. En repartant, c’était très irrationnel, mais j’avais toujours peur de la traversée du territoire tchécoslovaque. Même aujourd’hui, la peur a disparu, mais le réel, c’est là-bas. Le réel, ce sont ces prisonniers. On n’imagine pas dans quel paradis de liberté nous vivons ici quand on n’a pas touché à cela. »
Propos recueillis par Catherine Clément, Le Matin du 4 janvier 1982.
Filmé dans le train qui le ramène de Tchécoslovaquie où il a été emprisonné, Jacques Derrida fait le récit de son arrestation et de ses conditions de détention sur Antenne 2, le janvier 1982 (7’40).

 Parmi les nombreuses manifestations de sympathie que lui vaut son arrestation, l’une revêt une importance particulière : la lettre que Philippe Sollers lui envoie, dix ans presque jour pour jour après la rupture de leurs relations :
Parmi les nombreuses manifestations de sympathie que lui vaut son arrestation, l’une revêt une importance particulière : la lettre que Philippe Sollers lui envoie, dix ans presque jour pour jour après la rupture de leurs relations :
Mon cher Jacques
Ouf !
C’est dans des moments de haute intensité comme ceux-là qu’on s’aperçoit de qui on aime. La radio, à l’aube.
Étrangement, la chose que j’avais devant les yeux était votre graphie, aussitôt.
N’empêche, nous voilà dans un sacré roman, avec Pape, drogue, police, Ambassades — et le reste. Bonjour Poe ! évidemment !
Bonne année — je vous embrasse ainsi que Marguerite (j’ai beaucoup pensé à vous tous) [100].
La réponse de Derrida, sur une carte postale représentant le vieux cimetière juif de Prague, montre à quel point la blessure reste vive :
Merci, merci de votre lettre. Ce que vous me dites va au coeur.
Il aura donc fallu cela (la prison et le reste) !
N’importe, votre geste ressemble à ce que j’avais aimé de notre amitié, pendant près de dix ans, il y a déjà dix ans..
Vous devez le savoir, mais je dois ou je préfère le dire : c’est par fidélité rigoureuse à ce passé d’amitié que devant le pire (agressions, injures, dénigrement dégradant, etc.) j’ai gardé le silence et que, bien sûr, j’y retourne maintenant. Après votre lettre, ce silence aura peut-être pour moi un autre goût, et c’est surtout de cela que je voulais vous remercier. À vous [102].
Derrida en restera là et se détournera ostensiblement de Sollers lorsque ce dernier s’approchera de lui, pendant l’un ou l’autre cocktail : cette rupture, pour lui, est de l’ordre de l’irréparable.

Jacques Derrida est mort, le samedi 9 octobre 2004
« Contrairement à la tradition juive, il a demandé à ne pas être enterré trop vite pour donner, dernier clin d’oeil à Jean-Luc Nancy, une chance à la résurrection. »
« Jacques Derrida [...] a souhaité être inhumé plutôt qu’incinéré. »
Les obsèques ont lieu le 12 octobre au cimetière de Ris-Orangis.
« Reproduisant le geste de son père, trente-quatre ans plus tôt, il a composé sa propre épitaphe :
Jacques n’a voulu ni rituel ni oraison. Il sait par expérience, quelle épreuve c’est pour l’ami qui s’en charge. Il me demande de vous remercier d’être venus, de vous bénir, il vous supplie ne pas être tristes, de ne penser qu’aux nombreux moments heureux que vous lui avez donné la chance de partager avec lui.
Souriez-moi, dit-il, comme je vous aurai souri jusqu’à la fin.
Préférez toujours la vie et affirmez sans cesse la survie...
Je vous aime et vous souris d’où que je sois. [103]. »
Le 31 octobre, Sollers écrit dans son « Journal du mois » (Le Journal du Dimanche) :
 Je revois Derrida, alors tout à fait inconnu, roulant en 2CV, raquette de tennis sur la banquette arrière. Pas du tout l’air d’un philosophe : beau, subtil, dissimulé, extraordinairement minutieux. Il venait de publier une préface étonnante à L’origine de la géométrie de Husserl, en esquissant un parallèle entre Husserl et Joyce. On se rencontre, je lui propose d’écrire sur Artaud, ce qu’il fait dans la revue Tel Quel. Quelques années d’amitié s’ensuivent. L’un de ses grands textes, La dissémination, (qui donne son titre à un volume de lui), prend appui sur un de mes romans, Nombres. Le plus étonnant est que ce texte de Derrida est étudié un peu partout dans les universités (notamment aux Etats-Unis), alors que le livre qu’il commente n’est pas traduit en anglais (autrement dit n’existe pas).
Je revois Derrida, alors tout à fait inconnu, roulant en 2CV, raquette de tennis sur la banquette arrière. Pas du tout l’air d’un philosophe : beau, subtil, dissimulé, extraordinairement minutieux. Il venait de publier une préface étonnante à L’origine de la géométrie de Husserl, en esquissant un parallèle entre Husserl et Joyce. On se rencontre, je lui propose d’écrire sur Artaud, ce qu’il fait dans la revue Tel Quel. Quelques années d’amitié s’ensuivent. L’un de ses grands textes, La dissémination, (qui donne son titre à un volume de lui), prend appui sur un de mes romans, Nombres. Le plus étonnant est que ce texte de Derrida est étudié un peu partout dans les universités (notamment aux Etats-Unis), alors que le livre qu’il commente n’est pas traduit en anglais (autrement dit n’existe pas). On s’est brouillés ensuite, Derrida et moi, pour des raisons apparemment politiques. Il est devenu, comme beaucoup de mes amis de cette époque (Barthes, Foucault, Lacan), une vedette et une référence internationales. Il faudrait analyser de plus près l’effervescence et la créativité de cette époque, et surtout les passions privées qui la sous-tendaient. Je le ferai un jour. Ce n’est pas ce que croit la dévotion universitaire. L’université me fait en général mourir en 1968, on se demande pourquoi. Il est vrai que j’ai beaucoup déplu au Parti communiste et à la gauche, sans pour autant plaire à la droite. Voilà ce qui arrive à un écrivain qui poursuit son chemin seul, et qu’on ne peut donc ranger dans aucune case connue. Derrida, finalement, était triste. Il a beaucoup parlé de la mort.

Et dans Un vrai roman, en 2007 :
 Je revois Derrida, du temps de notre amitié, me faisant lire La Dissémination (son commentaire de mon roman, Nombres, paru d’abord dans la revue Critique, en deux numéros), dans son bureau de l’École normale, avant qu’on se brouille, pour des raisons « politiques » (soutien de Derrida au parti communiste), ce qui met fin à des tas de dîners excitants chez la généreuse Paule Thévenin, décryptant sans cesse les manuscrits d’Antonin Artaud ; dîners avec Leiris ou Genet ; dîners encore, en banlieue, chez Derrida et sa fine femme, Marguerite (on s’est quand même embrassés, Derrida et moi, avant sa disparition, un soir, chez Christian Bourgois, lors d’une réception donnée pour la bouillante Toni Morrison)...
Je revois Derrida, du temps de notre amitié, me faisant lire La Dissémination (son commentaire de mon roman, Nombres, paru d’abord dans la revue Critique, en deux numéros), dans son bureau de l’École normale, avant qu’on se brouille, pour des raisons « politiques » (soutien de Derrida au parti communiste), ce qui met fin à des tas de dîners excitants chez la généreuse Paule Thévenin, décryptant sans cesse les manuscrits d’Antonin Artaud ; dîners avec Leiris ou Genet ; dîners encore, en banlieue, chez Derrida et sa fine femme, Marguerite (on s’est quand même embrassés, Derrida et moi, avant sa disparition, un soir, chez Christian Bourgois, lors d’une réception donnée pour la bouillante Toni Morrison)...

Jacques Derrida : radios et télévision

Triste, Derrida ? Il est vrai qu’il parlait beaucoup de la mort. « L’avenir est la possibilité de la mort » était d’ailleurs le titre d’un entretien qu’il donnait à Catherine Paoletti, en 1998, et qui vient d’être rediffusé sur France Culture. Mais, bien sûr, les choses sont un peu plus compliquées ; Derrida y parlait aussi des cinquante années d’après-guerre, de l’effondrement des totalitarismes et des conditions de l’héritage (26’).
« L’héritage, s’il y en a, suppose une liberté absolue. » « L’héritier doit contresigner autre chose dans une fidélité infidèle. » « Une filiation est toujours multiple. » « Il y a toujours plus d’un père et plus d’une mère. » On peut méditer ces phrases.
« Raison de plus »
17 décembre 2001.
Alain Veinstein s’entretient avec Jacques Derrida, auteur de « Papier machine » (Galilée), « L’Université sans condition » (Galilée), « De quoi demain - Dialogue » (Fayard).
Où il est question de :
Ornette Coleman.
La déconstruction.
L’Europe.
La mondialisation.
le « 11 septembre ».
Ce qui vient, l’événement, l’à venir.
La démocratie à venir.
La figure de l’intellectuel.
Atlan, « Peinture de la voix ».
1ere partie (46’)
2eme partie (37’37)
Le cercle de minuit — 23/04/1996
Laure ADLER reçoit Jacques DERRIDA
 Il évoque la télévision, dont il se méfie à cause de son action d’homogénéisation, de son inquiétude quant aux pouvoirs énormes du marché de la télévision. Il estime que la télévision est un instrument de nivellement de la pensée et que le citoyen doit la transformer dans le sens de la rupture de préjugés, de la diversité... Il se dit intéressé par le développement, insuffisant, d’une pratique critique des journalistes de TV et signale l’émission "Arrêt sur images" qui analyse les techniques de TV. Il parle de l’absence de liberté et de rapports entre journalistes et spectateurs induite par le prompteur puis note que, dans cette émission, il n’y a pas de prompteur mais des effets de prompteur puisqu’il lit dans sa tête des textes préétablis. Il compare ensuite Laure ADLER à un téléprompteur puisqu’elle oriente son intervention par les questions qu’elle pose.
Il évoque la télévision, dont il se méfie à cause de son action d’homogénéisation, de son inquiétude quant aux pouvoirs énormes du marché de la télévision. Il estime que la télévision est un instrument de nivellement de la pensée et que le citoyen doit la transformer dans le sens de la rupture de préjugés, de la diversité... Il se dit intéressé par le développement, insuffisant, d’une pratique critique des journalistes de TV et signale l’émission "Arrêt sur images" qui analyse les techniques de TV. Il parle de l’absence de liberté et de rapports entre journalistes et spectateurs induite par le prompteur puis note que, dans cette émission, il n’y a pas de prompteur mais des effets de prompteur puisqu’il lit dans sa tête des textes préétablis. Il compare ensuite Laure ADLER à un téléprompteur puisqu’elle oriente son intervention par les questions qu’elle pose.
 Jacques DERRIDA parle ensuite, brièvement de ses racines algériennes, de son sentiment d’être une sorte d’immigré, de son nom, de ses études et de la façon dont il est arrivé à la philosophie puis il évoque Albert CAMUS, L’Etranger, Noces.
Jacques DERRIDA parle ensuite, brièvement de ses racines algériennes, de son sentiment d’être une sorte d’immigré, de son nom, de ses études et de la façon dont il est arrivé à la philosophie puis il évoque Albert CAMUS, L’Etranger, Noces.
 A propos de La Circumfession, réflexion sur la circoncision et ses différents niveaux d’interprétation. Il soulève le problème du temps à la TV : urgence objective de la durée de l’émission et urgence qualitative qui fait qu’il ne pourrait parler comme il le voudrait de son sujet.
A propos de La Circumfession, réflexion sur la circoncision et ses différents niveaux d’interprétation. Il soulève le problème du temps à la TV : urgence objective de la durée de l’émission et urgence qualitative qui fait qu’il ne pourrait parler comme il le voudrait de son sujet.
 Diffusion d’un document sur le retour de Jacques DERRIDA de Tchécoslovaquie, en 1982, après la soit-disant découverte de drogue dans ses bagages.
Diffusion d’un document sur le retour de Jacques DERRIDA de Tchécoslovaquie, en 1982, après la soit-disant découverte de drogue dans ses bagages.
 En plateau, DERRIDA raconte et analyse l’affaire consécutive à la création d’une association d’aide aux intellectuels tchèques.
En plateau, DERRIDA raconte et analyse l’affaire consécutive à la création d’une association d’aide aux intellectuels tchèques.
 Spectres de MARX : ce livre, dit-il, est placé sous le signe de la fin de l’apartheid. Il a essayé d’y analyser le travail de deuil du point de vue politique et la hantise du spectre de MARX. Il se demande ensuite ce qu’est un penseur et juge que le travail critique qui se fait dans de nombreuses disciplines témoigne d’un désir de justice.
Spectres de MARX : ce livre, dit-il, est placé sous le signe de la fin de l’apartheid. Il a essayé d’y analyser le travail de deuil du point de vue politique et la hantise du spectre de MARX. Il se demande ensuite ce qu’est un penseur et juge que le travail critique qui se fait dans de nombreuses disciplines témoigne d’un désir de justice.
 Diffusion d’un document sur Mumia ABU JAMAL, ex président de l’Association des Journalistes Noirs de Philadelphie, accusé d’avoir tué un policier, condamné à mort et emprisonné depuis 14 ans [104].
Diffusion d’un document sur Mumia ABU JAMAL, ex président de l’Association des Journalistes Noirs de Philadelphie, accusé d’avoir tué un policier, condamné à mort et emprisonné depuis 14 ans [104].
 En plateau, Jacques DERRIDA parle du contexte dans lequel on a découvert cette affaire et du Congrès International des Ecrivains qui s’est donné pour tâche de lever les censures, les persécutions dont sont victimes les écrivains et les journalistes.
En plateau, Jacques DERRIDA parle du contexte dans lequel on a découvert cette affaire et du Congrès International des Ecrivains qui s’est donné pour tâche de lever les censures, les persécutions dont sont victimes les écrivains et les journalistes.
 Laure ADLER l’interroge sur le rôle de la philosophie aujourd’hui. Pour lui, la philosophie est une espèce de pensée et le philosophe, un être nécessaire, en particulier dans l’enseignement. Il souligne que la France est l’un des rares pays où l’on enseigne la philosophie à l’école, et pas seulement à l’université, se dit partisan d’introduire cet enseignement avant la classe de terminale.
Laure ADLER l’interroge sur le rôle de la philosophie aujourd’hui. Pour lui, la philosophie est une espèce de pensée et le philosophe, un être nécessaire, en particulier dans l’enseignement. Il souligne que la France est l’un des rares pays où l’on enseigne la philosophie à l’école, et pas seulement à l’université, se dit partisan d’introduire cet enseignement avant la classe de terminale.
 Dans son livre Aporie, Jacques DERRIDA évoque le passage et la possibilité de se réapproprier sa propre mort ainsi que le secret et sa valeur.
Dans son livre Aporie, Jacques DERRIDA évoque le passage et la possibilité de se réapproprier sa propre mort ainsi que le secret et sa valeur.
 Laure ADLER donne les titres des trois derniers livres de Jacques DERRIDA.
Laure ADLER donne les titres des trois derniers livres de Jacques DERRIDA.

Qui n’a pas appris à lire grâce à Jacques Derrida ? En 1967 sortent, « en tir groupé » (Ph. Forest), chez trois éditeurs différents, La Voix et le Phénomène, De la grammatologie et L’écriture et la différence qui bénéficient rapidement d’un très grand retentissement, bien au-delà du public universitaire traditionnel [105]. A l’automne 1969 Philippe Sollers publie dans le numéro 39 de Tel Quel un texte qui allait servir de présentation à la traduction argentine de La grammatologie [106]. Le 21 juillet 1969 Neil Armstrong et Buzz Aldrin étaient les premiers hommes à avoir posé le pied sur la lune.

- L’un des tout premiers pas sur la Lune, l’empreinte de Buzz Aldrin, NASA
Un pas sur la lune [107]
« éternel et muet ainsi que la matière ».

Ce titre peut étonner : peu à peu, simplement, il devrait donner à lire selon une mythologie à sa mesure un texte déjà partout opérant à l’Ouest de notre culture et dont l’efficacité ne peut, détour après détour, que s’accentuer et nous entraîner toujours à nouveau plus loin. Avertissons, cependant : on ne trouvera ici qu’un accompagnement de la Grammatologie, de sa thèse brève et cependant sans retour, de l’écart qui fait sa difficulté. Texte qui avait pour but de prévoir la méconnaissance dont il pouvait faire l’objet. Non seulement cette méconnaissance a eu lieu (elle-même dérivation d’une reconnaissance hâtive ou d’une incompréhension absolue), mais elle a eu lieu, semble-t-il, de la façon dont elle avait toujours eu lieu avant d’avoir lieu réellement, je veux dire : dans sa proposition écrite. La proposition écrite d’une réflexion sur l’écriture s’est ainsi trouvée vérifier le barrage spécifique portant sur l’écriture et détournant de la connaissance de ses opérations. [108] Une telle vérification n’est pas un cercle d’annulation mais une nécessité redoublée de destruction et de construction.
L’écriture se laisse poser des questions, elle se laisse aussi ignorer. La Grammatologie pose pour la première fois en théorie, d’un trait complexe et multiplié, l’espace où la question et l’ignorance communiquent dans un refoulement qui ne "pourrait" pas, de toute façon, traverser la forme d’une question simple : "qu’est-ce que l’écriture ?". Cette question est en effet posée, elle reçoit ses réponses : mais déjà, dans le mouvement du "qu’est-ce que", ce qui se parle et s’écrit est toujours plus que ce qui se pose, toujours en excès par rapport à ce qui est supposé pour être posé. La science d’une histoire de l’écriture est constituée, mais la science théorique de l’entrelacement entre écriture et historicité doit l’être [109]. C’est une science nouvelle dont le "terrain" commence à peine à se découvrir. Un "terrain" qui semble appeler "l’homme" au moment où il "sort de terre", donc de manière très ancienne et très moderne : quand il s’en est distingué, quand il est sur le point de s’en détacher. De cette différence, la cause aurait été longtemps oubliée, d’un oubli lui aussi "nécessaire", et c’est à partir d’elle — à partir, aussi, de Freud — qu’une histoire différentielle "inouïe" deviendrait en effet possible comme l’enseigne d’ailleurs le marxisme, première et fondamentale science révolutionnaire de la terre non pas "bouclée" mais massivement dégagée.
REGARDEZ EN PREMIER LIEU CES CARACTÈRES : LEUR APPARENCE N’EST PAS LEUR RÉALITÉ.
Quelques mots encore sur le titre : la lune, nous dit Vandier dans la Religion égyptienne [110], aurait été créée par le dieu-soleil pour le remplacer pendant la nuit.

C’est Thot que Rê avait choisi pour exercer cette fonction de suppléance. Thot, on le sait, était le dieu de l’écriture et, à ce titre, pour la parole ou plutôt le verbe, la figure fuyante, insaisissable du supplément, de l’usurpation. Pendant des millénaires, donc, et, marquons-le brutalement, jusqu’à une époque récente (mais cette époque est le temps technique à l’intérieur duquel nous interrogeons de façon irréductible ; c’est un temps qui n’a plus de ligne, un temps hors-ligne dont la rotation et la progression nous sont encore à moitié interdites), l’écriture aurait été ainsi par rapport au soleil (logos, parole, raison, vie, bien, père) cette lune morte astreinte à la réflexion, ce miroir rocheux dont la face cachée, féminine et proprement la surface — contemporaine de la formation de la terre avant l’homme — ne serait apparue de près, n’aurait été vue, foulée — ou violée — qu’à présent et pour le futur. Le pas du premier homme sur la lune, pensons-y bien, est le pas — impossible à nu — sur l’état initial de la terre, exorbitant, ce fouillis de traces sans vent pour les effacer, communique avec la "nuit" dont la lune porte, si l’on peut dire, l’envers. Avec un certain savoir sur la mort. Le déplacement qui se laisse entrevoir dans cette série d’ellipses, seule l’écriture en rend compte, seule elle peut l’inscrire dans sa pratique nocturne et supplémentaire. Nous pourrions mieux lire depuis cet espace une phrase aussi insolite que : "A tous les sens de ce mot, l’écriture comprendrait le langage." Alors l’écriture comme "lune" serait définitivement abandonnée : touchée, elle obtiendrait une autre fonction exposant pourquoi elle a été si longtemps pour nous réduite, dérobée [111]
Dérobée, exploitée, circonscrite, exténuée par ce que Derrida appelle le logocentrisme qui n’est que l’autre nom de la métaphysique grecque et de sa régulation verbale de propriété. La science de l’écriture a été "bridée par la métaphore, la métaphysique et la théologie".
" Tout se passe donc comme si ce qu’on appelle langage n’avait pu être en son origine et en sa fin qu’un moment, un mode essentiel mais déterminé, un phénomène, un aspect, une espèce de l’écriture. Elle n’avait réussi à le faire oublier, à donner le change qu’au cours d’une aventure : comme cette aventure elle-même. "
La domination que la parole a tenté d’exercer sur l’écriture — tentative domination que la Grammatologie démontre de manière irréfutable — est donc un change au sens strictement économique et finalement monétaire de ce mot. C’est à l’intérieur de l’écriture, dans un dedans fictif qui équivaut à la capacité même de représentation d’un sujet que la satellisation de l’écriture a cru se fonder pour toujours. Mouvement accompli par une écriture (phonétique, alphabétique) qui :
— asservit l’écriture à la "langue en général" en la libérant de chaque langue particulière ;
— fait de la représentation une fonction filtrée par la parole (l’écriture devient un "système de signifiants dont les signifiés sont des signifiants : les phonèmes") ;
— marque une étape spécifique dans la constitution de la monnaie comme telle
("le mouvement d’abstraction analytique dans la circulation des signes arbitraires est bien parallèle à celui dans lequel se constitue la monnaie. L’argent remplace les choses par leurs signes... C’est pourquoi l’alphabet est commerçant. Il doit être compris dans le moment monétaire de la rationalité économique. La description critique de l’argent est la réflexion fidèle du discours sur l’écriture... l’oubli des choses est le plus grand dans l’usage de ces signes parfaitement abstraits et arbitraires que sont l’argent et l’écriture phonétique.")
(cette dernière proposition à propos de Rousseau) ;
— assure la subjectivité consciente comme valeur transcendantale ;
— garantit la domination de la "prose" :
" Avant l’écriture, le vers serait en quelque sorte une gravure spontanée, une écriture avant la lettre. Intolérant à la poésie, le philosophe aurait pris l’écriture à la lettre. "
— à savoir la domination de la grammaire et du mot.
Nous atteignons ici ce qui se disjoint de l’écriture au sens étroit et de la peinture. D’un côté, il ne sera plus possible de penser l’écriture comme peinture, la peinture se trouvera être ce qui dans la répression idéologique de l’écriture, deviendra graduellement objet de et fétiche de toute une culture : il faudrait, pas à pas, à travers chaque mode de production, étudier cette constitution qui culmine dans le mode de production capitaliste. De l’autre, dans ce blocage de l’écriture par la lettre — dont Freud commencera à démasquer les effets —, ce qui est recouvert (rendu inconscient), c’est bien "l’écriture qui a lieu dans et avant la parole" : réalité impensable pour la raison classique (de Platon à Hegel, en passant par Rousseau), impuissantes devant l’écriture générale.
REGARDEZ CES CARACTÈRES : LEUR INSCRIPTION EST ET N’EST PAS CE QUE VOUS ENTENDEZ PAR CES MOTS IMPRIMÉS.
Or la métaphysique, désormais, s’essouffle. Elle aurait correspondu au formidable développement des forces productives, leur mise en place contrôlée dans le capitalisme et son stade final : l’impérialisme du capitalisme monopoliste d’état, dernier stade avant le passage au socialisme et au communisme. Elle ne répond donc plus à la poussée de forces nouvelles, destinées à transformer de part en part l’économie des sociétés humaines, Elle ne tient plus sa sphère d’influence même si elle semble en envahir la planète et l’espace, ni son langage même si elle croit encore imposer sa façon de parler et de penser à la fonction de sens en général. La rupture se produit ici à la base économique de sa clôture idéologique : les modes de signification dans leur surdétermination. En ce sens, on peut dire que la métaphysique logocentrique était "depuis toujours" habitée par deux éléments d’extériorité irréductibles : les mathématiques, la "littérature". A la fois par une enclave systématique et de plus en plus non-phonétique (mathématiques où le nom de Leibniz est à souligner en même temps que les projets de Caractéristique et de langue universelle), et par un masque graphique débordant la surface représentative et susceptible de se creuser indéfiniment au fur et à mesure de l’ébranlement de la représentation. Deux éléments du dehors dans la sécurité parlante du dedans et de sa présence. Deux éléments échappant par définition au signe de la divinité, à la divinité comme signe. En somme, une science non-phonétique freinée, clôturée à grand peine et de plus en plus difficilement par une idéologie phonétique, et "entre les deux", le procès mouvant, double, qui les relie. Défaite toujours plus complète de la représentation mais aussi atteinte de sa ressource s’il est vrai que toute proto-écriture s’enracine dans une violence par rapport à "l’objet chassé", à la fois exclu et poursuivi dans le logique et l’économique comme sur les parois sauvages et coulantes des grottes de Lascaux. La circonscription de la parole surgit d’autre part dans l’impact de l’irruption chinoise dans l’histoire ("L’écriture... est à la parole ce que la Chine est à l’Europe").
C’est ainsi que le développement rapide, martelé, de la linguistique prend place dans ce procès de dissolution.
" La métaphysique occidentale se produit comme la domination d’une forme linguistique. "
Un pivot se renforce, incarnant la mortalité de la lettre : le nom. Or
" l’écriture non-phonétique brise le nom, Elle décrit des relations et non des appellations ".
Il faut observer ici le travail de subversion opéré par la Grammatologie dans tous les compartiments des "sciences humaines" réglés par l’idéologie linguistique. Insistons sur le sol refoulé de ce réglage, par exemple chez Saussure :
" Le langage littéraire accroît encore l’importance imméritée de l’écriture. L’écriture s’arroge de ce fait une importance à laquelle elle n’a pas droit. "
Préjugé fondateur de l’écriture comme dérivation qui trouve son expression mécanique — avec plus ou moins d’hésitations — chez tout linguiste en proie à une conjuration théorique initiale de ce qui pourrait signifier pour lui, et visiblement, la mort. Martinet :
" On apprend à parler avant d’apprendre à lire. L’écriture vient doubler la parole, jamais l’inverse. " / " L’étude de l’écriture représente une discipline distincte de la linguistique, encore que, pratiquement, une de ses annexes. La linguistique fait donc abstraction des faits de graphie. "
Écriture annexée, restreinte à la projection d’une dictée, coupée ainsi de son ouverture spatiale, de ses rapports scéniques avec l’inconscient espace [112] d’où il ressort — dans ce qui aura été appelé "littérature", peinture, musique, danse, théâtre et, en retrait d’eux mais déjà au-delà d’eux s’ils sont effectivement traversés : dans l’analyse — que "la langue est une espèce de l’écriture".
" Si la langue n’était pas déjà une écriture, aucune " notation " dérivée ne serait possible et le problème classique des rapports entre parole et écriture ne saurait surgir. "
UNE IMAGE DE L’ÉCRITURE PREND LA PLACE DE L’ÉCRITURE AU NOM DE LA PAROLE QUI OCCUPE SA PLACE.
C’est pourquoi il faut distinguer entre "écriture" (au sens général, les guillemets marquant ici la fonction de scansion et de "métaphoricité" surdéterminante irréductible à la langue, intérieure à elle) et écriture (au sens étroit de la clôture idéologique d’une notion devenue pour nous faussement évidente, celle de notation linéaire de la chaine parlée) [113]. Derrida peut ainsi avancer que
" s’il y a dans la littérature quelque chose qui ne se laisse pas réduire à la voix, à l’épos ou à la poésie, on ne peut le ressaisir qu’à condition d’isoler avec rigueur ce lieu du jeu de la forme et de la substance d’expression graphique ".
En ce sens, il a raison de souligner l’importance de la glossématique qui, mieux que la phonologie, pose les prémisses d’une reconnaissance de la spécificité de l’écriture :
" la substance de l’encre n’a pas droit, de la part des linguistes, à l’attention qu’ils ont prodiguée à la substance de l’air " (H. J. Uldall).
Remplaçons ici, comme il faudrait partout le faire substance par matière, et nous approchons de la question fondamentale qui se pose désormais à tout travailleur de la signification. Le Cercle linguistique de Copenhague fait donc en ce point figure de véritable précurseur scientifique :
« Cet intérêt pour la littérature s’est effectivement manifesté dans l’école de Copenhague. Il lève ainsi la méfiance rousseauiste et saussurienne à l’égard des arts littéraires. Il radicalise l’effort des formalistes russes, précisément de l’OPOIAZ qui privilégiaient peut-être, dans leur attention à l’être-littéraire de la littérature, l’instance phonologique et les modèles littéraires qu’elle domine... (la glossématique) s’est peut-être mieux préparée à étudier ainsi la strate purement graphique dans la structure du texte littéraire et dans l’histoire du devenir-littéraire de la littéralité, notamment dans sa "modernité ". »
Il n’en reste pas moins que la linguistique dont il n’y a pas lieu, dans son ordre, de nier la nécessité et la cohérence, au contraire, repose sur des préjugés métaphysiques dont l’accentuation se fait lourdement sentir lorsqu’elle est appelée à devenir le "modèle" des "sciences humaines". Ainsi des distinctions entre "forme" et substance, "contenu" et "expression" etc. Ainsi de son utilisation ethnographique, analytique, "littéraire." Ce que la linguistique nomme écriture n’a qu’un rapport de "parenté" avec ce que la Grammatologie dénomme sous le même nom. La question est alors de savoir
« POURQUOI LE NOM D’ÉCRITURE RESTE A CET X QUI DEVIENT SI DIFFÉRENT DE CE QU’ON A TOUJOURS APPELÉ " ÉCRITURE ". »
Mais c’est indiquer le lieu d’un ébranlement et la matière par laquelle elle se fait dans sa différence : lieu double à la fois plein et vide, marqué et non-marqué, marqué par la marque et la non-marque. L’espacement de "temps" différentiels, stratégiques est ce lieu et ce non-lieu, ce rien que lieu futur, antérieur, où la répétition et l’après-coup viennent chaque fois re-montrer que "l’écriture est autre que le sujet" (Saussure : "la langue n’est pas une fonction du sujet parlant"). La pensée de la trace à laquelle nous introduit la Grammatologie n’est pas une phénoménologie de l’écriture pas plus que du signe : elle commence et se fait à travers les "blancs" : à travers la métaphysique de la signification portée et chauffée à blanc. Là où tout concept se décroche provisoirement de son articulation en chaîne, pris dans la non-contradiction, la non-négation, la non-temporalité simple de l’inconscient comme langage depuis toujours s’écrivant. Là où "ça rêve". Là où s’implante le rêve
"dans la parole de la présence refusée à l’écriture, refusée par l’écriture".
"L’espacement coupe, tombe et fait tomber dans l’inconscient : celui-ci n’est rien sans cette cadence et cette césure."
Nous vivons (sous) sa loi. Dans la scansion et le déploiement machinal de cette "cadence" apparaît alors la "structure granulaire" de la forme dans le langage mais aussi — ou simultanément — sa base écrite, ses faisceaux de traits distinctifs. La pensée de la trace est ainsi "antérieure", comme différence à la distinction (cultivée) entre nature et culture, animalité et humanité, etc. Non pas antérieure à la nature elle-même, à l’animalité elle-même mais à ce qui en est toléré pour pouvoir parler [114].
LA PENSÉE DE LA TRACE SERAIT FONDAMENTALEMENT MATÉRIALISTE.
Pensée de la déconstruction de l’idéalisme, de sa représentation et de son pouvoir (seul l’idéalisme ayant eu en droit le pouvoir, construit et exercé sur et contre le matérialisme, de telle sorte que le statut d’une représentation ou d’un pouvoir matérialistes ne peuvent être qu’entrevus à partir de ce "trait zéro"). En effet, si le matérialisme comme nous comptons en dégager le détail [115], n’a jamais été défini que par son autre (l’idéalisme) — autre n’étant d’ailleurs son autre que dans les limites où le même se conçoit comme idéalité — la percée matérialiste se produirait alors en un sens encore insoupçonné. Ouverte-fermée avec le platonisme, close par et dans Hegel, s’ouvrirait ainsi sur les confins idéologiquement non-asservis de la science, cette refonte glissée dans un futur illimité et "venant" réellement de l’illimité. La Grammatologie nous permet ainsi de voir l’époque historique et "logique" du logos comme "sublimation de la trace", fondée sur un certain temps, sur une consécutivité (le linéarisme phonologique) qui manque le signifié dans son tracement étagé. La philosophie serait et aurait été ce discours paralysé par la ligne et confondant la trace avec l’horizon. Le mot histoire aurait alors désormais deux sens : l’un philosophique (étymologique) rigoureusement limité ; l’autre extra-philosophique ne réduisant plus l’histoire : ce qui se constituerait ainsi serait la charnière d’une nouvelle phase de l’"histoire de l’écriture, de l’histoire comme écriture".
Le procès historique de l’écriture se dégage alors d’une représentation de l’histoire qui avait intérêt à ne pas interroger les conditions de cette représentation. Autrement dit, c’est à l’histoire dans sa masse que la question de l’écriture est posée dans ses déplacements, ses décentrements :
"LE DÉCENTREMENT NÉCESSAIRE SUIT LE DEVENIR-LISIBLE DES ÉCRITURES NON-OCCIDENTALES."
Nous savons de mieux en mieux comment l’histoire est faite de temps différents que l’on doit traiter en volume au lieu de les projeter ensemble sur le même plan. Cette projection linéaire correspond à un état de la raison qui méconnaît à la fois l’inconscient freudien et la réalité du matérialisme historique, en particulier l’importance d’un mode de production décisif : le mode de production asiatique. Comme l’écrit Godelier :
"L’archéologie moderne a assez montré que ce n’est pas la "civilisation" qui est née en Grèce mais seulement l’Occident une de ses formes particulières qui devait finalement la dominer. Du point de vue de la dynamique des forces productives, l’apparition de l’État et des sociétés de classes que Marx et Engels classaient dans le "mode de production asiatique" témoigne... d’un gigantesque progrès des forces productives. Si l’Égypte pharaonique, la Mésopotamie, les empires précolombiens appartiennent au "mode de production asiatique", alors celui-ci correspond aux temps où l’homme s’arrache localement mais définitivement à l’économie de l’occupation du sol, invente des formes nouvelles de production, d’agriculture, l’élevage, l’architecture, le calcul, l’écriture, le commerce, la monnaie, le droit, de nouvelles religions, etc. Donc, dans ses formes originaires, le "mode de production asiatique" signifierait non pas la stagnation mais le plus grand progrès des forces productives accompli sur la base des anciennes formes communautaires de production. "
"Toute discussion sur le mode de production asiatique mène donc... vers la constitution d’une théorie comparée des structures sociales et la construction d’un schéma multilinéaire d’évolution des sociétés." [116]
LA CHINE A ÉTÉ PLUS "AVANCÉE" QUE L’EUROPE JUSQU’AU DÉBUT DU XVIe SIÈCLE : Y PENSONS-NOUS ?
N’oublions-nous pas sans cesse que nous vivons sous un mode de production transitoire (le mode de production capitaliste) qui impose sa conception de l’histoire à partir d’un "temps" qui le sert ? A partir d’un langage de reproduction dont la raison d’être serait cette méconnaissance de l’écriture, sa dissimulation dans une parole immédiate, présente, qui, en Occident, aussi bien l’état féodal religieux que la démocratie capitaliste bourgeoise ; la hiérarchie aristocratique que le socialisme utopique ; l’idéalisme que le matérialisme mécaniste ? De Platon à Rousseau, de Rousseau à Lévi-Strauss, ne pouvons-nous pas tracer à l’intérieur de ce que Derrida appelle "l’onirisme ethnocentrique", la même ligne d’aveuglement ? Le langage comme instrumentalité n’est-il pas commun à toutes les pensées qui plient devant cette raison même ? Et pourtant, dès le XVIIIe siècle, il est possible de calculer l’échec d’un des plus formidables refoulements tentés par une civilisation, si l’on entend, comme Derrida, par métaphysique "le système exemplaire contre la menace de l’écriture" et "l’anathème obstinément ressassé" que celle-ci a en effet supporté.
"Ce qui menace (au XVIIIe siècle), c’est bien l’écriture. Cette menace n’est pas accidentelle et désordonnée : elle fait composer en un seul système historique les projets de pasigraphie, la découverte des écritures non-européennes ou en tout cas les progrès massifs des techniques de déchiffrement, l’idée enfin d’une science générale du langage et de l’écriture. Contre toutes ces pressions, une guerre s’ouvre alors. Le "hégélianisme" en sera la plus belle cicatrice."
La question de l’écriture est violente, d’une violence à la mesure de celle qui lui est faite en tant qu’extériorité. La violence exercée sur l’écriture en retour de sa menace violente définit aussi la conscience comme dénégation répétée de la sexualité : ce n’est pas le hasard qui inscrit le nom de Sade au détour contradictoire de la révolution bourgeoise. De la pensée de la trace ("unité d’un double mouvement de protention et de rétention" [117] dont Derrida annonce par ailleurs "l’aventure séminale" [118]) à celle de la graphie, de "l’écriture avant la lettre", au leurre qui apparaît, comme parole soi-disant sans écriture, une économie se joue dans la protection de la tête pensante qui aura cru possible de se transcender intérieurement : en fait, dans un phallus vide résonnant d’une voix suprême, dans un entendement relevé au dessus du temps. Le fantasme de maîtrise sur les traces et les systèmes qui en dérivent plus directement que d’autres (les mathématiques, les écritures non-phonétiques) tombe peu à peu en ruines, de façon à la fois simple et dramatique :
"La linéarité... desserre son oppression parce qu’elle commence à stériliser l’économie technique et scientifique qu’elle a longtemps favorisée."
La ligne, le sujet idéologique qui y est causé ne peut plus recueillir ou dissimuler la portée d’où elle se détache, les masses dont elle est l’indice de division ou de multiplication. Le cogito cartésien est démantelé en — même temps que le nom de l’homme, un nom beaucoup trop court pour l’espace qui vient. Reste à savoir sur quelle table il nous serait possible de compter "quatre mille ans d’écriture linéaire" : formellement, surgit ici l’énigme du mythogramme et du pictogramme dont l’inconscient freudien nous a déjà contraints de subir l’empreinte groupée, battante, éclipsée. Le phrasogramme apparaît ainsi comme étant cette écriture "première" non appuyée sur le mot (l’écriture de phrase, Satzenschrift, des pictogrammes), et Leroi-Gourhan [119] (cité par Derrida) insiste :
"L’émergence de l’écriture ne se fait pas plus à partir d’un néant graphique que celle de l’agriculture ne se fait sans intervention d’états antérieurs." / "L’apparition de l’écriture n’est pas fortuite ; après des millénaires de mûrissement dans les systèmes de représentation mythographique émerge, avec le métal et l’esclavage, la notation linéaire de la pensée." (C’est nous qui soulignons.)
Nous arrivons en vue de ce sondage (inconscient / histoire) qui, du fait du développement des forces productives, rend possible la " récapitulation " de tous les modes de production et de leurs conducteurs matériels idéologiques : les modes de notation. L’abandon du livre pour le texte, de la bibliothèque pour la magnétothèque, laissent envisager un avenir bouleversant du passé [120]. Comme l’écrit encore Leroi-Gourhan :
"Les conséquences à longue échéance sur les formes de raisonnement, sur un retour à la pensée diffuse et multidimensionnelle... sont imprévisibles au point actuel... L’écriture (au sens étroit) passera dans l’infrastructure... comme une transition qui aura eu quelques millénaires de primauté."
Pour l’instant, il s’agit de l’ouverture d’un champ d’une ampleur sans précédent, celui du "desserrement" du modèle linéaire (épique) de la rationalité nécessairement assujettie. Ce champ implique qu’on reconnaisse les limites du phonétisme y compris à l’intérieur de lui-même :
"Non seulement le phonétique n’est jamais tout-puissant, mais (il) a toujours commencé à travailler le signifiant muet. "Phonétique" et "non-phonétique" ne sont donc jamais les qualités pures de certains systèmes d’écriture, ce sont les caractères abstraits d’éléments typiques, plus ou moins nombreux et dominants, à l’intérieur de tout système de signification en général."
Ce qui s’annoncerait alors dans la pensée de la trace, ce serait à la fois une remontée à travers tous les systèmes politiques, juridiques, linguistiques jusqu’à l’économie complexe (dialectiquement matérielle et signifiante, produite et notée) qui les détermine, et en même temps ce "forçage" de la clôture métaphysique dont l’idéologie des "sciences humaines" s’acharne à colmater les brèches. Le caractère chinois wen qui signifie à la fois les traits, les veines (de la pierre, du bois), les constellations, les traces de pattes d’oiseaux, les tatouages, le dessin des carapaces, mais aussi la "littérature" (caractère que l’on retrouve dans l’expression traduite par "grande révolution culturelle prolétarienne") pourrait alors désigner l’objet de cette science nouvelle et immense qu’est la grammatologie. D’un côté : dissipant l’illusion monogénétiste, renforçant les fondements du déchiffrement, avançant dans la connaissance de civilisations encore en partie illisibles (les Mayas), développant peu à peu l’assignation exacte de ces grandes fresques que les peuples n’ont cessé d’élever, de peindre, de graver et de dessiner. De l’autre : dégageant les processus inconscients de nos systèmes en apparence transparents et stables, accentuant la percée dans les champs où la domination du signe est restée compromise : la psychanalyse, le texte dit autrefois "littéraire". Programme scientifique radical même si, comme l’écrit Derrida,
"la pensée de l’écriture (ne peut) se contenir à l’intérieur d’une science, voire d’un cercle épistémologique. Elle ne peut en avoir ni l’ambition, ni la modestie".
Programme déjà entamé de façon multiple mais qui appartient à l’avenir [121]. Pour cela, il faudra obtenir, dans une lutte sévère et jamais finie, l’abandon d’un préjugé fondamental, aussi difficile à faire disparaître, sans doute, que l’immobilité de la terre avant Galilée, "l’éternité" du mode de production capitaliste avant Marx et Lénine ou la toute-puissance de la conscience avant Freud : celui du
"concept instrumentaliste ou techniciste d’écriture, inspiré par le modèle phonétique auquel il ne convient d’ailleurs que dans une illusion téléologique".
Ce concept — ou pseudo-concept — tout, depuis les sciences (dans leur cours théorique et technique) jusqu’à "l’art" moderne, depuis les mathématiques jusqu’à la peinture, la musique, en passant par les textes les plus risqués de notre culture, tout le cerne, l’isole, le dissout et, avec lui, un certain sujet bavard qui, ici, ne peut plus trouver de support. Quand Antonin Artaud, en 1937, écrit au Mexique :
" Ne m’a-t-on pas dit dans la montagne là-bas que ces figures de géométrie éparses n’étaient pas éparses mais rassemblées et qu’elles constituaient les signes d’un langage basé sur la forme même du souffle quand il se dégage en sonorités (...) dans ces montagnes incrustées de plus de figures que les murailles de l’Inde ne comportent de divinités, voyant passer des hommes à bandeaux, des hommes enroulés de manteaux avec aussi des triangles brodés, des croix, des points, des cercles, des larmes, des éclairs... "
ou encore :
" Ce qui sortait de ma rate ou de mon foie avait la forme des lettres d’un très antique et mystérieux alphabet mastiqué par une énorme bouche, mais épouvantablement refoulée, orgueilleuse, illisible, jalouse de son invisibilité ; et ces signes étaient balayés en tous sens dans l’espace pendant qu’il me parut que j’y montais, mais pas tout seul... "
quand Antonin Artaud écrit, donc, ces phrases, ne sommes-nous pas au plus près de ces quelques mises en scènes exorbitées (Lautréamont, Mallarmé, Joyce, Pound) qui déplacent, depuis un siècle, la force nommée "écriture" ? Lisons, d’autre part Georges Bataille :
" Écrire est rechercher la chance. La chance anime les plus petites parties de l’univers... " (souligné par nous)
et demandons-nous si ce qui a lieu entre ces lignes peut encore être réduit à une approche peureuse, rhétorique ou linguistique, sous le nom subordonné et servile de "littérature" ? Quelle est au contraire l’expérience sans précédent qui s’indique là ? Peut-être la métaphysique, la théologie, la philosophie spéculative et les "sciences humaines" qui leur empruntent le même refoulement de base n’auront-elles été que l’autre nom de cette rétractation, que ce recul devant le détour et la différence de la trace et ses effets de mutation, de transformation. Cette résistance serait alors toujours tombée et tomberait encore nécessairement, par son abréviation même (son court-circuit de sublimation) en avant et à côté de la question de l’écriture. En avant et à côté de ce qui pourtant s’écrit, autrement et depuis toujours, en tournant sous nos yeux aveugles. Kafka :
"Le mot de "littérature" exprimé comme un reproche est une abréviation si puissante qu’elle a entrainé peu à peu — il y avait peut-être là une intention dès le début — une abréviation de pensée qui supprime la perspective exacte et fait tomber le reproche très en avant du but, et à côté."
Et maintenant ? Le but ? De l’autre côté ?
Philippe Sollers, Tel Quel 39, automne 1969.
Jacques Derrida, De la grammatologie, Éditions de Minuit, 1967.
Sollers termine son article sur une citation de Kafka. En 1983, dans Ghost dance, le film que j’ai évoqué en commençant, sur des images évoquant la Commune de Paris, Jacques Derrida raconte les mésaventures survenues lors de son séjour à Prague alors même qu’il s’était rendu sur la tombe de Kafka. Il y est à nouveau question des fantômes et, cette fois, du fantôme de Kafka.

Ou encore ici un peu avant à la 75ème minute du film...

Jacques Derrida dans Tel Quel
 La parole soufflée n° 20 Hiver 1965
La parole soufflée n° 20 Hiver 1965
 Freud et la scène de l’écriture n° 26 Été 1966
Freud et la scène de l’écriture n° 26 Été 1966
 La pharmacie de Platon n° 32 Hiver 1968
La pharmacie de Platon n° 32 Hiver 1968
 La pharmacie de Platon (fin) n° 33 Printemps 1968
La pharmacie de Platon (fin) n° 33 Printemps 1968
 La double séance n° 41 Printemps 1970
La double séance n° 41 Printemps 1970
 La double séance II n° 42 Été 1970
La double séance II n° 42 Été 1970
 L’écriture et la différence, Seuil, coll. Tel Quel, 1967
L’écriture et la différence, Seuil, coll. Tel Quel, 1967
 La différance, dans Théorie d’ensemble, Seuil, coll. Tel Quel, 1968
La différance, dans Théorie d’ensemble, Seuil, coll. Tel Quel, 1968
 La dissémination, Seuil, coll. Tel Quel, 1972
La dissémination, Seuil, coll. Tel Quel, 1972
A propos de Jacques Derrida
De Philippe Sollers
 Tel Quel, n° 24, Hiver 1966. Informations :
Tel Quel, n° 24, Hiver 1966. Informations :
« Dans le numéro de déc. 55 (sic) et janv. 66 de Critique un très important essai de Jacques Derrida « De la grammatologie » sur lequel nous ne serons assurément pas les seuls à revenir. » (p. 95).
 Un pas sur la lune, n° 39, Automne 1969.
Un pas sur la lune, n° 39, Automne 1969.
 "Camarade" et camarade, n° 39, Automne 1969.
"Camarade" et camarade, n° 39, Automne 1969.
Sur Pileface :
 Images de Jacques Derrida.
Images de Jacques Derrida.
Textes de Jacques Derrida en ligne
Derrida aux éditions Galilée
Derrida — le courage de la pensée
Un film de Virginie Linhart et Benoît Peeters (France, 2014, 53 min).
A l’occasion du dixième anniversaire de sa mort, portrait du philosophe, théoricien de la déconstruction (mercredi 8 octobre - 22 h 25 - Arte)
Avec les témoignages de Marguerite Derrida, Étienne Balibar, Lucien Bianco, David Carroll, Hélène Cixous, Alexander Düttmann, Jean-Luc Nancy, Avital Ronell, Elisabeth Roudinesco, Philippe Sollers, Samuel Weber.

La transmission, comme geste à la fois nécessaire et impossible, fut pour Jacques Derrida (1930-2004) le combat d’une vie. Il n’y a donc nul hasard si cette exigence se retrouve au coeur du documentaire cosigné par Virginie Linhart et Benoît Peeters, dix ans après la mort du philosophe : la première a déjà réalisé plusieurs films sur le passage du témoin entre les générations, le second a écrit une biographie de Derrida (Flammarion, 2010).
La transmission, la vie, une seule et même guerre : on le comprend d’emblée en écoutant le témoignage d’un ami d’enfance, Jean Taousson, qui rappelle comment le petit Jackie Derrida, 12 ans, fut exclu de son collège, à Alger, parce que juif sous les lois de Vichy : « Il a pris un coup qui l’a envoyé à terre, mais il s’est relevé tout de suite et à partir de là n’a plus compté que sur lui-même », témoigne-t-il. Cette expulsion brutale, le jour de la rentrée 1942, Derrida n’en est jamais revenu : « Le surveillant général m’a appelé dans son bureau et m’a dit : “Tu rentreras chez toi, tes parents t’expliqueront.” Et je n’ai rien compris, je dois dire », se souviendra plus tard le philosophe.
Le philosophe français Jacques Derrida,
photographié le 06 janvier 2001 dans sa maison à Ris-Orangis, près de Paris.

Or, tout se passe comme si ce « coup » avait été le coup d’envoi d’une trajectoire qui a fait du retrait une stratégie, et des marges une position de combat. C’est là que Derrida s’est tenu, c’est de là qu’il a mené ses batailles. Marges de la langue française, qu’il aima d’un amour fou : « Laisser des traces dans la langue française, voilà ce qui m’intéresse », aimait-il à répéter. Marges de la philosophie, dont il a dynamité une à une les certitudes. Marges de l’université, à laquelle il s’est sans cesse heurté, du moins dans son propre pays : « La France n’aime pas que ceux qu’elle n’a pas reçus soient applaudis ailleurs », résume la philosophe Hélène Cixous.
INTELLECTUEL ENGAGÉ
Alternant lectures de textes et témoignages (les philosophes Jean-Luc Nancy, Avital Ronell, Etienne Balibar et Samuel Weber, l’écrivain Philippe Sollers, l’historienne de la psychanalyse Elisabeth Roudinesco), le film propose également quelques belles images d’archives, qui donnent à voir les différents visages du théoricien de la déconstruction. Derrida le khâgneux, écharpe drapée sous veston studieux, fraîchement débarqué de son Algérie natale et affrontant cette période de concours qu’il évoquera toujours comme des « années infernales ».
Derrida l’agrégatif, auquel Louis Althusser, son maître à Normale-Sup, écrit des mots fraternels, à l’encre bleue, sur du papier d’écolier : « Derrida nous verrons ensemble le détail de ce devoir : il n’aurait aucune chance de passer à l’agrégation. Je ne mets pas en cause la qualité de tes connaissances ni ton intelligence conceptuelle, ni la qualité de ta pensée. Mais on ne les “reconnaîtra” au concours que si tu opères une “conversion” radicale dans l’exposition et l’expression », prévenait le grand théoricien marxiste. Derrida l’intellectuel engagé, jeté dans les prisons tchèques, en 1981, puis menant différentes batailles, contre la peine de mort ou pour la défense des sans-papiers. Derrida la star américaine, enfin, qui inspire Woody Allen et reçoit les hommages de ses groupies étudiantes, avec un sourire faussement modeste mais authentiquement malicieux.
Sans grande audace formelle, ce documentaire propose ainsi une honnête introduction à la vie d’un intellectuel « marginal » dont la gloire fut et demeure internationale.
Jean Birnbaum, Le Monde du 8 octobre 2014.
[2] Cf. « Je suis en guerre contre moi-même », son dernier entretien.
[3] C’est moi qui souligne.
[4] Note (A.G.) : Si Derrida est absent de Femmes, il est bien présent dans le roman de Julia Kristeva, Les samouraïs sous le nom de Saïda. Dire qu’il n’y est pas à son avantage est un euphémisme ! Exaspéré par la légèreté avec laquelle, dans le roman, Julia Kristeva le met en scène dans son opposition à Lacan (« Lauzun » dans le livre), Derrida répliquera, de manière cinglante, dans sa conférence Pour l’amour de Lacan (in Derrida, Résistances — de la psychanalyse, Galilée, 1996, p. 68-69). Il vaut la peine de citer le passage en entier, avec sa longue parenthèse :
« Je n’ai rencontré Lacan que deux fois et l’ai croisé dans un cocktail une troisième fois, longtemps après. Je ne sais pas si cela veut dire que nous avons été ensemble, l’un avec l’autre, mais en tout cas ces deux rencontres n’eurent pas lieu chez (apud) l’un ou l’autre mais chez un tiers, et d’abord, pour la première fois, à l’étranger, en 1966, aux États-Unis où nous nous étions pour la première fois exportés (je dis à dessein « exportés », c’est une citation, parce que vous savez peut-être qu’à travers des pseudonymes que les journalistes disent transparents, le personnage reconnaissable d’un bien mauvais roman (quand je dis mauvais, c’est pour parler « littérature » et non seulement « morale »), se plaignant d’abord de ne pas être traduit à l’étranger, s’en plaignant avec une aigreur dont le papier même paraît imprégné, ce personnage disait tout récemment, dans un seul souffle, que Lacan et moi, Lacan avec moi, alias Lauzun avec Saïda pour les intimes, sommes tous deux des « produits frelatés bons pour l’exportation ». Me trouver dans le même emballage d’exportation avec Lacan aurait plutôt été de mon goût, mais cela n’a pas été supportable et du goût de tous puisqu’un journaliste qui fait la navette entre le comité de Gallimard et Le Nouvel Observateur a tenté de me séparer d’avec Lacan en disant que, pour l’auteur de ce roman consternant, c’était seulement Derrida, car il disait, lui, mon nom, point celui du personnage de fiction, pas même Saïd, Sida ou Saïda qui, cette fois au singulier, citation trafiquée, devient un produit frelaté bon pour l’exportation. Moi tout seul, non plus avec Lacan comme le voulait l’auteur ou le personnage de la fable, mais sans Lacan, moi tout seul désormais, « produit frelaté » dans le compartiment d’exportation, moi tout seul dans ma boîte, déporté, exporté à l’étranger, et pourquoi pas interdit de séjour, moi tout seul, isolé, insularisé par le décret d’un agent de la circulation culturelle. Voilà une des choses qui se passent en France aujourd’hui, dans les grands quartiers de la culture et de la politique dont je parlais en commençant). »
On comprend que, lorsqu’il la rencontre, le 23 mai 2008, Benoît Peeters soit amené à constater que « Julia Kristeva ne s’engage guère » et ajoute :
« Elle parle surtout de Sollers, de la fascination que Derrida aurait éprouvé pour lui. [...] Même si elle s’en défend, Kristeva ne semble avoir aucune sympathie pour Derrida ; elle élude mes questions sur le « Saïda » des Samouraïs, comme si le portrait qu’elle y trace du philosophe de la « condestruction » n’avait rien de négatif. Proust, dit-elle, faisait un peu la même chose... » (p. 83-84).
[5] Jean-Pierre Faye l’aurait également assuré que « Derrida avait tenté de le joindre, pendant les derniers mois. »
[6] Elle me fait penser à « cette anecdote, qui dit beaucoup de choses » que raconte Sollers dans Solitude de Bataille (in Éloge de l’infini, folio, p. 786) : « un jour que j’étais au Pré-aux-clercs avec Bataille, tout près du bureau de Tel Quel, Breton [...], entre et s’asseoit à une table. Je me lève et vais voir Breton qui me dit qu’il est entré dans le café car il suivait une très jolie femme puis me demande : « Est-ce que ça n’est pas Georges Bataille ? » Il va saluer Bataille, ils se serrent la main, avec l’idée de se revoir. Cela a eu une porté très émouvante pour moi, pour les années qui suivent. » Bataille est mort deux ou trois mois après (Michel Deguy, présent lui aussi ainsi que Marcelin Pleynet, évoque également la scène dans le numéro que Les Temps Modernes ont consacré à Georges Bataille en janvier 1999, p. 6).
[7] « ... l’introduction récente de Jacques Derrida à l’Origine de la géométrie, de Husserl. Dans ce dernier texte, Derrida propose comme exemplaires deux options radicales de notre temps : celle de Husserl, justement, et celle de Joyce. » écrit Sollers, Tel Quel 13, p. 94. (A.G.)
[8] Lettre de Philippe Sollers à Derrida, 10 février 1964. Entretien avec Ph. Sollers.
[9] Lettre de Derrida à Philippe Sollers, 16 août 1964.
[10] Lettre de Derrida à Philippe Sollers, 30 septembre 1964.
[11] Lettre de Derrida à Philippe Sollers, 1er décembre 1964.
[12] Lettre de Derrida à Ph. Sollers, 28 février 1965.
[13] Lettre de Ph. Sollers à Derrida, 3 mars 1965.
[14] Jacques Derrida, « La parole soufflée », L’écriture et la différence.
[15] Cf. L’écriture et la différence, p. 261.
[16] Lettre de Paule Thévenin à Derrida, 19 mars 1965.
[17] Lettre de Derrida à Michel Deguy, 20 août 1966.
[18] Lettre de Derrida à Ph. Sollers, sans date (été 1966).
[19] Lettre de Ph. Sollers à Derrida, 27 août 1966.
[20] Lettre de Derrida à Jean Piel, 26 février 1967. L’article de Badiou, intitulé « Le (re)commencement du matérialisme dialectique », paraîtra finalement dans Critique n° 240, mai 1967.
[21] Lettre de Derrida à Ph. Sollers, 21 mars 1967.
[22] Lettre de Ph. Sollers à Derrida, 20 juillet 1967.
[23] Lettre de Derrida à Ph. Sollers, 25 juillet 1967.
[24] « L’étrangère » sera le titre de l’article de Roland Barthes sur Julia Kristeva, paru le 1er juin 1970 dans La Quinzaine littéraire et repris dans Le bruissement de la langue (Seuil, 1984).
[25] Entretien avec Julia Kristeva.
[26] Lettre de Ph. Sollers à Derrida, 28 septembre 1967.
[27] Pour plus de détails sur les débuts de Julia Kristeva en France, on se reportera au livre de Philippe Forest, Histoire de Tel Quel, Seuil, coll. « Fiction & Cie », 1995, p. 249-259.
[28] Lettre de Ph. Sollers à Derrida, 20 juillet 1967.
[29] Lettre de Julia Kristeva à Derrida, 31 octobre 1967.
[30] Cet entretien écrit sera publié dans la revue Information sur les sciences sociales VII en juin 1968, avant d’être repris dans Positions en 1972.
[31] Lettre de Derrida à Ph. Sollers, sans date (décembre 1967 ou janvier 1968).
[32] Lettre de Derrida à Ph. Sollers, 24 avril 1968.
[33] Lettre de Jean-Pierre Faye à Derrida, sans date.
[34] Lettre de Jean-Pierre Faye à Derrida, 2 novembre 1967.
[35] Lettre de Jean-Pierre Faye à Derrida, 8 décembre 1967. Pour plus de détails sur la rupture de Jean-Pierre Faye avec Tel Quel et la création de Change, on consultera le livre de Philippe Forest, Histoire de Tel Quel, op. cit., p 281-288.
[36] La Nouvelle Critique, novembre-décembre 1967, cité in François Dosse, Histoire du structuralisme I, p. 330.
[37] Histoire de Tel Quel, p. 291.
[38] Jacques Derrida, « Une "folie" doit veiller sur la pensée », Points de suspension, p. 358.
[39] Jacques Derrida, Il Gusto del Segreto.
[40] Lettre à Ph. Sollers, sans date (été 1968).
[41] Lettre de Ph. Sollers à Derrida, 24 septembre 1968.
[42] Entretien avec Julia Kristeva.
[43] Lettre de Ph. Sollers à Jacques Henric, 9 septembre 1968, citée par Philippe Forest, Histoire de Tel Quel, op. cit., p. 333.
N’oublions pas que Julia Kristeva est d’origine bulgare. La « passion » rendrait-elle aveugle ? Ou ne peut-on imaginer, dans le couple Ph. S. - J.K., des interrogations plus secrètes que les positions "tactiques" affichées ? (A.G.)
[44] Idem.
[45] Lettre de Jacques Derrida à Ph. Sollers, sans date (octobre 1968).
[46] Ces articles sont repris en 1973 dans le volume Économie et symbolique aux éditions du Seuil.
[47] Entretien avec Jean-Joseph Goux.
[48] Ci-dessous :
Première partie de La dissémination
Critique 261, février 1969 (archives A.G.)

[49] Entretien avec Philippe Sollers.
[50] Entretien avec Jean-Joseph Goux. On se reportera aussi à l’excellente analyse de cette partie d’échecs « sociale, politique et intellectuelle » entre Sollers, Kristeva et Derrida proposée par Philippe Forest dans son Histoire de Tel Quel (op. cit., p. 259).
[51] Lettre de Catherine Clément à Derrida, 4 mai 1970.
[52] Entretien avec Dominique Lecourt.
[53] Entretien avec Dominique Dhombres.
[54] Entretien avec Ph. Sollers. Pour plus de détail sur cette affaire, on consultera Histoire de Tel Quel, op. cit., p. 361-363, ainsi que Histoire de la psychanalyse en France, II, p. 542-543.
[55] L’Humanité, 19 septembre 1969.
[56] Lettre de Jean-Pierre Faye à Derrida, 24 septembre 1969.
[57] La Gazette de Lausanne, 10-11 octobre 1969.
[58] Liens conflictuels notamment dans le cadre du Collège de philosophie, mais pas seulement.
Et cela continue aujourd’hui... Benoît Peeters m’écrit le 10 juin 2011 :
Cher Albert Gauvin,
J’ai reçu aujourd’hui un document qui devrait vous intéresser.
Il s’agit d’un épais numéro de la revue "Passages d’encre", n° 42, coordonné par Jean-Pierre Faye.
L’un des articles de Faye s’intitule "Le temps du grand danger / Lettre à Benoît Peeters" ; c’est une réponse — de 45 pages grand format — à l’envoi de mes deux livres.
Je n’ai pas encore eu le temps de la lire, mais il semble s’agir d’un minutieux plaidoyer pro domo, revenant en détail sur les éternelles vieilles histoires : Heidegger, Klages, le CIPh, etc.
Certaines allusions (à Tel Quel surtout) doivent rester opaques pour la plupart des lecteurs.
Je reste surpris par la publication d’une lettre qui ne m’a jamais été adressée directement.
Mais je vais lire le texte avec attention.Bien à vous.
Benoît.
Voici ma réponse :
Cher Benoît Peeters
Je vous remercie de l’information. J’essaierai de me procurer la revue lors d’un prochain passage à Paris.
J.-P. Faye est un habitué des combats... d’arrière-garde après avoir été un des tenants de l’avant...
Il est des ruptures qui laissent des traces... ineffaçables (un oxymore, aurait dit Derrida). Ainsi celle avec Tel Quel, indéfiniment ressassée.
Quant à Derrida et à Heidegger, cela fait plus de quarante ans de malentendus entretenus !
Combat à ce point harassant que c’est devenu une entreprise familiale depuis que le fiston, Emmanuel Faye, est venu à la rescousse il y a quelques années !
Mais, aujourd’hui comme hier, ne s’agit-il pas de donner le change ?
A.G., 12 juin 2011.
Et... — suite (et non fin) du feuilleton — voici des extraits du texte de J.-P. Faye : Bonnes feuilles de « Lettre sur Derrida » et, cette année, une réplique dans Libération : Un brûlot pour les 30 ans du Collège international de philosophie.
A.G., 29-11-13.
[59] Lettre de Jean-Louis Houdebine à Derrida, 17 mars 1970.
[60] Entretien avec Élisabeth Roudinesco. Voir aussi Histoire de la psychanalyse en France, II, p. 544-545 et Histoire de Tel Quel, p. 350-351.
Note personnelle (A.G.). J’étais à ce colloque. Les tensions furent effectivement extrêmes du premier au dernier jour. La "lutte idéologique" n’était pas un mot creux ! C’est vrai que le "spectre" de Derrida flottait dans l’atmosphère. Les interventions des membres de Tel Quel et de Promesse furent nombreuses, mais peu "derridiennes". Après les violents échanges susmentionnés, je me souviens avoir bu un café avec Catherine Backès-Clément dans un bistrot : son désarroi était total, et son incompréhension (ça n’apparaît pas de manière évidente quand on lit son témoignage, 25 ans après, dans Tel Quel 48/49, printemps 1995). Quelques semaines plus tard, à Lille, devant un amphi rempli d’étudiants et d’universitaires, une véhémente altercation m’opposera à Joseph Venturini qui faisait un compte-rendu très tendancieux du colloque, "au nom du Comité central" du pcf. Je dus, malgré son opposition et à la demande insistante du public qui le fit taire, de pouvoir donner ma version des événements. Les Actes du colloque ne furent publiés par La Nouvelle Critique que plusieurs mois après. Elisabeth Roudinesco peut se flatter après coup d’avoir contribué à empêcher une bien hypothétique "OPA" de Tel Quel sur le "parti" ; son exposé sur Derrida fut, comme elle le reconnaîtra elle-même plus tard, le type même de la confusion ignorante et obscurantiste ! Derrida y répondra d’ailleurs longuement dans Positions en 1972.
[61] Lettre de Derrida à Gérard Granel, 4 février 1971.
[62] Lettre de Jean-Louis Houdebine à Derrida, 20 décembre 1970.
[64] Jacques Derrida, Positions, p. 85.
[65] Ibid. p. 73.
[66] Fragment de lettre cité in Philippe Forest, Histoire de Tel Quel, p. 368.
[67] Cf. Positions, p. 112-113.
[68] Ibid. p. 115-118.
[69] Voir Poe, Freud, Bonaparte, Lacan, « et al. » (A.G.).
[70] Lettre de Jean-Louis Houdebine à Derrida, 30 juillet et 7 août 1971.
[71] Jacques Derrida, « L’ami d’un ami de la Chine », in Aux origines de la Chine contemporaine. En hommage à Lucien Bianco, p. II-III. L’essentiel de la préface de Derrida en pdf
 .
.
[72] En fait Julia Kristeva figure au comité de rédaction depuis le n° 42 de Tel Quel qui date de septembre 1970. (A.G.).
[73] Lettre de Bernard Pautrat à Derrida, 16 octobre 1971.
[74] Lettre de Louis Althusser à Derrida, 29 octobre 1971.
[75] Lettre de Bernard Pautrat à Derrida, 16 octobre 1971.
[76] Pour plus de détails sur ces péripéties tragi-comiques, on se reportera au livre de Philippe Forest, Histoire de Tel Quel, p. 384-441.
[77] Lettre de Louis Althusser à Derrida, 29 octobre 1971.
[78] Lettre de Jean-Louis Houdebine à Derrida, 2 novembre 1971.
[79] Ce passage est cité dans une lettre de J.-L. Houdebine à Derrida, le 12 mars 1972, lorsque la discussion entre les deux hommes se sera envenimée.
[80] Lettre de Derrida à Rodolphe Gasché, 21 décembre 1971.
[81] Lettre de Derrida à Henry Bauchau, 7 janvier 1972.
[82] Lettre de Derrida à Ph. Sollers, 14 janvier 1972.
[83] Lettre de Derrida à Jean-Louis Houdebine, 18 janvier 1972.
[84] Philippe Forest, Histoire de Tel Quel, p. 402.
[85] Lettre de Derrida à Edith Heurgon, 19 janvier 1972.
[86] Lettre de Ph. Sollers à Derrida, 23 janvier 1972.
[87] Cité par Morgan Portès, Ils ont tué Pierre Overney, Grasset, 2008.
[88] Voir note plus haut.
[89] Entretien avec Éric Clémens.
[90] Lettre de Derrida à Éric Clémens, 18 mars 1972.
[91] Ibid.
[92] Politics and Frienship, entretien entre Michael Sprinker et Derrida. Paru dans The Althusserian Legacy. Je cite d’après le manuscrit français conservé à l’IMEC.
[93] Entretien avec Jean Ristat. Derrida remerciera Aragon au lendemain de la publication du dossier le concernant dans Les Lettres françaises. Le 30 mars 1972, il lui écrit qu’il termine la lecture heureuse de son livre Henri Matisse, roman à deux pas de l’immeuble de Cimiez où vivait Matisse.
[94] Les minuscules indiquent toute l’estime que l’auteur de l’article a pour le parti communiste français. Quant à la lettre « r », elle est l’initiale de « révisionniste », l’une des grandes insultes du moment. Dans la phrase suivante, « servir les changes » est bien entendu une allusion à Change, la revue de Faye, honnie par les telqueliens. Quant au mois de juin 71, choisi pour nommer le mouvement, il est celui qui a vu la parution de De la Chine de Macciocchi. Bien d’autres allusions appelleraient un décryptage.
[95] Cf. Tel Quel — mouvement de juin 71 — Informations n° 2-3. Archives IMEC.
[96] Ibid.
[97] Cf. Le Monde, 14 juin 1973.
[98] C’est moi qui souligne. A.G.
[99] Geoffrey Bennington et Jacques Derrida, Jacques Derrida, Seuil, 1991.
[100] Lettre de Ph. Sollers à Derrida, 2 janvier 1982.
[101] Geoffrey Bennington et Jacques Derrida, Jacques Derrida, Seuil, 1991.
[102] Lettre de Derrida à Ph. Sollers, sans date (janvier 1982)
[103] Benoît Peeters, Derrida, p. 659-660.
[104] Cf. mumiabujamal.com.
[105] J’ai découvert Derrida à travers ces trois livres en même temps que je découvrais Tel Quel. Dire que le choc fut profond et durable n’est pas exagérer. Il faut des anecdotes ?
— J’ai vu et entendu, pour la première fois, Derrida en avril 1968. Le 25, très exactement, si j’en crois le bloc-notes que j’ai conservé et qui me servira pendant plusieurs années lors des conférences du Groupe d’Études Théoriques de Tel Quel. La conférence a lieu à Arras et porte sur « Culture et écriture ». Il est question de « la fin du Livre ». J’ai noté : « Le livre comme analogie Homme-Dieu est transgressé par toute pratique d’une écriture non phonétique (chinoise). » (cf. Nombres que Derrida avait lu) Après la conférence, avec un ami, je vais timidement poser quelques questions à Jacques Derrida. Malgré leur évidente naïveté, Derrida les trouve très pertinentes et est, tout le temps de la conversation, d’une extraordinaire attention. Cela marque.
— En septembre 1968, alors que je repasse l’oral d’un certificat d’« Histoire de la philosophie » (l’oral du mois de juillet n’a guère été préparé selon les normes !), je suis interrogé sur Husserl (qui m’a valu 16 au bac). Je cite Derrida. Froncement de sourcils. A la question « qu’est-ce que Derrida a voulu dire ? », je bafouille : « si tant est qu’il est "voulu dire" quelque chose » (je m’apprête à évoquer la problématique du « vouloir-dire » que Derrida questionne dans La voix et le phénomène). Réplique sèche de mon examinateur (un universitaire communiste, spécialiste des sciences, dont je tairai le nom) : « Vous pourriez être poli ! » Je suis partagé entre la stupéfaction et le fou-rire. J’ai oublié ma note (éliminatoire)...
— En février 1969, je repasse pour la troisième fois le même oral avec le même examinateur. A commenter : un passage de L’idéologie allemande de Marx. Je connais. Malgré certaines tensions (mon commentaire doit être un peu trop « althussérien »), cela se passe plutôt bien. A la fin, je demande si cela "va" (il me manque cet oral pour "boucler" ma licence). Une hésitation, puis : « oui, oui ». Le soir, j’ai beau chercher, mon nom n’est pas sur la liste d’affichage des "reçus". Acte manqué ? Je bondis au domicile de mon examinateur qui m’assure que je suis bien reçu. Le lendemain, mon nom a été rajouté entre les lignes.
Depuis cette époque, si j’ai appris à lire entre les lignes, je crois que je le dois, en partie, à Derrida. A.G.
[106] On se souviendra qu’à la même époque, Sollers est plongé dans une réflexion sur le matérialisme qui fera l’objet d’une série d’interventions au Groupe d’Études Théoriques de Tel Quel au printemps (30 avril, 7 et 14 mai). Voir notre dossier.
[107] Une première version de ce texte a paru dans le Times Literary Supplement du 25 septembre 1969 dans un numéro spécial consacré à "L’argent dans l’écriture". Il servira de présentation à la traduction argentine de la Grammatologie, assurée à Cordoba par les Éditions Pasado y Presente dont plusieurs publications ont déjà été interdites. Nous saluons ici la lutte des intellectuels révolutionnaires de cette ville et de ce pays, parallèle à celle de la classe ouvrière, contre la dictature militaire de la bourgeoisie et de l’impérialisme américain.
[108] Tous les mots en caractères gras, à l’exception des noms propres, figurent en italiques dans le texte original.
[109] Elle l’a été, disons-le clairement et une fois pour toutes, par la Grammatologie, à savoir par la transgression que ce texte calcule de la recherche husserlienne et de la "méditation" heideggerienne. D’où l’ignorance (ou la mauvaise foi) de ceux qui croient pouvoir maintenant trouver des traces d’une « science de l’écriture » un peu partout (et par exemple autour du "Cercle de Prague" qui n’a rien à voir avec la question) sans faire référence à Derrida. Censure dérisoire, qui ne saurait abuser personne.
[110] Avec Henri-Charles Puech et René Dussaud, Les anciennes religions orientales, Tome I : La religion égyptienne, PUF, 1944 et 1949.
[111] On sait que pour les Mayas le calendrier lunaire — lié à l’horticulture et à l’établissement des clans matrilinéaires, donc à la prédominance sociale de la femme — a précédé le calendrier luni-solaire lié au développement de l’agriculture patriarcale. De manière générale, nous parlons ici sous la juridiction grecque qui est sans doute celle qui a imposé le plus brutalement la fonction paternelle. C’est à travers elle que nous est imposée la vision d’une « Égypte » qui n’a pas été l’Égypte, pas plus que n’est la Chine celle avec laquelle notre culture a cru longtemps se mesurer et se rassurer.
[112] Cf. La Voix et le Phénomène, l’Écriture et la Différence [sic : on sait que Derrida ne voulait pas de majuscules. A.G.] (notamment : sur Freud, Artaud, Bataille) ; la Pharmacie de Platon (Tel Quel, 32, 33) ; la Dissémination (Critique n° 261-262) ; la Double Séance (à paraître).
[113] Cf. Niveaux sémantiques d’un texte moderne, (Théorie d’ensemble).
[114] "Toute la conceptualité philosophique faisant système avec l’opposition nature/culture est faite pour laisser dans l’impensé ce qui la rend possible, à savoir l’origine de la prohibition de l’inceste."
[115] Lors d’une série d’interventions au Groupe d’Études Théoriques de Tel Quel de mai 1969 à janvier 1971. Cf. Sur le matérialisme, Seuil, coll. Tel Quel, 1974. Note Pileface.
[116] La notion de "mode de production asiatique" et les schémas marxistes d’évolution des sociétés, Centre d’études et de recherches marxistes, 1964. Note de Pileface.
[117] « Les traces ne produisent donc l’espace de leur inscription qu’en se donnant la période de leur effacement. »
[118] « Dans le hasard absolu, l’affirmation se livre aussi à l’indétermination génétique, à l’aventure séminale de la trace. »
[119] Cf. Leroi-Gourhan.
[120] Pour une première analyse, rigoureuse et systématique, de ce qui aura été dévoilé par Marx et Freud de la genèse structurale de l’"équivalent général", voir le texte fondamental de Jean-Joseph Goux, Numismatiques (Tel Quel 35, 36) qui prévoit théoriquement cette "anamnèse historiographique" sans précédent... qui devrait faire porter sa rétro-action jusqu’aux commencements de l’animal humain ».
[121] Chaque nouvelle grande pensée trouve immédiatement, on le sait, son bouffon ou son diffamateur. Les deux rôles réunis en un seul, sont ici tenus par M. Jean Pierre Faye, notamment dans un article intitulé « Le camarade Mallarmé » étrangement publié dans l’Humanité du 12 septembre 1969, journal qui a pu compter ainsi soudainement, parmi ses collaborateurs, un "compagnon" des plus singuliers (lequel, par amalgames et insinuations, laisse entendre que Derrida reprend une « idéologie nazie »). Voir, sur cette basse provocation et la faille intellectuelle qu’elle suppose, les mises au point immédiates de Claude Prévost et Philippe Sollers dans l’Humanité du 19 septembre (reproduites ici même en fin de numéro) [voir ci-joint la réponse de Sollers à Faye. A.G.]. Dans l’ordre du bouffon simple, on se reportera à l’anodin pamphlet intitulé les Matinées structuralistes qui peut obtenir la palme de l’écho mondain et réactionnaire actuel (cf. l’article d’un certain Palmier dans Le Monde du 1er novembre 1969).






 Version imprimable
Version imprimable
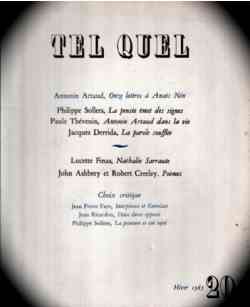



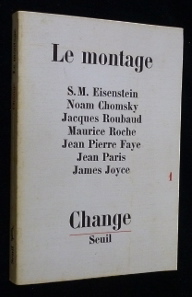



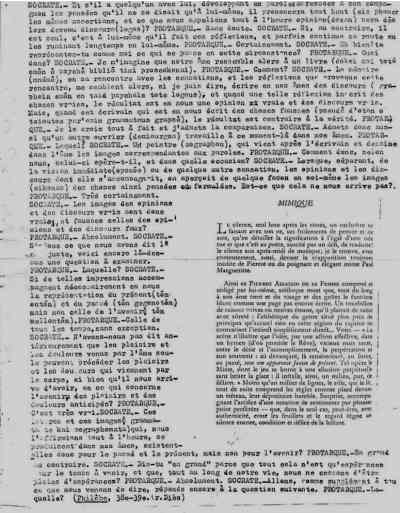

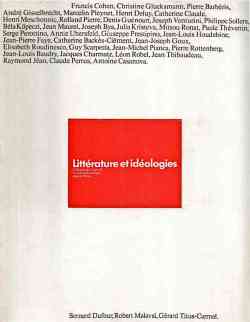
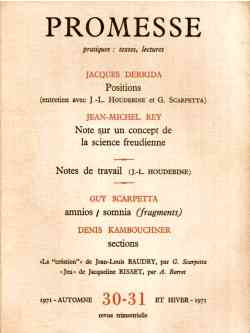



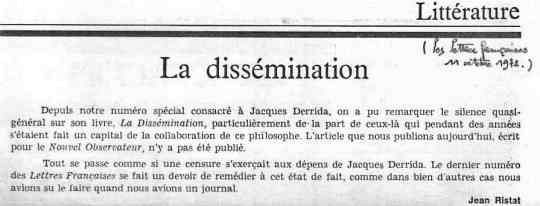






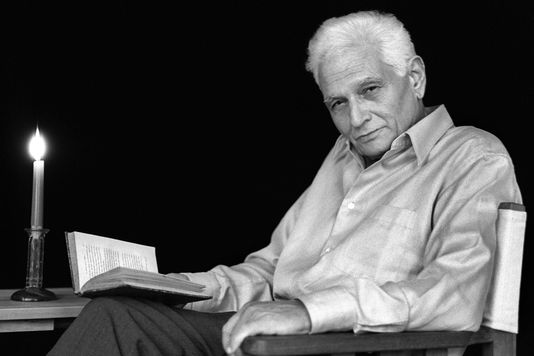
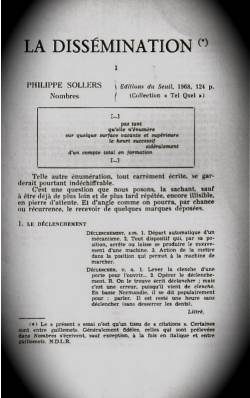
 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?



12 Messages
Mais qu’est-ce que la déconstruction ?
Avec philosophie, vendredi 27 janvier 2023.
Avec
Denis Kambouchner philosophe et professeur de philosophie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de Descartes
Anne-Emmanuelle Berger Professeure émérite de littérature française et d’études de genre à l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, essayiste et théoricienne. Elle a co-fondé en 2014 et longtemps dirigé l’UMR LEGS (CNRS/ Paris 8/ Paris Nanterre), premier laboratoire de recherche interdisciplinaire dédié aux études de genre et de sexualité en France.
ECOUTER ICI.
En janvier 2022, s’est tenu à la Sorbonne un colloque intitulé "Après la déconstruction. Reconstruire les sciences et la culture". Multipliant les contresens, les intervenants de ce colloque se sont attaqués aux recherches féministes et décoloniales, au soi-disant "wokisme" et par-dessus tout à la "déconstruction", dénoncée comme une entreprise "nihiliste". Sous ce nom, ils s’en sont pris aux œuvres les plus créatives de la philosophie française contemporaine, celles de philosophes comme Jacques Derrida, Michel Foucault, ou Gilles Deleuze.
Nous ne pouvons pas laisser dire que la déconstruction est destructrice, alors qu’il s’agit d’une démarche affirmative et inventive, qui s’efforce de redonner du jeu et de la vie à la pensée. C’est pourquoi nous organisons en janvier 2023 un colloque intitulé "Qui a peur de la déconstruction ?" afin de donner à entendre les voix de celles et ceux qui se revendiquent, à un titre ou un autre, de cet héritage intellectuel.
Nous voulons montrer comment la déconstruction a essaimé de manière féconde dans différents domaines de la recherche. En mettant en question les préjugés phallocentriques, elle a rendu possible l’analyse de la construction des identités de genre et un renouveau de la théorie psychanalytique. En s’interrogeant sur la prédominance de la métaphysique occidentale, elle a favorisé l’écoute de pensées subalternes et l’essor des recherches décoloniales.
Derrida en était venu à identifier la déconstruction avec la promesse d’une "démocratie à venir". C’est bien la démocratie qui est en jeu et en danger dans l’Université et la société. C’est la liberté d’exercice et de diffusion de la pensée que nous voulons réaffirmer.
Isabelle Alfandary, professeur à l’Université de la Sorbonne Nouvelle, ancienne présidente du Collège international de philosophie
Anne Emmanuelle Berger, professeure émérite de littérature française et d’études de genre, Université Paris-8 / CNRS, Visiting Melodia E.Jones Chair, University at Buffalo.
Jacob Rogozinski, professeur émérite à la Faculté de philosophie de Strasbourg
LE PROGRAMME
LIRE AUSSI : Des disciples de Derrida élèvent le débat autour de la déconstruction et du wokisme
« On peut se demander si ceux qui accusent la déconstruction derridienne d’être uniquement destructrice ont lu Derrida »
par Jacob Rogozinski
« L’apparition d’une pensée forte a toujours suscité la jalousie hargneuse des médiocres et ils l’ont à chaque fois accusée d’être “destructrice” », note le philosophe Jacob Rogozinski, indigné par la mise en cause de Jacques Derrida (1930-2004) lors du colloque des 7 et 8 janvier en Sorbonne. LIRE ICI.
Réveille-toi Derrida, ils sont devenus fous !…
par Daniel Bougnoux
Un curieux renversement – pour ne pas dire une étrange défaite – frappe ma génération, celle qui a commencé sa carrière d’enseignant dans les années 1960-1970. LIRE ICI.
Mort en 2004, adulé aux Etats-Unis, Jacques Derrida n’a cessé d’inspirer les intellectuels des pays émergents. En Afrique, en Inde, en Chine, sa pensée nourrit la remise en question des grands dualismes noir/blanc, Orient/Occident, modernité/tradition, homme/femme… LIRE ICI.
Valéry, Derrida : quelle Europe ?
par Benoît Peeters 23 avril 2019
« L’Europe n’a pas été donnée d’emblée à Valéry. Souvenons-nous qu’il est né en 1871, au lendemain de l’écrasement de l’armée française par les troupes prussiennes. Il grandit dans une France amputée et avide de revanche. »
« L’Europe n’a pas été, pour de tout autres raisons, l’horizon premier de Jacques Derrida. Né en 1930 à Alger, de l’autre côté de la Méditerranée, dans cette Algérie qui, comprend-il très tôt, n’est pas tout à fait la France. Déchu de la nationalité française en tant que juif par le gouvernement de Vichy, entre 1940 et 1942, puis tiraillé entre plusieurs cultures, Derrida ne se sentira jamais "tout à fait européen" ». LIRE ICI
« Expliquez-moi Derrida » : c’est le titre de la série d’émissions qu’Adèle Van Reeth consacre cette semaine au philosophe mort il y a déjà treize ans et dont on continue de publier de nombreux inédits (dernier en date : Théorie et pratique. Cours de l’ENS-Ulm 1975-1976). Dans la première émission, Benoît Peeters, auteur en 2010 de la riche biographie dont je rend compte partiellement (et partialement) dans l’article ci-dessus, revient sur le parcours de Jacques Derrida d’Alger à Paris.
Crédit France Culture
Entretien avec Benoît Peeters :
Partie I : La pratique du genre biographique
Partie II : Le cas de Jacques Derrida
Derrida - le courage de la pensée
Un film de Virginie Linhart et Benoît Peeters (France, 2014, 52 min).
A l’occasion du dixième anniversaire de sa mort, portrait du philosophe, théoricien de la déconstruction.
Avec les témoignages de Marguerite Derrida, Étienne Balibar, Lucien Bianco, David Carroll, Hélène Cixous, Alexander Düttmann, Jean-Luc Nancy, Avital Ronell, Elisabeth Roudinesco, Philippe Sollers, Samuel Weber. Voir ici.
« Jacques Derrida. Le courage de la pensée », un film de Virginie Linhart et Benoît Peeters, sera diffusé sur Arte mercredi 8 octobre à 22 h 25.
Zoom : cliquer sur l’image.
« C’est un film de 52 minutes, ne l’oubliez pas. Il fallait des partis pris. Nous avons choisi de montrer avant tout Jacques Derrida dans l’Histoire et dans sa trajectoire personnelle, pour donner envie de le lire. Je vais bien sûr beaucoup plus loin dans la biographie parue chez Flammarion. » Benoît Peeters.
Pour la biographie, voir le dossier ci-dessus. Voir aussi Images de Jacques Derrida.
« Derrida », la biographie de Benoît Peeters, traduite en plusieurs langues, est parue en chinois chez Renmin University Press.
Préface à l’édition chinoise
C’est pour moi une joie et un honneur de voir cette première biographie de Jacques Derrida traduite aujourd’hui en chinois.
Si l’auteur de L’écriture et la différence et de Spectres de Marx ne s’est rendu en Chine qu’une seule fois, en 2001, c’est très tôt qu’il avait commencé à s’intéresser à la langue et à la civilisation chinoise. Alors qu’il était élève de l’École Normale Supérieure, en 1953, Derrida occupait en effet la même chambre — la même thurne dans le jargon qui prévalait rue d’Ulm — que Lucien Bianco, lequel s’était mis à étudier le chinois. C’est à Bianco, écrivit Derrida dans un beau texte d’hommage — « L’ami d’un ami de la Chine » — qu’il devait « tout ce qu’il avait appris à comprendre, et à penser, de façon inquiète, critique, mouvementée, de la Chine moderne » . Un demi-siècle durant, Lucien Bianco fut le principal interlocuteur de Jacques Derrida pour tout ce qui concernait la Chine, sa langue, son histoire et ses bouleversements politiques. Et c’est notamment grâce à ce fin connaisseur et cet esprit indépendant que le philosophe fut préservé des errements idéologiques et des fantasmes de beaucoup d’intellectuels français de sa génération.
Les contacts concrets de Bianco avec la Chine commencèrent très tôt. Pendant l’été 1954, il eut la chance, grâce à Louis Althusser, d’être invité à parcourir la Chine pendant deux mois et demi, avec un groupe des Amitiés franco-chinoises dont faisait également partie Félix Guattari. À son retour, le futur auteur de Les Origines de la révolution chinoise (Gallimard, 1967) était intarissable sur son voyage et Derrida fut son interlocuteur privilégié. Bianco et lui partageaient alors la même voiture — une antique Citroën C4 de 1932 qui ne roulait plus qu’à peine — et le même abonnement au journal Le Monde. Ils partageaient surtout les mêmes convictions politiques, résolument de gauche, mais tout à fait anti-staliniennes. Avec quelques autres étudiants de l’École Normale Supérieure, dont Pierre Bourdieu, ils venaient de fonder le « Comité des intellectuels pour la défense des libertés », regroupant la gauche non communiste.
Chacun suivit ensuite son chemin, et plusieurs années durant — on le verra dans la première partie de cette biographie — c’est la question algérienne qui fut pour Jacques Derrida la plus déterminante sur le plan politique comme sur le plan personnel. Mais philosophiquement, la question de l’écriture — ce grand refoulé de la métaphysique occidentale — était au cœur de son travail. Et tandis qu’il préparait De la Grammatologie, l’ouvrage qui le rendrait bientôt célèbre, il interrogeait régulièrement Bianco sur les spécificités de la langue chinoise, regrettant de ne pouvoir l’étudier de plus près.
À l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm, où Derrida enseignait depuis 1964, la Chine de Mao-Tse-Toung exerçait désormais une fascination bien plus grande que l’URSS sur les étudiants les plus politisés. Et au comité de rédaction de la revue Tel Quel, où il publiait certains de ses textes majeurs, l’engouement pour une Révolution culturelle dont on n’avait qu’une idée bien approximative prenait des allures caricaturales. Derrida conservait une distance vigilante, malgré les pressions insistantes dont il faisait régulièrement l’objet. Dans son hommage à Lucien Bianco, il évoque ces années de l’après-Mai 68 où « les sommeils dogmatiques les plus inquiétants, les plus menaçants parfois, les plus comiques aussi, dominaient la scène d’une certaine culture parisienne ».
La question chinoise était devenue un enjeu majeur, pour Philippe Sollers comme pour Jean-Luc Godard. Publié en 1971 aux prestigieuses éditions du Seuil, De la Chine, le récit lyrique par Maria Antonietta Macciocchi d’un voyage de trois semaines, allait déclencher une intense polémique. Lorsque Derrida l’avait interrogé, Bianco ne lui avait pas dissimulé son exaspération face à ce volume de lourde propagande, rempli d’erreurs et de complaisances. En janvier 1972, “l’affaire Macciocchi” allait provoquer une douloureuse rupture avec Tel Quel et avec Philippe Sollers.
C’est dans une lettre au jeune philosophe belge Eric Clémens, le 18 mars 1972, que Derrida s’est expliqué le plus en détail sur ce conflit. Il commence par rappeler à son interlocuteur qu’il n’a bien évidemment aucune hostilité contre la Chine : « Sur le plan historico-théorique et dans le champ qui nous est commun, je ne crois pas avoir été le dernier à m’y référer. Sur le plan politique le plus actuel, rien contre non plus. » Mais aux yeux de Derrida, une analyse rigoureuse reste à faire et elle promet d’être difficile. En attendant, il tient à garder « la vigilance critique la plus froide » à l’égard de ce que l’intelligentsia parisienne désigne sous le nom de Révolution Culturelle. L’avenir ne tardera pas à lui donner raison. Et c’est le même Derrida, longtemps soupçonné d’apolitisme, qui en 1993, de manière volontairement intempestive, publiera le superbe Spectres de Marx, première tentative de repenser le marxisme après la chute du Mur de Berlin et la fin de l’URSS.
Un voyage en Chine avait été projeté dès la fin des années 1980, mais les événements de Tien-An-Men avaient conduit à son annulation. Ce n’est qu’en 2001 que le projet peut enfin se concrétiser. À cette époque, sept livres de Derrida ont été traduits en chinois, mais la plupart l’ont été à partir de la version anglaise, ce qui suscite bon nombre d’approximations et de malentendus. Jacques Derrida espère trouver de bons interlocuteurs pour relancer les publications sur des bases plus rigoureuses. Avant le départ, c’est bien sûr à son vieil ami Lucien Bianco que Derrida demande quelques conseils : quels sont les sujets sur lesquels le public chinois sera le plus désireux de l’entendre ? est-il possible d’évoquer une question qui lui tient particulièrement à cœur, celle de la peine de mort.
La première conférence, prononcée le 4 septembre 2001 à l’Université de Pékin, a pour thème « Le pardon, l’impardonnable et l’imprescriptible ». Deux autres conférences, plusieurs séminaires et de nombreuses interviews ponctueront le voyage qui le mène de Pékin à Nankin, Shanghai et Hong Kong. Le marxisme n’est pas mort, déclare notamment Jacques Derrida aux étudiants chinois qu’il rencontre. Sans pour autant s’en réclamer lui-même, le philosophe est persuadé que ce courant de pensée peut retrouver force et pertinence, s’il parvient à se délivrer des dérives totalitaires auxquelles il a parfois servi d’alibi .
Le voyage lui-même est un grande réussite. Derrida ne cache pas sa fascination pour la puissance et la modernité de la Chine, l’ampleur des bâtiments et des chantiers qu’il a l’occasion de découvrir. Il est tout aussi sensible à la qualité de l’accueil qui lui est réservé ; partout, il est reçu comme un personnage de premier plan et ne peut faire le moindre pas sans être photographié. Mais ce qui le réjouit le plus, ce sont les nombreux projets de traduction de ses livres, à partir de leur version française cette fois.
C’est à Shanghai, presque au terme de son voyage, que Jacques Derrida se trouve le 11 septembre. « C’était le soir, là-bas, racontera-t-il quelques semaines plus tard à Giovanna Borradori. Le patron du café où je me trouvais avec des amis nous annonce qu’un avion a “crashé” sur les Twin Towers. Je rentre précipitamment à l’hôtel et dès les premières images télévisuelles (...) il était facile de prévoir que cela allait devenir aux yeux du monde ce que vous avez appelé un “événement majeur”. » Et Derrida en propose une première analyse, à chaud, dans la conférence qu’il donne à Hong-Kong.
Je conclurai cette rapide évocation des relations de Derrida et de la Chine par une question essentielle, aussi mystérieuse que fascinante. Comment une pensée aussi profondément inscrite dans la langue française que celle de Jacques Derrida peut-elle aussi bien passer les frontières ? De quelle manière est-elle lue et perçue dans une tradition aussi différente que celle de la Chine ? Comment l’expérience de la pensée dans la langue révélée par des concepts tels que la différance, la déconstruction ou l’hantologie, comment la traversée minutieuse d’œuvres littéraires aussi liées aux ressorts de la langue française que celles d’Antonin Artaud, Francis Ponge, Maurice Blanchot et Jean Genet peuvent-elles survivre à la traduction dans une langue dont les ressorts sont absolument autres ?
La réponse à ces questions, c’est aux lecteurs chinois qu’elle appartient. Elle ouvre à elle seule un immense champ de travail et de réflexion. J’espère en tout cas que la présente biographie les aidera à entrer plus facilement dans cette œuvre majeure de la seconde moitié du vingtième siècle et qu’elle leur fera découvrir un homme fragile, génial et attachant.
Benoît Peeters.
Paris, le 17 avril 2013.
1. « Derrida » traduit en chinois, 29 novembre 2013, 10:25, par A.G.
PS : sur les rapports, évoqués par Benoît Peeters, entre Derrida, Tel Quel, la Chine et la rupture qui s’ensuivit, voir ci-dessus 1971 : De la Chine.
J’ai appris cet après-midi avec tristesse que Philippe Bonnefis, écrivain, Professeur émérite à l’Université Charles de Gaulle Lille III, Asa Candler Professor at Emory University, Atlanta (où il se sentait le mieux), était mort le 5 mai 2013. Son dernier livre, Une colère d’orgues, consacré à son ami Pascal Quignard était sorti en janvier 2013. Il me l’avait dédicacé : « Pour Albert Gauvain (sic), ce signe d’existence. » J’étais loin de me douter qu’il n’en avait plus que pour quelques mois. Nous ne sommes pas revus. C’est trop con.
Sa biographie, rédigée, je crois, par lui-même, et sa bibliographie sont sur le site des éditions Galilée.
Complice de ses réflexions au début des années 70 (longues discussions), je ne l’ai revu qu’en juillet 2009, complètement par hasard, feuilletant une vieille édition de Melmoth (gros livre à couverture rouge), sur un étal de bouquiniste, à Charleville. J’allais visiter le musée Rimbaud, poète qu’il aimait beaucoup. Nous avons passé deux heures à discuter à bâtons rompus dans un café (« littérature et philosophie mêlées »). En novembre 2009, j’étais à l’hommage qui lui fut rendu à "Cité-philo" à Lille, puis, en 2010, lors de la présentation de son très beau livre sur Valerio Adami, en compagnie du peintre (voir mon commentaire ci-dessous). Le livre que je préfère de lui : son Céline, publié en 1997.
Philippe Bonnefis était quelqu’un de bien.
Le « portrait allégorique » de Jacques Derrida que j’ai fait figurer au début de ce dossier fut réalisé par Valerio Adami le 21 janvier 2004 quelques mois avant la mort du philosophe. Il fut commenté, avec d’autres « portraits littéraires », par Philippe Bonnefis et l’artiste lors d’une conférence aux musée des Beaux-Arts de Lille le dimanche 21 novembre dans la soirée. Pendant tout le débat qui suivit, la reproduction du portrait de Derrida fut projetée sur l’écran qui se trouvait derrière les intervenants.
Valerio Adami et Philippe Bonnefis, Lille, 21 novembre 2010 (photo A.G.)
Valerio Adami et Philippe Bonnefis, Lille, 21 novembre 2010 (photo A.G.)
Philippe Bonnefis, Valerio Adami - Portraits littéraires