L’année qui s’achève aurait pu être celle de Georges Bataille dont c’était le cinquantenaire de la mort. A de rares exceptions près dont j’ai rendu compte [1], il n’en fut rien. 2013 sera l’année du centenaire de la naissance d’Albert Camus et la commémoration, déjà, est lancée. France Culture l’annonçait cette semaine : « L’année sera donc camusienne ou ne sera pas. » « Avant que les réjouissances ne laissent place à la lassitude puis à la saturation », une série d’émissions, d’ailleurs fort intéressantes, ont donc été consacrées à l’écrivain. La dernière donnait la parole à Michel Onfray qui ravivait une fois de plus l’opposition, ô combien datée, entre Camus et Sartre (cf. Camus et moi). Comme s’il ne s’était rien passé, rien écrit, rien pensé depuis soixante ans !
Breton et Bataille étant indisponibles, Sollers ayant, une fois de plus, fugué, je profite de ce passage d’un cinquantenaire discret et, somme toute, dérangeant et clivant, à un centenaire que tout annonce unanime et consensuel pour vous donner à relire ce dossier dont, trois ans après l’avoir rédigé, je vois, finalement, bien peu de lignes à changer.
Première mise en ligne le 23 novembre 2009.

Camus au Panthéon ?
Depuis l’annonce par le journal Le Monde de la nouvelle initiative de Nicolas Sarkozy (« Faire entrer Albert Camus au Panthéon, ce serait un symbole extraordinaire »), la bataille fait rage ! Non ! dit le philosophe Michel Onfray pour qui « Albert Camus est un libertaire irrécupérable », qui « proposait un hédonisme tragique » et « voulait la justice et la liberté [...] » [2]. Pourquoi pas ? déclare Alain Finkelkraut : « C’est l’un des très rares penseurs du XXe siècle qui ait posé des limites à l’empire de l’Histoire, c’est-à-dire de l’Homme. » « Le caractère écrasant de la consécration me paraît contraire aux notions que Camus a approfondies. Pour moi, Camus c’est l’auteur de l’Homme révolté, l’héroïsme de la mesure. Je ne vois pas le Panthéon glorifiant l’héroïsme de la mesure. Camus a été totalement libertaire. Jamais le reniement du totalitarisme ne l’a fait rejoindre le centre ou la droite », écrit, de son côté, Jean Daniel.
Alors, Panthéon ou pas, Camus, objet d’un large consensus ? Avant la droite sarkozienne (décidément sans vergogne), les anarchistes, mais aussi des socialistes le revendiquaient. Cela continue aujourd’hui. Jeanyves Guérin, qui vient de publier un « Dictionnaire Albert Camus » (Bouquins, Robert Laffont), le rappelle :

« Il faut de nouvelles références aux socialistes. Ils se mettent alors tous à citer Camus, avec plus ou moins de conviction. Même si Badinter et Maurois avaient vraiment de la sympathie pour lui, Mitterrand par exemple avait assez peu d’affinités avec l’auteur de "La Peste" : son machiavélisme s’accordait assez mal à l’humanisme de l’écrivain... Mais depuis, il y a bien un recours massif au Camus citoyen. Chez Ségolène Royal comme chez Dominique Voynet. Tous les courants modernistes démocratiques se sont mis à le citer. Il n’y a guère qu’au Front national, ou sans doute du côté de Chevènement, qu’on s’en est abstenu. Et tandis que le nombre de lycées et collèges Albert-Camus bat désormais des records, on trouve des kilomètres de boulevards Albert-Camus dans les villes socialistes... »
De quoi surprendre les thuriféraires de celui qui déclarait : « Bakounine est vivant en moi », et qui, après avoir reçu son Prix Nobel et prononcé son fameux Discours de Stockholm, accorda, de Stockholm, sa première interview à la revue anarcho-syndicaliste Arbetarem [3] ! Mais faut-il vraiment s’en étonner ?
Camus, référence obligée pour un nouvel humanisme, une nouvelle morale ? Cela semble aller de soi. Peut-on s’en contenter sans un plus ample examen ?
Une voix divergente se fait, très tôt, entendre dans ce concert, celle de Philippe Sollers qui, dès 1960 (il a 23 ans, Camus est mort trois mois plus tôt, d’ « une mort, particulièrement atroce »), dans le premier numéro de la revue Tel Quel, consacre à Albert Camus un article, nuancé mais déjà critique, dans lequel il pointe chez l’auteur de L’Étranger, de Noces et de L’Été (livres dans lesquels il salue « tel ou tel passage dicté par un air lumineux et vif, qui semble soudain plus vrai et d’une évidence [...] criante »), une « contradiction »
« une contradiction esthétique entre une pensée trop vive pour son style qui, à la fin, ne la supporta plus, et revint de lui-même à une matière rassurante » — « muni d’une morale simplifiée. » [4]
Jugement qui, semble-t-il, n’a pas changé puisque Sollers republiera ce texte en 1996 dans L’Infini 54 [5].
Lautréamont-Camus-Breton
Philippe Sollers, cinquante plus tard, écrit ironiquement sur son site officiel : « Camus au Panthéon ? Nous avons reçu les réponses de Lautréamont et André Breton. » C’est cette fois le chapitre VIII du Chant sixième de Maldoror qui est convoqué [6].
Pourquoi Lautréamont ?
J’ai déjà eu l’occasion de rappeler, lors de la publication des Oeuvres complètes de Lautréamont ce que ce dernier pensait de son appartenance à l’humanité et, donc, de tout humanisme possible :
« Était-ce comme une récompense ? Objet de mes voeux, je n’appartenais plus à l’humanité ! Pour moi, j’entendis l’interprétation ainsi, et j’en éprouvai une joie plus que profonde. » (Les Chants de Maldoror, Chant IV) [7].
Albert Camus, en 1951, dans un article publié dans Les Cahiers du Sud — Lautréamont et la banalité [8] —, voit dans Les Chants de Maldoror « le livre d’un collégien presque génial » (!), « une révolte nihiliste », et dans les Poésies des « banalités laborieuses », un « morne anticonformisme » ou « un conformisme métaphysique », voire « la morale de l’enfant de choeur et du manuel d’instruction militaire » ! On a vu jugement plus inspiré.
André Breton répond dans Sucre jaune (Arts, 12 octobre 1951). Le titre de son article reprend les mots d’Isidore Ducasse dans Poésies I :
« ... Allez, la musique.
Oui, bonnes gens, c’est moi qui vous ordonne de brûler, sur une pelle rougie au feu, avec un peu de sucre jaune, le canard du doute, aux lèvres de vermouth, qui, répandant, dans une lutte mélancolique entre le bien et le mal, des larmes qui ne viennent pas du cœur, sans machine pneumatique, fait, partout, le vide universel. C’est ce que vous avez de mieux à faire. »
La réplique de Breton est cinglante :
- André Breton, vers 1950
« "Morale" : il y a de quoi s’émouvoir dès les premiers mots. Lautréamont "est, comme Rimbaud, celui qui souffre et qui s’est révolté ; mais, reculant mystérieusement (sic) à dire qu’il se révolte contre ce qui est, il met en avant l’éternel alibi de l’insurgé : l’amour des hommes". Outre que rien n’est plus faux (Lautréamont déclare qu’il s’est "proposé d’attaquer l’homme et Celui qui le créa"), il est atterrant au possible de voir quelqu’un qu’on pouvait tenir pour un homme de coeur dénier à l’insurgé le sentiment d’agir non pour son seul bien mais pour celui de tous. »
Breton conclut son article par ses mots sans appel :
« Il n’y aurait encore que demi-mal si l’indigence de ces vues ne se proposait d’élever la thèse la plus suspecte du monde, à savoir que la "révolte absolue" ne peut engendrer que le "goût de l’asservissement intellectuel". C’est là une affirmation toute gratuite, ultra-défaitiste qui doit encourir le mépris plus encore que sa fausse démonstration.
On ne saurait trop s’indigner que des écrivains jouissant de la faveur publique s’emploient à ravaler ce qui est mille fois plus grand qu’eux. Il n’y a pas si longtemps qu’on nous présentait un Baudelaire tout "absence de vie ou destruction de la vie", en proie à une "tension vaine, aride", se tuant volontairement "à la petite semaine" et dont les caractéristiques étaient "frigidité, impuissance, stérilité, absence de générosité, refus de servir, péché". "Je parierais, allait jusqu’à s’exalter l’auteur du portrait, je parierais qu’il préférait les viandes en sauce aux grillades et les conserves aux légumes frais." [9] Ces messieurs ont la vie facile : qu’ils supportent qu’on les rappelle parfois à quelque décence. » [10]
Camus s’est donc lourdement trompé sur Lautréamont [11]. Cet aveuglement signe sans doute les limites de l’écrivain et du "philosophe" — et ce sont sans doute aussi ces limites et cet aveuglement qu’on encense aujourd’hui. Il est bon de le rappeler car là est l’essentiel si l’on parle de poésie (ou de « littérature »).
L’affaire de « L’Homme révolté » (I)
Camus fut-il pour autant toujours cet objet de consensus intéressé ? Peut-il être réduit à l’un de ces « écrivains jouissant de la faveur publique » dont parle Breton ? Force est de reconnaître qu’il n’en est rien. Georges Bataille, en décembre 1952, écrivait :
« Camus se révolte contre l’histoire : [...] cette position est intenable. Il se condamne à la louange de ceux qui ne l’entendent pas, à la haine de ceux qu’il voudrait convaincre. »
Et Jacques Henric le rappelait il y a quelques mois :
« Voilà donc deux écrivains, Camus et Mauriac [12], dont avec le recul il apparaît d’évidence qu’ils furent ceux qui, confrontés aux événements tragiques du 20e siècle (la guerre d’Espagne, les fascismes, l’antisémitisme, le stalinisme, Vichy, l’Occupation, la Collaboration, l’Epuration, les guerres coloniales, celle d’Algérie particulièrement, les événements de Hongrie de 1956, l’existence d’Israël menacée,..) furent les plus clairvoyants, les plus intellectuellement courageux. »J. Henric, Politiquement justes, surtout pas corrects, art press, janvier 2009
En 1951-1952, au moment où a lieu la polémique sur Lautréamont et où paraît L’Homme révolté (dont le texte sur Lautréamont n’est qu’un des extraits [13]), Albert Camus est non seulement l’objet des attaques de Breton — justifiées pour ce qui est de Lautréamont —, il est aussi l’objet d’une violente polémique en provenance des Temps Modernes, la revue de Jean-Paul Sartre (c’est de là que viendra la rupture entre les deux hommes). Et, devant ces attaques simultanées, une autre voix, là aussi, se fait entendre. Et quelle voix ! celle de l’auteur de Madame Edwarda, de L’expérience intérieure et de La part maudite : la voix de Georges Bataille. Dans les numéros 55 (décembre 1951) et 56 (janvier 1952) de la revue qu’il dirige — Critique — Bataille défend en effet Camus et L’Homme révolté (dans lequel il voit un livre capital), contre Breton, mais entend aussi « montrer non seulement l’accord essentiel de Breton et de Camus, mais une coïncidence de la position qui leur est commune avec celle [qu’il a] prise de [son] côté. » [14] Un an plus tard, en décembre 1952, suite au numéro de mai des Temps Modernes consacré à Camus, Bataille prendra à nouveau la défense de Camus dans le n° 67 de Critique : c’est L’affaire de « L’Homme révolté ».
Évidemment le Bataille des années cinquante est un homme seul (plus encore que Camus). Il recherche en Camus un allié qui cherche à fonder une morale sur la révolte (une « hypermorale » pour Bataille). Cela ne doit pas masquer la différence entre les pensées de l’un et de l’autre. Bataille le notait déjà en 1949 dans Le bonheur, le malheur et la morale d’Albert Camus :
« J’aimerais marquer [...] à quel point je me sens proche d’Albert Camus. [...] Je vois néanmoins une opposition profonde entre l’auteur de La Peste et moi. Et même il se peut qu’en découle un malentendu que rien ne saurait résoudre.
Je ne puis me soumettre à ce qui est, je ne puis me résoudre à servir un principe établi, la question mortelle est pour moi de ne jamais rien placer au-dessus d’une possibilité sans limite ferme, à laquelle nous pourrions donner — méchanceté ? honnêteté ? — le nom péjoratif de caprice. La vie, le monde ne sont rien à mes yeux sinon le caprice ; c’est la raison pour laquelle je me sens tout à fait étranger, tout à fait hostile à ce qui me dérange, même si l’on me dérange au nom de la loi [...] » [15]
Aussi bien n’est-il pas question de lire Bataille à partir de Camus, mais bien de proposer de lire Camus (et Breton !) à partir de Bataille — ce que personne ne fait.
Même si, en un sens, tout cela est daté, il m’a semblé qu’il était intéressant de republier ces textes (d’ailleurs peu connus, peu cités) [16]. Ils incitent en effet à relire Camus autrement — en tout cas le Camus de L’Homme révolté pris (et compris) dans le contexte de l’époque (ce que fait admirablement Bataille) —, un Camus qui vaut sans doute mieux que la réputation qu’on lui faisait hier (« philosophe pour classes terminales ») ou qu’on tente de lui faire aujourd’hui (« le nouveau philosophe » [17] d’une droite et d’une gauche en mal de "morale").
Bataille écrit à la fin du Temps de la révolte :
« On pourrait douter que la révolte de Camus puisse être confondue avec une exigence de souveraineté.
Ce qui me semble de nature à passer outre est l’intérêt marqué par l’auteur, à l’encontre de tous les théoriciens politiques, pour les positions morales données dans la poésie, et, par-delà la poésie, dans la littérature. C’est que la poésie — et la littérature — de nos temps n’ont qu’un sens : l’obsession d’un élan souverain de notre vie. Et c’est bien la raison pour laquelle elles sont si constamment liées à la révolte [18]. »
On redécouvrira — avec la notion de « souveraineté » qui était alors au centre de sa réflexion (« l’exigence fondamentale de cette morale est la souveraineté ») — la complexité et l’actualité intempestive de la pensée de Georges Bataille, décidément irrécupérable, lui, quand il essaie de comprendre (annonce ?) le temps de la révolte, un temps qui fait signe, au-delà du nom de la revue éponyme, vers un dépassement des « Temps Modernes », précisément.
Albert Camus
par Philippe Sollers
Malgré tout, un écrivain n’existe pas. Même si imprudemment il l’affirme et tente de se mêler à la vie des autres hommes, ce qui à chaque moment l’en sépare forme ses livres et le défend contre lui. On dira de Camus le contraire. Mais je crois qu’il fut l’artiste ayant vécu ce drame aussi nettement qu’il se pouvait. Cette contradiction qu’il ne se permettait pas de résoudre en sa faveur, le grandit à certains yeux, le diminue à d’autres et marque dans son oeuvre précisément ce qui nous touche et continuera de nous atteindre, et ce qui fut impuissant à nous retenir. Tout jeune homme se souvient de L’Étranger comme de la conscience brusquement prise de sa singularité, face à une liberté que lui apportait la certitude de l’insuffisance des raisons (de toute raison) et de la seule réalité d’une vie pour ainsi dire immédiate et réduite à l’innocence. La morale devenait enfin ce qu’elle est au plus profond pour chacun : une convention dérisoire à moins d’être poussée aussi loin que notre existence, et elle seule, nous permet de l’y conduire. On ne voit guère l’Étranger dans La Peste. Mais on le rencontre dans Noces ou dans l’Été, dans tel ou tel passage dicté par un air lumineux et vif, qui semble soudain plus vrai et d’une évidence — si j’ose dire — criante. Il y avait sans doute, chez Camus, un obscur besoin d’aller où il n’avait que faire, à des problèmes dont il aurait dû laisser l’exclusivité à qui ne connaissait pas ce qui lui avait été révélé. Peut-être a-t-il craint de se retrouver seul et que ces cris de haine souhaités par l’Étranger (qui aurait pu conquérir une autre vérité, découvrir, faire avancer envers et contre tout une connaissance subjective et impartiale) lui fussent adressés. Il est revenu, il est reparti, en groupe cette fois, muni d’une morale simplifiée, vers une solidarité dont il a dû sentir quelquefois la gageure, vers une gloire inévitable et un bonheur qu’il aurait de toute manière préservé. Jusqu’à ce qu’une mort, particulièrement atroce, détruise cette intelligence qui avait si bien su affronter, en la dévisageant, la Mort.
Comment une conscience si nette — et méprisante — s’est-elle masquée au point de devenir cette mauvaise conscience de La Chute, ce monologue brillant et immobile qui ne nous apprend rien que nous ne sachions et ne regrettions de savoir ? Cette emprise théâtrale de l’autre dont on choisit de se couper pour aller plus loin — mais qu’on veut à toute force : reconquérir, amadouer, et, en définitive, manoeuvrer et juger — a quelque chose de terrifiant et Camus, du moins, l’a exprimée avec une lucidité enviable. Ainsi piétine l’écrivain qui ne se fait pas de son art une idée assez haute pour lui soumettre les idées. Ainsi est-il forcé à cette justification incessante (car enfin, oui, nous sommes coupables, mais ce sont là des questions qui ne nous agitent que lorsque nous avons décidé de nous agiter), usant du langage pour une communication par avance incomplète et souffrante.
La contradiction de Camus, il faut bien le dire, était une contradiction esthétique entre une pensée trop vive pour son style qui, à la fin, ne la supporta plus, et revint de lui-même : à une matière rassurante. Il en était arrivé — comme dans ce texte contre la peine de mort [19] — à une dissertation classiciste, comme si rien ne s’était passé dans l’expression que du dehors et qui ne changeât le fond même. Ce trait est révélateur. On ne peut conserver sa pensée la plus audacieuse que par cette recherche du langage qui n’est pas le langage recherché. Sinon, tout se dissout, le plus vif sentiment de l’existence s’émousse, et le plus rigoureux esprit — que Camus possédait — se répète, trouve ses sujets avant de les avoir choisis et s’arrête, étourdi au seuil de la morale qui le récupère bientôt. Il ne s’agit plus de vivre, alors. Tout est vécu plus ou moins justement, selon une règle arbitraire que l’ironie elle-même ne peut plus conjurer. Et la beauté devient nostalgique, émouvante sans doute, mais furtive, presqu’un rêve, à moins que, se reprenant tout à coup, Camus, dont nous guettions à chaque livre quelques pages admirables, ne l’eût réaffirmée pour nous.
Tel Quel n° 1, printemps 1960. (L’Infini n° 54, printemps 1996).
Quarante ans après la mort de Camus, Sollers salue l’auteur de Noces et de L’été qui veut « rejoindre les Grecs ». Il écrit dans Le JDD du 31 janvier 2010 :
Camus
A force de commémorer Camus, de le panthéoniser, de le transformer en fantôme abstrait, on a réussi à le rendre ennuyeux. Comme toutes ces histoires avec Sartre, le communisme et Les Temps modernes sont poussiéreuses ! C’était il y a longtemps, dans l’obscur XXe siècle.
Le Camus vivant (par pitié, qu’on le laisse dormir tranquille au soleil de Lourmarin !) est, pour moi, celui de Noces et de L’Eté. Camus ne dit pas que « tout est bien », puisqu’il y a la misère et l’absurde. Mais il fait confiance, sur fond de tragique, à ce qu’il sent de plus physique et de plus animal en lui, ce qu’il nomme « l’orgueil de vivre ».
« Aujourd’hui l’imbécile est roi, et j’appelle imbécile celui qui a peur de jouir. »
Il insiste, Camus, il veut de toutes ses forces « rejoindre les Grecs ».
« Le sens de l’histoire de demain n’est pas celui qu’on croit. Il est dans la lutte entre la création et l’inquisition. Malgré le prix que coûteront aux artistes leurs mains vides, on peut espérer leur victoire. Une fois de plus, la philosophie des ténèbres se dissipera au-dessus de la mer éclatante. »
Ces lignes sont écrites en 1948. En 2010, la lutte entre la création et l’inquisition reste la même. En 1950, Camus écrit encore :
« Je ne hais que les cruels. Au plus noir de notre nihilisme, j’ai cherché seulement des raisons de dépasser ce nihilisme. (...) Eschyle est souvent désespérant : pourtant, il rayonne et réchauffe. Au centre de son univers, ce n’est pas le maigre non-sens que nous trouvons, mais l’énigme, c’est-à-dire un sens qu’on déchiffre mal parce qu’il éblouit. »
En 1952, voici une récusation des « tombeaux criards » (et qu’est-ce que le Panthéon, sinon un trafic bruyant de cercueils ?) :
« Un jour, quand nous serons prêts à mourir d’épuisement et d’ignorance, je pourrai renoncer à nos tombeaux criards, pour aller m’étendre dans la vallée, sous la même lumière, et apprendre, une dernière fois, ce que je sais. »
Énigmatique et silencieux Camus, qu’on veut à tout prix simplifier et réduire. En 1953, quatre ans avant son Nobel, sept ans avant son accident mortel, il écrit :
« Un brusque amour, une grande oeuvre, un acte décisif, une pensée qui transfigure, donnent à certains moments la même intolérable anxiété, doublée d’un attrait irrésistible. (...) J’ai toujours eu l’impression de vivre en haute mer, menacé, au coeur d’un bonheur royal. »
C’est beau.
Philippe Sollers, Le JDD du 31 janvier 2010. [20]

- Georges Bataille
- Coll. privée. A.G.
Le début de l’article dans le n° 55 de Critique (décembre 1951)
Même de l’attaque dont L’Homme révolté vient d’être l’objet, il ressort — c’est l’aveu de l’auteur de l’attaque, André Breton — qu’il s’agit d’un livre capital. Il faudrait être aveugle ou de mauvaise foi pour le nier.
Albert Camus a voulu saisir dans sa cohérence ce mouvement excessif et précipité qui a fait des siècles récents une suite de destructions et de créations renversantes, où il n’est plus rien dont la face n’ait été brusquement renouvelée. La chose est bien certaine : ces siècles ne ressemblent guère à ceux qui les précédèrent et, dans les convulsions qui les traversent, le sort de l’humanité se joue entièrement ; c’est pourquoi il importe tant de bien savoir ce que signifie la fièvre, ou plutôt le délire qui nous anime, c’est pourquoi il fallait enfin éclairer dans ses angles cachés et sa profondeur un problème réduit en principe à la vue de surface.
1. — L’ère de la révolte
Dès l’abord il y a une raison majeure de nous en prendre avec quelque angoisse (avec un désir de connaître exigeant) au problème de la révolte. L’immense période qui précéda fut au contraire celle de la soumission : une suite de soumissions et d’esclavages, tantôt subis à contrecoeur, tantôt acceptés de plein gré. Si longtemps le principe de tout jugement fut une référence à l’autorité. Mais c’est bien, de nos jours, un mouvement contraire de révolte qui donne à la voix sa force convaincante ; il n’est plus rien qui suscite le respect, l’amitié ou la contagion qui n’ait en quelque mesure un sens de refus. Un mot, conformisme, à lui seul, et les réactions qu’il entraîne exposent assez bien le changement survenu. Mais, si nous voyons qu’il est conforme aux nouveaux principes d’être révolté, nous ne pouvons pas toujours donner nos raisons. Il n’est pas seulement étrange que des croyants réagissent eux-mêmes à l’accusation de conformisme ; d’où vient une rage si générale d’occuper dans chaque domaine la position de la révolte ? Nous n’avons de cesse, en quelque situation, que nous n’ayons renversé les conditions mêmes de l’activité, de la sensibilité ou de la pensée. Comme si nous voulions, par un acte de violence, nous arracher de l’ornière qui nous liait, et (l’absurdité de cette image répond seule à ce mouvement) nous saisissant nous-mêmes par les cheveux, nous tirer et sauter dans un monde jamais vu.
Pour un certain nombre d’esprits, il est vrai que la révolte se réduit à des aspects plus rationnels. Une expression était donnée contre laquelle l’opprimé devait s’insurger. Mais point n’est besoin de récuser ce point de vue pour en convenir : dès le XVIIIe siècle il est certain qu’une fois nié le principe de son humble soumission, perdue l’autorité divine qui donne un sens à nos limites, — l’homme tendit à ne plus reconnaître rien qui s’opposât en droit à son désir.
Ce n’est pas seulement la condition de l’homme économiquement asservi qui fut l’occasion d’exprimer la révolte. C’est en général que les valeurs dominantes du passé ont été niées. L’esprit de refus s’étendit si bien que, de Sade à Nietzsche, en un siècle, il n’est pas de dérèglement, pas de renversement, que l’esprit humain n’ait portés rigoureusement à leur terme. La révolte des opprimés eut sans doute, historiquement, le plus d’effet. Mais les raz de marée du langage — si le langage est bien, comme on le doit penser, une clé de l’homme — ne sont pas indignes d’intérêt. Ils sont sans précédents et ils coïncidèrent avec des changements historiques qui n’avaient pas de précédents non plus. Aussi bien devons-nous prêter l’attention la plus grande, si maintenant Albert Camus envisage hardiment l’unité et la cohérence de ces mouvements.
2. — Un discours sur la révolte fondamental
Il est vrai que cette cohérence, le surréalisme, le premier sans doute, a tenté de la montrer. Mais le surréalisme se borna à de fortes affirmations. À la mesure des possibilités et des besoins de l’intelligence, cela pourrait sembler insignifiant. En même temps, le surréalisme tendit à définir une position morale qui réponde à ce double mouvement de la révolte. Il a de la sorte esquissé — vaguement — ce qu’aujourd’hui Albert Camus s’efforce de préciser. Pour Albert Camus, comme pour le surréalisme, il s’agit de trouver dans la révolte un mouvement fondamental où l’homme assume pleinement son destin. Si l’on veut comprendre un livre profond, il faut le rattacher à l’état d’esprit qu’il prolonge et auquel il répond. Je ne dis pas qu’Albert Camus est surréaliste, mais le surréalisme fut l’expression la plus voyante — parfois la plus heureuse — de cet état d’esprit élémentaire. Il peut donc être légitime de parler de L’Homme révolté à partir de l’attaque dont il est l’objet de la part d’André Breton.
Je devrai d’abord en dire ce qui s’impose, qu’elle est paradoxale (Breton dirait en son langage, tout en excès : « insoutenable sous tous les rapports »). Quiconque de sang-froid et sans parti pris lit attentivement, les textes auxquels elles se réfèrent en main, les allégations de l’auteur de « Nadja » [21], est saisi d’une disproportion désarmante entre les griefs et les conséquences tirées. Cela surprend d’autant qu’une amitié ouverte précéda l’éclat : « j’ai fait longtemps, lisons-nous, toute [22] confiance à Albert Camus. Si vous vous souvenez, au meeting Pleyel de décembre 1948 j’ai tenu à lui rendre un hommage personnel, disant qu’au lendemain de la Libération sa voix m’était parvenue comme la plus claire et la plus juste... » Mais nous sommes dans le monde du tout ou rien : entre-temps, Camus a parlé de Lautréamont qu’apparemment il a lu sans le long frisson qui, chaque fois, traverse Breton (qui d’ailleurs me traverse moi-même). II s’agit donc d’un élément sacré qu’Albert Camus ne ressent pas comme tel. Ce que dit exactement Camus de Lautréamont n’est en cause qu’en apparence. Mais le disant il n’a pas le ton qui convient au mystère que ne livrent pas les Poésies. Je ne pense pas que le passage incriminé tienne suffisamment compte du caractère démesuré, « forcené », provocant, de ce texte « conformiste » ; imagine-t-on un personnage soucieux de conformisme que les Poésies satisferaient ? Il n’empêche que la dialectique de Camus, tirée de l’opposition des Poésies aux Chants de Maldoror, expose (sans l’épuiser) un mouvement de l’esprit de Lautréamont qui touche à l’essentiel de la révolte. La « révolte poétique » — qui appelle l’outrance, la « méchanceté théorique » et toutes sortes de dérèglements — est rejetée vers la banalité : il me semble que l’expérience de la poésie, dans la mesure où l’excès de la révolte la porte à l’extrême degré de la négation, devrait confirmer l’identité, en ce point, de Maldoror et des Poésies : d’un parfait dérèglement et de l’observance scrupuleuse (il est vrai dérisoire, il est vrai ambiguë) de la règle. Sans doute, Albert Camus n’a pas, à propos de Lautréamont, tiré d’autres conséquences de cette identité que l’explication du passage allant du surréalisme au communisme stalinien (l’explication n’est pas mauvaise, mais fallait-il la lier à l’insaisissable glissement des Poésies ?), mais le mouvement du livre tout entier va dans le même sens : l’esprit qu’a soulevé la révolte sans frein éprouve l’absurdité (l’inviabilité) de son attitude, mais il y découvre une vérité inattendue : l’existence générale d’un bien qui vaut la peine de la révolte, « quelque chose... qui demande qu’on y prenne garde ». « Le révolté, au sens étymologique, fait volte-face » et s’il parle — plus simplement, s’il a une conduite humaine, non animale —, il lui faut dire et concevoir ce qui justifie son attitude, et qui vaut qu’il affronte la mort. Mais cet élément inviolable, souverain, qui ne peut être subordonné, soumis, sans se nier et dépérir, le mouvement même de la révolte signifie que le révolté le possède en commun avec quiconque se révolte avec lui. Dans le mouvement de la révolte première, l’esprit, prenant conscience en exprimant sa position, en parlant, appréhende ce bien valable pour tous qui vaut que l’homme, généralement, s’insurge s’il lui est porté atteinte. Camus en vient à dire : « Dans l’épreuve quotidienne qui est la nôtre, la révolte joue le même rôle que le « cogito » — dans l’ordre de la pensée : elle est la première évidence. Mais cette évidence tire l’individu de sa solitude. Elle est un lieu commun qui fonde sur tous les hommes la première valeur, Je me révolte, donc nous sommes [23]. » Ainsi la révolte, s’en prît-elle à la morale — dans la mesure où la morale devient la base de l’ordre établi —, n’en est pas moins, dès le premier moment, engagée dans une voie morale. Bien plus, son mouvement dégage seul une valeur dépassant l’intérêt vulgaire : ce bien plus précieux que l’avantage ou la condition favorable de la vie, qui même excède la vie, dont il est distinct, puisque, la vie, nous sommes prêts à la perdre pour le sauver.
Entre cette vue, en un sens géniale, et l’état d’esprit surréaliste, il est difficile d’éviter le rapprochement. La différence tient au mode orageux et balbutiant, parfois même chargé d’un fracas peu intelligible, auquel, volontairement, l’expression surréaliste s’est tenue.
L’analyse à froid succède au délire de la fièvre : elle n’en a pas l’aveugle véhémence, mais elle sort de cette façon de l’embarras évident de Breton cherchant à fonder sa morale en dépit de son intolérance du passé. Elle sort aussi de ce domaine à part où Breton voulut édifier un monde qui lui appartienne en propre. Pouvons-nous oublier l’incompréhension purement brutale du Manifeste du surréalisme jugeant l’oeuvre de Dostoïevski d’une manière autrement légère que Camus les Poésies ? Breton a l’habitude depuis toujours de remplacer par l’assurance et le déplacement, parfois subtil, de la question un développement rigoureux de la pensée : ce qu’il dit avec une puissance sans contrôle touche la sensibilité ou les passions. Cette impuissance désinvolte lui valut, en même temps qu’une large audience, le peu de sens et la fragilité des adhésions qu’il a trouvées. Mais elle a principalement commandé le caractère incomplet du monde où il veut enfermer l’existence de l’homme. Le plus gênant est le refus qu’il oppose à une méthode plus correcte. Il ne veut pas voir que les jugements fondés sur la force du sentiment ont peu de chance de convaincre, ou plutôt tiennent du hasard un pouvoir convaincant des plus vagues. Le monde présent manque, au dernier degré, de rigueur, de lucidité simple et surtout de largeur de vue : chacun se cantonne dans le monde restreint qu’il aperçoit d’un point de vue jamais changé. Si André Breton ne ressentait un malaise si grand dès l’instant où sont dérangés les effets de perspective éblouissants — mais trop rares, trop difficiles à composer — qu’il ordonne autour de lui, s’il ne manquait pas d’imagination, mais parfaitement, dès qu’on le sort de ses merveilleux domaines, il aurait apprécié les trésors que le livre de Camus lui apportait. Il aurait tenu pour rien une divergence, même profonde, dans la manière de juger les Poésies. Mais il n’a pas d’imagination, pas même une simple curiosité, s’il s’agit des choses ordinaires. Au temps où il admirait Lénine sans réserve, il est probable qu’il n’a jamais pensé au haussement d’épaules que ce dernier, sans nul doute, aurait opposé à la frénésie de Maldoror. (Peut- être même Breton en est-il encore à contester une évidence si incontestable...) Aujourd’hui, la pensée d’Albert Camus tient le plus grand compte de Lautréamont, sans doute avec beaucoup de prudence : nous sommes loin de la vision plus pénétrante, mais souvent aveuglante de la fièvre. La lecture de Lautréamont n’a donné à Camus qu’un assez tiède sentiment d’admiration. Il répond à la première attaque de Breton : « Littérairement..., je confesse que je place Guerre et Paix infiniment au-dessus des Chants de Maldoror [24] » Mais Breton ne veut pas voir que la divergence multipliée, vertigineuse, est inhérente à la condition humaine, et qu’il est nécessaire de le bien voir si l’on veut réserver l’espoir de ne pas donner de la voix pour les sourds. Il a le tort assez étrange d’impliquer dans son attitude qu’en dehors d’un petit nombre d’hommes qui lui ressemblent — ou de ceux qui prêtent à la confusion — il n’y a dans le monde qu’une ignoble tricherie humaine. C’est la seule réponse — implicite — qu’il sait donner au fait qu’on lui ressemble si rarement. C’est aussi le seul sens — non moins implicite — de la phrase où il parle, à propos du texte incriminé de Camus, de faux témoignage [25]. Faux témoin ! cela signifie tout bonnement : il ne voit pas ce que je vois.
Un autre se dirait sans plus : je ne pourrais d’aucune façon souscrire à ce jugement sommaire, mais si l’auteur se trompe, et risque de tromper autrui, si je suis, dans le cas présent, sûr qu’il a tort, je dois néanmoins chercher les raisons qui font parler ainsi un homme que je crois honnête, auquel au surplus je faisais « toute confiance ». À moins d’avoir d’autres raisons, qu’il nous tait. Breton aurait dû d’autant plus être prudent qu’il a fait récemment suivre de repentirs la dernière édition de ses Manifestes, dont le second contenait telles attaques personnelles entre temps devenues regrettables. Si Breton avait su dominer le mouvement de passion qui lui fait tenir pour une preuve de vulgarité morale l’insensibilité à l’oeuvre de Lautréamont, il aurait au contraire aperçu qu’avec Camus, par une coïncidence des intentions et des réactions premières, l’expérience surréaliste rencontrait le moyen de rendre claire et indiscutable l’exigence profonde à laquelle elle avait répondu. L’unité de la révolte poétique et de l’historique, qu’autrefois le surréalisme se donna pour tâche élémentaire de manifester, est avérée dans le fait qu’une révolte inconditionnelle est la base de l’éclatante révélation du bien et de son empire sur l’homme, la base en conséquence d’un mouvement de révolution qui postule la souveraineté de la justice.
3. — Au royaume du malentendu
À ce point, je suis obligé de me mettre moi-même en cause. Il est paradoxal en effet que je doive, moi, montrer que ces « ennemis » sont d’accord et qu’une coïncidence dernière de leur opinion (dont une polémique saugrenue souligne en fait l’objectivité, la profondeur) donne à la vérité dominante d’une période sa plus ferme assise, En effet, ce curieux « accord » se fait contre une position que j’avais prise, dont parfois j’ai représenté les aspects dans cette revue, et dont j’énoncerai maintenant le principe, adapté aux termes du présent développement : l’opposition du bien identique au sacré et de la justice, qui relève, elle, du bien identique au profitable.
Ainsi, montrant le tort qu’ont de se battre les parties opposées (dans une discorde à laquelle Breton seul donna son caractère venimeux), c’est surtout mon tort que j’avouerai. Et comme mon aveu et ses raisons permettent, selon moi, de préciser le sens de la position d’Albert Camus, j’ajouterai au rapprochement de l’expérience surréaliste et de L’Homme révolté, celui de l’expérience à mon sens commune à l’un et l’autre et de la mienne.
Avant cela, cependant, je devrai rendre claire la simple vérité. Dans l’ensemble de cette histoire, il n’y a d’opposition qu’accidentelle. Je m’en prends à ce qui me semble une erreur d’André Breton. Mais de cette façon je ne suis son ennemi qu’en surface. J’ai eu plus d’une fois, après des difficultés vieilles de vingt ans, l’occasion d’exprimer mon accord avec la position surréaliste, au sens du moins qu’elle a pour moi j’ai même publiquement — dans une lettre ouverte à son rédacteur en chef — renoncé à mon intention de donner un article aux Temps modernes en raison de la désinvolture avec laquelle Sartre avait parlé des surréalistes dans cette revue [26]. Ceci n’importe guère : je le dis seulement voulant souligner le fait que, sur le plan de la pensée, je me suis plus souvent trouvé d’accord avec Breton qu’avec Camus.
Il est plus important d’insister sur l’estime et l’intérêt que L’Homme révolté montre pour la personne de celui qui l’attaque aujourd’hui. Le long passage touchant le surréalisme ne saurait passer pour un accord de Camus. C’est une critique serrée qui, à mon sens, a le pouvoir de rendre compte. Peut-être manque-t-il à l’auteur l’information de ceux qui subirent au jour le jour les remous et les contrecoups du mouvement. Mais reprocherait-on de mal entendre et de ne pas aimer à celui qui écrit : « Un grand appel vers la vie absente s’arme d’un refus total du monde présent » ? Comme le dit assez superbement Breton : « Incapable de prendre mon parti du sort qui m’est fait, atteint dans ma conscience la plus haute par ce déni de justice, je me garde d’adapter mon existence aux conditions dérisoires ici-bas de toute existence. »
L’esprit, selon Breton, ne peut trouver à se fixer ni dans la vie, ni au-delà. Le surréalisme veut répondre à cette inquiétude sans repos. Il est un « cri de l’esprit qui se retourne contre lui-même et est bien décidé à broyer désespérément ces entraves ». Il crie contre la mort et « la durée dérisoire » d’une condition précaire. Le surréalisme se place donc aux ordres de l’impatience. Il vit dans un certain état de fureur blessée : du même coup dans la rigueur et l’intransigeance fière, qui supposent une morale ». Et plus loin : « Dans la chiennerie de son temps, et ceci ne peut s’oublier, il est le seul à avoir parlé profondément de l’amour. L’amour est la morale en transes qui a servi de patrie à cet exil. » Certes, une mesure manque encore ici. Ni une politique, ni une religion, le surréalisme n’est peut-être qu’une impossible sagesse. Mais c’est la preuve même qu’il n’y a pas de sagesse confortable : « Nous voulons, nous aurons l’au-delà de nos jours » s’est écrié admirablement Breton. La nuit splendide où il se complaît, pendant que la raison, passée à l’action, fait déferler ses armées sur le monde, annonce peut-être en effet ces aurores qui n’ont pas encore lui, et les matinaux de René Char, poète de notre renaissance. » Aussi bien la phrase où Breton accusa, sans attendre d’avoir lu le livre entier, celui qui a si justement traduit, parce qu’il le connaît, le mouvement de sa révolte, de se ranger « du côté du pire conservatisme, du pire conformisme [27] » restera-t-elle comme un exemple stupéfiant de malentendu sans excuse.
(A suivre)
GEORGES BATAILLE, Critique n° 55, décembre 1951, p. 1019-1027.
Le début de l’article dans le n° 56 de Critique (janvier 1952)
4. — Le dilemme de la révolte
L ’histoire elle-même est peut-être — en tout cas, paraît bien être — un interminable malentendu. Néanmoins la fin du discours est de résoudre la difficulté que les hommes ont à s’entendre : considérée dans son rapport à l’ensemble du langage, à cette pensée développée, exhaustive et cohérente à laquelle aspire toute pensée isolée, une vue bornée n’a de sens que dans l’instant où elle se dément. (C’est pourquoi une pensée pleine de vie n’a de cesse qu’elle ne se soit elle-même enfin prise en défaut.) Il lui faut d’abord s’attacher aux malentendus, qui attirent et n’apportent pas seulement une promesse de résolution, mais ce pouvoir angoissant de faire la nuit, qui nous donne de la mort un sentiment opaque où elle s’abîme.
Je veux si fortement me représenter ce qui est et que je dois vivre avec exactitude, et la représentation exacte des choses me paraît liée si étroitement à la possibilité de la communiquer dans l’accord manifeste des esprits, qu’à la seule pensée de ces désaccords violents séparant ceux qui peuvent s’entendre, il me semble odieux de poursuivre l’exercice, devenant dérisoire, de la réflexion et du langage. Le sens — et le sort — de la révolte sont en jeu. Nous pouvons sagement, comme on le fit dans les conciles, comme le font maintenant les congrès, chercher un accord que fonde une soumission préalable aux décisions de l’assemblée. Mais nous risquons, par l’absurde, de bien montrer que conciles et congrès ont raison : en ce qu’ils nous épargnent du moins les discordances de la révolte. Il semble souvent qu’il n’y ait, du côté des révoltés, que caprice, souveraineté de l’humeur instable, contradictions multipliées sans frein. En fait, de quoi soumettre indéfiniment la révolte à l’esprit de soumission ! Cette nécessité est inscrite dans la destinée de l’homme : l’esprit de soumission a l’efficace qui manque si bien à celui d’insoumission. Sa révolte laisse le révolté devant un dilemme qui le déprime : si elle est pure, intraitable, il renonce à l’exercice de tout pouvoir, il poussera l’impuissance au point de se nourrir des facilités du langage incontinent ; si elle pactise avec une recherche du pouvoir, elle lie par là même partie avec l’esprit de soumission. D’où l’opposition du littérateur et du politique, l’un révolté à coeur ouvert et l’autre réaliste.
Comment, d’une part, disjoindre le mouvement de la révolte et l’inclination contraire à forcer la volonté d’autrui ? Comment, d’autre part, éviter l’écueil d’une excitation verbale, d’une impuissante multiplicité d’opinions où le langage, que jamais plus ne mesure la réalité de l’action, s’emporte, s’exaspère et se vide ? Ce n’est pas seulement le problème d’Albert Camus, c’est celui de chaque homme aujourd’hui vivant la douleur de son temps, c’est enfin le problème premier de tout le présent.
5. — La seule réponse au dilemme de la révolte est la mesure
C’est le mérite d’Albert Camus d’avoir le premier posé le problème en entier (comme c’est la chance, ou la malchance, d’André Breton d’en avoir éclairé malgré lui le côté pénible). Nous pouvons rejeter la solution efficace de la révolte tyrannique, d’un passage — révolutionnaire, au point d’accomplir, au sens où les astronomes l’entendent, un parfait mouvement de « révolution » — de la révolte des meilleurs à la soumission de tous. (Car les tyrans, dans la révolte tyrannique, sont eux-mêmes soumis à la tyrannie qu’ils exercent sur les autres.) Encore devons-nous savoir si la révolte refusant la tyrannie a d’autres voies que l’excitation et le verbalisme discordant. Ce n’est pas sûr, et s’il est vrai qu’Albert Camus apporte une solution dépassant la colère aveugle, la preuve reste à faire qu’elle nous donne le pouvoir de passer aux actes sans recourir au meurtre et à la tyrannie. Là-dessus, il faut dire que seul l’avenir peut authentiquement décider, mais nous pouvons chercher dès maintenant si cette solution échappe aux difficultés que nous avons dites (que le surréalisme est si loin d’avoir résolues qu’il n’a jamais si brutalement fait savoir qu’immuable, il était du côté de l’exigence exaspérée et du cri jeté pour rien) [28].
Camus ne dissimule pas son aversion pour la démesure, il l’affiche. Ouvertement, sa doctrine est celle du juste milieu. Il ne craint pas de heurter de front cet état d’esprit juvénile, qui condamne ce qui n’est pas tout d’une pièce, qui engage à se compromettre le plus entièrement qu’il se peut. Camus ne s’oppose pas à la pureté, mais au système, à la volonté d’absolu.
Selon lui : « La mesure... nous apprend qu’il faut une part de réalisme à toute morale : la vertu toute pure est meurtrière, et qu’il faut une part de morale à tout réalisme :
le cynisme est meurtrier. C’est pourquoi le verbiage humanitaire n’est pas plus fondé que la provocation cynique. L’homme enfin n’est pas entièrement coupable, il n’a pas commencé l’histoire, ni tout à fait innocent puisqu’il la continue. Ceux qui passent cette limite et affirment son innocence totale finissent dans la rage de la culpabilité définitive. La révolte nous met au contraire sur le chemin d’une culpabilité calculée. Son seul espoir, mais invincible, s’incarne à la limite dans des meurtriers innocents. »
6. — Le premier mouvement de la révolte est la pleine démesure
On ne saurait trop louer un langage également éloigné de la phraséologie naïve et du réalisme rusé. Mais il est facile de répondre, et de miser avec Breton sur le prestige d’une incorrigible surdité : ...« une révolte dans laquelle on aurait introduit la "mesure" ? La révolte une fois vidée de son contenu passionnel, que voulez-vous qu’il en reste [29] ? ». Comme si l’on n’avait pas sous les yeux ce qui reste d’une révolte depuis trente ans réduite à la violence des mots.
Nous voici de nouveau dans la nuit du malentendu, où Breton veut confondre un premier mouvement et les conséquences qu’il demande. De ce premier mouvement — passionnel — de la révolte, Breton a sans doute formulé les images les plus précises : même encore aujourd’hui, c’est la plus chargée de démesure qui a le mérite d’éclairer l’essentiel. Mais on pourrait généralement s’accorder sur ce point que la révolte, si son exigence nous conduit, finalement, à la mesure, est d’abord dans son mouvement démesurée. Aussi bien, devons-nous saisir, à partir de la démesure, la nécessité d’en venir à la mesure.
Il n’est peut-être pas de vérité que nous devions plus nécessairement — plus vite, mais aussi plus facilement — dépasser, que celle à laquelle Breton prêta la forme de celle phrase célèbre : « L’acte surréaliste le plus simple consiste, revolvers aux poings, à descendre dans la rue et à tirer au hasard, tant qu’on peut, dans la foule. Qui n’a pas eu, au moins une fois, envie d’en finir de la sorte avec le petit système d’avilissement et de crétinisation en vigueur a sa place toute marquée dans celle foule, ventre à hauteur de canon. »
J’entends bien qu’on ne peut vivre dans cette impasse. Mais je ne puis m’accorder aux réactions que la phrase a suscitées. Sur ce point, il faut dire que Breton a raison d’insister. Il est évident que, « dans (son) esprit, il est toujours allé de soi que l’auteur d’un tel acte serait lynché sur-le-champ [30] ». Il ajoute : « Il s’agissait — métaphysiquement parlant — d’un attentat savant contre l’homme, qui fût de nature à atteindre à la fois le « je » et l’ « autre », ce qui, pour peu qu’on y réfléchisse, n’est pas sans rapport avec l’attentat final de Jules Lequier contre « Dieu ». Je suis passé, j’en conviens — fugitivement, je précise — par le désespoir nihiliste. Ma consolation serait que j’y avais eu de grands prédécesseurs :
Tout à la guerre, à la vengeance, à la terreur,
Mon esprit ! Tournons dans la morsure : Ah ! passez,
République de ce monde ! Des empereurs,
Des régiments, des colons, des peuples, assez ! »
J’ai voulu citer le passage entier. Il a la vertu de saisir la révolte au moment de démesure où elle se déchaîne : le vertige ébloui et mortel dans lequel un homme s’arrache à la soumission imposée. Je ne m’éloigne pas de cette manière de la description d’Albert Camus, aux yeux duquel Rimbaud (sinon dans son oeuvre, dans sa vie) « est le poète de la révolte, et le plus grand », — Rimbaud qui put donner « à la révolte le langage le plus étrangement juste qu’elle ait jamais reçu ». Je ne m’attarde pas à la distance que Breton laisse aujourd’hui entre lui et cette phrase, déjà vieille de quelque vingt ans. Ni à l’insistance d’Albert Camus, soucieux de placer la « révolte métaphysique » sur des voies clairement distinctes de celles du crime (de celles en particulier de la violence nazie). La phrase des « revolvers » n’a rien à voir avec la bestialité politique : même elle met en jeu, sans nul doute, les prestiges vertigineux du suicide. Au surplus, cette forme de révolte élémentaire a plus qu’une existence verbale : c’est l’amok des îles de la Malaisie, dont la pratique, traditionnelle n’était pas si rare. Las d’endurer la pesanteur du monde, un homme tout à coup voyait rouge : il se jetait alors à travers les rues et frappait d’un kriss ceux qu’il atteignait, au hasard, jusqu’au moment de succomber — à son tour — sous les coups d’une foule apeurée. Il est curieux qu’en un point du monde du moins, un geste si insensé ait répondu à la coutume ; qu’autant qu’il semble, il y ait pris valeur, moins de folie criminelle que d’acte sacré. C’est en vain que nous chercherions révolte plus entière. Rien n’a plus parfaitement répondu, quels que soient les fondements, simplement physiques, d’une manifestation si entière, à l’esprit de cette révolte métaphysique dont Albert Camus nous dit qu’elle est « le mouvement par lequel un homme se dresse contre sa condition et la création tout entière » ; qu’elle est « métaphysique parce qu’elle conteste les fins de l’homme et de la création ».
Il n’est plus pour l’amok de malentendu ; ni pour ses victimes.
Mais ceux qui le virent assoiffé de mort, qui survivent, et peut-être l’ont tué ?
La foule européenne, peut-être plus pesamment asservie, succomberait à la rancune ; mais je puis me représenter une assistance plus fière et plus ouverte, qui ne serait pas sourde à cette protestation souveraine, dont elle a néanmoins dû se défendre. Elle saurait sans malentendu que l’amok voulut, le temps d’un éclair, nier ce qui le limitait, plutôt que d’accepter de survivre limité : elle s’inclinerait pour cette raison devant l’amok, dont la mort a le sens de la souveraineté authentique.
Ma façon de voir est paradoxale et semble s’éloigner de celle de Camus, pour lequel le révolté se définit par te désir de voir en lui-même reconnue la valeur de la révolte. Mais avant cela, ne devons-nous pas considérer la révolte qui aveugle — et veut rester aveugle, dans la mort ?
7. — La révolte, la souveraineté et le caractère criminel et rebelle de la royauté
Dans la première partie de cet article, j’ai dit mon intention de montrer non seulement l’accord essentiel de Breton et de Camus, mais une coïncidence de la position qui leur est commune avec celle que j’ai prise de mon côté.
Il s’agit de fonder la valeur sur la révolte, et par là de donner une base à la loi traditionnelle, qui condamne le mensonge et nous demande la loyauté envers autrui. Bien entendu, la justice elle-même est impliquée dans la morale définie par cette valeur. Or ces mots : révolte, loyauté, justice, ne sont pas sans équivoque et je voudrais maintenant montrer que l’exigence fondamentale de cette morale est la souveraineté. Ainsi, la morale de la révolte, qui fonde comme on verra la justice, ne serait pas toutefois fondée sur elle : son fondement est la volonté d’être souverainement.
Ceci ne ressort pas clairement, du moins d’emblée, du livre de Camus. Je dois reconnaître au surplus qu’en elle-même, la proposition n’est pas si claire. Je m’efforcerai maintenant, non seulement de la prouver, mais de lui donner une signification familière.
Si Camus parle du motif des sentiments de révolte, il est ambigu. Ce motif semble tout d’abord être l’injustice et la souffrance qui en résulta. Albert Camus ne semble nullement étranger à la pitié. Mais encore devons-nous savoir quelle souffrance est l’objet de cette pitié. Il dit bien : « La révolte naît du spectacle de la déraison devant une condition injuste et incompréhensible. » Mais il peut aussi bien dire : « ... La révolte est, dans l’homme, le refus d’être traité en chose. » « Traité en chose » signifie dans le vocabulaire de Kant : comme un moyen, non comme une fin. Positivement ce refus se traduit par une exigence : la révolte est dans l’homme la volonté d’être souverain (de relever de soi-même et de personne d’autre).
Albert Camus n’est pas le seul à fonder sur une exigence de souveraineté le grand mouvement de revendication depuis deux siècles. Marx lui-même a fait de l’aliénation des prolétaires le principe de la lutte de classes. Mais souvent cet aspect fondamental est voilé. Souveraineté, autonomie de l’être, sont en principe des formules abstraites. On met d’ordinaire au premier plan des satisfactions plus concrètes. S’il est question de liberté, c’est en raison d’images familières qu’évoque aussitôt ce grand mot : la prison, la répression. Ce n’est pas que la souveraineté soit abstraite inévitablement, mais, dans la mesure où une représentation commune lui est liée, elle n’est pas populaire. La souveraineté est avant tout le fait de la divinité ou des rois. La « souveraineté du peuple » est encore un énoncé irréel ; c’est la souveraineté du peuple laborieux, asservi au travail, et la souveraineté se définit par le fait de n’être pas soumis ! le fait, avant tout, d’être là sans autre fin que d’exister ! Ce n’est pas contradictoire avec le travail à venir ou achevé, mais avec le travail actuel ou avec l’essence du travail, assumé dans la qualité laborieuse, dans la qualification de travailleur. Il faut le préciser : le travailleur est souverain s’il le veut, mais c’est dans la mesure où il pose ses outils à ses pieds.
Allons plus loin.
Camus lui-même a laissé les choses dans l’ombre, tant il est vrai qu’elles sont lourdes et irrésolues. II me semble, et mon sentiment, sur ce point, est très fort, que sa pitié s’adresse d’abord à ceux qui se veulent souverains, et que brise ce qui demeure en eux d’irréductible. Je crois même que le mot pitié trahit la vigueur, je dirai la souveraineté, de ce mouvement, c’est de solidarité qu’il s’agit ; mais à ce dernier mot, trop vague, Camus préfère celui de complicité, qui lève le rideau sur la tragédie. La souveraineté est dans son essence coupable, on pourrait même dire en un sens que c’est la même chose que la culpabilité. Camus le sait bien qui rappelle le mot de Saint-Just : « Nul ne peut régner innocemment. » C’est ambigu si l’on entend régner au sens grossier de gouverner. Mais la souveraineté est dans le crime en ce que ses humeurs divines et majestueuses sont en elle, comme la révolte, au-delà des lois. « Saint-Just pose... en axiome que tout roi est rebelle... » La souveraineté n’est-elle pas le fait de celui qui aime mieux mourir, mettre du moins sa vie en jeu, plutôt que de subir le poids qui accable l’homme ? À l’extrême, ce poids n’est pas seulement la servitude ou la souffrance, mais la mort, et nous pouvons nous révolter comme Albert Camus contre la mort, mais qui ne voit qu’il y a d’abord dans la révolte une volonté propre de démesure et que l’on ne peut tirer de la souveraineté la mesure ? Ce fut même la misère de la souveraineté au sommet de vouloir dérober à la mort l’existence souveraine du roi : mais y eut-il là plus que la vaine contrepartie de cette vérité criante : « Tout roi, dit Camus, est coupable et par le fait qu’un homme se veut roi, le voilà voué à la mort ? ». De même, le révolté moderne est dans le crime : il tue, mais il convient d’être, à son tour, voué par son crime à la mort : il « accepte de mourir, de payer une vie par une vie ». Il y a humainement malédiction de toute souveraineté, de toute révolte. Qui n’est pas soumis doit payer, car il est coupable. Ces termes archaïques peuvent n’être pas derniers : jamais l’innocence de l’homme n’est vraiment, n’est définitivement perdue. Mais la vie souveraine, répondant au désir d’être elle-même une fin sans attendre, de n’être pas subordonnée, comme un moyen, à d’autres fins, exige de prendre sur soi la culpabilité et le paiement.
8. — Le paiement de la culpabilité du roi
La culpabilité est la démesure, mais le paiement est le retour à la mesure. Il est vrai, le paiement n’est pas toujours le fait de la souveraineté, mais il lui est si bien lié que si l’on envisage les temps les plus anciens ou les formes arriérées, les mythes et les rites dans lesquels elle prend figure donnent la contre-partie des pouvoirs démesurés du souverain. Un homme peut incarner par ses prérogatives l’existence insoumise de l’homme, libérée du moins de ce poids qui accable la foule : le peuple peut avoir exigé cette levée en un point de la loi commune, et même, en quelque sorte, il cesserait d’être humain, en quelque sorte il succomberait sans cette levée sous le poids d’une misère et d’une soumission qui seraient sans limites, mais une malédiction fatale poursuit en contrepartie qui a reçu des prérogatives divines. Parfois cette malédiction est conjurée. Une infirmité mythique peut être associée à la royauté [31]. Ou la religion demande au roi de s’incliner aussi bas que le plus malheureux devant une puissance céleste écrasent généralement les humains. Parfois encore, un simulacre de sacrifice, ou un sacrifice frappant une victime de substitution le libèrent. Mais il arriva souvent que le roi dût payer ses privilèges divins de sa mise à mon rituelle, même à la rigueur que la royauté devint un redoutable fardeau.
Au reste, la souveraineté se confondit le plus souvent avec le pouvoir militaire, qui selon les termes dont Hegel se servit dans le dialectique du maître — Herr — et de l’esclave — Knecht — appartient au maître, c’est-à-dire à celui qui paie de sa vie ses privilèges de maître (le Genuss, la jouissance, et le fait de lever, pour soi-même, tout le poids de la vie matérielle). (Pour Hegel, le maître et l’esclave choisirent leur sort : l’esclave préféra la subordination à la mort, et le maître, la mort à la subordination : mais faute de l’expérience que l’homme acquiert dans la servitude (essentiellement l’expérience du travail), le maître ne saurait parvenir au stade de l’homme achevé, qu’atteindra seul l’esclave révolté ; on devrait dire à mon sens que la souveraineté du maître — ou du roi — est une souveraineté inconséquente : qui ne paie que malgré elle et contradictoirement se sert de sa souveraineté comme d’une chose possédée par lui.)
9. — La révolte et la mesure
D’ordinaire on ne voit dans la vie des grands et des rois que le crime (au sens du mot le plus grossier), à tout le moins l’abus, l’exploitation des faibles au profit d"intérêts particuliers. Par la violence, la noblesse et la royauté confisquaient à leur profit les fruits du travail des autres. Mais il est naturel de ne plus voir là qu’un détournement, et de méconnaître le sens initial du mouvement : le refus d’accepter comme une limite la condition commune des hommes.
Il y a dans la souveraineté historique tout autre chose que ce refus, un sommeil plutôt, l’exploitation de la propriété acquise par la violence du refus. Il y a même, dans l’exercice de la royauté, quelque chose de contraire à ce refus qu’il est facile de mettre en valeur en représentant la situation, qui se trouva dans l’Inde, du roi proposé comme une victime, à l’occasion d’une fête, à un éventuel amok. L’amok qui tuait le roi lui succédait (à peu près comme ce roi du bois de Nemi, dont le meurtre en combat rituel est le point de départ du Rameau d’or de Frazer). Sinon, il était aussitôt massacré. Dans ce thème significatif se retrouve la situation animale, la souveraineté était le fait de celui qui a refusé la loi humaine, qui accable l’homme, qui le soumet. Celui qui règne après l’amok s’oppose à la course d’un nouvel amok, mais il ne s’y oppose qu’à demi : il s’offre à la rigueur à la mort, il admet le principe du paiement. Mais le souverain peut trahir entièrement la vérité de sa puissance, et ne plus rien garder de ses origines souveraines, de sa complicité originelle avec la violence. Dès lors, il passe dans l’autre camp. Il réduit la force et les prestiges dont il dispose à un moyen ; il se retire du jeu et gouverne, au lieu de régner. Il peut même gouverner, sans plus, au mieux de ses intérêts privés. Il n’a plus rien désormais de souverain (sinon le nom), rien qui dépasse, en tous les sens, une organisation des intérêts (une subordination de tous les instants à la sauvegarde calculée des intérêts). De la souveraineté, il n’est que la caricature. Sa présence n’a plus qu’une valeur : elle nous propose de rechercher une souveraineté authentique aux antipodes d’une institution méprisée.
Ces détours nous mènent assez loin des analyses d’Albert Camus. Pourtant la place apparaît maintenant préparée pour la succession indirecte que revendiquera l’« homme révolté ».
L’« homme révolté » tient sa valeur de sa révolte, de son refus du poids qui accable et soumet les hommes. Il vit l’attention maintenue sur cette part irréductible de lui-même qui peut être brisée sans doute : mais qui, profondément, maintient en lui tant de violence, qu’il ne peut même envisager de la réduire et de s’incliner. Il ne peut plus que succomber ou trahir. La connaissance de ce simulacre de souveraineté devant laquelle l’histoire l’a placé le détourne dès l’abord des solutions animales, il se méfie de la course aveugle — ou de ces privilèges clinquants substitués à la sainteté de celui qui se voue. Il est dès l’abord à côté de ceux qui refusent la souveraineté établie et, à l’encontre de celle des souverains du passé, sa révolte est consciente d’elle-même, en lui-même et dans les autres. Cette part à jamais irréductible à la loi, qu’il tient d’une immensité de l’être en lui, que l’on ne peut traiter en moyen, qui est une fin, il sait qu’il peut la réserver en travaillant, en soumettant à la loi une autre part de lui-même, qui est réductible. Il ne peut plus se laisser prendre aux apparences qui montraient, d’un côté, des esclaves soumis au travail, et de l’autre, de superbes bêtes sauvages, trichant puisqu’elles s’abaissaient au calcul des revenus provenant du travail des autres. Il sait que cette part indomptable en lui existe en tous les autres, à moins qu’ils ne l’aient reniée. Le vieux système du monde où ceci n’était pas (ou n’était plus) sensible, où le mensonge régnait, est justement ce qu’il refuse, c’est l’objet même de sa révolte. Il n’est pas réellement opposé, du moins il ne l’est pas profondément, à ce qui transpirait de sacré, dans le vieux mensonge, et profondément sa protestation se fait contre la condition commune, contre l’inéluctable nécessité d’asservir en partie la vie de l’homme au travail.
Mais cette protestation liée à ces mouvements démesurés qui soulèvent la vie humaine n’a plus lieu dans la démesure. L’« homme révolté » sait qu’il peut faire la part du travail, à condition de ne pas faire de toute sa vie un système de rouages subordonné aux exigences des travaux. Et c’est aussi l’effet de la mesure en lui de ne plus vouloir succéder au pouvoir qu’il abat.
Il sait maintenant qu’à prendre la place de ceux qu’il a combattus, il hérite avant tout de leur démesure et détruit en lui ce qu’il a trouvé de plus grand, la « complicité des hommes entre eux ». Il perd d’un coup tout le bénéfice de la révolte, Il brise en lui — et chez ceux qu’il gouverne désormais — l’élan qui l’avait suscité. El il ne reste plus en lui ni dans ceux qui le suivent — d’accord ou malgré eux — que la démesure, traduite en tyrannie et en terreur.
10. Révolte, poésie, action
Je suis de cette façon revenu, partant de mes propres analyses, au mouvement essentiel de la pensée d’Albert Camus. Il me semble que le rapport introduit par moi entre ce mouvement et mes prémisses ne le déforme en rien et même l’explicite. Mais j’insiste sur ce point : ma propre pensée me semblait suspendue faute d’arriver à ce qui en est maintenant la conclusion tirée à la fin de ce livre généralement admirable dont j’ai voulu donner le sens profond.
Il est vrai : le point de départ de ces rapprochements, qui me semblent établir une coïncidence, peut encore être tenu pour contestable. On pourrait douter que la révolte de Camus puisse être confondue avec une exigence de souveraineté.
Ce qui me semble de nature à passer outre est l’intérêt marqué par l’auteur, à l’encontre de tous les théoriciens politiques, pour les positions morales données dans la poésie, et, par-delà la poésie, dans la littérature. C’est que la poésie — et la littérature — de nos temps n’ont qu’un sens : l’obsession d’un élan souverain de notre vie. Et c’est bien la raison pour laquelle elles sont si constamment liées à la révolte. (Néanmoins la littérature et la poésie dont parle Camus n’ont le plus souvent rien à voir avec les efforts, touchants ou non, des écrivains « engagés ».) C’est de la négation des limites du monde réel qu’il s’agit, de ces limites qui entachent si souvent une souveraineté dont justement le sens est donné dans la poésie, une souveraineté qui est poésie.
Bien entendu ceci achève de montrer que le motif de tout ce mouvement s’accorde continuellement à la recherche surréaliste, dont il va sans dire que sa démesure dépassa la littérature en ce qu’elle mit en jeu, bien avant les écrits, qui demeurent, la souveraineté de l’instant, qui est à lui seul sa fin. Mais pour autant la mesure n’a pas manqué à la révolte d’André Breton, qui a prévenu Camus dans cette volonté de justice (qui met fin aux excès — et aux tricheries — de la démesure initiale). Et de même, le surréalisme, d’abord séduit par les violences et la ruse d’une politique réaliste, s’en est vite éloigné lorsqu’il en connut les aspects démesurés.
Ce qui isole néanmoins les surréalistes c’est leur éloignement de la conscience claire, qui est à la clé de l’attitude de Camus. Breton est capable de vues profondes, d’illuminations hasardées, mais il répugne à l’analyse, n’éprouve pas apparemment le besoin de s’élever à la vue d’ensemble. S’il s’en tient, à la fin, à un quiétisme de naufrage, qui parfois semble digne d’admiration, c’est dans l’ignorance où il est des voies d’eau qui l’éveilleraient au sentiment de la mort.
Sans doute, il est des esprits pour lesquels ces questions morales n’ont pas de portée. Et il est vrai, comme je l’ai dit, que nous ne pouvons être sûrs de trouver l’issue à partir de là. Camus s’en est remis à la solution de la mesure, et il glisse rapidement sur le sujet. Il manifeste néanmoins de l’optimisme et il a peut-être raison. L’essentiel ne serait-il pas de ne plus se laisser prendre aux facilités qui ont mené à d’inextricables situations ? Il me semble surtout qu’il serait temps de comprendre que l’homme révolté ne peut prétendre succéder à ceux qu’il combat, sans compromettre la valeur donnée dans la révolte. Pourquoi, s’il est vrai, comme tout l’indique, qu’il est toujours dans l’administration, ou la direction des choses (je ne dis pas la souveraineté), une volonté d’opprimer, ne pas maintenir en dehors de la direction une force de révolte qui en limiterait les pouvoirs ? Ce pourrait être le sens de l’action syndicale, en faveur de laquelle Camus se prononce dans ce livre capital. Personne ne saurait prétendre à l’avance qu’une volonté de mesure ne pourrait, dépassant l’excitation vide, « disjoindre le mouvement de la révolte et l’inclination contraire à forcer la volonté d’autrui ».
GEORGES BATAILLE, Critique n° 56, janvier 1952, p. 29-41.

L’affaire de « L’Homme révolté » (II)
par Georges Bataille

- Jean-Paul Sartre
En mai 1952, Les Temps Modernes consacrent un numéro à Albert Camus. Georges Bataille en rend compte en décembre 1952 dans le numéro 67 de Critique. A nouveau, il défend Camus, mais cette fois contre Sartre.
L’intérêt suscité par la controverse Sartre-Camus fait songer aux passants qu’amuse dans la rue la moindre bagarre. Le fond de l’affaire a peu de place, ou aucune, dans cette curiosité un peu lourde. L’accueil que fit la presse de droite au livre de Camus est sans doute à l’origine du débat. Les Temps Modernes, en la personne de leur gérant, Francis Jeanson, ont tout d’abord reproché à Camus d’être loué par des réactionnaires. L’argument est de bonne guerre et traditionnel entre ennemis, mais il me semble temps de dire en insistant que ces louanges de la droite ne signifient rien aujourd’hui qui touche en particulier le sens d’un livre. Qui ne voit qu’elles manifestent plus simplement un changement global des esprits ?
Les idées politiques dans les conditions présentes s’énoncent dans un monde que partagent déjà des jeux de force stabilisés.
Les camps sont faits, organisés, et si quelque attention est encore donnée à la manifestation des idées, c’est qu’on pourrait à la rigueur en faire des utilités. Les esprits ont la permission de penser seulement ce qui convient à de vastes mouvements de force qui les négligent (qui négligent à coup sûr l’angoisse, l’espérance ou la révolte profondes). Ils s’agitent sinon dans le vide.
Ceci ne doit pas seulement être dit en termes vagues. Il y a dans le monde présent quelque chose de changé, radicalement : ce monde-ci, autant qu’il semble, a perdu la plasticité. Rien n’y compose plus des forces nouvelles inexistantes jusque-là ; les idées ne coagulent plus, rien de semblable aux mouvements socialistes ou fascistes, que le jeu des idées suscita, n’y prend corps. Ce n’est pas une vérité mystérieuse : cela tient, d’une part, à la force d’attraction décidément massive du parti communiste, qui élimine d’emblée ce qui ose la concurrencer, de l’autre à l’échec catastrophique des fascismes. Pour l’instant, le monde se partage entre deux grandes coalitions, dont l’une, la soviétique, résulta d’une initiative capitale et dont l’autre oppose pêle-mêle à la première tout ce qui en refuse la loi. Il s’agit uniquement, dans le premier camp, de poursuivre la lutte au nom des idées qui sont à sa base : cela tend à les rendre immuables, elles sont mises ouvertement au-dessus de la discussion ; et à l’intérieur du second camp, il règne la plus vague indifférence à l’égard de tout jeu possible d’idées. Dans la faible mesure où survit une agitation d’esprit, les intérêts qu’elle suscite ont peu de sens : à coup sûr, à l’avance, l’idée nouvelle, si elle met en cause, en sa totalité, le destin des hommes, s’adresse à une curiosité qui l’examine avec calme, n’en attend pas grand-chose et n’en redoute rien. Ainsi la pensée n’est-elle plus en principe, aujourd’hui, qu’un exercice gratuit, sans conséquence. Il n’en fut pas de même durant les deux siècles qui précèdent, en tout cas ; et souvent nous réagissons avec un peu de retard : nous jugeons d’un ouvrage naïvement comme s’il était écrit et publié pour un monde mobile, qui pourrait lui donner — ou lui refuser — une efficacité. En particulier, les protagonistes des Temps Modernes, qui écrivent pour agir, qui librement ont décidé d’avoir un rôle dans l’histoire qui se fait, qui croient que la grande affaire en ce monde est de déterminer le destin de l’homme, reprochent à Albert Camus de mal répondre à leur propos. C’est leur droit. Il me semble même qu’ils ont raison. Camus pourrait sans doute n’y pas répondre mieux qu’ils ne font eux-mêmes ; il pourrait bien être à la fin réduit comme eux au rôle contraire, celui d’appoint. Mais on oublie aux Temps Modernes que, les unes et les autres, ces réactions de l’esprit sont venues trop tard.
Il apparaît que, dans le monde présent, la pensée qui s’engage est d’avance écrasée. Ce n’est pas scandaleux : ceux qui agissent devraient-ils interminablement s’embarrasser de la fièvre de ceux qui pensent ? De toute façon, les voies qui mènent de la pensée à l’action diffèrent de celles de la pensée naissante. Les hommes d’action demandent aujourd’hui aux « penseurs » de les comprendre. Discrète et lucidement désespérée, c’est ainsi qu’aujourd’hui la pensée pourrait survivre...
Toutefois, la différence de positions qui ressort de la controverse Sartre-Camus laisse entrevoir, me semble-t-il, une zone d’issue, peut-être insignifiante, mais qui échappe aux Temps Modernes. Je comprends mal ce que Jean-Paul Sartre et Francis Jeanson voient de si satisfaisant dans les possibilités de lutter qui leur sont offertes. Je veux bien l’espérer : sans tarder, la lecture d’un nouvel article de Sartre ouvrira mes yeux... Mais il n’importe : les perspectives de l’histoire aujourd’hui rendent aisé d’imaginer l’hésitation de l’homme réfléchi. Il me semble même, pour moi, que, devant cette somme de colères et de surdités, et devant le cataclysme où mène cette double démesure, la tentation de l’inertie a quelque chose qui fascine. Au moins, ne pas répondre aux voeux de ce Jupiter qui a décidé notre perte et nous fait brutalement délirer ! Je veux bien que s’abstenir est se résigner à ce délire, c’est même y participer passivement : nous ne faisons jamais dans l’inertie que donner dans la facilité de la pensée qui se figure être hors de l’histoire alors qu’elle y est tout entière enfermée. Nous ne pouvons sans une intime lâcheté laisser l’exercice aigu de la pensée tourner en bévue, il est ridicule de nier l’histoire, mais du moins nous pouvons, si nous sommes pour cela assez forts — assez lucides surtout —, prendre sur nous de lui opposer un refus, contre l’histoire nous pouvons en un mot nous révolter.
J’entends qu’il y a là quelque chose d’inattendu, qui tout d’abord doit paraître peu défendable. D’ailleurs, en un sens, il est logique de dire : la révolte contre l’histoire ? n’est-ce pas la chose du monde la plus connue ? c’est la contre-révolution ! ...
En vérité, la révolte dont je parle refuse cette révolution démesurée dont la démesure donne sa raison d’être à l’adversaire, mais elle est étrangère, elle est hostile à l’avare inintelligence de la contre-révolution. Ceci doit être dit en premier lieu, mais il faut ajouter aussitôt qu’il ne suffit pas de le dire, et que l’attitude définie de cette façon doit sembler sottement verbale. C’est même, nous l’avons vu, l’essence de la situation présente : les jeux sont faits et des affirmations de principe à l’intérieur d’un camp ne peuvent en infléchir la politique. Le refus de l’histoire ne peut à coup sûr désigner une tentative qui, se situant sur le plan de l’histoire, y serait seulement en porte à faux. C’est une attitude à la fois plus modeste et plus hardie. Dans le sens ordinaire, elle ne peut susciter d’action, elle ne veut pas changer le monde, mais elle répond à un changement déjà survenu dans le monde.
En effet, l’histoire est bien en dernier, je crois, celle d’une lutte de classes exprimant la souffrance des opprimés, donnant ses conséquences à la tension qui en résulte. Si l’on m’invite à songer d’abord à ceux qui ont faim, je reconnais une précellence de ceux qui ont raison contre moi parce qu’ils souffrent. C’est d’eux, me dit-on, qu’il s’agit, non de moi. Je ne suis pas aussi assuré que Sartre et que Jeanson d’un principe selon lequel la souffrance des déshérités compterait plus que toute autre chose en ce monde. Je sais que les déshérités justement pourront m’aider un jour à le bien savoir si j’en doute. Mais je vois pour l’instant que leur souffrance n’est plus la seule : la menace d’une guerre a placé globalement l’humanité dans une situation désespérée : les privilégiés cette fois ne sont pas à l’abri et ce qui nous accable ainsi sans mesure, ce ne sont pas leurs intérêts, c’est l’histoire. Je le veux bien : si les privilégiés abandonnaient leurs privilèges, aucune guerre ne serait possible. Mais justement : on ne nous laisse pas oublier que la violence seule, et non la persuasion, les en dépouillera. On a raison, mais comment ne pas voir aussitôt l’horreur de cette raison ? Comment ne pas voir aussitôt, dans l’histoire même, un mal plus grand que l’oppression ? Ce qui dans le monde où nous sommes est révoltant n’est plus seulement le sort fait par la direction bourgeoise à ceux qu’elle opprime, ce qui nous révolte jusqu’à la nausée est que l’histoire inexorablement accule l’espèce humaine au suicide.
Voici, il va sans dire, une manière de penser d’une immense sottise ! Comment se révolter contre l’histoire ? C’est se condamner à parler sans être entendu, c’est prêcher les pierres du désert, ou c’est proposer de folles équivoques : sous une forme rafraîchie, reprendre la risible plainte du pacifiste ! Au mieux, c’est rencontrer l’audience inattentive qui ne peut prêter à ce qu’elle écoute la seule attention véritable : lui donner des conséquences en agissant. Agir, c’est toujours se battre et il n’y a que peu d’occasions dans ce monde pour la lutte sans violence d’un Gandhi ; cette lutte eut d’ailleurs, à défaut de violence, une fin historique. Il n’y a finalement qu’une justification solide d’une attitude si peu efficace : c’est que seule aujourd’hui l’absence de pensée, la routine, fait l’histoire et que ne pas se révolter contre elle, c’est la faire. S’il en est ainsi, nous ne pourrons nous étonner de la controverse qui vient d’opposer Sartre et Camus. Les Temps Modernes optent pour l’histoire. Ils s’en tiennent, en manière de pensée politique, à la position marxiste traditionnelle, à laquelle Jeanson reproche à Camus de n’être pas fidèle. Il est vrai que cette position a le privilège d’une efficacité historique exemplaire... Les idées de liberté, de choix, d’engagement qui, dans le domaine politique, ont représenté l’apport personnel de Sartre ne me semblent pas actuellement mises en avant. Il faut d’ailleurs leur reconnaître un mérite : elles ne sont pas dérangeantes, elles n’intéressent évidemment pas plus la masse ouvrière que la révolte de Camus contre le destin des hommes, mais elles gênent peu. Sartre cesserait à jamais d’en parler que rien ne paraîtrait changé. Elles signifient que la liberté de l’homme fait l’histoire, mais il en résulte de toute façon que l’histoire et l’homme qui la fait sont une même chose. Sartre écrit : « Nous sommes dedans jusqu’aux cheveux. » C’est incontestable et l’on ne peut contester non plus que l’histoire ait un sens. Toute action humaine a un sens, et l’histoire est toujours l’effet d’une action, seulement ce sens est parfois critiquable. Action et histoire détruisent afin de créer. Laissons de côté la possibilité de créations inférieures en qualité à ce qu’elles détruisirent pour être. Mais la somme des biens détruits peut à la fin représenter un prix démesuré. Camus oppose à la confiance des Temps Modernes une horreur raisonnée de ce qui arrive. L’horreur va même en lui jusqu’à ne pas aimer l’action que l’histoire attend de lui, quelle qu’elle soit. La révolte en arrive avec lui à des formes en même temps anachroniques et très neuves. Anachroniques, en ce qu’elles refusent la grossière simplification de l’efficacité, neuves en ce qu’elles seules répondent, ou tentent de répondre, à la situation désespérée de l’homme actuel. II oppose au typhon de l’histoire la sève, à la démesure de l’activité moderne la mesure d’une humanité moins tendue. Cette détente choque profondément des esprits qu’enferment des formules à la mesure de réunions frénétiques. Quel révolutionnaire ne se dresserait contre une attitude qui ne peut agir puisqu’elle est détente ? On peut ne pas aimer le livre de Camus, je vois bien les raisons (toutes ne sont pas mauvaises) pour lesquelles il a déçu. Néanmoins les voies de L’Homme révolté demandent plus de fermeté que la routine. Camus se révolte contre l’histoire : je le répète, cette position est intenable. Il se condamne à la louange de ceux qui ne l’entendent pas, à la haine de ceux qu’il voudrait convaincre. Il ne peut trouver ni assise ni réponse. L’inévitable vide où il se débattra le voue au mépris de lui-même. Il devra cependant s’obstiner parce qu’il n’est rien aujourd’hui de plus révoltant que la démesure de l’histoire.
FRANCIS JEANSON, Albert Camus ou l’âme révoltée (dans Les Temps Modernes, mai 1952, p. 2070—2090) — ALBERT CAMUS, Lettre au directeur des Temps Modernes (ibid., août 1952, p. 316-333) — JEAN-PAUL SARTRE, Réponse à Albert Camus (ibid., p. 334-353) - FRANCIS JEANSON, Pour tout vous dire (ibid., p. 354-383).
 LA POLÉMIQUE CAMUS-SARTRE
LA POLÉMIQUE CAMUS-SARTRE
La critique féroce et injuste de l’Homme révolté par Francis JEANSON, dans Les Temps Modernes, revue dirigée par Sartre mettra un terme défnitif aux relations de Camus avec Sartre. Jeanson reproche à Camus d’adopter la position d’un intellectuel au dessus des conflits réels. Il qualifie sa révolte de révolte métaphysique. Il lui reproche de s’en prendre aux perversions de la révolution (celle de 1789 comme cellet de 1917). En bref, il lui reproche de n’être pas marxiste, de ne pas vouloir prendre en compte les « urgences de l’histoire » et les nécessités d’une lutte efficace.
Ignorant Jeanson, CAMUS écrit à « Monsieur le directeur » de la revue (Jean Paul Sartre). Sa lettre couvrira dix-sept pages : « On trouve dans votre article [...] le silence ou la dérision à propos de toute tradition révolutionnaire qui ne soit pas marxiste. La Première Internationale et le mouvement bakouniniste, encore vivant parmi les masses de la CNT espagnole et française sont ignorés. Les révolutionnaires de 1905 dont l’expérience est au centre de mon livre sont totalement passés sous silence. [...] [Votre article] fait silence sur tout ce qui, dans mon livre, touche aux malheurs et aux implications proprement politiques du socialisme autoritaire. En face d’un ouvrage qui, malgré son irréalisme, étudie en détail les rapports entre la révolution du XXème siècle et la terreur, votre article ne contient pas un mot sur ce problème et se réfugie à son tour dans la pudeur. [...] L’homme révolté tente de montrer que les sacrifices exigés, hier et aujourd’hui, par la révolution marxiste ne peuvent se justifier qu’en considération d’une fin heureuse de l’histoire et qu’en même temps la dialectique hégélienne et marxiste, dont on ne peut arrêter le mouvement que de façon arbitraire, exclut cette fin [...]. Libérer l’homme de tout entrave pour ensuite l’encager pratiquement dans une nécessité historique revient en effet à lui enlever d’abord ses raisons de lutter pour enfin le jeter à n’importe quel parti, pourvu que celui-ci n’ait d’autres règle que l’efficacité [...] je commence à être un peu fatigué de me voir, et de voir surtout de vieux militants qui n’ont jamais rien refusé des luttes de leur temps, recevoir sans trêves leurs leçons d’efficacité de la part de censeurs qui n’ont jamais placé que leur fauteuil dans le sens de l’histoire, je n’insisterai pas sur la sorte de complicité objective que suppose à son tour une attitude semblable. »
SARTRE répond et marque la rupture définitive de leur amitié : « Mais dites-moi, Camus, par quel mystère ne peut-on discuter vos oeuvres sans ôter ses raisons de vivre sa vie à l’humanité ? Mon Dieu, Camus, comme vous êtes sérieux, et, pour employer un de vos mots, comme vous êtes frivole ! Et si votre livre témoignait simplement de votre incompétence philosophique ? S’il était fait de connaissances ramassées à la hâte de seconde main ? .. Avez-vous si peur de la contestation ? Je n’ose vous conseiller de vous reporter à la lecture de L’Etre et le Néant, la lecture vous en paraîtrait inutilement ardue. Vous détestez les difficultés de pensée. [...] Notre amitié n’était pas facile, mais je la regretterai. Si vous la rompez aujourd’hui, c’est sans doute qu’elle devait se rompre. Beaucoup de choses nous rapprochaient, peu nous séparaient. Mais ce peu était encore trop : l’amitié, elle aussi, tend à devenir totalitaire [...] »
Cet ensemble de textes, en dépit de son caractère polémique, n’est pas toujours sans intérêt. L’arrière-fond du débat, cette réalité qui accable la pensée la prenant pour objet, est présent malgré le souci de porter des coups, et malgré l’assurance, que j’aime â croire de règle, du directeur et du gérant des Temps Modernes. L’essentiel des reproches adressés par cette revue â l’ouvrage d’Albert Camus apparaît sans doute dès l’abord, il ne se dégage vraiment que dans les répliques finales. La pensée de Jean-Paul Sartre n’est pas exprimée sans nuances :
« Et si vous vous étiez trompé ? Et si votre livre témoignait simplement de votre incompétence philosophique ? S’il n’était fait de connaissances ramassées à la hâte et de seconde main ? S’il ne faisait que donner une bonne conscience aux privilégiés...? Si vos pensées étaient vagues et banales ? Et si Jeanson, tout simplement, avait été frappé par votre indigence ?... Je ne dis pas que cela soit... » (p. 340, je souligne)
Il ne le dit pas... si l’on veut. De son côté, Jeanson ne peut souffrir la solennité, le ton sentimental de L’Homme révolté.
J’aurais su gré à Sartre d’exprimer plus clairement ce qu’il pense de la compétence de Camus. Mais ceci me semble une ruse. Sans doute le livre de Camus est d’abord un témoignage humain. Mais il est clair en effet qu’Albert Camus a résumé l’inquiétude d’esprit de notre temps, comme on ne l’avait pas fait avant lui, comme il était souhaitable qu’on le fasse, indépendamment de l’analyse des infrastructures. Le marxisme évidemment ne s’en porte pas plus mal. Ce n’est pas la question. L’ouvrage ne saurait passer pour définitif : mais il est, et il est possible, à partir de lui, d’envisager bien moins vaguement le problème de la révolte, dans ses rapports avec le développement de la pensée et de la sensibilité, dans ses rapports enfin avec un aspect irréductible de toute condition humaine. Nul n’est forcé de s’y tenir et personne ne saurait négliger le fait qu’un tel livre intéresse un public qu’il rassure. Il va encore de soi qu’il peut sembler antipathique, et que l’on peut toujours discuter la compétence d’un auteur. Mais la première critique est tout de même insuffisante et la seconde aurait plus de sens si elle était suivie, dans les soixante-dix pages d’articles de Sartre et de Jeanson, au moins d’un embryon de discussion des analyses fondamentales de Camus. Au lieu de cela, Jeanson s’est borné d’abord à montrer ce qu’elles avaient d’inconciliable avec le marxisme : puis les brocanteurs répondant à Camus qui s’en plaint en restent sur leur dédain. Soixante-dix pages pour refuser de voir l’intérêt d’une recherche portant sur le sentiment de la révolte dans les esprits les plus remarquables des temps modernes, cela est d’autant plus regrettable que Sartre s’est évertué, par une rhétorique pleine de maîtrise, et tout juste au niveau de loyauté de la polémique moyenne, à faire de Camus une sorte d’« homme fini ». Il n’est pas jusqu’à une description remarquable, favorable cette fois, de la position du directeur de Combat au temps de son prestige le plus grand, qui ne contribue à servir ce dessein.
GEORGES BATAILLE, Critique n° 67, décembre 1952.
« L’accident qui a tué Camus, je l’appelle scandale »

Au lendemain de la mort de Camus, Sartre avait rendu hommage à l’ami avec lequel il était brouillé. Voici son texte.
Jean-Paul Sartre
Il y a six mois, hier encore, on se demandait : « Que va-t-il faire ? » Provisoirement, déchiré par des contradictions qu’il faut respecter, il avait choisi le silence. Mais il était de ces hommes rares, qu’on peut bien attendre parce qu’ils choisissent lentement et restent fidèles à leur choix. Un jour, il parlerait. Nous n’aurions pas même osé risquer une conjecture sur ce qu’il dirait. Mais nous pensions qu’il changeait avec le monde comme chacun de nous : cela suffisait pour que sa présence demeurât vivante.
Nous étions brouillés, lui et moi : une brouille, ce n’est rien — dût-on ne jamais se revoir —, tout juste une autre manière de vivre ensemble et sans se perdre de vue dans le petit monde étroit qui nous est donné. Cela ne m’empêchait pas de penser à lui, sentir son regard sur la page du livre, sur le journal qu’il lisait et de me dire : « Qu’en dit-il ? Qu’en dit-il EN CE MOMENT ? »
Son silence que, selon les événements et mon humeur, je jugeais parfois trop prudent et parfois douloureux, c’était une qualité de chaque journée, comme la chaleur ou la lumière, mais humaine. On vivait avec ou contre sa pensée, telle que nous la révélaient ses livres — « la Chute », surtout, le plus beau peut-être et le moins compris — mais toujours à travers elle. C’était une aventure singulière de notre culture, un mouvement dont on essayait de deviner les phases et le terme final.
Il représentait en ce siècle, et contre l’Histoire, l’héritier actuel de cette longue lignée de moralistes dont les oeuvres constituent peut-être ce qu’il y a de plus original dans les lettres françaises. Son humanisme têtu, étroit et pur, austère et sensuel, livrait un combat douloureux contre les événements massifs et difformes de ce temps. Mais, inversement, par l’opiniâtreté de ses refus, il réaffirmait, au coeur de notre époque, contre les machiavéliens, contre le veau d’or du réalisme, l’existence du fait moral.
Il était pour ainsi dire cette inébranlable affirmation. Pour peu qu’on lût ou qu’on réfléchît, on se heurtait aux valeurs humaines qu’il gardait dans son poing serré : il mettait l’acte politique en question. Il fallait le tourner ou le combattre : indispensable en un mot, à cette tension qui fait la vie de l’esprit. Son silence même, ces dernières années, avait un aspect positif : ce cartésien de l’absurde refusait de quitter le sûr terrain de la moralité et de s’engager dans les chemins incertains de la pratique. Nous le devinions et nous devinions aussi les conflits qu’il taisait : car la morale, à la prendre seule, exige à la fois la révolte et la condamne.
Nous attendions, il fallait attendre, il fallait savoir : quoi qu’il eût pu faire ou décider par la suite, Camus n’eût jamais cessé d’être une des forces principales de notre champ culturel, ni de représenter à sa manière l’histoire de la France et de ce siècle. Mais nous eussions su peut-être et compris son itinéraire. Il avait tout fait — toute une oeuvre — et, comme toujours, tout restait à faire. Il le disait : « Mon oeuvre est devant moi. » C’est fini. Le scandale particulier de cette mort, c’est l’abolition de l’ordre des hommes par l’inhumain.[...] Rarement, les caractères d’une oeuvre et les conditions du moment historique ont exigé si clairement qu’un écrivain vive.
L’accident qui a tué Camus, je l’appelle scandale parce qu’il fait paraître au coeur du monde humain l’absurdité de nos exigences les plus profondes. Camus, à 20 ans, brusquement frappé d’un mal qui bouleversait sa vie, a découvert l’absurde, imbécile négation de l’homme. Il s’y est fait, il a pensé son insupportable condition, il s’est tiré d’affaire. Et l’on croirait pourtant que ses premières oeuvres seules disent la vérité de sa vie, puisque ce malade guéri est écrasé par une mort imprévisible et venue d’ailleurs. L’absurde, ce serait cette question que nul ne lui pose plus, qu’il ne pose plus à personne, ce silence qui n’est même plus un silence, qui n’est absolument plus rien.
Je ne le crois pas. Dès qu’il se manifeste, l’humain devient partie de l’humain. Toute vie arrêtée même celle d’un homme si jeune —, c’est à la fois un disque qu’on casse et une vie complète. Pour tous ceux qui l’ont aimé, il y a dans cette mort une absurdité insupportable. Mais il faudra apprendre à voir cette oeuvre mutilée comme une oeuvre totale.
Dans la mesure même où l’humanisme de Camus contient une attitude humaine envers la mort qui devait le surprendre, dans la mesure où sa recherche orgueilleuse et pure du bonheur impliquait et réclamait la nécessité inhumaine de mourir, nous reconnaîtrons dans cette oeuvre et dans la vie qui n’en est pas séparable la tentative pure et victorieuse d’un homme pour reconquérir chaque instant de son existence sur sa mort future.
Jean-Paul Sartre
(Texte publié le 7 janvier 1960 dans « France Observateur ».)
 Parmi les écrivains qui nous importent aujourd’hui, je citerai enfin le point de vue de Jacques Henric. Voici l’éditorial qu’il consacrait à Albert Camus et à François Mauriac dans le numéro 352 d’art press en janvier 2009.
Parmi les écrivains qui nous importent aujourd’hui, je citerai enfin le point de vue de Jacques Henric. Voici l’éditorial qu’il consacrait à Albert Camus et à François Mauriac dans le numéro 352 d’art press en janvier 2009.
Politiquement justes, surtout pas corrects
par Jacques Henric
Dans les pages littéraires de ce numéro d’art press quatre ouvrages sont recensés ayant pour objet la période la plus noire de notre histoire. Ont également vu le jour deux parutions importantes que nous n’avons pu signaler dans nos pages : les tomes 3 et 4 des oeuvres complètes de Camus (Pléiade Gallimard) et le Journal et les Mémoires politiques de Mauriac (Bouquins). De Camus, outre les grands textes littéraires et certains essais philosophiques, les deux volumes comportent ses interventions politiques (articles, préfaces. conférences, notamment les admirables chroniques algériennes de 1939-1958). De Mauriac. la republication de son Journal met à notre disposition l’ensemble des articles publiés dans divers organes de presse entre 1934 et le début des années 1950. Voilà donc deux écrivains, Camus et Mauriac, dont avec le recul il apparaît d’évidence qu’ils furent ceux qui, confrontés aux événements tragiques du 20e siècle (la guerre d’Espagne,les fascismes, l’antisémitisme, le stalinisme, Vichy, l’Occupation, la Collaboration, l’Epuration, les guerres coloniales, celle d’Algérie particulièrement, les événements de Hongrie de 1956, l’existence d’Israël menacée,..) furent les plus clairvoyants, les plus intellectuellement courageux. Les plus politiquement corrects ? Sûrement pas, Qu’on en juge par les attaques dont ils furent l’un et l’autre gratifiés. Camus, homme de gauche est attaqué par la droite, mais plus durement vilipendé par une gauche sartrienne et par les communistes. Camus « fasciste », va-t-on jusqu’à écrire dans la presse stalinienne. Mauriac, catholique, écrivain de droite, et revendiqué tel par lui, est violemment combattu par la gauche laïcarde et communisante (Mauriac « versaillais »), mais aussi traîné dans la boue par une droite et une extrême droite n’ayant rien appris de l’affrontement entre les démocraties et les régimes totalitaires, rien d’une nécessaire décolonisation, rien des catastrophes de leur temps. « Le conformisme est à gauche », écrira Camus, dans un texte paru en 1957, titré « Le socialisme des potences ». Lucidité prémonitoire de l’auteur des Justes : ne pourrait-on pas recopier mot pour mot son constat de l’époque pour obtenir un joli tableau de la situation actuelle : « La gauche est en pleine décadence, prison-mère des mots, engluée dans son vocabulaire, capable seulement de réponses stéréotypées... ». Même justesse de vue de Mauriac, ce qui obligera après-guerre à ferrailler avec le menu fretin des intellectuels et journalistes communistes dont les noms sont aujourd’hui tombés dans le plus juste oubli (des médiocres que j’ai approchés de près au début des années 1960 et qu’on peut retrouver, mal vieillis sous le harnais stalinien, dans mon livre Politique [32]). Il est arrivé, certes, que Camus et Mauriac s’affrontent à leur tour, mais une passion commune les unissait : Mozart. Rien de vraiment grave ne pouvait donc se produire entre eux.
Sollers en 2018...Sartre ou Camus ? Sartre

Lire également dans Libération du 21-11-09 : Philippe Lançon, Camus, l’homme bien révolté.
[2] Voir Le Nouvel Observateur.
[3] Voir le texte de Lou Marin Camus et les libertaires.
[4] Je souligne.
[5] Avec un autre texte, également publié dans le n° 1 de Tel Quel : Requiem.
[6] Voir Camus au Panthéon ?.
[8] Lautréamont et la banalité dans Lautréamont, Oeuvres complètes, Gallimard, La Pléiade, 2009, p. 502-507. Et p. 110-117 de L’homme révolté, Folio.
[9] Breton s’attaque ici à Sartre et à son Baudelaire.
[10] Sucre jaune, dans Lautréamont, Oeuvres complètes, Gallimard, La Pléiade, 2009, p.508-510. Le texte complet d’André Breton se trouve à la fin de Camus au Panthéon ?.
[11] Idem en ce qui concerne Sade en qui il voit le précurseur des "sociétés totalitaires" :
« Deux siècles à l’avance, sur une échelle réduite, Sade a exalté les sociétés totalitaires au nom de la liberté frénétique que la révolte en réalité ne réclame pas. Avec lui commencent réellement l’histoire et la tragédie contemporaines. »
De ce point de vue, Michel Onfray doit tout à Camus.
[12] A l’occasion de la publication des tomes 3 et 4 des oeuvres complètes de Camus (Pléiade Gallimard) et le Journal et les Mémoires politiques de Mauriac (Bouquins). Sur Mauriac qui n’est pas ici notre propos, voir Mauriac, « un moraliste de premier ordre ».
[13] 8 pages sur un livre de 382 pages.
[14] Je souligne.
[15] Georges Bataille, OC, tome XI, p. 410-411.
[16] Cf. les Oeuvres complètes de Georges Bataille, tome XII, Le temps de la révolte, p. 149-169. Dans le même volume, on trouve l’autre article de Bataille : L’affaire de « L’Homme révolté », p. 230.
[17] Voir Camus le nouveau philosophe.
[18] Faut-il rappeler que l’exergue de L’Homme révolté est tiré de La Mort d’Empédocle de Hölderlin ?
« Et ouvertement je vouai mon coeur à la terre grave et souffrante, et souvent, dans la nuit sacrée, je lui ai promis de l’aimer fidèlement jusqu’à la mort sans peur, avec son lourd fardeau de fatalité, et de ne mépriser aucune de ses énigmes. Ainsi, je me liai à elle d’un lien mortel. »
[19] Le plaidoyer de Camus est extrait de « Réflexions sur la peine capitale » co-écrit avec Arthur Koestler (1957) :

Les premières pages de Réflexions sur la guillotine d’Albert Camus :
« Peu avant la guerre de 1914, un assassin dont le crime était particulièrement révoltant (il avait massacré une famille de fermiers avec leurs enfants) fut condamné à mort en Alger. Il s’agissait d’un ouvrier agricole qui avait tué dans une sorte de délire de sang, mais avait aggravé son cas en volant ses victimes. L’affaire eut un grand retentissement. On estima généralement que la décapitation était une peine trop douce pour un pareil monstre.
Telle fut, m’a-t-on dit l’opinion de mon père que le meurtre des enfants en particulier avait indigné. L’une des rares choses que je sache de lui, en tout cas est qu’il voulut assister* à l’exécution pour la première fois de sa vie. Il se leva dans la nuit pour se rendre sur les lieux du supplice, à l’autre bout de la ville, au milieu d’un grand concours de peuple. Ce qu’il vit ce matin là, il n’en dit rien à personne. Ma mère raconte seulement qu’il rentra en coup de vent, le visage bouleversé, refusa de parler, s’étendit un moment sur le lit et se mit tout d’un coup à vomir. Il venait de découvrir la réalité qui se cachait sous les grandes formules dont on la masquait. Au lieu de penser aux enfants massacrés, il ne pouvait plus penser qu’à ce corps pantelant qu’on venait de jeter sur une planche pour lui couper le cou.
Il faut croire que cet acte rituel est bien horrible pour arriver à vaincre l’indignation d’un homme simple et droit et pour qu’un châtiment qu’il estimait cent fois mérité n’ait eu finalement d’autre effet que de lui retourner le coeur. Quand la suprême justice donne seulement à vomir à l’honnête homme qu’elle est censée protéger, il paraît difficile de soutenir qu’elle qu’ elle est destinée comme ce devrait être sa fonction à apporter plus de paix et d’ordre dans la cité. Il éclate au contraire qu’elle n’est pas moins révoltante que le crime, et que ce nouveau meurtre, loin de réparer l’offense faite au corps social, ajoute une nouvelle souillure à la première. Cela est si vrai que personne n’ose parler directement de cette cérémonie. »
Albert Camus (Folio, p. 143-144).
[20] Ce dossier était rédigé quand Sollers a écrit son article.
Camus, Noces, L’été et les Grecs.
Ce sont des essais écrits entre 1936 et 1950.
J’ai retrouvé mon vieil exemplaire de 1967 (Livre de poche).
[...] « rejoindre les Grecs », la formule se trouve dans L’exil d’Hélène (1948), un des chapitres de L’été. Camus écrit :
« L’ignorance reconnue, le refus du fanatisme, les bornes du monde et de l’homme, le visage aimé, la beauté enfin, voici le camp où nous rejoindrons les Grecs. D’une certaine manière, le sens de l’histoire de demain n’est pas celui qu’on croit. Il est dans la lutte entre la création et l’inquisition. Malgré le prix que coûteront leurs mains vides, on peut espérer leur victoire. Une fois de plus, la philosophie des ténèbres se dissipera au-dessus de la mer éclatante. O pensée de midi, la guerre de Troyes se livre loin des champs de bataille ! Cette fois encore, les murs terribles de la cité moderne tomberont pour livrer, « âme sereine comme le calme des mers », la beauté d’Hélène. »
Noces commence par une épigraphe de Stendhal : « Le bourreau étrangla le cardinal Carrafa avec un cordon de soie qui se rompit : il fallut y revenir deux fois. Le cardinal regarda le bourreau sans daigner prononcer un mot. » (La Duchesse de Palliano) ; et L’été par un vers de Hölderlin : « Mais toi tu es né pour un jour limpide... ». (L’exergue de L’homme révolté est aussi de Hölderlin).
A l’époque (il y a plus de 40 ans donc), j’avais souligné quelques phrases :
— dans Noces : « Je comprends ici ce qu’on appelle gloire : le droit d’aimer sans mesure. Il n’y a qu’un seul amour dans ce monde. Étreindre un corps de femme, c’est aussi retenir contre soi cette joie étrange qui descend du ciel vers la mer. »
« Il n’y a pas de honte à être heureux. Mais aujourd’hui l’imbécile est roi, et j’appelle imbécile celui qui a peur de jouir. »
« Tout à l’heure, avec la première étoile, la nuit tombera sur la scène du monde. Les dieux éclatants du jour retourneront à leur mort quotidienne. Mais d’autres dieux viendront. Et pour être plus sombres, leurs faces ravagées seront nées cependant dans le coeur de la terre. »
« De la boîte de Pandore où grouillaient les maux de l’humanité, les Grecs firent sortir l’espoir après tous les autres, comme le plus terrible de tous. Je ne connais pas de symbole plus émouvant. Car l’espoir, au contraire de ce qu’on croit, équivaut à la résignation. Et vivre, c’est ne pas se résigner. »
— Dans L’été : « La Méditerranée a son tragique solaire qui n’est pas celui des brumes. »
« Nous avons exilé la beauté, les Grecs ont pris les armes pour elle. Première différence, mais qui vient de loin. La pensée grecque s’est toujours retranchée sur l’idée de limite. Elle n’a rien poussé à bout, ni le sacré, ni la raison, parce qu’elle n’a rien nié, ni le sacré, ni la raison. Elle a fait la part de tout, équilibrant l’ombre par la lumière. Notre Europe, au contraire, lancée à la conquête de la totalité, est fille de la démesure. Elle nie la beauté, comme elle nie tout ce qu’elle n’exalte pas. »
« Voilà pourquoi il est indécent de proclamer aujourd’hui que nous sommes les fils de la Grèce. Ou alors nous en sommes les fils renégats. »
« La démesure est un incendie, selon Héraclite. L’incendie gagne, Nietzsche est dépassé. [...]
La nature est toujours là, pourtant. Elle oppose ses ciels calmes et ses raisons à la folie des hommes. »
« Ulysse peut choisir chez Calypso entre l’immortalité et la terre de la patrie. Il choisit la terre, et la mort avec elle. »
Ces phrases, je les soulignerais encore. Avec celle-ci — c’est la fin de L’été — :
« J’ai toujours eu l’impression de vivre en haute mer, menacé, au coeur d’un bonheur royal. »
On peut être et avoir été.
« Ce qui a été ne passe pas. On demeure ce qu’on est si on a connu un grand été. « Je suis été » : le Français permet cette clarté d’orage. »
A.G., 10 février 2010.
[21] NOTES DE BATAILLE. — Dialogue entre André Breton et Aimé Patri à propos de L’Homme révolté, d’Albert Camus, dans Arts, 16 novembre 1951.
[22] Souligné par moi.
[23] L’Homme révolté, p. 36. Le passage, et, en général, l’analyse dont je viens de faire état, se trouvent dans un chapitre portant à lui seul le titre « L’Homme révolté », qui avait paru à part sous le titre Remarque sur la révolte, dans L’Existence, collection « La Métaphysique », dirigée par Jean Grenier (Gallimard, 1945). Cette étude constitue en somme un « discours sur la méthode » de la révolte. J’en avais déjà parlé dans un article général sur Camus (Critique, juin-juillet 1947), mais sans avoir su, alors, en dégager toute la portée.
[24] Une lettre d’Albert Camus en réponse à André Breton, dans Arts, 19 octobre 1951. Cette première lettre était justifiée par Sucre jaune (Arts, 12 octobre), où Breton s’en prend à Camus à la suite de la publication en article, dans les Cahiers du Sud, du passage de L’Homme révolté concernant Lautréamont.
[25] Dialogue... (Arts, 16 novembre), p. 1. Voici la phrase entière : « ... Je ne crois (pas) à la vertu finale d’une pensée qui s’appuie chemin faisant sur les interprétations arbitraires et ne recule pas, au besoin, devant le faux témoignage. »
[26] Les pages des Temps modernes auxquelles je fais allusion sont reproduites dans Situations, II (Gallimard, 1945), p. 214-229, où l’auteur, entre autres, ajoute en note : (Breton) « se rend-il bien compte de la manoeuvre dont il fait l’objet ? Pour l’éclairer, je lui révèlerai donc que M. Bataille, avant d’informer publiquement Merleau-Ponty qu’il nous retirait son article, l’avait avisé de ses intentions dans une conversation privée. Ce champion du surréalisme avait alors déclaré : « Je fais les plus grands reproches à Breton, mais il faut nous unir contre le communisme. » Voilà qui suffit. » Voici pour moi l’occasion de dire qu’un jour Merleau-Ponty me prévint de l’existence de cette note ; il ajouta : « Je ne me souviens plus très bien de ce que j’ai dit à Sartre, mais cela ne devait pas être exactement ce que vous m’avez dit et je suis sûr que Sartre n’a pas reproduit exactement ce que je lui ai dit ». Ce qui est dans l’ordre des choses, mais il l’est moins de reproduire un propos que l’on n’a pas personnellement entendu... Je n’avais aucun souvenir de ce que j’avais dit à Merleau-Ponty, mais je me rappelai dans sa précision la phrase, facile à retenir sans déformation, qui me rendait compte du fait que Sartre put me prêter un propos aussi loin de ma pensée. Celle-ci diffère peut-être de ce que j’ai réellement dit, mais je la connais bien, elle n’a pas changé : je pense que le texte de Sartre contenait des vérités qui déforment la vérité et que cette sommaire exécution renforçait la position communiste sur le plan de la littérature, à laquelle je ne m’accorde pas, et à laquelle je pensais que Sartre lui-même ne s’accorde pas. J’étais alors loin d’être seul à trouver l’attitude de Sartre pénible ; il ne s’agissait pas de manoeuvre de ma part, mais d’un peu d’excitation extérieure, à laquelle je ne cèderais pas maintenant aussi vite. Sartre seul manoeuvrait, me prêtant une phrase qui devait susciter contre moi la double hostilité de Breton et des communistes ! Mais le fait est : je me suis désintéressé de la question. Le passage de Sartre me venant sous les yeux, pour avoir voulu donner une référence, je crois bon malgré tout, plus de trois ans ayant passé, et l’occasion se présentant, de mettre finalement les choses au point.
[27] Sucre jaune (Arts, 12 octobre 1951).
[28] Toutefois, l’exigence ne va pas sans incohérence, sans relâchement : un petit nombre de personnes se souviennent de l’affaire Matta, de Matta exclu en raison d’un suicide qui suivit, sans d’ailleurs en être clairement l’effet, la rupture entre une femme et son mari. Nous touchons ici, mais indéniablement, le « pire conformisme », aux antipodes de la révolte.
[29] Dialogue entre André Breton et Aimé Patri..., dans Arts, 16 novembre 1951, p. 3
[30] Ibid.
[31] L’oeuvre de Georges Dumézil montre la part dans l’imagination de l’Antiquité et du Moyen Âge, de l’idée du roi méhaigné, du roi infirme.




 Version imprimable
Version imprimable



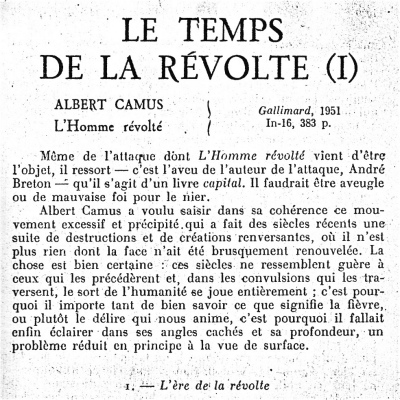
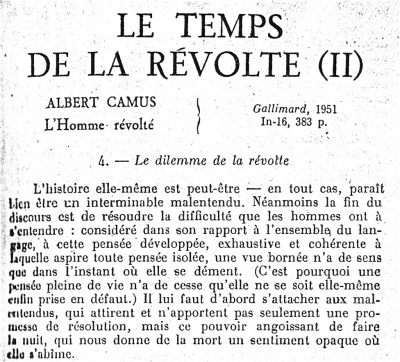
 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?



8 Messages
En direct et en public de Lourmarin du 24 au 27 juin. Un festival co-produit par Les Rencontres Méditerranéennes Albert Camus et France Culture. VOIR ICI : France Culture à l’ESTIVAL ALBERT CAMUS.
ARCHIVE. Trois jours après la mort d’Albert Camus, Sartre avait rendu hommage, dans « France Observateur », à l’ami avec lequel il était brouillé. Voici son texte, paru le 7 janvier 1960.
Camus : Sartre, ce très cher adversaire
Sartre et Camus dans l’atelier de Pablo Picasso, en juin 1944.
Zoom : cliquez l’image.
La question de la violence soviétique a divisé les deux intellectuels majeurs de l’après-guerre, et avec eux toute la gauche française. Pourtant, Sartre et Camus avaient auparavant entretenu une amitié passionnée, comme l’explique l’universitaire américain Ronald Aronson, qui a étudié leur relation. LIRE ICI pdf
Pour juger sur pièces, de nombreux documents sonores sont présentés cette semaine lors de l’émission : Les nouveaux chemins de la connaissance.
Ce lundi :
_ — le discours du Nobel et les réponses de Camus — qui ne manquent pas d’humour — à des journalistes. Où l’on notera que l’écrivain se considère comme fidèle à une certaine tradition française, celle de La Bruyère ou Pascal, pas celle de Lamartine ou de Victor Hugo.
_ — un discours sur son " métier " du 22 janvier 1958 devant des républicains espagnols qui vaut bien — parce que moins convenu — celui du Nobel.
Bref entretien avec Raphaël Enthoven dans Le Monde.
La citation de Artaud par A.G est foudroyante.
Croyez-vous que Sollers la signerait ?
Ce que dit Artaud dans la citation signifie entre autres la neutralisation pure et simple de quelqu’un comme Sollers.
Si tant est qu’on prenne ce qu’écrit Artaud au sérieux...
(mais il ne s’agit pas de ça, n’est-ce pas...)
Après ce copieux et très riche dossier, la réponse de Jean-Jacques Brochier me suffit : "Philosophe pour classes terminales".
1. > Bataille à propos de Camus : Le temps de la révolte ,
5 août 2013, 05:51, par Claude
,
5 août 2013, 05:51, par Claude
Il y en a qu’aucun orgueil ou qu’aucune idéologie,ici de classe,ne saurait limiter dans leur suffisance et leur prétention,par exemple comme ici,celle de vouloir toujours et à n’importe quel prix, établir des catégories, des types, des degrés de conscience ou d’intelligence propres à désigner tel ou tel type,telle capacité etc..A.Camus,"philosophe pour classes de terminales",l’indigence du propos ou de la réflexion renvoie nécessairement à l’idéologie qui la sous tend. Encore une fois,démonstration est faite que les tenants et les valets du dogme et de l’idéologie, de l’arbitraire et de tous les totalitarismes sont toujours,hélas,bien présents dans l’histoire des hommes. A.Camus n’était certes pas pour vous messieurs, un philosophe digne de reconnaissance mais il a sur vous cet avantage et cette vérité irréductibles d’avoir été un homme vrai et libre.
Comme vous le savez, Artaud dit très précisément : « Toute l’écriture est de la cochonnerie.
_ Les gens qui sortent du vague pour essayer de préciser quoi que ce soit de ce qui se passe dans leur pensée, sont des cochons.
_ Toute la gent littéraire est cochonne, et spécialement celle de ce temps-ci.
Tous ceux qui ont des points de repère dans l’esprit, je veux dire d’un certain côté de la tête, sur des emplacements bien localisés de leur cerveau, tous ceux qui sont maîtres de leur langue, tous ceux pour qui les mots ont un sens, tous ceux pour qui il existe des altitudes dans l’âme, et des courants dans la pensée, ceux qui sont esprit de l’époque, et qui ont nommé ces courants de pensée, je pense à leurs besognes précises, et à ce grincement d’automate que rend à tous vents leur esprit,
_ — sont des cochons.
_ Ceux pour qui certains mots ont un sens, et certaines manières d’être, ceux qui font si bien des façons, ceux pour qui les sentiments ont des classes et qui discutent sur un degré quelconque de leurs hilarantes classifications, ceux qui croient encore à des "termes", ceux qui remuent des idéologies ayant pris rang dans l’époque, ceux dont les femmes parlent si bien et ces femmes aussi qui parlent si bien et qui parlent des courants de l’époque, ceux qui croient encore à une orientation de l’esprit, ceux qui suivent des voies, qui agitent des noms, qui font crier les pages des livres,
_ — ceux-là sont les pires cochons.
_ Vous êtes bien gratuit, jeune homme !
_ Non, je pense à des critiques barbus.
Et je vous l’ai dit : pas d’oeuvres, pas de langue, pas de parole, pas d’esprit, rien.
Rien, sinon un beau Pèse-Nerfs. » (Le Pèse-Nerfs, 1925)
Quelques rectifications s’imposent. En réaction à ce que je lis, entend, ici et là. Bien que jeune lecteur, j’ai un peu attrapé le virus littéraire, dirons-nous. Donc j’exprime mon avis. Je m’en sens obligé. De démangeaison. Sur un site par ailleurs remarquable.
D’abord dire et redire que Camus n’est ni un MORALSTE ni un HUMANISTE. AU CONTRAIRE. Il suffit de LIRE ses textes.
Par exemple, souvenons-nous que l’Etranger a été taxé à l’époque de livre "immoral". Ensuite, je cherche en vain un résidu d’humanisme dans Caligula ou la Chute.
Mais Camus avait anticipé cette classification abrupte, inepte. Cette récuperation politique obtuse, ce radotage de corniaud. " Oui, l’enfer doit être ainsi : des rues à enseignes et pas moyen de s’expliquer. On est classé une fois pour toutes" Page 52, la Chute.
De la même façon, après la parution de l’homme révolté, on l’a accusé d’exalter le terrorisme. (dans lettres sur la révolte, Actuelle 2 pléiade n° 3)
On tape jamais sur les bons. Allez voir du côté d’Hegel ( ce que fait courageusement Camus d’ailleurs ) et d’autres, qu’on récupère à coups de slogans institutionnels. Et j’en passe. C’est re-vol-tant. Il y a une chape de plomb à pulvériser, un monde de dandy à défigurer.
Et puis se positionner contre la peine de mort ( comme l’a fait Camus) n’est en rien une façon d’être humaniste. L’humaniste, c’est celui qui est pour la peine de mort. En croyant qu’il y a d’un côté le coupable et de l’autre les gentils, les épouvantails de vertu, c’est-à-dire les juges. Or ces oppositions de bistrot commencent à être exasperantes.
Le coupable n’est que le reflet de ce que refoule les magistrats ou le citoyen lambda. IL N’Y A PAS D’INHUMAIN. ( Lautréamont est bien de l’engeance, quoi qu’il en dise. Et il est sûrement plus humain que le reste, dans son inhumanité verbale.)
Le paradoxe monumental est qu’on accuse des gens, en les amenenant à la potence, alors qu’ils sont alles eux au bout de leurs pulsions, celles de tout un chacun. PARFAITEMENT. Car qui n’a jamais eu envie de tuer quelqu’un ?? Qu’il se lève).
Kafka avait raison, on accuse d’abord quelqu’un d’être homme, avant son forfait, quel qu’il soit
Ensuite, Breton. Sans commentaires. Voilà un écrivain-voyou qui est resté à quai (comme la plupart, ils se sont erigés un seuil de censure, ont serré les fesses, et n’ont pas suivi le conseil de Lautréamont " Allez-y voir vous-même si vous ne voulez pas me croire". A qui la faute ? )
Enfin Sade. La encore, c’est de la violence gratuite ( Comme Guyotat et consorts). La pornographie est-elle un art ? Sade n’est donc pas de la littérature. Mais s’il ne fallait garder que des écrivains dignes de ce nom, des chercheurs d’absolu, on aurait plus qu’à vendre sa bibilothèque.
Au risque de pasticher Artaud "toute la culture est de la cochonnerie".
Il n’est pas sûr que je revienne. C’est le propre de la dénonciation que d’être un réceptacle d’échos désertiques.