Viens de terminer Le lièvre de Patagonie de Claude Lanzmann. Passionnant. Lu jusqu’à la dernière ligne, ce qui est l’exception pour moi.
Le curé d’Uruffe, l’extrait présenté ici, n’est sans doute pas le plus significatif de ce livre, encore qu’il illustre la capacité exceptionnelle, la détermination farouche de Claude Lanzmann d’aller à l’extrême de l’extrême d’une investigation, jusqu’à s’incarner dans ce curé criminel comme il s’incarne dans ces femmes et hommes Juifs dans la chambre à gaz : « on les contraint à se dévêtir et à entrer nus dans la pièce immense où on les presse à 3000 les uns contre les autres, et dans laquelle les cristaux verdâtres de gaz Zyklon seront jetés une fois les portes fermées [1]. L’électricité est coupée : dans le noir se livre ce que Philip Müller appelle « le combat de la vie, le combat de la mort », chacun tentant d’attraper un peu d’air pour respirer une seconde de plus. » Comme il s’incarne dans ce lièvre de Patagonie.
Fait divers des années 1950 couvert dans une de ses vies de journaliste, pour France Dimanche, puis approfondi dans un texte publié dans Les Temps modernes en 1958 et repris par Philippe Sollers, 40 ans plus tard dans L’Infini N° 61, automne 1998. C’est ce pont avec Sollers, qu’évoque Claude Lanzmann dans son livre et sa faculté hors du commun d’incarnation qui ont guidé notre choix.
Mais ce livre ne saurait se réduire à une de ses facettes, pas plus que le diamant taillé. Philippe Sollers et Bernard Henri Lévy l’ont qualifié de chef-d’oeuvre. Même venant de sympathisants, le mot chef-d’oeuvre n’est pas galvaudé dans leurs écrits. Serge July a écrit un très bel article d’hommage "Un très grand vivant"
 Mais surtout, lisez Le Lièvre de Patagonie. Comme Shoah, il ne se résume pas, il se vit, dans l’incarnation de ceux et celles qu’il évoque. « Dévoiler leur vérité - s’il le faut la débusquer -, les rendre vivants et présents à jamais. C’est ma loi en tous cas.[...] » C’est aussi un livre d’aventure, d’aventure humaine, l’aventure de ses vies multiples et Claude Lanzmann est un merveilleux conteur qui sait se faire lièvre de Patagonie, bondissant, infatigable [2] », plusieurs fois foudroyé par l’amour, baroudeur intrépide...
Mais surtout, lisez Le Lièvre de Patagonie. Comme Shoah, il ne se résume pas, il se vit, dans l’incarnation de ceux et celles qu’il évoque. « Dévoiler leur vérité - s’il le faut la débusquer -, les rendre vivants et présents à jamais. C’est ma loi en tous cas.[...] » C’est aussi un livre d’aventure, d’aventure humaine, l’aventure de ses vies multiples et Claude Lanzmann est un merveilleux conteur qui sait se faire lièvre de Patagonie, bondissant, infatigable [2] », plusieurs fois foudroyé par l’amour, baroudeur intrépide...
 et saurien placide au débit lent, tête burinée, portant l’histoire humaine dans les plis de sa peau, et ses gènes immémoriaux, le temps ramassé en lui, avec son tempo propre, douze ans de travail pour le film Shoah, avant la première en avril 1985 (cinq années de gestation suivies de sept autres de tournage.et de montage), hors du temps économique, du monde de la finance et de l’immédiateté frénétique du spectacle moderne. Pour important que soit ce moment de sa vie, et « justifiant une vie » comme le lui a dit Jean Daniel après la projection, il n’est abordé qu’à la fin de son livre et nous fait découvrir l’aventure de la réalisation de Shoah.
et saurien placide au débit lent, tête burinée, portant l’histoire humaine dans les plis de sa peau, et ses gènes immémoriaux, le temps ramassé en lui, avec son tempo propre, douze ans de travail pour le film Shoah, avant la première en avril 1985 (cinq années de gestation suivies de sept autres de tournage.et de montage), hors du temps économique, du monde de la finance et de l’immédiateté frénétique du spectacle moderne. Pour important que soit ce moment de sa vie, et « justifiant une vie » comme le lui a dit Jean Daniel après la projection, il n’est abordé qu’à la fin de son livre et nous fait découvrir l’aventure de la réalisation de Shoah.
Si ce n’est déjà fait, lisez Le Lièvre de Patagonie.

Pourquoi « Le Lièvre... » ?

- Barbelés de Birkenau
- © Gérard Conreur / RF
... « Les lièvres, j’y ai pensé chaque jour tout au long de la rédaction de ce livre, ceux du camp d’extermination de Birkenau, qui se glissaient sous les barbelés infranchissables pour l’homme, ceux qui proliféraient dans les grandes forêts de Serbie tandis que je conduisais dans la nuit, prenant garde à ne pas les tuer. Enfin, l’animal mythique qui surgit dans le faisceau de mes phares après le village patagon d’El Calafate, me poignardant littéralement le coeur de l’évidence que j’étais en Patagonie, qu’à cet instant la Patagonie et moi étions vrais ensemble. C’est cela l’incarnation. J’avais près de 70 ans mais tout mon être bondissait d’une joie sauvage, comme à 20 ans. » ...
Claude Lanzmann
Le Lièvre de Patagonie
A propos du Curé d’Uruffe
Le Lièvre de Patagonie (extrait)
CHAPITRE XIII
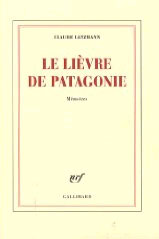 1958, j’ai trente-trois ans. C’est pour moi l’année du « Curé d’Uruffe », du retour au pouvoir du général de Gaulle, de mon voyage en Corée du Nord et en Chine, du pressentiment, bientôt devenu évidence, que ma relation avec le Castor devrait prendre un autre tour. Ce qui relie ces moments de ma vie est bien plus profond que la simple confluence chronologique. À Uruffe, ordinaire paroisse de Lorraine, le curé avait tué d’une balle dans la nuque Régine Fays, une de ses ouailles, jeune fille de vingt ans grosse de lui et proche de la délivrance, puis, le meurtre accompli, l’avait accouchée par éventration avant de crever les yeux du bébé avec un petit couteau de scout, non sans lui avoir administré préalablement, dans un fulgurant raccourci liturgique, baptême et extrême-onction. C’était un fait divers comme il en arrive peu dans la suite des âges et France Dimanche me demanda de « couvrir » le procès, qui s’ouvrit devant la cour d’assises de Meurthe-et-Moselle le 24 janvier 1958, un matin de froidure où la neige et la glace recouvraient Nancy. Je ne raconterai pas ici la vie affolante qui fut celle de Guy Desnoyers, « l’assassin d’Uruffe » comme osa le nommer Le Figaro dans son édition du jour, réalisant une opération difficile et de style magique qui consistait à expulser le prêtre de l’Église et l’Église du prêtre. J’ai suivi l’intégralité des débats, y compris les sessions où le huis clos avait été décidé, et j’ai assisté au prononcé du verdict d’indulgence, qui permit au curé doublement meurtrier et mille fois pécheur d’échapper à la peine de mort, les circonstances atténuantes lui ayant été accordées sans qu’elles aient jamais été évoquées pendant les deux journées d’un procès conduit au pas de charge par un président soucieux avant tout d’éviter que les vraies questions ne soient posées.
1958, j’ai trente-trois ans. C’est pour moi l’année du « Curé d’Uruffe », du retour au pouvoir du général de Gaulle, de mon voyage en Corée du Nord et en Chine, du pressentiment, bientôt devenu évidence, que ma relation avec le Castor devrait prendre un autre tour. Ce qui relie ces moments de ma vie est bien plus profond que la simple confluence chronologique. À Uruffe, ordinaire paroisse de Lorraine, le curé avait tué d’une balle dans la nuque Régine Fays, une de ses ouailles, jeune fille de vingt ans grosse de lui et proche de la délivrance, puis, le meurtre accompli, l’avait accouchée par éventration avant de crever les yeux du bébé avec un petit couteau de scout, non sans lui avoir administré préalablement, dans un fulgurant raccourci liturgique, baptême et extrême-onction. C’était un fait divers comme il en arrive peu dans la suite des âges et France Dimanche me demanda de « couvrir » le procès, qui s’ouvrit devant la cour d’assises de Meurthe-et-Moselle le 24 janvier 1958, un matin de froidure où la neige et la glace recouvraient Nancy. Je ne raconterai pas ici la vie affolante qui fut celle de Guy Desnoyers, « l’assassin d’Uruffe » comme osa le nommer Le Figaro dans son édition du jour, réalisant une opération difficile et de style magique qui consistait à expulser le prêtre de l’Église et l’Église du prêtre. J’ai suivi l’intégralité des débats, y compris les sessions où le huis clos avait été décidé, et j’ai assisté au prononcé du verdict d’indulgence, qui permit au curé doublement meurtrier et mille fois pécheur d’échapper à la peine de mort, les circonstances atténuantes lui ayant été accordées sans qu’elles aient jamais été évoquées pendant les deux journées d’un procès conduit au pas de charge par un président soucieux avant tout d’éviter que les vraies questions ne soient posées.
J’ai écrit pour France Dimanche un article que j’aimerais relire aujourd’hui, satisfaisant à mes yeux par tout ce que j’y disais, insatisfaisant par manque de place et impossibilité d’une analyse en profondeur. France Dimanche — l’unité du moi se retrouve ici était comme un poisson-pilote, comme le premier étage d’une fusée, je décidai que je ne pouvais en rester là et que j’allais écrire un autre texte, libre de toute contrainte, pour Les Temps modernes, revue qui par ailleurs avait donné au fait divers un statut et une dignité ne le cédant en rien à ceux de la littérature ou de la philosophie. Sartre et le Castor dévoraient dans les journaux ce qui avait trait aux passions humaines, lisaient des romans policiers, et la revue ne recula jamais devant la publication du récit des pires déviances, lorsque nous les jugions dévoilantes. Je me mis donc au travail à mon bureau de la rue Schoelcher dès le début février, mais le Castor n’entendait pas déroger aux sacro-saintes vacances d’hiver et avait décidé que nous irions skier à Courchevel. Je lui remontrai que je ne pourrais mener de front le ski et mon article, qui me mobilisait entièrement. C’est au ski que je renonçai et je m’en étonne aujourd’hui encore, car je ne m’en croyais pas capable, tant j’aimais foncer sur les pistes : pendant les quinze jours de grand beau temps ininterrompu que nous passâmes à Courchevel, je n’ai pas skié une heure. Castor dévalait seule, je ne quittais pas la chambre sombre, écrivant du matin au soir, ne sortant même pas pour respirer l’air raréfié et pur des cimes et lui donnant à lire, le soir, ce que j’avais écrit.
Le curé d’Uruffe et la raison d’Eglise
Quarante ans après, il garde, me semble-t-il, toute sa force d’analyse.
Misérable curé d’hier, bouchers islamiques d’aujourd’hui,
intégristes cinglés en tout genre, même pathologie, mêmes crimes.
Et comme la déraison d’État s’entend très bien, pourvu que la marchandise y trouve son compte, avec la déraison religieuse (quelle qu’elle soit),
j’ai pensé qu’il fallait faire relire aujourd’hui cette prose magnifique.
Je remercie Claude Lanzmann d’avoir accepté cette idée.
PHILIPPE SOLLERS Janvier 1998
(L’INFINI N° 61, printemps 1998)


Le texte intégral " Le curé d’Uruffe et la raison d’Eglise "

Les femmes de Claude lanzmann
 Si je fais un nouveau film, ce sera un film d’amour et de sexe
Si je fais un nouveau film, ce sera un film d’amour et de sexe

Chat Le Monde 24/02/2009

Lanemann, Beauvoir et Sartre, le 4 mars 1967, à Gizeh, Egypte. AFP
ZOOM : cliquer l’image

Simone de Beauvoir
La comédienne Judith Magre qu’il épousa
Angelika Schrobsdorff, sa deuxième femme, épousée à Jérusalem
La brève et romantique rencontre avec Kim Kum-sun, en Corée du Nord, qui nous vaut un chapitre sublime et éclaire le livre.
Sa soeur, la comédienne Evelyne Rey qui se suicida. Belle, et talentueuse interprète de Sartre dans Huis clos, Claude Lanzmann organisa un dîner à la demande de Sartre. Elle devint son amante. Sa réussite apparente, sa beauté qui attirait les amants, cachaient un grand mal de vivre. Elle avait 39 ans. Une blessure pour Claude Lanzmann qui se reproche de n’avoir pas été là pour arrêter son geste. Il vivait alors avec la comédienne Judith Magre, autre co-interprète de Huis clos. Judith Magre n’aimait pas Evelyne nous dit-il. Evelyne ne l’avait pas appelé. Pas osé ? Le remord de Claude Lanzmann.

« ce fut une véritable vie commune : nous vécûmes conjugalement pendant sept ans de 1952 à 1959. Je suis le seul homme avec qui Simone de Beauvoir mena une existence quasi maritale. Nous réussîmes à cohabiter pendant plus de deux ans dans une pièce unique de vingt-sept mètres carrés et étions, elle comme moi, quand il nous arrivait d’en prendre conscience et d’en parler, légitimement fiers de notre entente. Je trouvais juste et normal qu’elle partît en voyage ou qu’elle passât une grande part des vacances avec Sartre, il trouvait normal qu’elle en fit autant avec moi. [...] Nous étions tous les trois très faciles à vivre. Elle comme lui — et c’est aussi depuis très longtemps ma conviction — pensaient qu’on ne discute bien qu’avec ceux avec lesquels on est d’accord sur le fond. C’est pourquoi ils détestaient les mondanités et les grandes tablées françaises, privilégiant la relation duelle. Être deux, se parler deux à deux était selon eux — selon moi aussi, ils m’ont appris cela — la seule façon se se comprendre de s’entendre, d’avancer, de réfléchir. »
p. 250


La comédienne Judith Magre qu’il rencontra en 1946, « d’emblée foudroyé [foudroiement réciproque] par cette nerveuse liane de vingt ans au corps mince et dur, à la voix profonde et riche de toutes les inflexions, par ce visage aux pommettes hautes, ce regard de feu, cette bouche rouge et sensuelle sous un nez puissant. Elle ne s’appelait alors ni Judith, ni Magre. » Il l’épousera plus tard. « J’admirais Judith actrice, son allure nerveuse, sa diction parfaite, ses brusques ruptures de ton et démarche, l’ironie, la puissance tragique, combinaison unique qui lui valut plus tard d’obtenir par trois fois un « Molière » qui la consacrait meilleure comédienne de France. Je la regardais d’un oeil à la fois amoureux et professionnel car il m’arrivait non seulement de l’aider à apprendre ses textes, mais aussi d’en faire pour elle et avec elle l’explication ».
[...]
Mon mariage avec Judith [1963] marqua pour moi mon intégration à une vraie famille française. J’avais toujours envié les familles des autres, les familles constituées, où tout semblait ordre et beauté, luxe calme et volupté. Judith et moi nous étions unis en catastrophe presque clandestinement, à la mairie du Vie arrondissement. Il fallait bien que je fusse un jour présenté à ma belle famille, les Dupuis, des industriels de Haute-Marne, inventeurs de machines agricoles, à la tête d’une importante usine, longue lignée catholique, six enfants, quatre filles, deux garçons. Tous pour accueillir un jeune marié de trente huit printemps, avaient pris place autour de la table du déjeuner dominical [...]
p.386

(sous titrage pileface)

Pourquoi Israël fut présenté pour la première fois au Festival de New York le 7 octobre 1973. Le matin qui précédait la projection, je me rasais dans la salle de bains de ma chambre de l’hôtel Algonquin, 44e Rue Ouest, quand j’entendis un hurlement. C’était Angelika, que j’épouserais un an plus tard à Jérusalem : elle voyait sur un petit poste de télévision les troupes égyptiennes traversant le canal de Suez et détruisant les bunkers de la ligne Bar-Lev. La projection eut donc lieu dans des conditions singulières et angoissantes. Au cours de la conférence de presse qui suivit, une journaliste américaine, juive peut-être, m’interpella : « Mais enfin, monsieur, quelle est votre patrie ? Est-ce la France ? Est-ce Israël ? » Avec vivacité et sans prendre le temps d’aucune réflexion, je répondis, et cela éclaire peut-être le mystère dont je viens de parler : « Madame, ma patrie, c’est mon film. » [...]
p. 244
J’étais tombé amoureux d’Angelika Schrobsdorff
De nombreuses strates de temps confluent dans ce film et ont concouru à sa réalisation, l’événement déclencheur, le dernier en date et sûrement le plus impérieux fut que j’étais tombé amoureux d’Angelika Schrobsdorff à Jérusalem et que faire le film était pour moi le seul moyen de la revoir. [...]
p. 250
Elle était berlinoise d’une mère juive
Elle était berlinoise d’une mère juive et s’un père de la haute bourgeoisie prussienne, elle venait d’épouser par lassitude le baron bavarois, architecte de son état, avec lequel elle vivait depuis plusieurs années, mais l’avait quitté pour Jérusalem dès le lendemain du mariage, Jérusalem où elle retrouvait des amis de sa mère, qui l’avaient connue enfant et avaient réussi à fuir l’Allemagne en 1936 ou 1938. Angelika Schrobsdorff était écrivain, elle avait publié un livre impitoyable sur les hommes, Die Herren (Ces messieurs), qui avait connu un grand succès, et elle passait pour la plus belle femme d’Allemagne. Je guéris de mon rhume, l’appelai, nous nous vîmes, je l’enlevai à la hussarde tant la sincérité et l’intensité de la passion que je nourris pour elle dès le premier instant emportèrent ses défenses. Ce fut un coup de foudre violent et partagé, je crois que, peu disposée au bonheur, elle fut, au début de notre amour, heureuse comme elle ne l’avait jamais été. À peine mariée avec le baron, elle lui signifia que l’officialisation de leur liaison était une erreur et qu’elle voulait divorcer.
En Israël parmi les Juifs berlinois
La question de réfléchir à la possibilité d’un film ne se posa plus, il allait de soi que je le ferais. Je restai près d’un mois en Israël, parcourant le pays, tantôt seul, tantôt avec elle, seul le moins souvent possible. Elle me fit faire la découverte sans prix de ses amis, Juifs berlinois, amis de sa mère en vérité, qui la regardaient et la traitaient comme leur propre fille, l’admirant aussi pour sa beauté et parce qu’elle représentait pour eux l’excellence de la langue allemande, la liberté critique, l’invention et la causticité de l’Allemagne pré-hitlérienne, dont ils avaient gardé l’inguérissable nostalgie. Les Sâmtliche Werke (oeuvres complètes) de Goethe, de Schiller, de Hölderlin, de Hegel ou de Kant, beaux volumes reliés qui emplissaient les rayonnages des appartements des Yekke — c’est ainsi qu’on nommait, en Israël, les Juifs allemands —, dans le calme et ombreux quartier de Rehavia dont j’ai déjà parlé, faisaient monter à mes yeux d’irrésistibles larmes sans que j’en comprisse vraiment les raisons. Israël, l’Allemagne, les deux années que j’y avais passées, la Shoah, Angelika se nouaient en moi à d’insoupçonnables profondeurs. Et je concevais, pour ces banquiers, médecins, avocats, professeurs, juristes pointilleux, qui formaient la majorité des membres de la Cour suprême d’Israël, un préjugé d’emblée favorable, une affection admirative qui reléguait au second plan l’amitié que je portais aux kibboutznikim de Hachomer Hatzaïr, les camarades de Flapan. J’ai déjà dit à quel point la bibliothèque de Gershom Scholem, fabuleuse caverne d’Ali Baba de la grande culture juive, m’avait émerveillé, mais j’aimai Scholem lui-même dès le premier dîner auquel, avec sa femme Fania, il nous avait conviés, Angelika et moi. Ce grand savant était dépourvu de cuistrerie, généreux de sa science à la condition d’être persuadé de l’authentique intérêt de son interlocuteur, il était pionnier, défricheur, curieux de tout, penseur, philosophe, polémiste, libre dans ses propos et d’une drôlerie souveraine. Je l’aimais aussi pour son visage, son grand nez puissant, ses yeux bleu clair où demeurait une lueur d’enfance. Berlinois comme Angelika avec laquelle il entretenait une relation complice, il nous prit tous les deux sous son aile protectrice et fut le témoin de nos épousailles juives lorsque le rabbin Gotthold nous unit quatre ans plus tard à Jérusalem, sous la houppa, à la fin d’un jour d’octobre encore très chaud. Le mariage civil, on le sait, n’existe pas en Israël, mais la guerre de Kippour avait eu lieu en octobre de l’année précédente, et nous unir ainsi était, pour Angelika comme pour moi, un tribut à ce pays que nous avions cru perdre et que nous aimions tous les deux.
L’amour d’une femme, le ressort décisif d’une oeuvre : Pourquoi Israël
Je repartis pour Paris annoncer à la productrice que j’acceptais de réaliser le film, habité par une idée fixe : revoir Angelika, revenir vers elle au plus vite. Mais Mlle C.W. n’entendait pas brûler les étapes. Malgré sa fortune, elle n’avait aucunement l’intention de financer elle-même le projet. Les producteurs, c’est bien connu, risquent très rarement leur argent personnel [...] Cela allait retarder le moment des retrouvailles avec Angelika, elle en fut aussi malheureuse que moi. Nous nous écrivions chaque jour de longues lettres en anglais (ce fut notre langue commune pendant plusieurs années, jusqu’à ce qu’elle apprenne le français), j’aimais son style, cynique et désespéré, elle ne se racontait jamais d’histoires, le pire, pour elle, était sûr. L’idée de rédiger un scénario, scène par scène, avec dialogues, mentions « extérieur jour » ou « extérieur nuit », etc., me faisait horreur. Je m’appliquai pourtant, produisis soixante-dix pages, qui comprenaient mes idées essentielles sur la normalité d’Israël vue par moi comme l’anormalité même, avec des indications de plans et de séquences. Mlle C.W. et son assistante se déclarèrent enchantées et m’informèrent quelques jours plus tard que, selon leurs calculs, j’aurais à tourner pendant quarante-huit jours, huit nuits, quatre aubes et trois crépuscules. Je compris que j’avais affaire à des amatrices caricaturales et que je n’arriverais à rien de concret avec elles. J’acceptai pourtant de repartir pour Israël avec C.W. qui, armée de mon script, prétendait lever là-bas l’argent du film, mon seul but étant de me précipiter dans les bras d’Angelika et de passer avec elle toutes les nuits où nous resterions là-bas. Mais les velléités et atermoiements de C. W. finirent par me lasser, je rompis avec elle et entrepris de trouver moi-même des moyens autres de financer le film. Maigres moyens, le budget de Pourquoi Israël était très modeste, j’obtins de plusieurs sources de modiques sommes que j’apportai en dot à une maison de production professionnelle, qui me fut recommandée par Claude Berri. Si je semble m’appesantir ici, c’est pour rendre clair que l’amour d’une femme a été le ressort décisif d’une oeuvre. Pourquoi Israël est d’ailleurs dédié à Angelika Schrobsdorff, les Juifs allemands, que j’ai tous connus par elle, sont les protagonistes de scènes capitales, Gert Granach, qui ouvre, conclut et, à plusieurs reprises, scande le film de bouleversantes chansons spartakistes qu’il accompagne à l’accordéon, est un ami intime d’Angelika. On l’aperçoit elle-même fugitivement à la fin d’un long panoramique droite-gauche, mais il y a aussi — façon plus secrète de marquer sa présence —, sur le rebord d’un balcon de pierre de Jérusalem, sa belle chatte persane écaille de tortue, Bonnie. [...]
Un passé douloureux
Lorsque je la rencontrai, Angelika avait cessé d’écrire depuis plusieurs années, en proie au passé douloureux de sa famille, qu’elle savait devoir affronter et revivre si elle voulait retrouver sa liberté créatrice. Je lui arrachai, par bribes, son histoire qu’elle a, depuis, racontée dans ses livres puisque j’ai vraiment réussi, réciprocité de l’amour, à la remettre au travail, à la persuader qu’elle ne surmonterait les moments de dépression qui la terrassaient qu’en allant au plus difficile. Mais c’est seulement lorsqu’elle me donna à lire les lettres déchirantes et sublimes adressées à leur mère commune par son demi-frère, Peter Schwiefert, que ces lambeaux de récit s’organisèrent pour moi en un tout cohérent et que je pris la pleine mesure de la singularité tragique de ces destinées traversées par l’Histoire. C’était la seule réponse à l’énigme qu’avait été pour moi Angelika dès le premier jour, l’énigme était sa vie même. Ayant lu les lettres de Peter Schwiefert, je sus quelles questions poser et comment les poser. Dans le Berlin effervescent et libre des années vingt, Else, la mère juive, belle, frivole, à la fois insouciante et tourmentée, vivait à sa guise, elle eut trois enfants, de trois hommes différents, tous non-juifs, dont elle n’épousa que le dernier. Du premier naquit Bettina, Peter était le fils du deuxième, un auteur dramatique en vogue, Fritz Schwiefert. La benjamine, Angelika, avait pour père Eric Schrobsdorff, fils de grands propriétaires, possesseurs de nombreux immeubles à Berlin et promoteurs immobiliers. Eric épousa Else malgré l ’hostilité radicale de sa famille. Sa mère, une fois Hitler maître de l’Allemagne, s’inscrivit au parti nazi et contraignit Eric à divorcer : son mariage avec une Juive faisait scandale. Mais Else aimait Berlin, n’envisageait pas de vivre ailleurs et se refusait à prendre le nazisme au sérieux. Au lieu de fuir ou de partir pour la Palestine quand il en était encore temps et comme l’avaient fait ses amis, qui étaient, quand je la connus, la raison de la présence d’Angelika à Jérusalem, elle attendit l’ultime moment. Il était déjà trop tard.
p. 419-423


« J’ouvris, ce n’était pas un infirmier, mais une infirmière, ravissante, en costume traditionnel, les seins bridés mais non abolis par le sarrau, la noire chevelure qui tombait bas en deux nattes, les yeux, bridés eux aussi, mais de feu, bien qu’elle les tint baissés, accompagnés de leur guide nommé Ok cinq hommes à casquette. Ils sont six en tout, tous au centre de ma chambre, prêts à observer sourcilleusement chaque moment, chaque détail de l’action. Je remets à Ok la boîte aux ampoules magiques et la prescription simplissime de Louis Cournot, qu’il traduit pour la soignante aux yeux baissés. Elle ne dit mot, sort de sa trousse seringue, aiguille, alcool, lime, observe dans un rayon de soleil la lente aspiration de la B12 1000 gammas. Je me tiens à son flanc, prêt à faire glisser légèrement mon pantalon de pyjama sur une fesse jusqu’à en découvrir le gras, mais Ok et les cinq hommes à casquette — repérés par nous depuis longtemps comme membres du KGB coréen, fantômes silencieux présents dans tous les couloirs de l ’hôtel et attachés à nos pas partout où nous allions — ne bougent pas, ne font pas mine de se retirer, font cercle autour de nous, nous surveillent, me glacent. Je dis à Ok : « Je vous prie de vous retirer, dites-leur de sortir. En France, on ne se fait pas piquer en public. » Il paraît très ennuyé, dit quelques mots, tous reculent, mais d’un mètre, pas plus. J’élève la voix, commence à feindre la colère, à me plaindre de la suspicion dans laquelle on semble me tenir, moi, invité officiel du gouvernement et hôte du Grand Leader. Reflux général cette fois, mais pas plus loin que le seuil de ma chambre, ils se tiennent tous dans l’encadrement de la porte. Je saisis mon infirmière par le bras et l’entraîne dans un angle mort, je ne les vois plus, ils ne me voient pas, je présente alors ma chair nue à l’impassible beauté. Son geste est parfait, précis, net, sans brutalité, je n’éprouve aucune douleur à l’instant où l’aiguille pénètre et elle procède à l’injection, d’ordinaire peu agréable, avec toute la lenteur requise, m’évitant ainsi l’ombre d’une peine. Il faut imaginer la scène, la chambre est spacieuse, la porte ouverte sur le couloir, on entend les bruits de la vie de l ’hôtel, les casquettes et Ok sont agglutinés en attente, formant un groupe d’intervention compact et frustré, une souterraine intimité forcée par la transgression même — le déplacement vers l’angle mort — s’établit entre l’infirmière et moi sans qu’un seul regard, un seul battement de cils, le moindre signe de connivence aient été échangés. Mon pantalon rajusté et tandis qu’elle range ses instruments, je surgis bien en vue au centre de la pièce et je lance : « Vous pouvez maintenant entrer, messieurs. » Ils le font, avec un peu moins d’assurance qu’à leur arrivée. Rendez-vous est pris pour le lendemain à la même heure. À l’infirmière, je n’ai dit rien d’autre que « Merci, mademoiselle », à Ok, qui se rengorge et traduit pour les casquettes : « C’est une grande professionnelle, nous n’en avons pas beaucoup de pareilles à l’Ouest. »
P. 294-295
Le traitement dura plusieurs jours. Claude Lanzmann gamberge, Kim Kum-sun le subjugue. A nouveau foudroyé ! Il imagine des plans. Comment va évoluer la relation avec Kim Kum-sun ? Arrivera t-il à fausser compagnie aux casquettes ? Vous le saurez en lisant Le lièvre de Patagonie.


Dans l’après-midi du 18 novembre 1966, Pierre Lazareff, directeur de France-Soir, Elle et de tous les journaux du groupe, [...] - J’écrivais alors un grand reportage par mois dans Elle dirigé par sa femme Hélène, et un après-midi et une nuit par semaine, je faisais partie de la célèbre équipe des rewriters de France Dimanche -, m’appela lui-même de son bureau du deuxième étage de la rue Réaumur : « Claude, venez me voir, c’est urgent », sa voix était pleine d’angoisse car c’était un homme bon. Il me dit : « Allez tout de suite rue Jacob, un malheur est arrivé. » C’est Norbert Bensaïd qui m’ouvrit, le visage décomposé, il avait découvert une heure auparavant le corps de ma soeur. Je me ruai vers son lit, elle était allongé sur le flanc, avec un très beau, très doux, très paisible visage, j’écartai couvertures et draps, son corps brûlait et il est impossible de se faire à l’idée que le souffle de vie l’avait quitté à jamais. Incrédule, je demandai à Norbert s’il y avait quelque chose à faire, si on pouvait la ranimer. Il me répondit qu’elle étai morte depuis plusieurs heures ; si son corps brûlait ainsi, c’est parce que l’appartement était surchauffé. Elle avait absorbé non seulement des barbituriques, mais aussi un poison qui agit irréversiblement. Elle ne s’était d’ailleurs donné aucune chance, ayant interdit à sa femme de ménage comme celle-ci en avait l’habitude et averti Norbert, qui s’inquiétait beaucoup pour elle et lui téléphonait presque tous les jours, qu’elle ne serait pas à Paris. [...]
Elle avait laissé trois lettres, bien en évidence, chacune avec son enveloppe et une adresse, écrites au crayon, pour Sartre, pour son amie Dolores Ruspoli, pour moi. Les lettres étaient brèves, mais c’est à Dolorès qu’elle a dû écrire en dernier, car soudain, au milieu d’une ligne, l’écriture plonge, s’effondre, passant de l’horizontale à la verticale, signe que le poison fait son oeuvre et lui ôte la force de continuer.[...]
Elle avait probablement fait le geste fatal au coeur de la nuit, vers quatre heures du matin. Ses lettres prouvent qu’elle l’accomplit en pleine lucidité, elles sont sans pathos, elle met rapidement ses affaires en ordre, elle sait qu’elle est en train de mourir. À moi : « Mon Claudie, je t’en supplie, il y a les textes là de toute l’émission, je veux que tu dises à Eliane qu’elle regarde bien le montage du film, que les textes essentiels soient dits ; si tu pouvais y aller, qu’au moins j’aie fait quelque chose de bien. Claude, mon frère mon frérot je t’embrasse. É. » À Dolores : « Ma Dodo, qu’on me tape pas trop dessus c’est tout. Je ne m’arrange plus avec moi bien que tout extérieurement aille très bien. J’aurai au moins réussi ça. Je t’aime. Je veux que tu aies l’appartement. Robert t’en parlera. » Je ne sais plus si j’ai lu ces lettres aussitôt après l’avoir vue dans son lit ou si je l’ai fait plus tard. Je n’ai pas sa lettre à Sartre, mais je me souviens qu’elle était tendre. Comme chaque jour à cette heure, le Castor et lui travaillaient ensemble dans son nouveau petit appartement, au 222 boulevard Raspail. Norbert et moi nous étreignîmes en sanglotant, c’était complètement insupportable.
Norbert partit, je restai auprès d’elle, il n’était pas question de la laisser seule et, dans ce tête-à-tête avec ma soeur morte, un remords commença à m’envahir, qui depuis ne m’a jamais quitté : si elle avait pu m’appeler avant de s’empoisonner, j’eusse accouru et peut-être aurais-je pu empêcher cela. Mais elle ne le fit pas, elle savait que Judith, qui vivait avec moi, ne l’aimait pas, elle n’aurait pas osé, elle n’avait pas osé. Je me disais qu’il fallait que je prévienne tout le monde, mon frère, Paulette, Monny, mon père, le Castor et Sartre, mais je demeurai longtemps incapable d’action tant me faire l’annonciateur de la tragédie me coûtait, tant cela allait faire mal. J’appelai le Castor qui fondit en larmes, je lui dis : « Il faut que tu viennes », et j’entendis qu’elle parlait à Sartre. Elle me dit : « Je vais venir, Sartre ne veut pas. » J’insistai : « Il est impossible qu’il ne le fasse pas, il n’a pas le droit. » Il vint. La première parole de mon frère, à son arrivée — il était alors une vedette des médias [3] et très occupé —, fut étonnante. Il me prit aux épaules et me dit : « Claudie, jure-moi que tu n’en feras pas autant ! » Tout Paris vint, tout Saint-Germain-des-Prés, tous les acteurs avec qui elle avait travaillé, tous les amoureux, tous les amants, les anciens, les récents, à l’exception notoire de Deleuze et Rezvani, venaient de jour comme de nuit, dans une veillée funèbre ininterrompue et chaleureuse. Sartre et le Castor passaient là chaque soir plusieurs heures, sirotant leur Chivas, les amis innombrables d’Évelyne étant heureux de les voir là, de leur parler en simplicité, chacun évoquant ses souvenirs personnels de la vivante. De temps en temps, l’un ou l’autre quittait le groupe bavard et allait s’asseoir sur le lit d’Évelyne, lui caressant les cheveux ou baisant son front froid. J’étais changé à mon corps défendant en chef du protocole, maître des cérémonies, car venaient là des gens qui ne se seraient pas rencontrés dans la vie ordinaire ou dont la rencontre ne pouvait être qu’explosive. Paulette, saccagée autant par la façon dont sa fille était morte que par sa mort même, déchaînait ses dons de limier, ses talents d’investigatrice, ne lâchant pas sa proie, et demandait publiquement des raisons et des comptes. Elle s’en prenait à moi, à Sartre, et j’étais obligé d’inventer des ruses pour qu’elle ne vînt pas ou pour que la confrontation n’eût pas lieu. Mais à tout suicide il faut un coupable, un bouc émissaire. Le plus évident était Claude Roy : j’avais découvert ses lettres dans l’appartement, l’idée qu’il parût à l’enterrement m’était insupportable, elle nous l’était à tous et Sartre lui envoya une dure lettre, dont j’ai oublié les termes, lui disant que sa présence n’était pas souhaitée. Claude ne vint pas, mais j’ai retenu par contre les premiers mots de sa réponse à Sartre : « Sartre, votre douleur devait être atroce, votre lettre l’était. » Nous reconnûmes qu’il savait écrire [...] Nous descendîmes son cercueil pour la conduire au cimetière du Montparnasse. Tous ceux qui l’accompagnèrent avaient vécu la mort d’Évelyne Rey comme un séisme.
D’année en année, j’ai trouvé plus injuste la désignation de Claude Roy comme bouc émissaire. Si faute il y a, elle est partagée et nous sommes nombreux à en porter la responsabilité. Il ne faut pas jouer à ce jeu-là. J’ai rencontré Claude un jour au Festival d’Avignon, je lui ai dit mes regrets et proposé la paix. Nous l’avons conclue.
« Beya ou ces femmes de Tunisie », l’émission de télévision à laquelle Évelyne avec raison tenait tant, fut diffusée deux ans après son suicide, le 3 janvier 1968, elle durait cinquante minutes et fut unanimement saluée comme un comble d’intelligence et d’humanité. C’est Robert Morris qui tenait la caméra. Ma soeur, belle, très jeune, svelte, la chevelure nattée, est à l’image en compagnie de Beya au tendre visage, pendant presque toute la durée du film. [...]
Le suicide de ma soeur m’avait ravagé, je pensais que j’aurais à vivre désormais et de façon permanente sous l’ombre de sa mort. Ce serait la seule forme de la fidélité. Une amie de Sartre, Claude Day, que je connaissais peu, à qui je m’étais confié et qui avait elle-même subi de grands malheurs, m’avait répondu : « Vous vous trompez, vous oublierez, la vie l’emporte toujours. » Elle avait raison. Et tort. Je n’ai rien oublié, j’ai vécu. Mais les novembre ne me valent rien, c’est le mois de la mort d’Évelyne, c’est aussi celui de ma naissance.
[1] Se transforment en gaz toxique au contact de l’air, ils sont déversés à partir d’orifices dans le plafond
[2] Jeune résistant, khâgneux à Louis-le-Grand en 1946, condisciple de Jean Cau « Cau était un parleur intarissable », professeur à Berlin dans l’immédiat après guerre, « nègre- rewriter » , intellectuel engagé aux côtés de Sartre, puis son successeur à la tête de sa revue « Les Temps modernes ».
[3] Jacques Lanzmann, alors parolier de Jacques Dutronc.




 Version imprimable
Version imprimable



 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?



2 Messages
L’écrivaine Cécile Guilbert. / Photo Nicolas Guilbert
Le Lièvre de Patagonie, de Claude Lanzmann, Éd. Gallimard, 2009 « S’agissant de Claude ¬Lanzmann récemment disparu, j’aimerais que Le Lièvre de Patagonie soit autant cité que Shoah au chapitre du “mémorable” de son œuvre. Car c’est un immense livre, magnifique, écrit dans une langue précise et belle qui possède sa propre musique, sa voix […]
https://www.la-croix.com/Culture/Le-livre-chevet-lecrivaine-Cecile-Guilbert-2018-08-15-1200961940
En janvier 1945, il est admis en hypokhâgne au lycée Louis-le-Grand, à Paris. Il y rencontre Jean Cau, secrétaire de Jean-Paul Sartre (de 1946 à 1957), avec qui il noue une grande amitié. Il suit des études de philosophie à la Sorbonne puis à l’université Eberhard Karl de Tübingen, en Allemagne. Il enseigne à Berlin en 1948-1949.
La parution des Réflexions sur la question juive, de Sartre, en 1947, est pour lui un événement majeur. L’ouvrage devient le socle d’un séminaire sur l’antisémitisme que Lanzmann organise en Allemagne à la demande de ses étudiants. Voulant dénoncer la faiblesse de la dénazification au sein de l’université, il publie en 1949 deux articles dans le Berliner Zeitung, journal de la République démocratique allemande (RDA), ce qui lui vaut de quitter ses fonctions d’enseignant. De retour en France, il se lance dans une carrière de journaliste. Il devient pigiste en 1951 pour France Dimanche et part en reportage en Allemagne de l’Est. Ses articles ne sont pas retenus par son journal et c’est Le Monde qui les publie.
Sartre et Simone de Beauvoir
Il rencontre en 1952 Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, qui lui proposent de participer au comité de rédaction des Temps modernes, fondé en 1945. Il devient le compagnon de Simone de Beauvoir, une relation qui durera sept ans. En avril 1952, il publie son premier article dans Les Temps modernes, « La Presse de la liberté », puis part pour la première fois en Israël.
Engagement anticolonialiste
En mai 1958, le journaliste Lanzmann se rend en Corée du Nord. Puis, le 27 avril 1959, il publie un long article sur la fuite du dalaï-lama du Tibet, cette fois-ci dans Elle. Son engagement anticolonialiste s’affirme. Il fait notamment partie des dix inculpés, parmi les signataires du « Manifeste des 121 », qui dénoncent la répression en Algérie en 1960.
Crédit : Edouard Pflimlin, Le Monde 5/07/2018
Claude Lanzmann est mort à Paris, jeudi 5 juillet, à l’âge de 92 ans.
Le journaliste, l’écrivain de Le lièvre de Patagonie, un livre de mémoires, Gallimard, 2009.
Mais surtout le cinéaste des documentaires historiques sur la Shoah, et des témoignages associés de survivantes Les Quatre sœurs, comme aussi, Le Dernier des injustes (2013), « donnant la parole au dernier doyen des Juifs du ghetto de Theresienstadt » près de Prague, (par où transitèrent les sœurs de Kafka avant d’être convoyées vers Auschwitz-Birkenau).
Autant de témoignages pour l’Histoire qui lui ont valu un Ours d’or d’honneur pour l’ensemble de son œuvre lors de la Berlinale 2013, et il a été fait grand officier de l’ordre national de la Légion d’honneur le 14 juillet 2011.
La peau de son visage me fait penser aux dinosaures sans que rien d’irrespectueux soit associé à cette image. Comme les dinosaures, avant lui, Claude Lanzmann disparaît. C’était un géant qui a vécu à l’époque du cataclysme de l’extermination des Juifs par les Nazis. Sans en être une victime directe, l’antisémitisme de l’époque l’a cependant atteint et marqué à jamais. Il se ferait le porte-parole de ceux que cette catastrophe folle, déclenchée par la folie des hommes, décima ou marqua à jamais.
Il y a quelques jours, Simone Veil, survivante du camp de Birkenau entrait au Panthéon. C’est aussi en pensant à Birkenau que Claude Lanzmann a choisi pour titre de ses mémoires « Le lièvre de Patagonie ».
Découvrez le Lanzmann plus léger, avec un récit réaliste et ébouriffant à la Simenon, ci-dessus :
Ou également, plus privé :
avec en bonne place : Simone de Beauvoir, et ceci, en bonne harmonie avec Sartre.