
Cécile Guilbert, « la fille en noir ».
© Nicolas Guilbert. Zoom : cliquez l’image.

Le dernier livre de Cécile Guilbert
Les Républicains
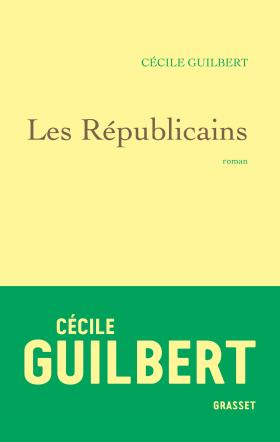 Décembre 2016. Trente ans après s’être perdus de vue, deux anciens camarades d’études se retrouvent à l’occasion d’une émission de télévision. La fille en noir est écrivain, Guillaume Fronsac un marquis de l’aristocratie d’État devenu banquier d’affaires.
Décembre 2016. Trente ans après s’être perdus de vue, deux anciens camarades d’études se retrouvent à l’occasion d’une émission de télévision. La fille en noir est écrivain, Guillaume Fronsac un marquis de l’aristocratie d’État devenu banquier d’affaires.
De 17h à minuit, au cœur d’un Paris hanté par le terrorisme mais où la beauté de l’histoire française se révèle à chaque pas, ils vont se juger, se jauger, se confier, se séduire peut-être. À travers la confrontation de leurs existences, de leurs désirs, de leurs illusions perdues, se dessine le tableau d’un pays abimé par l’oubli de sa grandeur littéraire, enkysté dans la décomposition politique et le cynisme de son oligarchie. Comment échapper au déclinisme et aux ruines mentales de la République des Lettres ? En allant jusqu’au bout de la nuit.
Écrit d’une plume allègre et brillante qui n’épargne ni les importants du jour croqués dans des portraits assassins, ni ses propres personnages traités avec une ironie grinçante, ce roman d’amour et de pouvoir est la pièce du théâtre de notre époque, dont le rideau final tombe comme une guillotine. — Grasset, février 2017
« Le pouvoir réside là où les hommes s’imaginent qu’il doit résider :
c’est un leurre, une ombre sur le mur…
Et un très petit homme projette quelquefois une très grande ombre. »
Varys dit « L’Araignée »,
Game of Thrones, saison 2, épisode 3
« Quand on est au bas de l’échelle sociale, Balzac, ça pulse. »
« off » de Nicolas Sarkozy, 24 mai 2016
Chapitre 1
DIX-SEPT HEURES
Longtemps, mon existence a été si romanesque que j’ai préféré la vivre au lieu de l’écrire. Jusqu’au jour où, sortant de l’appartement de Thierry Ardisson, alors que je venais de souffrir mille morts en une heure et de trébucher sur un câble électrique qui serpentait sur la moquette prune, étourdie par la lumière trop crue des spots et les piapias de bonne humeur aussi énervants que les rires préenregistrés d’une sitcom, tout m’est revenu, juste à l’oreille.
— Non, je n’y crois pas, la fille en noir !
Depuis combien de temps n’avais-je pas entendu cette expression ? Et sonner cette voix sourde qui n’avait jamais eu l’énergie de son corps ? Je me retournai pour envisager le regard clair sous les paupières remontées au bistouri. Le ravinement à peine perceptible du front. Les rides estompées du lion. La légère voussure de l’ancien jeune homme pressé, précis, pressant. Il en avait conservé le pas hardi, la sveltesse. Et par miracle presque tous les cheveux. Mais aussi cette allure volontaire qui jadis pompait l’air partout où il passait.
Il venait de grimper les quatre étages, à peine essoufflé, et réajustait d’un geste sec le nœud Windsor de sa cravate de soie puce. Je ne sus quoi répondre, me rétractant dans une coque de silence, ce que, dans l’embarras, je savais encore faire le mieux.
Le temps de laisser venir.
Et de compter.
Trente ans avaient passé.
Au mitan fatidique de la cinquantaine, un notable de la IVe République aurait affiché silhouette replète, pansue, trahissant ses ripailles aux banquets de sous-préfectures et autres chefs-lieux de cantons qui avaient mieux façonné la carte électorale du pays que tous les tripatouillages des Fouché s’étant succédé à Beauvau. Mais pas l’alerte Guillaume Fronsac, car c’était bien lui, pour qui une silhouette de mannequin valait toutes les décorations. Souples et minces, ne faisant plus leur âge du moment que l’aisance faisait le reste, jamais les corps n’avaient autant muté qu’en ce grand moment de décomposition générale. Les visages retouchés masquaient le travail de la mort, pas d’inquiétude, les futurs cadavres porteraient beau dans leurs costards Slimane.
« Eh oui, c’est bien moi… enfin presque », finis-je par répondre. Car de « fille », j’étais devenue femme et avais changé de visage, sinon de corpulence, depuis le temps. Raccord avec mon sobriquet d’antan, je portais une robe de lainage noir, des collants opaques et des bottes noires.
Sur le palier où il raccompagnait les invités de son émission, Ardisson nous couvait d’une mine rigolarde et intriguée. Fascinée, j’observais de plus près ses innombrables petites dents alignées comme des perles dans sa mâchoire de squale. J’aimais bien ce Méphisto dandy qui avait dû verser pas mal de sirop dans son brûle-gueule mais conservait vaille que vaille son surplomb d’arrogance. L’air un poil plus sage en surface et toujours de ne craindre rien ni personne, on trouvait difficilement moins béni oui-oui niaiseux avec une telle longévité dans le PAF. Fronsac et moi échangions quelques banalités et force sourires quand l’animateur, curieux de cet impromptu et si grand pro des provocations stipendiées qu’il ne pouvait s’empêcher de les rafaler même en off, lança : « Qu’est-ce que vous avez à vous mater comme des carpes ? Vous avez couché ensemble dans une autre vie ? » À quoi nous répondîmes presque en chœur que cela ne le regardait pas. Puis, se jetant dans mon oreille, Fronsac y glissa en vitesse et sourdine : « Pardon, je suis venu voir Copé à qui j’ai un truc à dire mais je suis trop heureux de t’avoir retrouvée, tu m’attends en bas qu’on aille boire un verre pour fêter ça ? » Et sans attendre ma réponse, il s’engouffra d’un bond dans l’appartement. L’habitude de ceux qui n’ont pas besoin de commander pour être obéis ?
Je m’exécutai.
Guillaume Fronsac n’était pas qu’un courant d’air. C’était aussi un courant d’ombre. À l’inverse des anciens de notre promo de Sciences-Po qui se rappelaient à moi tous les dix ans et que je venais de retrouver le temps de ce revival de l’émission « 93, Faubourg Saint-Honoré » mixant Perdu de vue et Copains d’avant, il avait toujours été attiré par le pouvoir sans avoir jamais eu le désir d’agir sur l’avant-scène. Car en tout il préférait la coulisse, le secret, l’entre-deux paranoïde où l’on est plus souvent dupé par la défiance que par la confiance. Mais surtout, d’après ce que j’en avais entendu dire par la régie médiatique qui évoquait parfois son nom, cet énarque – qui était aussi normalien et pur produit de la méritocratie républicaine – avait fini par être possédé par l’ambition qu’on se découvre presque sans y penser, à force d’habileté couronnée de réussite : la plus dangereuse. Des mentors puissants et l’effacement du clivage droite-gauche avaient, dit-on, fait le reste. À part ça, j’ignorais quels avaient été les méandres de son parcours depuis tant de lustres. Et bien davantage encore, cela va sans dire, ce qu’il était venu comploter avec l’ex-Zorro des LR dans cet appartement situé à un jet de pierre de l’Élysée.
Encore un peu énervée par l’émission, en descente d’excitation mais réveillée par cette rencontre inopinée, je demeurais plantée sur le trottoir, un pas derrière le petit groupe qui refluait en bavardant. Ce n’étaient ni des amis ni des potes. Pas même d’anciens camarades. Hormis la pathétique Frigide Barjot à choucroute en pétard et colifichets girly, et cet éternel escogriffe de Beigbeder recroisé parfois dans les couloirs de notre éditeur quand il n’était pas en train de se remarier ou de bronzer à Bali, les autres m’étaient inconnus. Ou presque.
Si je n’avais pas le moindre souvenir de les avoir seulement calculés du temps de notre scolarité, ils étaient désormais si célèbres que découvrir en vrai leurs faces d’os et de chair provoquait une impression bizarre : un « déjà vu » sans le truc proustien de l’ancienne physionomie surnageant dans la nouvelle qui mesurait les ravages du temps.
Et pour cause.
Cela faisait vingt ans que les visages de Jean-François Copé, David Pujadas, et dans une moindre mesure d’Anne Roumanoff, s’affichaient sur les écrans.
Leurs bobines maquillées, arrangées, botoxées.
Leurs images lisses zoomées plein cadre à la télé.
Leurs photos retouchées plein pot dans les hebdos.
Leurs masques.
À eux seuls, les noms de ce trio comico-politico-journalistique, dont chacun aurait pu peu ou prou endosser la spécialité des deux autres, fournissaient, avec l’égérie cathomophobe de la Manif pour tous et l’auteur people déconneur, un bon résumé du show que nous venions d’enregistrer : un peu foutraque sur la forme, d’une logique « people » de fer sur le fond. Un excellent concept, cette promo 1986.
Du lourd.
Auquel manquaient ce soir-là l’aimable Alexandre Jardin et l’ambitieuse Laurence Parisot, l’ex-patronne du MEDEF, mais pas la caution du clair-obscur incarnée par Stéphane Fouks, ancien rocardien, fils spirituel de Séguéla, l’homme aux vingt campagnes présidentielles qui aurait vendu une télé couleurs à un aveugle mais n’avait pas trompé Sarko sur la came en lui présentant Carla.
Longtemps conseiller de DSK, spin doctor du CAC et coach de crise, Fouks jouissait aux yeux des autres, non du prestige retors de Mazarin, n’exagérons rien, mais de l’aura d’un maître réseauteur au carnet d’adresses aussi épais qu’un Bottin. Et, last but not least, de l’amitié indéfectible du pion martial nommé Premier ministre malgré ses 5 % aux primaires, hidalgo vindicatif dont chaque discours menton levé délivrait un déluge de béton. Le pauvre n’avait jamais compris qu’une armure trop pesante rend immobile celui qui la porte.
Et moi, qu’est-ce que je foutais là, jouant à me souvenir d’eux parce qu’ils prétendaient aimablement se souvenir de moi et qu’il aurait été trop mortifiant que j’avoue mon amnésie ? Ma télégénie ? Mon job prestigieux ? Tu parles !
Essayiste respectée aux tirages dont je me serais presque vantée en rappelant qu’ils étaient à l’étiage de ceux de Stendhal en son temps, mon coefficient de surface médiatique avoisinait le zéro et je passais mal à l’écran quand on m’invitait. Pas assez contente d’y figurer mais cherchant à le masquer pour ne pas donner l’impression de cracher dans la soupe, j’affectais l’air dégagé, m’obligeais à sourire et à défroncer le sourcil quand j’avais la parole : faux naturel qui laissait vite revenir le vrai au galop dans son sérieux, son rugueux, son agacé mal dissimulé qu’aggravaient mon regard noir et ma voix de contralto. C’est simple, j’avais toujours l’air de mauvaise humeur ou d’engueuler quelqu’un. À côté, Yann Moix ressemblait à la fée Clochette. Après tout, me disais-je pour me ragaillardir, c’est un rôle comme un autre et la TV prouve à chaque instant que tous sont les bienvenus. On y trouve bien l’égaré balbutiant Modiano, le lutin sautillant Jean d’O., l’énervée douloureuse Angot, le faux abruti Houellebecq, le tonton pédago Orsenna… Pourquoi n’y trouverait-on pas plus loin, beaucoup plus loin, en queue de peloton et de classement, l’ombrageuse lettrée « en noir » ?
Mais là encore, je me racontais des histoires. Outre que je n’avais guère fait mon trou dans les ruines de ce que les clercs continuaient d’appeler la « République des Lettres », mes publications étaient si espacées dans le temps que le téléspectateur m’avait oubliée d’une promo l’autre. Du coup, tout était chaque fois à recommencer. Et ma prestation semblait toujours ratée.
La seule raison de mon invitation, c’est que j’avais tout de même écrit quelques essais percutants – sur Jonathan Swift, sur Marcel Duchamp – dont La Fronde au fond de l’encrier ou la subversion selon Paul de Gondi, cardinal de Retz, premier livre publié dix ans après ma sortie de la rue Saint-Guillaume par la « banque centrale », comme disait mon éditeur de l’époque. Régulièrement traité par la presse de consigliere ou de capo dei tutti capi, sa réputation de fine lame sur le front du goût m’avait conféré durant quelques années le respect du milieu littéraire – du moins de sa section labellisée « post-avant-garde classique » – avant de me plomber dans le bassin des piranhas. J’avais donc changé de boutique et m’en trouvais fort bien.
À ma grande surprise, Ardisson qui, durant l’émission, m’avait qualifiée devant les autres de « fille mystérieuse », avait également cité, pensant l’élucider, un extrait d’un de mes bouquins qui résumait crânement mon état d’esprit d’alors : Je n’ai jamais vécu ailleurs que dans la société du spectacle. Ayant anéanti dans son ubiquité faste jusqu’à la possibilité même d’un ailleurs, elle a congédié toute velléité de congé et banni même l’idée qu’on puisse l’être. Mais je ne m’en plains pas. Que pourrais-je regretter, n’ayant rien connu d’autre ? Après tout, il est toujours excitant de vouloir sauver sa peau quand on cherche à vous la faire…
Si je ne m’estimais pas encore tout à fait parvenue au stade de la « vieille peau », quoique consciente que les jeunes ayant aujourd’hui les vingt printemps que nous avions eus jadis étaient d’un avis contraire, j’avais désormais assez vécu pour me sentir mortelle et savoir que c’est moins la société du spectacle chère à Guy Debord que l’entropie qui vous tanne la vie, cette peau de chagrin. Estimant malgré tout l’avoir bien défendue, après être passée à travers bon nombre de cerceaux enflammés, j’en déduisais que, bloqué comme une mouche à miel dans son tropisme cathodique, Ardisson m’avait invitée pour servir d’alibi. Voire m’en faire rabattre. Afin qu’il ne soit pas dit que l’on peut échapper aux séductions du bocal à gogos. Ni prétendre s’absenter de cet empire omnipotent du visible dont le carbonaro du situationnisme avait justement affirmé que jamais le soleil ne s’y couche. Ce qui revenait à prouver que l’inclusion du poil à gratter était prévue par le programme ? Bien sûr. Mais c’était là une remarque digne des années 90. Autant dire de la préhistoire. On faisait depuis mieux et pire.
Aussi, qu’il était pitoyable et anachronique, ce plateau de quinquas venus échanger sur une chaîne du câble leurs maigres souvenirs potachiques ! Outre les audiences TV en chute libre, aucun de nous n’était devenu un grand homme d’État, une éminence panthéonisable, et nulle sentence impérissable n’était sortie de nos échanges décousus. Insignifiante, l’émission serait oubliée cinq minutes après sa diffusion, que dis-je cinq minutes ? Effacée du temps de cerveau disponible au fur et à mesure de son visionnage fractionné, plus ou moins zappé, comme les milliards d’images court-circuitées par les tweets et le buzz déchaîné des réseaux dont nous étions submergés en temps réel et en boucle. Car la célébrité du néant par le rien, comme disait Vialatte, c’était ça, le nouveau programme.
Fronsac tardait à me rejoindre. L’écran de mon téléphone affichait dix-sept heures quinze. Nous étions fin novembre et Paris s’enveloppait déjà dans la nuit. Un vent froid mordait mes oreilles. Deux voitures banalisées passèrent en trombe, sans girophares, sirènes hurlantes. J’observais à la dérobée mes anciens condisciples qui s’attardaient, m’évertuant à démêler la logique de l’accidentel dont procédait leur apparente complicité, peut-être même leur connivence.
Je m’étais un peu rencardée avant de venir. Ces six personnages de la « cratie » – démo & média – qui n’étaient pas en quête d’auteur mais de followers, en totalisaient presque 500 000 sur Twitter. Lesquels s’étaient revus depuis 1986 ? Continuaient de se fréquenter ? N’avaient jamais cessé ? À quelles occasions ? Quand et comment ? Dans ces matières, la nécessité a ses raisons que le hasard ne connaît pas. D’autant que l’élection présidentielle approchait, crise épileptoïde nationale qui promettait un degré d’incertitude inégalé dans les annales de la Ve République au couchant, menacée par la barbarie djihadiste et livrée aux pires surenchères populistes. S’apprêtant à y endosser divers jeux de rôle et de dupes, certains d’entre eux fourbissaient déjà leurs poignards.
Fouks s’était isolé depuis dix minutes sur un bout de trottoir avec Pujadas.
L’homme qui s’était fait poser des implants capillaires par son pote Cahuzac papotait ferme avec celui qui avait les mêmes talonnettes que Sarko. La tête et les jambes ? Des paroles et des actes ?
J’entendais le rire moqueur de Beigbeder en plein délire avec Frigide Barjot, toujours minaudante, qui, après avoir servi de tête de gondole à un clergé frelaté en pleine déconfiture pédophilique, se sentait repousser des ailes maintenant que le paroissial et provincial Fillon était sur les starting-blocks. Sous son casque en pétard où s’affichait sa mine d’éternelle ravie, Anne Roumanoff rigolait de bon cœur à leurs vannes. Puis la haute stature de Copé s’encadra dans le porche, suivie par Fronsac qui lui serra furtivement l’épaule pour prendre congé, le rassurer ou le remercier. Il revenait vers moi quand le super loser de la primaire des LR, qui dépassait physiquement toutes les têtes, me lança d’une voix forte : « Alors adieu, la fille en noir ! »
J’y perçus une pointe de malice à laquelle je répondis bien droite d’un grand sourire, essuyant machinalement l’air de la main comme une idiote, ou la reine d’Angleterre.
— Tu le connais ? demanda aussitôt Fronsac en m’ouvrant la portière d’une berline noire à vitres opaques qui avait glissé à notre hauteur comme par magie.
— Non, il était dans la même section que nous à Sciences-Po, c’est tout, dis-je en pénétrant dans le véhicule.
Je le vis alors tapoter son smartphone, dire un mot au chauffeur, puis il me rejoignit à l’arrière et la voiture démarra.
p. 17-25.
Entretiens radiophoniques
SUD RADIO, 6 février 2017.


Les lettres républicaines de Cécile Guilbert
France Inter, Boomerang, 7 février 2017.
Elle est l’un des écrivains les plus étonnants de ses vingt dernières années. Cécile Guilbert est l’invitée d’Augustin Trapenard.
Son écriture, en oscillation permanente entre l’essai, le récit et le roman, est de celle qui font mouche. Son nouveau roman, le troisième, s’appelle Les Républicains et vient de paraître chez Grasset. Un dialogue entre un écrivain et un homme politique. Un état des lieux sans concession de la vie politique, intellectuelle et culturelle française.
Carte blanche
La carte blanche de Cécile Guilbert est consacrée à "Cold Song" de Henry Purcell, tirée de l’opéra King Arthur.

Europe 1 Social Club – 09/02/17
Frédéric Taddei (avec Jean Viard et Fishbach)
Extraits.

Le roman au secours de la république
France Culture, La Grande table, Olivia Gesbert, 14 février 2017.
La République des Lettres au secours de la République, tout court... deux romanciers font dialoguer leur imaginaire littéraire et politique. Après Sans entraves et sans temps morts et Réanimation, Cécile Guilbert revient avec Les Républicains chez Grasset, le récit en temps réel des retrouvailles de deux anciens camarades de Sciences po, trente ans après. Xabi Molia, l’auteur de Avant de disparaître et de Grandeur de S, qui signe Les premiers au Seuil. Dans une France en crise, surgissent de la foule des humiliés, des supers héros. Ce qui les rassemble : "un faisceau commun de talents héroïques, le vil, la puissance physique, une endurance, et une adresse décuplée", ils signent avec leur gouvernement un contrat d’exclusivité.
Avec la voix d’André Malraux.

Cécile Guilbert, portrait corrosif de l’élite française
RFI, Jean-François Cadet , 22 février 2017.
Cécile Guilbert signe un portrait corrosif et glaçant de la France d’en-haut, celle des politiques, des grands patrons, des stars des médias... tout ce petit monde issu du même terreau et qui partage les mêmes codes.
Joli livre très amoureux de Paris et très sceptique sur ce qu’est devenue l’élite française. Les Républicains est un roman plein d’amour déçu et de nostalgie. L’auteur y questionne le pouvoir et la façon dont il passe.
« Les Républicains »,
badinage amoureux dans les coulisses du pouvoir
En novembre 2016, « la fille en noir », écrivaine se rend par curiosité à l’émission de Thierry Ardisson sur la fameuse « Promo 1986 » de Sciences-Po où elle a fait ses classes. Elle y retrouve le svelte Guillaume de Fronsac, qui ne la laissait pas indifférente à l’époque. Trente ans après, il s’accordent une soirée d’errance au cœur de Paris, du bar du Regina à la Place de la Concorde en passant par le Meurice. Ils y croisent des célébrités, qui ne sont pas les mêmes pour eux deux : il a eu l’ENA, elle pas ; elle a choisi la lettres et la pauvreté, lui, l’ombre des cabinets ministériels et l’exercice discret et lucratif du pouvoir. Un tête-à-tête plein de fantômes, dont la France et les lettres françaises ne sont pas des moindres…
Joli livre très amoureux de Paris et très dubitatif sur ce qu’est devenue l’élite française, Les Républicains est un roman plein d’amour déçu et de nostalgie. Le pouvoir y est interrogé, ainsi que la manière dont il passe. Badinage à la fois sublimement inutile et mélancoliquement grave ce dialogue où l’on entend chacune des deux voix de l’intérieur est l’histoire d’une rencontre possible mais jamais certaine. Un thème universel qui résonne, au-delà du tout petit monde incestueux des arcanes du pouvoir.
Novembre 2016 : trente ans après s’être connus à Sciences Po où ils ont préparé l’ENA, deux anciens camarades se retrouvent à l’occasion d’une émission de Thierry Ardisson consacrée à la promo 1986 de l’école de la rue Saint-Guillaume. La fille en noir est une essayiste qui s’est vite affranchie de la « négritude » au service des puissants pour consacrer sa plume à Retz et à Swift. Guillaume Fronsac est énarque, banquier d’affaires et auteur d’un livre sur Machiavel qui, pense-t-il, fait de lui un écrivain.
Unité de temps : ces deux là ne se quitteront plus, de 17h00 à Minuit. Unité de lieu : du 93 faubourg Saint-Honoré à leurs appartements respectifs en passant par les décors luxueux du Régina, de l’hôtel Meurice et celui de Talleyrand, ils vont déambuler dans le coeur du Paris historique du pouvoir régalien et de la Révolution française. Unité d’action : une joute intellectuelle et un suspense amoureux où se joue, à travers le bilan de leurs vies, celui d’une génération qui aura vu les politiques abandonner la mémoire culturelle et historique de leur pays.
Que le spectacle commence ! Nous sommes successivement dans sa tête à elle, dans sa tête à lui et dans celle d’un narrateur omniscient. Anatomie cruelle de la chute de la maison France, advenue en trente ans avec les premières cohabitations, la collusion progressive du public et du privé et la décomposition du politique réduit à cet éternel bal des prétendants dont les fantômes jamais rassasiés de pouvoir ne cessent de nous hanter.
Nostalgie sur son identité aussi, fracassée depuis le divorce de la République des lettres et de la République tout court, dans un pays où la littérature avait jusqu’alors toujours été politique et la politique littéraire. Jeu entre ces deux personnages qui s’étaient jadis embrassés le temps d’une fête, qui se cherchent et se défient, et pour lesquels, jeux de pouvoir et de séduction se confondent.
En sept puissants chapitres qui scandent les heures et les lieux traversés, Cécile Guilbert mêle la grande histoire à la petite pour dresser un portrait peu flatteur d’un pays dont les élites sont à la dérive. Et elle n’épargne personne : pas plus les importants du jour croqués dans des portraits assassins que ses propres personnages, dont elle se joue avec une ironie grinçante. D’une plume allègre, cruelle et brillante, elle nous emporte dans son roman comme dans une pièce de théâtre dont on ressort séché.
Autant qu’impressionné.
LIRE AUSSI : Cécile Guilbert : Comment j’ai pu faire Sciences Po
Interview de Cécile Guilbert par Marie Ève Lacasse
META festival#1 - 4 avril 2015
Cécile Guilbert revient sur les différents livres qu’elle a écrits depuis vingt ans.




 Version imprimable
Version imprimable



 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?



3 Messages
Les illusions perdues
Répliques, 3 juin 2017, Alain Finkelkraut.
Les protagonistes du roman de Cécile Guilbert Les Républicains et ceux de Marc Lambron Les menteurs ont plusieurs choses en commun. Ce sont de brillants sujets. Ils ont fait, dans les meilleures écoles, de très belles études. Ils sont nés trop tard pour avoir, comme on dit, fait 68. Il appartiennent donc à une génération, celle des années 80, qui ne peut se prévaloir d’un grand évènement ou d’un grand psychodrame fondateur. Et ils ont aussi cette particularité d’être très lucides sur eux-mêmes et sur leur temps.
Qui sont-ils ? Qu’ont-ils reçu ? Qu’ont-ils transmis ? Qu’ont-ils à nous apprendre ? Que signifie leur vie ? Que révèle leur trajectoire ?
Intervenants :
Cécile Guilbert : Romancière
Marc Lambron.
L’OBS du 23 février 2017.
Zoom : cliquez l’image.
La critique du livre se trouve dans le numéro 442 d’art press (mars 2017). Pas de quartier !
art press 442, mars 2017, p. 75.
Zoom : cliquez l’image.