Après Baudelaire par Baudelaire, Baudelaire lu par Proust, voici le troisième volet de notre hommage au poète des Fleurs du mal. Au moment du centenaire de la naissance de Baudelaire, Proust écrivait dans son article de 1921 :
« ... en tenant compte de la différence des temps, rien n’est si baudelairien que Phèdre, rien n’est si digne de Racine, voire de Malherbe, que les Fleurs du Mal. Faut-il même parler de différence des temps, elle n’a pas empêché Baudelaire d’écrire comme les classiques. »
Racine ? Rimbaud, dans sa lettre à Demeny du 15 mai 1871, dite Lettre du Voyant, écrivait :
« Voici de la prose sur l’avenir de la poésie —
Toute poésie antique aboutit à la poésie grecque ; Vie harmonieuse [...]. Racine est le pur, le fort, le grand. — On eût soufflé sur ses rimes, brouillé ses hémistiches, que le Divin Sot serait aujourd’hui aussi ignoré que le premier venu auteur d’Origines. — Après Racine, le jeu moisit. Il a duré deux mille ans ! »
Et, dans la même lettre :
« Baudelaire est le premier voyant, roi des poètes, un vrai Dieu. Encore a-t-il vécu dans un milieu trop artiste ; et la forme si vantée en lui est mesquine — les inventions d’inconnu réclament des formes nouvelles. » (je souligne)
Racine et Baudelaire donc (non sans ambivalence). Il appartenait à un poète contemporain, Marcelin Pleynet d’y regarder de plus près. C’est dans un recueil publié en 1984 dans la collection L’infini (alors éditée par Denoël) et intitulé Fragments du choeur (sur lequel je ne ne me souviens pas avoir lu beaucoup de commentaires) qu’on trouve la plus profonde méditation poétique et sur Racine et sur Baudelaire, sur Racine et Baudelaire. L’essai de Pleynet s’intitule « Vers et proses II : Racine devant Baudelaire » [1]. De quoi est-il question dans cette méditation ? De la « haine de la poésie », formule qui reprend le premier titre d’un essai que Georges Bataille publia en 1947 et republiera en 1962 sous le titre de L’Impossible [2]. Haine de la poésie ? De quelle haine et de quelle poésie s’agit-il ? La poésie serait-elle toujours objet de haine ? Pourquoi ? Et pourquoi Racine ? Pourquoi Baudelaire ? Quel sens donner à un tel titre : Racine devant Baudelaire ? Pleynet :
« Ce qui inspire la haine [...], c’est précisément la poésie de Baudelaire comme celle de Racine. »
« Que Baudelaire découvre l’une des plus profondes motivations du génie de Racine, de la singularité du vers racinien, cela n’implique-t-il pas un retour sur la fonction du langage poétique, de la poésie et de la langue française ? »
Voici de la prose sur l’avenir de la poésie tel qu’un passé parfois oublié — et pourtant plus que présent — peut le laisser entendre pourvu que l’oeil écoute.
Racine par François de Troy — Baudelaire au cigare, par Charles Neyt, 1864.
Zoom : cliquez l’image.

Vers et prose
Racine devant Baudelaire
Viens, reconnais la voix qui frappe ton oreille.
Iphigénie I, 1.
Haine de la poésie
Cette poésie qui occupe la prose de Bossuet (« il n’y a à proprement parler que le peuple de Dieu où la poésie soit venue par enthousiasme ») et lui barre le chemin de la traduction des Psaumes (voir « Vers et Prose I »), il nous faut aujourd’hui encore la chercher. Comment le génie poétique français est-il à ce point torturé qu’on n’en trouverait pas, aujourd’hui encore, un éloge sincère, et que tous les jugements qu’il appelle semblent ou tordus ou... coudés ? Haine de la poésie publie Georges Bataille en un éloge intelligent et qui manque son coup. Et, cela semble désormais inévitable, le détour est pris qu’il faudrait reprendre et détourner. Haine de la poésie pour contourner la critique qui n’en veut rien savoir et l’indifférence : la négation ; pour penser au-delà d’une misère qui fait désormais tradition. Détours, contours, bonheur et malheur de la prose mais non sans embarras ; mais non sans l’embarras d’une prosodie qui ne peut se défaire d’elle-même et de s’avouer en cachant son nom. De ce point de vue le roman, qui occupe la place, aura toujours mauvaise conscience. N’est-ce pas, dans la langue, cette mauvaise conscience qui fait roman ? Voyez déjà Baudelaire ! Et la feinte indifférence et la critique de la poésie ne sont-elles pas de ce parti ? Aujourd’hui lieu commun, discours de convention. C’est aujourd’hui lieu commun de dénoncer, non le mauvais vers, mais le genre, s’en s’inquiéter plus, et comme s’il y allait d’une tare, d’une faute ontologique ; et sans non plus s’occuper de savoir ce qui s’y joue de vrai, et en français d’une toute particulière tradition. La prose, ce que l’on dit de la prose française ne s’est pas forgé sans que la poésie y joue et y déjoue son jeu. Et ce que l’on peut voir s’établir du pouvoir et de l’éloquence de Bossuet se joue aussi d’un implicite interdit sur la versification (cf sa traduction des Psaumes), d’un interdit dans la langue, d’un interdit d’abord français, gallican, soumettant la théologie à la morale.
Pour bien apprécier ce qui qualifie la grande prose oratoire et la carrière de Bossuet il suffit d’en penser le double, la forme égale et inverse, dans l’établissement d’un homme, d’un style, d’une langue et d’une tradition : l’œuvre et la carrière de Racine. A part égale, leur présence à l’Académie française, Furetière dans ses factums ne propose-t-il pas déjà deux ordres de grandeur, le premier, comptant les nobles et les évêques (dont Bossuet), et le second, les dramaturges et les poètes, dont Racine qui a pourtant déjà alors déclarativement abandonné le théâtre et la poésie pour se faire une réputation en devenant historiographe du roi ? Faut-il rappeler que Racine n’aura d’autorité qu’après avoir abandonné la carrière des lettres... alors que paradoxalement (mais qu’en est-il de ce paradoxe) ce sont les lettres, et plus particulièrement la poésie (La Nymphe de la Seine à la reine) qui lui permirent d’espérer cette autorité. Mais que savons-nous de la carrière de Racine si nous ne tenons pas compte des divisions qu’elle maîtrise ? Divisions entre le poète, l’homme de théâtre et l’historiographe (qui ne laissera rien, ou presque rien de l’histoire) gentilhomme ordinaire et courtisan de Louis XIV. Divisions entre la Lettre à l’auteur des Hérésies imaginaires et des deux Visionnaires (1665) et l’Abrégé de l’histoire de Port-Royal qu’il rédige à la fin de sa vie et qu’il laissera inachevés. La Lettre où Racine déclare à Nicole : « Nous connaissons l’austérité de votre morale. Nous ne trouvons point étrange que vous damniez les poètes, vous en damnez bien d’autres qu’eux. Ce qui nous surprend, c’est de voir que vous voulez empêcher les hommes de les honorer. Hé ! Monsieur, contentez-vous de donner des rangs dans l’autre monde, ne réglez point les récompenses de celui-ci. » Et l’Abrégé où l’on comprend bien, en fin de compte, que Racine n’a jamais oublié Pascal, et qu’il veut finalement l’associer à sa mémoire, comme il a fait en retenant l’éloge de Corneille dans son discours de janvier 1685 à l’Académie. Mais de la Lettre à l’Abrégé où était le poète Jean Racine et que retrouvons nous ? Que retrouvons-nous si ce n’est le chemin parcouru de la déclaration de Nicole (« un poète de théâtre est un empoisonneur public, non des corps mais des âmes des fidèles, qui se doit regarder comme coupable d’une infinité d’homicides spirituels... Ces sortes de péchés sont d’autant plus effroyables qu’ils sont toujours subsistants, parce que ces livres ne périssent pas... »), à la cabale des dévots, qui suspend les représentations d’Athalie ? Que retrouvons-nous si ce n’est une œuvre établie, imposée et sauvée, sur le modèle d’une existence ? La duplicité de Racine ne fait aucun doute (relisez Bajazet, Phèdre), c’est sa clef dramatique, son suspens : « On m’a dit "soyez aveugle". Si je ne le puis être tout à fait, il faut du moins que je sois muet... » (lettre à La Fontaine, 11 nov. 1661). « On voit peu de gens que la protection des Muses ait sauvés des mains de la justice » (lettre du 22 déc. 1661.) « Il faut du solide, et un honnête homme ne doit faire le métier de poète que quand il a fait un bon fondement pour toute sa vie et qu’il se peut dire honnête homme à juste titre » (lettre, juin 1661). Racine écrit cela, quatre ans avant la publication de Nicole, comme s’il prévoyait ce qui l’attend comme parcours obligé et « fondement » d’honnêteté pour sa justification et sa poésie. C’est au début de cette même année, qui va le voir en passe d’être tonsuré à Uzès, qu’il célèbre pourtant, à l’abbé Le Vasseur, les charmes de La Callipedie (poème latin, en bien des passages pornographique, de C. Quillet) qu’il associe directement et crûment à son mode d’écriture : (« Vous vous fâcherez peut-être de voir tant de ratures... je puis dire avec autant de raison que M. Quillet qu’il ne se faut pas mettre à travailler sitôt après le repas : Nimirum crudam si ad laeta cubilia portas / Perdicem, incoctaque agitas genitalia ceana, / Heu tenue effundes semen. Mais il n’importe de quelle façon je vous écrive, pourvu que j’ai le plaisir de vous entretenir ... » Ce que l’on peut considérer comme une jolie technique de mise en place pour, ce qu’il nommera l’année suivante, « la chaleur de la poésie ».
Enfin, lorsque la nuit a déployé ses voiles,
La lune, au visage changeant,
Paraît sur un trône d’argent Tenant cercle avec les étoiles :
Le ciel est toujours clair tant que dure son cours,
Et nous avons des nuits plus belles que vos jours.
Racine, après avoir cité ces vers, écrit à son correspondant (Nicolas Vitart) : « J’ai fait une assez longue pause à cet endroit parce que lorsque j’écrivais ces vers il y a huit jours, la chaleur de la poésie m’emporta si loin que je ne m’aperçus pas que le temps passait... » (17 janv. 1662). Chaleur pour chaleur, la vérité de Racine devra déjouer, en duplicité, le pouvoir direct et l’intelligence de Bossuet qui, comme on sait, lui rendra grâces, en 1694, d’avoir « renoncé publiquement aux tendresses de Bérénice... ». Mais si on lit attentivement ce qu’écrit le jeune poète, et si on tient compte du tempérament [3] et du caractère de Racine, peut-on être assuré de ce renoncement ? A quoi finalement fallait-il renoncer ? Au théâtre, aux actrices, aux « parties », que déplore Mme de Sévigné, aux déclarations batailleuses, au jeu, au libertinage, à la colère... à douze années qu’occuperont aussi la passion et le meurtre, toujours mal démêlé de la Du Parc. Coupable, non coupable ? Présent en tout cas. Mais, au demeurant, c’est d’abord de poésie que Racine doit se justifier, et pour cela il lui faut se marier [4], faire des enfants (la Du Parc est peut-être morte des suites d’une fausse couche), abandonner les vers, servir l’institution et son roi, jouer des ultramontains et des gallicans, cultiver l’histoire.
Et l’on s’interrogea, et l’on s’inquiétera : Est-ce l’œuvre, est-ce l’homme que, suivant cette politique, Racine défend ? Et de Phèdre à Esther pendant près de quatorze ans d’historiographie officielle, est-ce l’œuvre, est-ce l’homme... ou de l’œuvre à l’homme ce qu’il écrivait dans sa jeunesse de l’honnêteté et du « fondement » ? La poésie, Racine le sait, n’a ni l’honnêteté, ni la morale pour elle ; et que Racine ne s’identifie à la poésie qu’au détour (« il faut du moins que je sois muet », n’oublions pas qu’il écrit ces mots alors qu’il espère obtenir une charge à Uzès) d’une carrière, qu’en sacrifiant au « fondement » (et comme ce mot laisse à entendre)... n’est-ce pas ce qui, pour nous et notre langue, aura permis, à long terme et objectivement, d’identifier Racine et la poésie ? C’est en ce détour, en cet apparent espace de renoncement, que Racine se souvient de Pascal, croise le pouvoir de Bossuet, le maître de la prose... et établit son œuvre. C’est en ce détour, et en ce renoncement, qui n’est en effet qu’apparent, puisque qu’en ces années Racine n’en continue pas moins à publier des versions corrigées de ses tragédies, pour revenir au théâtre, puisque finalement avec Esther on lui commande une comédie (« Les personnes illustres qui ont bien voulu prendre la principale direction de cette maison (Saint Cyr)... me firent l’honneur de me communiquer leur dessein et même de me demander si je ne pourrais pas faire sur quelques sujets de piété et de morale, une espèce de poème où le chant fût mêlé avec le récit... »), et qu’il n’a pas attendu de commande pour, l’année précédente, admirablement remanier sa traduction des Hymnes du Bréviaire romain en des vers d’une frappante beauté :
Tandis que le sommeil, réparant la nature
Tient enchaîné le travail et le bruit
Nous rompons ses liens, ô clarté toujours pure
Pour te louer dans la profonde nuit.
Racine sait, et il sait d’expérience, que la poésie naît spontanément du mal et du péché (« il n’y a proprement que le peuple de Dieu où la poésie soit née par enthousiasme » cette déclaration de Bossuet mériterait d’être commentée) ; aussi se félicite-t-il de pouvoir remplir toute l’action d’Esther « avec les seules scènes que Dieu lui même, pour ainsi dire, a préparées ».
Si ce n’est pas le roi c’est déjà tout autant que le roi qui lui commande Esther. Le poète retrouverait-il le prédicateur, et la prose la poésie ? Rien n’y fera, ni le succès, le triomphe d’Esther (cf. Mme de Sévigné), ni la discrète citation de l’évêque de Meaux (« l’illustre et savant prélat ») dans la préface d’Athalie. Si moral soit-il,
De tous ces vains plaisirs où leur âme se plonge,
Que leur restera-t-il ? Ce qui reste d’un songe.
(Athalie, II, 9)
le vers est empoisonné et cette seconde pièce ne sera pas représentée (elle ne connaîtra que de plus ou moins officielles répétitions). Et c’est quatre ans plus tard que « l’illustre et savant prélat » feindra d’oublier Esther et Athalie, pour, les confondant en quelque sorte avec Bérénice, féliciter leur auteur d’avoir « renoncé publiquement » à ces sortes de « tendresses ».
Bien que ne lisant pas Racine comme il fut lu par ses contemporains nous ne pouvons pas douter qu’ils soupçonnèrent ce que nous y trouvons (cf. la rancune dont le poursuit Mme de Sévigné et de moindres échotiers). Qu’a donc entendu Mme de Sévigné lorsqu’elle écrit à Mme de Grignan : « Il aime Dieu comme il aimait ses maîtresses, il est pour les choses saintes comme il était pour les profanes », si ce n’est que Racine n’a pas changé ? Vrai courtisan, faux dévot, faux historien, Racine n’est rien de ce qu’on attend, parce qu’à le considérer du « fondement » qui, pour Mme de Sévigné entre autres, l’autorise, Racine n’est rien. Son moderne biographe, R. Picard, cite les propos des chansonniers Clairambault et Maurepas : « panneau qu’a tendu le dévot Racine », « que Racine faisait le dévot et ne l’était pas », et cette étonnante et inoubliable pointe qui découvre notre lecture :
Hypocrite rimeur ...
Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère, doutons et ne doutons pas des bons sentiments de Racine... puisque son fils fut un authentique dévot. Doutons et ne doutons pas de sa politique et du vers défendu. Doutons et ne doutons pas de ce qui l’habite et qui ne peut être que de ce théâtre, de ces « qualités qui ne sont pas fort honorables au jugement des honnêtes gens » et sont horribles « considérées selon les principes de la religion chrétienne... » de ces sortes de péchés qui sont « d’autant plus effroyables qu’ils sont toujours subsistants ».
Chaque mot sur mon front fait dresser mes cheveux.
(Phèdre, IV, 6)
Racine poète tragique y échappe moins qu’un autre ; l’enthousiasme, l’inspiration poétique vise la catastrophe que la biographie n’a jamais pour charge que de remettre et de différer. Ce peuple de mots par enthousiasme n’est jamais sauvé qu’in extremis, et toujours pour une autre chute, pour un destin plus vrai, plus sombre...
Mes crimes désormais ont comblé la mesure
Je respire à la fois l’inceste et l’imposture.
(Phèdre...)
Cette tragédie (Phèdre) n’est pas grecque, elle est racinienne... Il n’est pas une préface où Racine ne s’emploie à justifier la vraisemblance historique de sa tragédie ... Mais de quoi s’agit-il ? De faire des vers et d’en justifier la chaleur (et de se justifier de leur chaleur). De faire des vers avec et sans « fondement » et de les sauver ; et de tenir encore, pour les sauver, la feinte d’un fondement. Qu’on voie comment Racine s’occupe à l’Académie et comme, à tout moment, il semble dire et se contredire. En 1690, au comble des honneurs, au sommet de sa carrière de courtisan, ami du père de La Chaise, le jésuite confesseur du roi, il se déclare dévot, il se cache pour écrire l’Abrégé de l’histoire de Port-Royal ; il écrit Athalie et recopie des extraits de l’extravagant livre de Huet Concordia Rationis et Fidei seu Alnetenae Quaestiones (« Moïse ne fit rien de miraculeux ... » — « Il n’y a point non plus de miracle dans la manne qui tombe dans le désert ») ; il prend des notes dans le livre d’Arnauld, Difficultées proposées... (« On a mis à l’index la Métaphysique de Descartes et sa Réponse à Gassendi pour prouver l’immortalité de l’âme. On n’y a point mis la Philosophie de Gassendi, ni son Traité contre Descartes où il donne des preuves contre l’immortalité de l’âme ») ; enfin on trouve dans la bibliothèque de Racine le livre de ce Richard Simon que Bossuet s’est employé, avec tant d’énergie (et de proses), à faire condamner. Racine est, en ses dernières années, comme toujours il fut ; double, triple, quadruple, dévot, courtisan, historiographe glorieux, génie secret, esprit libre et croyant, toujours, encore, et d’abord condamné.
La poésie, ce que nous héritons de la poésie et de son accueil, n’est pas plus étrange. La morale, la nôtre, qui est aujourd’hui la bonne pensée intelligente, voire analytique, ne s’y retrouve pas... puisque, là encore, il y faudrait un établissement : Assurons-nous que le poète ne nous proposera pas des complaisances de nature à troubler les nouvelles vertus... qu’il n’a pas pour sa mère de ces attachements où Phèdre... N’en parlons plus. Et pourtant quelle famille !
Chaque mot sur mon front fait dresser mes cheveux
Mes crimes désormais ont comblé la mesure
Je respire à la fois l’inceste et l’imposture
Mes homicides mains, promptes à se venger,
Dans le sang innocent brûlent de se plonger.
Misérable ! et je vis ? et je soutiens la vue
De ce sacré Soleil dont je suis descendue ?
J’ai pour aïeul le père et le maître des Dieux ;
Le ciel, tout l’univers est plein de mes aïeux.
Où me cacher ? Fuyons dans la nuit infernale.
Mais que dis-je mon père y tient l’urne fatale...
En 1960 Roland Barthes écrivait : « Je ne sais s’il est possible de jouer Racine aujourd’hui... Mais si l’on essaye, il faut le faire sérieusement, il faut aller jusqu’au bout. La première ascèse ne peut être que de balayer le mythe Racine, son cortège allégorique (Simplicité, Poésie, Musique, Passion, etc.) ; la seconde, c’est de renoncer à nous chercher nous-même dans ce théâtre : ce qui s’y trouve de nous n’est la meilleure partie ni de Racine, ni de nous. » Ce livre, qui donna lieu à une méchante polémique qu’il était mieux de laisser passer, à le relire ne dirait-on pas que la poésie s’y trouve portée au même compte, au même déficit ? « Si nous voulons garder Racine éloignons-le. » Éloignons le trouble sentiment et la faute et la plus trouble poésie (« Rentre dans le néant dont je t’ai fait sortir » Bajazet, II, 1). Éloignons le vers et ce sens troublant qui n’est que d’être et de naître d’un sens qui n’est que de naître à l’instant. Barthes est d’une certaine façon justifié d’écrire de Racine que son œuvre est apparemment divisée, esthétiquement irréconciliée... « loin d’être le sommet rayonnant d’un art, elle est le type même d’une œuvre passage, où mort et naissance luttent entre elles », mais il faut alors ajouter que c’est moins le théâtre que le vers (les vers dans le théâtre) qui vient conforter et donner dimension, justifier la tragédie dans la belle définition lapidaire qu’en propose Barthes : « La tragédie est seulement un échec qui se parle. » Ce qui est évidemment valable pour la meilleure comme pour la pire des tragédies, se justifie et se fonde en vérité dans la singularité du vers racinien. Il faut donc reprendre : la tragédie est seulement un échec qui se parle dans le vers et dans la poésie... C’est dans la tentative de littéralement dé-jouer le pouvoir, le « fondement »... c’est dans la fatale et désespérée tentative de déjouer le pouvoir (le réel), le « fondement », que naît l’échec tragique (la catastrophe) et avec lui l’inspiration, la revendication élevée, la chaleur du savoir et de la parole... et, au-delà, la vocalise (Phèdre comme Athalie vocalisent quasi littéralement l’autre raison en un chant qui transcende la loi comme le crime), l’échec sublime et vrai de la réussite du vers de la poésie. Thierry Maulnier définit la poésie racinienne comme « le psaume d’un lent office dit par la voix du désespoir pur, adressé seulement à l’absence... » (Lecture de Phèdre).
Racine premier poète moderne et définitivement condamné avec la poésie pour les siècles des siècles, si l’on veut bien savoir que l’homme ne peut vivre que de ce qu’il condamne dans l’impossibilité de vivre ce qu’il est en tant qu’homme : condamné. Racine et Bossuet nous engagent aux deux versions, poétique et prosaïque, de cet impossible débat. Mais, où la prose, d’une façon ou d’une autre, soumet inévitablement son inspiration à la mesure d’une autorité (au jeu plus ou moins bien articulé d’une double loi — on comprend que le siècle se déchire entre l’Église ultramontaine et l’Église gallicane), la poésie (sublime... et misérable) célèbre l’autorité sans loi d’une « catastrophe », d’une démesure. Et de ce point de vue, tout dévot qu’il fût, Racine n’a trompé personne (et lui même moins que tout autre) avec sa dernière tragédie. Le dernier acte d’Athalie double et justifie l’emportement de Phèdre dans une vision des abîmes et des siècles épouvantés. Comment se laisser convaincre par les mauvaises raisons que nous propose Racine lorsqu’il écrit d’Athalie : « J’aurais dû dans les règles l’intituler Joas. Mais, la plupart du monde n’en ayant entendu parler que sous le nom d’ Athalie, je n’ai pas jugé à propos de la présenter sous un autre titre, puisque d’ailleurs Athalie y joue un personnage si considérable et que c’est sa mort qui termine la pièce. » Entre le bien et le mal, c’est le mal qui titre l’histoire ; et loin de faire oublier la mémoire de Phèdre (« D’une action si noire / Que ne peut avec elle expirer la mémoire »), Athalie la justifie (en portant la scène, le théâtre, dans le temple de Jérusalem) en lui donnant la dimension du drame biblique. Ne pourrait-on pas penser la lecture que Racine fait du Concordia... alors qu’il écrit Athalie, comme un élément destiné à justifier ce rapprochement (on sait que dans la très délirante thèse de P. Huet les dogmes chrétiens sont assimilés aux croyances des Anciens, et les miracles de l’Ancien et du Nouveau Testament présentés comme ayant été, sous des formes diverses, attestés comme des faits naturels par les écrivains grecs et latins). Ainsi, en deçà comme au-delà de la forme des croyances, dominera la forme tragique et... la poésie. Racine n’écrit-il pas déjà en préface à Esther : « Je m’aperçus qu’en travaillant sur le plan qu’on m’avait donné, j’exécutais en quelque sorte un dessein qui m’avait souvent passé par l’esprit, qui était de lier, comme dans les anciennes tragédies grecques, le chœur et le chant avec l’action, et d’employer à chanter les louanges du vrai Dieu cette partie du chœur que les païens employaient à chanter les louanges de leurs fausses divinités. » Mais que dit-il ici précisément, si ce n’est que, d’une part, il associe Esther aux tragédies qu’il a écrites douze ans plus tôt et que donnant pour titre à sa prochaine tragédie le nom d’Athalie au lieu de lui donner le nom du héros momentanément positif, Joas, il ne s’en tient pas au simple déplacement d’une soumission formelle, mais tend à soumettre toute forme, et toute croyance, à la catastrophe, à l’échec tragique. En cela il se distingue radicalement du prosateur, je veux dire de Bossuet, qui ne saurait, en aucun cas, et pour cause, assimiler tragique et éternité. La mort d’Athalie ne profitera, nous le savons, que momentanément à Joas et aux héritiers de David, et la fin du V• acte ne se dégagera pas de la malédiction d’Athalie (« Joas : Dieu qui voyez mon trouble et mon affliction / Détournez de moi sa malédiction / Et ne souffrez jamais qu’elle soit accomplie... »). La dernière scène d’Athalie ne sera-t-elle pas toujours, et pour toujours, une avant-dernière scène ; l’antichambre d’une autre nouvelle, semblable et non moins sanglante, tragédie où l’humain n’appréhendera le dieu et la démesure qui l’habite que dans l’ultime vocalisation d’une catastrophe, d’un châtiment et d’un crime :
Le fer a de sa vie expié les horreurs
Jérusalem, longtemps en proie à ses fureurs,
De son joug odieux à la fin soulagée
Avec joie en son sang la regarde plongée.
Voltaire et d’Alembert estiment Racine maladroit d’avoir finalement révélé « l’avenir » de Joas... mais n’est-ce pas qu’ils croient l’un et l’autre davantage au récit dramatique qu’à la transcendante grandeur tragique de l’éternité ? « Avec joie dans son sang la regarde plongée. » Comme on imagine bien, la psychologie de Racine et la vraisemblance psychologique n’ont rien à faire avec de tels vers, ils ne portent que la célébration, la vocalisation, la stupéfaction vocale, de la joie et de l’horreur. C’est là l’ordre de la conclusion racinienne où « l’échec » (le non-fondement absolu) du vers, de la poésie, troue le discours : sens et non-sens, excès de sens. Qu’est-ce que cette « joie en son sang » ? Et que l’on reprenne toute l’admirable réplique. Nous dit-elle autre chose que la joie de Jérusalem en cette « plongée » ? Quel sens propose-t-elle, que le chant catastrophique n’emporte, ne domine et n’excède ?
Racine et Baudelaire
Trois volumes dépareillés de Racine,
ce sont tous les trésors que j’ai gardés de toi.
Ch. Baudelaire (lettre à sa mère, mars 1852).
La poésie bien entendu m’emporte à cet ultime, à ce sublime arrachement de l’être, et de la lettre ; à ce moment où la mort, où le mort vient à faire un vide que le sang colore, et où la douleur s’élève, en lieu et place du plein criminel, comme une joie.
Mortel chéri du ciel, mon salut et ma joie,
Aux conseils des méchants ton roi n’est plus en proie
Mes yeux sont dessillés, le crime est confondu.
Viens briller près de moi dans le rang qui t’est dû
Je te donne d’Aman les biens et la puissance :
Possède justement son injuste opulence.
Je romps le joug funeste où les juifs sont soumis.
Je leur livre le sang de tous leurs ennemis ;
A l’égal des Persans je veux qu’on les honore,
Et que tout tremble au nom du Dieu qu’Esther adore.
Rebâtissez son temple, et peuplez vos cités
Que vos heureux enfants dans leurs solennités
Consacrent de ce jour le triomphe et la gloire,
Et qu’à jamais mon nom vive dans leur mémoire.
(Esther, III, 7)
······················································································
Seigneur, le traître est expiré
Par le peuple en fureur à moitié déchiré.
On traîne, on va donner en spectacle funeste
De son corps tout sanglant le misérable reste.
(Esther, III, 8)Et la mort, à mes yeux dérobant la clarté,
Rend au jour, qu’ils souillaient, toute sa pureté.
(Phèdre, V, scène dernière)(Et la mort rend au jour toute sa pureté.)
L’impossible a accompli son œuvre de vérité, de torture, de douleur, de chant. L’impossibilité de vivre sa condamnation entraîne l’homme jusqu’à la catastrophe ; l’entraîne à vivre le mal qui tue. En vérité la tragédie, comme la vie, est un échec qui occupe la voix et dont l’écho se perpétue.
Si l’on comprend la biographie de Racine, entre la lettre de juin 1661 à l’abbé Le Vasseur — Racine a vingt deux ans (« Il faut du solide, et un honnête homme ne doit faire le métier de poète que quand il a fait un bon fondement pour sa vie et qu’il peut se dire honnête homme à juste titre »), la lettre de novembre 1661 à La Fontaine (« On m’a dit "soyez aveugle". Si je ne puis l’être tout à fait il faut du moins que je sois muet »), la querelle des Imaginaires (« un poète de théâtre est un empoisonneur public » Nicole), les douze années de création dramatique, sa nomination à l’Académie française, son discours à la réception de MM. de Corneille et de Bergeret en janvier 1685 — Racine a quarante-six ans — (« Oui, Monsieur, que l’ignorance rabaisse tant qu’elle voudra l’éloquence et la poésie, et traite les habiles écrivains de gens inutiles dans les États, nous ne craignons point de dire à l’avantage des lettres et de ce corps fameux dont vous faites maintenant partie : du moment que des esprits sublimes, passant de bien loin les bornes communes, se distinguent, s’immortalisent par des chefs-d’œuvre comme ceux de Monsieur votre frère, quelque étrange inégalité que durant leur vie la fortune mette entre eux et les plus grands héros, après leur mort cette différence cesse. »), sa situation d’historiographe de Louis XIV, Athalie, ses notes sur le Concordia et l’Abrégé ; si l’on comprend la biographie de Racine, si l’on suit l’ordre de cette ponctuation biographique, on ne peut pas ne pas considérer le mal que se donne Racine pour maintenir et imposer la poésie — c’est-à-dire ce que l’ultime cabale contre Athalie entraîne, après G. Bataille, à qualifier d’impossible (« je tente de dire en des termes possibles ce que seule aurait le pouvoir d’exprimer la poésie qui est le langage de l’impossible », O.C. t. III).
La critique académique s’accorde sur ce point : « C’est comme poète que Racine est Racine, non comme "dramaturge" ou comme "psychologue"... Toute poésie échappe à nos définitions, la sienne plus que tout autre. Du moins peut-on noter la puissance d’évocation de ses vers. Puissance de nature toute musicale... » (Pierre Clarac). Encore faut-il, si je puis dire, s’entendre sur cette musicalité qui entraîne paradoxalement cette même critique académique à rapprocher le plus grand poète classique de la langue française, l’homme couvert de fonctions, de titres et d’honneurs, Racine, avec le plus misérable, le plus sombre et le plus maudit de nos poètes modernes : Baudelaire. Pierre Clarac écrit, renversant en quelque sorte la chronologie : « Les tragédies de Racine aussi [c’est moi qui souligne] sont des fleurs du mal » ; et Raymond Picard lui-même en préface à l’ensemble des poésies : « Ces quelques centaines de vers n’ajoutent pas peu à sa gloire et aux problèmes que son œuvre pose. Leur postérité est riche et leur écho n’est pas près de s’éteindre. Si l’on y prend garde Les Fleurs du mal rejoignent souvent ces fleurs d’édification... »
Si l’on veut bien lire Racine, il faut en effet le penser comme poète et non comme dramaturge [5] ; il faut associer poésie et tragédie et suivre jusqu’à la catastrophe ce que cette association implique. N’est-il pas étonnant que la critique académique, au sens littéral du terme, se serve d’un livre légalement condamné jusqu’en 1946 (Les Fleurs du mal) pour dire et ne pas dire ce qu’il en fut, ce qu’il en est de Racine ; réservant un jugement qui porte bien entendu d’abord sur ce que l’on ne veut pas savoir de la poésie, et qui aujourd’hui entraîne à en nier l’existence ? Que Baudelaire découvre l’une des plus profondes motivations du génie de Racine, de la singularité du vers racinien, cela n’implique-t-il pas un retour sur la fonction du langage poétique, de la poésie et de la langue française. Il est étonnant de suivre le destin, quasi secret, de cette connivence ; et de constater qu’elle n’est, le plus souvent (et brièvement), signalée que par des prosateurs. Qui s’attendrait à cette déclaration d’Anatole France : « Encore serai-je en droit de lui reprocher [à Brunetière] de méconnaître en Baudelaire la morale de Bossuet mise en vers classiques par un disciple de Boileau » (Le Temps, 2 oct. 1892) ? André Gide, qui cite Barrès (« C’est par Les Fleurs du mal peut-être que nous reviendrons à la grande tradition classique... appropriée sans doute à l’esprit moderne », 1884), insiste de son côté : « dans les vers de Racine principalement, parfois détériorant la perfection extérieure, une perfection plus cachée [c’est moi qui souligne], musicale déjà, mais comme à son insu — et je ne crois pas très exagéré de dire qu’on vient seulement de s’en apercevoir. — Baudelaire le premier, d’une manière consciente et réfléchie a fait de cette perfection secrète [on voit que Gide tient au secret — c’est toujours moi qui souligne] le but et la raison de ses poèmes » et encore : « C’est aussi par là qu’il s’apparente étroitement à Racine ; le choix des mots chez Baudelaire peut être plus inquiet et de prétention plus subtile : je dis que le ton de la voix est le même ... » (Nouveaux Prétextes). Gide semble alors se faire entendre de Claudel (« Mes compliments sur votre excellent article relatif à Baudelaire ! Il y a surtout une dizaine de lignes tout à fait essentielles » lettre du 12 nov. 1910) qui pourtant n’y reviendra jamais. Et si l’on trouve encore, entre autres, une semblable indication chez Proust, citant des vers de Bénédiction à sa mère (« A côté de vers raciniens si fréquents chez Baudelaire : "Tous ceux qu’il veut aimer l’observent avec crainte." »), elle reste sans suite et, encore une fois attachée au secret, sans autre conséquence pour la poésie. Il faudra donc, si je puis dire laisser courir. Il faudra donc laisser pourrir et que la poésie soit tout entière confondue avec sa dénégation pour qu’en un détour s’énonce cette vérité : « Haine de la poésie. » Le malentendu étant pourtant maintenu puisque Georges Bataille, lecteur (et quel lecteur !) comme on sait de Proust, ne se préoccupera pas plus des origines de l’aventure, et que sans songer à aller regarder ce qu’il en fut par exemple de Racine [6], écrit : « Je songeais à l’aversion que m’inspirait alors "la belle poésie". Jamais la poésie de Baudelaire ou celle de Rimbaud ne m’ont inspiré cette haine » (O.C., t. III). Le mode de sélection et le flou de la déclaration critique ne seront pourtant pas très éclairants, et il faut bien entendu les reprendre si l’on veut s’y retrouver... Ce ne fut jamais, ce n’est pas « la belle poésie » (la proposition est tout de même très vague) qui inspire la haine ; c’est tout au contraire, là encore si je puis dire, la poésie qui de toute façon ne saurait qu’être belle (qui de toute façon ne saurait qu’être — c’est-à-dire n’être ni belle, ni laide, ni quoi que ce soit d’autre qu’elle-même), c’est « l’impossible » (second titre que Bataille donne à ce même livre et qui est immédiatement plus justifié). C’est la tragédie (la catastrophe) : « Il y a devant l’espèce humaine une double perspective : d’une part celle du plaisir violent, de l’horreur et de la mort — exactement celle de la poésie ... » (préface à L’impossible), « L’impossible est encore, est avant tout la violence tout entière et l’inévitable tragédie... » (note pour la préface à L’impossible). Ce qui inspire la haine, non pas celle de Bataille, qui ne nous occupe qu’à moitié, mais celle dont en une posture de négation (« la belle poésie ») il croit devoir nous entretenir, c’est précisément la poésie de Baudelaire comme celle de Racine. En fait, d’une édition à l’autre, Bataille se débat avec cette distinction qui n’en est pas une : la « belle poésie » (poésie « liée au goût du possible », note pour la préface) et la « poésie véritable » (« il me semblait que la poésie véritable accédait seule à la haine » — préface). On voit comment Bataille se prend lui-même à son tir coudé par négation de la négation. La « poésie véritable » serait-elle ce qu’elle est si elle n’était pas liée « au goût du possible » (Baudelaire nous dit sur ce point l’essentiel : « Tâche difficile que de s’élever vers cette insensibilité divine ! Car moi-même, malgré les plus louables efforts, je n’ai pas su résister au désir de plaire à mes contemporains, comme l’attestent en quelques endroits, apposées comme un fard, certaines basses flatteries, adressées à la démocratie, et même quelques ordures destinées à me faire pardonner la tristesse de mon sujet », projet de préface aux Fleurs du mal) ? Ne faut-il pas ce lien pour que se manifeste, dans la catastrophe, « une convulsion qui met en jeu le mouvement global des êtres » : l’impossible ?
Baudelaire évidemment nomme les fleurs du mal ; et toute la poésie s’échoue dont on lève le secret, et le mal secret... Et l’horreur confusément saisit le monde des lettres
— une horreur si je puis dire déjouée par négation, dénégation, psychologie. Et l’essentiel sans doute serait réglé, n’était-ce alors dans cette langue (le français) la constante et toujours vive présence du vers, la constante et toujours vive présence de Racine dont, bien souvent pour « les modernes », la voix ne se fait plus entendre qu’à travers Baudelaire. Pourtant Baudelaire cite peu Racine (quasiment pas), mais il faut retenir que les rares occasions où il le cite sont, dans la biographie du poète, lourdes de conséquences ; notamment en ce que les plus significatives d’entre elles sont adressées à sa mère (et ce à treize ans de distance). Dans une lettre du 27 mars 1852 il lui rappelle, comme on l’a vu, que « trois volumes dépareillés de Racine ce sont tous les trésors » qu’il garde d’elle. Baudelaire écrit alors de façon, me semble-t-il, encore plus significative : « quatre lettres, et trois volumes dépareillés de Racine, ce sont tous les trésors que j’ai gardés de toi... » Enfin dans une lettre du 22 décembre 1865 (deux ans avant sa mort) il compare sa propriété littéraire à celle de Racine : « Suppose que les lois permettent de transférer indéfiniment la propriété littéraire et que les héritiers de Racine aient touché, depuis sa mort, des droits sur la réimpression de ses travaux ... » De l’un à l’autre, et de vous à moi, c’est bien de cela qu’il s’agit, n’est-ce pas, de propriété (à tous les sens du mot) littéraire — de transférer indéfiniment la propriété littéraire sur les droits de réimpression — de cette propriété de la poésie transférée aux héritiers... Suis-je entraîné à faire dire à Baudelaire autre chose que ce qu’il dit... mais que dit-il qui ne comprenne, ici précisément, toute son œuvre et sa vie ? Ne fut-il pas de son vivant privé de ses droits sur lui-même et jusqu’à la catastrophe finale, jusqu’à cette anorexie qui dit aussi la vérité de l’actuelle « crainte » poétique ?
De Racine à Baudelaire, du Racine attaché à Phèdre (où nous dit Thierry Maulnier « la tragédie se fait poème pur ») comme à Athalie, au Baudelaire des Fleurs du mal : cette déclaration de Baudelaire dans son second projet de préface au livre condamné : « Quelques-uns m’ont dit que ces poésies pouvaient faire du Mal. Je ne m’en suis pas réjoui. D’autres, de bonnes âmes, qu’elles pouvaient faire du bien, et cela ne m’a pas affligé. La crainte des uns et l’espérance des autres m’ont également étonné, et n’ont servi qu’à me prouver une fois de plus que ce siècle avait désappris toutes les notions classiques relatives à la littérature. » Le mal en effet n’est pas là où la morale va le chercher, cette morale-là se psychologise, se commente, se romance... Le mal est dans le vers et dans le vers seul. Nicole (à qui Racine répond « Nous connaissons l’austérité de votre morale. Nous ne trouvons point étrange que vous damniez les poètes » Lettre...), Nicole ne s’y est pas trompé et s’il dénonce la description des « passions criminelles »..., il stigmatise plus particulièrement les poésies « ces sortes de péchés sont d’autant plus effroyables qu’ils sont toujours subsistants... ». Le mal n’est pas seulement dans le drame païen — Racine le découvrira avec la cabale d’Athalie, il est d’abord dans ce qui dramatise, il est d’abord dans la portée tragique où s’emporte et s’abîme la langue, et en ce point, d’autant plus terrifiant, et d’une terreur archaïque qui ne saurait se nommer, qu’il est comme les vers dans le fruit. Baudelaire ne dit que le vrai lorsqu’il oppose à la morale de l’honnête homme (« un honnête homme ne doit faire le métier de poète que quand il a fait un bon fondement », rapporte Racine)... Baudelaire ne dit que le vrai lorsqu’il oppose à la morale de « l’honnête homme » du bon « fondement », la « terrible moralité » des Fleurs du mal (« Le livre doit être jugé dans son ensemble, alors il en ressort une terrible moralité » — note pour son avocat). Mais Baudelaire qui n’a pas pris les précautions de Racine, et qui en conséquence ne peut pas ne pas être amené à jouer sa propre catastrophe (s’identifier à la catastrophe poétique), Baudelaire ne peut pas voir, emporté comme il est dans la fureur tragique qui le soulève et qui l’anéantira, que la moralité ne juge jamais de faits moraux ou immoraux, mais de cette autre à elle-même ; qu’elle ne juge jamais que de cette « terrible moralité », que de ce qui la terrorise : l’anéantissement, la mort dite en catastrophe et « toujours subsistante », la mort de Baudelaire justement. Et d’abord, et ne le dit elle pas, elle juge en elle (en la mort de Baudelaire) la trahison de l’espèce, cette trahison qui en tête du livre se titre Bénédiction — ce moment où l’apparition du poète provoque l’épouvante, la vérité monstrueuse, la trahison et la négation comme amour ; bref le renversement double et vrai de toutes les « valeurs » et, par voie de conséquence, la tragique condamnation de la mère
Le crime d’une mère est un pesant fardeau
(Phèdre, II, 3)
Et ne comprenant pas les desseins éternels,
[elle m’aime] Elle-même prépare au fond de la Gehenne
Les bûchers consacrés aux crimes maternels.
(Bénédiction, 18/20)
Les desseins éternels, qui ne sont pas ici les desseins de l’Éternel, sont bien entendu à rapprocher de la « terrible moralité », logés avec les vers dans la langue, disant, avec la langue, la mort de la langue, disant la mort comme l’amour (aimer est nier), comme la lumière, disant la mort comme le soleil
Toi... qui peut-être rougis du trouble où tu me vois. Soleil.
(Phèdre, I, 3)
A ce rouge soleil que l’on nomme l’amour.
(Les Femmes damnées)
logé dans la langue, dans sa terreur comme un désordre tragique (« Faites votre destin âmes désordonnées »), comme une charogne
Alors, ô ma beauté ! dites à la vermine
Qui vous mangera de baisers
Que j’ai gardé la forme et l’essence divine
De mes amours décomposés.
Ces vers de Baudelaire identifient le désordre tragique et sa langue. Si claire, si transparente, si régulière soit-elle, la versification impose un désordre à l’ordre du possible (du « fondement » et de « l’honnêteté »). « Faites votre destin âmes désordonnées... » La beauté est, par essence, divine, mangée de vermine ; et ces desseins sont éternels comme les vers, ils sont les fleurs du mal. La plus haute, la plus sublime grandeur de ce qui traverse l’homme avec sa mort n’est plus de l’homme dans son langage. Cris, ululements, chant (« je ne fais pas le bien que j’aime. Et je fais le mal que je hais » Stance à la louange de la Charité —, Cantique 3), bien, mal, est-il rien de plus joyeusement, de plus terriblement chanté que ce cri de mort de Roxane : « Rentre dans le néant dont je t’ai fait sortir » (Bajazet, II, 1). Est-il rien de plus baudelairien dans le vide sublime que fait ce vers dans la catastrophe, dans la chute, dans la quasi-absence de sens qui le porte ! Et, puisqu’il s’agit en effet d’entrer dans le néant, passera-t-on plus près que cette vocalise ? On n’en finirait pas de citer, de citer et de suivre ce grand chœur qui s’élève des langues, connaît (« terrible moralité ») et jouit d’une chute, « d’un désastre obscur » (Mallarmé applique si bien à E. Poe ce qui ne revient qu’à Baudelaire...). Juste en ce point de répétition sonore d’un nombre (où Saussure entrevoit l’abîme anagrammatique), que le vers marque de manière particulièrement frappante à sa fin, qui s’élève et qui chute en un éclat, où l’écart (qui ne saurait en aucune façon être comblé) de la poésie la définit fondamentalement comme anti-prose (Jean Cohen, Structure du langage poétique), où l’écart décisif laisse place, ouverture à ce qui excède l’excès... juste en ce point, toutes les anomalies se précipitent dans la démesure qui les annule. Ce n’est ni l’écart ni l’anomalie qui constitue la poésie (et le vers) mais en excès leur annulation, leur précipitation et leur annulation par ce qui les compte en sonorité et, en sonorité, les surdétermine, les frappe d’un éclair, d’une foudre, d’une charge, d’un voltage d’investissement que seul le rire, le hurlement de la douleur, vocalise. Baudelaire le dit admirablement dans l’Épigraphe pour un livre condamné
Lecteur paisible et bucolique
Sobre et naïf homme de bien
Jette ce livre saturnien
Jette ! tu n’y comprendrais rien,
Ou tu me croirais hystériqueMais si, sans se laisser charmer
Ton œil sait plonger dans les gouffres
Lis-moi, pour apprendre à m’aimer ;Ame curieuse qui souffre.
Et va cherchant ton paradis,
Plains-moi !... Si non, je te maudis !
Ainsi Les Fleurs du mal s’ouvriront, finalement, si je puis dire, par une malédiction ! Finalement la poésie, le vers portent leur nom, fleurs du mal, et se placent explicitement sous la malédiction avec laquelle débat et querelle Racine : « Nous ne trouvons point étrange que vous damniez les poètes... » Certes « l’homme de bien » de Baudelaire n’est ni tout à fait comparable à « l’honnête homme » du « fondement » racinien, ni tout à fait comparable à l’honnête objectivité de l’homme de science moderne qui, comme chacun sait, prend des gants ; mais la poésie n’en joue pas moins le même rôle et continue à produire une horreur plus grande que la mort. Que cherche à dire Baudelaire lorsqu’il écrit en ouverture du premier projet de préface à la réédition des Fleurs du mal : « La france [la minuscule est de Baudelaire] traverse une phase de vulgarité. Paris centre et rayonnement de la bêtise universelle » ? Que cherche à dire Baudelaire, si ce n’est ce qui distingue « l’honnête homme » du XVIIe siècle, de « l’homme de bien » du XIXe, et que « l’homme des sciences de l’homme » de cette fin du XXe siècle nous permet de mieux comprendre ? Quelle « vulgarité » française et quelle « bêtise universelle » ? Pour ce qui nous occupe est-il d’autres vulgarités et d’autres bêtises que celles qui touchent à la mort et qui ne se disent jamais que dans ce qui touche au sexe ? Si nous ne pouvons aujourd’hui ignorer que la monstrueuse grandeur qui dresse face à face Bossuet et Racine est un complot auquel, justement, nous devons notre intelligence et notre distinction ; si nous ne pouvons pas non plus ignorer ce qu’a de troublant la misérable rencontre de Baudelaire et de Sainte-Beuve (a-t-on jamais dit sur ce fait combien Proust fut admirable ?)... qu’on n’oublie pas en effet ici la hautaine lettre de Baudelaire à Poulet-Malassis :« Mon cher ami, Vous seriez bien gentil si vous m’envoyiez une note me disant quel est le prix d’un exemplaire de la Justine, et où cela peut se trouver, tout de suite ; / me disant aussi le prix des Aphrodites, de Diable au corps, et quelles sont selon vous les caractéristiques morales ou littéraires d’autres saloperies telles que celles produites par le Mirabeau et le Rétif. / Que diable le sieur Baudelaire veut-il faire de ce paquet d’ordure ? / le sieur Baudelaire a assez de génie pour étudier le crime dans son propre cœur. — Cette note est destinée à un grand homme qui croit ne pouvoir l’étudier que chez les autres » (le’ octobre 1865). Ce « grand homme » s’appelait Sainte-Beuve... Si nous ne pouvons pas ignorer ce qu’il en fut pour Baudelaire d’un tel face à face, nous ne pouvons pas ne pas savoir qu’aujourd’hui nos modernes « hommes des sciences de l’homme » sont définitivement trop engagés dans « la voie du Progrès » pour tolérer la mort, et qu’en conséquence le sexe fait boutique. la mort est sous déni et sa vérité n’accède même plus à la conscience. la « bêtise » alors, en effet, est universelle et ne peut trouver la poésie qu’inutile et bête. Bataille en dit sur ce point plus long qu’il ne dit lorsqu’il rebaptise Haine de la poésie : L’impossible (« Il y a quinze ans j’ai publié une première fois ce livre. Je lui donnais alors un titre obscur Haine de la poésie. Il me semblait qu’à la poésie véritable accédait seule la haine. la poésie n’avait de sens puissant que dans la violence de la révolte. Mais la poésie n’atteint cette violence qu’évoquant l’impossible. A peu près personne ne comprit le sens de ce premier titre, c’est pourquoi je préfère à la fin parler de L’impossible ») ; ce remords de Bataille est significatif, Haine de la poésie était n’en doutons pas un titre aussi direct que possible, et proche en effet des Fleurs du mal, mais alors adressé à « l’homme de bien » du XIXe siècle, à ce reste de doute quant à la mort, à ce furieux reste de doute quant à la mort. Pour que le titre dise le tout du contemporain de Bataille, pour que le titre se dise et dise la dénégation de « l’homme des sciences de l’homme », pour qu’ainsi le titre dise ce qu’il en est de la mort pour « l’homme des sciences de l’homme », il fallait effectivement qu’il dise, en tous sens désormais, l’Impossible (c’est là sa réussite et son échec). Haine de la poésie, qui ne fut jamais entendu, ne pouvait être entendu, sous la malédiction des Fleurs du mal, que dans la violence et la gloire mortelle d’une voix portant la jouissance, la joie et la mort sans bien ni mal et faisant chœur au souffle précipité de la parole, au cœur précipité de la langue (vie et mort — vie comme mort — amour comme négation de l’amour, grand chant des crevants gueule ouverte).
Saran et Verrier au début du siècle voulaient qu’on étudiât le vers en faisant abstraction de son sens. N’est-ce pas le premier signe formel d’une dénégation de la poésie, d’une dénégation de la peur, de la terreur qui saisit confusément « l’homme » inconsciemment devant la décomposition de la lettre... de la terreur de la mort, de la « charogne » dans la lettre.
Tout cela descendait, montait comme une vague,
Ou s’élançait en pétillant ;
On eût dit que le corps, enflé d’un souffle vague,
Vivait en se multipliantDerrière les rochers une chienne inquiète
Nous regardait d’un œil fâché,
Épiant le moment de reprendre au squelette
Le morceau qu’elle avait lâchéEt pourtant vous serez semblable à cette ordure
Oui ! telle vous serez, ô la reine des grâces
Après les derniers sacrements,
Quand vous irez sous l’herbe et les floraisons grasses,
Moisir parmi les ossements .Alors, ô ma beauté, dites à la vermine
Qui vous mangera de baisers,
Que j’ai gardé la forme et l’essence divine
De mes amours décomposés !
Qu’est-ce que cette charogne, si elle n’est pas la langue en proie à la poésie (« On eût dit que le corps enflé d’un souffle vague / Vivait en se multipliant ») ? Rien n’échappe à ce roulement sombre de la langue, ni le sens, ni l’esprit, ni la lettre (« Tu crois, quoi que je fasse / Que mes propres périls t’assurent de ta grâce/ Qu’engagé avec toi dans de si forts liens / Je ne puis séparer tes intérêts des miens », Bajazet, II, 1), ils vivent, ils ne vivent que de rentrer musicalement dans le néant dont les vers les firent sortir
La mort planant comme un soleil nouveau
Fera s’épanouir les fleurs de leur cerveau.Tu marches sur des morts, Beauté, dont tu te moques
De tes bijoux, !’Horreur, n’est pas le moins charmant,
Et le meurtre, parmi tes plus chères breloques
Sur ton ventre orgueilleux danse amoureusement.
(Hymne à la beauté)
Il n’y faut pas seulement le sens, il faut encore qu’il débatte de toutes les conventions, de toutes les formes normatives, et, justement, entre toutes, celles du bien ou celles du mal,
Que tu viennes du ciel ou de l’enfer qu’importe.
(Hymne à la beauté)
Enfer ou Ciel qu’importe ?
(Le Voyage VIII)
Si ton œil m’ouvre la porte
D’un Infini que j’aime et n’ai jamais connu
(Hymne à la beauté)
Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel qu’importe,
Au fond de l’inconnu pour trouver du nouveau.
(Le Voyage VIII)
Le vers conjugue, il est le dialecte passionné qui peut seul traverser les limites de la norme — il naît mélodieusement de cette traversée. Aussi ne peut-il pas ne pas prendre en compte tous les aspects du réel et de ses légendes meurtrières : ce craquement de l’être, ce théâtre, cette fatale catastrophe de la mort en représentation, cet ultime artifice, cet ultime déni du jeu tragique de la communication et de la langue, qui ne dit que de dédire, et qui ne s’entend jamais que dans la mesure de ce qu’elle réussit à différer. La monstruosité qui n’est ni de « l’honnête homme », ni de « l’homme de bien », ni de « l’homme des sciences de l’homme », la monstruosité justement inhumaine de la poésie, du vers, consiste non pas à « éterniser » mais à mettre éternellement en présence (à mettre éternellement au présent) de ce que le tragique a, aussi, pour fonction de différer... C’est au passage de la norme prise dans la langue que se présentifie et se module le ululement mélodique, furieux plaisir, d’une joie, d’une méconnaissance in-humaine.
Une juste fureur s’empare de mon âme
Vous allez à l’autel, et moi, j’y cours Madame.
Si de sang et de mon le ciel est affamé,
Jamais de plus de sang ses autels n’ont fumé.
A mon aveugle amour tout sera légitime.
Le prêtre deviendra la première victime ;
Le bûcher par mes mains détruit et renversé ;
Dans le sang des bourreaux nagera dispersé ;
Et si dans les horreurs de ce désordre extrême
Votre père frappé tombe et périt lui-même,
Alors, de vos respects voyant les tristes fruits
Reconnaissez les coups que vous aurez conduits.
(Iphigénie, V, 2)
Achille expose ici en un éblouissant raccourci la précipitation en abîme des formes normatives et met progressivement en évidence leurs fissures — dressées les unes contre les autres, elles ne peuvent que précipiter la catastrophe dont chaque rime s’emploie à faire résonner, en chute, la constance, l’événement ponctuel... Le drame, l’horreur, le bonheur poétique, se nouent de ce que la rime actualise ce que l’accumulation des normes s’emploie à la fois à différer et à révéler dans sa précipitation... ce que la rime, toujours, une fois pour toutes, répète éternellement de la langue et de sa mort. Quelle que soit la posture qu’il adopte le héros, quelle que soit la convention héroïque, formelle, morale, psychologique, qu’il adopte, le héros est déjà, et de toujours, voué à la mort et au silence. Achille est dès le début de la tragédie explicitement (c’est-à-dire comme tout un chacun) condamné à mort.
On sait qu’à votre tête
Les Dieux ont d’Illion attaché la conquête ;
Mais on sait que pour prix d’un triomphe si beau,
Ils ont aux champs troyens marqué votre tombeau ;
Que votre vie ailleurs et longue et fortunée,
Devant Troie en sa fleur doit être moissonnée.
C’est donc un mort en sursis qui parle :
O grâce, ô rayon salutaire,
Viens me mettre avec moi d’accord ;
Et domptant par un doux effort
Cet homme qui t’est si contraire,
Fais ton esclave volontaire
De cet esclave de la mon.
(Cantique 3)
La tragédie d’Iphigénie terminée prépare, comme celle d’Athalie, une autre catastrophe. Et n’est-ce pas, dans cette déclaration d’Achille, la mort qui vient donner dimension à la norme héroïque ? Le mort habite le vivant (« Le mort mange le vif »), la mort est déjà morte dans la norme qui s’en défendant ne parvient qu’à la différer. Et, pour dire l’indicible (ce qui ne veut pas être entendu, ce qui ne peut pas être entendu), le poète s’engage à détruire la destruction, à renverser le renversement, brûler le bûcher, ensanglanter le sang et... voler la victime.
Le prêtre deviendra la première victime
Le bûcher par mes mains détruit et renversé
Dans le sang des bourreaux nagera dispersé.
Le désordre est à son comble et la vérité, « comme un cœur qu’on afflige », frémit et chante tout à côté (tout à côté « Le soleil s’est noyé dans son sang qui se fige »).
Et si, dans les horreurs de ce désordre extrême,
Votre père frappé tombe et périt lui-même,
Alors, de vos respects voyant les tristes fruits,
Reconnaissez les coups que vous aurez conduits.
Tout est dit de la norme et de ce qui l’habite (« de vos respects voyant les tristes fruits / Reconnaissez les coups que vous aurez conduits ! ») le gong mortel résonne et bat (Oui / fuis / aime ta haine et ris). Cela ne peut évidemment convenir ni à ces Messieurs Dames de Port Royal, ni à « l’honnête homme », ni au dieu jaloux de Bossuet. Le rire de Racine, le rire des Plaideurs troue la vérité : c’est de toucher et d’être touché par la souffrance qu’il s’inflige à lui-même dans sa langue que l’homme chante, qu’il rit et qu’il chante (l’heautontimorumenos « Au rire éternel condamné et qui ne peut plus sourire »).
Le rire de Racine, celui qui emporte en son chant les vers les plus tragiques, et celui des Plaideurs, brille d’éclats sombres et lumineux comme une rivière perlée. R. Picard écrit à juste titre des Plaideurs : « Il y a bien peu de passages qui appellent la détente d’un sourire : c’est l’explosion du gros rire de farce, ou bien le ricanement cynique de la satire sans espoir. Le seul trait commun entre la comédie de Racine et ses tragédies serait peut-être précisément une certaine méchanceté froide... » et encore « il (Racine) sait déchaîner un mouvement comique qui emporte le vers, le secoue, le disloque comme un accès de rire ». Et pourquoi les vers sur la Signature du Formulaire ne seraient-ils pas de Racine, du Racine qui confiera sa première pièce à Molière, du Racine de la comédie des Plaideurs, d’un Racine s’employant ainsi à
donner une des vérités de sa Lettre à l’auteur des Hérésies imaginaires
Contre Jansénius j’ai la plume à la main,
Je suis prêt à signer tout ce qu’on me demande.
Qu’il soit hérétique ou romain
Je veux conserver ma prébende.Quand j’écris pour mes intérêts
Et que je suis touché de près,
Je veux savoir ce que je signe ;
Mais dans ce nouveau cas, ce qui m’est ordonné
Ne touchant que la foi, soit humaine, soit divine
Je veux bien faire un blanc signé.
Ce rire étrange (et toujours d’une certaine façon étranger), grinçant, le plaisir du rythme et de la rime, le rire perlé du vers au moulin de la rime, et de ses entraînements, et du roulement de l’abîme, ce rire qui ne dit plus qu’incidemment le ridicule du monde et de la religion (voir les vers sur la dispute de Bossuet et de Fénelon sur le quiétisme), s’établit chez Racine en un retrait, qui fera aussi de lui le dévot historiographe du roi, et un homme de fondement. Retrait, espace réservé de « l’honnête homme » du XVIIe siècle : entrée, sortie et rentrée à Port-Royal, dans l’estime de Bossuet et dans la chambre du roi, avec en entracte, en coupe de vérité : rire, théâtre, poésie, tragédie, et ce rien de l’homme qui pourrait encore être entendu, qui a licence de résonner dans la prose oratoire et dans la nuit des cathédrales, mais qui ne peut s’exposer (hypocrite rimeur) qu’à être renoncé. Ce retrait que Baudelaire ne peut plus tenir et qu’il se doit en conséquence comme le reste de déclarer : « Faut-il vous dire, à vous qui ne l’avez pas plus deviné que les autres, que dans ce livre atroce, j’ai mis tout mon cœur, toute ma tendresse, toute ma religion (travestie), toute ma haine ? Il est vrai que j’écrirai le contraire, que je jurerai mes grands dieux que c’est un livre d’art pur, de singerie, de jonglerie ; et je mentirai comme un arracheur de dents » (A Ancelle, 18 fev. 1866).
Mais ce rire d’une hauteur ultime (se rire de la mort) n’assume, une fois encore, évidemment pas les mêmes misères (ni les mêmes formes de dénégation) au XVIIe et au XIXe siècle. Et si Racine peut être rapproché de Baudelaire, ce ne peut être jamais qu’à reconnaître à l’un et à l’autre la part poétique (« que la poésie française possède une prosodie mystérieuse et méconnue comme les langues latine et anglaise... », troisième projet de préface à la réédition des Fleurs du mal), la part du mal (cf la part de ce qui n’est scandaleusement, autrement scandaleusement, ni du bien, ni du mal) ; ce ne peut être que de ce qu’ils provoquent l’un et l’autre, et selon le compte de médiocrité du siècle, la haine ; de ce qu’en fin de compte ils ne sont pas plus l’un et l’autre de « l’honnête homme » ou de « l’homme de bien » que je ne suis de « l’homme des sciences de l’homme ».
Marcelin Pleynet, Fragments du choeur, 1984, p. 205-241.
 « Comment vivre ? Comment parler dans la dimension vive et retrouver en voisinage ce chœur vivant qui nous traverse par éclats ? Quelle mémoire, quelle parole nous séduit et nous cite dans le chant ? Tout ce qui fut écrit, tout ce qui fut dit dans cette langue, notre langue, résonne aujourd’hui en corps. Et notre mesure est cette disposition d’un corps de langue, d’une résurrection, d’un relèvement, d’un parfum, d’un chant, d’un tombeau vide (venez et voyez)... Tout ce que nous entendons et qui fut et qui vient et passe par l’oreille ; et en nous-même tout ce qui se dit dans les livres. Comment ne pas aimer cette partition de la langue, ces variantes que nous éveillons et qui nous justifient en un plaisir toujours nouveau, une lumière tracée dans le temps ? Comment ne pas soulever les questions qui portent cette traversée d’une lecture à l’autre, d’une écoute en obstacle ? Et qu’entendons-nous si nous n’entendons plus ce débat, cet ébat, cette poursuite dans la langue comme un art poétique : fragments d’un vaste chœur où la douleur du vécu (ici un ensemble de poèmes écrits à partir de la prise du pouvoir par les militaires en Pologne) et de l’actualité croise, en partition, l’emportement des lettres vives qui se composent, par exemple dans la singularité d’un accord, d’une "entente" avec les œuvres de Dante, de Shakespeare, de Bossuet, de Racine, de Mozart, de Baudelaire..., et brûlent dans l’ordonnance en clavier d’un nom. »
« Comment vivre ? Comment parler dans la dimension vive et retrouver en voisinage ce chœur vivant qui nous traverse par éclats ? Quelle mémoire, quelle parole nous séduit et nous cite dans le chant ? Tout ce qui fut écrit, tout ce qui fut dit dans cette langue, notre langue, résonne aujourd’hui en corps. Et notre mesure est cette disposition d’un corps de langue, d’une résurrection, d’un relèvement, d’un parfum, d’un chant, d’un tombeau vide (venez et voyez)... Tout ce que nous entendons et qui fut et qui vient et passe par l’oreille ; et en nous-même tout ce qui se dit dans les livres. Comment ne pas aimer cette partition de la langue, ces variantes que nous éveillons et qui nous justifient en un plaisir toujours nouveau, une lumière tracée dans le temps ? Comment ne pas soulever les questions qui portent cette traversée d’une lecture à l’autre, d’une écoute en obstacle ? Et qu’entendons-nous si nous n’entendons plus ce débat, cet ébat, cette poursuite dans la langue comme un art poétique : fragments d’un vaste chœur où la douleur du vécu (ici un ensemble de poèmes écrits à partir de la prise du pouvoir par les militaires en Pologne) et de l’actualité croise, en partition, l’emportement des lettres vives qui se composent, par exemple dans la singularité d’un accord, d’une "entente" avec les œuvres de Dante, de Shakespeare, de Bossuet, de Racine, de Mozart, de Baudelaire..., et brûlent dans l’ordonnance en clavier d’un nom. »Marcelin Pleynet.
Démarches - Fragments du choeur

VOIR AUSSI
Par Gérard-Julien Salvy
Avec Marcelin Pleynet
1ère diffusion : 21/04/1984
AUTRES PUBLICATIONS :
 L’infini 140 (spécial Marcelin Pleynet).
L’infini 140 (spécial Marcelin Pleynet).
 Marcelin Pleynet, Les grands entretiens d’art press (septembre 2017).
Marcelin Pleynet, Les grands entretiens d’art press (septembre 2017).
 Marcelin Pleynet, L’expatrié, Gallimard, coll. L’infini (octobre 2017).
Marcelin Pleynet, L’expatrié, Gallimard, coll. L’infini (octobre 2017).

- Marcelin Pleynet en avril 2013. Photo A.G.
Baudelaire et le songe d’Athalie
Remy de Gourmont
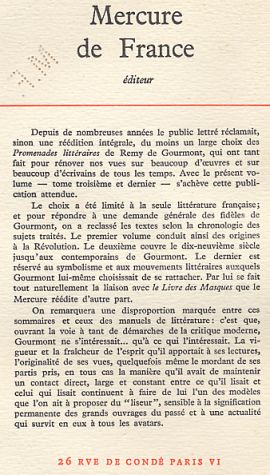 Que Baudelaire ait imité le songe d’Athalie et que cette imitation soit devenue les Métamorphoses du Vampire, voilà de quoi surprendre. Rien n’est pourtant plus véritable.
Que Baudelaire ait imité le songe d’Athalie et que cette imitation soit devenue les Métamorphoses du Vampire, voilà de quoi surprendre. Rien n’est pourtant plus véritable.
On sait que Baudelaire affectait d’admirer les poètes du grand siècle, et même Boileau ; mais on sait beaucoup de choses qui n’ont qu’une très faible apparence de vérité. Ce goût pour Boileau, pour Racine n’était pas, chez Baudelaire, une affectation, et il le prouva bien en écrivant ses poèmes dont la forme, très peu romantique, ne fut pas sans donner à Victor Hugo quelques inquiétudes. Il y avait autre chose dans les Fleurs du Mal qu’un « frisson nouveau », il y avait un retour au vers français traditionnel. Après les caprices orientaux, on revoyait des cavaliers bien assis sur un cheval solide, sûrs d’eux-mêmes et de leur monture, prêts à tous les exercices utiles ou esthétiques, nullement disposés à la vaine parade.
Jusque dans le malaise nerveux, Baudelaire garde quelque chose de sain ; on sent assez souvent l’effort que le poète s’impose pour garder l’équilibre, mais il y a équilibre. Ses poèmes sont composés. Il veut dire quelque chose et il le dit. Ses métaphores sont cohérentes ; surtout, elles sont visibles et donnent des visions logiques :
Sois sage, ô ma Douleur, et tiens-toi plus tranquille,
Tu réclamais le Soir ; il descend ; le voici :
Une atmosphère obscure enveloppe la ville,
Aux uns portant la paix, aux autres le souci.
(Recueillement)
Habitué des poètes raisonneurs du XVIIe siècle, il l’était aussi des théologiens et des moralistes catholiques. Cet homme, que les magistrats condamnaient tel qu’un monstre d’impiété et de luxure, s’agenouillait très sincèrement, après une belle débauche, pour demander pardon, et il acceptait le châtiment :
Soyez béni, mon Dieu, qui donnez la souffrance
Comme un divin remède à nos impuretés.
(Bénédiction)
Attribuer cette attitude à quelque besoin paradoxal de contradiction, ce serait avouer que l’on connaît bien mal Baudelaire. On n’a qu’à lire les Fusées et Mon cœur mis à nu, cahiers qu’il ne destinait pas sans doute à une publicité immédiate. La religiosité qu’il y avoue, pour lui seul, provisoirement, a même, par son ingénuité, quelque chose de pénible. Mais n’est-ce point déjà sensible dans les Fleurs du Mal ? Il y abuse vraiment de la morale chrétienne. Presque toujours, quand il a dit quelque chose d’un peu fort, il éprouve le besoin de s’en excuser par une conclusion morale. Cette faiblesse n’avait pas échappé à ses accusateurs publics. Ils disent, dans l’avant-propos de la condamnation :
« En ce qui concerne la prévention d’offense à la morale publique et aux bonnes mœurs :« Attendu que l’intention du poète, dans le but qu’il voulait atteindre et dans la route qu’il a suivie, quelque effort de style qu’il ait pu faire, quel que soit le blâme qui précède ou qui suit ses peintures, ne saurait détruire l’effet funeste des tableaux qu’il présente au lecteur et qui, dans les pièces incriminées, conduisent nécessairement à l’excitation des sens par un réalisme grossier et offensant pour la pudeur. »
En ouvrant pour une recherche, au tome deuxième, le Génie du Christianisme, je tombe sur le chapitre XI, Suite des Machines poétiques : Songe d’Énée, Songe d’Athalie. Je lis le Songe d’Énée, traduit par un des amis de Chateaubriand, sans doute Fontanes, et le morceau me paraît et d’une valeur nulle et d’une laide platitude. Cependant, confronté avec le Songe d’Athalie, il a cet intérêt d’en paraître le prototype. Mais Racine l’a beaucoup perfectionné, surtout en mettant en scène le revirement qui, dans Virgile, est antérieur au songe lui-même. Dans Racine, c’est un véritable tableau vivant : on voit la métamorphose. Le quantum mutatus ab illo s’opère sous les yeux du lecteur, qui en a la claire vision. Chateaubriand, dans toute cette partie de son livre, émule, presque malheureux, de La Harpe, rédige sur ce morceau de littérature artificielle un commentaire très serré, feint d’éprouver à cette lecture banale une intense émotion. C’est à peine s’il ose avouer combien il trouve supérieure, en cette rencontre, du moins, la poésie de Racine. Très soumis à la hiérarchie des admirations, il trouve « malaisé de décider ici entre Virgile et Racine ». Cependant il note le revirement, « une sorte de changement d’état, de péripétie, qui donne au songe de Racine une beauté qui manque à celui de Virgile ».
Ce revirement, Baudelaire, un jour qu’il relisait Athalie, en fut très frappé et, prenant la scène, l’incorporant dans un rêve de mauvais amour, il écrivit les Métamorphoses du vampire.
Transcrire les deux morceaux à la suite l’un de l’autre évitera beaucoup de remarques. Les voici :
C’était pendant l’horreur d’une profonde nuit ;
Ma mère Jésabel devant moi s’est montrée,
Comme au jour de sa mort pompeusement parée ;
Ses malheurs n’avaient point abattu sa fierté :
Même elle avait encor cet éclat emprunté,
Dont elle eut soin de peindre et d’orner son visage,
Pour réparer des ans l’irréparable outrage.
« Tremble, m’a-t-elle dit, fille digne de moi,
« Le cruel Dieu des Juifs l’emporte aussi sur toi !
« Je te plains de tomber dans ses mains redoutables
« Ma fille. » En achevant ces mots épouvantables
Son ombre vers mon lit a paru se baisser,
Et moi, je lui tendais les bras pour l’embrasser ;
Mais je n’ai plus trouvé qu’un horrible mélange
D’os et de chairs meurtris et traînés dans la fange,
Des lambeaux pleins de sang et des membres affreux,
Que des chiens dévorants se disputaient entre eux.
(Athalie, II, 5.)
Le poème de Baudelaire est en parallélisme parfait avec le poème de Racine. Tous les deux sont en trois actes (le troisième acte de Baudelaire ayant deux tableaux). Premier acte : description du lieu et de la figure qui apparaît ; deuxième acte : mouvement de sympathie vers l’apparition à laquelle on veut donner un baiser ; troisième acte : la métamorphose s’est accomplie pendant ce mouvement et l’on en voit le résultat. Bien entendu qu’il faut tenir pour un songe le récit de Baudelaire ; son caractère fantastique l’exige absolument, bien que le poète, pour augmenter l’impression d’effroi qu’il veut donner, présente la scène telle que réelle, c’est-à-dire telle que vue en état d’hallucination.
LES MÉTAMORPHOSES DU VAMPIRE
La femme, cependant, de sa bouche de fraise,
En se tordant ainsi qu’un serpent sur la braise
Et pétrissant ses seins sur le fer de son busc,
Laissait couler ces mots, tout imprégnés de musc :
« Moi, j’ai la lèvre humide, et je sais la science
De perdre au fond d’un lit l’antique conscience.
Je sèche tous les pleurs sur mes seins triomphants
Et fais rire les vieux du rire des enfants.
Je remplace, pour qui me voit nue et sans voiles,
La lune, le soleil, le ciel et les étoiles.
Je suis, mon cher savant, si docte aux voluptés,
Lorsque j’étouffe un homme en mes bras redoutés
Ou lorsque j’abandonne aux morsures mon buste,
Timide et libertine, et fragile et robuste,
Que sur ces matelas qui se pâment d’émoi
Les anges impuissants se damneraient pour moi ! »
Quand elle eut de mes os sucé toute la moelle,
Et que languissamment je me tournais vers elle
Pour lui rendre un baiser d’amour, je ne vis plus
Qu’une outre aux flancs gluants, toute pleine de pus !
Je fermai les deux yeux dans ma froide épouvante,
À mes côtés, au lieu du mannequin puissant
Qui semblait avoir fait provision de sang,
Tremblaient confusément des débris de squelettes,
Qui d’eux-mêmes rendaient le cri d’une girouette
Ou d’une enseigne, au bout d’une tringle de fer,
Que balance le vent pendant les nuits d’hiver.
(Les Épaves, édit. Lemerre, VI.)
Et voilà où mènent les voluptés illicites, ce que deviennent celles qui les procurent aux libertins et les plaisirs d’après que les libertins exténués trouvent dans leur lit cruel ! Le tableau de Racine, moins pittoresque, est supérieur par sa sobriété même. Faisant partie d’une action étendue et complexe, il ne porte pas de morale immédiate. Celui de Baudelaire est d’une moralité qui, encore que sarcastique, est fort saisissante ; elle ricane, pareille à la tête de mort qu’est devenue la tête ironiquement tendre de la docte créature, mais son ricanement est un avis, et que Baudelaire se donne à lui-même.
On a été frappé, je pense, par la similitude du mouvement pendant lequel s’opère la métamorphose. Les deux morceaux tournent exactement autour du même pivot :
... En achevant ces mots épouvantables,
Son ombre vers mon lit a paru se baisser
Et moi, je lui tendais les bras pour l’embrasser...Quand elle eut de mes os sucé toute la moelle
Et que languissamment je me tournais vers elle
Pour lui rendre un baiser d’amour...
Il est assez difficile de caractériser par un terme précis ce genre d’imitation. Il n’y a ni plagiat, ni pastiche, ni emprunt. Ce n’est pas la transposition du tragique au comique, ou l’inverse. Tout au plus pourrait-on y voir une sorte de parodie, mais tout à fait inavouée, et que Baudelaire pouvait croire impénétrable.
La poésie classique étant toujours la nourriture première des enfants dans les collèges, il est tout naturel que des réminiscences de Racine, de Boileau se retrouvent dans les œuvres en apparence les plus divergentes de la tradition. Analysé à ce point de vue, Victor Hugo lui-même paraîtrait plein de ressouvenirs, jusqu’au milieu de sa plus superbe originalité. L’abbé Delille fut son maître, et c’est pourquoi tant de morceaux fulgurants du grand poète ne sont, en somme, que du Delille apocalyptique.
Au dix-septième siècle, l’imitation des anciens était de commande. Emprunter des passages entiers de Virgile ou de Sénèque, c’était enrichir la langue française. Tout en ignorant du Bellay, on suivait à la lettre ses conseils ingénus. Mais on imitait aussi ses devanciers immédiats. Corneille prend à la belle Sophonisbe de Mairet les imprécations de Camille ; Racine se souvient, dans Phèdre, de l’Hippolyte, de Gilbert, et, dans Athalie, du Triomphe de la Ligue, de Nérée. C’est à cette obscure tragédie qu’il emprunte le fameux : « Je crains Dieu, cher Abner... », et les célèbres petits oiseaux auxquels Dieu donne leur pâture. Cette niaiserie du poète devenu dévot n’est pas plus ridicule dans Nérée que dans Racine ; elle y est même mieux à sa place et on regrette qu’elle n’y sommeille pas toujours. Il semble que la tactique des emprunteurs volontaires soit de s’attaquer aux inconnus. Elle est adroite ; le profit est plus sûr et le danger bien moindre à voler les pauvres que les riches. Les emprunteurs involontaires s’adressent au contraire aux riches ; aussi cela ne leur profite guère, car la raison du plus fort est toujours la meilleure.
Baudelaire, métamorphosant le songe d’Athalie, a-t-il agi consciemment, a-t-il obéi à une réminiscence ? Il est très difficile d’en décider. Peut-être pourrait-on supposer que la pièce en question, le Vampire, est comme une suite à la pièce qui débute ainsi :
Une nuit que j’étais près d’une affreuse Juive.
La liaison des idées pouvait le conduire à cette Athalie, le songe lui revenir à la mémoire...
Mais il suffit d’avoir conté cette anecdote littéraire. Ce n’est qu’une curiosité.
Remy de Gourmont, 1905. Promenades littéraires , 2e série, Mercure de France, 1906.
[1] Premier volet : « Vers et proses I : Sur une lecture de Bossuet ».
[2] Bataille : « Il y a quinze ans j’ai publié une première fois ce livre. Je lui donnai alors un titre obscur : La Haine de la Poésie. Il me semblait qu’à la poésie véritable accédait seule la haine. La poésie n’avait de sens puissant que dans la violence de la révolte. Mais la poésie n’atteint cette violence qu’évoquant l’Impossible. À peu près personne ne comprit le sens du premier titre, c’est pourquoi je préfère à la fin parler de l’Impossible.
Il est vrai, ce second titre est loin d’être plus clair.
Mais il peut l’être un jour... » Préface à la 2e édition.
Bataille qui aimait Baudelaire et Rimbaud a-t-il pensé au texte de ce dernier intitulé L’Impossible ?
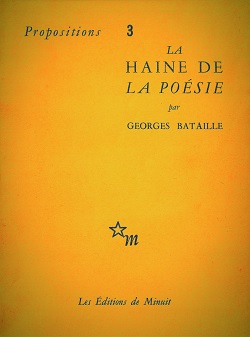
- Edition de 1947 (A.G.)
[3] Voir l’anecdote que rapporte F. Mauriac : « A Auteuil, chez Boileau, Valincourt, l’entendit, un soir, lire l’Œdipe de Sophocle, à livre ouvert, avec une telle véhémence que toute l’assistance haletait, et un jour qu’il déclamait pour lui seul, aux Tuileries, les vers de Mithridate, des ouvriers le crurent fou, prêt à se jeter dans un bassin... »
[4] « Le Racine qui se tait est un Racine sage... Il se marie parce qu’il renonce à la poésie... » T. Maulnier.
[5] « Il semble que dans Phèdre l’équilibre soit rompu au profit de poème » (Th. Maulnier).
[6] Bataille interviendra sommairement sur Racine dans une note publiée par Critique en juin 1949. Note expéditive : « Il importe à ce point que le caractère de Racine ait été de peu de sens, anodin, et que le destin l’ait agité d’un libertinage à une dévotion très ordinaire. Il faut prendre en ce sens l’égoïsme de sa jeunesse, qui ne le sort d’aucune façon de la médiocrité. » —
« La tragédie de Racine assuma la plus profonde féminité, se déroba et jamais ne fut en proie que malgré elle aux désordres qu’elle exigeait », et encore « la vie de Racine tire sans nul doute d’un caractère peu compatible avec le tragique son aptitude à l’exprimer, non par des formules intelligibles, mais par un mouvement d’une ampleur incomparable. Bien entendu ce caractère neutre ne pouvait suffire, mais c’est lui qui ouvre le champ à la puissance multipliée des cris. Ces échappées de la passion demandent un monde où la passion est reçue du dehors comme un fléau et comme un monstre, où le langage discursif — la conscience — ne peut lui accorder sa place ». Ce qui est déjà beaucoup dire tout en faisant bon marché de l’histoire des détours et des aventures d’une langue sans laquelle assurément Chateaubriand et Baudelaire et Proust ne seraient pas ce qu’il sont.
Georges Bataille, Racine, Critique, juin 1949. pdf





 Version imprimable
Version imprimable



 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?


