« On ignore trop souvent que c’était au nom du socialisme qu’il [Orwell] avait mené sa lutte antitotalitaire, et que le socialisme, pour lui, n’était pas une idée abstraite, mais une cause qui mobilisait tout son être, et pour laquelle il avait d’ailleurs combattu et manqué se faire tuer durant la guerre d’Espagne. »
Simon Leys, Orwell ou l’horreur de la politique, 1984 [1].
« Si Orwell plaidait pour qu’on accorde la priorité au politique, c’était seulement afin de mieux protéger les valeurs non politiques. »
Bernard Crick, Orwell, une vie.
« L’opinion courante est de croire qu’Orwell était finalement un pur et simple anticommuniste. Mais pas du tout : son expérience auprès du prolétariat anglais, c’est-à-dire au contact de ce qu’il appelle « la décence », devrait nous ouvrir les yeux. [...] Orwell a été, et est resté de gauche, et c’est ce qui le rend irrécupérable. Il agaçait ses amis, par exemple Cyril Connolly : "Il ne pouvait pas se moucher sans moraliser sur les conditions de travail dans l’industrie des mouchoirs." On ne pense pas assez à l’industrie des mouchoirs [2]. »
« Comme l’écrit Jean-Claude Michéa dans son excellent essai [Orwell, anarchiste tory, Ed. Climats.], "le désir d’être libre ne procède pas de l’insatisfaction ou du ressentiment, mais d’abord de la capacité d’affirmer et d’aimer, c’est-à-dire de s’attacher à des êtres, à des lieux, à des objets, à des manières de vivre". »
Philippe Sollers, Orwell, à gauche toute !
Dans notre dossier Orwell, cet anarchiste conservateur, nous avons longuement présenté les essais du philosophe Jean-Claude Michéa. Celui-ci vient de publier un nouveau livre aux éditions Flammarion : La double pensée, sous-titré Retour sur la question libérale.
Pour Michéa, l’actualité récente — la crise financière et économique — oblige à repenser le libéralisme, cette forme moderne du capitalisme. Mais la crise tout aussi évidente de la gauche [3], nécessite un effort plus grand encore : repenser ce que pourrait être une alternative socialiste (pas du tout contradictoire avec l’anarchisme).
Si cette perspective a un sens il est bon de revenir sur ce que Jean-Claude Michéa, à la suite de George Orwell, appelle « la morale commune » ou la « common decency ».
Jean-Claude Michéa, La double pensée
4ème de couverture -

- En couverture : La Reproduction interdite de René Magritte, 1937.
Le libéralisme est, fondamentalement, une pensée double : apologie de l’économie de marché, d’un côté, de l’État de droit et de la "libération des moeurs" de l’autre. Mais, depuis George Orwell, la double pensée désigne aussi ce mode de fonctionnement psychologique singulier, fondé sur le mensonge à soi-même, qui permet à l’intellectuel totalitaire de soutenir simultanément deux thèses incompatibles.
Un tel concept s’applique à merveille au régime mental de la nouvelle intelligentsia de gauche. Son ralliement au libéralisme politique et culturel la soumet, en effet, à un double bind affolant. Pour sauver l’illusion d’une fidélité aux luttes de l’ancienne gauche, elle doit forger un mythe délirant : l’idéologie naturelle de la société du spectacle serait le "néoconservatisme", soit un mélange d’austérité religieuse, de contrôle éducatif impitoyable, et de renforcement incessant des institutions patriarcales, racistes et militaires. Ce n’est qu’à cette condition que la nouvelle gauche peut continuer à vivre son appel à transgresser toutes les frontières morales et culturelles comme un combat "anticapitaliste".
La double pensée offre la clé de cette étrange contradiction. Et donc aussi celle de la bonne conscience inoxydable de l’intellectuel de gauche moderne.
Le premier entretien de La double pensée a été publié dans Le Nouvel Observateur du 27 septembre 2007 sous le titre Y a-t-il une vie après le libéralisme ?.
Entretien avec Jean-Claude Michéa
Jean Cornil a rencontré le philosophe français Jean-Claude Michéa, chez lui, à Montpellier.
Philosophe « inclassable », Jean-Claude Michéa a un parcours singulier. Venant d’un milieu communiste, anarchiste, penseur critique du libéralisme et singulièrement du libéralisme culturel qu’il assimile à la gauche. Dans cette émission, Jean Cornil ira à la rencontre de ce philosophe étonnant, très éloigné des schémas traditionnels de la pensée politique.
Extraits : Orwell et la "common decency"
« Le libéralisme exclut, par définition, toute idée d’une morale commune (« chacun a sa propre morale » est probablement l’idée que l’on rencontre le plus souvent dans les copies du baccalauréat — signe que la jeunesse assimile beaucoup plus facilement les leçons du Système que celle de ses professeurs). Naturellement, quand je parle ainsi de "morale commune", je ne fais que reprendre cette notion de common decency qui définissait, selon Orwell, le coeur de toute révolte socialiste.
C’est un point sur lequel il me paraît important de s’arrêter un instant, car la stratégie habituelle des libéraux — surtout à gauche — est de transformer immédiatement toute référence à des valeurs morales en un appel à restaurer l’"ordre moral" ou à instituer une société totalitaire. Or ce que Orwell appelle la common decency n’a évidemment rien à voir, de près ou de loin, avec ce que j’ai appelé par ailleurs une "idéologie du Bien" (ou encore une "idéologie morale") ; c’est-à-dire avec ces constructions métaphysiques arbitraires, généralement liées aux dogmes d’une église ou à la ligne d’un parti, et qui ont toujours servi, dans l’histoire, à cautionner le pouvoir d’une élite ou d’une inquisition quelconque. Une idéologie du Bien peut, ainsi, décréter que l’homosexualité représente un péché contre la volonté de Dieu ou — variante stalinienne — une déviance petite bourgeoise. On saisit aussitôt ce qui distingue ce genre de catéchisme moralisateur des invitations traditionnelles à la bienveillance, à l’entraide ou à la générosité qui ont toujours constitué l’essence même de la common decency. Il est, en effet, évident qu’il ne peut exister aucune relation a priori entre l’orientation sexuelle d’un individu et son comportement moral effectif : tel "homosexuel" (en admettant qu’il tienne à se définir par ce seul aspect de sa personnalité) sera profondément généreux et et honnête, tandis qu’à l’inverse, son voisin "hétérosexuel", pourra se montrer égoïste et immature — uniquement soucieux d’accumuler pouvoir, richesse et "célébrité". La volonté orwellienne de réenraciner le projet socialiste dans les valeurs traditionnelles de la common decency se situe donc aux antipodes du moralisme qui caractérise les idéologies du Bien.
— Comment peut-on traduire en français ce terme de « common decency » ?
Le terme est habituellement traduit par celui d’ « honnêteté élémentaire », mais le terme de « décence commune » me convient très bien. Quand on parle de revenus "indécents" ou, à l’inverse, de conditions de vie "décentes", chacun comprend bien, en général (sauf, peut-être, un dirigeant du Medef) qu’on ne se situe pas dans le cadre d’un discours puritain ou moralisateur. Or c’est bien en ce sens qu’Orwell parlait de « société décente ». Il entendait désigner ainsi une société dans laquelle chacun aurait la possibilité de vivre honnêtement d’une activité qui ait réellement un sens humain. Il est vrai que ce critère apparemment minimaliste implique déjà une réduction conséquente des inégalités matérielles. En reprenant les termes de Rousseau, on pourrait dire ainsi que dans une société décente « nul citoyen n’est assez opulent pour pouvoir en acheter un autre, et nul n’est assez pauvre pour être contraint de se vendre [4] ». Une définition plus précise des écarts moralement acceptables supposerait, à coup sûr, une discussion assez poussée. Mais, d’un point de vue philosophique, il n’y a là aucune difficulté de principe.
Note : Orwell avait d’ailleurs sur la question une position ouverte et pragmatique. « Il est vain de souhaiter, dans l’état actuel de l’évolution du monde — écrit-il ainsi dans Le Lion et la Licorne — que tous les êtes humains possèdent un revenu identique. Il a été maintes fois démontré que, en l’absence de compensation financière, rien n’incite les gens à entreprendre certaines tâches. Mais il n’est pas nécessaire que cette compensation soit très importante. Dans la pratique, il sera impossible d’appliquer une une limitation des gains aussi stricte que celle que j’évoquais. Il y aura toujours des cas d’espèce et des possibilités de tricher. Mais il n’y a aucune raison pour qu’un rapport de un à dix ne représente pas l’amplitude maximum admise. Et à l’intérieur de ces limites, un certain sentiment d’égalité est possible. Un homme qui gagne trois livres par semaines et celui qui en perçoit mille cinq cent par ans peuvent avoir l’impression d’être des créatures assez semblables [can feel themselves fellow creatures] ce qui est inenvisageable si l’on prend le duc de Westminster et un clochard de l’Embankment. »
Essais, Articles, Lettres, vol. 2, éditions Ivrea/L’Encyclopédie des nuisances, 1996, p. 126.

- Michéa avec Alain Caillé du MAUSS
J’ai récemment appris qu’il existait à Paris un palace réservé aux chiens et aux chats des riches. Ces charmantes petites bêtes — que vous aimez sans doute autant que moi — s’y voient servir dans des conditions parfaitement surréalistes (et probablement humiliantes pour les employés qui sont à leur disposition) une nourriture d’un luxe incroyable. Le coût de ces prestations est, comme on s’en doute, astronomique. Eh bien, je suis persuadé que dans un monde où des milliers d’êtres humains meurent chaque jour de faim — et où certains, dans nos sociétés occidentales, ne disposent pas d’un toit pour dormir, alors même qu’ils exercent un travail à temps complet —, la plupart des gens ordinaires s’accorderont à trouver une telle institution parfaitement indécente. Et il en irait probablement de même si j’avais pris comme exemple le salaire des vedettes du football professionnel ou des stars politiquement correctes du show-biz. Or pour fonder de tels jugements, il est certain que nous n’avons pas besoin de théorisations métaphysiques très compliquées. Une théorie minimale de la common decency suffirait amplement. Dans son Essai sur le don, Mauss en a d’ailleurs dégagé les conditions anthropologiques universelles : le principe de toute moralité (comme de toute coutume ou de tout sens de l’honneur) c’est toujours — observe-t-il — de se montrer capable, quand les circonstances l’exigent, de « donner, de recevoir et de rendre ».
Note : Si on accepte de voir dans la morale commune moderne (ou common decency) une simple réappropriation individuelle des contraintes collectives du don traditionnel (tel que Marcel Mauss en a dégagé les invariants anthropologiques) on pourra assez facilement en définir les maximes générales : savoir donner (autrement dit, être capable de générosité) ; savoir recevoir (autrement dit, savoir accueillir un don et non comme un dû ou un droit ; savoir rendre (autrement dit, être capable de reconnaissance et de gratitude). On pourra également en déduire les fondements moraux de toute éducation véritable (que ce soit dans la famille ou à l’école) : ils se résumeront toujours, pour l’essentiel) à l’idée qu’à l’enfant humain tout n’est pas dû (contrairement à ce qu’il est initialement porté à croire) et qu’en conséquence, il est toujours nécessaire de lui enseigner, sous une forme compatible avec sa dignité, que le monde entier n’est pas à son service (sauf, bien entendu, si le projet explicite des parents est de faire de leur enfant un exploiteur ou un politicien — ou, d’une manière plus générale, un manipulateur et un tapeur). Il suffirait, d’ailleurs, d’inverser ces principes socialistes pour obtenir automatiquement les axiomes de toute éducation libérale (et notamment l’idée décisive que l’enfant doit être placé en permanence au centre de tous les processus éducatifs).
— ... C’est aussi le simple bon sens, non ?
Bien sûr. Il arrive d’ailleurs un moment où les revenus des plus riches atteignent de tels sommets qu’il finissent presque par apparaître encore plus absurdes qu’indécents. Chez Orwell, la common decency et le common sense (c’est-à-dire le « bon sens ») sont d’ailleurs intimement liés. Dans son essai sur James Burnham, il souligne, ainsi, qu’il n’était pas nécessaire d’avoir fait de brillantes études universitaires pour comprendre qu’Hitler et Staline n’étaient pas des individus recommandables. Il suffisait pour cela — écrit-il — d’un minimum de sens moral. Si tant d’intellectuels — parmi les plus brillants du XXe siècle — ont donc cédé aussi facilement à la tentation totalitaire — au point d’en perdre tout bon sens et d’écrire des textes hallucinants — ce n’est certainement pas parce que l’intelligence ou les outils philosophiques leur faisaient défaut (les intellectuels français les plus délirants ont, du reste, très souvent été formés à l’École normale supérieure ; c’est presque une marque de fabrique). En réalité — nous dit Orwell — il faut rechercher l’explication de leur folie politique dans leur manque personnel de common decency — manque qui a forcément à voir avec l’égoïsme, l’immaturité et le besoin de s’imposer aux autres (c’est, d’ailleurs, la raison pour laquelle ce genre d’intellectuels éprouve traditionnellement un mépris sans limites pour la morale commune, supposée être "petite-bourgeoise" ou "judéo-chrétienne"). Dès que quelqu’un cède au délire idéologique (qu’on songe au culte hystérique dont Mao — l’un des plus grands criminels de l’histoire moderne — a pu être l’objet), on peut donc être quasiment sûr que l’on trouvera les clés de sa folie intellectuelle en observant la façon concrète dont il se comporte avec les autres dans sa propre vie quotidienne. Les fanatiques et les inquisiteurs (ceux que Dostoïevski appelait les « possédés ») sont presque toujours de grands pervers. Et ce sont aussi, paradoxalement, de grands donneurs de leçons. »
Entretien à Contretemps / Radio libertaire,
in La double pensée (Flammarion Coll. Champs essais, p. 156-161).
Présentation et discussion de la thèse centrale de l’ouvrage
La double pensée du libéralisme : économique et culturel
L’ouvrage se présente comme un recueil d’entretiens et de textes, d’origines diverses, augmenté de notes. La thèse de l’auteur est la suivante : il récuse l’analyse selon laquelle le libéralisme économique aurait pour pendant un néoconservatisme du point de vue des moeurs. Au contraire, pour lui, le libéralisme se présente comme une double pensée dont l’un des versants est le libéralisme économique et l’autre le libéralisme culturel. Il reproche à la nouvelle gauche des années 70 et à la gauche actuelle, dans son sillage, d’avoir détourné son projet du socialisme et de la démocratie radicale (entendue comme critique de la représentation) vers le libéralisme culturel.
Pour sa part, l’auteur considère que le projet initial de la gauche se caractérise à la fois par le socialisme en économie, la démocratie radicale en politique, et la common decency en matière de moeurs. Cette notion désigne, pour Michéa, à la suite d’Orwell, la morale spontanée des classes populaires faites de vertus traditionnelles telles que la solidarité, l’honnêteté, la loyauté, la générosité....
Discussion des thèses de l’auteur
Je vais tenter d’expliquer les raisons pour lesquelles je ne partage pas la thèse de Jean-Claude Michéa.
Le libéralisme culturel : une expression pour deux signifiés distincts
Il me semble que l’auteur a raison lorsqu’il met en avant, au sein du libéralisme, l’existence d’un versant qu’il qualifie de libéralisme culturel. Celui-ci prend sa source dans la tolérance libérale et la thèse selon laquelle dans les sociétés ouvertes actuelles, qui ne forment plus des communautés, mais qui sont caractérisées par l’individualisme et le multiculturalisme, la politique ne peut pas fixer de règles en matière de moeurs, mais doit laisser chacun choisir librement le mode de vie et les valeurs auxquels il adhère. C’est ce que l’on appelle également le pluralisme libéral.
Néanmoins, le libéralisme culturel désigne en réalité également autre chose. Cette expression sert à dénommer une évolution sociologique qui se caractérise par : une plus grande liberté des moeurs, en particulier sexuelle, une remise en cause des rôles traditionnels des hommes et des femmes, une plus grande acceptation de l’homosexualité... Ces évolutions ont été revendiquées et accompagnées de mouvements plutôt portés par des personnes issues des classes moyennes. C’est ce qu’on a appelé les nouveaux mouvements sociaux.
Diversité des théories féministes, anti-racistes et d’émancipation individuelle
Le problème selon moi, c’est que Jean-Claude Michéa assimile les deux phénomènes. La pensée libérale et les nouveaux mouvements sociaux ne se confondent pas. Sous ces nouveaux mouvements sociaux, identifiés à la nouvelle gauche, on peut distinguer plusieurs courants.
Il faut à mon avis distinguer par exemple libération sexuelle et liberté des moeurs d’une part et d’autre part féminisme ou anti-racisme par exemple. Le féminisme et l’anti-racisme sont eux-mêmes composés de plusieurs courants. Si on prend le féminisme, il existe certes un courant féministe libéral-égalistariste, mais également par exemple des courants féministes radicaux dont certains peuvent eux-mêmes se revendiquer d’une analyse matérialiste. Il est exact que certaines féministes se sont appuyées sur l’égalitarisme formel du libéralisme pour revendiquer l’égalité en droit des femmes et des hommes. Mais il existe des courants, qui comme le féminisme matérialiste, ont centré leur analyse sur la critique de l’exploitation domestique des femmes.
S’il faut distinguer féminsme ou anti-racisme et liberté des moeurs, c’est qu’il peut y avoir une antinomie entre ces courants. Par exemple, il est exact que le mouvement des femmes peut sembler aller dans le sens de la libération sexuelle lorsqu’il réclame la contraception et le droit à l’avortement. Mais sa relation à la libération sexuelle est plus ambiguë lorsque ce mouvement critique la pornographie ou la libéralisation de la prostitution.
La revendication de la libération des moeurs et de la libération sexuelle inclut certaines tendances du libéralisme, mais elles ne se limitent pas à ces courants. Il y a en particulier un individualisme aristocratique et esthète qui critique la morale judéo-chrétienne et le puritanisme bourgeois au nom d’un anti-conformisme refusant de se plier au moeurs dominantes. Cet individualisme n’a rien à voir avec l’individualisme abstrait et sans qualité du libéralisme. Il est possible de voir chez Sade, Nietzsche, Bataille, Deleuze ou Foucault par exemple des traces d’une telle conception.
En ce qui concerne la pensée anarchiste ou libertaire, il me semble qu’elle essaie de concilier socialisme, démocratie directe et émancipation individuelle. C’est parce que les libertaires pensent conjointement égalité économique et liberté individuelle ou liberté individuelle et liberté politique comme participation, qu’ils se différencient du libéralisme.
Common decency et conservatisme
Que penser à l’inverse de la common decency que nous propose Michéa ? Il est tentant d’opposer à Michéa une fable politique, à la manière d’Orwell dans La ferme des animaux, pour décrire la vision que nous inspire le socialisme de Michéa (à défaut de savoir si c’est également celui que nous propose Orwell).
Ce socialisme, ce serait celui d’hommes et de leurs familles vivant dans de petites communautés. Ici, on n’est pas riche, on travaille dur, mais les gens sont solidaires. Les habitants de ces communautés sont certes un peu rudes, mais ils sont honnêtes.
Les conseils des hommes et des femmes dirigent la cité en démocratie directe. Les femmes sont respectées, elles sont les égales des hommes. Mais chacun occupe sa place bien définie. Les hommes sont de bons pères et de bons maris, les femmes de bonnes épouses et de bonnes mères. Il n’est pas bien vu ici d’être volage, bisexuel ou transgenre. Les homosexuels sont acceptés lorsqu’ils aspirent à fonder une famille et à respecter les bonnes moeurs communes.
Dans ces communautés, on n’est pas raciste, on fait bon accueil à l’étranger de passage. L’hospitalité fait partie de la common decency. Mais on se méfie des étrangers, on n’aime pas trop le risque que de nouvelles idées, de nouvelles manières de vivre, viennent troubler les valeurs traditionnelles de la communauté. De manière générale, on n’aime pas trop par ici les anticonformistes ou les excentriques.
Lorsque Michéa décrit sa conception du socialisme, c’est ce type de société que j’imagine. La common decency, les valeurs traditionnelles des classes populaires concernant les femmes, les minorités sexuelles ou les étrangers, je ne suis pas en effet certaine qu’elles soient celles auxquelles j’aspire. Elles me semblent dessiner les traits d’une société conservatrice du point de vue des moeurs. Or, comme je l’ai montré, d’autres courants que le libéralisme ont pu porter la revendication d’une émancipation individuelle contre le conservatisme, en particulier des morales religieuses, qui peuvent traverser aussi bien la bourgeoisie que les classes populaires.
Néanmoins, quelque soit mon désaccord avec la thèse de l’auteur, celle-ci a au moins pour mérite de donner à penser et de susciter la discussion.
Irène Pereira, Iresmo

- Jean-Claude Michéa
« Le livre de Jean-Claude Michéa sur George Orwell doit vous être indispensable » écrit Sollers. N’ayons pas peur d’élargir le propos : il faut lire les livres de Jean-Claude Michéa. C’est irritant, décapant, souvent à contre-courant, discutable, toujours stimulant.
Le philosophe publiait l’an dernier L’empire du moindre mal, essai sur la civilisation libérale (Editions Climats).
"l’Empire du moindre mal". Extraits
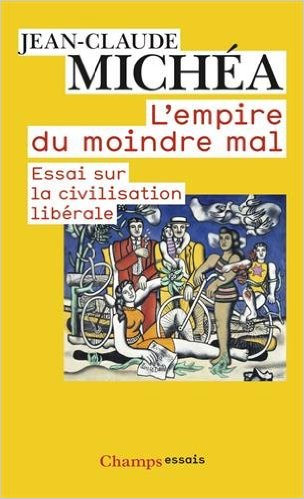 La prostitution vue par Catherine M.
La prostitution vue par Catherine M.
« À partir du moment où l’on refuse de fonder son jugement sur une critique de la marchandisation du corps (puisqu’il s’agit d’une philosophie particulière et, qui plus est, anticapitaliste) il est difficile de ne pas suivre le juriste libéral Daniel Borillo lorsqu’il en vient à conclure : « L’État n’a pas à promouvoir une morale sexuelle spécifique sous peine de devenir lui-même immoral. La personne adulte est la seule capable de déterminer ce qui lui convient (...). De quel droit l’État interdirait-il à une personne la faculté d’avoir des relations sexuelles moyennant rétribution et de faire de cela sa profession habituelle ? » Cette analyse juridique imparable, du moins si l’on tient les dogmes fondateurs du libéralisme pour sacrés, offre ainsi une assise idéologique blindée à la position des « féministes » libérales, lorsqu’elles proclament sous la plume de Marcela Iacub et de Catherine Millet : « En tant que femmes et féministes nous nous opposons à ceux qui prétendent dire aux femmes ce qu’elles doivent faire de leur corps et de leur sexualité. Nous nous opposons à ceux qui s’acharnent à réprimer l’activité prostitutionnelle au lieu de chercher à la déstigmatiser, afin que celles qui ont choisi ce qu’elles considèrent comme un authentique métier, puissent l’exercer dans les meilleures conditions possibles ». Ce schéma argumentatif assez rustique peut, naturellement, être étendu à toutes les revendications concevables, y compris les plus contraires au bon sens ou à la common decency, comme l’exemple des États-Unis en offre la démonstration quotidienne. Il suffit, pour cela, de savoir manier, même de façon très approximative, ces techniques de la « déconstruction », que leur heureuse simplicité conceptuelle met désormais à la portée de n’importe qui (même d’un lecteur de « Libération ») et qui permettent, sans trop d’efforts intellectuels, de transformer tous les scrupules éthiques possibles en autant de tabous arbitraires et historiquement déterminés. » (p.40-41) [5]
Le populisme expliqué à Philippe Torreton
« Dans le « Figaro magazine » du 6 janvier 2007, Alain-Gérard Slama écrit que « les deux valeurs cardinales sur lesquelles repose la démocratie sont la liberté et la croissance ». C’est une définition parfaite du libéralisme. À ceci près, bien sûr, que l’auteur prend soin d’appeler « démocratie » ce qui n’est, en réalité, que le système libéral, afin de se plier aux exigences définies par les « ateliers sémantiques » modernes (on sait qu’aux États-Unis, on désigne ainsi les officines chargés d’imposer au grand public, à travers le contrôle des médias, l’usage des mots le plus conforme aux besoins des classes dirigeantes). Ce tour de passe-passe, devenu habituel, autorise naturellement toute une série de décalages très utiles. Si, en effet, le mot « démocratie » doit être, à présent, affecté à la seule définition du libéralisme, il faut nécessairement un terme nouveau pour désigner ce « gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple » où chacun voyait encore, il y a peu, l’essence même de la démocratie. Ce nouveau terme, choisi par les ateliers sémantiques, sera évidemment celui de « populisme ». Il suffit, dès lors, d’assimiler le populisme (au mépris de toute connaissance historique élémentaire) à une variante perverse du fascisme classique, pour que tous les effets désirables s’enchaînent avec une facilité déconcertante. Si l’idée vous vient, par exemple, que le Peuple devrait être consulté sur tel ou tel problème qui engage son destin, ou bien si vous estimez que les revenus des grands prédateurs du monde des affaires sont réellement indécents, quelque chose en vous doit vous avertir immédiatement que vous êtes en train de basculer dans le « populisme » le plus trouble, et par conséquent, que la « Bête immonde » approche de vous à grands pas. En « citoyen » bien élevé (par l’industrie médiatique), vous savez alors aussitôt ce qu’il vous reste à penser et à faire. De là, évidemment, les Charles Berling et les Philippe Torreton. » (p.85-86)

« La Bourse ou la vie ! »
« Une société qui se présente comme « la moins mauvaise possible », tend logiquement à fonder l’essentiel de sa propagande sur l’idée qu’elle est là pour nous protéger de maux infiniment pires. C’est pourquoi, comme le fait remarquer Guy Debord dans ses « Commentaires sur la société du spectacle » (Editions Gérard Lebovici, 1988) une société libérale s’arrange généralement pour « être jugée sur ses ennemis plutôt que sur ses résultats ». C’est, par conséquent, toujours un drame idéologique pour elle, que de voir disparaître, avec le temps, telle ou telle figure historique du Mal absolu (comme avec la chute du Mur de Berlin, par exemple). Et comme la place du pire, ne doit jamais rester vide très longtemps, la propagande libérale se trouve dans l’obligation perpétuelle d’en découvrir de nouvelles incarnations, au besoin, cela va sans dire, en les fabriquant de toutes pièces. » (note de la p.93)
Quand Nicolas « liquide » 68...
« Si, par définition, la gestion libérale du politique doit faire abstraction de toute considération morale ou religieuse, elle inclut cependant, comme toute gestion digne de ce nom, une stratégie de l’image et de la communication. Et comme les classes populaires semblent demeurer exagérément sensibles à l’idée prémoderne selon laquelle la politique devrait respecter un certain nombre de valeurs, les politiciens libéraux se trouvent donc régulièrement contraints d’habiller la rationalité mathématique de leur programme du manteau douteux de l’ancienne morale. D’où le spectacle, toujours insolite (notamment lors des comédies électorales) de ces défenseurs intransigeants du Marché, obligés de prononcer, la main sur le c ?ur, les éloges les plus incongrus du lien familial, de la solidarité envers les plus démunis, de la responsabilité écologique ou du sens civique, alors même que ce Marché, dont ils travaillent sans relâche à étendre l’empire, ne peut fonctionner efficacement, comme ils sont les premiers à le savoir, qu’en sapant continuellement toutes ces dispositions. Ces bouffonneries nécessaires ne surprendront aucun lecteur de Machiavel. [...] On admirera tout particulièrement la charge de Nicolas Sarkozy, lors de sa campagne électorale de 2007, contre ces « héritiers de mai 68 » qui « avaient proclamé que tout était permis, que l’autorité c’était fini, que la politesse c’était fini, que le respect c’était fini, qu’il n’y avait plus rien de grand, plus rien de sacré, plus rien d’admirable, plus de règles, plus de normes, plus d’interdits » [6]. Surtout si on la rapproche de ses propres confidences, livrées dans le cadre, il est vrai, beaucoup plus intime d’un entretien avec Michel Onfray : « L’intérêt de la règle, de la limite, de la norme, c’est justement qu’elles permettent la transgression. Sans règles, pas de transgression. Donc pas de liberté. Car la liberté, c’est de transgresser. » (« Philosophie magazine », avril 2007). (p.113-114)
Orwell et la common decency
Ce cycle du don qui définit, en un sens, le "moment fondateur de la société", ne doit naturellement pas être confondu avec une manifestation de la morale au sens strict du terme. Mais d’une certaine manière, comme le remarque Jacques T. Godbout, on peut considérer qu’"il en est le fondement". Ce que George Orwell appelle la common decency ne trouve ainsi sa cohérence philosophique véritable qu’une fois replacée sous cet éclairage anthropologique particulier. Les exemples concrets qu’il ne cesse de donner montrent bien, en effet, que cette notion politiquement cruciale ne renvoie jamais, chez lui, à une quelconque métaphysique (ou théologie) du Bien : autrement dit à une idéologie morale parmi d’autres. Son souci permanent, à travers l’emploi de ce concept délibérément vague et imprécis, est, au contraire, d’enraciner au plus profond de la pratique socialiste les vertus humaines de base, dont l’oubli, le refus ou le mépris ont toujours constitué le signe distinctif des idéologues et des hommes de pouvoir. Ces vertus, ou dispositions psychologiques et culturelles à la générosité et à la loyauté (et qui se résument, au fond, à notre capacité personnelle de donner, de recevoir et de rendre), admettent, naturellement, un nombre illimité de traductions particulières, et varient selon les différentes civilisations et les différents contextes historiques. Mais c’est précisément cette traductibilité permanente qui fonde, en dernière instance, leur caractère universalisable, par opposition aux simples idéologies du Bien qui ne peuvent étendre leur empire singulier (voire se mondialiser) que sur le mode privilégié de la croisade et de la conversion. En revanche, la négation de ces vertus élémentaires se manifeste toujours sous une forme identique : celle de l’égoïsme et de l’esprit de calcul, conditions historiquement immuables de la volonté de puissance, et, par conséquent, de toutes les trahisons qui l’accompagnent inexorablement. (p. 138-140)
Trotski contre le peuple
« De ce point de vue, le pamphlet de Trotsky, « Leur morale et la nôtre » (écrit en 1938), constitue l’une des plus terribles illustrations du mépris des hommes ordinaires et de leur common decency, dispensé, en toute bonne conscience, au nom d’une idéologie du Bien, sourde à toute parole de bonté (pour reprendre l’opposition de Zygmunt Bauman entre pratique effective de la bonté et culte idéologique du Bien). On tient, sans doute, ici, l’une des sources culturelles majeures de cette inaptitude pathétique de l’Extrême Gauche française à comprendre les revendications morales des classes populaires (et notamment, leur refus traditionnel d’idéaliser la délinquance et les conduites de transgression) ; quitte à les offrir sur un plateau doré aux vieux renards expérimentés de la Droite libérale. » (p.157)
Misère sentimentale du bourdieusien
« La gauche — constate Christopher Lasch — a trop souvent servi de refuge à ceux que terrifiait la vie intérieure. Paul Zweig a déclaré qu’il était devenu communiste à la fin des années 1950, parce que le Parti le délivrait « des chambres défaites et des vases brisés d’une vie qui n’était que privée ».
 Tant que ceux qui cherchent à noyer le sentiment de leur faillite personnelle dans l’action collective — comme si cette dernière empêchait que l’on portât une attention rigoureuse à la qualité de sa vie personnelle — seront absorbés par les mouvements politiques, ceux-ci auront peu à dire sur la dimension personnelle de la crise sociale (« La Culture du narcissisme »). Le besoin de chercher à tout prix une explication purement sociologique à l’ensemble des comportements humains (qu’il s’agisse de la délinquance, du rapport à l’école ou de sa propre vie personnelle) trouve, sans doute, dans cette analyse une grande partie de ses raisons véritables. »
Tant que ceux qui cherchent à noyer le sentiment de leur faillite personnelle dans l’action collective — comme si cette dernière empêchait que l’on portât une attention rigoureuse à la qualité de sa vie personnelle — seront absorbés par les mouvements politiques, ceux-ci auront peu à dire sur la dimension personnelle de la crise sociale (« La Culture du narcissisme »). Le besoin de chercher à tout prix une explication purement sociologique à l’ensemble des comportements humains (qu’il s’agisse de la délinquance, du rapport à l’école ou de sa propre vie personnelle) trouve, sans doute, dans cette analyse une grande partie de ses raisons véritables. »
La beauferie ne passera pas
« En France, c’est le film « Dupont Lajoie » (Yves Boisset, 1974) qui illustre de manière à la fois emblématique et caricaturale, l’acte de naissance d’une nouvelle Gauche, dont le mépris des classes populaires, jusque-là assez bien maîtrisé, pourra désormais s’afficher sans le moindre complexe. C’est, en effet, au lendemain de la défaite sanglante du peuple chilien, défaite dont le pouvoir alors traumatisant est, aujourd’hui bien oublié, que cette nouvelle Gauche s’est progressivement résolue à abandonner la cause du peuple (dont chacun pouvait désormais mesurer les risques physiques que sa défense impliquait) au profit d’une réconciliation enthousiaste avec la modernité capitaliste et ses élites infiniment plus fréquentables. C’est alors, et alors seulement, que l’« antiracisme » (déjà présenté, dans le film de Boisset, comme une solution idéale de remplacement) pourra être méthodiquement substitué à la vieille lutte des classes, que le populisme pourra être tenu pour un crime de pensée et que le monde du showbiz et des médias pourra devenir la base d’appui privilégiée de tous les nouveaux combats politiques, aux lieux et place de l’ancienne classe ouvrière. » (p.186)
Google est-il de gauche ?
« Dans une société libérale, la main invisible du Marché est, par définition, toujours plus difficile à percevoir que la main visible de l’État, alors même que le pouvoir qu’elle exerce sur la vie des individus est autrement plus développé. Remarquer l’existence de contrôles policiers permanents ne demande ainsi aucune agilité intellectuelle particulière. C’est donc tout à fait à la portée d’un homme de gauche. Reconnaître, en revanche, l’emprise que Google, par exemple, exerce sur les individus modernes, constitue une opération infiniment plus compliquée pour un individu soumis depuis toujours aux techniques du contrôle maternel : « Google Big Brother ? » Pour Olivier Andrieu, spécialiste des moteurs de recherche, le soupçon existe. « Google collecte une masse de données inimaginable. Ils me connaissent mieux que moi-même, explique-t-il. De fait, si vous utilisez l’ensemble de ses services, Google analyse vos recherches, mais aussi le contenu de vos e-mails (Gmail), les vidéos que vous regardez (YouTube), le contenu de votre ordinateur (Google Desktop), ce que vous achetez (via le comparateur de prix Froogle), etc. Des données utilisées pour offrir aux annonceurs des publicités toujours plus ciblées. Google prévoit même, à l’avenir, de s’appuyer sur la localisation géographique de l’internaute, et vient de déposer un brevet sur une technologie naissante analysant le comportement des joueurs en ligne afin de diffuser dans leurs jeux vidéo des réclames correspondant à leur profil psychologique » (« Journal du Dimanche », 27 mai 2007). Pour autant, on imagine assez mal la Gauche et l’Extrême Gauche modernes, (toujours prêtes à s’indigner du moindre contrôle policier opérée dans une gare de banlieue) appeler un jour les classes populaires à se révolter contre le contrôle permanent de leur vie par Google, ou même simplement contre cette omniprésente propagande publicitaire, sans laquelle le dressage capitaliste des humains resterait un vain mot. » (p.193-194)
Entretiens
Pour avoir une idée plus précise de la pensée de Jean-Claude Michéa, voici sur le site de l’Université Populaire de Montpellier l’entretien qu’il donnait dans Le Point du 8 septembre 2007 à Elisabeth Lévy. Le titre était parlant : Jean-Claude Michéa et la servitude libérale (L’entretien est suivi de l’article que Philippe Raynaud consacrait à L’empire du moindre mal dans Le Monde).
Jean-Claude Michéa s’entretenait par ailleurs le 25 octobre 2007 avec Aude Ancelin dans Le Nouvel Obs. : Y a-t-il une vie après le libéralisme ?
Lire aussi : le compte-rendu de la réunion du MAUSS du 16 février 2008 avec J.-C. Michéa autour de son ouvrage L’empire du moindre mal, 2007 sur le site de la Revue du MAUSS permanente.
Enfin vous trouverez là La biographie de Jean-Claude Michéa.
Jean Claude Michéa présente son livre " L’empire du moindre mal "

Invité pour l’inauguration 2007/2008 de l’Université Populaire Montpellier Méditerranée.
Qu’est-ce que la civilisation libérale ?

Jean-Claude Michéa et Philippe Raynaud lors de l’émission Répliques le 10 novembre 2007.
« Voici un petit problème utilisé parfois comme test d’intelligence. Un homme sort de chez lui, marche six kilomètres plein sud et tue un ours. Puis, il marche trois kilomètres plein ouest, et enfin six autres kilomètres plein nord. Il se retrouve alors chez lui. De quelle couleur était l’ours ? Le plus curieux, c’est que, si j’en juge d’après mes observations personnelles, en général les hommes trouvent la réponse, mais pas les femmes. »
George Orwell, 7 juillet 1944, A ma guise .
« La réponse, qu’Orwell ne donna que le 28 juillet, est : blanc. Parti du pôle Nord, l’homme y est revenu ; il s’agit donc d’un ours polaire. » A ma guise, p.197, en note. Orwell ne dit pas à quelles conclusions l’ont amené ses « observations personnelles »...
[1] Réédité chez Plon en 2006.
[2] Cité par Bernard Crick dans George Orwell, une vie : « Orwell était un animal politique. Il ramenait tout à la politique (...). Il ne pouvait pas se moucher sans moraliser sur les conditions de travail dans l’industrie des mouchoirs. » (p.266)
[3] Orwell écrivait déjà : « Ce que j’ai vu en Espagne, et ce que j’ai découvert depuis, concernant les opérations internes des partis politiques de gauche, m’ont donné l’HORREUR DE LA POLITIQUE. » (The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, Londres, 1968.). Qu’écrirait-il aujourd’hui, aujourd’hui même ?
[4] Le Contrat social, Livre II, chap. XI.
[5] Pileface a suffisamment parlé de Catherine Millet pour que nous n’ayons pas ici à dire nos réserves avec ce passage.
[6] Allez-y voir vous-mêmes si vous ne voulez pas le croire :
Sarkozy et l’héritage de Mai 1968 au meeting de Bercy, le 29 avril 2007.
Réécoutez ce discours aujourd’hui (fin octobre 2008) permet de comprendre la profonde cohérence du discours de Nicolas Sarkozy — au-delà même de ses contradictions : il faut, n’est-ce pas, moraliser la politique et le capitalisme.




 Version imprimable
Version imprimable
 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?



3 Messages
Avoir raison avec George Orwell. « Orwell et la décence ordinaire » : avec Bruce Bégout.
À partir de 1935, la question de la « décence commune » apparaît souvent sous la plume de George Orwell lorsqu’il évoque le peuple anglais, opposant les ‘intellectuels’ aux ‘gens du commun’, en qui il place son espoir. Réflexions sur la vision politique d’Orwell avec Bruce Bégout, philosophe. Voir ici.
Pour un anarchisme conservateur
Les débats de l’Obs. Dans un essai décapant, Jean-Claude Michéa s’interroge sur la gauche et sa religion du progrès, et défend l’idée d’une « société décente » dans la lignée d’Orwell. Entretien avec un philosophe inclassable.
Le Nouvel Observateur - En quoi le complexe d’Orphée, titre de votre livre, définit-il pour vous l’imaginaire de la gauche progressiste ?
Jean-Claude Michéa - Tout comme un pythagoricien aurait préféré mourir plutôt que de traverser un champ de fèves, un militant de gauche éprouve immédiatement une terreur sacrée à l’idée que quelque chose ait pu aller mieux dans le monde d’avant. Une pensée aussi incorrecte le conduirait en effet à remettre en question le vieux dogme progressiste selon lequel il existe un mystérieux sens de l’histoire, porté par le développement inexorable des nouvelles technologies, et qui dirigerait mécaniquement l’humanité vers un monde toujours plus parfait - que celui-ci ait le visage de l’« avenir radieux » ou celui de la « mondialisation heureuse ».
Difficile alors de ne pas penser au pauvre Orphée qui, pour ramener Eurydice des Enfers, avait dû s’engager à aller toujours de l’avant sans jamais s’autoriser le moindre regard en arrière. Mais la comparaison avec le Juif errant d’Eugène Sue aurait été tout aussi appropriée.
L’entretien intégral
Pour prolonger vos lectures : George Orwell et le concept de décence ordinaire.
Avec Bruce Bégout et Jacques Dewitte, philosophes.
Bruce Bégout (né en 1967 à Talence, enseignant à Bordeaux) a publié De la décence ordinaire aux Editions Allia (2008).
Orwell, chacun l’aura remarqué est très présent dans Les voyageurs du Temps. Sollers cite ce passage de 1938 :
« [...] Le conditionnement des masses est une science née au cours des vingt dernières années, et nous ne savons pas encore jusqu’où iront ses progrès. »
et ajoute : « Nous l’avons su, et nous ne le savons toujours pas, ou plutôt nous ne voulons pas le savoir. » (p. 169)