
Carnets du Japon Tokyo, ville du « bura bura »
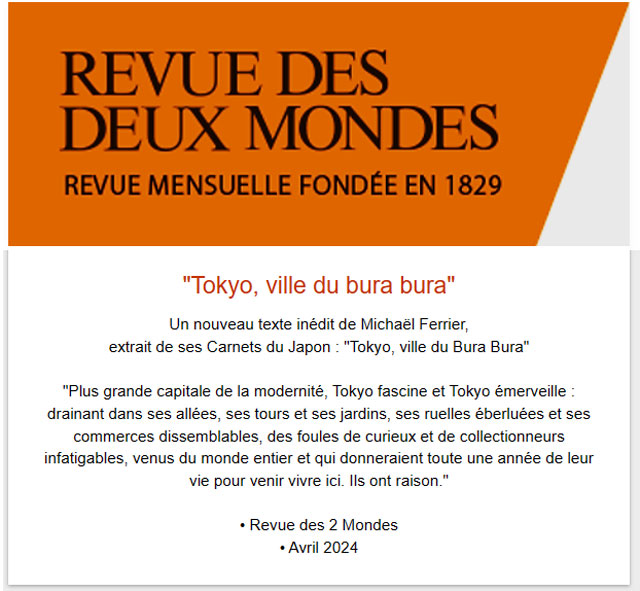

Par Michaël Ferrier
Ce qui frappe d’abord en arrivant à Tokyo, c’est le tumulte et l’agitation des rues, qui gardent cependant, quasi en toutes circonstances, un ton de courtoisie et de feutre. On ne parle pas, on chuinte ou on chuchote, on murmure, on fredonne. On ne crie presque jamais, sauf dans les restaurants (où l’accueil n’est bruyant que parce qu’il est chaleureux). On ne marche pas, on circule, on se transporte comme sur un tapis volant, se faufilant toujours, ne se heurtant jamais : la ville est un grand tracé d’esquives et d’excuses. L’ensemble est joyeux sans être criard, remuant sans être agité, amusant sans être vulgaire, distrayant sans être futile, surprenant sans jamais étourdir. La ville est énergique, pimpante au possible, soyeuse et toujours inattendue. Elle est aussi très agréable parce qu’elle est propre. Il n’y a pas une ville au monde qui soit en même temps aussi surpeuplée et aussi bien tenue que Tokyo. Très peu d’odeurs, sauf dans les quartiers les plus défavorisés, et aucune qui vous suive ou qui vous intoxique. Quelquefois, une senteur de poisson grillé ou le parfum discret d’une jeune femme en fleurs. S’il pleut, un arôme léger de terre fraîche et, de temps en temps, le vent qui pousse quelques effluves venus de la mer – algues, fucus, varech. Tokyo est un festival de venelles, de pentes, de marches, de montées et de perrons, un dédale d’impasses et de traverses, oscillant toujours entre la passerelle et le cul-de-sac. On dirait un immense bateau parcouru de grandes avenues impériales, larges et calmes, mais également strié d’une multitude innombrable de coursives filant au milieu de petites villas inaccessibles, tassées les unes contre les autres, chacune cependant disposant de sa spécificité indiscutable, se côtoyant toujours et ne se touchant jamais, étranges, asymétriques, bosselées ou boitillantes, dont les piliers s’entrecroisent et s’escaladent au mépris de toutes les règles de l’ordonnancement urbain ou du risque sismique et dont les terrasses, bien cachées, dévoilent soudain au passant qui sait s’y aventurer – ou, au contraire, s’y prélasser, couché au bord de l’eau comme un promeneur prenant le frais – des échappées époustouflantes ou des panoramas improbables, en bois, en fer, en bambou ou en béton, dominant une série d’immeubles en verre aux formes géométriques ou le petit chemin ponctué de statues et de pins d’un cimetière taiseux, enfoui dans la mémoire presque indéchiffrable des stèles et le silence du soir. Ouvrez les yeux, lisez le texte de la ville, suivez la phrase ondoyante et voltigeuse des rues, tour à tour droite et découpée, voltigeant parmi volutes et méandres.
Si Tokyo n’est pas, au sens strict, la ville la plus peuplée du monde (supplantée par une dizaine de villes, notamment chinoises : Chongqing, Shanghai, Pékin forment le trio de tête, suivies par Delhi [1]), elle est l’aire urbaine la plus fréquentée, regroupant autour de la baie de Tokyo plus de quarante millions d’habitants, soit près d’un tiers de la population totale du pays. La notion d’« aire urbaine » varie selon les pays, mais pour qui connaît Tokyo, une chose est sûre : c’est la plus grande mégapole du monde. La ville n’a pas de centre unique, comme le notait Roland Barthes dans son célèbre livre [2], mais elle n’a surtout pas de bout ! En avril 1982, quand, pour la première fois dans l’histoire, un président de la République française en exercice – François Mitterrand – vient en visite officielle au Japon, il se rend en train de Tokyo à Kyoto, distantes de quelque cinq cents kilomètres. « Mais comme c’est grand, Tokyo ! », s’exclame-t-il, alors qu’il est déjà dans les faubourgs de Kyoto… La plaine du Kantô forme en effet une gigantesque conurbation, d’où cette image d’une Tokyo surpeuplée et dense, parcourue en tous sens de mouvements pendulaires, concentrant en son sein les emplois et les activités, les entreprises et les services, les noyaux d’affaires. Pourtant, Tokyo possède encore de belles zones de verdure disséminées à l’intérieur même de la ville. Dans les recoins de la capitale se terre une autre Tokyo : Tokyo-campagne, Tokyo-bourgade, Tokyo-vallons et Tokyo-vergers, avec ses terrains vagues couverts d’herbes et d’oiseaux, ses rangées de maisons basses. Pendant des kilomètres, on ne croise rien que des façades et des murs, des vitrines, des devantures et des bâtiments grisâtres (fabriques et fonderies, scieries, cimenteries…), et tout à coup, sans crier gare, on se retrouve face à des champs jaunes, des vallons verts, des prairies blondes ou ocre, des ruisseaux sinueux, des forêts obscures. Les ateliers et les manufactures laissent la place à des espaces plats, duveteux, clairsemés. Encore quelques pas de côté et l’on retrouve alors les petites maisons de bois qui font le charme du Japon : elles se tiennent, menues et attendrissantes, alignées de part et d’autre de ruelles étroites où deux cyclistes ne pourraient pas se croiser sans mettre pied à terre, défendues par de jolis portails bas et des rangées de plantes en pots. Ici, les pivoines ou les cerisiers, les roses, les chrysanthèmes, les fleurs de mousse et les fleurs de pêcher font de la ville un jardin fleuri en toute saison. C’est une ville à mille facettes que Tokyo et l’on comprend vite que c’est en se déplaçant sans cesse qu’il faut la découvrir, toujours à l’improviste. « Bura bura suru » : flâner, marcher sans but. Ce style de déambulation est aussi un mode de connaissance. Bura bura… À partir de cette onomatopée pétillante, les Japonais ont inventé un verbe pour désigner cette méthode mobile de découverte, nomade et déroulante, qui ouvre sous vos yeux les panoramas comme les profondeurs. Alors, on regarde, on ouvre ses pupilles, ses narines, ses ouïes, et on dévore jusqu’à l’ivresse cette ville-monde. On arpente les grandes artères, avec leurs bâtiments et leurs monuments inspirés de la modernité européenne, mais aussi les quartiers populaires, avec leurs petites maisons de torchis et de tuiles. On pousse vers les zones industrielles et on se régale aussi des brûlis et des jachères qui persistent sous les équipements dernier cri qui prolifèrent. On observe et on prend des notes. En même temps, on lit et on relit Sôseki, un des grands écrivains de la ville qui, il y a plus d’un siècle, l’explorait dans toutes ses dimensions avec le même ravissement, pour écrire cela : « On se sent l’esprit plus clair à la seule idée de vivre sous un ciel pareil, et le fait de marcher à travers champs ajoute à la perfection des choses. »
L’une des grandes spécialités de Tokyo, c’est le commerce. Et son corollaire obligé, sonore et bariolé : la publicité. Bien sûr, les endroits à la mode comme Ginza ou Marunouchi sont bondés. Zones commerciales, quartiers d’affaires, nœuds ferroviaires… Ici, les rues sont plutôt larges, pleines de passants et de banques, bordées de tous côtés par les magasins, les restaurants de luxe, les théâtres ou les cinémas, les salles de concert. Peu importe où vous dirigez le regard, les femmes sont toujours belles, les hommes portent des costumes bien coupés et des chaussures en cuir véritable. Tout le monde marche, flâne, trottine, certains finissent par entrer dans un café, les autres passent des heures à regarder les vitrines décorées avec goût, dans une grande insouciance. Tokyo est vaste et Tokyo resplendit. Des hommes en bras de chemise prennent le frais, on voit passer des femmes frémissantes et chargées de paquets. Dans les quartiers populaires, l’ambiance est très différente. Les chats batifolent, les corneilles criaillent. Elles croassent partout dans la ville, mais ici, dans les rues plus étroites et encombrées de piétons, leur cri semble prendre un ton à la fois plus aigre et plus ample. Certaines placettes sont envahies par les étals : on y vend des gâteaux aromatisés au sucre et au soja, de la pâte de haricots, des friandises au riz gluant. On brocante tout, des sacs et des pochettes, des vélos et des landaus, des étuis à cigarettes et des montres de poche, des brochures illustrées et des romans d’aventures. Une boutique de jardinage voisine avec une caserne de pompiers, on trouve un magasin de jouets à côté d’un débit de saké, et une boutique de céramique au deuxième étage d’un restaurant de poulet. Mais que ce soit dans les quartiers rutilants ou dans les faubourgs modestes, la reine de Tokyo, c’est la publicité. En 1909 déjà, ¬Abdürrechid Ibrahim, un ouléma tatar de passage sur l’archipel, en faisait l’expérience : « Au Japon, la publicité est incomparablement plus développée qu’en Europe, écrivait-il dans son journal de voyage. Le commerce marche avec la publicité, les expositions et les annonces. [3] » Plus d’un siècle plus tard, rien n’a changé : la quantité des annonces est toujours stupéfiante, sur les routes, les trottoirs, dans les trains, les métros. Les enseignes foisonnent, semées sur les murs, trônant sur les toits, fixées sur les flancs ou au sommet des gratte-ciel, suspendues dans l’atmosphère. Tatouée à toute heure du jour et de la nuit de signes et de sons, la ville offre un spectacle hypnotique : esthétiques ou comiques, irradiantes, innovantes, les publicités de la capitale sont plus fastueuses, plus insolites les unes que les autres. On ne voit qu’elles et on pourrait passer son temps à ne rien regarder d’autre. Les grandes marques internationales déferlent sur les murs, les superstars mondiales du cinéma ou de la musique vous font un clin d’œil, soudain réduites au rôle de camelot d’une marque de whisky, de porte-parole d’un parfum. Devant une telle quantité de lumières et un tel flot de couleurs, on a l’impression que le monde entier défile devant ses yeux.
Plus grande capitale de la modernité, Tokyo fascine et Tokyo émerveille : du touriste interloqué à l’étudiant fureteur, du visiteur épris à l’homme d’affaires intéressé, drainant dans ses allées, ses tours et ses jardins, ses ruelles éberluées et ses commerces dissemblables, des foules de curieux et de collectionneurs infatigables, venus du monde entier et qui donneraient toute une année de leur vie pour venir vivre ici. Ils ont raison.
Michaël Ferrier

- Michaël Ferrier, 2018
Michaël Ferrier est écrivain et essayiste. Dernier ouvrage publié : Notre ami l’atome (écrits cinématographiques, en collaboration avec Kenichi Watanabe, Gallimard, 2021). Vit au Japon où il enseigne la littérature. Créateur du site www.tokyo-time-table.com



 Edition originale Gallimard/L’Infini 2004
Edition originale Gallimard/L’Infini 2004
 Réédition poche, Arléa, 2010, 2019
Réédition poche, Arléa, 2010, 2019

Notons que Michaël Ferrier qui vit à Tokyo depuis une trentaine d’années, est aussi l’auteur d’un court roman « Tokyo Petits portraits de l’aube ». Lu il y a longtemps et le souvenir qu’il m’en reste est un récit qui retient l’attention, à la verve fantastique dans le Tokyo interlope de la nuit. Un récit qui avait aussi capté l’attention de Philippe Sollers puisqu’il l’a édité dans sa collection L’Infini.
L’écrivain René de Ceccatty, fin connaisseur de la littérature japonaise, replace très justement Tokyo, petits portraits de l’aube dans une filiation littéraire.
À travers plusieurs personnages marginaux ou simplement marginalisés par leur passion de la nuit, l’auteur se promène dans un paysage souterrain ou aérien, fait de bars, de ruelles, d’arrière-boutiques, de caves : « La douceur et la fluidité de la surface cachaient une intense activité des profondeurs, un travail collectif, obscur et térébrant, où les siècles se confondaient, où agriculture ancestrale et science des particules se faisaient écho, où la nature et l’homme se rejoignaient. Recherche, rumination, macération, fermentation, la vie surgissait de ces mystérieux tressaillements, de cette intense réflexion sous-jacente. »
Un lecteur familier de la littérature japonaise d’avant-guerre sera heureux de trouver cette étrange modernisation d’un fonds poétique commun à Dazai, à Kafû, à Akutagawa. Michaël Ferrier ne se contente pas de décrire un petit monde amical étrange et des lieux qu’il aime (« un de ces petits bistrots comme on n’en trouve qu’à Tokyo, nichés au bord de la rivière et planqués sous la ceinture de la voie ferrée, comme si la vie les avait oubliés là, entre le fer et l’eau »), mais offre un bel hommage à une littérature dont il est nourri et qui a comme filtré son regard d’étranger sur un monde devenu le sien.
René de Ceccatty,
Le Monde, 22 octobre 2004

Nagai Kafû le jour -1954


Nagai Kafû la nuit (Tokyo, 1950)
Ihee Kimura ©Tokyo Metropolitan Museum of Photography

 PLUS sur le livre et Tokyo ICI
PLUS sur le livre et Tokyo ICI
Le voyage manqué de Sollers au Japon par ABE Shizuko
En 1985, on annonça la venue de Sollers au Japon. La nouvelle de sa première visite au Japon, dans une situation où l’ancien porte-drapeau de l’avant-garde semblait bondir sur le devant de la scène du monde littéraire, a sans doute suscité beaucoup d’espérance chez ceux qui s’apprêtaient à l’accueillir. Mais Sollers n’est pas venu.

- Abe Shizuko,
photo ©Marie Gaboriaud
Dans ce texte inédit, l’universitaire Abe Shizuko revient sur cet épisode insolite pour rappeler la place de Sollers dans le milieu littéraire japonais et s’interroger sur sa manière inimitable de dire "Non"..
« une empreinte considérable dans le monde littéraire japonais »
ABE Shizuko



ZOOM : cliquer l’image

 Traduit du japonais par Michaël Ferrier
Traduit du japonais par Michaël Ferrier

Un peu plus d’une semaine après la publication de mon essai « Une heure avec Philippe Sollers » dans le n°45 du bulletin Tomo no Kai [4], j’ai reçu la nouvelle de la mort de Sollers. Certains ne le savent peut-être pas car cela n’a pas été largement rapporté dans les médias japonais, mais le 5 mai, Philippe Sollers est décédé à l’âge de 86 ans, après une vie qui fut faite à la fois de splendeur et de solitude. Cet écrivain rare, qui n’a cessé d’écrire avec vigueur à Paris, sur l’Île de Ré, à New York et à Venise, et qui laisse derrière lui une œuvre importante, a également laissé une empreinte considérable dans le monde littéraire japonais.
En 1985, on annonça la venue de Sollers au Japon, peu de temps après qu’il eut arrêté la revue Tel Quel, qui servait de base principale à ses activités, et lancé une nouvelle revue, L’Infini, et qu’il ait créé au même moment la controverse avec son roman Femmes, où il changeait complètement son style habituel. La nouvelle de sa première visite au Japon, dans une situation où l’ancien porte-drapeau de l’avant-garde semblait bondir sur le devant de la scène du monde littéraire, a sans doute suscité beaucoup d’espérance chez ceux qui s’apprêtaient à l’accueillir. Mais Sollers n’est pas venu. Il annula sa visite au Japon à la dernière minute, en raison d’une maladie soudaine [5]. Ainsi, le programme si bien rempli fut résilié et les conférences prévues furent supprimées. Ces deux conférences étaient respectivement intitulées « Le Nu, tradition française » et « La Liberté catholique ». On dit qu’à l’annonce de la nouvelle, un Français aurait prononcé les mots suivants : « Oh ! Voilà bien un Telqueliste ! »… dont on peut dire qu’ils étaient représentatifs de la réaction des gens à l’époque. Mais Sollers s’est-il jamais conduit de la manière dont on s’y attendait dans son entourage ? [6]

Portrait du joueur,
Édition japonaise, Asahi Shinbunsha, 1990

« Oh ! Voilà bien un Telqueliste !... »
Mais Sollers s’est-il jamais conduit de la manière dont on s’y attendait ?
On peut affirmer avec certitude que les actions de Sollers n’ont jamais rien moins visé qu’à détruire une harmonie prédéterminée, depuis que, peu après ses débuts, il eut renié sa première œuvre et commencé à publier une série de textes difficiles. Jacques Henric, l’un de ses rares alliés depuis l’époque de Tel Quel, parlant de Sollers dans Art Press, a déclaré que ce qui l’avait attiré chez lui était sa manière de dire « non », sa façon de toujours prendre une position opposée, du début à la fin. Et il a poursuivi : « Dans le domaine de la pensée et de l’art, la majorité a toujours tort (…). Le parcours de Sollers est cohérent. Dire la vérité fait partie d’un art de la guerre qui implique stratégie et tactique. » Si Henric dit vrai, la voie empruntée par Sollers a toujours été un combat contre la majorité, et cela, c’est sans doute Sollers lui-même qui l’a le mieux compris. ]Iwasaki Tsutomu, l’un des meilleurs connaisseurs de Sollers au Japon, qui n’a jamais douté de sa cohérence depuis le début, dit de son roman autobiographique Portrait du Joueur qu’il ne s’agit pas seulement d’un roman personnel (watakushi-shôsetsu [7]), mais que « l’on peut y sentir l’intention de dévoiler minutieusement quelque chose et de surmonter quelque chose », et il se demande si l’annulation de sa visite au Japon n’est pas un acte qui s’inscrit dans le prolongement de cette démarche. Je pense que c’est exactement cela. J’aimerais penser qu’il y a là quelque chose qui ne pouvait s’exprimer qu’en disant « non ».
D’ailleurs, en annulant sa visite, il ne semble pas que Sollers se soit fait autant d’ennemis parmi les journalistes japonais qu’il n’en avait en France, ni qu’il ait perdu l’influence qu’il avait sur les lecteurs japonais depuis ses débuts. J’en veux pour preuve les tentatives de création inspirées par Nombres et Paradis, les articles dans des revues littéraires et les publications successives des traductions de ses nouveaux romans. En fait, on pourrait dire que c’est à cette période que Sollers fut le plus proche de notre pays, et il s’agit peut-être là d’une précieuse période de lune de miel entre cet écrivain que l’on disait « trop français » et le Japon. Même si Sollers, profondément dévoué à la culture et à la pensée de la Chine ancienne, ne partageait pas la compréhension de la société et de la culture japonaises de son mentor Roland Barthes.

Roland Barthes, Sollers écrivain,
Édition japonaise, Misuzu Shobo, 1986


« Je suis résolument hostile à la fausse vie.
C’est la guerre : la lutte est pour la poésie. »
Philippe Sollers

Ce qui ressort de ces nombreux ouvrages nés d’un vigoureux désir de création, dont on dit parfois qu’ils sont trop écrits, c’est la silhouette d’un écrivain qui, en menant hardiment la bataille de l’écriture, en s’ancrant solidement dans le catholicisme, et grâce à de puissants discours sur les idées, la littérature, l’art et la musique de pays et d’époques variées, à commencer par celle des Lumières, a essayé de mener une Renaissance à lui tout seul. On peut voir là l’ambition qu’il avait confiée dès ses débuts à son nom de plume, créé en combinant des mots latins : « Sollers » (« Tout entier art »).
Maintenant, ce que nous appelons « Sollers » s’est refermé pour l’éternité, et tout le bruit également associé à son nom est sur le point de devenir une chose du passé. Désormais, la question qui demeure est : « De quoi Sollers était-il le nom ? ». Quelqu’un l’a un jour décrit comme : « une vie dédiée à l’art, une vie qui s’aperçoit qu’elle s’achèvera peut-être sur un échec [8] » Sollers a dit : « Je suis résolument hostile à ce genre de vie, de fausse vie. C’est la guerre : la lutte est pour la poésie. (…) Et c’est gratuit, figurez-vous, la poésie c’est comme l’air, avant que tout soit pollué. Ce qui est gratuit est suspect. C’est comme l’amour, c’est gratuit [5]
» Maintenant qu’une grande distance nous sépare de l’annulation de sa visite au Japon, le temps est venu de s’interroger sur le « Non » de Sollers.
ABE Shizuko

A PROPOS DE L’AUTEURE
ABE Shizuko est née à Tokyo en 1943. Elle est spécialiste de la littérature moderne française et a notamment enseigné à l’Université Keio. Elle est également traductrice (par exemple de Georges Bataille, Madame Edwarda, Tokyo, Getsuyosha, 2022). Parmi ses publications : Qu’ont fait les telqueliens ? – Un pont suspendu vers l’avant-garde (Tokyo, Keio University Press, 2011) ; La Chine sollersienne : au-delà de l’orientalisme (Tokyo, Suiseisha, 2022).
Ce texte a été publié dans la Lettre d’information des Amis du musée Suzuki Shintarô (2023) et est reproduit avec leur aimable autorisation.
Traduction : Michaël FERRIER
Michaël Ferrier pour la traduction
Tokyo Time Table 2024

Références électroniques
http://www.tokyo-time-table.com/sollers-japon-abe
Le Bunraku de Barthes par François Bizet
Bunraku : C’est le nom du théâtre de marionnettes d’Osaka, d’où est sorti le drame moderne, dit Kabouki.
in Paul Claudel, L’Oiseau noir dans le soleil levant


近松門左衛門の『曽根崎心中 (Suicides d’amour à Sonezaki de Monzaemon Chikamatsu) / Roland Barthes

et c’est d’un seul bloc :
la vision qu’a Barthes du Japon est fondamentalement syncrétique et synthétique.

Commençons par mettre en regard deux événements décisifs de la vie de Barthes : la révélation, en juillet 1954, du travail de Brecht, et la découverte, une douzaine d’années plus tard, du Japon. Voici ce qu’il dit du premier :
« …ce théâtre désaliéné que nous postulions idéalement […]
s’est trouvé en un jour devant nous dans sa forme adulte et déjà parfaite [9] ».
Je me demande si cette phrase, écrite un an après la commotion esthétique qu’a été la rencontre avec le Berliner Ensemble [10], ne pourrait pas venir éclairer, par anticipation, la fascination pour la chose japonaise. Je relis en effet la quatrième de couverture de L’Empire des signes :
« …de tous les pays que l’auteur a pu connaître, le Japon est celui où il a rencontré le travail du signe le plus proche de ses convictions et de ses fantasmes, ou, si l’on préfère, le plus éloigné de ses dégoûts, des irritations et des refus que suscite en lui la sémiocratie occidentale. Le signe japonais est fort : admirablement réglé, agencé, affiché, jamais naturalisé ou rationalisé [11] ».
De même qu’il existait, quelque part en Europe, une scène déjà radicalement affranchie de l’emprise illusionniste propre à ce théâtre « petit-bourgeois [12] » que Barthes n’avait cessé de fustiger, il existait « quelque part dans le monde (là-bas [13]) », un pays où l’utopie des signes se trouvait pleinement, et comme immédiatement réalisée, un espace symbolique où leur exposition purement extérieure conjurait toute possibilité de concrétion mythologique. Pas de « nouvelle Citroën [14] » au Japon…
Le parallèle semble assez opératoire : l’auteur de L’Empire des signes aurait reproduit à quelques années de distance un même schéma interprétatif, et mis sur un même pied les deux phénomènes. Or on doit y regarder à deux fois. Barthes savait en 1954 que la pratique théâtrale « distanciée » de Brecht était inséparable d’une longue maturation théorique, ce qui lui permet de faire jouer la métaphore de l’insecte accompli, de l’imago. Or on le voit bien, cette durée historique, nécessaire à la métamorphose de la scène européenne, est absente du discours japonais. On devine aisément pourquoi. Barthes n’avait en effet aucun mal à diagnostiquer le passage d’un théâtre abîmé dans les narcoses de l’identification à un « théâtre de libération [13] », véritablement populaire : il y était porté par une philosophie matérialiste de l’histoire, et tout comme Brecht à la même époque, par cette « critique offensive de l’idéologie » dont Jean-Claude Milner fait le nerf d’un « marxisme strictement et complètement entendu [15] ».
Arrivé au Japon, un autre réel prend Barthes par surprise, et c’est d’un seul bloc, sans cet étagement local et subtil des temporalités philosophiques, littéraires, politiques, idéologiques, qu’il reçoit tout ce qu’il voit. La vision qu’a Barthes du Japon est fondamentalement syncrétique et synthétique [16]. C’est un instantané sans épaisseur (non sans vertu illuminante, faut-il le rappeler ?), où la profondeur diachronique se voit non pas abolie, mais neutralisée, repérable à des effets de miroitement (cartes anciennes et haïkus côtoyant des acteurs et des joueurs de pachinko), tout le contraire apparemment du « feuilleté » (mot fétiche de Barthes), et qui s’annonce, dès les premières phrases de L’Empire des signes, sous la forme d’une série de prélèvements :
« Je puis aussi […] prélever […] un certain nombre de traits […] et de ces traits former délibérément un système [17] ».
Je voudrais avancer ici qu’une telle saisie du réel, tout en frôlements et effleurements, qui fait l’étoffe de L’Empire des signes, a déjà été thématisée, sinon théorisée dans le commentaire que j’évoquais plus haut du livre de Michel Butor, Mobile, dont il est important de rappeler qu’il a été écrit après un séjour de sept mois aux États-Unis, et dans le refus d’emprunter au genre canonique du récit de voyage. Je propose donc de lire l’article de 1962 comme une espèce de matrice du livre de 1970. Barthes y présente Mobile comme « une énumération d’objets signalétiques » brassant trois plans historiques distincts, et il ajoute ceci, qui nous importe particulièrement : « On dirait que l’écrivain procède à des “prises”, à des “prélèvements” variés, sans aucun égard à leur origine matérielle. » Dans Mobile comme plus tard dans L’Empire des signes du Temps et à sa logique : « en mêlant sans cesse ex abrupto le récit d’Indien, le Guide bleu de 1890 et les autos colorées d’aujourd’hui, l’auteur perçoit et donne à percevoir l’Amérique dans une perspective rêveuse [18] ». L’histoire, pourtant bien présente, perd alors ses contours habituels. Tous ces « éclats du temps [19] », tous ces objets discontinus, « producteurs de fantasmes [20] » se combinent à l’intérieur d’un « grand tableau [21] », d’un « grand catalogue [22] », et finalement d’« une histoire mythique [23] », dimension nouvelle à laquelle Barthes ne peut qu’attribuer le « nom mythique [24] » qui la signifie le mieux : pour lui en effet, c’est moins des « États-Unis » qu’il s’agit que de « l’Amérique ».[Ibid., p. 439.]] »), et dans leur contiguïté dynamique. À l’évidence, cela relève d’une tension, d’une contradiction insoluble, indialectique, que l’on pourrait toutefois s’amuser à faire tenir dans un (autre) mot fétiche de Barthes, dans une de ces catégories du sensible bien relevées par Jean-Pierre Richard : « le moiré [25] ». La moire, c’est bien sûr la surface pure, qu’aucune intériorité ne vient i><expliquer, à tout moment susceptible de muer ou de se fuir, et de se recomposer sans pour autant cesser d’être elle-même, mais pour Richard, elle renvoie aussi à « une proxémie : un art de l’immédiateté voluptueuse. Pour être reconnu, et mis en mouvement, le trait n’y a plus besoin d’invoquer aucun autre trait lointain […]. La qualité s’y manifeste d’elle-même, en une sorte d’expansion aussi intime qu’extatique [26] ». L’Empire des signes, ou : à même la peau des choses…
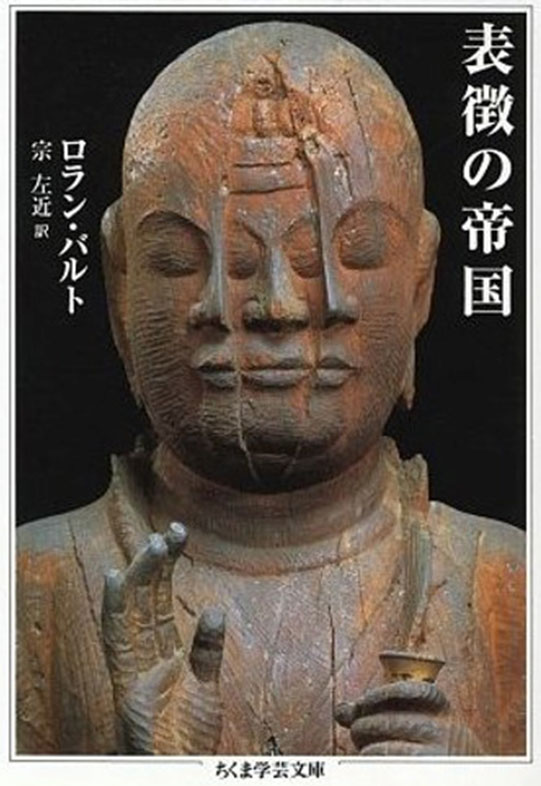
Édition japonaise de L’Empire des Signes (Tokyo, Shinchôsha, 1974, Chikuma Gakugeibunko, 1996) 『表徴の帝国』宗左近訳、新潮社「創造の小径」 1974年/ちくま学芸文庫 1996年
« … ce à quoi la Sémiologie doit s’attaquer,
c’est le système symbolique et sémantique de notre civilisation, dans son entier ;
c’est trop peu de vouloir changer des contenus,
il faut surtout viser à fissurer le système même du sens :
sortir de l’enclos occidental, comme je l’ai postulé dans mon texte sur le Japon. »
Roland Barthes
[…] il faut je crois considérer L’Empire des signes comme un exemple de ce que Barthes appellera plus tard, dans ce formidable laboratoire qu’est La Préparation du roman, une « œuvre-maquette » : une œuvre qui se présente « comme simulation d’elle-même », « comme sa propre expérimentation », une œuvre qui « met en scène une production [27] ». Le théâtre, toujours.


Photo ©Stéphane Barbery
Je voudrais pour terminer ajouter un petit grain de sel.
Il n’est pas sans intérêt que dans les dernières années de la vie intellectuelle de Barthes, le haïku se soit imposé en tant qu’idéal formel, devant le bunraku, et qu’il ait fini par figurer l’ingrédient principal, la materia prima du roman, y compris d’un roman aussi démesuré que la Recherche du Temps perdu. Mais au fait, en quoi consiste exactement le roman de Proust ? Faut-il se ranger à l’avis de Barthes, au risque d’une indigestion de mayonnaise ? Ou bien à celui de Jean-Pierre Richard, qui bien avant de se pencher sur l’imaginaire barthésien des substances, a repéré dans l’immense masse narrative de la Recherche un plat emblématique de l’entreprise littéraire même, comme est emblématique de L’Empire des signes, la tempura — à moins que ce ne soit le sukiyaki —, tous deux analogons sapides d’une scène où tout, absolument tout, se fait sous vos yeux.
Ce plat, proustien, c’est le bœuf à la gelée, qui apparaît sous la forme d’une spécialité de Françoise dans les Jeunes filles en fleurs, et qui ressurgit à quelques pages de la fin du Temps retrouvé, comme le modèle, réduit mais illuminant, de l’œuvre qui s’achève et qui vient [28]. Et bien pourtant, malgré cette reconnaissance de Proust lui-même, pas un mot, dans le cours au Collège de France, sur ce bœuf mode que la cuisinière prépare avec un soin d’esthète, en choisissant au marché des morceaux variés de viande — « carrés de romsteck, […] jarret de bœuf, […] pied de veau [29] » que la gélatine viendra fédérer tout en maintenant l’intervalle à la fois matériel et transparent qui leur assure à tous, aujourd’hui encore, d’apparaître tels quels, comme ça, comme ils sont, côté Swann et côté Guermantes, dans leur fraîcheur de détails.
François BIZET
© 2018 by François Bizet/Tokyo Time Table
VOIR AUSSI :
 Paul Claudel et le Bounrakou (ou Bunraku)
Paul Claudel et le Bounrakou (ou Bunraku)
A PROPOS DE FRANCOIS BIZET
Après avoir été libraire à Paris pendant dix ans, et lecteur dans plusieurs universités d’Ankara et d’Istanbul de 1993 à 2004, François Bizet est maintenant maître de conférences à l’université de Tokyo. Il étudie depuis 2007 le gidayû (義太夫) avec Takemoto Koshikô (竹本越孝).
Il a publié : Une communication sans échange. Georges Bataille critique de Jean Genet (Droz, 2007), Tôzai !... Corps et cris des marionnettes d’Ôsaka (Belles Lettres, 2013), des articles sur Pétrarque, Ponge, Bataille, Genet, Perec, Guyotat, Volodine, et dans le cadre d’un collectif sur la catastrophe de Fukushima, un texte intitulé « L’inhabitat » (Penser avec Fukushima, Cécile Defaut, 2016).
Écrivain, il est l’auteur de : Tombeau (Yapi Kredi, 2013, français et traduction turque) ; Dans le Mirador, 2018, Presses du Réel ; La Construction d’Ugarit et Traité du corail, dont des extraits ont été accueillis dans diverses revues (Le Nouveau Commerce, La Revue littéraire, Fusées, Nioques).
Le texte inédit, est adapté d’une conférence donnée le 21 mars 2017 dans le cadre du séminaire animé par Emmanuel Lozerand : « L’Empire des signes : un objet, une époque. L’autre aujourd’hui », à l’INALCO, au Centre d’Études Japonaises.
François Bizet, © Michaël Ferrier
Claudel « Ambassadeur-poète » au Japon
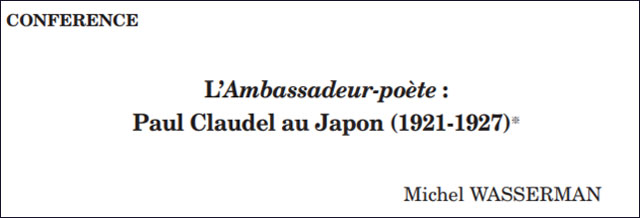

Extrait d’une conférence prononcée le 10 septembre 2005 , par Michel Visserman à l’occasion du cinquantenaire de la mort de Paul Claudel et de l’exposition « Destination Japon. Sur les pas de Guimet et Claudel au Muséum de Lyon » [30].
[…] Claudel fut, vous le savez, un diplomate de profession, et non des moindres. Reçu premier au Concours des Affaires étrangères, et alors qu’il avait tout loisir d’opter pour la voie des ambassades, il avait choisi la carrière consulaire qui lui semblait moins pesamment hiérarchique (dans un petit poste éloigné de la capitale, on est son propre maître) et moins astreinte aux obligations mondaines qu’il exécrait par nature, et aussi parce qu’elles lui paraissaient relever le plus souvent de la perte de temps. Or, diplomate à plein temps (il se fait une haute idée de ce qu’il appelle ses “devoirs d’Etat”), Claudel a aussi une oeuvre à écrire, et quelle oeuvre, et aussi une activité contemplative liée à son catholicisme intransigeant, qui ne lui ferait par exemple manquer pour rien au monde, dans quelque poste que ce soit, la messe du matin, ou omettre de consacrer en marcheur chevronné le temps nécessaire à la pérégrination solitaire. Peu carriériste, au moins dans la première partie de sa vie de diplomate, sans fortune et sans nom, Claudel allait pourtant accéder aux plus hauts postes du Ministère, à l’exception notable toutefois de ceux de la Direction centrale (à l’encontre notamment de Saint-John Perse qui sous son vrai nom d’Alexis Leger fit une carrière presque uniquement française et fut de facto en charge de la politique extérieure de la France durant la majeure partie de l’entre-deux guerres). Chef de poste au Brésil puis au Danemark, Claudel est nommé ambassadeur de France (il s’agit d’un grade, non d’une fonction, la plupart des ambassadeurs ne sont pas ambassadeurs de France) au début des années vingt. Ce grade lui ouvre les plus grands postes : il sera successivement ambassadeur à Tokyo, à Washington […]

Voici, me direz-vous, un bien long préambule pour vous parler de la période japonaise de Claudel, qui n’occupe, congé statutaire défalqué, qu’à peine plus de quatre ans de cette interminable carrière tricontinentale, et qui nous le montre une nouvelle fois dans l’un de ces postes lointains et exotiques qui furent bien souvent son lot. Après tout, face à quatorze années de rang où il n’eut d’affectations que chinoises, face à huit ans passés aux Etats-Unis en tout début et en toute fin de carrière, le Japon ne pèse pas si lourd dans la trajectoire du diplomate. Comment expliquer alors que devant la tombe de ce grand catholique figurent les éléments d’un sanctuaire shinto, que de tous les postes qu’il ait occupé il n’en est aucun où il ait laissé dans le pays même un si impérissable souvenir, au point que les études claudéliennes forment au Japon comme un domaine à part dans les études françaises, un peu comme chez nous les études proustiennes ? Comment se fait-il que sa grande ombre obscurcisse à peu près tout ce qui s’est fait avant et après lui, au point que sa mission paraît incarner à elle seule la relation bilatérale et que la présence française dans le pays fonctionne aujourd’hui encore sur la base d’instruments qu’il a contribué, parfois non sans volontarisme ni obstination, à créer ? Pour avoir été en charge moi-même de l’un de ces instruments, l’Institut Franco-Japonais du Kansai à Kyoto, au cours d’années que j’aime à évoquer comme comptant parmi les plus belles de ma vie, c’est-à-dire exactement les termes qu’il employait pour désigner celles qu’il avait passées lui-même au Japon, c’est toujours pour moi un agréable devoir de mémoire, et comme le sentiment de m’acquitter bien modestement d’une dette, que de célébrer les années heureuses et fécondes que passa dans leur pays celui que les Japonais avaient baptisé d’autorité à son arrivée “l’Ambassadeur-poète”, et qui à la vérité sut si bien, en poète, aider au travail du diplomate en portant sur le Japon et les hommes qui l’habitent un regard amoureux et pénétrant (et pénétrant parce qu’amoureux). De ce regard, ce pays souvent si difficile à cerner et qui n’est pas sans souffrir de l’incompréhension, voire de l’hostilité que fréquemment il suscite, lui demeure à jamais reconnaissant, comme à l’un de ses interprètes les plus autorisés.
[… [En 1921], lorsque Claudel prend son poste japonais, il se retrouve ambassadeur dans un pays qui a annexé Formose et la Corée, la moitié méridionale de Sakhaline (la grande île oblongue est à quelques encablures de ses territoires septentrionaux), et qui fait la pluie et le beau temps en Chine au gré de ce qu’il perçoit comme ses intérêts du moment, en attendant d’y mener une guerre de conquête coloniale systématique au cours des années trente. L’Occident, qui a considéré avec une stupeur croissante cette montée en puissance (on ne dira jamais assez le choc que constitua en son temps l’issue de la guerre russo-japonaise, première défaite d’une puissance occidentale aux mains d’une nation non blanche), a pris progressivement ses distances avec ce pays que Claudel décrit dans une lettre personnelle à Leger comme une sorte de “Robinson international” avec lequel, pour cette raison précisément, la France a un rôle à jouer. L’Angleterre, qui vient de dénoncer une ancienne alliance défensive avec le Japon destinée à l’origine à contenir les ambitions russes dans la région, peut donc être désormais comptée au nombre des nations potentiellement hostiles et dispose avec Hong-Kong et Singapour de bases navales formidables en Extrême-Orient. L’Allemagne vaincue est momentanément hors-jeu, la Russie bolchevique, la rivalité transpacifique avec les Etats-Unis se dessine, rendant l’affrontement à terme inéluctable. Reste la France, qui partage avec le Japon les mêmes intérêts de puissance coloniale aux marges du monde chinois, et qui pourrait tenter de prendre auprès de lui la place que les Anglais ont laissée vacante. C’est ainsi que le grand oeuvre politique de Claudel au Japon, celui dont il ne cesse d’entretenir ses correspondants au Quai, soit pour obtenir leur accord préalable soit pour se féliciter, c’est de bonne guerre, des succès obtenus, sera l’organisation de la visite officielle du Gouverneur général de l’Indochine française (mai 1924), prélude selon Claudel à un rapprochement franco-japonais qu’il appelle du plus profond de son être, car il traduit de sa part une connivence étroite et ancienne. Il n’a en effet cessé de désirer le Japon, fidèle en cela à l’attachement comme fasciné qui le lie à sa soeur aînée Camille, laquelle exsudait littéralement le japonisme qui, du temps de l’adolescence de Claudel, régnait en maître sur les milieux littéraires et artistiques. Par ailleurs, pour le jeune membre de l’administration consulaire qu’est Claudel au milieu des années 1890, le Japon, tout auréolé du succès de sa modernisation au forceps et du retentissement de sa victoire militaire sur la Chine, est le pays d’Extrême-Orient dans lequel il convient de se faire nommer, l’intérêt du travail et les possibilités d’avancement y étant sans comparaison. Mais, faute d’ancienneté ou d’appuis, ou des deux, le Japon échappe à Claudel malgré des candidatures réitérées, et il avouera sans détour dans les Mémoires improvisés que la Chine, qu’il devait tant aimer par la suite, n’est à l’heure de la première mission qu’il y effectue (consul suppléant à Shanghaï, 1895-96), qu’un “pis-aller2%6#8221 ;. Il ne manquera pas d’ailleurs, après trois ans d’affectation dans divers postes chinois, de profiter des quatre semaines d’un congé pour se précipiter dans le pays si longtemps rêvé, qu’il arpente en touriste consciencieux de Nagasaki à Nikko (nord-est de Tokyo) et retour, lui consacrant quelques pages éblouies de Connaissance de l’Est.
Il lui reste alors plus de dix ans de Chine, si l’on y inclut les deux congés statutaires d’un an qui entrecoupent son séjour. Consul à Tien-tsin de 1906 à 1909, il s’attend, on l’a vu, à un nouveau poste asiatique (Yokohama figurant parmi les destinations envisagées), lorsqu’il se retrouve à la faveur d’une “inspiration du Personnel” en Bohème alors autrichienne, puis en Allemagne où la déclaration de guerre le surprend et où il n’est pas loin de se faire prendre à partie par “une foule vociférante”. A l’exception d’une mission d’un an et demi au Brésil qui tient du roman d’aventures exotiques, il passe en Europe la seconde décennie du siècle. Lorsqu’il apprend en janvier 1921 sa nomination à Tokyo (il ne prendra possession de son poste qu’en novembre), ce n’est donc pas sans une sorte de plaisir gourmand qu’il écrit dans son journal : “Je vais donc le rouvrir une fois de plus, ce grand livre de l’Orient”.
Il va le rouvrir, certes, mais à une tout autre page. Pour des raisons qui tiennent à la nature même de la mission qui lui a été confiée, mais aussi au sentiment de plénitude qu’il ressent à exercer son métier, et cette fois au plus haut niveau de responsabilité, dans le pays qui a toujours fait l’objet de son plus grand désir, Claudel, pour l’unique fois dans sa longue carrière, va au cours de son ambassade japonaise accorder la priorité au culturel sur l’économique. Plus encore, car nous touchons ici au coeur même du processus de création chez un diplomate qui ne nous intéresse bien entendu si fort que parce qu’il est l’un de nos plus grands écrivains, le Japon, parce qu’il est doué d’une tradition artistique vivante pour laquelle Claudel éprouve une admiration sans nuances, va le mettre en situation de travailler avec des artistes locaux, et qui plus est des artistes majeurs (chose qu’il n’avait par exemple jamais fait en quinze ans de Chine), élaborant à leur contact des oeuvres de conception et de facture extrêmement originales, comme celles que vous pouvez découvrir dans le cadre de l’actuelle exposition. Les Japonais ne mesuraient sans doute pas combien donc était pertinent le surnom que leurs journaux avaient d’emblée donné à “l’Ambassadeur-poète” (shijin taishi) parce qu’il arrivait dans leur pays précédé de sa réputation de grand écrivain, ayant été traduit jusque dans leur lointain idiome dès les années 1900. Le trait d’union, qui rend tant bien que mal en français la juxtaposition des deux substantifs japonais dont le premier, shijin (le poète), qualifie comme adjectivalement le second, taishi (l’ambassadeur), exprime en revanche avec bonheur la fusion sans équivalent que le Japon réalisa chez Claudel entre l’écrivain et l’homme de métier. La mission japonaise de Claudel est en quelque sorte une mission de combat, et comme une poursuite de la guerre par d’autres moyens avec nos “anciens ennemis” devenus nos “rivaux”. L’Allemagne, pour vaincue qu’elle soit, conserve en effet au Japon les positions
Expérience de collaboration artistique aussi féconde en son genre que celle qu’il pourra avoir à d’autres périodes de sa vie avec des artistes comme Milhaud, Honegger, Barrault ou Ida Rubinstein, à cette énorme différence près qu’en l’occurrence il collaborait avec des artistes qui partageaient sa culture. Il avait travaillé brièvement avec le peintre à son arrivée au Japon, à l’occasion de la publication chez un éditeur local de l’une de ses oeuvres de guerre, Sainte-Geneviève, pour laquelle il souhaitait un frontispice à la japonaise. Keisen, qui habitait une petite maison au toit de chaume dans une zone restée aujourd’hui encore étonnamment rurale de l’ouest de Kyoto, avait fait tout exprès le voyage de Tokyo, et Claudel, grand marcheur, l’avait entraîné dans sa promenade quotidienne autour des douves du Palais Impérial. Keisen s’était acquitté de la commande de sa manière légère et quelque peu désinvolte en esquissant un troupeau de canards paressant au pied des murailles, tandis que Claudel reproduisait pleine page de sa fine écriture de fonctionnaire le premier des douze poèmes de La muraille intérieure de Tokyo, sacrifiant ainsi pour la première fois à l’antique manière de la peinture lettrée à la chinoise dont Keisen, artiste volontiers archaïsant et délibérément dédaigneux de la modernité (ce qui n’est pas obligatoirement le cas de ses deux glorieux aînés), était un adepte plutôt provocateur. Vous n’aurez donc aucune peine à déchiffrer sur l’exemplaire qui figure dans l’exposition la suite du poème dont je me borne à citer l’entame, et qui exprime le sentiment de malaise éprouvé par tous les étrangers abordant Tokyo (“Centre-ville, centre vide”, écrira Barthes dans L’Empire des Signes), et découvrant cette ville organisée autour d’une immense cité interdite qui conduit les usagers à un perpétuel glissement autour du centre qu’il convient d’éviter, de contourner, au rebours de toutes les habitudes urbanistiques occidentales. “Non point la forêt ni la grève chaque jour le site de ma promenade est un mur, Il y a toujours un mur à ma droite. Un mur que je suis et qui me suit et que je déroule derrière moi en marchant et devant moi il y en a encore provision et fourniture, Un mur continuellement à ma droite…” Les années avaient passé. Mettant à profit les loisirs d’une croisière sur la Mer Intérieure au printemps 1926, Claudel était revenu avec un ensemble de 172 poèmes courts où il avait visiblement cherché, sans céder toutefois à l’imitation formelle, à retrouver quelque chose de la manière et de la sensibilité du haiku, le poème bref (dix-sept syllabes) qui exprime traditionnellement l’émotion du poète japonais devant le spectacle (le plus souvent naturel) ou la situation de la vie quotidienne qui s’imposent à lui. Faisant appel à nouveau à Keisen aux fins d’illustration d’un choix de ces poèmes, Claudel allait s’engager dans un processus chronologiquement bref (quelques mois) mais d’une extrême complexité, qui, à la faveur d’un détour médian par la peinture in fine écartée, allait aboutir à cet objet littéraire sans précédent ni postérité que sont les Cent Phrases pour éventails , “le recueil de ces poèmes que jadis au Japon”, écrit-il à l’occasion d’une réédition tardive chez Gallimard (l’original est paru chez le japonais Koshiba), “à la recherche de leur ombre, j’ai essayé effrontément de mêler à l’essaim rituel des haï kaï”. […]

Cent phrases pour éventail
 Pin sous la neige
Pin sous la neige ZOOM : cliquer l’image

Le 1er décembre 1926, Claudel a reçu notification officielle de sa nomination à Washington. Il va y aller en traînant les pieds. Par bonheur (?) le décès de l’Empereur Taisho survient à point nommé pour lui offrir une prolongation de séjour de quelques mois, et l’occasion d’assister aux grandioses funérailles impériales, pour lesquelles il s’improvise à nouveau reporter, cette fois pour le compte de L’Illustration. Lorsqu’il se rend le 6 décembre à Osaka pour installer la Société de rapprochement intellectuel franco-japonais (cette dénomination semble résumer toute son ambassade, il s’agit de la fondation destinée à servir de tutelle juridique à l’Institut Franco-Japonais du Kansai, établissement culturel qui verra le jour dans la ville voisine de Kyoto à l’automne 1927), il sait que c’est “la dernière fois (qu’il fait) de Tokyo à Kyoto par la vieille route historique du Tokaido un pélerinage d’art et de beauté”, et son coeur se serre en contemplant “par la fenêtre de (son) wagon ce paysage d’hiver japonais d’un charme si harmonieux et si pénétrant”. Une fois ses obligations officielles accomplies à Osaka, il se précipite à Kyoto pour échanger une dernière fois “vers et dessins” (c’est l’un de ses grands plaisirs japonais) au cours d’un repas avec Takeuchi, et aussi pour rendre une ultime visite à Keisen dans la petite maison dont la rusticité l’enchante. Les deux hommes vident quelques coupes pour fêter l’achèvement de la peinture que Claudel a commandée pour le Musée du Luxembourg, laquelle reste aujourd’hui inexplicablement introuvable alors que l’on sait par son télégramme du 3 février 1927 que Claudel l’a dûment expédiée.
[…] Le 17 février, c’est le départ pour Washington via San Francisco. Claudel sait-il qu’il ne reviendra jamais dans le pays où, a-t-il dit à ses hôtes d’Osaka, il a passé “cinq des plus belles années de (s)a vie” ? Quoi qu’il en soit, de son arrachement au pays aimé il a d’ores et déjà dicté les conditions dans la dernière des Cent Phrases pour éventails, que vous n’aurez donc aucune peine à découvrir au terme des trois accordéons de papier qui forment le cadre matériel de cet étonnant recueil :
Si l’on veut
me séparer du Japon
que ce soit
avec une poussière
d ’
….or
Ce que le calligraphe japonais a sèchement ponctué d’un mot en deux idéogrammes qu’il a tracés avec une inhabituelle et donc intentionnelle netteté, un peu comme des caractères d’imprimerie qu’il a disposés de telle sorte qu’ils se trouvent séparés l’un de l’autre par le poème français, formant ainsi eux-mêmes un calligramme aux allures d’irrémédiable : betsu-ri (séparation).
(Michel WASSERMAN, Professeur, Faculté des Relations internationales, Université Ritsumeikan, Japon)
Crédit : http://www.ritsumei.ac.jp


Paul Claudel en 1926 tenant une marionnette de bunraku © Indivision Paul Claudel

Liens
 « Tokyo Time Table », Le site de Michaël Ferrier
« Tokyo Time Table », Le site de Michaël Ferrier
 Le dossier Sollers de Tokyo Time Table
Le dossier Sollers de Tokyo Time Table
 Le Japon de Roland Barthes : L’empire des signes
Le Japon de Roland Barthes : L’empire des signes
 Série Roland Barthes contre Série Le Bureau des Légendes
Série Roland Barthes contre Série Le Bureau des Légendes
[1] Sur Pékin et Shanghai, voir les Carnets de voyage dans la Revue des Deux Mondes : « Carnets de Chine : Pékin », octobre 2023, p. 100-104, « Carnets de Chine : Shanghai », décembre 2023-janvier 2024, p. 103-107.
[2] Voir Roland Barthes, « Centre-ville, centre vide », dans L’Empire des signes, Skira, 1970.
[3] . Un Tatar au Japon. Voyage en Asie, 1908-1910, traduit du turc ottoman par François Georgeon et Işik Tamdoğan-Abel, Actes Sud, 2004.
[4] 『友の会通信45号』, Lettre d’information des Amis du musée Suzuki Shintarô, 29 avril 2023. (Note du traducteur).
[5] Iwasaki Tsutomu, « À propos de Sollers, qui n’est pas venu au Japon » (« Rainichi shinakatta sorerusu no koto »), Cahier de poésie contemporaine (Gendaishi Techô), numéro spécial « Au-delà de l’Avant-garde », juillet 1985, Shichôsha, p. 108-114. Les citations de Jacques Henric et d’Iwasaki ci-dessous sont tirées du même article. Note du traducteur.
[6] « (Note du traducteur) »
[7] Watakushi-shôsetsu (mot à mot : « roman-je ») : genre littéraire japonais complexe, Souvent écrit à la première personne (en anglais, on le traduit par I-novel), et que l’on compare souvent à l’autofiction.
(Note du traducteur).
[8] ] Frédéric Beigbeder,
« Pour saluer Sollers », dans Le Figaro magazine, 6 mars 2015.
[9] R. Barthes, « Mère Courage aveugle » (1955), repris dans Essais critiques (1964), O.C., vol. II, Seuil, 2002, p. 313.
[10] « …je me rappelle très bien […] avoir été littéralement incendié par cette représentation, mais, je le dis tout de suite, incendié aussi par les vingt lignes de Brecht reproduite dans le programme. Je n’avais jamais rien lu un tel langage sur le théâtre et sur l’art » (R. Barthes, « Vingt mots-clés de Roland Barthes » (1975), IV, p. 868).
[11] R. Barthes, L’Empire des signes, op.cit., p. 346
[12] En gros : Opéra, Châtelet, Folies-Bergère (R. Barthes, « Folies-Bergère » (1953), O.C., vol. I, Seuil, 2002, p. 242).
[13] R. Barthes, L’Empire des signes, op.cit., p. 351.
[14] R. Barthes, Mythologies (1957), O.C., vol. I, Seuil, 2002, p. 788.
[15] R. Barthes, « Théâtre capital » (1954), O.C., vol. I, Seuil, 2002, p. 505.
[16] Bien plus tard, au Collège de France, Barthes anticipe d’éventuelles critiques envers son approche anhistorique du haïku : « On dira : vous faites une philosophie du haïku écrit (alors qu’à l’origine, il était évidemment dit) ; mais je ne m’occupe pas de l’origine, de la “vérité” historique du haïku ; je m’occupe du haïku pour moi » (La Préparation du roman. Cours et séminaires au Collège de France (1978-1979 & 1979-1980), Seuil-IMEC, « Traces écrites », 2003, p. 59).
[17] R. Barthes, L’Empire des signes, op.cit., p. 351. Par ailleurs, cette définition du « logothète » peut aider à comprendre la nature et la finalité de ces prélèvements : « …c’est quelqu’un qui sait voir dans le monde, dans son monde (social, érotique ou religieux), des éléments, des traits, des “unités”, comme disent les linguistes, qu’il combine et agence d’une façon originale, comme s’il s’agissait d’une langue nouvelle dont il produirait le premier texte » (R. Barthes, « Roland Barthes contre les idées reçues », op.cit., p. 568). Françoise Gaillard quant à elle fait de ce trait « une figure du refus de l’approfondissement » (« Autoportrait en Roland Barthes », Conférence, 2016, à écouter ci-après).
[18] R. Barthes, L’Empire des signes, op.cit., p. 351. Par ailleurs, cette définition du « logothète » peut aider à comprendre la nature et la finalité de ces prélèvements : « …c’est quelqu’un qui sait voir dans le monde, dans son monde (social, érotique ou religieux), des éléments, des traits, des “unités”, comme disent les linguistes, qu’il combine et agence d’une façon originale, comme s’il s’agissait d’une langue nouvelle dont il produirait le premier texte » (R. Barthes, « Roland Barthes contre les idées reçues », op.cit., p. 568). Françoise Gaillard quant à elle fait de ce trait « une figure du refus de l’approfondissement » (« Autoportrait en Roland Barthes », Conférence, 2016, à écouter ci-après).
[19] Ibid., p. 437.
[20] Ibid., p. 437.
[21] Ibid., p. 437.
[22] Ibid., p. 441.
[23] Ibid., p. 438.
[24] Ibid., p. 441.
[25] Jean-Pierre Richard, Roland Barthes, dernier paysage, Lagrasse, Verdier, 2006, p. 9 sq.
[26] Ibid., pp. 10 & 11. En 1979, Barthes fait référence au livre d’Edward Twitchell Hall, La Dimension cachée (1966), traduit en français en 1971, et à la proxémie, pôle de plus en plus présent, relève-t-il, des sciences du discours (« Présentation », O.C., vol. V, Seuil, 2002, pp. 662-665).
[27] R. Barthes, La Préparation du roman, op. cit., p. 232.
[28] « D’ailleurs, comme les individualités (humaines ou non) seraient dans ce livre faites d’impressions nombreuses, qui, prises de bien des jeunes filles, de bien des églises, de bien des sonates, serviraient à faire une seule sonate, une seule église, une seule jeune fille, ne ferais-je pas mon livre de la façon que Françoise faisait ce bœuf mode, apprécié par M. de Norpois, et dont tant de morceaux de viande ajoutés et choisis enrichissaient la gelée. », Marcel Proust, Le Temps retrouvé, Gallimard, 1927, p. 214. Ce texte est cité par J.-P. Richard, « Proust et l’objet alimentaire », Littératures, vol. 6, n° 2, « Lectures », 1972, p. 18. Je remercie mon ami Hervé Couchot de m’avoir mis sur la piste de cet article.
[29] « D’ailleurs, comme les individualités (humaines ou non) seraient dans ce livre faites d’impressions nombreuses, qui, prises de bien des jeunes filles, de bien des églises, de bien des sonates, serviraient à faire une seule sonate, une seule église, une seule jeune fille, ne ferais-je pas mon livre de la façon que Françoise faisait ce bœuf mode, apprécié par M. de Norpois, et dont tant de morceaux de viande ajoutés et choisis enrichissaient la gelée. », Marcel Proust, Le Temps retrouvé, Gallimard, 1927, p. 214. Ce texte est cité par J.-P. Richard, « Proust et l’objet alimentaire », Littératures, vol. 6, n° 2, « Lectures », 1972, p. 18. Je remercie mon ami Hervé Couchot de m’avoir mis sur la piste de cet article.
[30] L’auteur assurait la direction scientifique de la partie Claudel de la manifestation.
Professeur à la Faculté des Relations internationales, Université Ritsumeikan, Japon.




 Version imprimable
Version imprimable


 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?


