Julia Kristeva
Dostoïevski face à la mort
ou le sexe hanté du langage

Dostoïevski face à la mort
ou le sexe hanté du langage

Parution : octobre 2021
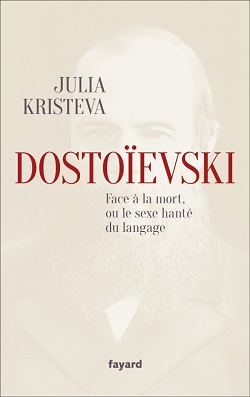
LIRE ARTICLE
Julia Kristeva, aimer Dostoïevski ?
par Philippe Forest, Art press, novembre 2021





 Version imprimable
Version imprimable


