
- Gilles Kepel./ Photo C. Hélie, Gallimard.
L’année 2015 aura été marquée en France par des actes terroristes jamais vus jusqu’alors : en janvier l’attaque de la rédaction de Charlie hebdo et de l’hyper cacher ; en novembre dernier celles contre le Bataclan et des terrasses parisiennes. Depuis plus d’un mois, l’état d’urgence est décrété, l’enquête sur les attentats progresse et la révision constitutionnelle promise par le Président Hollande se dessine. Mais les politiques ont pris la mesure des événements ? Prennent-ils les bonnes options ?
Spécialiste de l’islam et du monde arabe contemporain, Gilles Kepel, qui publie « Terreur sur l’hexagone », un ouvrage retraçant le basculement vers le djihad « de troisième génération » – celui-là même qui a frappé la France en 2015 – répond à nos questions.
État d’urgence, perquisitions administratives… Que vous inspirent les réponses politiques apportées au phénomène terroriste ?
Les mesures de police, l’état d’urgence, ce sont des mesures symptomatiques. Comme quand on met un garrot pour stopper un saignement. Faisons attention à ne pas tomber dans le piège tendu par Daesh, qui veut réduire la capacité démocratique de la France. D’autant qu’en novembre 2015, Daesh a raté sa cible.
En quoi ont-ils « raté leur cible » ?
L’économie politique du terrorisme djihadiste est à la fois fragile et double : d’une part il faut sidérer l’adversaire, l’obliger à se raidir, et d’autre part, il faut galvaniser les sympathisants pour avoir des soutiens. Or, contrairement au 7 janvier, on peine après le 13 novembre à trouver des gens qui expriment publiquement le moindre soutien à Abaaoud, le cerveau présumé du 13 novembre et à ses comparses. Le fait que ces attaques aient ciblé la jeunesse, dans laquelle il y avait aussi de jeunes musulmans, a suscité un rejet massif.
Nos responsables politiques ont-ils perçu ce changement ?
Je ne suis pas complètement sûr que les autorités françaises se soient donné les moyens d’analyser ce phénomène dans ses dimensions politique et culturelle. Le fait que les cercles gouvernementaux, tenus par la haute fonction publique, soient totalement coupés de la réflexion universitaire sur ces sujets les amène à faire des erreurs d’appréciation.
Vous parlez d’une coupure avec le monde universitaire. Avez-vous personnellement été sollicité, en tant que spécialiste, par l’exécutif ?
J’ai remis, le 15 janvier dernier, un rapport à Manuel Valls. Ce rapport, qui était le produit d’une mission menée dans 23 pays après avoir interrogé près de 300 personnes, évoquait la situation catastrophique de l’étude du monde arabe et de l’islam en France, qui est pourtant fondamentale. Ce rapport a été enterré sous la pression des réseaux proches des partis politiques, qui ont leurs propres experts – généralement bidon – et de la haute fonction publique.
Il existerait donc une forme de cécité de nos élites ?
Oui, et j’en veux pour preuve le discours de François Hollande, qui a déclaré que nous étions en guerre contre une armée djihadiste. En France, il n’y a pas d’état de guerre. Et nous ne sommes pas menacés par une armée de djihadistes. Si l’on regarde les parcours d’Abaaoud et consorts, on voit surtout des méthodes de truands, qui ont mitraillé des gens à la terrasse des cafés. Abaaoud, lorsqu’il a pris la fuite, a sauté par-dessus le tourniquet du métro de la station Croix de Chavaux à Montreuil, s’est réfugié avec des Roms sur un talus de l’A86, avant de finir dans un squat où il a été liquidé…
Vous expliquez que les événements de 2015 sont la conséquence d’un processus entamé en 2005, avec les émeutes de Clichy Sous-Bois ? Mais comment a-t-on pu laisser prospérer cette situation ?
On a préféré ne pas voir. Et puis on a raté le virage de ce djihadisme de troisième génération, construit sur Youtube et les réseaux sociaux, théorisé par Abou El Mansouri et diffusé dans « l’incubateur carcéral » qu’est devenue la prison. L’administration pénitentiaire fait face à un gros problème : en déléguant la paix sociale au caïdat comme on l’a déléguée en banlieue aux salafistes, on favorise la radicalisation. La prison permet de « répandre la bonne parole » Imaginez qu’en 2005, à Fleury-Mérogis, vous avez Djamel Beghal — qui est le principal idéologue d’Al Qaeda — enfermé au quatrième étage, et en dessous Cherif Kouachi et Coulibaly. Et ces gens-là communiquent…
Vous évoquez Abou El Mansouri et son « appel à la résistance islamique mondiale », publié en 2005 et qui, lui aussi, est passé inaperçu…
Ce texte, que certains spécialistes ont pris pour une vague feuille de route, c’est le mode d’emploi du djihadisme moderne. Il prône, contrairement au djihadisme pyramidal d’Al Quaeda, un djihadisme par le bas, fait d’actions isolées. Cela a plutôt bien fonctionné jusqu’ici, même si le 13 novembre en marque les limites.
Quelles sont ces limites ?
Ceux qui commettent ces actes ne sont pas mandatés par une organisation qui avait tout prévu, comme c’était le cas avec Ben Laden. Ils se lancent un peu dans le vague. Ils ont tué beaucoup de monde, comme peuvent le faire des truands. Mais ils ont été incapables de faire exploser leurs ceintures au Stade de France, et la fin misérable d’Abaaoud est bien le signe qu’on n’a pas une armée en face de soi. Agir comme une armée face à ces gens-là, c’est se tromper de cible. Et c’est aussi prendre le risque, alors qu’ils sont en train d’être isolés au sein de leurs sympathisants, de les remettre en selle.
Votre analyse de la montée parallèle du Front National et du radicalisme djihadiste a suscité la colère de Marine Le Pen. Qu’en avez-vous pensé ?
L’un se nourrit de l’autre, et inversement. Madame Le Pen prospère sur le terrorisme et la peur qu’il inspire et Daesh voit d’un très bon œil la progression du Front National. Parce que cela va favoriser la stigmatisation de la population musulmane que Daesh pense pouvoir réunir derrière sa bannière. De mon point de vue, Madame Le Pen a surréagi, en utilisant d’ailleurs des photos de Daesh… Mais ce qui est intéressant c’est que la France, dont nos compatriotes musulmans, n’a pas réagi comme pouvaient l’imaginer le Front National et Daesh] [1]. Il y a d’abord eu ce vote du deuxième tour. Puis, contrairement aux attentats de janvier, les musulmans français ont pris la parole pour défendre leur religion face à la captation qu’en faisaient les salafistes et les djihadistes. C’est une réaction totalement différente.
Propos recueillis par Samuel Ribot, ALP (La Dépêche)
Chronique matinale sur France Culture : Le Monde selon Gilles Kepel.
« Terreur dans l’Hexagone, Genèse du djihad français »
Gilles Kepel (avec Antoine Jardin). Gallimard. 21 €.
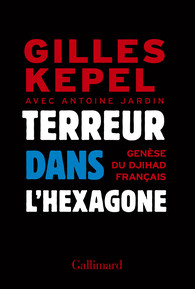 Parution : 15-12-2015
Parution : 15-12-2015
Pendant les dix ans qui séparent les émeutes de l’automne 2005 des attentats de 2015 contre Charlie Hebdo puis le Bataclan, la France voit se creuser de nouvelles lignes de faille. La jeunesse issue de l’immigration postcoloniale en constitue le principal enjeu symbolique.
Celle-ci contribue à la victoire de François Hollande aux élections de 2012. Mais la marginalisation économique, sociale et politique, entre autres facteurs, pousse certains à rechercher un modèle d’« islam intégral » inspiré du salafisme et à se projeter dans une « djihadoshère » qui veut détruire l’Occident « mécréant ».
Le changement de génération de l’islam de France et les transformations de l’idéologie du djihadisme sous l’influence des réseaux sociaux produisent le creuset d’où sortiront les Français exaltés par le champ de bataille syro-irakien. En 2015, plus de huit cents d’entre eux le rejoignent et plus de cent trente y trouvent la mort, sans compter ceux qui perpètrent leurs attentats en France.
Dans le même temps, la montée en puissance de l’extrême droite et les succès électoraux du Front national renforcent la polarisation de la société, dont les fondements sont aujourd’hui menacés de manière inédite par ceux qui veulent déclencher, dans la terreur et la désolation, la guerre civile.
C’est à dénouer les fils de ce drame qu’est consacré ce livre. Gallimard
LIRE AUSSI : Gilles Kepel : Les services de renseignement ont raté la mue du djihadisme pdf





 Version imprimable
Version imprimable Redécouvrir la maîtrise littéraire étourdissante de Paul Auster en sept romans clés
Redécouvrir la maîtrise littéraire étourdissante de Paul Auster en sept romans clés


