Il y a cinquante ans, Philippe Sollers publiait son sixième roman H, premier livre écrit sans signes de ponctuation — sans ponctuation visible.
Sollers, dans le film de Georgi K. Galabov et Sophie Zhang sur Le génie féminin de Julia Kristeva, présenté au Colloque international de Cerisy en juin-juillet 2021, revient précisément sur l’analyse que Kristeva a consacrée à ce roman dans son essai monumental Polylogue.

« Les raisons pour lesquelles ce livre ne peut pas comporter de présentation seraient sans doute aussi longues à exposer que ce livre lui-même. Il faut donc éprouver son rythme : dictions, timbres, accents, ponctuation latente, tourbillon, flot, appels. Au-delà de l’automatisme un calcul joue, veille, critique, partant à la fois de tous les points de l’histoire. Ce calcul se dit par masses dans l’unité discontinue de ses coupes. Il module, frappe, chuchote, apostrophe, marque, efface, compte, signale l’absence mouvante mais cependant adressée, dialoguée, de toute langue de fond. Il récite ses abréviations ivres, ses ensembles bordés d’excès. Il insiste et force l’oreille interne, radar tournant sous un souffle passant où il veut, quand il veut.
Voilà, détendez-vous, c’est clair. Restez sur le sens, c’est simple.
Ils sont deux, ici, dans la nuit. Tempo. »

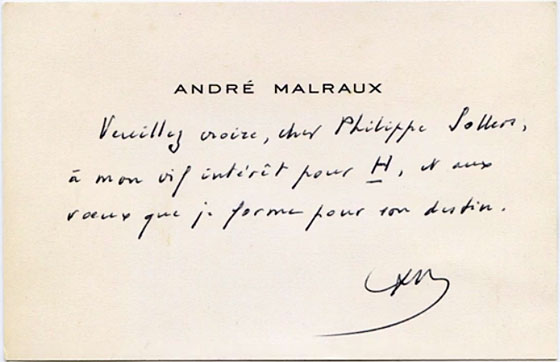
« mais est-ce qu’on peut mettre le tout en vrac en jet continu personne ne pourra naviguer là-dedans c’est sûr la ponctuation est nécessaire la ponctuation vieux c’est la métaphysique elle-même en personne y compris les blancs les scansions tant pis il faut que les acteurs fassent désormais un peu de gymnastique sans quoi on n’en sortira jamais »
« il y a au-dessus leur vague la grande vieille vague oubli de la terre promise fairest isle all isles excelling seat of pleasure and love [1] allume le tube apprends à patienter »
« ce qu’on voit est parfois tout près de ce qu’on écoute limit of the diaphane why in diaphane adiaphane if you can put your five fingers through if it is a gate if not a door shut your eyes and see [2] »
« imagine que nous répétions tous les anciens gestes libations invocations rituel marqué pour tresser le vide avant de passer à l’action s’enfonçant depuis le futur attends attends c’est le moment de reprendre de façon plus large »
« non les flics ne pourront pas défigurer notre programme je dis au contraire qu’avec ça nous nous installons au coeur du pouvoir qu’on le fait sauter si on tient sur les points obscurs »
Philippe Sollers, H, Seuil, coll. Tel Quel, 1973, p. 14, 22-23 et 56.

Survol
H a été écrit juste après Lois. Publié en 1973, ce roman a souvent été présenté comme un roman de transition préparant Paradis. Ce n’est pas faux. Il a pourtant son existence propre qui mérite qu’on le lise pour lui-même. Peu l’ont fait.
Philippe Forest, dans son essai sur Philippe Sollers (Seuil, « Les contemporains », 1992) le mentionne, bien sûr, mais passe très vite : 40 pages sur Lois, 50 pages sur Paradis (remarquables), quelques lignes seulement sur H.
Forest écrira d’ailleurs lui-même, quelques années plus tard : « ... H, le plus oublié des romans de Sollers, perdu un peu dans l’ombre que fait porter sur lui le monument, à peine postérieur, de Paradis. » (art press 364, février 2010)
Heureusement, Roland Barthes, dès 1973, écrivait un très beau texte, Par-dessus l’épaule (repris dans Sollers écrivain, 1979). Avec cette phrase : « Je m’entête donc, et je dis du livre de Sollers qu’il est beau. » Voilà : c’est bien de commencer par là.
Et puis, il y a l’analyse, décisive, de Julia Kristeva : Polylogue, publié dans Tel Quel 57 (printemps 1974) et repris dans le volume éponyme (Seuil, coll. Tel Quel, 1977 [3]). Est-ce un hasard si Philippe Sollers dans le petit film de Georgi K. Galabov et Sophie Zhang, présenté au Colloque international de Cerisy en juillet 2021, sur Le génie féminin de Julia Kristeva, revient précisément sur cette analyse, sur ce Polylogue ?
Je cite un passage de Kristeva :
« H explore précisément ce moment que tant de philosophies et de dogmatismes visent à recouvrir : le moment où le matérialisme peut se parler (...). Le sujet se perd dans le procès matériel et historique, mais il se reconstitue, reprend son unité et parle, rythmé, sa dissolution aussi bien que son retour. Le discours matérialiste, lorsqu’il s’énonce en rythme, est d’une gaieté déchirée de douleur. » (p 198)
Est-ce ce matérialisme, ce rythme, qu’on n’a pas voulu comprendre ? On peut le penser. A peu près en même temps, Sollers publie Sur le matérialisme. Qui a lu ce livre ? Personne [4].
Sur la couverture de H, un curieux diagramme. Qui l’a vu ? Qui en a parlé ? Il est pourtant sur la couverture (et même repris sur la première page) de la première édition, au Seuil, comme, vingt-huit ans plus tard, sur celle de la réédition chez Gallimard.
Ce diagramme est de Giordano Bruno. Qui connaît, qui a lu Giordano Bruno ? Pas au programme des universités.
H a été publié en mars 1973 (Le Seuil, coll. Tel Quel). Rappelons le 4e de couverture :
« Les raisons pour lesquelles ce livre ne peut pas comporter de présentation seraient sans doute aussi longues à exposer que ce livre lui-même. Il faut donc éprouver son rythme : dictions, timbres, accents, ponctuation latente, tourbillon, flot, appel. Au-delà de l’automatisme un calcul joue, veille, critique, partant à la fois de tous les points de l’histoire. Ce calcul se dit par masses dans l’unité discontinue de ses coupes. Il module, frappe, chuchote, apostrophe, marque, efface, compte, signale l’absence mouvante mais cependant adressée, dialoguée, de toute langue de fond.
Voilà, détendez-vous, c’est clair. Restez sur le sens, c’est simple.
Ils sont deux, ici, dans la nuit. Tempo. » — Ph.S.
La première page de H
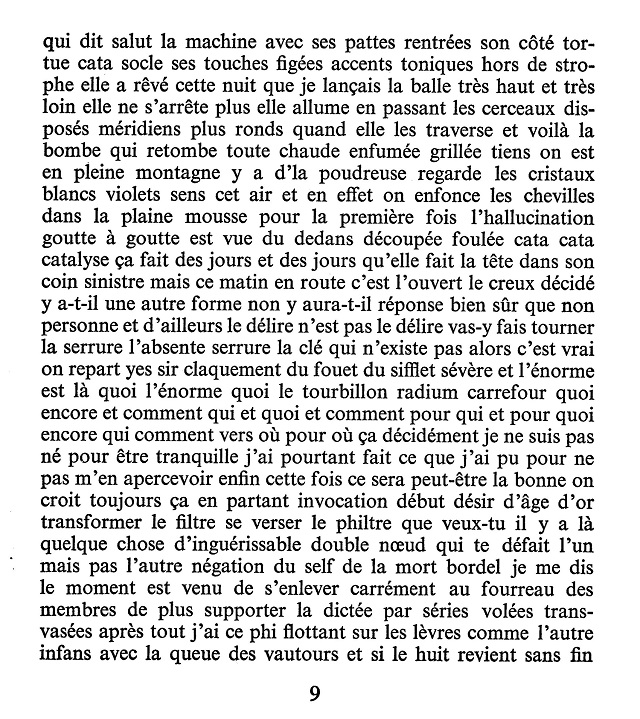
La première page de H.
ZOOM : cliquer sur l’image.

Ce qu’en dit Julia Kristva dans Polylogue
Au-delà de la phrase : le transfini dans la langue
Sans ponctuation, H n’est pas une phrase, mais il n’est pas moins qu’elle. Les propositions sont là : courtes et régulières, sans qu’aucune anomalie syntaxique ou lexicale vienne en troubler la clarté. Il est facile de « rétablir » les phrases, de ponctuer, d’isoler les noyaux propositionnels simples constitutifs du texte qui court. On perdra des ambiguïtés sémantiques et logico-syntaxiques, mais on perdra surtout une musique. J’entends par musique l’intonation et le rythme qui ne jouent que très subordonnés dans la communication usuelle, mais qui, ici, constituent l’essentiel de l’énonciation et nous conduisent tout droit au lieu, autrement muet de son sujet. Vous retrouvez vous-même la musique si vous vous laissez porter par ces atomes phrastiques non ponctués ; vous pouvez la vérifier, si vous voulez, en écoutant lire l’auteur-acteur. Vous constatez que là où, banalement, la voix devait se poser, se baisser et s’éteindre pour suggérer une limite, un point, elle s’élève, relève le point et, au lieu de déclarer, interroge ou postule. De sorte que la limite phrastique est là, le sens (position d’un sujet d’énonciation) et la signification (dénotation possible, vraisemblable ou vrai) persistent, mais le procès sémiotique ne s’arrête pas à eux. Au lieu d’être des limites supérieures de l’énonciation, la phrase-le sens-la signification sont ici des limites inférieures. A travers ces limites et avec elles, mais non pas en deçà reviennent des processus qu’on a pu dire « primaires » et que dominent l’intonation et le rythme. Ce retour, appliqué au morphème, produit, on le sait, des « figures stylistiques » : des métaphores, des métonymies, des ellipses, etc. Ici, le retour intonationnel, rythmique, disons pulsionnel, se place au lieu le plus fort de ’ta nomination : au lieu thétique de la syntaxe inéluctable qui coupe la jubilation auto-érotique indistincte du corps de la mère, se reconnaît dans un miroir et déplace la motilité pulsionnelle dans un signifiant logifiable. La relève de la pulsion, à travers cette limite et sans éluder sa coupe, situe l’expérience sémiotique au-delà de la phrase, et donc au-delà de la signification et du sens.
Les pratiques dites artistiques ont, depuis toujours, exercé leur fascination du fait qu’elles se dérobaient à cette limite dont s’instaure la signification (toujours déjà phrastique), et ressuscitaient le malaise d’une régression avant le stade du miroir. Avec H, nous ne sommes plus dans ces régions de l’esthétique qui ne continuent pas moins à bouleverser l’ordre logique plat en faisant agir, de nos jours, les pratiques les plus éveillées, révoltées, modernes : mais c’est en musique que cette action trouve son terrain d’élection. Cage, La Monte Young, Kagel, Stockhausen nous le font entendre.
[...]
Nous sommes donc dans une composition où la phrase est l’unité minimale à partir de laquelle se constitue un tissu qui l’excède, mais ne l’ignore pas : plus-que-phrase, plus-que-sens, plus-que-signification. Si perte il y a, si une dépense s’opère, ils ne sont jamais en moins, mais toujours en plus : plus-que-syntaxique. Il n’y a pas d’épuisement du mouvement logique sans accomplissement de son trajet : l’achèvement de la raison passe par la plénitude la raison et la crève après l’avoir comblée : « une raison en enfer » (p. 26). Sans quoi, la raison persiste comme pouvoir et réclame son droit de contrôle sur ta dérive qui l’ignore. Sans quoi, la littérature se prête au défi hégélien qui n’y découvrait que quelques perles de pensées dans un tas de foin. H expose une pratique où la raison, présente et excédée, n’a pas de pouvoir ; où l’antipouvoir de la pulsion est privé à son tour de son emprise hallucinatoire, parce qu’il est filtré à travers la rigueur de la phrase ; où le surmoi logique et l’oralisation fétichiste se neutralisent mutuellement, sans maîtrise et sans régression.
A regarder de près le début de H, on remarque que les phrases, aisément détachables de l’ensemble textuel, s’emboîtent ou bien se juxtaposent de manière ambiguë à cause d’ellipses de déterminants (particules de subordination, pronoms relatifs, etc.). Cette ambiguïté est accentuée du fait que les syntagmes prédicatifs se donnent, dans les structures de surface, comme des syntagmes nominaux, attributifs, juxtaposés, et pouvant se rapporter, de façon multiple, au syntagme nominal sujet ; ou bien la suite prédicative elle-même, pour des raisons sémantiques ou de longueur, se scinde en syntagmes à fonction de sujet et en syntagmes à fonction de prédicat. A ajouter également : l’ambivalence des pronoms personnels dont le référent est indécidable : « elle » de la première page est aussi en « la machine », une « femme » que la « balle ». Des réseaux allitératifs (corrélation de « différentielles signifiantes ») opèrent des circuits trans-phrastiques qui se superposent à la suite linéaire des propositions et font intervenir, dans la mémoire logique-syntaxique du texte, une mémoire phonique-pulsionnelle : établissant des chaînes associatives qui sillonnent le texte du début à la fin et dans tous les sens : son côté cata socle (9, 1-2 [5]) — accents toniques (9, 2) cata cata catalyse (9, 10-11) ; filtre, philtre (9, 23) — phi flottant (9, 28) — philippe filioque procedit — l’fil (10, 23-24) ; clé (9, 15) claquement (9, 16) — glaïeul clocher clé de sol (10, 6-7) ; sollers-sollus (11, 1) ; etc.
A travers ces ambiguïtés, ces polyvalences, des séquences phrastiques se constituent quand même, qui sont délimitées, dans la lecture, par un seul mouvement respiratoire donnant lieu à une intonation généralement ascendante. Ce souffle porte donc une suite de phrases qu’unit, en même temps, un sens (une position du sujet de l’énonciation) et une signification (une dénotation virtuelle). Un mouvement respiratoire coïncide donc avec une posture du sujet parlant et avec une possibilité de dénotation. Le prochain mouvement respiratoire introduira une nouvelle posture du sujet parlant et une nouvelle dénotation. Le corps et le sens, inséparables, construisent ainsi une partition démembrée : l’arrêt du souffle et la finitude syntaxique, inséparables, sont relancés, mais dans un autre domaine logique, et comme s’ils prenaient appui sur un autre territoire du corps-support.
Les frontières qui constituent une séquence comme unité de respiration, de sens et de signification (grammaticalement construite comme une suite de phrases), sont très variées et désignent la motilité du sujet de l’énonciation : sa possibilité de résurgence et de métamorphose. En voici quelques-unes, dans le début du texte :
— Le pronom personnel elle (9, 3) marque la limite de la séquence précédente et embraye vers une autre unité de respiration-sens -signification. Réponse à l’interrogation initiale (« qui dit salut »), reprise de la « machine », ou rappel d’une énonciation hétérogène, d’un « elle » qui impulse la « machine » et déclenche ses « accents toniques » -en tout cas, déplacement de l’anonymat machinique vers « elle », le rêve et le mouvement lancé -la deuxième frontière est marquée par « elle » devenue « balle », « bombe qui retombe ». Notez que le « je » du sujet énonçant le texte s’énonce pour la première fois dans un rêve d’« elle » : « elle a rêvé cette nuit que je lançais la balle » (9, 3). La narration est ouverte : « elle » y est, à la fois, sujet énonçant et actant du récit, tout comme « je ». Je/elle — marque de l’altération sexuelle et discursive maximale, trauma et saut, début de récit.
— L’énonciation déclarative, ayant ainsi succédé à l’interrogation, se coupe à son tour et se trouve remplacée par l’impératif : « tiens on est en pleine montagne y a d’la poudreuse regarde les cristaux blancs violets sens cet air ». « Je » prend la parole et commande dans le récit désormais déclenché.
— Une position métalinguistique suit, qui commence le trajet effectué du corps muet mis en jeu par le rêve d’une autre et placé désormais en état de commander cette altérité narrative, fantasmatique, hallucinée : « pour la première fois l’hallucination goutte à goutte est vue du dedans découpée foulée ».
— Irruption des onomatopées : « cata cata catalyse », rappelant le son de la machine à écrire lancée, marquant le courant biologique, électrique, signifiant, à l’infini... Cassure, donc, de la maitrise métalinguistique précédemment affirmée ; rappel de la dissolution lexicale, des salves pulsionnelles passant par les phonèmes : la position métalinguistique ne dominera pas.
— Nouvelle reprise du récit, avec « elle » : la machine, la femme ?...
— Encore la métalangue : « y a-t-il une autre forme non y aura-t-il réponse bien sûr que non personne et d’ailleurs le délire n’est pas le délire ».
— En quelques lignes, plusieurs nouvelles frontières analogues aux précédentes, amenant un « je » explicite (« je ne suis pas né pour être tranquille ») qui commence son récit « propre », mais de nouveau dérapant, impossible à fixer, flottant cette fois à travers de nouvelles frontières que désignent les références historiques et biographiques.
— « Je » ne se cherche pas, « je » se perd dans une série de renvois à des événements logiques ou politiques qui, dans le passé ou le présent, déterminent une semblable mobilité du sujet lancé dans le tourbillon de son morcellement et de son renouvellement : de son « ex-schize » (82). Scission mortelle, mais « exquise » (ironisation du « cadavre exquis » de l’automatisme surréaliste), parce que antérieure, reprise relançante, prophétique. Ainsi, au début, ce renvoi au « filtre » ou au « philtre » magiques, structurant et régénérant l’ivresse d’une identité éclatée, mais non perdue ; ou ce « phi flottant sur les lèvres comme l’autre infans avec la queue des vautours » : rappel de l’interprétation donnée par Freud d’un rêve de Léonard de Vinci ; ou le prénom et le nom paternels induisant à travers des séries signifiantes toute une panoplie de signifiés, indéfiniment ouverte, chaque élément donnant lieu à un mini-récit qui est ce que nous avons appelé une « séquence » : unité de respiration de sens et de signification, recueillant des souvenirs d’enfance ou des raccourcis historiques par une ribambelle de rois homonymes ; ou bien ces renvois à la Bible : « on a le même mot en hébreu pour nu rusé éveillé » (11) ou au Coran : « celui qui recevra son livre dans la main droite ça pourra aller mais celui qui le recevra derrière son dos paf zéro » (12).
[...]
Dans la transcription ci-dessous nous essayerons de "rétablir" la ponctuation classique : le signe + marque les ambiguïtés syntaxiques (emboîtements indéfinis) qui persistent après ce rétablissement ; le signe / / note les frontières des séquences ; les lignes au-dessus des phrases indiquent la courbe de l’intonation. Les traits recoupant le texte signalent quelques réseaux de différentielles phoniques-signifiantes.
On remarque que l’intonation, en fait, ponctue le texte : la "scansion" vocalique correspond généralement au découpage syntaxique et, en ce sens, elle réduit certaines ambiguïtés qui subsistent si on se contente de rétablir la ponctuation classique écrite. Mais la scansion vocalique ne s’identifie pas à la ponctuation courante : la scansion établit des séries vocaliques dont l’agencement est aussi autonome par rapport à la portée signifiée, car ce rythme se soutient de lui-même, comme si une envolée de l’énonciation, par le souffle découpé, excédait les limites des phrases et les frontières des séquences, et rappelait, dans le phénotexte, une "langue de fond" qui n’est que rythme. On est frappé par la régularité de ce souffle qui s’élève et se suspend à intervalles précis : soit succession de portées courtes, soit une portée longue suivie de trois courtes ; mais souvent cassées, raccourcies ou dramatisées par l’introduction d’accents toniques. Cette scansion qui se surajoute à la ponctuation sous-jacente et désigne l’impuissance de celle-ci à saisir "la langue de fond rythmée", frappe l’inconscient comme une violence calmée et épouvantable, mais que l’écoute consciente enregistre comme une monotonie invocante, lyrique — une sorte de Mozart thibétain.
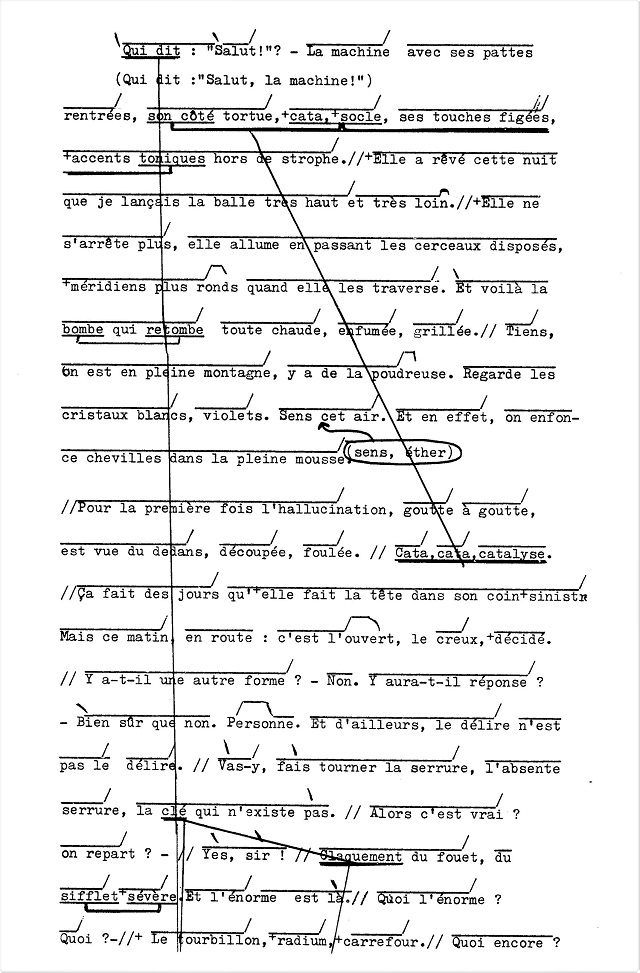
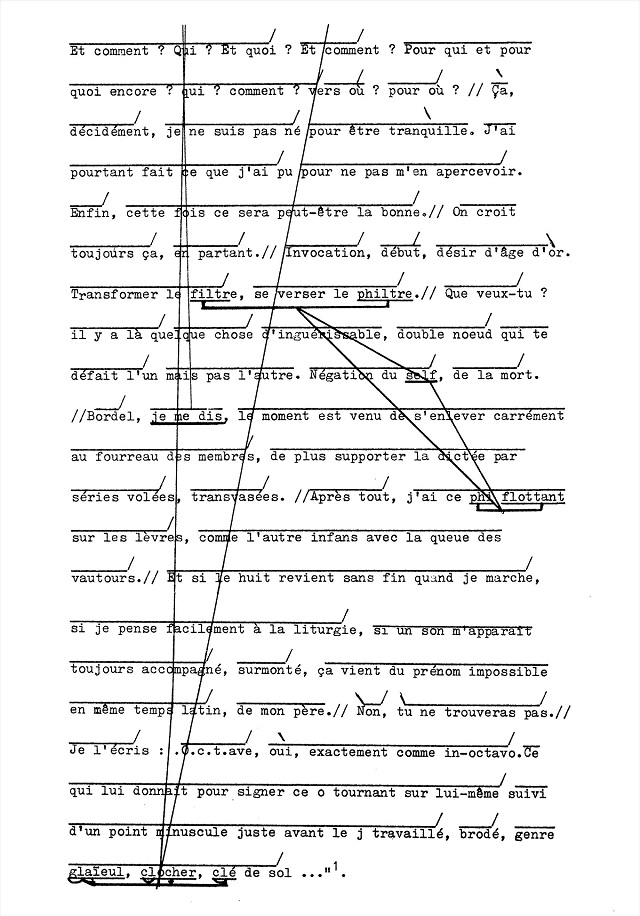
Tapuscrit. Le début de H.
ZOOM : cliquer sur l’image.

Julia Kristeva, Polylogue, Tel Quel 57, printemps 1974, p. 24-27 et 32.
Dans le livre (coll. Tel Quel, 1977), p. 180-185 et 190.
H : La lettre
H. Que désigne cette lettre latine (la huitième de l’alphabet et la sixième des consonnes) ?
« H latin, Η grec, heth phénicien. Le sens et la forme de heth, 𐤇, sont d’accord pour signifier une haie, une clôture ; le signe hiéroglyphique de la haie est devenu le caractère de tous les mots commençant par le même son. »
« En musique, H chez les Allemands désigne le si. »
« Anciennement, être marqué à l’H, être battu. Prions seulement que cette ordonnance ne porte son appel en croupe, que les commissaires l’effectuent pour notre profit et pour notre consolation, et ainsi nous aurons la paix chez nous ; car, si elle est observée, nous aurons plus de biens et moins de coups ; nous sommes le plus souvent marquées à l’H, pour montrer que notre peau est tendre, la Réjouissance des femmes sur la défense des tavernes et cabarets, Paris, 1613, dans CH. NISARD, Parisianismes, p. 136, qui pense que cette locution provient d’une allusion aux lettres par lesquelles commencent le plus souvent des noms de coups et d’instruments servant à donner des coups : horion, heurt, hoche, hache, etc. » (Littré)
« Chez les Anciens l’H estoit une lettre numerale qui signifioit 200. » (Dictionnaire universel de Furetière, 1690, cité par le dictionnaire Robert).
C’est l’hydrogène, l’élément chimique (la bombe H).
C’est bien entendu le hasch : de l’arabe حَشَّاشِين, soit haschashin, le fumeur de haschich... la secte persane des Haschischins (XIe siècle) d’où, a-t-on longtemps pensé, dériverait le mot « assassin ».
« Petite veille d’ivresse, sainte ! quand ce ne serait que pour le masque dont tu nous as gratifié. Nous t’affirmons, méthode ! Nous n’oublions pas que tu as glorifié hier chacun de nos âges. Nous avons foi au poison. Nous savons donner notre vie tout entière tous les jours.
Voici le temps des Assassins. » (Rimbaud, Matinée d’ivresse)
Vérifications quarante-cinq ans plus tard :
2015 (Technikart, décembre 2015 - janvier 2016) : J’ai eu la curiosité de me demander si ce n’était pas une tradition très ancienne et j’ai appris qu’elle remontait aux « vieux de la montagne », une secte ismaïlienne fondée en Iran et en Syrie au XIe siècle. Vous avez affaire à un personnage tout à fait important — puisqu’il faut maintenant apprendre des noms arabes —, Hasan-i Sabbâh. Les Vieux de la montagne avaient l’habitude de bourrer leurs tueurs de haschisch, ce qui permettait de les envoyer à la mort. Ils tuaient des croisés. Et les croisés, voyant ces gens qui n’avaient absolument pas peur de mourir et qui les tuaient allègrement, les ont appelés les haschischains. C’est devenu « assassin » par dérivation.
Je vous conseille vivement, ainsi qu’à vos lecteurs, de prendre, dans les Illuminations de Rimbaud, le texte « Matinée d’ivresse » : « Nous avons foi au poison / Nous savons donner notre vie toute entière tous les jours / Voici le temps des assassins. ». Relisez Rimbaud : les assassins sont des gens profondément sous substances.
2017. (cf. Philippe Sollers l’éclaireur, 5eme entretien, 20 janvier) :


Si j’en crois la lettre que Sollers envoya à Dominique Rolin du Martray le 26 avril 1973, la fin de H fut écrite à Venise :
« Je repense à la mort de Pound, pendant que j’achevais H. Il y a eu un moment extraordinaire où il était assis devant Seguso [6], près des géraniums, et où, brusquement, j’ai vu que nous étions ensemble sur une des corniches du Purgatoire, dans la "Divine Comédie". Et je me suis dit : maintenant, ça va. Et je pensais qu’il devait sentir, sans que rien soit dit, qu’il avait été "rencontré" (donc qu’il pouvait mourir). Rencontré, lu, déchargé d’une longue attente. Tout cela était calme, lumineux, très dramatique, avec le vent léger, les bateaux — et je crois que ce "souffle" passe — passera à jamais — dans la fin de H. » (Lettres à Dominique Rolin 1958-1980, Gallimard, 2017, p. 232)
Les derniers mots du roman sont : « sors rentre vite et si la voix crie tombant d’hydrogène alors que crierai-je crie lui toute chair est comme l’herbe l’ombre la rosée du temps dans les voix » (c’est moi qui souligne. A.G.)
H, c’est aussi le titre d’une des Illuminations de Rimbaud :
« Toutes les monstruosités violent les gestes atroces d’Hortense. Sa solitude est la mécanique érotique ; sa lassitude, la dynamique amoureuse. Sous la surveillance d’une enfance, elle a été, à des époques nombreuses, l’ardente hygiène des races. Sa porte est ouverte à la misère. Là, la moralité des êtres actuels se décorpore en sa passion ou son action. — O terrible frisson des amours novices sur le sol sanglant et par l’hydrogène clarteux ! trouvez Hortense. » (c’est moi qui souligne [7])
Dans le numéro 3 d’art press, Sollers notait déjà :
« Wo es war, soll dervich werden. C’est-à-dire : une danse-vertige du "je pense" avec son langage, comme si celui-ci commençait à "pleuvoir" (je note au passage que la lettre h dans les inscriptions runiques vient du mot hagall, qui signifie : grêle). »
« H, hydrogène, haschich (Rimbaud établit l’équivalence). Mais aussi cette citation d’Artaud disant qu’au Mexique il a vu un peu partout dégagée par le feu, cette lettre, " le H de la génération en somme ". Rappel du HCE de Finnegans Wake. Dans l’écriture ogamique par entailles le A et le H s’écrivent d’un seul trait et H, huitième lettre de l’alphabet pour nous, devient la première (voir l’étude de Stephen Heath dans Tel Quel 54 et en partie consacrée à Joyce — voir article). H hiératique des hiéroglyphes. H où vous entendez le tranchant du A, son sifflement aspiré. Marque indiquant qu’il s’agit d’opérations portant sur des ensembles et, comme Lacan a raison de le rectifier, la lettre ne désigne pas des ensembles, elle les fait. »...
Giordiano Bruno
H est contemporain de l’écriture de Sur le matérialisme, publié peu de temps après (janvier 1974).
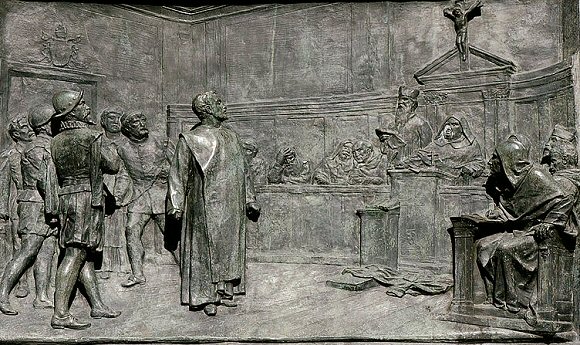
- Le Procès de Giordano Bruno, par Ettore Ferrari.
Bas-relief du socle de la statue de Bruno, à Rome.
Sollers parle de Giordano Bruno p. 60 :
« Giordano Bruno, brûlé en 1600* (notamment à cause du maintien de la virginité de la Vierge), est ici l’acteur clé de cette pluralisation et de cette infinitisation dramatique.
« Voici celui, dit-il de lui-même, qui a franchi les espaces, pénétré dans le ciel, enjambé les étoiles, dépassé les frontières du monde, pulvérisé les murailles fantastiques des première, huitième, neuvième, dixième sphères et de toutes celles qu’auraient pu y ajouter les vains calculs des mathématiciens et l’aveugle obstination des philosophes vulgaires...Il a donné des lumières aux taupes, la lumière aux aveugles. »
(Ici, un rappel de biais : Joyce). Et pourtant, Bruno s’est arrêté, il n’a pu admettre les "éléments impies" (de Démocrite). Il "reconnaît au contraire l’existence d’un haut esprit paternel par lequel tous ces éléments sont gouvernés". Ah, ce "père" ! Il prend partie contre le "clinamen" (la déclinaison épicurienne), ce concept ou plutôt cette surdétermination de tout concept d’une extrême importance pour toute l’histoire de notre pensée, et contre le hasard. » (p 59)
et plus loin : « Pour Bruno, l’atome est un minimum, non un terme. Il est source de nombre et le monde est un texte écrit d’une infinité de mots. Les mots sont formés par un nombre limité de signes (lettres ou accents) qui eux-mêmes consistent en points. Les mots représentent l’infinie variété des objets sensibles ; les lettres sont les corps élémentaires dont ces objets sont composés ; les points sont les éléments (minimaux) en lesquels, en définitive, tout se résout. Conception traditionnelle du matérialisme. Question d’écriture. De division et d’hétérogénéité. La « fente » qui mène au matérialisme est aussi ce passage dans un autre état du langage. Question de fission atomique. « Au-delà » de la représentation. » (p 63).
* Si Sade a été "prisonnier sous tous les régimes", Giordano Bruno, lui, a été excommunié par toutes les Églises : par la communauté calviniste à Genève, la communauté luthérienne en Allemagne ; puis finalement, après huit années de procès, il a été condamné à mort par l’Église de Rome et son pape Clément VIII. L’inquisition a fait son office (celle de Venise avait été plus "clémente"). Curieusement, c’est en France que, sous la protection de Henri III, Bruno a connu un peu de tranquillité (de 1578 à 1583). (Cf. Giordano Bruno l’insoumis) [8]
Le diagramme de la couverture : Figura Intellectus

- Couverture de H.
ZOOM : cliquer sur l’image
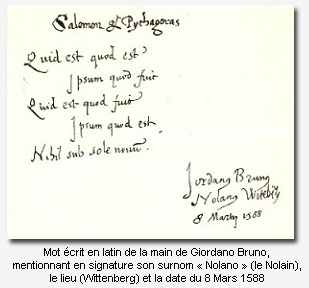 Figura intellectus de Giordano Bruno. Le Traité contre les mathématiciens et les philosophes de ce temps (Articuli centum et sexaginta adversus huius tempestatis mathematicos atque philosophos) est publié à Prague en 1588.
Figura intellectus de Giordano Bruno. Le Traité contre les mathématiciens et les philosophes de ce temps (Articuli centum et sexaginta adversus huius tempestatis mathematicos atque philosophos) est publié à Prague en 1588.
Il est intéressant de noter que c’est la même année 1588, que Montaigne publie la 2ème édition des Essais et que Tintoret peint « Le Paradis ».
Trois diagrammes (fig. IIa, b, c) sont des variations sur le thème de l’intersection des cercles. Le premier diagramme représente la « mens universelle », le deuxième (qui se trouve sur la couverture de H), l’intellectus, et le troisième, la « figure d’amour » qui harmonise les contraires et unifie la multiplicité dans l’un. Ces trois figures, dites les plus « fécondes », représentent la trinité hermétique comme elle est définie par Bruno dans les « Trente Statues ». La troisième, l’amoris figura (fig. IIc) porte même les lettres du mot « Magic » inscrites dans le diagramme. Bruno se servait dans ce traité de l’étoile pour signifier « amor ».
Comment est fait « Figura intellectus », le diagramme de Giordono Bruno ?
Projet de crédit supplémentaire pour les cours de maths de M. Kotty.
La bande son est de Propellerheads "Spybreak !(short one)".
L’infini
Et ne nous dites pas que la référence à Bruno n’annonce rien [9] !
« Le seul infini est parfait, dans la simplicité de lui-même absolument, rien ne peut être mieux ou plus grand, c’est le tout unique, Dieu, la nature universelle, occupant tout l’espace à partir de quoi rien sauf l’infini peut en donner une image parfaite »
Giordano Bruno argumente sur la notion d’infini lors de son troisième interrogatoire au tribunal de l’Inquisition, le 2 juin 1592 à Venise. Extrait de Giordano Bruno, Oeuvres complètes, Documents I, Le procès, Paris, Éditions Les Belles Lettres, 2000, pp. 64-66.
Dernière déclaration
« Je ne recule point devant le trépas et mon cœur ne se soumettra à nul mortel »
« Vous éprouvez sans doute plus de crainte à rendre cette sentence que moi à l’accepter »
Sollers écrit dans Mystérieux Mozart :
Il n’est pas inutile de rappeler ici les derniers moments de Giordiano Bruno, brûlé à Rome en 1600 :
« Sa dernière déclaration fut pour dire : 1. Qu’il n’avait pas le désir de se repentir. 2. Qu’il n’y avait pas lieu de se repentir. 3. Qu’il n’y avait pas de matière sur laquelle se repentir. En conséquence de quoi, on a décidé de brûler : 1. Les livres. 2. Leur auteur. 3. Des branches de chêne-liège. »
Le 25-11-06 (complété).
H, « Les coulisses du Paradis »
Note du 7 février 2007
Dans le 11ème entretien avec Ligne de risque intitulé « Les coulisses du Paradis » et publié dans Poker en 2005, Sollers évoque un livre d’André Padoux, L’énergie de la parole, qui traite de la dimension mystique de la vâk, de la parole, dans la tradition indienne, védique. Il revient sur la lettre H :
« Avec la lettre H, voici l’union rituelle du yoga tantrique. Le dynamisme propre à cette lettre est lié au va-et-vient des yeux de l’adepte à ceux de sa partenaire pendant l’échange sexuel. La partenaire, grave question, avec tout ce que vous imaginez de romances, d’impasses, de ratages — bref d’enlisement sexuel sur fond d’illusion. Suzette aurait pu être ma partenaire, Lou aussi, et Anna... Qui est la partenaire ? La mère des enfants ? Eh non. Le dynamisme que procure la lettre H est sans limites : l’adepte va et vient sans arrêt. Sa sexualité ne connaît aucune borne. Un mystique commente : "La pensée totalement immergée dans la joie la plus intense, émettant ce son de façon ininterrompue, dans le bonheur de l’union, avec une femme au corps harmonieux. Les maîtres du yoga, à l’esprit totalement détaché, atteignent ainsi à l’union suprême." J’ai connu, de manière indubitable, cette immersion de la pensée dans la joie intense. C’était après avoir pris des substances, et dans la compagnie de femmes au corps harmonieux. J’ai été ainsi emmené dans les parages de la "Voyante" ».
Selon Sollers, André Padoux distingue dans la Parole « quatre quarts » : au plus haut degré, la « parole suprême », « entièrement différente du langage humain, et qui l’enveloppe », la « parole voyante », la « Moyenne » ou l’« Intermédiaire » et l’« Etalée » (la plus vulgaire, qui sert à communiquer).
Le premier recueil d’essais de Sollers s’appelle L’intermédiaire (Seuil, 1963).
Sollers nous parle de la « Voyante » en ces termes : « Elle inclut tout ce qui a trait à l’organique dans le langage : la gorge, le palais, la glotte, la langue, etc... Elle est avant tout une vibration. Elle résonne dans le son. Energie de la volonté, et non plus de repos (...), elle soutient le désir de connaissance. Ce n’est plus un murmure intérieur, mais un murmure subtil. La "Voyante" a la rapidité de la foudre. Elle se déplace à l’instant. Elle est également ce qui porte la mémoire (...) »
Cet entretien s’appelle, rappelons le, Les coulisses du Paradis. Evoquant la lettre H, Sollers ne parle pas de son roman H. On ne peut éviter d’y penser.
H a été écrit juste avant Paradis.
Il n’est peut-être pas excessif de penser que Paradis touche à la "parole suprême".
« La "parole suprême" est "émerveillement indifférencié, et comparable à un signe de tête intérieur". La parole à son état suprême : salut dans la clarté. Elle est, cette parole, "éveillé, indestructible, éternelle" : elle configure un "Je absolu" dont une tête en liberté [allusion au roman de François Meyronnis] pourrait faire l’expérience. Avec cette parole suprême, nous sommes avant la manifestation (...) Avec la parole suprême, vous frayez dans une dimension qui ignore l’inertie. Le corps humain s’inclut en elle, devenant immédiatement résurrectionnel — et cela sans avoir à produire un cadavre, encore moins un squelette à balayer. » [c’est moi qui souligne. A.G.]
Sollers a dit souvent avoir écrit Paradis dans un état de « grand repos ».
Le passage de H à Paradis serait celui de la "parole voyante" (on pense au "voyant" de Rimbaud), encore prise dans "l’énergie de la volonté" sans repos, au repos (mais un repos — paradoxal — qui refuserait l’inertie) de la "parole suprême". Il marquerait, pour la première fois, dans le roman , le "saut", le « salut dans la clarté hors de la métaphysique de la volonté » (Heidegger), la sortie du nihilisme.
LIRE : Les coulisses du Paradis (version complète)
Vers la notion de Paradis (I).
A propos de l’avant-garde
Au printemps 1973, Sollers donne un interview à Marc Devade [10], pour la revue « Peinture, cahiers théoriques », il revient sur la situation politique et idéologique du moment et, finalement, sur la réception de « Lois » et du nouveau roman qu’il vient de publier, « H ».
Extraits :
De « Lois » à « H »
[...] Marc Devade : L’évènement idéologique, donc politique, principal de cette année écoulée [1972] a été votre livre Lois. S’il n’a pas été purement et simplement censuré, il a été l’objet de réductions (refoulements) multiples mais surtout au niveau de la sexualité et de la politique. Pouvez-vous nous expliquer l’économie réelle de ce livre et celle de H qui la développe encore plus, et ce que tous deux annoncent et dégagent comme air (« H ») nouveau pour l’avenir ?
Philippe Sollers : Qu’est-ce qu’on a fait de Lois, c’est-à-dire d’une masse de langage en mouvement portée par un sens multiple ? Différentes tentatives de réduction. Les deux principales : feindre de croire à une porno-écriture, alors qu’au contraire tout le texte est fait pour décrocher d’avec la fascination sexuelle et ironiser la tenaille dans laquelle l’espèce se trouve prise du fait de sa reproduction. Lois est aux antipodes de tout « érotisme », de toute apologie du « désir » etc... Je ne recherche ni une excitation ni une fébrilité épidermique de la représentation, rien de cette néo-phénoménologie qui couvre, de ses contorsions plus ou moins kitsch, l’impossible nudité occidentale. La jouissance dont j’essaye que mon écriture soit le lieu est à l’obsession sexuelle ce que les états comateux sont à l’ébriété alcoolique. Ou encore, si vous préférez, ce que l’héroïne est au maxiton. Autrement dit, il s’agit d’une tout autre économie que celle d’une recherche dérivée de l’objet qui échappe. Ce qui m’intéresse ce sont des états plus enchevêtrés du langage, tout un sol logique, négatif, un surgissement, un franchissement de la division qui opère par transpositions, coupes, reports. C’est l’impossibilité d’une unité homogène, où qu’elle soit, quelle qu’elle soit. C’est au fond une organisation sérielle qui tente de prendre en écharpe le maximum de condensations inconscientes, culturelles, etc... j’appelle cette forme de composition « springing » du sujet (pour la différencier du « fading » ou du « splitting »), c’est-à-dire un enchaînement - déchaînement de sauts, de fréquences, avec implication de l’énonciation dans l’énoncé comme indice de réfraction, de « passage ».
Cette composition (j’insiste sur cette notion, pour différencier une certaine vue d’ensemble surdéterminante de la simple répétition ou juxtaposition récurrente qui ne fait qu’ajouter à elle-même sa propre limite au lieu de se perdre et de reparaître dans un volume sans cesse repris à l’état naissant) est encore plus développée dans « H » au niveau des voix qui semblent arriver de partout dans le flot du récit, voix modulantes, glissantes, lancées qui font exploser la « langue de fond » psychotique. L’histoire se récite sous forme de sujet innombrable, intra-ponctué, contradictoire, mais ce qui distingue cette galaxie de sons du chaos est l’intervention critique à l’intérieur même de l’explosion lyrique. Formellement, je pense que cela est assez proche de la musique contemporaine (Stockhausen, par exemple, de loin le musicien le plus branché sur la mutation en cours). C’est précisément cet élément « compositionnel » qui semble le moins aperçu aujourd’hui : l’empirisme marque aussi la position de lecture. On croit « reconnaître » tel ou tel élément au passage, on ne voit pas comment et pourquoi il est inséré dans le développement qui le double, le redouble, l’annule etc... La seconde réduction à laquelle ce que j’écris est soumis, c’est une sorte de parachutage de sens politiquement anecdotique. Comme si cette littérature était de la propagande ! Voilà encore une fois une façon de se rassurer à peu de frais. Et remarquez que ces deux réductions portent sur l’équation fondamentale qui définit désormais la place qu’occupe le sujet dans sa possibilité d’y voir ou d’être aveuglé : la sexualité, la politique. La sexualité ne m’intéresse qu’en tant que jouissance irrécupérable par la représentation. Autrement dit dans son point de décharge protoplasmique, au sens où l’entendait Reich, car là est l’aspect le plus subversif, le plus dénié du sexe (bien plus subversif, y compris intellectuellement, que toute « perversion », en ceci que la perversion s’y perd). La politique, elle, c’est essentiellement, dans ce que j’écris, une forme de concentration de toute l’économie de sens et de langue qui se joue d’abord, à corps perdu, dans l’expérience. La politique, c’est ce qui révèle si une formation symbolique est porteuse ou non d’une « nouvelle conception du monde ». Exemple : le fait que les énoncés de Lois ou de H puissent avoir une justification scientifique, qu’ils ne soient pas réductibles à un fonctionnement psychologique (cela vaut pour l’information historique, celle des sciences naturelles ou celle du freudisme). C’est cette « vision du monde » qui va, en dernière instance, et compte tenu d’abord des différentes performances formelles, distinguer entre vieille littérature et nouvelle, mais aussi entre « avant-garde » au sens de marché rotatif, bazar, imitations provisoires, et avant-garde au sens de ce qui vient. Il me semble que nous allons vers des tentatives monumentales qui relègueront facilement dans les vitrines d’un musée pour bibelots hâtifs beaucoup de produits de la décomposition actuelle. Une forme absolument inédite d’épos est en train de se dégager, discontinue, sondeuse, annonciatrice, impliquant un minutieux travail sous-jacent (un travail sur le savoir saisi dans son saut qualitatif, au moment où il est autre chose qu’une langue morte). Tout cela devrait apparaître avec le temps, malgré le brouillage en cours. On le voit bien dans Stanze, de Pleynet. Notre culture radiographiée, devenue effervescente, décapée, parlant de ses « restes » ; les cultures rentrant par osmose les unes dans les autres et se traversant ; tout un autre pas de la démarche lyrique sur un autre chemin « qui se construit lui-même », c’est-à-dire sortant enfin de l’enclos religieux. Petites unités électroniques mobiles, grandes unités de durée, mouvement micro-langue, macro-histoire. Anamnèse à la fois du sujet et de sa civilisation. Ce nouvel épos sera internationaliste, transculturel, au contraire des minables efforts néo-classiques fascistes ou pseudo-avant-gardistes pour ressusciter des singularités, des enracinements, des territoires. Ecoutez Stimmung de Stockhausen :
« Allez, la musique »
Stockhausen, « Stimmung » (1968) :

qu’est-ce qui commence à parler, peu à peu, à travers les voix reprises en elles-mêmes ? Quel est ce tissu récitatif souple, abrupt, qu’on entendait déjà pour la première fois dans les grandes cantates de Webern, par exemple « Das Augenlicht » ?
Webern, Das Augenlicht — "Durch unsere offnen Augen" (direction : Pierre Boulez) :

C’est un espace-temps, un son-sens, un écrit-vu-calculé-nié qui se signifie dans son frayage et, simultanément, signifie ses bords infinis, neuve de l’histoire, rives éparses de l’inconscient. Le vieux Joyce a fait parvenir son Anna Livia jusqu’à l’océan. H, voilà, c’est un peu d’hydrogène pour le monde futur : pas une recherche du temps perdu, une irrigation-vibration de milliers de « temps », chantés, chuchotés, criés, nettement et distinctement, une foule de fugues, j’ai envie de dire le feu du repos, l’en-trop.
Ph. Sollers, A propos de l’avant-garde, Entretien avec Marc Devade,
Peinture, cahiers théoriques n° 6/7, printemps 1973.
Extraits de « H » sur des partitions de Webern et de Bach
Extraits de « H » sur partition de Webern


Extraits de « H » sur partition de Bach. Documents Ivanka Kristeva

Peinture, cahiers théoriques 6/7, printemps 1973 (archives A.G.)
Première mise en ligne le 27 juin 2010.
H — Philippe Sollers, entretien avec Jacques Henric
« ... H, le plus oublié des romans de Sollers, perdu un peu dans l’ombre
que fait porter sur lui le monument, à peine postérieur, de Paradis. »
Philippe Forest, Une comédie de phrase
art press 364, février 2010.
Dans le numéro 364 de la revue art press, en février 2010, pas d’entretien avec Sollers qui vient de publier Discours Parfait, mais un article de Philippe Forest, Une comédie de phrase, précédé d’un texte où Jacques Henric raconte, pour la première fois, l’étrange rituel de ses entretiens avec Philippe Sollers depuis... trente-sept ans. Henric écrit :
Il m’a été donné d’assister de près, depuis des années et à intervalles réguliers, à l’occasion de la parution des romans de Sollers, à une étrange opération suscitée par moi, opération qui a donné naissance à ces objets bizarres qui n’ont laissé d’intriguer les lecteurs d’art press, puis ceux de Tel Quel et de l’Infini. Je veux parler des textes qu’on retrouve aujourd’hui, pour un certain nombre d’entre eux, dans Discours Parfait, et qui ont de statut : Propos recueillis par Jacques Henric, ou Réponses à des questions de Jacques Henric.
Le rituel est simple : un coup de fil, arrivée à 11h chez Sollers, bref échange sur les amis communs et la situation politique, assis en tailleur sur le plancher, un magnéto. « On y va ? ». Pas ou peu de questions. Sollers parle pendant une heure et demi (monologue, polylogue). Puis : « ça vous va ? — ça me va ». C’est que Henric appelle un corps à l’oeuvre [11].
Voici le tout premier de ces entretiens. C’était au printemps 1973, art press en était à son numéro 3 (première série). L’entretien portait sur H, le roman que Sollers venait de publier [12].
ZOOM : cliquer sur l’image
Comme il le fera toujours par la suite, Jacques Henric présentait rapidement l’entretien.
Ces jours-ci, paraît aux Éditions du Seuil (collection Tel Quel) un roman de Philippe Sollers : H. Après la publication des thèses du Mouvement de juin 71, les augures du monde littéraire parisien avaient avec un sérieux appliqué, donné les raisons « profondes » de ce mouvement : difficultés avec le texte de fiction, impuissance subite... La parution de Lois, l’an dernier, devait leur apporter un cinglant démenti. En toute logique, l’accueil réservé au livre par l’ensemble de la presse fut à la mesure du mouvement de dénégation, de refoulement forcené, que la critique opposa à ce texte qui bouleversait si brutalement ses douillettes et séculaires habitudes. Parions que H, qui poursuit, approfondit, radicalise cette expérience de relance textuelle amorcée dans Lois et le geste de subversion du sujet qu’elle implique, va se heurter à une incompréhension redoublée. Il faudra plusieurs années, sans doute, avant que la mesure réelle soit prise d’un tel acte.



Quelle continuité/rupture H marque-t-il par rapport à votre précédent livre ?
Une chose me paraît claire : j’ai dû, depuis trois ou quatre ans réapprendre à écrire. C’est une drôle d’histoire, compliquée, personnelle et non personnelle, liée, je crois, à l’ébranlement de mai 68. En tout cas, il y a là, pour moi, un avant et un après. Lois est évidemment un livre de crise. Et j’ai l’impression maintenant de commencer à peine à entrer dans le langage qui serait le mien. C’est pourquoi, je voudrais écarter tout de suite un malentendu : « sollers » n’existe pas encore, « sollers » est en train d’opérer autre chose que ce qu’on croyait et que lui-même croyait. En un sens, il faudra reparler de « sollers » dans dix ans. Ceci pour dire que j’ai eu à un moment très précis la vision de mon cadavre en circulation sur le marché littéraire, lui-même contrôlé par celui du savoir. Bref, « j’avais eu lieu », et certains de m’expliquer où, quand, comment et pourquoi. C’est une expérience. L’étrange est qu’elle soit à ce point une expérience de vie ou de mort je veux dire évidemment sexuelle. Sexuelle et politique, bien entendu. Inscrite avec violence dans une guerre des discours. Lois a provoqué une sorte de scandale dont la signification fondamentale était : comment ça, il s’obstine à écrire ? Sans demander la permission ? En changeant de rythme ? De quel droit ? L’accueil fait à ce livre a été symptomatique d’une désorientation comique. Or, l’essentiel pour moi, à ce moment là, était d’atteindre un tourbillon de langue, une autre scansion signifiante qui fasse surgir massivement le poudroiement du sujet dans l’histoire. Disons : Wo es war, soll dervich werden. C’est à dire : une danse-vertige du « je pense » avec son langage, comme si celui-ci commençait à pleuvoir (je note au passage que la lettre h dans les inscriptions runiques vient du mot hagall qui signifie : grêle). Si l’on n’embraye pas sur cet aspect de tourniquet, de moulin non plus à prière mais à critiques qu’est Lois, si l’on ne saute pas dans son geste à la fois agité et sec, dans son bombardement électronique, dans sa « chambre à bulles », on est tout de suite obligé de se raccrocher à des lambeaux de sens transitoires et, finalement, de reconstruire un fantasme d’unité que la partition du texte a pour fonction de liquider. H, il me semble, va encore plus loin dans ce sens : ça se met à parler, à murmurer, à chanter, à marquer et à effacer en même temps de tous les points du discours et de la durée. La tentative est d’arriver à ce que j’appelle dans Lois une « langue pluriverselle » qui serait moins la condensation-martellement d’ensembles de langues qu’une matrice de transformation elle-même en transformation brisant et relançant toute matrice de langue possible. Le travail, en somme, à peine commencé, consiste à se munir d’un appareil qui soit à la fois un analyseur, une arme et un compteur de décharge. Ce qui m’intéresse, c’est d’aller chercher au fin fond de son effondrement actuel (là où, comme le dit Joyce d’Ulysse, on n’est plus séparé de la folie que par une mince feuille de papier) le creuset de notre culture et d’en prévoir la transmutation. Je vois maintenant la suite sous forme d’une fresque, entamée en plein milieu et à calculer sur un certain nombre d’années.
Dans Lois, l’espace de la page était relativement morcelé : blancs, décalages de lignes, marges diverses, disposition du texte en colonnes ; ponctuation insistante... Dans H : plus de chapitres, de retours à la ligne. Un ensemble d’une typographie compacte, sans la moindre fissure. Plus un signe de ponctuation. Pourquoi ? Vous écrivez : « ... la ponctuation vieux c’est la métaphysique en personne y compris les blancs les scansions... » Pouvez-vous préciser ?
Lois présente en effet une ponctuation en relief. C’est un espace d’interpellation, d’exclamation, on sent que le sujet de l’expérience est littéralement débordé de plusieurs côtés à la fois. Vibration, flux et noeuds de mots-phrases. Matière première d’un geste discontinu, transitif. Quelque chose frappe à pic (inconscient à pic) dont on voit l’ombre portée. Ce livre restera pour moi lié à un état inattendu et constant d’ivresse, d’effervescence non cherchée, d’a-pesanteur. « De joie, je prenais une expression bouffonne et égarée au possible » (Rimbaud). Il paraît que ce n’est pas bien. Que cela prouve les plus noirs desseins quant à la cohérence sociale. Qu’il s’agit de désespoir ou de dérision, etc... Comme quoi le malentendu est à son comble. Dans H on peut dire que le travail porte sur la liaison de cette énergie déclenchée. Le texte se déploie comme une cantate (je pensais aux cantates de Webern, par exemple Das Augenlicht) où les blocs de voix, percutantes, s’enlèvent au-dessus d’un passage à vide, pulsion continue. C’est pourquoi ce texte, beaucoup plus microactif que Lois, encore plus différencié, hétérogène, a l’air d’une seule coulée. Il laisse apparaître les positions d’énonciations à l’intérieur même d’une ponctuation latente . Ni écrit, ni parlé il suppose que le lecteur prenne d’abord acte du volume contradictoire dans lequel « s’allume » l’ensemble des messages en cours de modulation. Je dis que la ponctuation manifeste fait la preuve d’une certaine limite métaphysique, dans la mesure où quelque chose du rythme du sujet reste pour lui « dehors », en représentation, capté par l’exhibition de son image spéculaire. La ponctuation injectée, elle, est à la fois plus interne et plus externe, elle laisse en plan le lieu médian où s’expose le compromis de censure. Du point de vue technique, cela relève si l’on veut de la « mélodie de timbres », de la Klangfarbenmelodie. J’appelle ça le « polylogue extérieur » (rien à voir avec le monologue intérieur centré) qui est en même temps beaucoup plus intériorisé que toute instance subjective. Ce qui me frappe, déjà, c’est à quel point les lecteurs « cultivés » ont davantage de difficultés que d’autres à embrayer directement sur cette vitesse qui est simultanément très rapide et très lente, là où, disons, des lecteurs plus jeunes, déjà familiarisés avec l’underground, trouvent tout cela naturel (naturel du point de vue formel : je ne dis pas que le sens leur soit immédiatement accessible dans la mesure où il porte des condensations de savoir). Bref, le surmoi veille au découpage il refuse d’être entraîné, immergé dans ce flot verbal. Cette introjection de la ponctuation a d’autre part pour moi la signification de mimer la jouissance. H est aussi un éclat d’orgasme, dissolvant l’écueil de l’objet.
ZOOM : cliquer sur l’image

Il est intéressant de noter de quelle façon Lois a été reçu par la critique. Deux aspects de votre travail ont été totalement occultés : le « contenu » lui-même (et pour cause !). je veux dire ses thèses, ses propositions théoriques et politiques ; et le travail sur la langue, plus précisément ce qui touche à la musique de la langue. Pourquoi ce refoulement portant sur la musicalité du texte ? Vous dites : « ... rien n’est dit si rien n’est chanté. » Qu’entendez-vous par là ? Écoutez-vous de la musique en travaillant ? Laquelle ?
« Plus que le goût, écrit Artaud, plus que la lumière, plus que le toucher, plus que l’émotion passionnelle, plus que l’exaltation de l’âme soulevée pour les plus pures raisons, c’est le son, c’est la vibration acoustique qui rend compte du goût, de la lumière, et du soulèvement des plus sublimes passions. Si l’origine des sons est double, tout est double. Et ici commence l’affolement ». Voilà. Toutes les révolutions du langage moderne me semblent liées à ce postulat. Depuis La Musique et les lettres et le Allez la musique ! de Lautréamont jusqu’à l’étourdissante base sonore qui sous-tend la roue de Finnegans Wake. Finalement, quoi ? S’il y a une « troisième oreille » analytique (qui n’a que trop tendance à se refermer mais avec laquelle il est devenu impossible de ne pas écouter toute structure de discours), disons qu’il y en a une quatrième qui n’est plus seulement d’écoute et de repérage de l’évanouissement ou du clivage du sujet, mais de son surgissement transversal, pluriel, vibratoire. La musique met en échec le discours universitaire sourd et muet comme le verbiage philosophique spiritualiste. C’est l’instance matérialiste minimale d’une nouvelle position du langage, sa chance de dialectisation. Insistance du signifiant, filtres : ça commence à tenir les notes, à monter, descendre, couper, se tendre et dégringoler ; ça raconte en forme de découverte invocatoire ; ça empêche l’Autre de se refermer. La musique-en-langue me paraît être le champ d’expérience même du sujet entre la pulsation énergétique et une économie de pensée dont, sans doute, la topologie donne le levier. Accents, fréquences : on oublie toujours trop les voix. Il y a une pétrification littéraire, une langue pâteuse, mortuaire, qui signe l’impossibilité à franchir une interdiction fondamentale, comme si la jouissance venait buter sur une membrane ossifiée, cuirassée, tabou. H commence dans un cimetière et en sort. Bien entendu, la musique n’est pas encore la musique : la musique arrive en même temps que la langue et le concept passent dans leur consumation réciproque. Là se mettent en place les abréviations, les séries « épiques » (destinées à éclairer les procès historiques, à analyser les dépôts mythiques, linguistiques, religieux, etc...). Je peux cependant dire la musique-musique qui m’aide à obtenir parfois un certain « déclic » architectural : les Selva morale e spirituale de Monteverdi, des cantates de Purcell et, pour « l’attaque », le dernier quatuor à cordes de Webern. Mais il peut s’agir de n’importe quelle conversation saisie au hasard.
La composition : c’est ce qui est le moins vu
Vos précédents livres se construisaient selon un schème structurel donné : 64 chants pour Drame, le carré pour Nombres, le cube pour Lois. Un tel mode de progression existe-t-il dans H ? Ou le développement de récriture obéit-il à une logique autre ?
La composition : c’est ce qui est le moins vu. Je suis surpris de voir à quel point il est difficile d’aborder le sens du volume. Au fond, il s’agit ici de sculpture. Barthes, à propos de Drame, avait repéré cette distinction de Vinci, reprise par Freud, entre peinture et suggestion d’un côté (via di porre), sculpture et analyse de l’autre (via di levare). Ceci rejoint Hegel qui écrit : « La poésie épique présente avec la sculpture une étroite affinité, et cela aussi bien au point de vue de son contenu substantiel qu’à celui de la forme extérieure ». En passant, il n’est peut-être pas inutile de rappeler précisément ce que dit Freud du poète épique comme fonction d’assumation du meurtre du père. Les compositions auxquelles j’ai eu recours (échiquier, carré, cube), outre qu’elles avaient pour rôle d’instituer une sorte de méthode « sérielle », devaient aussi « traiter » la représentation depuis son décrochage interne, court-circuiter l’investissement projectif, donner accès à l’engendrement d’abord topologique des scènes de langue. L’accent était mis ainsi sur un développement-transformation, différent de la simple répétition-juxtaposition qui sert en général de support à la fiction. Champ magnétique, donc, préparant l’intervention ponctuelle de l’énonciation (et non pas remplissage d’énoncés). Autrement dit : système de coupes intégrées. Blanc global divisant les termes. En fait, cette phase est pour moi désormais dépassée. H n’est d’ailleurs que le premier tome d’une autre organisation par bandes. Il s’agit du prologue de ce qui pourrait devenir une sorte de télescripteur fonctionnant presque de façon permanente (ou du moins donnent l’idée d’une telle folie). Journal lumineux-sonore mais en-dessous du seuil de conscience, destiné à déjouer sans fin la censure et à se transposer sans fin, librement. L’utopie est ici de se livrer à une orchestration immédiate et simultanée des explosions de sens au moment où elles passent d’un état à l’autre, de rassembler et de relancer des rapts de sauts qualitatifs (psychiques, sociaux) comme s’il s’agissait de faits « naturels » (tourbillons, cristaux).
H. Pourquoi ce titre ? Référence à Rimbaud... ?
H, hydrogène, hashisch (Rimbaud établit l’équivalence). Mais aussi cette notation d’Artaud disant qu’au Mexique il a vu un peu partout dégagée par le feu, cette lettre, « le H de la génération en somme ». Rappel du HCE de Finnegans Wake. Dans l’écriture ogamique par entailles le A et le H s’écrivent d’un seul trait et H, huitième lettre de l’alphabet pour nous, devient la première (voir l’étude de Stephen Heath dans Tel Quel 54 en partie consacré à Joyce). H hiératique des hiéroglyphes. H où vous entendez le tranchant du A, son sifflement aspiré. Marque indiquant qu’il s’agit d’opérations portant sur des ensembles et, comme Lacan à raison de le rectifier, la lettre ne désigne pas des ensembles, elle les fait.
Lois constituait pour une part une réécriture décapante, violemment subversive, de divers grands mythes fondant notre culture occidentale. Dans H, il semble que vous ayez été occupé plutôt par un matériau historique...
Le problème qui se posait à moi était le suivant comment inventer une forme d’épopée qui, tenant compte du bouleversement de la rationalité et du langage au 20e siècle (Finnegans Wake ; les Cantos ; Artaud), n’en expose pas moins les inégalités-détours-courbes-sauts du procès historique ? Regardez le 19e : la perspective téléologique, linéaire, évolutionniste, spiritualo-scientifique, se marque dans La légende des siècles, par exemple, ou dans Michelet. Tout un formidable fouillis culturel, pulsionnel, vient se couler dans une vision perspectiviste qui est à la fois majuscule (Peuple, Humanité, etc...) et prosodie fixe (la « période » romantique, l’alexandrin). Hugo est magnifique mais comment le lire sans s’endormir ? On ne peut pas « refermer » la crise ouverte par Lautréamont, Mallarmé, etc... et « revenir » à l’unité du 19e. Quand cela a été tenté, on voit bien l’échec. Pourquoi ? D’abord les « siècles » ne sont pas le lieu d’une légende mais d’une vérité, et nous ne pouvons pas faire semblant de ne pas savoir que cette vérité est marxiste. Ensuite, l’inconscient depuis Freud (et Lacan) coupe court à toute « continuité » de l’énonciation, nous oblige à penser et à pratiquer des « places » de discours multiples, un sujet « innombrable ». La dialectique matérialiste, à ce niveau, ne peut plus prendre l’aspect d’un mouvement total, englobant, mais se fait tri, criblage, intégration d’intégrations, mouvement du fini et de l’infini dans chaque cellule, zébrure battante du transfini, verticalité, masses. Autre exemple : Dante (cf. Dante et la traversée de l’écriture, dans Logiques). Il est évident que tout ce que j’écris est hanté, à la lettre, par la Comédie. A savoir par la question d’ensembliser le savoir de toute une époque dans une opération-procès « langue-musique ». Mais il est non moins évident que cela ne peut se faire aujourd’hui que dans un espace méconnaissable. Je pense que tout le monde se rend plus ou moins consciemment compte de la nécessité d’un tel risque de refonte lyrico-épique, lequel, pour n’être pas « creux » exige des prises de connaissance incessantes. De plus en plus, il apparaît impossible de continuer le vieux jeu du roman naturaliste ou formel, le vieux jeu du lambeau-poésie, bref la question des cloisonnages de langue. L’ambition de sortir de toutes ces potiches devrait augmenter. Stanze, de Pleynet, en précise le surgissement inévitable. Nous pouvons prévoir, en ce sens, la conjonction critique, subversive, de l’histoire avec le sujet. Dans Lois, les sondages historiques, les fouilles, sont déjà profondément entamés. Cela, comme dans la cure analytique, ne va pas sans des résistances violentes qui vont du mimétisme hystérique à l’agression projective-identificatoire (j’en donne un exemple : tout un antisémitisme refoulé viscéral, jetant sur Lois l’accusation de fascisme et d’antisémitisme alors que ce livre précisément met à jour les tumeurs enfouies du cancer raciste). Ouvrir le tombeau d’une culture ne vas pas sans cris, ni attitudes vertueusement indignées des tartuffes de la bonne conscience. Inutile de préciser que ces partisans du refoulement se retrouvent après 68 comme par hasard, principalement au sein du même parti d’ordre (le pcf). Un parti marxiste-léniniste qui s’intéresse désormais au « personnalisme » ! Toute cette décomposition est d’ailleurs logique. Crue de bêtise.
Mais Lois, H, ce qui suivra, c’est déjà une autre histoire, une autre mémoire, un autre futur. J’aimerais faire sentir comment la préhistoire entre dans le temps de la fission nucléaire, comment la conquête de l’espace a lieu sur les traces de la tragédie grecque, comment nous entrons dans ce sens insensé, vie-mort, expansion audible et « apocalyptique » d’écarts.
« ... multiple voix une et liée multiple divisée liée et l’un multiple le non-un le toujours et jamais multiple... ». On a l’impression que votre texte est constamment multicentré, plutôt décentré ou a-centré. Comme si le roman connaissait enfin sa révolution copernicienne... Vous traversez les époques, les lieux, les cultures, les langues, les peuples, les sujets... Qui parle dans H ? Quels sont les lieux d’émission des messages ? Comment, de façon inédite, se pose, a partir de ce texte, le problème du sujet de l’énonciation dans le roman ? Quelle est la part de mise en jeu du « sujet biographique » ?
Il y aurait, à la rigueur, une seule figuration pensable, corporelle, du héros moderne, une seule silhouette humaine supportable à se profiler dans la mutation en cours : Chaplin. Si H était un film, il faudrait voir le récitant sous cette forme, c’est-à-dire affecté d’un coefficient irréductible d’humour. Mais évidemment ce n’est pas un film. Donc, pas besoin de personnages. Rien que des lieux de discours rapides, effleurés, repris, déformés, reformés, harmonisés avec leurs fautes volontaires, leurs dissonances. Qui parle, dans H ? Jamais un un , un tout . Toujours au moins deux . Peut-être le qui du zéro, s’il avait la parole. Le « sujet biographique », lui, est là parmi d’autres . Il fait part des boucles de son parcours dans une histoire située, réelle (la mienne donc). La biographie est un élément du procès de transformation. Écrivons ça : l’zhéros positif.
Comment, après un tel texte, peuvent se penser la vieille question de la sublimation, celle, neuve, de la jouissance ? Ne croyez-vous pas que l’accueil critique fait à Lois, celui, probable, réservé à H, s’expliquent par le fait que tels textes déçoivent de manière abrupte toute tentative de fétichisation ?
Le problème du fétichisme me paraît déterminant pour savoir si, oui ou non, un langage est ouvrable. Le point de fuite du fétiche bloque, en fait, la quasi-totalité des champs d’expérience esthétique. Que serait un « au-delà du fétichisme » ? Probablement une langue neuve, inouïe, une désarticulation-réarticulation au premier abord insensée de syntaxe. Un « par-delà la mère », en tout cas. Ce qui ne manquerait pas de nous donner un peu d’air. Par là-même, cette position a-fétichiste pourrait être considérée par le sens social comme la plus grave transgression, la plus impardonnable, celle qui met (bien plus profondément que la perversion) en question son espace de reproduction. Si ce que dit Freud est vrai, alors ni la forme ni l’anomalie ne sont à leurs places, et, en effet, la jouissance est un immense continent inconnu. Je crois que l’approche de cette « côte » est perceptible dans H. Sans quoi, pourquoi cette intonation ? Pourquoi cette fin de Lois, avec cette couleur, ces sonorités-là ? Pourquoi, dans H, cette espèce de « certitude » sans certitude, cet état léger matériel dans chaque micro-drame écrit ?
Questions plus concrètes : avez-vous travaillé à partir de notes ? Quand travaillez-vous ? Quel effet physique a sur vous l’écriture d’un tel texte ? Le matériau onirique joue-t-il un rôle important ? Comment envisagez-vous votre travail à venir ?
Notes : Jour et nuit (carnets, inscriptions au vol). Temps : quand ça marche. Effets physiques : accélérateurs. Rêves : fonction de bords. Travail à venir : plus libre.
Le numéro d’art press faisait le point sur l’évolution de Tel Quel depuis sa création. Utile rappel.

Historique de « Tel Quel »

1960 : Naissance de Tel Quel. Soutien des recherches menées dans le domaine de la fiction ; plus particulièrement le « nouveau roman » dont le travail formel rend possible une manière nouvelle d’aborder la littérature. Période formaliste. Dès les premières années, les dissensions d’ordre politique et littéraire vont instaurer ce qu’on pourrait appeler une crise permanente dans le comité de rédaction
1963 : Colloque de Cerisy. Moment charnière dans l’histoire de la revue. Accent mis non seulement sur les recherches formelles de fiction mais sur l’élaboration d’un terrain critique. Déjà se trouve précisée la manière dont la série littéraire s’insère dans la politique. Jusqu’en 67 environ, élaboration d’une théorie de l’écriture et d’une théorie de l’action littéraire. Déconstruction de l’idéologie littéraire bourgeoise. Apparition en 1966 du sous-titre : linguistique/psychanalyse/littérature. En 67 : science/littérature. Publication de textes de Pound, Artaud, Bataille... numéro spécial de la revue consacrée à Sade. Dès 1966, intérêt très vif de certains membres de Tel Quel pour ce qui se passe en Chine.
1967 : Publication de « Pour une sémiologie des paragrammes » de Julia Kristeva. Fin 67, nouvelle crise due à la politisation croissante de la revue qui se place désormais sur des bases marxistes.
1970-1971 : Rupture avec le parti communiste français à propos de la Chine. Vive polémique entre Tel Quel et la Nouvelle Critique, organe des intellectuels du P.C. Tel Quel dénonce vivement ce que les collaborateurs de la revue appellent l’hégémonie idéologique désormais régnante de la bourgeoisie et du révisionnisme (cf TQ 47 comportant une autocritique à propos de mai 68). Nouvelle crise dans le comité de rédaction qui voit les membres et les collaborateurs favorables à la politique du P.C. quitter Tel Quel. Fondation du Mouvement de juin 71 qui se donne pour tâche partout où cela est possible la formation de noyaux d’intervention politique dans la lutte idéologique Le but étant une lutte idéologique générale et approfondie que Tel Quel estime désormais avoir un rôle déterminant dans la conjoncture actuelle.
1972 : Colloque de Cerisy sur Artaud et Bataille. Parution courant 73.
Dans Le Monde du 22 mars 1973, le critique attitré et futur académicien commence et achève son article critique par un étrange pastiche... Il voit dans le livre « le vomi désormais typique de l’héritier gavé » (sic).
" H ", de Philippe Sollers

par Bertrand Poirot-Delpech
cent quatre-vingt-cinq pages sans point ni virgule ni majuscule ni alinéa pas même une phrase déponctuée après coup du torrent du jet et débrouillez-vous c’est d’abord ça le dernier livre de sollers un truc pour faire parler de lui par les pontifes à défaut d’être lu pas impossible il est rusé dit-on mais enfin barthes le compare à rabelais et l’étranger épluche sa revue tel quel il y a bien une raison et puis figurez-vous ça se laisse lire son machin ça charrie plein de choses et ce n’est pas si difficile une fois lancé on fait la planche dans le courant une convention comme Une autre en tous cas sans faire le malin on ne voit pas de meilleur moyen pour transmettre l’impression de lecture on est là pour ça que d’imiter le flux en question l’acheteur saura à quoi s’attendre d’ailleurs barthes déjà cité conseille chaudement la critique-plagiat et curtis manie volontiers le pastiche donc du texte en vrac compact la tête la première là-dedans ouille ouille chiqué migraine qu’on se dit et puis non valéry a bien dit que si nous étions véritablement révolutionnaires à la russe nous oserions toucher aux conventions du langage il est vrai que lui c’était pour compliquer encore la ponctuation mais fargue a dit aussi que l’art était peut-être une question de virgule il n’a pas précisé en plus ou en moins pour guyotat duvert cixous et la plupart des jeunes l’affaire est classée et si le lecteur pleure après ses blancs comme après la métaphysique en personne c’est sollers lui-même qui prévoit l’objection eh bien tant mieux il faut dixit que les acteurs fassent désormais un peu de gymnastique sans quoi on en sortira jamais ce sera toujours l’excuse des wagons qui suivent l’histoire de madame idéologie rien à voir ajoute-t-il avec une position abstraite aristocratique au-dessus des classes il s’agit de poser les problèmes en dehors de certains tics envahissants d’un empirisme poisseux et pour cela de n’être plus le petit chienchien culturel avec serviette autour du cou une cuillerée pour maman et coetera enfin suivre sa pulsion profonde devant sa machine et d’la route azertyuiop tactactactac est-ce qu’elle ponctue la pulsion elle est aussi constante que la fonction elle virgule est intermittente comme dit lacan qui la compare à un collage surréaliste sans queue ni tête nous y voilà en plein sollers ou la prose pulsionnelle à quand la thèse à vincennes l’auteur reconnaît que ça risque de faire hystérique sic mais non se répond-il tout le monde a compris qu’il s’agit d’un rythme paisible ouvert bienveillant vrai sens du spasme stop du spasme au sexe il n’y a qu’un pas qu’un pied vite pris excusez l’expression mais l’enfantillage abonde autant que l’orgasme on joue avec les mots et avec son robinet à tout propos tous les détails y sont au point que la question se pose sous prétexte que toute écriture est de la cochonnerie artaud dixit n’espère-t-on pas que toute cochonnerie devienne écriture mais non ça ne fait pas fabriqué seulement mélange des genres comme dans la vie c’est plutôt joyeux et puis c’est par la réalité sexuelle que l’homme a appris à penser dixit lacan il est normal qu’après freud la littérature intègre reich et le tract carpentier au reste les bouffées érotiques ne sont que des élans parmi d’autres des coudes du torrent ce qui domine c’est la coulée verbale encore plus dévergondée que chez joyce miller céline et autres toujours cités dans ces cas-là c’est le côté écriture automatique diarrhée psychanalytique cuite fabuleuse peut-être sous drogue qui sait débagoulis et débondage revendiqués glorifiés comme un droit et un devoir là-dessus l’auteur devient lyrique j’ai le droit de mentir dans la forme qui me chante j’oppose au monologue intérieur le polylogue extérieur ma frappe s’épanouit en soufflets de forge en raffineries flamboyantes surgies dans le désert sic et de s’observer aussitôt de s’objecter à lui-même oh la la que tu es obscure énigmatique y en a marre de tes envolées mystiques y a tout un public de zonards qui risque de pas suivre une masse de petits mecs paumés tu prends les choses de trop loin continue tout seul ça n’intéresse personne
Mais si, mais si,. Contrairement à ce que peut faire croire le pastiche ci-dessus, et bien qu’il ne repasse jamais, lui, dans le style de tout le monde, la lecture de H. n’est pas si accablante. On peut sauter des lignes ou lire d’un trait, à volonté. C’est moins obscur que fouillis. Un fouillis où on retrouve vite le brac-à-brac des défroqués de la bonne bourgeoisie cultivée et douée : souvenirs de lycée, citations célèbres, bribes de dissertations, lambeaux de dictionnaires étymologiques, passages en grec, latin, anglais, allemand, espagnol ou chinois, ricanements de fond de classe du genre "le silence qui effraie Pascal lui fera au moins passer le hoquet", calembours voulus navrants du style " sot d’homme et go more " ou " allume ton vrai berbère ", contrepèteries d’avant quatorze, histoires de Marie-Chantal, le tout farci de faux parler populaire tel que " c’est pas demain la veille ", avec le ton faubourg et les diminutifs garagistes appliqués au vocabulaire savant, psychiatrique en particulier. Bref, le vomis désormais typique de l’héritier gavé.
Ce qui n’empêche pas Sollers d’évoquer en militant l’histoire ouvrière et d’esquisser des raisonnements, par exemple : les choses les plus bouleversées depuis un siècle sont le sexe, l’histoire et la stabilité mentale ; un individu ne peut dire quelque chose de profond que s’il est obligé de balbutier quelque chose pour gagner sa vie ; la lecture est peut-être une pratique désespérée ; nous vivons comme si l’un de nous, un jour, devait tout comprendre... On ne peut pas dire que tout cela donne une pensée cohérente, ce n’est d’ailleurs pas le propos. Il faudrait plutôt parler d’un ensemble de refus viscéraux, de " ras-le-bol " : d’abord évidemment contre la bourgeoisie, promise au meurtre sans remords pour avoir entre autres " enfermé le marquis ", " tiré dans la nuque des communards " et " pris le thé avec les nazis ". " Ras-le-bol " élargi au vieil "Occident gâteux", à l’humanisme qui a fini par " cracher son secret dans les chambres à gaz " ; refus gauchiste des " révisos ", du " baratin légaliste justifiant, pleurnichant, couvrant les forces féodales " ; refus des profs, des conseilleurs, de tous les oppresseurs ligués comme des militaires en campagne (voir vers la page 150 le passage le plus soutenu et sans doute le plus réussi) : rejet de la religion, de la famille, et du tabou de l’inceste, clef de voûte, origine de tous les maux.
Sur ce thème de l’inceste, l’auteur montre à la fois le plus de véhémence et de charmes à l’ancienne. " Le difficile, écrit-il par exemple, est d’accepter que la mère soit cette lente oh lentement cassée de l’espèce qu’elle soit aveugle quoi voilà le secret qu’elle soit cette lente chute aveugle mais n’espérez pas le voir sans vous défoncer. " L’artiste reparait et le fils mal consolé se trahit.
Et après ? direz-vous. Que propose l’auteur ? Éternelle question. Sollers ne l’élude pas. C’est clair : rien, surtout pas une religion, rien que " renier avec une volonté indomptable, une ténacité de fer, le passé hideux de l’humanité pleurarde ". " Proclamer autre chose sur ma lyre d’or que les tristesses goitreuses les fiertés stupides ", " se mettre hors du marché "... Voilà le programme. Comment ? En " se grouillant de faire ce qu’on veut ", priorité absolue au plaisir sans mesure ni secret. " Le socialisme absorbera le capitalisme, écrit-il, mais on n’avancera pas d’un millimètre tant que la jouissance continuera d’être une affaire privée. "
Jouissance qui n’exclut pas celle de l’autobiographie : l’auteur raconte à l’occasion qu’il s’appelle " Joyaux " " fils d’Octave ", qu’il est " sagittaire comme Beethoven ", qu’il aime la mer et la nuit, les orages et les acacias. Ses souvenirs d’enfance lui arrachent même des images où Mauriac et Aragon retrouveraient leur cher petit : " comme si j’étais une fille offrant sa virginité au papa fleuve avec les orteils dans le gravier fuyard chatouillés par les anneaux d’eau... "
Voilà bien la contradiction. Sollers se proclame pour " l’égalité des chances devant la nature et société " mais il prouve et il avoue que " tout le monde ne peut pas être contrebassiste ". Il prône " l’absence de signature ", mais il signe quand même. Il conseille aux écrivains de raconter en détail ce qu’ils font du matin au soir, et il s’en tient aux allusions, comme tout le monde.
On comprend qu’un libéral de bonne volonté comme Jean-Louis Curtis place cette ambiguïté de l’avant-garde en tête de ses Questions à la littérature. Puisque tous les écrivains actuels sont nécessairement d’extraction bourgeoise et ne peuvent traduire de ce fait les aspirations de la classe ouvrière comme Breton le reconnaît lui-même dans le Second Manifeste du surréalisme, comment se fait-il que certains d’entre eux, encore plus " ciseleurs d’inanités " que les autres, échappent à l’opprobre et soient décrétés pionniers utiles à la révolution ? Par quel " biais mystérieux " sont-ils blanchis du soupçon de servir tacitement l’ordre établi, eux dont l’hermétisme sans public ne dérange guère cet ordre et l’arrange peut-être ? Serait-ce qu’il suffit d’être " affilié à une chapelle progressiste ", de signer des protestations comme Sartre reproche à Flaubert de ne pas l’avoir fait après la Commune ? Le conformisme politique de Balzac et de Stendhal annule-t-il leur génie ? Faut-il négliger Céline à cause de son antisémitisme ? Suffira-t-il un jour d’être clair pour être jugé superficiel et l’inverse ? Veut-on vraiment un système clos où les ouvrages soient " lus et commentés par le seul mandarinat qui les produit " ?
Il faut bien avouer que la question se pose à propos de H., d’où les réflexes d’autosatisfaction et d’individualisme bourgeois sont moins extirpés qu’il n’y semble, et auquel les masses ne trouveront ni accès ni profit dans un avenir prévisible. Mais si on prend des récits limpides comme les Coups, de Merkert, ou les Dos ronds, de Bruno Barth, si réalistes et bien orientés soient-ils, si prolétariens, il n’est pas sûr que les masses en raffolent et que la révolution s’y nourrisse. Il y a maintenant les documents et les sciences sociales pour cela. Zola pressentait déjà leur supériorité sur les meilleures combinaisons imaginaires. Qui sait, dans ces conditions, si le feu porté au cœur même de l’écriture par Sollers et un nombre grandissant de jeunes écrivains ne prépare pas la voie à de plus vastes libérations... oublions le systématique de toute innovation le goût pour le malentendu gagnant en épaisseur sic la griserie et la puérilité affichées quel toboggan mes agneaux en réalité ce qui reste ici est toujours enfantin re-sic eh bien il faut avouer que ce vertige au dessus du temps et de l’espace ce besoin d’aller plus profond voir d’où ça vient de quoi c’est fait vers quoi ça dérive comment transformer la langue dans le sens d’un démontage de l’idéologie sic cette espèce de san antonio maoïste ce n’est pas tous les jours qu’on voit ça même que bien des fausses princesses de clèves font nouille à côté de ce fil de gruyère que la culture fourchette n’en finit plus d’enrouler charabia de la vie éruptive d’avant les bonnes manières occulteuses et si un jour tout le monde écrivait comme ça.
Bertrand Poirot-Delpech, Le Monde, Publié le 22 mars 1973.
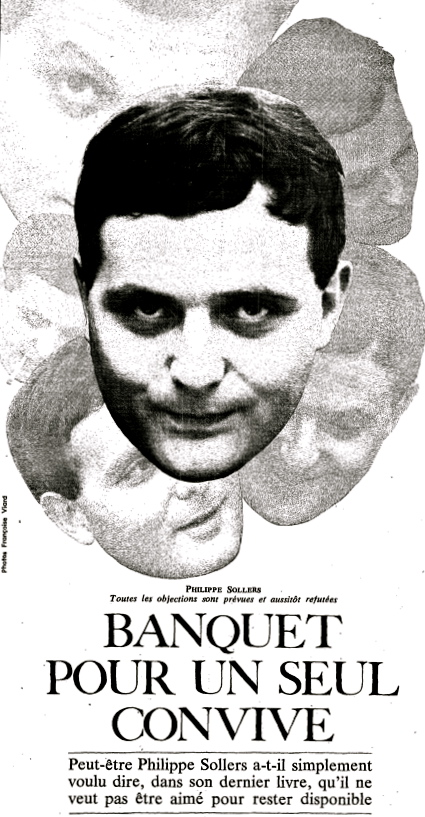
- Le Nouvel Observateur du 9 avril 1973, page 64.
Archives A.G.
par Hector Bianciotti
Il faut dire qu’on ne lit pas beaucoup Philippe Sollers — mais on le respecte. On croit en lui, ici et à l’étranger. On le suit, on le guette, on espère de lui quelque chose de plus. Il représente une rupture dans la littérature française. Ce qui se fait de vraiment nouveau. Et cela continue de compter, la nouveauté qui vient de Paris.
Depuis des années, on ressasse que cette ville est morte, finie. Qu’en matière artistique tout se passe ailleurs, à New York, à Londres, en Italie. Mais il suffit d’être à l’étranger pour se convaincre que les regards continuent d’être braqués sur Paris. Et, quand on y vient, on a l’impression d’être moins loin — on ne sait pas très bien de quoi, si c’est de Zurich, du passé ou de l’avenir, mais moins loin. Paris continue d’être, qu’on le veuille ou non, une sorte de conscience esthétique pour l’Occident.
A la différence d’autres magnifiques villes dont les volumes architecturaux composent un ordre évident, Paris est une ville qui est surtout belle par ses creux, ses espaces, ses perspectives. Littérairement, cela correspond aux claires avenues du concept que l’esprit français sait tracer comme nul autre. Réduire les choses à des concepts, c’est toujours séduisant. Classer, étiqueter, s’en tenir strictement à des théories, à des principes, à des règles, c’est une passion bien française, et qui donne l’illusion du savoir.
Et puis, Paris est une ville qui tend des miroirs. Et ces miroirs captent des images surprenantes, les rehaussent et les relancent. Parfois, du reste, ils sont vides. Alors, il n’y a plus d’images vivantes mais des masques sévères qui imposent la morne liturgie du commentaire.
Alors, toujours prêtes en coulisse, Cathos et Magdelon font leur entrée en scène. Les miroirs deviennent les « conseillers des grâces ». Ornées, précieuses, implacables, elles imposent des théories, inventent des codes, bannissent des mots, interdisent la métaphore ou autres figures de rhétorique. On ne parle plus de mise en scène mais d’écriture scénique, de lecture de Goya, de foyer textuel, de scripto-seminalo-gramma, etc. Et tout devient lieu : l’homme ou l’écriture sont le lieu où ceci et cela se produisent. La liste serait longue de ces mots de passe ultra-chics. Et la langue française — si bien mise au point qu’elle sert d’intelligence aux autochtones — devient un dialecte nocturne.
Paris est la cour du royaume occidental qui se prolonge en provinces lointaines et il se trouve toujours des gens de bonne volonté pour singer ses us et coutumes.
Qui dira jamais les souffrances des héros du snobisme ? Il se trouve des gens en Amérique du Sud, en Italie, en Espagne, partout, qui ne lisent « Tel quel » que pour se sentir différents. Parce que Paris est un mythe, une superstition inébranlable, même quand Paris n’est pas à la hauteur de sa réputation.
Or, bien que l’on sache que la revue « Tel quel » (où rien n’est jamais tel quel) est avant tout représentée par Sollers, l’opinion générale considère celui-ci comme quelqu’un qui, en marge de sa revue et bien au-delà de ses prises de position politiques et autres, possède un souverain pouvoir d’écriture, dont il n’a donné que des échantillons.
Personne ne nie qu’il ait, au plus haut point, le don — le don, qui n’est pas un bacille de Koch hérité du romantisme. Ou, si l’on préfère, une « griffe » hors du commun. Il a prouvé largement qu’il est un écrivain dont les phrases peuvent atteindre ce relief exact, cette ordonnance que l’on ne peut pas toucher sans entamer sa magie, ce qui est le signe même de la littérature et ce qui fait que les choses dites passent dans la vie des autres, élargissant leur vision du monde, ou leur procurant du plaisir.

Mais on dirait qu’il veut nier, détruire cette capacité dont il ne laisse apparaître que des bribes dans la trame de son incessant discours critique. Même ces simples mots du prière d’insérer de « H » : « Voilà, détendez-vous, c’est clair. Restez sur le sens, c’est simple. Ils sont deux, ici, dans la nuit. Tempo », font entrevoir au lecteur une zone affective et comme la promesse d’une révélation que le livre escamote.
Mais voilà « H », roman.
S’il y a un livre qui désarme à l’avance non seulement la critique ou l’opinion du lecteur mais toute interprétation, c’est bien celui-ci. L’auteur y prévoit toutes les objections pour les réfuter aussitôt. Mais qui parle dans « H » ? Un, personne et cent mille. Un auteur circulaire, global. Les messages fusent dans tous les sens, s’entrechoquent, s’annulent. Un véritable jeu de massacre. Cent quatre-vingt-quatre pages — des pages compactes — sans ponctuation, sans le moindre blanc, a-tant au milieu du calcul qui les conduit, le drapeau libertaire de la drogue. Mais pas la drogue charnellement vécue, jusqu’aux limites du manque, du coma. Il s’agit id de drogue domestique, imaginaire. Littéraire. On se perdrait à chercher un sens à ce livre dont les phrases sécrètent d’une façon vertigineuse ses propres métamorphoses. On dirait une rêverie du langage qui, ne pouvant pas saisir un sujet de livre — et historiquement déçu quant-u pouvoir qu’il exerce —, s’administrerait à lui-même un traitement humoristique, se livrant à la chance de l’indéterminé.
Sollers, le théoricien rigide et ponctuel, donne ici libre cours à ses contradictions toujours latentes. Ainsi son livre nous propose d’emblée une sorte de cataclysme où naviguent, flottent, sombrent, reviennent à la surface, se rattrapant, se télescopant,des bouts de phrase, des bribes, de pensée critique s’exerçant au passage et au hasard sur toute chose, philosophique, éternelle, historique ou appartenant à la plus éphémère actualité. Opposant au monologue intérieur le « polylogue extérieur », Sollers parle de Hölderlin, de Mao — « tortue truculente » —, de Sade, de Proust « voyant passer sous ses fenêtres les mecs et les filles avec leurs banderoles criant sodome gomorrhe le combat continue », de Golda « Menhir », de la théorie dite du « big-bang », de Mozart et du retour que Jésus effectue dans le pop’, du ballet « Spartacus » présenté par le Bolchoï, du devoir de l’écrivain et de Joyce qui le hante.

Et enfin, il parle de lui-même. Ou ne serait-il pas lui ce « grand garçon aimable subtil presque souriant d’un commerce exquis où l’on perçoit à peine des nuances d’ironie un peu timide avec ça directeur de conscience bagarreur tout de rage intellectuel qui procède par exclusives violentes depuis peu il assume un troisième rôle chef des brigades de l’intelligentsia maoïste il abreuve la société de consommation et la cinquième république d’insultes et de menaces dont on peut d’ailleurs se demander si elles ne sont plus les inutiles impatiences d’une âme élégiaque soudain saisie par le prurit d’un pouvoir impossible à atteindre mais enfin il lui manque la flamme véritable c’est des taquineries des extases forcées un splendide tempérament qui écrase des pensées douteuses d’ailleurs il paraît que l’ensemble du livre est la description très croustillante d’une gigantesque mêlée sexuelle d’accouplements sans nombre de caresses au catalogue complet pas possible non mais il y a intérêt à le dire en ajoutant aussitôt que de ce point de vue ça n’arrive pas à la cheville de x ou y » ?
Il nous gratifie de phrases en anglais, italien, espagnol, chinois, allemand, etc. Il se livre à une sorte d’« émotionnalisme imitatif » composant des, mots — des mots-valise et autres. Il s’adonne à l’étymologie — ce qui est une variante de la psychologie — ou fait des blagues, par exemple « aboli biberon d’insanité pécore ». Il s’offre une fête, un « satyricon ». Il glousse, il rigole. Et cette transcription scrupuleuse de tout ce qui traverse son esprit, sans mise en ordre, sans choix apparent, aboutit à une nouvelle forme de naturalisme.
Parce qu’il est bien évident, n’est-pas ? que c’est cela, exactement cela que peut penser un homme qui a lu Plotin et Pound et Mao et « le Figaro », et écouté Mozart et Webern et France-Inter, quand il marche ou mange ou fait l’amour... avec les mots. Un véritable encéphalogramme.
Une fête privée, banquet pour un seul convive — l’auteur. Le lecteur-Sisyphe qui, en arrivant en bas d’une page, doit, sans le moindre répit, remonter la lourde pente de la suivante, se sent exclu.
On pourrait risquer une autre interprétation de ce roman, réduire encore une fois le texte à test. Même si le prière d’insérer, signé Sollers, commence par ces mots : « Les raisons pour lesquelles ce livre ne peut pas comporter de présentation seraient sans doute aussi longues à exposer que ce livre lui-même. » On pourrait essayer de voir, comme dans les tables de Rorschach, ce que l’on peut. En définitive, que peut vouloir nous dire ce livre dont, assurément, une typographie courante rendrait évident et l’intérêt et la banalité de bien des pages ? Et s’il n’était qu’un refus ? Refus violent de l’image que Sollers a donné de lui-même, et dont ses partisans lui ont fait un véritable masque de fer, un carcan ? Il ne semble pas interdit d’y voir un besoin absolu de faire le vide autour de lui et en lui, et d’échapper aux dogmes que, si promptement, il a su promulguer et parfois substituer l’un à l’autre. Un besoin de liberté, de nettoyage. Une envie d’éluder le devoir de cohérence. D’être seul. Sans suiveurs. Sans acolytes. Et de voir venir. Peut-être Sollers voulait simplement dire, ici, qu’il ne veut pas être aimé, pour rester disponible.
« On aura peine à me persuader que l’histoire de l’enfant prodigue ne soit pas la légende de celui qui ne voulait pas être aimé », dit Rilke dans « les Cahiers de Malte Laurids Brigge ». Peut-être Sollers est-il cet enfant prodigue.
Mais il est « Tel Quel », et l’exercice de l’autorité, sinon de la terreur, est paralysant et laisse des traces indélébiles. Lui, qui a renié son premier livre — « Une curieuse solitude » — et très explicitement, dans l’avant-propos de son édition de poche —, osera-il aujourd’hui son auto-excommunication ?
Hector Bianciotti, Le Nouvel Observateur du 9 avril 1973.
Première mise en ligne le 24 avril 2010.
Et maintenant la leçon de lecture. Elle est parue initialement dans la revue Critique, n° 318, novembre 1973, et est reprise dans Sollers écrivain en 1979.
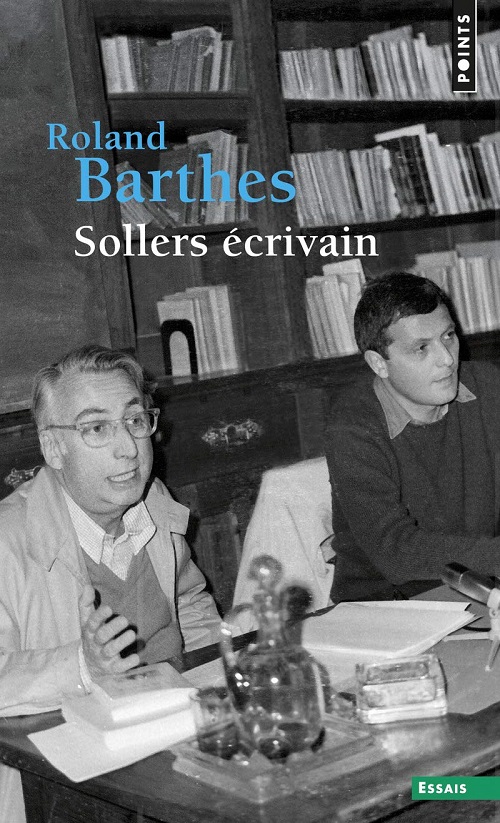
- Barthes et Sollers, juillet 1972.
Cerisy, colloque Artaud/Bataille.
Par-dessus l’épaule
par Roland Barthes
Un jour, je disais de quelque texte qu’il était beau. On se récria : comment peut-on être moderne et parler de beauté ? Notre vocabulaire est si limité (précisément là où les nouveautés surabondent) qu’il faut bien accepter que les mots tournent et reviennent. Je pars des choses et je donne des noms, même usés. Je m’entête donc, et je dis du livre de Sollers [13] qu’il est beau. Je désigne par là, non quelque conformité à un idéal canonique, mais une plénitude matérielle de plaisirs. Est beau, tout ce qui est érotiquement surdéterminé. Le livre de Sollers n’abandonne rien, ni l’histoire, ni la critique, ni la langue, et c’est cette suffocation que j’appelle « beauté ».
Comment ça marche ? Comme « un tourbillon de langue ». Voyez les feuilles à terre, prises dans l’orage qui vient : ce sont de petits vertiges, entrant eux-mêmes dans une grande spirale, et cette spirale se déplace, s’en va, on ne sait où. Dans H, tout est réglé selon un coq-à-l’âne généreux ; à peine pris dans un semblant de phrase, le sujet (topic) se décoince, évite la période oratoire, qui menace toujours. Le vertige vient de la distance des sujets télescopés, de la vitesse prodigieuse à laquelle ils défilent, de l’étroitesse de leur lieu d’échange. C’est une sorte de mouvement brownien, c’est, toutes proportions gardées, l’écran télé-visuel, avant que la représentation ne s’y fixe :lorsque l’image, la sacro-sainte image, est interrompue (par quelque orage) et que la surface dépolie, chargée d’électricité, vibre, éblouit, crépite, fait barrage à la métaphysique qui reviendra , l’orage passé (la métaphysique, c’est-à-dire le sketch publicitaire, la « « dramatique », le « grand reportage », etc.). Dans le livre de Sollers, ça pleut, à la façon de ces longues raies d’idéogrammes (serrées, drues, fines, élégantes, emportées et maîtrisées) qui viennent strier sans relâche (et pourtant comme c’est aéré !) le papier coloré du manuscrit Ise-shû (Japon, XIIe siècle) : « Pluie, Semence, Dissémination, Trame, Tissu, Texte, Écriture. »
H décape à peu près tous les langages [14] ; mais il ne peut le faire que parce qu’il n’est pas lui même un langage, mais une langue dans la langue : son pluriel est sans repli (au sens tactique, militaire et topographique du mot). L’aporie à quoi il échappe est que, pour décaper, il faut ordinairement un langage décapant, qui devient à son tour une nouvelle peinture. D’où la solution plurielle : par les bris de langage, produire sur le mur (l’écran, la page) de la représentation, des taches multiples, des dessins bizarres, des écailles, des craquelures (l’écriture chinoise n’est-elle pas née, dit-on, des craquelures apparues sur des écailles de tortue chauffées à blanc ?)
Différentes façons de prendre le « fouillis » : soit comme un désordre, soit comme une disposition aléatoire, soit comme une figure globale, soit comme un infini céleste, etc. Mais le fouillis, c’est aussi cet espace de jouissance où il est possible de fouiller. H est, de ce point de vue, une forêt de mots, au sein de laquelle je cherche ce qui va me toucher (enfants, nous cherchions dans la campagne des œufs de chocolat qu’on y avait cachés). C’est un autre suspense que celui de la narration ou du rébus ; j’attends le bout de phrase qui me concernera et fondera le sens pour moi. H est un théâtre, analogue au Livre utopique de Mallarmé : de la scène du texte partent des traits de langage (on peut dire, pour simplifier, des vers : le vers n’est-il pas ce qui se détache et vient percuter ?), dont aucun ne s’adresse à tous, mais dont chacun vient interpeller quelqu’un (le collectif des lecteurs d’un livre n’est pas une masse anonyme et égale ; plus le livre est « moderne », plus il requiert une différenciation aiguë de ses lecteurs — de ses jouisseurs ; la vacillation du sujet, recherchée par H, passe par un individualisme éperdu : celui des corps, qui se moque des lois d’universalisation, d’alignement, de massification, édictées par la société étatique et centralisée).
Mi-parole, mi-écriture (visant à une écriture parlée, qui sera le contraire même de la parole écrite), H transporte de l’une à l’autre une qualité étrange : l’éloquence. L’éloquence de H tient à ceci que le discours (est-ce encore du discours ?) avance, court, roule, boule, relancé par des « allumages » différents : les idées crépitent sans cesse (j’appelle « idée » l’antiphrase d’une platitude), les mots, les sons, les lettres, tout ce dont peut se bourrer l’écriture pour tenir de la voix, non son leurre expressif , mais son timbre, son grain, ce que, dans l’art vocal, on appelle son mordant, c’est-à-dire la marque inéluctable, implacable, inaliénable, du corps. Autrefois, l’éloquence était associée au « cœur » ; pourquoi pas ? Il n’eût pas été possible d’écrire un livre aussi plein de présences (au monde) sans générosité (valeur nietzschéenne).
Par où commencer ? Eh bien, par l’instrument de travail, la machine à écrire. Il y a très longtemps, l’aède, avant de réciter, s’essayait à lancer la machine narrative : c’était le proème. Plus tard, le troubadour, le minnesinger, avant de chanter, laissait agir ses mains sur l’instrument : c’était le prélude. Ayant à entrer dans l’infini du langage, Sollers part de ce qui va matériellement le produire : tout commence, non par le sujet, mais par l’instrument de production : « sollers » ne veut pas dire seulement « l’avisé » ; c’est aussi « le productif » (voir Henri Goelzer, le Latin en poche).
Lorsqu’il déplie son nom (signifiant majeur), Sollers, évidemment, ne reporte pas sur sa « personne » les significations du Nom (comme faisaient les nobles en se glorifiant de l’étymologie de leur patronyme, ou comme le proposent aujourd’hui les almanachs de prénoms). Le Nom est ici un départ digressif, la rupture d’une métonymie : c’est en délirant (voire historique ment) sur son propre nom (sur son nom propre), que le sujet se désempoisse de sa personne : le nom part tout seul, comme un ballon sans fil ; en détachant mon nom, je me discontinue (je me désacralise). Si chacun de nous explorait ainsi son nom, nous quitterions notre infatuation, et tout irait peut-être mieux, dans la fameuse « communication ».
Toute la musique tonale est liée à l’idée de construction (de « composition »). Or, la lisibilité de l’œuvre peut être assimilée d’une certaine manière à la tonalité : même règne et même éclatement [15] ; une nouvelle audition, une nouvelle lecture se cherchent, commencent, toutes deux atonales. Et ce qui est bouleversé dans les deux cas, c’est le développement (du thème, de l’idée, de l’anecdote, etc.), c’est-à-dire la mémoire : le texte est sans mémoire, et la figure sensuelle de cette amnésie souveraine, c’est le timbre. H (comme telle pièce de Webern — Sollers s’y réfère explicitement) est une gamme de timbres (la voix n’y est pas un instant détimbrée) ; cela s’éparpille, éclate, poudroie, comme les Jeux de Debussy ; depuis ce Debussy-là, depuis Webern et les musiciens postérieurs, plus de « thème-et-développement » ; dans H non plus, il n’y a pas un atome de graisse rhétorique. Cette nouvelle pratique frappe d’inanité la « composition » (même si le livre est secrètement agencé, à la façon d’un jeu) : la longueur (combien de genres classiques, littéraires ou musicaux, se définissaient par la dimension des œuvres) n’est plus pertinente : la nappe sollersienne n’est pas différente de la pièce brève (Webern), du haïku ou du fragment.
De l’absence de ponctuation, on induit une absence de phrases. Et c’est vrai ; on commence à entrevoir la signification suspecte de la Phrase, c’est-à-dire : qu’elle est un artefact linguistique ; qu’il n’est pas sûr que dans la parole vivante il y ait des phrases ; que la découpe prétendument logique du discours implique une idéologie, installe une tyrannie du signifié ; que d’une certaine manière la phrase est toujours religieuse, et que ses contestations sont toujours réprimées (à titre scolaire ou psychiatrique). H constitue donc un certain procès de la Phrase. Et cependant, ce qui est substitué à la Phrase, ce n’est pas son contraire mécanique, le babil, la bouillie. Une troisième forme apparaît, qui garde de la phrase sa séduction langagière, mais évite sa découpe, sa clôture, c’est-à-dire, en définitive, son pouvoir de représentation. H tisse, non des phrases, mais des mouvements syntaxiques, des bribes d’intelligibilité, des taches de langage (au sens que ce mot pourrait avoir dans la calligraphie d’un Pollock). Qu’est-ce donc, linguistiquement, qui est évincé, dans ce texte ? C’est moins la ponctuation (carence somme toute superficielle) que l’enrobement, l’emboîtement, l’enjambement des propositions, c’est-à-dire la période (objet aristotélicien). La phrase littéraire n’est-elle pas un montage ? Le texte de Sollers n’est pas monté : la composition (l’ordre rhétorique) est mise en échec, non le bombardement des représentations instantanées.
Dans le dossier de presse de H, il n’est pour ainsi dire pas un article qui ne commence par relever les singularités typographiques du livre (ni ponctuation, ni majuscules, ni alinéas). Parlons donc, nous aussi, du Texte avant qu’on le lise.
Il s’agit d’un débit continu, serré, apparemment sans faille. Ce débit peut être reçu de deux façons différentes, opposées. Si l’imagination du lecteur est aérienne (au sens où pouvait l’entendre Bachelard), ce texte continûment serré lui donnera une sensation d’asphyxie ; il dira « j’étouffe » et jettera le livre (soit dit en passant, pour qu’un texte existe, il est nécessaire qu’il soit rejeté par certains corps, par certains lecteurs ; il n’y a pas de lecture universelle, il n’y a pas de corps universel : le corps de désir — la lecture de désir — est immédiatement différencié). Si au contraire l’imagination du lecteur est liquide, tout change ; l’image figurée par la typographie devient bénéfique, exaltante ; c’est celle du bain lubrifiant, du jet libérateur, de l’orgasme utopiquement infini ; ce texte de jouissance n’est pas pour autant idyllique ; il a quelque chose d’implacable, à la façon d’un final de Bach ; ce débit veut dire en somme : le texte part, il n’arrive pas (il n’est pas « fonctionnel », « rentable », il se place dans une logique, dans une sexualité, détachées de toute finalité (pro)créatrice) ; la cause, la fin, bref l’interlocution est congédiée, mais le sujet aussi : l’auteur n’attend pas pour continuer de voir l’effet de ce qu’il vient de dire ; il ne ménage pas le lecteur, il ne se ménage pas, il ne surveille pas le langage.
L’écriture (contraire sur ce point à la « littérature »), c’est la tension du corps qui essaye de produire du langage irrepérable (c’est le rêve du degré zéro du discours). Cependant — paradoxe ou dialectique —, on ne peut désituer le langage qu’en passant par le relais du langage, qui est toujours du « déjà-entendu ». Il faut donc une dialectique de la mémoire qui se pose et se détruit elle-même. C’est à quoi servent, dans H, les « repères » : ce sont des rappels d’actualités, des syntagmes tout faits, de menues « condensations de savoir », des bribes vaguement identifiables, des bouées de lisibilité, de brèves floculations issues du discours des autres : souvent, très souvent, sous forme de légers « saluts », la mémoire sociale pointe, mais c’est pour aussitôt s’éclipser ; le plagiat est cassé, pulvérisé ; la mémoire flotte, ne tient pas en place ; il se produit une nouvelle langue dans la langue, un grund, un écran mouvant, électrifié, sur quoi aucune représentation ne s’enlève ; les souvenirs de langage fourmillent, mais ils ne sont jamais arrêtés, caressés. Il faut bien voir qu’avec le langage, rien de vraiment neuf n’est jamais possible : pas de génération spontanée ; hélas ! le langage lui aussi est filial ; en conséquence, le nouveau radical (la langue nouvelle) ne peut être que de l’ancien pluralisé : aucune force n’est supérieure au pluriel.
On trouve dans H maint syntagme de cette facture : « toupie de diamant liquide », « suspendues avec des poires jaunes remplies de roses sauvages », « prends cette jonquille cale-toi contre le caveau dans la mousse », etc. ; tous ces syntagmes renvoient à quelque chose qui est très important dans la théorie de l’écriture, et qui est : le passage des objets sensuels dans le discours. Il est en effet nécessaire (pour notre plaisir) que certains signes aient une sorte de poids référentiel ; que forçant l’absence du mot (« l’absente de tous bouquets »), la substance sensuelle des choses oblige par endroits le langage à disposer dans son tissu quelques effets physiques, quelques métonymies (du signifié au signifiant), quelques souvenirs (tactiles, voluptueux, savoureux). Il y a de ces « passages » chez Chateaubriand (les orangers de la Vie de Rancé) et chez Bataille (l’assiette de lait de l’Histoire de l’œil) ; par ce phénomène, cette grâce ne fait pas acception d’école ni d’époque ; ce brusque alourdissement du discours, cette tumescence légère (et subite) advient parfois à des écrits sévères et les sauve de l’ennui ; j’aime voir apparaître le plumage de la chouette chez Hegel (« ce n’est qu’au début du crépuscule que la chouette de Minerve prend son vol »), et chez Marx la silhouette du tisserand et du tailleur (à propos du travail concret /abstrait) ; l’effet bienfaisant de ces passages tient à ceci, que le sensuel est toujours lisible : si vous voulez être lu, écrivez sensuel. Or, dans H, ces passages abondent, rendus plus libres, plus brillants encore, par le lâcher de la Phrase ; car, ôté la Phrase, le Mot règne, cratyléen. On peut se demander : par quoi l’humanité a-t-elle commencé ? le Mot ou tout de suite la Phrase ? J’imagine que les hommes sont venus d’emblée et en même temps au Langage, à la Phrase, à la Loi ; et que la brilla nce du mot, sa sensualité cernée, le retour civilisé du Référent, ne peuvent survenir au discours que comme un désordre conquis. Je note aussi que, contrairement à la Phrase, le mot solitaire, le Mot-Roi ne s’offre à aucune « interprétation » ; c’est la Loi, c’est le sens qui s’interprètent ; c’est avec la Phrase, avec le sens, que commence la guerre sanglante des langages.
Un moyen sûr permet de distinguer I’écrivance de l’écriture : l’écrivance se prête au résumé, l’écriture non. H porte évidemment l’idée de « résumé » au plus haut point de dégoût. C’est précisément l’une des fonctions textuelles de H que de déjouer l’abstract, la conservation, le classement. H à la Bibliothèque nationale ? Je suis curieux de savoir quelle en sera la fiche méthodique.
Comment fait-on un article de critique ? On lit le livre de bout en bout, on prend des notes, on fait un plan, on écrit. Ici, ce chemin n’est pas le bon. H vous porte à la limite du commentaire : il ne permet pas « l’idée générale ». D’où ces fragments : eux seuls, on peut l’espérer, empêchent de produire dans le commentaire ce « fantasme d’unité » que H, précisément, s’emploie à dissoudre. Le recours aux fragments (se rappeler qu’ils sont toujours là pour éviter une consistance dont on ne veut pas) me dispense d’avoir, sur l’œuvre de Sollers, une thèse à défendre, une référence à préparer. Quoique l’accompagnant depuis longtemps, je prends à chaque fois son travail en marche : ces fragments sont les pas de cette marche : c’est le mouvement du « compagnon de route ».
Quand un texte « fait de l’effet », d’un certain sens, il n’y a plus rien à en dire (c’est le principe négatif de la jouissance). Ce qui est commenté ici n’est donc pas à proprement parler le texte de Sollers, ce sont plutôt les résistances culturelles de la lecture. Non plus : pourquoi a-t-il écrit ? mais : comment le lire ? Comment lire ce qui est attesté ici et là comme illisible ? H, comme Lois, doit rester suspendu, maintenu dans un certain étonnement de la lecture (chose curieuse, l’hostilité qui a trop souvent accueilli ce livre ne fait état d’aucun étonnement : vieux réflexe français : « on ne nous la fait pas », « si nous passions pour des imbéciles ? » : tel Gribouille, maint critique se précipite dans l’inintelligence de peur de paraître idiot ; la vraie bêtise ne s’étonne jamais de rien. Il faut dire que s’étonner, ce serait déjà être amoureux, l’étonnement étant le commencement timide de la jouissance.
Naguère, la critique était plus naïve — ou plus franche : les postulats s’affrontaient sans détours : le clan catholique attaquait Gide parce qu’il était protestant, et cela se disait en toutes lettres. Aujourd’hui, la dépréciation d’un auteur ne se fait pas directement ; elle ne se soutient plus d’arguments simples (ce qui ne l’empêche pas d’être au besoin simpliste) : on déplace l’objet de l’attaque ; on feint de viser des leurres, des mannequins. La critique de H permet de repérer quelques-uns de ces leurres.
Le « nouveau », par exemple, n’est pas attaqué de front ; on le faisait impudemment autrefois, mais ce serait aujourd’hui malséant : on serait rejeté du côté des passéistes, et la presse se veut « jeune » ; la dénégation est donc reportée sur l’adversaire : « H prétend au Nouveau, mais n’est pas si nouveau que ça » : suit le rappel de quelques discours aponctués (dans la masse culturelle de l’humanité, on trouve des exemples pour tout). Cet argument permet un coup triple : en dissociant H du « vrai » Nouveau, j’affirme mon hostilité à l’auteur, je me défends d’être moi-même opposé aux nouveautés et je laisse entendre que j’ai une grande culture. Procédé homéopathique : une pincée de la petite histoire vaccine contre les dangers de la grande Histoire.
Autre leurre : la Mode : « H n’est qu’un effet de Mode. » On réduit ainsi le texte à un phénomène superficiel (la Mode est légère), suiviste et peu estimable (à la Mode s’oppose implici tement la haute moralité des valeurs profondes, sincères, stables : humanistes). Cette réduction, dont toute une critique nous fait un vrai casse tête, censure les liens historiques du Nouveau et de la socialité la plus large : il n’y a pas d’insignifiant en Histoire : ce qui est suivi (n’exagérons pas, cependant, la mode de H !), combattu et défendu, ce qui provoque désirs et résistances, peut être transitoire, mais ne disparaît pas sans avoir déplacé, transformé, rendu impossible la lettre du passé. Il y a des snobs de l’avant-garde ? Mais ce que Mme Verdurin défendait, ce n’était pas Saint-Saëns ou Ambroise Thomas, c’était Wagner et Debussy ! Le snobisme peut être une petite machine bourgeoise qui fonctionne contre la bourgeoisie elle-même, et c’est à ce titre qu’il peut être (modestement) historique.
Un autre leurre, proche du précédent, c’est la « coterie » : H serait le produit sophistiqué, ésotérique, d’un petit groupe d’intellectuels qui vivrait triomphalement de sa propre clôture, coupé des grandes masses de l’opinion. C’est évidemment renverser les rôles : le travail accompli dans H — travail ample, profond, éloigné de tout projet formaliste — est fermé de l’extérieur : sa ligne d’incommunication est tracée par d’autres ; la « clarté » ou l’ « obscurité » ne sont pas des qualités de nature, ce sont des dispositions choisies par le lecteur : l’honnêteté (libérale) ne consisterait-elle pas à se dire d’abord : si vous êtes incompréhensible, c’est que je suis bête, ignorant ou mal intentionné ? Pour ne pas communiquer, il faut être deux.
Dernier procédé d’attaque, particulièrement patelin (disons que c’est un comble : ce qui couronne toute tactique d’exclusion) : faire la leçon à l’adversaire sur son propre terrain. Des journaux bourgeois diront donc à Sollers : « Ce que vous écrivez, tout compte fait, est bourgeois ; ce que vous faites ne sert pas la Révolution. » Ces stratèges se font imperturbablement procureurs de la cause qu’ils attaquent ; on enlève ainsi à l’adversaire tout allié, de quelque bord qu’il soit, on l’enferme dans la fatalité de son origine tout en lui retirant le bénéfice de son choix : « Rien à faire vous serez toujours un bourgeois ; ne comptez ni sur vos amis (vous êtes inexpiablement diflérent d’eux) ni sur vos ennemis (vous les terrorisez). »
Fonction gaffeuse de la critique : elle vous crédite de ce que vous ne voulez pas. Il existe ainsi un petit procédé journalistique qui consiste à dissocier systématiquement des travaux soli daires : d’un côté Philippe Sollers et Julia Kristeva et de l’autre, l’auteur de ces lignes : les compliments adressés en passant au second rendent plus « objectifs », pense-t-on, le rejet désinvolte des premiers : « ce n’est pas un choix théorique que nous attaquons, car ils sont tous estimables ; c’est une manière, un style, un discours ». L’amalgame est une figure bien connue des procès critiques ; voici la figure contraire : la dissociation : il y a une bonne avant-garde et une mauvaise ; la « bonne » avant-garde ne déclare rien de directement politique, elle écrit classique ; la « mauvaise » avant-garde ... (voir plus haut ce qui a été dit des leurres critiques). La véritable appréciation, elle, consisterait évidemment à situer les solidarités théoriques (qui sont grandes) et les différences tactiques (qui ne sont pas des oppositions), à imaginer, en un mot, une combinatoire de la modernité.
Si j’étais un théoricien de la littérature, je ne m’occuperais plus guère de la structure des œuvres, qui ne peut exister, au fond, que dans l’œil de cet animal particulier, le métalinguiste, dont elle est, en quelque sorte, une propriété physiologique (d’ailleurs fort intéressante) ; la structure, c’est un peu comme l’hystérie ; occupez-vous-en, elle est indubitable ; feignez de l’ignorer, elle disparaît. En somme deux sortes de phénomènes : ceux qui résistent au regard (ordre du « secret »), et ceux qui naissent du regard, qui n’existent qu’à proportion qu’on les regarde (ordre du « spectacle »). J’en viens à préférer le spectacle (la fiction) à la structure, parce que la fin de toute structure est de constituer une fiction, un « fantôme de théâtre » (Bacon).
Dans le texte (dans l’œuvre), c’est donc de l’acteur qu’il faut s’occuper. Or, celui qui agit le texte, c’est le lecteur ; et ce lecteur est pluriel (« ... car mon nom est Légion », disait le démon) ; pour un texte, il y a une multitude de lecteurs : non pas seulement des individus différents, mais aussi dans chaque corps des rythmes différents d’intelligence, selon le jour, selon la page. Pour nous donner une idée de ce pluriel, distinguons dans la lecture de H trois champs de différences, trois ordres de lectures.
Le premier champ est individuel (corporel) : j’expérimente sur H différentes approches. Je puis lire le texte : 1) en « piqué » (je survole la page et j’y pique, par hasard, intuition ou aimantation, un syntagme savoureux, ou choquant, ou problématique, bref notable) ; 2) en « prisé » (je saisis délicatement toute une plage du texte et je la savoure) ; 3) en « déroulé » (c’est la lecture ordinaire, légale, c’est la croisière : je déroule le volume de bout en bout, comme un roman, avançant du même pas, quel que soit mon plaisir, ou mon ennui) ; 4) en « rase-mottes » (je lis minutieusement, à même chaque mot, sans économiser mon temps, me mettant, si l’on peut dire, dans le rôle d’un glossateur. Il faut signaler ici l’un des paradoxes de H : la typographie, égale de bout en bout, d’une linéarité implacable, devrait emporter une lecture plus rapide, comme si, dans cette machine cinématographique, le sens, la figure ne pouvait apparaître qu’à une certaine vitesse ; or, bien au contraire, la lecture appliquée, lente, fait de H un livre profond, subtil, dont chaque lieu est intelligent, éclaire vivement, hors de la ligne, d’autres lieux que lui-même : H est à la fois une grande nappe oratoire et une boîte japonaise, pleine à l’infini de haïkaï ; H a les deux pouls : un pouls « populaire » — comme on dit : une chanson populaire —, rapide, allègre, et un pouls critique, celui d’un clerc qui lit obstinément, c’est-à-dire en levant la tête ; 5) en « plein-ciel » (je vois le livre entier comme un objet distant, prétexte d’une réflexion, je le replace dans son paysage historique : théorie du texte, résistances, Histoire, avenir, etc.).
Le deuxième espace de lecture est sociologique. Je me refuse alors à séparer H de son accueil critique ; je tiens H pour un acte (textuel) et je joins à cet acte les réactions qu’il provoque, comme si cette « réaction » faisait partie du texte ; et ce texte-là, precisément, a pour fonction historique de manifester l’antagonisme qui travaille aujourd’hui la consommation des produits symboliques.
Le troisième espace est historique. Le texte s’offre à des lecteurs qui ne vivent pas dans le même temps de lecture (même s’ils sont biographiquement contemporains). Certains veulent lire H comme un roman (et sont déçus) ; d’autres comme de la poésie (et sont déçus) ; d’autres sont dans l’avant-garde de 1930 ; d’autres se mettent enfin postulativement dans l’avenir ; ils tentent de lire H comme un texte de demain (même si, demain, ce ne sera pas ce texte-là), en sachant que cet avenir n’est pas seulement progressif et qu’il comporte dialectiquement des retours, des contretemps : un lecteur de Dante ou de Rabelais est sans doute plus proche de H qu’un lecteur de Malraux : même foyer, souvent, pour le plus lointain et le plus proche, le plus jeune et le plus vieux, le plus populaire et le plus aristocratique ; il peut y avoir enfin des lecteurs de transition : qui perçoivent dans H un passage hors de ce qui ne pourrait plus survivre qu’à coups de répétitions, .vers ce qu’ils ne connaissent pas et ne connaîtront pas (je pense être de ces lecteurs-là). Tel est le poudroiement du lecteur dans !’Histoire [16]
Quand aura-t-on le droit d’instituer et de pratiquer une critique affectueuse, sans qu’elle passe pour partiale ? Quand serons-nous assez libres (libérés d’une fausse idée de l’« objectivité ») pour inclure dans la lecture d’un texte la connaissance que nous pouvons avoir de son auteur ? Pourquoi — au nom de quoi, par peur de qui — couperais-je la lecture du livre de Sollers de l’amitié que j’ai pour lui ? Peu d’hommes, cependant, donnent à ce point l’impression d’un seul et même texte (tissu), en quoi se prennent à la fois l’écriture et la parole quotidienne : pour certains, la vie est textuelle. J’ai connu, à la limite, des écrivains sans livres, dont la pratique, le langage, le corps, l’organisation, donnaient la certitude d’un véritable texte, en produisaient sur moi tous les effets. Il faut lire H, non face au livre comme s’il s’agissait d’un produit conservé que l’on contemple et consomme en l’absence de tout sujet, mais par-dessus l’épaule de celui qui écrit, comme si nous écrivions en même temps que lui.
Roland Barthes, Critique 318, novembre 1973.

Barthes prolonge son analyse dans le numéro 57 de Tel Quel (printemps 1974). Son texte est précédé d’un manuscrit persan. Vous comprendrez pourquoi Sollers déclare plus loin : « Cela se passe comme une danse de derviche. »

Anthologie persane, manuscrit daté de Shiraz, 1398.
ZOOM : cliquer sur l’image.

SITUATION
Depuis la Renaissance, le savoir a été dominé par une liberté : celle de concevoir, d’accomplir et d’écrire des encyclopédies. Cependant, un livre de Flaubert marque le terme dérisoire de cette possibilité : Bouvard et Pécuchet est la farce définitive du savoir encyclopédique ; conformément à l’étymologie, les savoirs y tournent bien, mais sans s’arrêter ; la science a perdu son lest : plus de signifiés, Dieu, Raison, Progrès, etc. Et alors le langage entre en scène, une autre Renaissance s’annonce : il y aura des encyclopédies du langage, toute une " mathésis " des formes, des figures, des inflexions, des interpellations, des intimidations, des dérisions, des citations, des jeux de mots ; tous ces mouvements, autrefois massés et contenus dans des parcs et des quarantaines (la poésie, le baroque, Rabelais, etc.) deviennent peu à peu le seul tissu (le seul texte) du sujet humain. C’est ainsi que je lis H (et quelques-uns de ses contemporains) : comme une encyclopédie de langage, une Comédie de Phrases, un désir de Renaissance.
L’Histoire revient, sans doute, mais il faut le répéter : en spirale. Cette nouvelle Renaissance ne prend la caution d’aucune Nature : la Grande Encyclopédie de la Matière (verbale) est lancée sans filet. D’où vient le risque ? De ce que le langage, qui est précisément sa substance, est la Loi même : toute Loi se rassemble fatalement dans le langage, et partant toute transgression et toute négation de la transgression. Le langage est finalement le seul lieu où il soit possible d’accomplir la formule de Bataille (défendue dans Logiques) : lever l’interdit sans le supprimer. C’est ce que fait Sollers : il lève l’interdit sans supprimer le langage (" Le récit avait commencé brusquement quand j’ avais décidé de changer de langue dans la même langue "). C’est cette extériorité intérieure (lever la barre de la Phrase en gardant les yeux ouverts sur elle) qui déplaît à la fois aux gardiens de la Loi et ll ses négateurs.
Les textes de Sollers s’installent donc dans un écartèlement, une contradiction, comme nous disons poliment pour désigner de loin l’impossible abrupt du langage. C’est à cela je je reviens toujours dans H : j’y suis fasciné par cette énigme : un discontinu continu (ou l’inverse) ; les " sujets "(" topics " " quaestiones ") courent, voltigent, passent, c’est la striure incessante, sans prévenir. Ces sautes de textes, analoguea aux excès fascinants d’un oscillographe (annonciateurs d’inouï), sont cependant emportés, roulés dans une vague unique (un chant) qui ne peut être que la langue, dans sa matérialité pure, débarrassée, et avec quelle ardeur, de la métaphysique des contenus, des représentations, des phrases. Ce continu de la langue n’est pas de type huileux ; c’est plutôt celui d’un moteur musical, à la Bach (j’ai eu moi-meme une vive conscience du texte, de la textualité, dans la vallée d’un oued marocain d’où me parvenait toute une stéréophonie de sons virgiliens — oiseaux, cris lointains d’enfants, bruissements d’orangers, mais aussi, à longueur de journée, le moteur égal d’une pompe ; la campagne, le texte, c’est cela : une idylle traversée par quelque machine : des couleurs, des silences, des brises, tout un tissu de vieilles valeurs culturelles, romantiques, coupé par la rage d’un vélo-moteur). Je puis cerner cette énigme de plus près : le régime général du texte sollersien est fait d’une tension entre les traces du sujet (brisé) et l’emportement d’une piste qui va (c’est tout) : écrire droit avec des Z (la lettre du diable) :il y a une ligne générale (" comme si on était entré dans un grand fleuve strié ").
Que pour nous, vieux Européens, qui sommes encore condamnés à parler — non à construire —, l’ébranlement du discours soit tout de suite inscrit dans le projet révolutionnaire, c’est cet " avenir immédiat " qui est maintenu dans le travail de Sollers. Faites une épreuve de commutation : et s’il n’écrivait pas ? Nous n’aurions plus alors à choisir qu’entre le conformisme (de droite, de gauche) et le babil ; rien en avant : quel deuil, quel étouffement, quel bâillement ! Lui, tient les fils en même temps ; il va, double, visant à la fois l’avenir social et l’avenir textuel ; il ne se retourne pas sur l’arrière du langage. Ses amis ou ses ennemis, il nous maintient tous vivants.
Roland Barthes, Tel Quel 57, p. 17-18.

Après Drame, poème, roman (1965-1968), Le refus d’hériter (1968), Par-dessus l’épaule (1973) et Situation (1974), le dernier texte de Sollers écrivain reprend un extrait du cours sur le Neutre que fit Barthes le 6 mai 1978 au Collège de France. C’est L’oscillation » (1978).

Derviches tourneurs.
ZOOM : cliquer sur l’image.

Cela se passe comme une danse de derviche
L’écriture, c’est pour vous, en somme, la partie apparente de l’iceberg. Et la partie immergée, en quoi consiste-t-elle ?
Philippe Sollers : D’une façon large, il s’agit d’une connaissance du corps. Les rapports qu’entretient un écrivain avec ses sens, avec son odorat, avec son toucher et surtout avec sa sexualité, c’est très important. Mais, en ce qui me concerne, je préciserai que 90 % de mon travail consiste à écouter. On a beaucoup trop tendance, en effet, à faire de la littérature une question de visibilité. C’est cette dominante de la vue sur l’ouïe qui est responsable de toute la contrainte qu’ont exercée la psychologie et la représentation naturaliste sur la littérature (moi-même, j’ai été à demi-sourd, jusqu’à Lois). Que signifie écouter ? Eh bien ! cela veut dire surtout se mettre dans un état presque musical de porosité, à la fois volontaire et involontaire, conscient et inconscient, pour essayer de saisir ce qui se passe d’inconscient dans la langue.
Efforcez-vous de repérer chez tous les gens avec qui vous parlez ce qu’ils disent derrière les mots, il est clair que vous aurez bientôt une certaine expérience de l’oreille. L’accentuation, le ton, vous indiqueront très vite qu’ils sont en train d’exprimer exactement le contraire de ce qu’ils pensent. Vous avez là-dessus des passages célèbres de Proust. Mais je crois qu’il faut aller en fait beaucoup plus loin que la simple « sous-conversation ». Il faut arriver à une écoute analytique. Vous avez lu le journal de l’analyse de L’Homme aux rats de Freud (je ne crois pas qu’on puisse faire de la littérature, de nos jours, sans passer par Freud), on y voit très bien que ce qui est entendu dans un mot comme « rat » est tout autre chose que ce qui est réellement dit. Voilà ce qu’est l’écoute pour moi : quelque chose d’interne. Comme dans un rêve où vous entendez des choses alors qu’aucun son n’est émis. Dans ce curieux processus d’analyse, ce qui fait voir c’est le fait d’avoir entendu et non l’inverse.
Et l’on peut tout de même souligner que très peu d’écrivains s’astreignent à cette discipline.
Est-ce que vous prenez des notes ?
Cela va de soi. Je conçois mal qu’un écrivain ne soit pas tout le temps à noter, un peu comme un analyste qui prendrait tout le monde (et de façon désintéressée) en analyse. J’ai d’ailleurs toujours un carnet sur lequel j’amasse, au café, dans la rue, chez moi, chaque fois que cela vient, les différentes briques qui viendront s’intégrer en cours de rédaction. (Pour les choses sur lesquelles je n’ai pas encore à travailler, j’utilise un fichier qui constitue une sorte de micro-encyclopédie à usage personnel : astronomie, critique philosophique, etc.)
Tantôt, je note un proverbe, un mot en sanscrit qui m’a frappé ; ou bien, c’est un dessin : par exemple le monogramme du Christ : HCE que j’ai découvert dans une bible enluminée et qui a servi de matrice à Joyce pour Finnegans Wake (cela m’a paru illuminant pour expliquer le fonctionnement même du signifiant chez Joyce), ou encore (il s’agit alors d’une prospective de souvenirs destinée à une tentative d’auto-analyse) c’est un nom de villa où j’ai vécu, enfant, la photo du château du Prince noir, près duquel j’allais jouer (vous vous souvenez du poème de Nerval : « Le prince d’Aquitaine à la tour abolie »). L’essentiel, c’est que tout cela va se mettre à rayonner dans ma mémoire. À partir, ainsi, d’un mot, d’un dessin, d’une photo, c’est toute une constellation de souvenirs que je vais pouvoir retrouver.
Mais attention, je ne note jamais ce qui se passe sous ma fenêtre. Le réalisme, cela m’intéresse uniquement dans la mesure où la réalité passe à travers le discours.
Quelle sorte de discours ? Eh bien, je vous dirai que parmi l’énorme matériel dont je me sers pour essayer d’en faire l’analyse, à la fois historique et inconsciente, et de le réécrire sous forme rythmique, je travaille plus systématiquement sur trois sortes de « corpus » : à savoir, le discours religieux (en ce moment je m’attaque à la Bible), le discours scientifique (les accélérateurs de particules, quels déclencheurs d’imaginaire ! ) et le discours pornographique (j’ai une assez importante collection de textes en circulation dans les sex-shops). Pourquoi ces trois discours ? Eh bien, justement parce qu’ils se veulent exclusifs les uns les autres, alors qu’ils sont en réalité complices. Ce que j’essaie, c’est de faire éclater cette étanchéité des discours qui assure le pouvoir.
Et l’écriture, comment se déroule-t-elle ?
Alors là, c’est l’équivalent d’un acte musical, acte que j’accomplis souvent après (pas pendant, il y a alors trop de vacarme dans ma tête) avoir écouté de la musique : Haydn, Monteverdi, Schoenberg, Stockhausen... Mon rêve, ce serait d’arriver à créer une sorte d’opéra de la langue. C’est difficile parce que le français, colonisé par le classicisme, ne se prête guère à ce genre d’opération. Aussi, depuis Lois (1972), j’utilise tout au long de la rédaction un magnétophone afin de retravailler les différents passages en fonction de leur effet sonore. C’était un peu la technique développée par Joyce pour Finnegans Wake : si vous écoutez l’enregistrement qu’il a fait lui-même de cette œuvre en 1934, vous vous apercevrez que sa voix y passe à tour de rôle du grave à l’aigu et que ce texte qui a l’air opaque est en fait un système de modulation de voix.
Évidemment, il faut tenir compte du fait qu’on n’est pas toujours dans le même état pour écrire, et que s’il y a des moments où cela semble aller de soi, il y en a d’autres, au contraire (je ne sais pourquoi les écrivains sont si discrets sur ce chapitre) où rien ne marche. C’est pourquoi, en réalité, j’utilise deux techniques de travail différentes : la première, manuelle, est destinée aux moments où, mon état psychique étant insuffisant, il faut procéder de façon un peu chirurgicale ; la seconde, pour les moments où, sous l’effet de circonstances « heureuses », mon ordinateur cérébral fonctionne convenablement, fait appel à la machine qui permet, elle, d’obtenir des rendements extrêmement intéressants. Alors là, cela se passe comme une danse de derviches. Je fais tourner à la fois les phonèmes et le sens. Cela donne une espèce de bombardement que, désormais, je transcris sans signes visibles de ponctuation, parce que justement, à ce moment-là, tout n’est que ponctuation. J’ajoute qu’à ces deux techniques correspondent des lieux de travail séparés, et que celui destiné à la machine est équipé d’un piano. C’est normal : l’écriture à la machine n’est-elle pas, comme le piano, un acte de percussion ? N’y a-t-il pas, là aussi, un état de clivage des deux mains par rapport au cerveau qui est radicalement différent de la position traditionnelle du scribe ?
Mais il va de soi que, dans la réalité, toutes les différentes opérations qui constituent mon travail sont plus ou moins simultanées. Et finalement, s’il fallait une comparaison ironique, je dirais que je ressemble pendant tout le temps que je consacre (généralement le matin très tôt, entre 20 minutes et 3 heures) à l’écriture, à une déesse Kâli à mille bras s’agitant en tous sens. Le seul moment où il ne peut être question que de faire une seule chose c’est celui où l’on doit décider si, oui ou non, l’on va rendre un certain état définitif. C’est toujours dramatique. Mais il faut bien en passer par là. Ne serait-ce que pour s’apercevoir un jour que c’est raté. Car je rate toujours ce que je fais. Mais quel est l’écrivain qui arrive à dire un peu ce qu’il voulait ? Peut-être est-ce là d’ailleurs un bon critère pour juger celui qui est dans l’expérience et celui qui n’est pas.
Savez-vous à l’avance, au moment de commencer un livre, ce que vous allez dire ?
Un psychanalyste demande-t-il à son patient ce qu’il compte lui dire pendant la séance ? L’écriture, c’est la même chose, on peut toujours se prononcer à l’avance : « Je vais raconter ceci ou cela », rien ne se déroule comme prévu. À une époque très formaliste comme la nôtre, il faut insister sur ce côté indécidable de l’expérience. C’est en cela que réside justement son risque d’échec. Vous connaissez Jean Ricardou ? On a l’impression qu’on peut lui dire : « Passez-moi une commande : établissement X... » Non, ce n’est pas possible. On s’est fâché.
Dans mes premiers livres, il y avait, c’est vrai, une certaine structure établie à l’avance. Drame, c’était un dialogue entre « je » et « il », se déroulant en soixante-quatre cases comme au jeu d’échecs. Nombres, c’était un jeu entre « je », « il » et « vous » sur une scène carrée avec ses trois côtés et l’espace ouvert qui la fait communiquer avec la salle. Lorsque j’ai commencé Lois (mon projet étant de réécrire La Grande logique de Hegel), j’avais construit un cube. Mais, en cours de route, celui-ci a éclaté et tout s’est mis à se dérouler autrement que prévu. Je me suis, par exemple, aperçu que tout ce que j’écrivais était en pentasyllabes : sans doute, l’influence inconsciente de mai 1968. Le côté slogan, le martellement : « na na na - na na ». Alors à partir de H, j’ai décidé de ne plus mettre des digues, de laisser passer ce qui devait se passer. J’ai supprimé les majuscules, pour montrer que rien n’est graphique, que tout est prononçable.
Mais le plus curieux, c’est qu’en décidant que mon seul critère serait désormais d’être débordé par ce que j’écrivais j’ai résolu par la même occasion le problème du début. Vous savez que Freud a dit qu’une première séance d’analyse contient déjà tous les éléments qui mettront des années à ressortir. Il en va de même pour l’écriture. Alors, si vous organisez le jeu à l’avance, le problème du début devient presque insoluble. Autrefois, j’empruntais mes débuts à des rêves (Drame, Nombres) : Aujourd’hui, je puis être beaucoup plus ambitieux. Le début de H, je l’ai ajouté après coup. D’abord j’avais commencé par le récit, écrit le soir même, de la manifestation pour l’enterrement de Pierre Overney. Et puis, au moment d’achever le livre, j’ai été arrêté. Lorsque la machine s’est remise en marche, j’ai su que cette fin constituait en réalité mon début. Il s’agissait d’une série de jeux de mots sur mon nom. C’était en quelque sorte ma signature (pourquoi devrait-on signer à la fin ?). Comme l’a dit Barthes, c’est mon identité que je décline avant de commencer à jouer.
Votre carrière littéraire, depuis Une curieuse solitude, patronné par Mauriac et Aragon, semble accuser de curieux zig-zags.
Une curieuse solitude, je l’ai supprimé de mes bibliographies. Ce petit bouquin écrit à dix-neuf ans en deux mois et demi est un plagiat. Même le titre n’est pas de moi. Le Parc est, lui aussi, un très mauvais livre. D’ailleurs, il a eu un prix littéraire. La vérité, c’est que je suis resté longtemps un peu demeuré. Mais pourquoi l’authenticité devrait-elle être immédiate ?
C’est autour de 1968 qu’il s’est passé quelque chose. Il y a eu une levée de la censure. C’est alors que j’ai soudain renoncé à chercher une langue utopique qui pouvait tout dire tout en ne disant pratiquement rien pour me lancer à corps perdu dans la forme du jeu. Je dois à la vérité d’ajouter (je ne sais si on peut l’imprimer mais c’est important) que c’est souvent écrit de façon systématique avant, pendant, ou après des expériences d’états hallucinatoires. Prenez le titre H, vous entendez le son. Cela coupe. Il y a, bien sûr, le poème de Rimbaud. Mais il y a surtout le hash. Un peu avant Lois, je me suis mis à prendre un certain nombre de produits : pas tellement le L.S.D., mais plutôt le haschisch, la marijuana, les herbes, avec des effets très différents les uns des autres. Mais attention, là encore, l’essentiel n’est pas tel ou tel produit chimique, mais le fait d’attraper le fonctionnement musical de la langue, cet état que nous passons notre temps à refuser dans la communication dite normale. Pourquoi ce refus ? À cause du refoulement sexuel.
Pensez-vous que cette manière de travailler soit compatible avec vos conceptions révolutionnaires ?
Oh ! vous savez, je ne crois pas du tout à cette idée du lecteur tombé du ciel et communiquant directement avec un livre. Je pars d’un principe très opposé : on est immergé, qu’on le sache ou non, dans la réalité historique et inconsciente. Même si le lecteur de la rue ne sait pas qui est Hegel, toute sa vie n’en est pas moins influencée par la dialectique. Alors, s’il y a une révolution, elle doit passer par le langage. Mon seul problème c’est d’écrire une langue assez vivante, assez moderne, assez populaire (quoique cultivée) pour provoquer le choc immédiat.
Propos recueillis par Jean-Louis de Rambures
Le Monde du 29 novembre 1974.
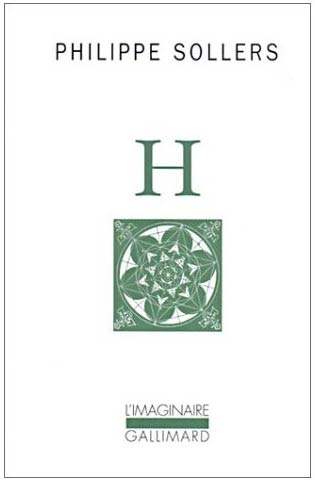
H comme... Hölderlin
La question de Hölderlin — la question posée par la poésie de Hölderlin — est présente dans de nombreux textes de Sollers qu’il s’agisse, comme on le lira ci-dessous, des romans — de Lois (1972) ou H (1973) à Studio (1997) (où Hölderlin et Rimbaud se croisent) — ou des essais ou livres d’entretiens (La divine comédie (2000), Illuminations (2003) ou encore Poker (2005).
La référence devient même plus importante au fur et à mesure que le rapport entre roman et poésie, entre poésie et pensée devient plus insistant. L’approche de Heidegger — au sens où Heidegger a écrit Approche de Hölderlin — y est sans doute pour quelque chose (ce ne fut pas toujours le cas comme on le verra ci-après).
Dans un entretien de Philippe Sollers et Marcelin Pleynet avec Jean Louis Houdebine paru dans Promesse n°34-35 (printemps 1973), peu après la publication de H et de Stanze, et repris dans Art et littérature de M. Pleynet en 1977, les deux écrivains parlent longuement de Hölderlin à partir de leur expérience respective :
Ph. Sollers : " Pourquoi la question d’Hölderlin est-elle si complexe ? Tout d’abord, comme vous dites, on parle de schizophrénie, et il semble qu’aucun discours ne veuille aller voir du côté d’Hölderlin ; je ferai remarquer que c’est la même chose pour Joyce. Cela prouve, encore une fois, que les discours universitaires ont du mal à se mesurer à certains phénomènes. Il est clair qu’on ne peut pas se promener dans Hölderlin comme ça, dans Artaud et dans Finnegans wake non plus ; ça n’est pas facile ; ça n’est pas facile à monnayer dans la presse électorale ou à l’Université. Il y a une seconde difficulté : c’est que Hölderlin s’est vu, comme par hasard, repris par un discours de commentaire philosophique prude, celui de Heidegger, dont ce n’est évidemment pas le propos de voir ce qui émerge là brusquement dans l’histoire [17]. Hölderlin est un des grands enterrés de notre culture : Lois et H ont aussi pour fonction de le ressusciter, si vous voulez, et c’est pour cela qu’il joue un rôle de personnage dans H où il est là, en effet, comme un spectre qui vient répéter quelque chose qui aurait été raté par la raison occidentale. Mais Nietzsche aussi. Il est là en tant que refoulé, et refoulé par l’incapacité du discours philosophique à se vivre comme risque de langue, au lieu de se vivre en position de commentaire de la mort de celui qui s’y produit. Le discours philosophique, depuis Marx et Freud, est une vaste nécropole (...) Cela n’a rien à voir avec ce que la langue peut déclencher si elle est prise au niveau du rythme, de la métrique, etc., et là, Hölderlin produit quelque chose qui n’a pas d’équivalent en français. Je ne pense pas que Pleynet me contredira sur ce point. de toutes façons, lui aussi a beaucoup à dire sur Hölderlin, sur ce que celui-ci a été pour lui. Et c’est pourquoi le problème de la musique n’est pas du tout un problème de "musicalité" : c’est bien autre chose, où il y va du rythme, de la diction, de la pensée. Il s’agit donc de saisir cette inter-connexion, européenne et mondiale, entre les différents passés de langues, liés à leurs propres problèmes philosophiques, et les différentes interventions musicales qui sont produites. Ce n’est nullement une attitude passéiste , car tout cela est repris dans une refonte historique mondiale qui doit faire tomber les frontières, les cloisonnements, les territoires.
M. Pleynet : Je suis tout à fait d’accord avec ce que Sollers vient de développer, notamment en ce qui concerne l’importance de Hölderlin (...) Ce qui a été décisif, ce qui m’a beaucoup appris, ce sont les derniers textes de Hölderlin, les textes dits "de la folie", dans la mesure où, justement, ils reprennent à la fois les textes plus anciens dans des séquences historiques très vastes, dans un retour et dans une syntaxe qui me semble très moderne ; j’y ai beaucoup appris, particulèrement quant à ce rapport, rapport fantasmé, de désir d’articulation au tout social, à ce qui se marque, à propos de Hölderlin précisément, dans Paysages en deux où Hölderlin figure sous la forme de l’évocation du récit d’une visite que lui fit Waiblinguer : "Nous prîmes congé. En descendant l’escalier, par la porte ouverte, nous l’avons vu encore une fois arpenter sa chambre à pas pressés. Un frisson d’horreur me parcourait. Je pensais aux fauves, qui dans leur cage vont d’un côté à l’autre. Plein de stupeur, nous sortîmes en courant de la maison."
Je pense précisément que la trajectoire biographique et historique dont nous parlions tout à l’heure est marquée là de telle façon que, finalement, il fallait en passer par cette coupure pour pouvoir écrire ce qui s’écrit aujourd’hui (...)"
HÖLDERLIN DANS H
Edition du Seuil, Collection Tel Quel, 1973, p. 16-19.
H est le premier roman de Sollers écrit sans ponctuation apparente. La lecture peut paraître difficile. Dès le début, l’auteur prévient : « mais est-ce qu’on peut mettre le tout en vrac en jet continu personne ne pourra naviguer là-dedans c’est sûr la ponctuation est nécessaire la ponctuation vieux c’est la métaphysique elle-même en personne y compris les blancs les scansions tant pis il faut que les acteurs fassent désormais un peu de gymnastique sans quoi on n’en sortira jamais »

Si dès les premières pages du roman des noms propres de poètes sont brièvement évoqués sans être nommés (à l’exception notable de "joyaux" et "sollers") - comme Dante ("l’alighieri"), Homère ("ulysse", "l’iliade"), Goethe ("dichtung wahreit") —, une longue séquence est accordée (à tous les sens du mot) à Hölderlin.
Faisons un peu de gymnastique, lisons, « c’est un matérialiste qui parle » (Julia Kristeva, Polylogue) :
« pour reprendre les témoignages on dit que la théologie lui a été tout de suite parfaitement étrangère nous sommes en 1790 et les anecdotes arrivent assez vite petite chambre pendant trente-six ans avec évolution vers catatonie dementia praecox politesse exagérée volubilité incessante stéréotypes ton enfantin réponses toujours négatives la plupart des sons inarticulés inintelligibles mêlés de français votre majesté royale c’est là une question à laquelle je ne peux je ne dois pas vous donner de réponse je suis précisément sur le point de me faire catholique la nuit il se lève et marche à travers la maison il lui arrive aussi de sortir dans la rue ou alors il noircit nous dit la famille tous les morceaux de papier qui lui tombent sous la main vers bien rythmés mais dépourvus de signification affirme l’inspecteur de passage ajoutant quand c’est clair il est toujours question d’oedipe de la grèce de grandes souffrances pauvre con c’est toi qui ne pouvais comprendre que ça avant de rentrer rassurer bobonne et de raconter comment la princesse de hombourg lui ayant offert un piano il en a coupé les cordes mais pas toutes de sorte que plusieurs touches marchent encore et c’est sur elle qu’il improvise j’ose à peine prononcer son nom écrit bettina gentille hystérique émue par une castration de cette envergure j’ose à peine prononcer son nom aussitôt on raconte sur lui les choses les plus épouvantables uniquement parce que pour composer un de ses bouquins il a aimé une femme pour les gens d’ici aimer et vouloir se marier est la même chose voilà ce qu’elle dit à l’époque mais remarque bien qu’aujourd’hui ce serait plutôt le contraire aimable cocotte de bettina fine très fine regarde comment elle apprécie le gâteau son âme dit elle est comme l’oiseau des indes couvé dans une fleur ce piano déchiré est une image de son âme miaou miaou j’en lècherai bien un p’tit bout je voulais faire le voeu d’entourer le malade de le guider ce ne serait pas un sacrifice j’aurais des entretiens avec lui qui me feraient voir ce que mon âme désire oh je suis sûre qu’alors les touches cassées les cordes brisées résonneraient encore il est submergé par les flots d’une puissance céleste la parole qui entraînant tout dans une chute rapide aurait inondé ses sens donc si je pouvais y brancher un canal de dérivation peut-être que mon nom pourrait être associé au sien dans cette grande mer que je sens faite pour moi et moi seule il dit que les lois de l’esprit sont métriques il dit que tant que la parole ne suffira pas à elle seule pour engendrer la pensée l’esprit dans l’homme n’aura pas encore atteint sa perfection que c’est seulement quand la pensée se voit dans l’impossibilité de s’exprimer autrement que par le rythme qu’il y a poésie force innée réflexion césure cheval cabré suspension rayon en sautant comme un bon cavalier en culotte blanche derby je mettrais mon beau chapeau mon nouvel ensemble tout le monde me regarderait ce serait délicieux j’en suis inondée de lumière peut-être le conseiller aulique se laisserait-il conseiller par moi peut-être hegel lui-même qui l’a connu autrefois me prendrait-il comme dépositaire de son message c’est toujours mieux que ce que dit mon mari qu’il est devenu incapable de fixer une pensée de l’élucider de la poursuivre de la relier à une autre du même ordre et de former au moyen de chaînons intermédiaires une suite ordonnée qu’il ne parvient pas à combler la distance qui sépare les idées de mon mari est trop antigauchiste peut-être qu’il a raison après tout ces gens-là n’arriveront à rien il vaudrait mieux les analyser une question de réglage en somme sinon impossible de décomposer ne fût-ce qu’un seul concept en ses éléments c’est comme cette histoire de drogue cette apologie éhontée aujourd’hui du schizo je vous demande un peu où allons nous avec cette irresponsabalité générale c’est une révolution dans la conception même de l’exception comme si le soldat inconnu soulevait sa flamme et voulait défiler sur les champs-élysées ce désordre vient des américains et là je me demande si nous n’avons pas eu tort de fixer sur les états-unis l’innocence toujours trop rapide de la jeunesse c’est une arme à double tranchant qui sait s’il ne vont pas déboucher dans une anarchie folle avec garçons sauvages nus homosexuels désorganisant les jurys qui sait si notre plus sûr rempart n’est pas de l’autre côté avec sens de l’air pur aisance il faudrait réviser tout ça j’en parlais justement à georges l’autre soir je lui disais bon oui d’accord le secrétaire général a plutôt une sale gueule il est effrayant son menton dit tout en une seconde mais c’est peut-être notre seule chance penses-y bien mon amour quant à l’exemple typique de l’autre on peut dire qu’il veut affirmer quelque chose mais comme il ne soucie pas de la vérité qui ne peut être que le produit d’une pensée saine et ordonnée il dit non aussitôt maintes fois j’ai pu observer le conflit fatal qui détruit ses pensées dès qu’elles se forment car d’habitude il pense tout haut et même s’il arrive à fixer une idée aussitôt la tête lui tourne cela ne fait que l’embrouiller davantage un tressaillement convulsif lui traverse le front il secoue la tête et s’exclame non non non il y a un abîme immense entre lui et l’humanité les camarades le jugent sévèrement malgré ses efforts je ne crois pas qu’il endormira jamais leur méfiance il y a là un problème qui vient de plus loin qu’eux tous et qui si tu veux mon avis les traverse s’avance déjà bien au-delà de ce qu’ils croient aujourd’hui c’est l’antique truc de l’humilité on ne doit pas oublier qu’il lui est resté une très forte vanité une sorte de fierté un sentiment de sa valeur j’ai l’impression qu’il ne pourra jamais s’anonymiser dans le mouvement de masse et pourtant il dit le contraire peut-être n’a-t-il pas si tort peut-être que c’est lui le moins personnel mais alors c’est d’une façon tellement étrange immorale froide que nous la ressentons comme du mépris nous ne sommes pas émus aux mêmes moments autrefois le monde extérieur qui ne l’appréciait il est vrai qu’à moitié lui était encore ouvert sa puissance créatrice et son action lui permettaient d’y jouer un rôle tandis que maintenant on dirait qu’il est pour lui seul moi et non-moi monde et homme première et seconde personne et qu’il continue à se considérer comme un être supérieur hors pair je me demande comment il se met au lit comme quand il est au piano on sent qu’il poursuit une ombre enfantine il vous la joue des centaines de fois c’est insupportable à ceci s’ajoute qu’il est parfois pris d’une espèce de crampe qui le force à parcourir les touches comme un éclair et puis il se met à chanter impossible de savoir dans quelle langue mais avec un pathos déchirant il prétend avoir toujours dix-sept ans le garagiste dit qu’il se lit des passages à lui-même tout haut déclamant comme un acteur avec des airs de vouloir conquérir le monde se posant des questions et y répondant le plus souvent par la négative et puis de nouveau la musique encore une fois le même air monotone la même scie il est mal luné aujourd’hui il dit depuis ce matin que la source de la sagesse a été empoisonnée que les fruits de la connaissance sont des poches creuses et voilà il va mourir doucement et sans agonie et pratiquement comme tous les autres de son espèce ouf »
page 119 : « vous me donnerez un peu de vin chaud pour finir un vin d’embouchure du côté d’l’océan sableux vallonneux c’est en 1802 qu’hölderlin écrit en voyage dans les régions qui confinent à la vendée j’ai été intéressé par l’élément sauvage guerrier le pur viril à qui la lumière de la vie est donnée immédiatement dans les yeux et les membres et qui éprouve le sentiment de la mort comme une virtuosité où s’assouvit sa soif de savoir le vent du nord-est se lève de tous les vents mon préféré et la suite intitulée andenken faisceau transparent avec mer vigne amour poésie fixité va-et-vient de base amour désigné par regard sans fatigue poésie par fondation du mélange des eaux sous le ciel »
page 126 : « hölderlin dit l’esprit de nuit celui qui porte au ciel la tempête a couvert notre pays du bavardage dans une pluies de langages sans poésie »
POLYLOGUE
A la fin de son essai sur H au titre éponyme, trop long pour être repris ici [18], Julia Kristeva donne les pages finales du roman ponctué par Sollers lui-même. Elle précise : « On s’apercevra que cette ponctuation donne à lire un signifié au détriment de la polyvalence musicale. »
J’ai essayé de ponctuer les pages consacrées à Hölderlin que vous venez de lire en mettant en italiques les citations que Sollers a prélevées dans divers témoignages et greffées sur son propre texte (celles, du moins, que j’ai moi-même relevées ; c’est un jeu, vous pouvez compléter). Voilà ce que cela pourrait donner (nous nous approchons de Studio écrit vingt-cinq ans après) :
« Pour reprendre les témoignages on dit que la théologie lui a été tout de suite parfaitement étrangère. Nous sommes en 1790 et les anecdotes arrivent assez vite : petite chambre pendant trente-six ans, avec évolution vers catatonie, dementia praecox, politesse exagérée, volubilité incessante, stéréotypes, ton enfantin, réponses toujours négatives, la plupart des sons inarticulés, inintelligibles, mêlés de français.
"Votre majesté royale, c’est là une question à laquelle je ne peux, je ne dois pas, vous donner de réponse. Je suis précisément sur le point de me faire catholique."
La nuit, il se lève et marche à travers la maison. Il lui arrive aussi de sortir dans la rue. Ou alors "il noircit, nous dit la famille, tous les morceaux de papier qui lui tombent sous la main."
"Vers bien rythmés, mais dépourvus de signification", affirme l’inspecteur de passage, ajoutant : "quand c’est clair il est toujours question d’Oedipe, de la Grèce, de grandes souffrances."
Pauvre con ! c’est toi qui ne pouvais comprendre que ça avant de rentrer rassurer bobonne !
Et de raconter comment, la Princesse de Hombourg lui ayant offert un piano, il en a coupé les cordes, mais pas toutes, de sorte que plusieurs touches marchent encore.
Et c’est sur elle qu’il improvise. "J’ose à peine prononcer son nom", écrit Bettina, gentille hystérique émue par une castration de cette envergure. "J’ose à peine prononcer son nom. Aussitôt on raconte sur lui les choses les plus épouvantables", uniquement parce que pour composer un de ses bouquins, il a aimé une femme. "Pour les gens d’ici aimer et vouloir se marier est la même chose."
Voilà ce qu’elle dit à l’époque. Mais remarque bien qu’aujourd’hui ce serait plutôt le contraire. Aimable cocotte de Bettina [19] ! Fine, très fine ! Regarde comment elle apprécie le gâteau. "Son âme, dit elle, est comme l’oiseau des Indes. Couvé dans une fleur, ce piano déchiré est une image de son âme."
Miaou, miaou ! J’en lècherai bien un p’tit bout !
"Je voulais faire le voeu d’entourer le malade, de le guider. Ce ne serait pas un sacrifice. J’aurais des entretiens avec lui qui me feraient voir ce que mon âme désire. Oh ! Je suis sûre qu’alors les touches cassées, les cordes brisées, résonneraient encore. Il est submergé par les flots d’une puissance céleste : la parole qui, entraînant tout dans une chute rapide, aurait inondé ses sens."
Donc si je pouvais y brancher un canal de dérivation peut-être que mon nom pourrait être associé au sien dans cette grande mer que je sens faite pour moi et moi seule.
"Il dit que les lois de l’esprit sont métriques. Il dit que, tant que la parole ne suffira pas à elle seule pour engendrer la pensée, l’esprit dans l’homme n’aura pas encore atteint sa perfection. Que c’est seulement quand la pensée se voit dans l’impossibilité de s’exprimer autrement que par le rythme qu’il y a poésie."
Force innée, réflexion, césure, cheval cabré, suspension, rayon. En sautant comme un bon cavalier en culotte blanche. Derby ! Je mettrais mon beau chapeau. Mon nouvel ensemble ! Tout le monde me regarderait ! Ce serait délicieux ! J’en suis inondée de lumière ! Peut-être le conseiller Aulique se laisserait-il conseiller par moi ? Peut-être Hegel lui-même, qui l’a connu autrefois, me prendrait-il comme dépositaire de son message ? C’est toujours mieux que ce que dit mon mari : qu’il est devenu incapable de fixer une pensée. De l’élucider. De la poursuivre. De la relier à une autre du même ordre et de former, au moyen de chaînons intermédiaires, une suite ordonnée. Qu’il ne parvient pas à combler la distance qui sépare les idées.
Mon mari est trop antigauchiste. Peut-être qu’il a raison après tout : ces gens-là n’arriveront à rien. Il vaudrait mieux les analyser. Une question de réglage en somme. Sinon impossible de décomposer ne fût-ce qu’un seul concept en ses éléments. C’est comme cette histoire de drogue ! Cette apologie éhontée aujourd’hui du schizo ! Je vous demande un peu : où allons nous avec cette irresponsabilité générale ? C’est une révolution dans la conception même de l’exception.
Comme si le soldat inconnu soulevait sa flamme et voulait défiler sur les Champs-Elysées.
Ce désordre vient des américains. Et là je me demande si nous n’avons pas eu tort de fixer sur les Etats-Unis l’innocence toujours trop rapide de la jeunesse. C’est une arme à double tranchant. Qui sait s’il ne vont pas déboucher dans une anarchie folle ? Avec garçons sauvages, nus, homosexuels, désorganisant les jurys ? Qui sait si notre plus sûr rempart n’est pas de l’autre côté ? Avec sens de l’air ? Pure aisance ? Il faudrait réviser tout ça. J’en parlais justement à Georges l’autre soir. Je lui disais : bon, oui, d’accord, le secrétaire général a plutôt une sale gueule. Il est effrayant. Son menton dit tout en une seconde mais c’est peut-être notre seule chance. Penses-y bien mon amour.
"Quant à l’exemple typique de l’autre, on peut dire qu’il veut affirmer quelque chose. Mais, comme il ne soucie pas de la vérité, qui ne peut être que le produit d’une pensée saine et ordonnée, il dit non aussitôt."
"Maintes fois, j’ai pu observer le conflit fatal qui détruit ses pensées dès qu’elles se forment. Car, d’habitude, il pense tout haut et, même s’il arrive à fixer une idée, aussitôt la tête lui tourne. Cela ne fait que l’embrouiller davantage. Un tressaillement convulsif lui traverse le front. Il secoue la tête et s’exclame : "Non. Non. Non." Il y a un abîme immense entre lui et l’humanité."
Les camarades le jugent sévèrement malgré ses efforts. Je ne crois pas qu’il endormira jamais leur méfiance. Il y a là un problème qui vient de plus loin qu’eux tous et qui, si tu veux mon avis, les traverse, s’avance déjà bien au-delà de ce qu’ils croient aujourd’hui.
C’est l’antique truc de l’humilité. On ne doit pas oublier qu’il lui est resté une très forte vanité. Une sorte de fierté, un sentiment de sa valeur. J’ai l’impression qu’il ne pourra jamais s’anonymiser dans le mouvement de masse. Et pourtant il dit le contraire. Peut-être n’a-t-il pas si tort. Peut-être que c’est lui le moins personnel. Mais alors c’est d’une façon tellement étrange, immorale, froide, que nous la ressentons comme du mépris. Nous ne sommes pas émus aux mêmes moments. Autrefois le monde extérieur — qui ne l’appréciait, il est vrai, qu’à moitié — lui était encore ouvert. Sa puissance créatrice et son action lui permettaient d’y jouer un rôle. Tandis que, maintenant, on dirait qu’il est, pour lui seul, moi et non-moi, monde et homme, première et seconde personne, et qu’il continue à se considérer comme un être supérieur, hors pair. Je me demande comment il se met au lit.
C’est comme quand il est au piano. On sent qu’il poursuit une ombre enfantine. Il vous la joue des centaines de fois. C’est insupportable. A ceci s’ajoute qu’il est parfois pris d’une espèce de crampe qui le force à parcourir les touches comme un éclair. Et puis il se met à chanter. Impossible de savoir dans quelle langue. Mais avec un pathos déchirant. Il prétend avoir toujours dix-sept ans. Le garagiste dit qu’il se lit des passages à lui-même, tout haut, déclamant comme un acteur, avec des airs de vouloir conquérir le monde, se posant des questions et y répondant le plus souvent par la négative. Et puis, de nouveau, la musique. Encore une fois le même air monotone. La même scie. Il est mal luné aujourd’hui. "Il dit depuis ce matin que la source de la sagesse a été empoisonnée. Que les fruits de la connaissance sont des poches creuses." Et voilà : il va mourir doucement et sans agonie. Et pratiquement comme tous les autres de son espèce. Ouf ! »
et page 119 : « Vous me donnerez un peu de vin chaud pour finir. Un vin d’embouchure. Du côté d’l’océan sableux, vallonneux. C’est en 1802 qu’Hölderlin écrit, en voyage dans les régions qui confinent à la Vendée : "J’ai été intéressé par l’élément sauvage, guerrier, le pur viril, à qui la lumière de la vie est donnée immédiatement dans les yeux et les membres et qui éprouve le sentiment de la mort comme une virtuosité où s’assouvit sa soif de savoir." [20] "Le vent du Nord-Est se lève/de tous les vents mon préféré". Et la suite, intitulée Andenken [21]. Faisceau transparent, avec mer, vigne, amour, poésie, fixité, va-et-vient de base, amour désigné par regard, sans fatigue, poésie par fondation, du mélange des eaux sous le ciel. »
Le 28 février 2007.
H, Mallarmé, Nietzsche et Rimbaud, Sollers
par Marcelin Pleynet
Dans son journal, à la date du 28 février 2004 (cf. « Situation », L’Infini n°88, automne 2004), Marcelin Pleynet revient sur une conférence de Sollers faite le même jour dans le cadre du séminaire de Pierre Brunel (auteur de nombreux essais sur Rimbaud), à l’auditorium des cours de Civilisation française de la Sorbonne. La conférence s’intitulait Nietzsche et Rimbaud. Sollers la dédia à Cesare Battisti (j’étais présent).
Pleynet écrit (extrait) :
« Si je me souviens bien, c’est en association avec la question du surgissement de l’hystérie que Sollers aborde la lecture de H, en signalant la très vraisemblable lecture, par Rimbaud, en 1871, dans le deuxième Parnasse contemporain, de l’Ouverture d’ "Hérodiade " de Mallarmé. Ce qui fait très efficacement évènement dans l’éclaircissement du face-à-face conflictuel et sans merci des deux écrivains.
Donc Mallarmé « Hérodiade » — H. dans le Parnasse contemporain de 1871, où Sollers prélève :
« J’aime l’horreur d’être vierge et je veux
Vivre parmi l’effroi que me font mes cheveux
Pour, le soir, retiré en ma couche, reptile
Inviolé, sentir en la chair inutile
Le froid scintillement de ta pâle clarté,
Toi qui meurs, toi qui brûle de chasteté
Nuit blanche de glaçons et de neige cruelle ! »
Comment mieux comprendre ce qu’il en est de Bottom et de H qu’en imaginant les proses de Rimbaud comme une réponse à Mallarmé — du cavalier à la danseuse.

« Toutes les monstruosités violent les gestes atroces d’Hortense. Sa solitude est la mécanique érotique, sa lassitude, la dynamique amoureuse. Sous la surveillance d’une enfance elle a été, à des époques nombreuses, l’ardente hygiène des races. Sa porte est ouverte à la misère. Là, la moralité des êtres actuels se décorpore en sa passion ou en son action — Ô terrible frisson des amours novices sur le sol sanglant et par l’hydrogène clarteux ! trouvez Hortense. »
Sollers insiste sur le Rimbaud latiniste entendant avec "Hortense" : hors en tension — dans le "hors-temps" en tension, manière de tendre... et encore "Hortense" : horreo — se tenir raide, "horrens", "hortus" — jardin, "hortulanus" — jardinier, "hortensis" de jardin, "hortensia" nom de fleur formé sue le prénom Hortense féminin du latin "hortensius" sur la base de "hortus" — Hortensia (XVIIIe siècle en latin, XIXe en français), nom formé par le botaniste Commerson en l’honneur d’Hortense Lepaute, femme d’un célèbre horloger du XVIIIe siècle. Hortense : la reine Hortense, mère de Napoléon III.
Usage érotique de soi-même... en son jardin... H — Hortense — Hortensia, Rimbaud est aussi l’auteur humoriste de « Ce qu’on dit au poète à propos des fleurs ».
H se trouve manuscrit sur le même feuillet que Bottom d’abord intitulé Métamorphoses et qui le précède. (Shakespeare, Le Songe d’une nuit d’été). Bottom est un tisserand transformé en âne. Dans le poème de Rimbaud Bottom, le narrateur se métamorphose tour à tour en « gros oiseau gris-bleu », en « un gros ours aux gencives violettes », en « âne claironnant et brandissant son grief, jusqu’à ce que les Sabines de banlieue vinrent se jeter à mon poitrail ». Sur le même feuillet, H fait immédiatement suite avec : « Toutes les monstruosités violent les gestes atroces d’Hortense. » « Geste — gestus : dur, farouche. Figures des métamorphoses érotiques (Picasso), usage érotique dynamique amoureuse du corps en sa parole, en son jardin.
Nietzsche et Rimbaud
Quelques maigres questions à la suite de l’intervention de Sollers. Pas une seule sur le livre qu’il a publié sous ce titre H, en 1973. Ce premier livre, entièrement sans ponctuation, publié huit ans avant Paradis, a été réédité chez Gallimard dans la collection "L’Imaginaire" en 2001, avec en quatrième de couverture ce texte de 1973 qui peut peut-être en effet éclairer ce qui se joue, dans cette actuelle intervention sur Nietzsche et Rimbaud, quant à l’essence de la liberté « qui ne vient proprement au regard que si nous nous enquérons de la liberté comme fondement de la possibilité du Dasein, alors elle est elle-même en son essence plus originelle que l’homme. » [22]
Je note donc, en quatrième de couverture de ce livre publié en 1973 :
« Les raisons pour lesquelles ce livre ne peut pas comporter de présentation seraient sans doute aussi longues à exposer que ce livre lui-même. Il faut donc éprouver son rythme : dictions, timbres, accents, ponctuation latente, tourbillon, flot, appel. Au-delà de l’automatisme un calcul joue, veille, critique, partant à la fois de tous les points de l’histoire. Ce calcul se dit par masses dans l’unité discontinue de ses coupes. Il module, frappe, chuchote, apostrophe, marque, efface, compte, signale l’absence mouvante mais cependant adressée, dialoguée, de toute langue de fond. Voilà, détendez-vous, c’est clair. Restez sur le sens, c’est simple... »
Qui pensera qu’aujourd’hui [23] Sollers s’est peut-être essentiellement adressé à ce texte publié alors que se préparait le voyage de Tel Quel en Chine ? Je dois encore avoir, dans les archives de ce voyage en Chine, des photos où l’on voit Sollers portant en bandoulière une sacoche sur laquelle se trouve très visiblement imprimée la lettre H.
Nietzsche et Rimbaud, ce qui se pense infiniment en lieu et place de cette pensée où l’homme habite poétiquement... to be at the bottom.
H, préparation au voyage en Chine ? Ce voyage aura lieu au printemps 1974, du 11 avril au 5 mai.
Le voyage en Chine
Film super 8 de Philippe Sollers. Archives de Julia Kristeva.

1. De Gaulle : Votez Sollers !
2. Documents : De Gaulle, Malraux, Mao, Jean XXIII
Deux interventions de Sollers en 2013, où, surprise, il est d’abord question de H... En cette année 2020 durant laquelle on a beaucoup célébré le général De Gaulle — les 130 ans de sa naissance (22 novembre 1890), les 80 ans de l’appel du 18 juin, les 50 ans de sa mort (9 novembre 1970) —... et où, ce 28 novembre, Sollers a eu 84 ans.
L’histoire, décidément, continue.
from PhilippeSollers on Vimeo.
De Gaulle fumait-il des joints ? C’est très probable, comme le prouve cette carte d’André Malraux à la parution, en 1973, de mon roman H . Il y a là une révélation étonnante d’un spécialiste de la vision imaginaire de l’art.
Cette révélation est d’autant plus importante que, avec la montée actuelle du Front national, on a pu voir Florian Philippot ne pas hésiter à se dire « gaulliste ». Il avait les lèvres pincées de celui qui, visiblement, ne s’est jamais défoncé. La confusion est donc à son comble et pousse dans le même sens, partout, vers la falsification généralisée de l’histoire. On demande à Florian Philippot où se situait Le Pen pendant la guerre d’Algérie. Il répond : « Je n’étais pas né. » J’en profite, une fois de plus, mais personne ne m’écoute, pour rappeler que c’est grâce à Malraux que j’ai été libéré des hôpitaux militaires de l’époque, après trois mois d’enfermement, terminés par une grève de la faim. (« Réformé numéro 2, sans pension, pour terrain schizoïde aigu. ») Comme l’a dit une fois Aragon, avant de se faire instrumentaliser par la police stalinienne : « J’ai conchié l’armée française dans sa totalité. » (Traité du style)
Depuis l’au-delà, de Gaulle et Malraux m’ont téléphoné à Venise, en s’inquiétant beaucoup du dernier livre d’Alain Finkielkraut, L’identité malheureuse, livre glorieusement présenté avec photo emphatique de l’auteur, en couverture du Point, avec cette question : Peut-on encore être français ? Ils m’ont demandé l’un et l’autre, avec des voix chargées de substances difficiles à identifier, de réagir. De Gaulle lui-même : « Enfin, Sollers, remuez-vous, vous qui êtes l’exemple du trésor national de l’identité heureuse. Je vous ai fait envoyer de l’excellent afghan, que vous avez fumé, comme moi, intensément, à l’époque. Vive la France ! Je vais lire aussitôt votre prochain roman Médium, qui paraît début janvier, et dont, déjà, mon génial ami Malraux me dit qu’il est excellent. Vive l’identité heureuse ! Et à nouveau : Vive la France ! »
J’étais à peine étonné, ce soir, mais, après cette interlocution stellaire, je crois que je vais dormir.
Philippe Sollers,
Venise, dimanche 13 octobre 2013, 18h43
Note : Vous pouvez aujourd’hui remplacer le nom de Philippot, désormais "patriote", par n’importe quel nom propre, chacun revendiquant désormais l’héritage "gaulliste".
LIRE AUSSI :
André Malraux / Charles de Gaulle / la Chine
De Gaulle surréaliste
par Philippe Sollers

un film de Georgi K. Galabov et Sophie Zhang
présenté au Colloque international de Cerisy JULIA KRISTEVA : RÉVOLTE ET RELIANCE (26 juin - 3 juillet 2021)



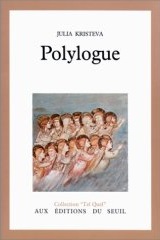 « Polylogue » : voici l’un des extraits du texte de Kristeva lu par Sollers sur son roman H. Il a paru dans le n° 57 de Tel Quel au printemps 1974 avant de donner son titre à l’ensemble du livre publié en 1977. C’est dans le même numéro de Tel Quel que paraît le premier extrait du feuilleton Paradis.
« Polylogue » : voici l’un des extraits du texte de Kristeva lu par Sollers sur son roman H. Il a paru dans le n° 57 de Tel Quel au printemps 1974 avant de donner son titre à l’ensemble du livre publié en 1977. C’est dans le même numéro de Tel Quel que paraît le premier extrait du feuilleton Paradis.
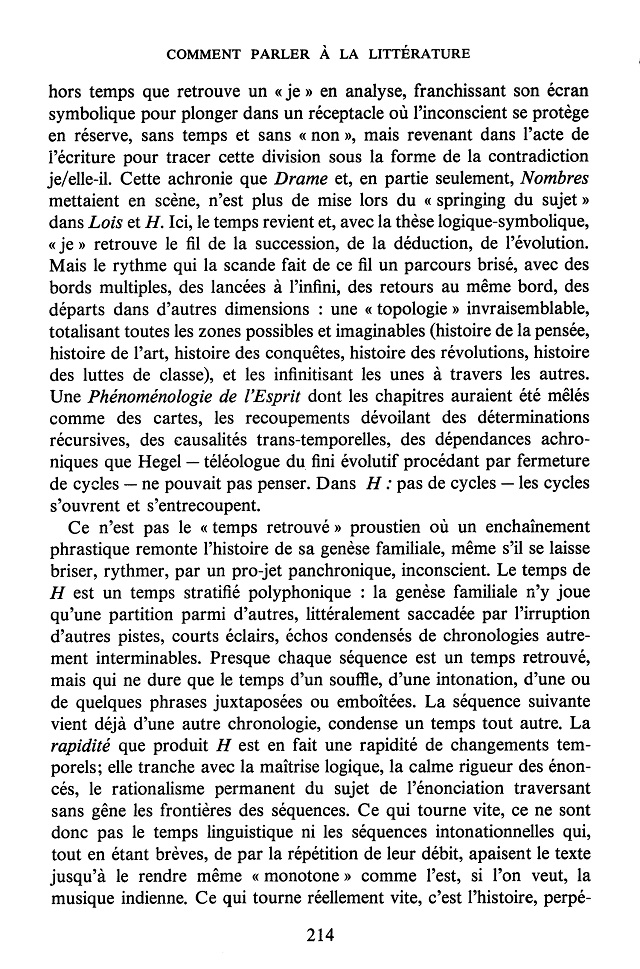
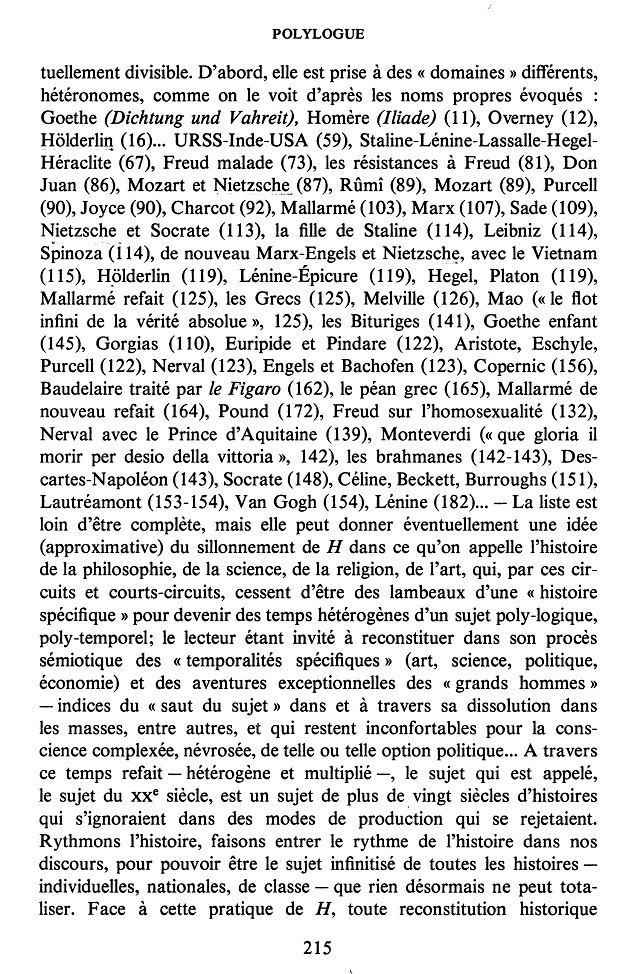
POLYLOGUE.
ZOOM : cliquer sur l’image.

Fin du roman H : « et si la voix crie tombant d’hydrogène alors que crierai-je crie lui toute chair est comme l’herbe l’ombre la rosée du temps dans les voix ». « H » c’est aussi l’hydrogène, la bombe H, ce qui explique le montage d’une des séquences finales de la vidéo où se superposent la couverture du roman, celle de Polylogue et des images d’explosion atomique.
Fin de Polylogue et de H dans sa version ponctuée :

POLYLOGUE.
ZOOM : cliquer sur l’image.



Yaël Dosquet, Une lecture de H (2022)
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

[1] « La plus belle île,/ toutes les îles excellentes,/Siège du plaisir et de l’amour/Venus choisira ici sa demeure », Henry Purcell, King Arthur.

[2] « Limite du diaphane dans. Pourquoi dans ? Diaphane, adiaphane. Si on peut passer ses cinq doigts à travers, c’est une grille, sinon une porte. Fermons les yeux pour voir. » James Joyce, Ulysse, Gallimard, 1948, Livre de poche, p. 36 (trad. Auguste Morel, revue par Valéry Larbaud et l’auteur).
« Limite du diaphane dans. Pourquoi dans ? Diaphane, adiaphane. Si l’on peut passer ses cinq doigts au travers, c’est une grille, sinon une porte. Ferme les yeux et vois. » Ulysse, folio Gallimard, 2004, p. 57 (traduction Pascal Bataillard, sous la direction de Jacques Aubert).
[3] Texte trop long pour être repris ici dans son intégralité. Vous pouvez en lire des extraits en traduction anglaise.
[4] Voir : Sur le matérialisme.
Dans le dernier volume de son Journal hédoniste, Michel Onfray — l’auteur de la Contre-histoire de la philosophie — écrit plaisamment : « ... Philippe Sollers — dont je ne retrouve pas Sur le matérialisme dans ma bibliothèque, tant mieux pour lui, dommage pour moi... » Ce qui, bien sûr, ne veut pas dire qu’il ne l’a pas lu.
[5] En italiques, les chiffres indiquent les lignes.
[6] La pension Seguso, à Venise, se trouve à côté de La Calcina où séjournaient deux fois par an Sollers et Dominique Rolin. A.G.
[7] Lire, plus bas, le commentaire de Marcelin Pleynet que j’ai découvert après avoir écrit cet article.
[10] Peintre et membre du Comité de rédaction de Tel Quel.
[11] J’ai déjà fait l’inventaire de ces premiers entretiens. Voir Sollers dans art press.
[12] Sauf erreur, cet entretien n’a pas été republié.
[13] H, Seuil, 1973.
[14] Jacques Henric parle, à propos de Lois, d’une « réécriture décapante de divers grands mythes fondant notre culture occidentale ».
[15] ... et vous voudriez que la tonalité continue non mais... (H, p. 184).
[16] ... le poudroiement du sujet dans l’histoire... (Sollers).
[17] Sollers reviendra trente ans plus tard sur cette lecture un peu rapide de Heidegger. Dans un entretien avec F. Meyronnis et Y. Haenel de 2002, il dira que, pour cet entretien, il a mieux lu Heidegger qu’il ne l’avait fait jusque là. Voir Richesse de la nature.
[18] Cf. Polylogue, Seuil coll. Tel Quel, 1977, p. 173-221.
[20] Hölderlin, Lettre à Böhlendorf, 2 décembre 1802. A noter que Hölderlin signe sa lettre " Dein H ", " Ton H ".
[21] Hölderlin, Andenken (Souvenir), 1803 ou 1804.
[22] Heidegger.
[23] C’est-à-dire le 28 février 2004. A.G.






 Version imprimable
Version imprimable


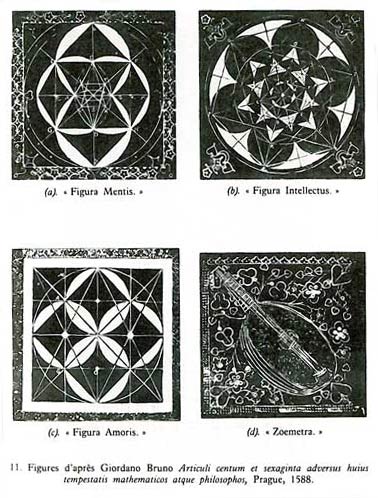
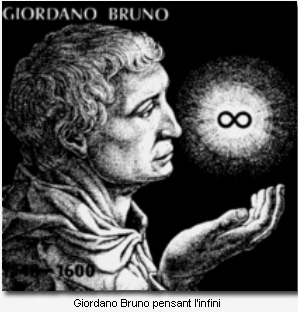

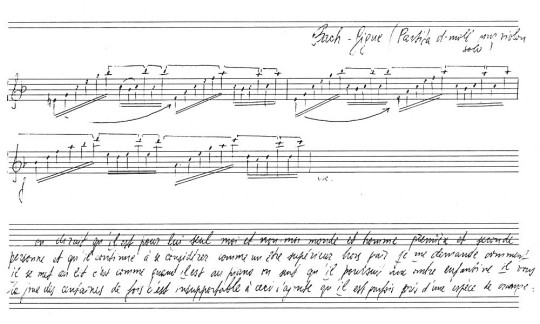

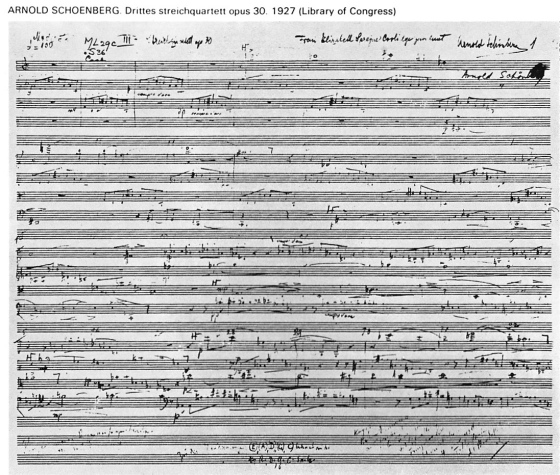





 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?



2 Messages
1. De Gaulle : Votez Sollers !
2. Documents : De Gaulle, Malraux, Mao, Jean XXIII
Deux interventions de Sollers en 2013, où, surprise, il est d’abord question de H... en cette année 2020 où on a célébré le général De Gaulle... et où, ce 28 novembre, Sollers a eu 84 ans. VOIR ICI.
Décidément, l’histoire continue.
Samedi 28 novembre 2020, jour J, Sollers a 84 ans aujourd’hui. Bonne chance.