
10/01/2024 Ajout sections :
 La critique de Fabien Ribery
La critique de Fabien Ribery
 « Bleu Bacon ». Entretien d’Eva Bester (Grand Canal) avec Yannick Haenel
« Bleu Bacon ». Entretien d’Eva Bester (Grand Canal) avec Yannick Haenel
 L’extrait "TOUT BACON’
L’extrait "TOUT BACON’
12/01/2024
 L’entretien avec Zone Critique’
L’entretien avec Zone Critique’
Un avant-goût du denier livre Bleu Bacon de Yannick Haenel
Par Alexis Brocas
La Tribune, 07 Jan 2024

 _ Yannick Haenel (Crédits : © Maylis Rolland / Hans Lucas)
_ Yannick Haenel (Crédits : © Maylis Rolland / Hans Lucas)

La collection « Ma nuit au musée » repose sur un principe simple : prenez un écrivain, laissez-le mijoter, une nuit durant, dans le musée de son choix, et voyez quel texte en sortira. L’expérience a déjà donné de grandes réussites : la rencontre de Lydie Salvayre avec L’Homme qui marche< du sculpteur Giacometti, celle de Lola Lafon avec les fantômes de l’Annexe amstellodamoise où Anne Frank se cachait des nazis. Aujourd’hui, le romancier Yannick Haenel livre le résultat d’une claustration volontaire qui s’annonçait périlleuse : une nuit au Centre Georges-Pompidou avec Francis Bacon, l’homme qui repeignit le Portrait d’Innocent X par Vélasquez en figure hurlante. On dit son œuvre cruelle, Haenel montre qu’il en est tout autrement.
Le livre commence par une violente migraine ophtalmique, suffisamment bien décrite pour qu’elle ne soit pas contagieuse : normal, la peinture de Bacon « cisaille les yeux ». Quelques pilules de tramadol salvatrices plus tard, nous voilà partis pour le récit d’une « expérience de saisissement ». Un tourbillon bien ordonné où l’ekphrasis - la description des œuvres -, l’analyse et l’autobiographie se mêlent jusqu’au mysticisme : « Je me disais que la peinture de Francis Bacon avait besoin de se nourrir, et que sa nourriture c’était nous, c’est-à-dire, cette nuit, moi, seul morceau de viande à se mettre sous la dent, et je n’étais pas effrayé à l’idée d’un tel sacrifice. » Haenel nous montre Bacon rejoignant Monet et Hokusai en peignant l’eau d’un lavabo, indique le pied renversé d’Œdipe face à la sphinge, tombe en arrêt devant un autoportrait, « tentative d’assassinat sur lui-même » perpétré par Bacon après le décès de son compagnon. Il suit, aussi, de tableau en tableau le fil d’une tache de sang, de la présence du bleu, et ainsi, peu à peu, l’exposition devient livre de signes. C’est peu dire que Haenel maîtrise sa forme - les liens fusent avec Rimbaud, Nietzsche, le Michel Strogoff de Jules Verne. C’est à la fois brillant et intime, un peu agaçant parfois - Deleuze et Bataille dégainés comme des cartes de modernité -, touchant aussi quand il raconte l’alcoolisme de Bacon ou son combat contre « l’abstraction décorative ». Mais par-dessus tout, Haenel, en témoignant sans filtre de ce que cette œuvre produit sur lui, nous rappelle combien l’art peut nous modifier, nous dévaster, nous reconstruire, pourvu qu’on accepte de s’ouvrir à lui. Et que la tendance à s’en protéger par l’indifférence annonce un monde beaucoup moins humain.
Alexis Brocas
BLEU BACON, Yannick Haenel. Stock, 228 pages, 19,50 euros. (en librairies mercredi).
Bleu Bacon, de Yannick Haenel : une merveilleuse errance avec Francis Bacon
Par Mohammed Aïssaoui
Le Figaro, 04/01/2024

 Yannick Haenel. Sébastien SORIANO/Le Figaro
Yannick Haenel. Sébastien SORIANO/Le Figaro

CRITIQUE - L’écrivain raconte sa nuit au musée de Beaubourg en compagnie du peintre anglais. Suivez le guide !
Se retrouver seul, une nuit, dans un musée rien que pour soi ? L’expérience fait rêver. Yannick Haenel a souvent associé la peinture à la littérature, il a déjà dit sa passion pour le Caravage, écrit sur « la radicalité artistique » d’Adrian Ghenie… Et une grande part de son œuvre est traversée par cet art, on songe aux scènes hallucinantes de Tiens ferme ta couronne au Musée de la chasse. Il aime Francis Bacon depuis son adolescence…
À découvrir
Cela tombe bien, Alina Gurdiel, directrice de la collection « Ma nuit au musée », lui propose de se rendre au Centre Georges-Pompidou, au moment d’une grande exposition consacrée à Bacon. L’écrivain veut profiter de cette chance exceptionnelle d’avoir ses tableaux pour lui tout seul, toute une nuit. Il en rêvait : « Je voulais contempler chacun d’eux sans me presser, passer enfin du temps avec la peinture, la voir de mieux en mieux. J’attendais de la joie, j’espérais une métamorphose. »
Des années qu’il attendait cette belle opportunité de se retrouver en tête à tête avec Bacon. Mais ça commence par un cauchemar. Dès les premières minutes où il entre à Beaubourg à la rencontre de Bacon, Yannick Haenel vacille. Une migraine ophtalmique l’attaque aussi sûrement qu’une crise d’angoisse. « La tête me tournait, j’avais chaud, et les yeux commençaient à me brûler. » Il avance en titubant vers le couloir où un lit de camp était mis à sa disposition. Que va-t-il pouvoir voir dans cet état ? Il ne va tout de même pas dormir toute la nuit ? Il hallucine, entend des voix. « Ma tête explosait, j’avais peur de m’évanouir avant d’atteindre le lit. »
Une relation sensuelle avec l’art
Petit à petit, il reprend le dessus. Commence alors ce que l’on pourrait appeler un voyage autour des tableaux de Bacon. Ou une merveilleuse errance : l’errance est la façon d’écrire de Haenel. Il dit ce qu’il ressent, il n’a avec l’art qu’une relation sensuelle, par moments charnelle. Pour sortir de la douleur, il va vers le bleu de Bacon, « une ligne bleue papillonnait en effet d’un tableau à l’autre avec l’intensité d’un sésame. » Il porte une attention toute particulière au tableau Water From a Running Tap - il a des commentaires qui vous enchantent. Chez le romancier, peinture, littérature et physique sont inextricablement liées : « Je me suis glissé dans ces reflets, j’ai mêlé mon corps à ces miroitements. »
Francis Bacon n’est pas le peintre de la violence et de la cruauté, c’est la société qui est sadique et qui a intérêt à nous faire croire que les artistes sont des détraqués
Yannick Haenel
En passant, il fustige une idée répandue : Bacon serait « le peintre de la cruauté et de la violence », comme indiqué dans les premières lignes de l’encyclopédie Wikipédia. Haenel s’insurge : « Soyons clairs : Francis Bacon n’est pas le peintre de la violence et de la cruauté, c’est la société qui est sadique et qui a intérêt à nous faire croire que les artistes sont des détraqués. »
Son récit montre toute la lumière, la foi, l’optimisme même, qu’on peut retrouver chez Francis Bacon. « La peinture se médite elle-même, sa solitude appartient à l’éclaircie. » Le livre est habité tout entier par des phrases de toute beauté qui sont la signature de Haenel. Il nous dit que l’art ne peut être abstrait : il permet de vivre intensément.
Bleu Bacon, de Yannick Haenel, Stock /« Ma nuitau musée »,234 p., 19,50 €. Stock
Yannick Haenel : "Le Caravage et Francis Bacon … sur France Culture le 4 mars 2019 ·
Rencontre avec l’écrivain Yannick Haenel autour de deux peintres, Francis Bacon et Le Caravage, à l’occasion de la parution de "Conversations" de Francis Bacon - dont il signe la préface - et "La solitude Caravage".
 La critique de Fabien Ribery
La critique de Fabien Ribery


 « Bleu Bacon ». Entretien d’Eva Bester (Grand Canal) avec Yannick Haenel
« Bleu Bacon ». Entretien d’Eva Bester (Grand Canal) avec Yannick Haenel

 9 janvier 2024. Eva Bester, dans son émission du soir Grand Canal, , reçoit Yanick Haenel. Il nous présente son ouvrage "Bleu Bacon" paru aux éditions Stock.
9 janvier 2024. Eva Bester, dans son émission du soir Grand Canal, , reçoit Yanick Haenel. Il nous présente son ouvrage "Bleu Bacon" paru aux éditions Stock.




Entretien avec Yannick Haenel : “Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d’homme.”
Par Sébastien Reynaud
Zone critique, mercredi, janvier 10, 2024 ·

Yannick Haenel ©Linda Tuloup

A l’occasion de la parution du dernier essai de Yannick Haenel, Bleu Bacon, Zone Critique vous propose un entretien fleuve en deux parties avec l’auteur de Cercle, de Tiens-ferme ta couronne et du Trésorier-payeur. Pour Yannick Haenel, l’origine de la littérature est l’expérience du désir. Nous avons décidé, dans cette première partie de l’entretien, d’explorer ce thème : “Le désir, selon moi, est un état qui, lorsqu’on y accède, nous ouvre à la création, c’est-à-dire au retournement de nos raisons de vivre.”, nous dit l’écrivain.
Zone Critique vous propose également une rencontre avec Yannick Haenel le vendredi 26 janvier à 19h30 au sein de RESO L’Ecole de Méditation autour de son dernière essai, Bleu Bacon Pour vous inscrire c’est ici.
ZC : Le désir est un motif qui traverse votre œuvre. Pourriez-vous nous donner votre définition personnelle de ce terme ?
Yannick Haenel : Le désir, dans mon cas, c’est le passage de la jouissance au langage. C’est ce qui brûle à ce point où la vie devient phrases, et accroît son intensité. La littérature se joue à ce croisement. Vous voyez, ça n’a pas seulement lieu sur le plan de l’expérience, ça ne se résume pas à ces moments où l’intensité de vivre nous ouvre à plus encore qu’à elle-même, mais c’est la transformation de cette intensité en phrases.
Je ne conçois pas de littérature sans désir. Je sais que cela va à l’encontre de quelqu’un comme Michel Houellebecq dont la littérature nous dit à quel point le désir est misérable et fait fausse route. En lecteur de Rimbaud, j’ai tendance au contraire à associer désir, aventure et littérature. Je dirais même que l’essence de la littérature a à voir avec ce désir et cette effervescence-là. Les livres que j’ai écrits sont tous travaillés par quelque chose qui les a déclenchés, et qui est une expérience de désir : que ce soit la découverte, à 15 ans, d’un tout petit morceau de peinture imprimé en noir et blanc dans un livre, et qui se révèle être un détail d’un Caravage, ou un autre moment dans ma vie où j’ai tout fichu en l’air, où j’ai rompu avec le travail, avec la vie vécue d’avance : le moment initial est toujours un événement de désir. Ce désir est à l’origine, et pourtant c’est lui que je cherche en écrivant. Le désir est donc au début et à la fin. Vous voyez, il ne s’agit pas de satisfaire un désir, mais de le faire vivre. La satisfaction impliquerait une forme de pouvoir : un type qui ne vise qu’à satisfaire ses désirs, ce n’est jamais qu’une brute infantile. Le désir, selon moi, est un état qui, lorsqu’on y accède, nous ouvre à la création, c’est-à-dire au retournement de nos raisons de vivre.
Le désir peut avoir des incarnations variées : il peut être érotique, poétique, existentiel. Si j’essaie tellement de rendre présent le désir, c’est parce que je crois qu’il n’y a pas mieux. La vie du désir est la vraie vie. Lorsque le désir est éteint, on ne vit pas : corps mort, intelligence morte, langage mort. Ce désir que je cherche à atteindre à travers le langage, à travers les phrases, n’a pas d’objet : c’est un désir qui se maintient en tant que désir, comme ce « plan d’immanence » dont parle Deleuze, comme une dimension qui n’aurait pas de bords, pas non plus de surface, et qui ne cesserait d’offrir des intensités. C’est là que j’essaie de me placer pour me rendre disponible aux échos et aux effets que le désir suscite dans le monde du langage. C’est cela, pour moi, un roman : un espace de pure disponibilité.
ZC : Vos romans, vos essais, font signe vers un certain chemin spirituel, tendent à nous mettre en relation avec une dimension de mystère. Comment articule-t-on cette dimension-là avec la question du désir ? Pourrait-on également dire, à l’unisson de Simone Weil dans son petit traité De l’attention, que le désir est le point de départ de toute vie spirituelle ? Simon Weil en parle en effet comme de “la seule force capable de monter l’âme”.
L’extrait
Voici, le chapitre 6 du livre (il y en a 25). Il illustre à la fois la virtuosité littéraire de Yannick Haenel à décrire une expérience initiatique, vertigineuse, labyrinthique, cauchemardesque, insoutenable, la sienne, en même temps qu’il nous fait entrer dans le processus de création de Francis Bacon. On n’en sort pas indemne. Mais comme le dit Fabien Ribéry :
le peintre, comme l’écrivain véritable, sont ces héros (terme sollersien) qui, au plus loin du néant, cherchent/trouvent obstinément ces points « où l’on se réveille de la mort ».
Notons que le livre que Sollers avait en chantier au moment de son décès, et à paraître, en mars, s’intitulera ‘ « La deuxième vie »
6
Tout BaconJ’avais soif de couleurs, de lumières – soif de peinture. Je voulais la voir, enfin, cette exposition, alors je me suis mis à courir et à traverser les salles en éclatant de rire. Il y avait de grands éclats bleus qui éclaboussaient les murs, des types torse nu en slip penchés au-dessus d’un lavabo ou assis sur une chaise en bois, des jaillissements d’encre noire et des nimbes violets, du rose, beaucoup de rose et de bleu giclant sur des matelas ou bien le long des escaliers dans un hôtel où la nuit se jette sur vous, des draps froissés, des journaux qui traînent, des portes qui vous observent d’un œil inflexible et shakespearien, qui vous refusent le passage comme si l’entrée du château vous était interdite, un pied qui se lève vers la serrure et tourne la clef, et puis aussi des interrupteurs poisseux, de larges fonds orange et des miroirs glissant sur cet orange comme des couperets de guillotine, des bouches qui crient, des bouches qui mangent leurs dents, des bouches qui dégurgitent la peinture, des parapluies ouverts sur un supplice, couvrant des scènes de crime, des bouts de viande, des ampoules qui se balancent au-dessus de la viande comme des micros qui enregistrent l’horreur de vivre, comme des stéthoscopes prenant le pouls de l’agonie, et la chair des humains divisée par la souffrance, cisaillée par le crime, la chair tordue, crispée, qui ressent devant nous jusqu’aux os ce qu’il en est d’être rongée, la chair où palpite l’opale et des roues de voiture qui se dirigent en dérapant vers un accident d’où giclent des épaisseurs écarlates, des contorsions vertes, des contorsions bleu lavande, des contorsions rouges, orange, mauves, des touffes d’herbe et des seringues, un étal de boucherie qui est une piste d’acrobate, une arène, un jardin pour les morts qui se croient vivants et pour les yeux qui se ferment sur le pire, et ce lavabo parcouru d’émail où j’ai tout de suite eu envie de boire au robinet et de m’éclabousser le visage, et cette odeur d’alcool, la sentez-vous, ce whisky au parfum de cuir et la fumée qui imprègne ces rideaux, ces canapés, ces literies défoncées, ces chambres surexposées offertes à la tyrannie du néon, ces hommes aux cuisses musclées de prédateurs empaillés qui trempent leurs pieds dans des flaques de larmes noires, ces hommes penchés sur des chiottes qui dégueulent, ces hommes à la chair rose bonbon, à la peau fripée de petit enfant sale, aux joues de tortue mongole, ces entrejambes statufiés dans une posture de coq décapité qui se plantent au milieu des cadres, comme les miniatures d’un jeu sexuel interrompu à jamais par dégoût, par tristesse, par mort du partenaire, des hommes encore, vissés à leur chaise de viande, qui se jettent sur un corps et se collent à son cul, des hommes qui coïtent et des géométries impossibles, absorbées dans leur siphon, du sable qui roule sur lui-même et se soulève comme animé sexuellement, comme si la dune avait des cuisses qui vous étreignaient, et puis dans une autre salle, un peu plus loin, il y a un taureau qui se divise en pénétrant un miroir, et son coup de corne qui menace mon regard, qui vise mon œil et projette son désir de m’aveugler sur l’ensemble du visible, cherchant à nous arracher les yeux à tous, à énucléer ce monde d’assassins, à retourner le crime dont il est l’objet, et les seins mauves, bleutés d’ecchymoses de Henrietta Moraes, qui se dressent en lisière d’une chambre noire couverte d’herbes où elle fait son apparition, et tandis que je repasse hors d’haleine devant mon lit de camp, le sein unique, rose pâle, de la sphinge au visage voilé d’un collant chair qui lorgne, impassible, la cheville bandée sanguinolente d’Œdipe, et la tête de Michel Leiris cravaté, sanglé, étranglé par le boyau même de son être, avec l’œil aigu d’un ragondin et le front traversé par un os découpé comme une corne (celle, peut-être, du taureau dont il énonça qu’elle était l’emblème de la littérature), son crâne tondu luisant dans les ténèbres et le faciès rond tranché aux angles, entièrement brossé de pointillés verts et roses, et puis de nouveau, tandis que je parcours les salles cœur battant, emportant dans mon sillage des féeries d’intensités bleuâtres et fauves, comme si je déshabillais les tableaux et m’enfuyais avec leurs couleurs, comme s’ils s’exhibaient plus crûment d’être seuls avec eux-mêmes dans la nuit, livrés à un unique regard qui se concentrait de mieux en mieux sur cette vieille substance imprévisible, la peinture à l’huile, appliquée par Bacon l’espèce de sibylle à la mèche blonde du triptyque de 1944 refait en 1988, celui qui habite mes cauchemars depuis tellement d’années et dont la présence ici, cette nuit, commençait à remuer mes hantises, et des ombres noires comme des mâchoires, un monocle, un singe qui montre les dents, des chauves-souris qui jouent les Érinyes qui se prennent elles-mêmes pour des vautours justiciers, avec le corps grisâtre d’un rat volant, un plumage et des ailes qui semblent une cape de vampire et des oreilles d’éléphant, un type au masque blanc vautré dans une nacelle qui fume un cigare, hautain comme un financier, et dont le poids sur une balançoire de justice signera son jugement (je me plais à le penser), un visage couvert de mousse à raser, un cendrier, peut-être, ai-je vu un cendrier, en tout cas des grimaces et des chevelures, et à travers ces phrases une joie sauvage répond à l’illumination des murs peints, comme si j’évoluais en contemplant les Bacon dans les boyaux extatiques de Lascaux où mon regard vient se perdre chaque nuit depuis l’enfance, où mes lèvres humectées de poudre se mettent à saliver sous l’effet de la drogue des chamans et de cette fraîcheur aphrodisiaque qui baigne les siècles contenus sous terre : oui cette joie sauvage qu’on éprouve lorsqu’on aime, et que notre peau s’offre à une autre peau, jusqu’à ce point où nous mènent les étreintes qui étanchent notre désir parce que d’elles s’écoule une fontaine, et peut-être aussi une tempête d’atomes blancs, jaunes et roses enroulés dans leur frisson, et aussi des chairs brossées, c’est-à-dire la lumière et le mouvement qui tournent sur eux-mêmes comme la nuit qui tombe, comme la stupeur qui la porte à vrombir, car vous le savez bien, nous nous sommes tous un jour couchés comme les personnages de Bacon dans des chambres qui tanguent, au bord de basculer dans la nausée, et s’il est affreux de se rêver ainsi rampant comme un enfant qui vomit, il devient urgent (Bacon me le dit) de bien considérer à quel point chaque corps qui s’étire dans son cadre et s’agrippe au réel qui le menace combat avec lui-même ou avec le monstre qui lui échoit, car cette ombre noire qui rampe sur tel corps (sur moi) avec des torsions de plaisir écœurant ressemble à la toison d’un sexe devenu animal qui absorberait à travers ses spasmes l’abondance des courbes qu’il colonise, et avec elles les cuisses, les fesses qui composent un paysage criard, comme si un serpent s’échappait d’une chair malheureuse, et puis encore des corps disloqués qui s’affaissent dans le canapé du non-être et des miroirs qui en fracturent la coulée rose et grise et bientôt noire, bien scellés sous leurs parois de verre et leurs cadres dorés, comme si la peinture s’éloignait déjà ironiquement dans le coffre-fort qui l’engloutira loin de nos yeux, et l’ébriété d’un silence de ménagerie, et les cris qui prennent la place des yeux, et ce bleu de Prusse qui gicle au cœur des étreintes ou des luttes, comment savoir s’il s’agit d’amour ou de combat, ne parle-t-on pas de combat amoureux, n’est-ce pas le nom d’un madrigal, ce bleu de Prusse, oui, ce cœur bleuté qui palpite comme du sperme à l’intérieur des bustes noués, entre le bas-ventre et le commencement des cuisses, à cet endroit, moiré comme une offrande, où même les brutes sont fragiles, où la blessure cesse de hurler et se pâme au-delà de la morsure en un jaillissement qui rend sa clarté à la nuit, affole les atomes, éclate de rire au nez des puritains et arrose le visible tout entier de sa fraîcheur scintillante, et plus encore que le temps ou l’espace, c’est la dissolution qui nous apporte « ce prisme impondérable dans lequel chaque être ou chaque chose est inclus », comme dit Leiris avec ses habituelles contorsions, je dirais quant à moi ce foutre multicolore qui redonne vie à la vie, qui élargit l’arc-en-ciel d’une palette où viennent glisser des extases et des crucifixions, où chacun de nous, pantelant face aux cadres de Bacon, cherche intérieurement à retrouver son geste, cet instant où dans le chaos de l’atelier, entre les chiffons maculés, les amoncellements de livres épaissis de peinture séchée, les palettes de croûtes et l’odeur de térébenthine, se donne à voir un passage, un trou soudain dans le mur, et c’est par ce trou qu’il faut sortir, dit une voix féminine dans ma tête, c’est en lançant un œil dans ce trou, et avec lui l’autre œil, et notre cœur et notre bouche pour embrasser l’inconnu, et voici qu’on y entre tout entier, la jambe droite haut levée, comme Œdipe face à la sphinge, et l’on passe à l’intérieur, ça y est, on est entré dans la peinture à l’huile, on s’est dissous dans la matière même de cet onguent dont Madeleine enduit les pieds du Christ, et vous avez remarqué : toutes les femmes que Bacon a peintes (il y en a si peu) nous dévisagent avec pitié, j’en avais vu tout au plus trois dans l’exposition, disons trois ou quatre, il aurait fallu que je vérifie, revienne sur mes pas, reparte en arrière, mais à ce moment de la nuit il n’y avait déjà plus ni avant ni arrière, juste un unique souffle qui se propulse d’une peinture à l’autre et s’offrant à l’aura qu’elles dégagent, devenu l’offrande qui manquait au début, se donnant tout entier à la sensation que le monstre tapi en chaque tableau suscite, et je me disais que la peinture de Francis Bacon avait besoin de se nourrir, et que sa nourriture c’était nous, c’est-à-dire, cette nuit, moi, seul morceau de viande à se mettre sous la dent, et je n’étais pas effrayé à l’idée d’un tel sacrifice, il me semblait au contraire que c’était de cette manière que se vivait la peinture, on s’abandonne ainsi dans l’amour, et si l’on ne s’abandonne pas ce n’est pas de l’amour, il fallait donc que je laisse faire la nuit, que je la laisse me défaire, et qu’en me faufilant dans le trou creusé par la peinture de Bacon je me livre corps et âme à celle-ci, car à cet instant de la nuit, sans que rien en fût voulu, après avoir perdu tous mes repères devant chacun des quarante-deux tableaux exposés dans les huit salles de cette aile hermétiquement close du Centre Georges-Pompidou, épuisé, haletant, gorgé de frissons, lourd et léger à la fois, je n’existais plus que sur un plan poétique, tout en moi était devenu phrases, le langage avait pris ma place et flottait sans moi dans cette nuit de peinture, j’étais nu comme un flocon, devenu entièrement lumière, écume, poussière en suspension entre deux lueurs, transparence, filigrane, rien.
.
Ce qu’en dit Arnaud Jamin (Diacritik) dans son excellente critique du livre
La soif de Haenel pour le mystère de la peinture est infinie et merveilleuse, un chapitre intitulé Tout Bacon, qui fait assurément écho au chapitre Tout Caravage de son ouvrage La solitude Caravage (Fayard, 2019), déploie ainsi sur plusieurs pages éblouissantes une accumulation diffractée et accélérée d’images, de plans et de profondeurs où toutes les scènes des tableaux défilent dans une tentative d’étancher une soif, de crier un désir. L’écrivain s’empare de sa propre pulsion scopique et lui restitue sa dimension de célérité jusqu’à la jouissance de l’empilement, de la multiplication, concentrant littéralement l’absolu. Voilà ce que fait la peinture lorsqu’on la pense et qu’on la poursuit comme Haenel dans la nuit (celle des heures dans le musée mais aussi celle de son âme). Il traverse alors devant les œuvres une peur enfantine, serpentant vers le passé d’une chambre au Niger, retrouvant une terreur panique d’être sacrifié par un sorcier mais approchant aussi le souvenir heureux d’une première caresse avec une fille portant une croix à l’adolescence. Cependant, c’est Bacon qui doit être sauvé du noir, les lignes de sa peinture appelant un grand dés-ensorcellement que Haenel trouve vers 2h30 du matin dans le centre même de l’œuvre du peintre, logée en retrait dans la couleur bleue. C’est le tour de force haenelien, il pointe sa lampe torche sur les déclinaisons des bleus de Bacon qui surgissent, s’ouvrent en une étrange épiphanie […], « Bacon affirme, à sa manière éruptive, un tel miracle, celui de la peinture qui ne cesse de se dresser contre la menace d’un engloutissement du visible. Si le monde n’est pas peint, on n’y verra bientôt plus rien – et peut-être même n’y aura-t-il plus de monde. »
Crédit : Diacritik.com
Ce qu’en dit Fabien Ribery sur son blog
:
Le chapitre 6 est un chorus de jazz (il y en a 25), dix pages sans paragraphe ni point énumérant Bacon jusqu’au vertige, non pas une vision panoramique, mais une vue totale où le temps n’existe plus, où Lascaux consonne avec Pontormo, et le corps du regardeur avec un flocon de peinture mauve.
Bacon se confronte à l’infigurable et à nos propres cauchemars.
Crédit « L’intervalle », le blog de Fabien Ribery
VOIR AUSSI sur pileface !"Bleu Bacon’
Conférence
Les Nuits de la lecture avec Yannick Haenel
Centre Pompidou 19 janv. 2024
Les Nuits de la lecture avec Yannick Haenel
Centre Pompidou 19 janv. 2024


En 2019, l’écrivain Yannick Haenel a passé une nuit entière dans l’exposition « Bacon en toutes lettres ». Dans son nouveau livre Bleu Bacon (éditions Stock, collection « Ma nuit au musée », 2024), il revient sur cette expérience nocturne.
Rencontre animée par Jean-Max Colard, en présence de Didier Ottinger, commissaire de l’exposition « Bacon en toutes lettres » et suivie d’une séance de signature à la librairie du Centre Pompidou.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Quand
19 janv. 2024
18h30 - 20h
Où
Centre Pompidou Niveau –1



 Bleu Bacon
Bleu Bacon 
 Version imprimable
Version imprimable

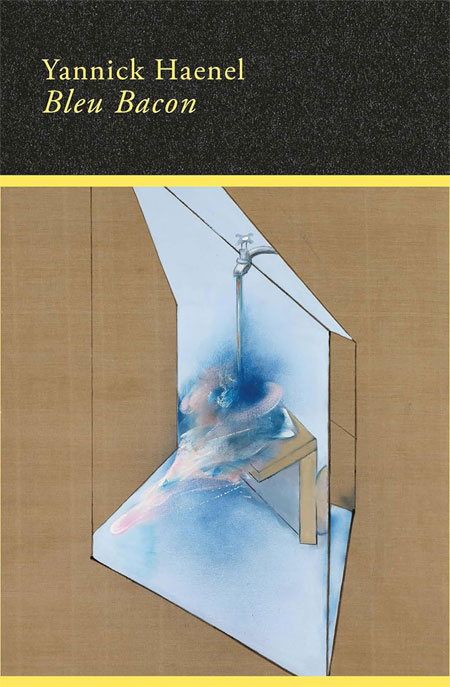

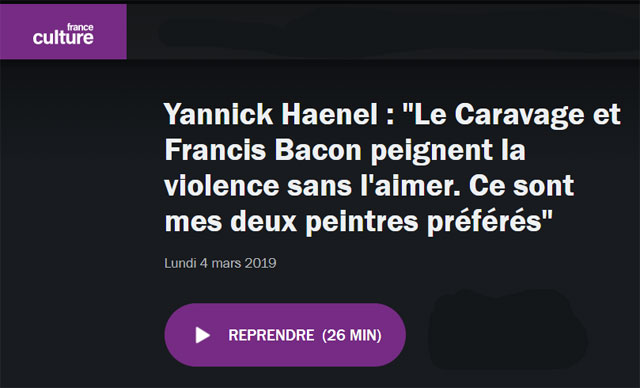


 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?



6 Messages
Bleu Bacon de Yannick Haenel paru aux éditions Stocks le 10 janvier 2024 sublime une nouvelle fois le monde de l’art. L’histoire se déroule en 2019. Yannick Haenel se rend au Centre Pompidou pour assister à l’exposition consacré à Francis Bacon. Mais alors qu’il a à peine mis un pied à l’évènement qu’il ne voit plus rien. Pris d’une violente migraine ophtalmique, il passe plusieurs heures allongé sur le lit de camp qu’on a dressé pour lui dans le musée. Il retrouve ensuite ses esprits, Yannick Haenel se met à parcourir l’exposition en proie à des états d’intensité contradictoires, qu’il raconte comme une aventure initiatique. "Est-il possible de ressentir intégralement la peinture, de la vivre comme une ivresse passionnée ?" Le livre met alors en lumière les impacts qu’une oeuvre peut avoir sur la personne qui lui fait face. Et au fil de l’ouvrage, c’est un autre aspect, moins connu de la peinture de Bacon qui va être abordé à sensualité de ses couleurs, la fraîcheur sexuelle de son bleu. Un voyage digne d’une nuit au musée qui ne laissera pas le lecteur indemne.
Présenté par : Augustin Trapenard
par Jean-Marie Durand
Les Inrocks, 16 janvier 2024
Francis Bacon , Water from a running tap © The Estate of Francis Bacon / ADAGP / Stock
L’art a une dette à l’égard de la littérature lorsque celle-ci capte l’effet vertigineux qu’une œuvre plastique produit parfois chez celui ou celle qui regarde. Deux textes d’écrivains, publiés en cette rentrée – Bleu Bacon de Yannick Haenel (Stock) et De plomb et d’or de François Jonquet (Sabine Wespieser) – réussissent chacun à leur manière à dire combien la proximité sensible avec un·e artiste peut transformer un regard, voire une vie entière. Francis Bacon, pour Haenel, Christian Boltanski, pour Jonquet, ont joué ce rôle de complice existentiel, auprès duquel le regard se construit, grâce auquel la vie se densifie, sans lequel le monde se vide.
Invité par le Centre Pompidou en octobre 2019 à passer une nuit au sixième étage du musée dans les salles de l’exposition Bacon en toutes lettres, Yannick Haenel restitue dans son texte l’ivresse d’une immersion nocturne, se rapprochant presque d’une transe, tant la proximité avec les toiles du peintre sorcier le plonge dans un trouble sensoriel. Dans une “expérience intérieure”, pour reprendre le titre du livre de Georges Bataille qui l’accompagne dans sa nuit et le protège des gouffres possibles suscités par la contemplation solitaire d’une peinture qui “exacerbe les apories” (un tramadol lui sera aussi nécessaire pour conjurer une migraine ophtalmique ; “trop de couleurs distrait le spectateur”, prévenait déjà Jacques Tati). Achevant avec ce livre une trilogie sur la peinture, inaugurée avec le Caravage et prolongée avec Adrian Ghenie, Yannick Haenel estime qu’on ne peut pas regarder Bacon comme on regarde n’importe quel autre tableau : “Il réveille précisément l’excès en vous.” À son contact, “on se met un peu à divaguer”. Car Bacon “nous saute au visage” ; il “vous attrape par les yeux et ligote votre esprit”. L’écrivain se demande “comment, face à des tableaux chargés d’abîmes comme ceux de Bacon, on risque, en s’approchant, de se faire absorber”. Car Bacon peint l’invivable, l’éternelle blessure de l’existence. Au cœur de la nuit, les ténèbres du peintre le contaminent indiciblement, car regardant ses toiles (Water form a Running Tap, Jet of Water, Les lutteurs…), “c’est soi-même qu’on scrute éperdument” ; “nous nous voyons partout”. Face à Bacon, Haenel se devine moins dans un reflet que dans une réflexion, comme si l’art constituait un accès unique à soi-même, à la source de ses sensations. “C’est en regardant la peinture qu’on continue à voir”, écrit-il. “La justesse du regard, c’est l’art qui nous l’enseigne” ; “ne plus regarder de tableaux, c’est risquer de perdre la vue”. À travers le récit de sa plongée baconienne, Yannick Haenel livre ainsi un éloge magistral de l’exercice du regard, qui le vitalise autant qu’il le déséquilibre.
À l’œuvre de Christian Boltanski, l’écrivain François Jonquet doit, lui aussi, le fait d’avoir appris à mieux vivre, à mieux comprendre ce qu’on peut attendre de l’art lui-même. Ami proche de l’artiste, disparu en 2021, le romancier se livre à travers le récit fictif de son personnage, François Jonas, élève aux Beaux-Arts du plasticien, à une évocation émouvante de son travail, et surtout de sa présence passée auprès de lui, de ses mots, de ses pensées impromptues, animées par une certaine sagesse. “Ce que j’aimerais, c’est que mes élèves aient l’impression d’avoir rencontré quelqu’un, en disant c’est un imbécile mais j’ai vraiment rencontré quelqu’un, et aussi qu’ils acceptent ce qu’ils sont”, confie Boltanski à François dans le livre. “Parce qu’il n’y a qu’une seule chose à faire en art, c’est attendre et espérer.”
Le roman, par-delà une légère satire du marché de l’art contemporain, restitue la générosité du plasticien, qui décidait dès l’âge de 24 ans de “mettre sa vie en boîte”, de garder une trace de tous les instants de sa vie, “de tous les objets qui nous ont côtoyés, de tout ce que nous avons dit et de ce qui a été dit autour de nous”. Jonquet fait aussi place à sa compagne Annette Messager, qui lui confie cette si belle pensée : “Tu sais, être artiste, c’est dans un même mouvement guérir ses blessures et les rouvrir.” Consignant ces échanges féconds avec Boltanski et Messager durant des années, Jonquet donne plus qu’à voir des œuvres d’art ; il les enveloppe et les magnifie par l’évocation d’une méthode artistique intuitive, et surtout d’un certain art de la transmission (“si quelqu’un te dit t’es con t’es laid mais ton travail est bien, embrasse-le”, disait Boltanski !). Avec le Bacon de Haenel, le Boltanski-Messager de Jonquet partage la volonté déchirante de saluer ce que les plasticien·nes nous font, quand on les écoute, quand on les contemple dans la nuit, entre le bleu et l’or, le silence et le plomb.
Bleu Bacon de Yannick Haenel (Stock/Ma nuit au musée), 231 p., 19,50 €
De plomb et d’or de François Jonquet (Sabine Wespieser), 246 p., 22 €
Exposition Francis Bacon à Paris en 1977 . © MINGAM/SIPA / SIPA
ZOOM : cliquer l’image
Marie-Laure Delorme
Paris Match, 14/01/2024
L’auteur Yannick Haenel passe une nuit au Centre Pompidou et consacre un récit au peintre Francis Bacon.
D’entrée de jeu, la migraine ophtalmique. Vertiges, yeux brûlants et brouillés, chaleur. Yannick Haenel avance à tâtons vers le lit de camp dressé dans le musée, pour s’y ¬reposer, avant de repartir à l’attaque des chefs-d’œuvre picturaux. Il craint que les comprimés de ¬tramadol ne le plongent dans un sommeil profond. Soudainement, son corps grelotte. Fallait-il se -préparer à une telle lutte ? L’écrivain passe une nuit seul au Centre Pompidou à Paris, le 12 octobre 2019, dans le cadre de l’exposition consacrée au peintre irlandais Francis Bacon (1909-1992).
Les huit salles constituent un labyrinthe à pièges. Depuis l’adolescence, Yannick Haenel vénère l’univers cru de Francis Bacon. Il attend de la joie de ce face-à-face nocturne entre ¬l’artiste et lui. La joie sera inextinguible, mais elle arrivera après un drôle de combat.
Dans son sac, une flasque de vin blanc, un livre de Georges Bataille, une lampe torche. Yannick Haenel a pris également de quoi écrire. Les souvenirs de l’enfance africaine affluent pour former un halo de lumière et de ténèbres autour de lui. À Niamey, au Niger, en 1979, il a commencé son corps-à-corps avec les mots. Sa chambre d’adolescent de 12 ans : quatre pales de ventilateur, des masques en ébène, le portrait d’une créature au visage barré de couleurs et à la crinière rousse.
L’auteur de « Tiens ferme ta couronne » (éd. Gallimard, prix Médicis 2017) a toujours dû faire face à sa propre exubérance. Il cherche et fuit la folie. À sa demande, les lumières du centre devront être coupées à 3 heures du matin afin qu’une autre expérience commence. Car tout est lutte entre vie et mort. Yannick Haenel exprime sa gratitude à Francis Bacon. Ses formes et ses couleurs ont ouvert des digues de liberté en lui.
C’est le bleu qui déjoue la pétrification
À plus de minuit, enfin, il émerge de sa migraine. Les tableaux de Francis Bacon bouleversent les fondations de son être. « Eau s’écoulant d’un robinet » (1982), « Œdipe et le Sphinx » (1984), « Trois études de figures au pied d’une crucifixion » (1944). « Triptyque, mai-juin 1973 » a été conçu en mémoire de George Dyer. L’amant du peintre durant huit ans s’est donné la mort, dans une chambre de l’hôtel des Saints-Pères, à Paris, l’avant-veille de la rétrospective de l’artiste au Grand Palais, en 1971.
Durant son errance nocturne, Yannick Haenel puise sa force dans le bleu des œuvres de Francis Bacon. « Dans les tableaux de Bacon, c’est le bleu qui déjoue la pétrification. » L’écrivain traverse les salles en riant et en courant et perd tous ses repères devant chacun des quarante-deux tableaux exposés. Ses questions : comment entre-t-on dans la peinture ? Pourquoi telle œuvre plutôt que telle autre ? Que voit-on de ce que l’on voit ?
Dans « Bleu Bacon », on retrouve le style de Yannick Haenel
Yannick Haenel ne souscrit pas à l’image d’un peintre violent et brutal, comme on l’affirme si facilement de Francis Bacon. Le créateur fait avec le monde. Il ne revêt pas ; il dénude. Son œuvre restaure l’énigme. L’auteur raconte son admiration pour un tableau où tout se tord et s’enfuit. L’art enseigne à regarder de manière juste le visible et l’invisible. La peinture est affaire sérieuse. Dans les entretiens avec Francis Bacon de David Sylvester, l’artiste notera à quel point il est toujours tendu : « Je suis totalement non relaxé. »
Dans « Bleu Bacon », on retrouve le style de Yannick Haenel. Son humour, son originalité. Ses phrases donnent l’impression de jaillir du ciel et non de la terre : « Parfois il me semble que le monde est mort, et que seule la peinture le remet en vie. » Yannick Haenel reste celui qui attend tout et trop de l’art et de l’amour. Son œuvre : le bleu et la nuit.
A LIRE ICI
Ajout de la section « L’extrait : « TOUT BACON »’
VOIR ICI
VOIR ICI
ET AUSSI :
 La critique de Fabien Ribery
La critique de Fabien Ribery