Le 13 juin 2021
Dans un entretien récent, Sollers déclarait :
« On s’étonne que le Front national et le fanatisme progresse. Mais que leur oppose-t-on ? Des caricatures. Est-ce que le fascisme français, le pétainisme, le nationalisme français ont été analysés à fond ? Non. Est-ce que le politiquement correct et l’anti-politiquement correct ont été analysés à fond ? Non. » (Subversion de Voltaire, 2015)



Cette question du « fascisme », du fascisme français, si propre (si l’on peut dire) à cette France moisie, avec « son corps, ses mots de passe, ses habitudes, ses réflexes », « son catalogue de clichés », « sa voix caractéristique », ses « petites phrases [...] bien rancies, bien médiocres, [s]es formules de rentier peureux se tenant au chaud d’un ressentiment borné », Sollers y a été sensible dès son enfance. C’est un leitmotif de sa réflexion depuis cinquante ans — avec ce qu’il appelle souvent « l’axe Vichy-Moscou » (et ne me dites pas que ce n’est pas d’actualité).
Dans les analyses de Sollers, Roland Barthes est toujours un ami et un allié sûr. En 1971, dans R.B., un texte mémorable publié dans le n°47 de Tel Quel, Sollers écrivait déjà :
R.B. n’est pas cosmopolite, mais réellement, fondamentalement, pluriel. Y a-t-il tellement de sujets-mouvants ? Chez lesquels on ne rencontre pas la moindre trace de : racisme, xénophobie, nationalisme, bref, d’hystérie ? L’hystérique est l’anti-R.B. : ce qui ne retient pas son autre, celui (celle) pour lelaquelle il n’y a pas d’autre. R.B. ou l’anti-névrose. Disons qu’il est inflexiblement, naturellement, démocrate. Tout ce qui, à l’endroit ou à l’envers, est imprégné de fascisme, le plus souvent sans le savoir, sans pouvoir le savoir (c’est-à-dire en le projetant au besoin sur autrui), ne peut que le trouver contre. R.B. contre le « vouloir-saisir » : ce pourrait être une bande dessinée. Le petit-bourgeois français s’y verrait simplement congédié par une liberté de langage : crispé, réactif, aigri, transférentiel, innombrable, seul, il défilerait, profil crayonné par Daumier, devant un lieu vide sur lequel il ne pourrait s’empêcher d’exhaler sa rancoeur.
Vingt ans plus tard, en 1993, c’est dans Vérité de Barthes que Sollers écrit :
Le fascisme, qu’il soit gris, noir, marron, brun ou rouge, a donc périodiquement la même couleur blanche de purification psychique. On peut d’ailleurs lui ajouter, pour faire bonne mesure, le vert islamique, comme le prouvent les intellectuels arabes et musulmans condamnés à mort ou assassinés un peu partout dans le monde.
Puis, car l’époque a changé (ce que ne veulent pas voir les adeptes à « l’intelligence borgnesse » de la « démocratie libérale », c’est-à-dire de ce que Debord appelait, dès 1988, le « spectaculaire intégré » [1]) :
Mais s’y ajoute aussi, nous le savons bien, un para-fascisme sournois, tourbillonnant et multicolore de la marchandise (liquidation en douceur par la loi du marché, le Spectacle, la dégradation de l’enseignement).
Dans un numéro hors-série du Monde consacré à Barthes (juillet-août 2015), Sollers rappelle encore le rôle précurseur de l’écrivain dans l’analyse de la société du spectacle.



Juillet 1972, Colloque de Cerisy « Vers une Révolution culturelle : Artaud, Bataille ».
Roland Barthes, Philippe Sollers, Stanislas Ivankov.
ZOOM : cliquer sur l’image.

L’antifascisme de Barthes
Je ferai un éloge politique de Roland Barthes. D’autant plus politique que nous sommes en plein bouleversement de ce pays qu’on a appelé autrefois la France, qui est dans un état de putréfaction avancé, où on voit se dessiner très bien un passé qui ne passe pas et revient sous la forme de ce qu’il faut bien appeler le fascisme. Barthes est à ma connaissance le seul écrivain français qui, très tôt, d’instinct — il faut souligner cet instinct — a compris le phénomène fasciste français. Il ne faut pas espérer comprendre ce qui s’est passé sous différentes formes totalitaires, qu’elles soient communistes ou strictement fascistes, ou qu’elles soient entre les deux de façon grise, si on ne fait pas référence à une politique de Barthes. Une conscience qu’il a très jeune, nous en avons la preuve par le petit groupe qu’il fonde au lycée Louis-le-Grand. Il a 19 ans, nous sommes en 1934, l’année des émeutes fascistes. Il réagit immédiatement en fondant avec quelques camarades de lycée un petit groupe antifasciste. À 19 ans, c’est remarquable. Mais c’est bien avant encore que son corps a compris quelque chose du corps fasciste, qui l’a profondément révulsé. Quand je dis « corps fasciste », il suffit de regarder ce qu’on voit constamment dans l’information, l’extraordinaire vulgarité, le populisme qui se développe à nouveau, sur ce fond qui n’a jamais été vraiment analysé et qui est toujours recouvert par ce qu’on nous dit.
Le corps, aussi, parce que Barthes a dû vivre tôt avec la maladie, la tuberculose, donc dans une certaine distance. Avec, d’autre part une passion pour la littérature et le langage lui-même. Donc pour savoir ce qu’il faut comprendre à la politique de Barthes, il faut aller au-delà des commémorations, même si elles sont légitimes. C’est Gide dans un premier temps et puis le langage. Qu’est-ce que cela veut dire ? Voilà un corps très attentif, qui perçoit que la société ment. Alors on va étudier systématiquement et très rationnellement — Barthes est un protestant des Lumières — la façon dont ladite société se représente. Ce qui donne des livres majeurs comme Le Degré zéro de l’écriture et Mythologies. Le portrait de l’abbé Pierre est un chef-d’œuvre. Le magazine Elle est décrit comme un journal tout à fait intéressant par ses symptômes. Barthes est très minutieux, il a une énorme documentation, c’est de la sociologie de haut niveau, rien à voir avec ce qu’on lit désormais dans des commentaires journalistiques brouillés. C’est aussi une vision du système de la mode. Comment la société habille-t-elle son mensonge dans ce déferlement de mode ? C’est tout à fait précurseur de ce qui sera appelé ensuite la société du spectacle, même si Debord ne fait pas référence à Barthes, a même une méfiance à son égard et ne l’a peut-être pas vraiment lu. Mais Barthes est le premier, politiquement, à envisager la société comme un spectacle. Un spectacle permanent de mensonges traversé évidemment par l’argent, à chaque instant. Ne jamais oublier que Barthes a été brechtien et marxiste, d’une certaine façon. Nous parlions souvent de Marx, on se disait qu’on était les seuls dans ce pays hexagonal, avec Althusser qui de son côté essayait de montrer que personne n’avait jamais lu Marx, surtout pas les communistes — de même que les catholiques ne lisent pas la Bible.Roland Barthes à propos de Mythologies
Lectures pour tous, 29 mai 1957.
Roland Barthes présente son livre Mythologies dans lequel il évoque des mythes de la vie quotidienne tels que la justice du catch, le steak frites, l’iconographie de l’abbé Pierre, Einstein, le plastique ou la nouvelle Citroën.
VOIR AUSSI
Barthes est donc le précurseur de l’analyse impitoyable du Spectacle, ce qui est extraordinairement politique. Je crois qu’aujourd’hui, il referait des Mythologies. Des portraits, la façon dont les politiques se présentent, la façon dont la télévision fonctionne, en boucle. La façon dont l’information est évacuée... On est dans un autre temps. Le temps où Barthes écrit est encore un temps lourd, un temps où l’on peut montrer du doigt le réalisme socialiste. Ce qui est intéressant dans le cas de Barthes, c’est que sa critique n’est jamais idéologique, nourrie d’un quelconque espoir en vue de l’avenir. Ça c’est le rôle de Sartre, il suffit de relire les Situations. Rien de cela chez Barthes. C’est sa grande singularité. Tout le monde est sommé, à partir de sa jeunesse, d’être d’un côté ou de l’autre, l’URSS ou le fascisme. Cela déchire tout le paysage. Barthes, lui, n’est jamais du côté d’une « ensemblisation sociétale » comme on dit aujourd’hui. De plus en plus, il va être attiré par les singularités, il va écouter comment les gens parlent, comment ils réagissent, souvent sans réfléchir, comment tout le monde est envahi de clichés. Le « clichisme », voilà l’ennemi. Pas de parole nouvelle sur le plan politique, on le voit aujourd’hui, alors qu’il est mort en 1980.
Il a eu cette invention merveilleuse qu’il appelle « le babil », par référence à la tour de Babel. Mais la tour de Babel est un mythe grandiose biblique. Le « babil » est autre chose : Barthes souffrait du bavardage. Il écoutait toujours généreusement, il répondait aux lettres, mais il ne supportait pas « le babil ». Je peux témoigner du fait que quand on dînait avec lui ce n’était pas pour faire du « babil ». Il y a deux individus qui m’ont paru extraordinaires dans les rapports que j’ai eus avec eux, avec qui parler voulait dire quelque chose, c’est Barthes et Lacan. Il y aurait d’ailleurs lieu de faire aussi un Lacan politique. Tout ça a l’air très loin dans le temps. Pas du tout. L’écart se creuse entre eux et les intellectuels qui sont en vue, à la mode, qui ne s’intéressent pas vraiment à la politique. Ils s’intéressent à des idéologies politiques, ce qui n’a rien à voir. La politique, c’est le savoir vivre concret au présent. Avec la distance que l’on doit avoir sur la société, la distanciation. C’est central pour le regard que Barthes porte sur toute chose, et tout individu. Il forge une formule magnifique pour aujourd’hui qui est un temps de violence, d’ignorance, de fanatisme, d’illettrisme exponentiel. Barthes serait ahuri de voir avec quelle rapidité on peut se passer de toute la bibliothèque, du latin, du grec, de Voltaire, tout cela entraînant une formidable mégalomanie des gens qui sont ignorants. C’est ce qu’il appelle « l’arrogance des paumés », une grande misère, mais sûre d’elle-même. À son époque, « l’arrogance des paumés » est là, certes, mais il faut se battre contre des systèmes très lourds, totalitaires. Il faut garder le mot fasciste, sinon c’est un peu confus. Il y a eu un fascisme fasciste, il y a eu un fascisme communiste, désormais on peut parler d’un islamofascisme. Je ne sais pas ce que Barthes en dirait, il ne faut pas faire parler les morts, encore que pour moi Barthes ne soit pas mort, mais très vivant.
Puisqu’on parle de fascisme, on ne peut pas ignorer sa phrase, qui a suscité tant de commentaires, « la langue est fasciste ». C’est une déclaration très étonnante, qui m’a surpris. Forcer à parler serait le fait de la langue elle-même. Ce qui est aussi très politique. On est entré depuis longtemps dans une société de surveillance, ce qui faisait beaucoup réfléchir Barthes. On serait parasité par le fait d’être forcé à parler. Il se situe toujours devant ce rapport de force qui consiste à forcer à avoir des opinions, à forcer à être de tel ou tel côté. Il avait un goût très profond du secret, du retrait. Politiquement on rentre là dans la prise que l’idéologie peut avoir sur toute formulation. Barthes, même s’il me laissait faire avec gentillesse, n’était pas un explorateur des extrêmes. Il y a une phrase de Kafka qui dit les choses d’une façon plus extrême que Barthes ne l’aurait fait : « La vérité ne détruit rien. Elle ne détruit que ce qui est détruit. » Barthes sentait cela très fortement, très sensible comme il l’était à la question de la mort. La mort de sa mère a été un cataclysme, le Journal de deuil est très émouvant. Tout cela redoublé du drame qui aurait eu lieu si sa mère avait appris son homosexualité. C’est ce qu’on peut appeler une certaine limite politique de Barthes. Ce qui ne veut pas dire, bien au contraire, comme on le lui reproche souvent dans la militance gay, qu’il aurait dû être militant. Ce n’est pas la conception que Barthes se faisait de sa propre homosexualité, qui est toujours teintée d’un désir qui reste le plus souvent insatisfait. Mais c’est une question politique et on est en plein dedans avec le mariage pour tous, la procréation assistée, etc. Qu’aurait-il eu à dire là-dessus ? Je ne sais pas mais je sais qu’il se serait certainement beaucoup intéressé à la façon dont la société actuelle se ment à travers ses procédures de renseignements et de diffusion d’informations qui s’effacent.


A la fin de son article, Sollers revient sur l’affirmation de Barthes prononcée lors de sa Leçon inaugurale au Collège de France : « la langue est fasciste ». Cette phrase a beaucoup choqué. Un jeune chercheur a analysé le sens de cette phrase dans un article où est également évoqué le « dialogue » entre Barthes et Pasolini.
Leçon inaugurale au Collège de France

Roland Barthes lors la Leçon inaugurale au Collège de France.
ZOOM : cliquer sur l’image.

Sur proposition de Michel Foucault, Roland Barthes est nommé professeur au Collège de France. Le 7 janvier 1977, Il prononce la « Leçon inaugurale » de la chaire de Sémiologie littéraire, puis donne son premier cours « Comment vivre ensemble ».
Voici la « Leçon inaugurale ».


Le fascisme de la langue
La célèbre phrase que Barthes prononça lors de sa leçon inaugurale au Collège de France, accusant la langue de fascisme [2], a provoqué et provoque encore aujourd’hui une certaine gêne chez un grand nombre de chercheurs en littérature, appartenant à des courants différents de la pensée littéraire. Cette gêne se manifeste sous des formes diverses, des condamnations rapides et lapidaires aux longs articles critiques. Mais ces lectures ont majoritairement un trait en commun : elles détachent cette phrase du texte dans lequel elle apparaît et a fortiori de l’œuvre de Barthes, car le mot « fasciste » dérange plus que l’idée qu’il transmet. « La langue est fasciste » n’est pourtant pas un énoncé indépendant. Il n’est ni une conclusion, ni une assertion, et encore moins une nouveauté que Barthes prétendait livrer à son auditoire. C’est le point culminant de son introduction, là où il pose, le plus directement possible, le problème qui l’a toujours préoccupé, pour montrer ensuite où il en est au moment de son entrée au Collège de France et quelle nouvelle solution il veut proposer pour régler ce problème ancien. Pour bien saisir l’enjeu de cette formule, il faudra suivre sa Leçon du début à la fin, en gardant un regard sur le contexte dans lequel il l’a prononcée.
D’emblée, en posant la question du pouvoir, Barthes fait de ce concept un point de rencontre qui lui permet de démontrer l’intersection des deux axes de réflexion qui créent ensemble l’enjeu théorique du texte : c’est par le pouvoir qu’il explique et la cohérence interne de sa trajectoire intellectuelle et le souci méthodique de son enseignement. Et ceci pour une raison claire : c’est par sa position vis-à-vis du discours du pouvoir que la sémiologie barthésienne se distingue des autres branches de la sémiologie et de la linguistique, à la fois par son objet et par sa méthode. Et Barthes commence précisément avec cette question. La leçon inaugurale de la chaire de sémiologie littéraire commence par poser la question du pouvoir ; affirmation significative : la sémiologie est à situer d’abord face au pouvoir. Quelques années avant de prononcer cette Leçon, dans son séminaire sur les idiolectes et ensuite dans son article de 1973 intitulé « La division des langages », Barthes partage les discours en fonction de leurs rapports au pouvoir, selon deux catégories : « encratique » et « acratique ». Les deux mots seront rapidement abandonnés, mais l’idée qu’ils expriment conserve toute son importance. Si le discours encratique est soumis au pouvoir, travaille à l’ombre du pouvoir, que le discours acratique est hors du pouvoir et s’y oppose, ils ont néanmoins ceci en commun qu’ils « ne relèvent pas d’une techné de la persuasion, mais [qu’] ils comportent tous des figures d’intimidation (même si le discours acratique paraît plus brutalement terroriste) : fruit de la division sociale, témoin de la guerre du sens, tout sociolecte (encratique et acratique) vise à empêcher l’autre de parler » (Barthes : 2002, IV, p. 358-359).
La tâche de l’intellectuel n’est pas simplement de critiquer la doxa, le discours encratique, mais aussi d’analyser et de critiquer son propre discours, le discours acratique : « l’analyser, c’est nous analyser nous-mêmes en tant que nous parlons : opération toujours risquée et que pour cela même il faudra entreprendre » (ibid., p. 358). Il faudra donc commencer par prendre en compte le rapport entre notre propre discours, c’est-à-dire le discours de l’intellectuel de gauche, avec le pouvoir, tout en prenant des distances avec le discours encratique. Pour ce faire, Barthes se démarque, dès le début de la Leçon, de la sémiologie et de la linguistique « universitaires », de ces disciplines qui pensent la langue comme un simple appareil transparent de communication et qui restent par ce parti pris à « l’ombre du pouvoir ». Il ne faut pas attendre longtemps pour que le discours des intellectuels de gauche soit à son tour également attaqué :
« L’innocence » moderne parle du pouvoir comme s’il était un : d’un côté ceux qui l’ont, de l’autre ceux qui ne l’ont pas ; nous avons cru que le pouvoir était un objet exemplairement politique, nous croyons maintenant qu’il est aussi un objet idéologique, qu’il se glisse là où on ne l’entend pas du premier coup, dans les institutions, l’enseignement, mais en somme qu’il est toujours un (Barthes : 2002, V p. 430).
Si, en insistant sur « l’enseignement », « les institutions » et « l’idéologie » Barthes laisse entendre qu’il évoque Althusser et notamment son Idéologie et appareil idéologique d’État (Voir Althusser : 1970), Althusser n’est pas le seul à être visé par cette phrase : il s’agit d’une certaine manière de tout le discours marxiste qui voit le pouvoir centralisé dans une classe dominante.
 À l’intérieur de ce même discours, nous avons des raisons de croire que Barthes fait appel, quelques lignes plus loin, à un autre adversaire/ami : Pier Paolo Pasolini, avec qui il avait commencé depuis un an un « dialogue » sur la question même du fascisme, sans attendre de réponses car son interlocuteur avait déjà été assassiné. Le mot « fasciste », à cette époque, peut facilement rappeler Pasolini, tant le cinéaste avait insisté sur le phénomène du fascisme dans son œuvre.
À l’intérieur de ce même discours, nous avons des raisons de croire que Barthes fait appel, quelques lignes plus loin, à un autre adversaire/ami : Pier Paolo Pasolini, avec qui il avait commencé depuis un an un « dialogue » sur la question même du fascisme, sans attendre de réponses car son interlocuteur avait déjà été assassiné. Le mot « fasciste », à cette époque, peut facilement rappeler Pasolini, tant le cinéaste avait insisté sur le phénomène du fascisme dans son œuvre.
Regardons donc de plus près comment Barthes voit la compréhension pasolinienne du « fascisme » dans l’article très critique qu’il a publié à propos de Salò : « Le fascisme est un danger trop grave et trop insidieux, pour qu’on le traite par simple analogie, les maîtres fascistes venant “tout simplement” prendre la place des libertins. Le fascisme est un objet contraignant : il nous oblige à penser exactement, analytiquement, politiquement » (Barthes : 2002, IV, p. 945). Devant le fascisme nous sommes donc obligés de penser exactement, d’être précis ; pour ce faire, Barthes distingue entre deux formes de fascisme : le « système-fasciste » et la « substance-fascisme » :
Autant le système requiert une analyse exacte, une discrimination raisonnée, qui doit interdire de traiter en fascisme n’importe quelle oppression, autant la substance peut circuler partout ; car elle n’est au fond que l’un des modes dont la ʺ raisonʺ politique vient colorer la pulsion de mort, qu’on ne peut jamais voir, au dire de Freud, si elle n’est teintée de quelque fantasmagorie (ibid., p. 945).
Mais l’analyse que fait Pasolini du fascisme ne se limite pas à Salò, il l’aborde notamment dans ses articles sur la société de consommation, et nous pouvons nous demander si la distinction de Barthes est applicable à la conception pasolinienne de « nouveau fascisme ». Est-ce d’un système-fascisme qu’il parle ou d’une substance-fascisme ? D’abord il faudra s’interroger sur l’argument qui permet à Pasolini de définir la société de consommation comme fasciste. Il s’agit avant tout du conformisme, notion qui rejoint plus ou moins le phénomène que Barthes critique sous le nom de « grégarité ». Mais ce qui importe pour Pasolini dans ce conformisme, c’est l’aliénation qui en résulte, c’est le fait que cette transformation idéologique, cette production massive des sujets semblables est en réalité plus efficace que ce qu’il appelle « le fascisme historique » :
Le fascisme avait en réalité fait d’eux des guignols, des serviteurs, peut-être en partie convaincus, mais il ne les avait pas vraiment atteints dans le fond de l’âme, dans leur façon d’être. En revanche, le nouveau fascisme, la société de consommation, a profondément transformé les jeunes ; elle les a touchés dans ce qu’ils ont d’intime, elle leur a donné d’autres sentiments, d’autres façons de penser, de vivre, d’autres modèles culturels (Pasolini : [1974] 1976, p. 269).
Pasolini et la « société de consommation »


C’est ce qui permet à Pasolini de traiter de génocidaire l’attitude de la société de consommation : si le génocide veut dire supprimer par intolérance tout ce qui est différent de soi, la société de consommation ne permet même pas que cette différence naisse. Nous pouvons en déduire que la société de consommation n’est pas une substance-fascisme, mais bel et bien un système-fascisme. Le fascisme sera donc défini comme une violence systématique et organisée qui condamne toute issue et, dans le même temps, exclut les différences. La société de consommation est à cet égard plus efficace que le « fascisme historique » en ceci que nous ne pouvons d’aucune manière en sortir. Nous pouvons faire un livre ou un film pour la critiquer : elle le transforme en objet de consommation, en marchandise, et se moque de notre naïveté, elle fonctionne par le phénomène que Barthes appelle la « récupération ».
Pasolini a bien senti la lacune du discours antifasciste, qui ne voit pas que le problème se reproduit sous une autre forme et de manière plus efficace. Il a également senti le rapport qu’il y a entre ce fascisme et la langue, mais il le pose différemment, par le concept de l’aphasie, c’est-à-dire par une imposition de la part du discours dominant qui nous empêche d’être inventifs dans la langue, qui nous empêche de dire. Mais Barthes a encore tendance à poser le problème plus profondément et à montrer que cette critique est insuffisante, comme il l’a toujours fait depuis le manifeste des 121. À ce moment-là aussi il s’agissait du fascisme, et Barthes résistait devant le sens léger que l’on donnait à ce mot : « nous sommes déçus, presque, que le gaullisme ne soit pas du fascisme » (Barthes : 2002, I, p. 985). Il essayait à cette époque aussi de déplacer le lieu de l’intervention intellectuelle : « Si vraiment le sens du gaullisme est au niveau de l’idéologique, ce sont les armes idéologiques qu’il faut trouver » (ibid., p. 986). Et il propose des stratégies pour ce changement, auxquelles il reste fidèle toute sa vie :
1. Il faut peu à peu corriger l’objet même de la contestation intellectuelle : la faire porter moins sur les abus du pouvoir que sur ses alibis, ses raisons, l’organisation implicite de ses valeurs à tous les niveaux. 2. Il faudrait alourdir, en quelque sorte, lester la technique du combat intellectuel : rassembler collectivement des matériaux sur la nouvelle idéologie, entretenir un dossier permanent, ouvrir peut-être une sorte de Bureau d’information mythologique […] 3. Enfin et surtout, il faudrait peut-être aborder franchement une réforme du statut interne (non écrit) de l’intelligentsia française […] substituer l’acte au geste, et l’acte intellectuel à l’acte politique (ibidem).
Comme nous le voyons, c’est par le combat sémiologique que Barthes essaie de « corriger l’objet de la contestation intellectuelle », pour qu’elle porte sur « les alibis du pouvoir ». Il n’est pas loin de cette position au moment où il prononce sa leçon inaugurale ; il l’affirme lui-même, et explique que les changements sociaux obligent la sémiologie à se déplacer tout en restant attachée au même objet : « La langue travaillée par le pouvoir : tel a été l’objet de cette première sémiologie. La sémiologie s’est ensuite déplacée, elle s’est colorée différemment, tout en gardant le même objet, politique – car il n’y en avait pas d’autre ». (Barthes : 2002, V, p. 440)
Qu’est-ce qui produit précisément la différence entre la sémiologie de l’époque des Mythologies et celle de la leçon inaugurale au Collège de France ? Pour l’essentiel, il s’agit de deux changements de position, l’un d’ordre scientifique, l’autre politique. Scientifiquement le déplacement se produit à propos de la distinction hjelmslévienne entre le métalangage et le langage-objet, tel que Barthes la définit dans son essai « Le Mythe aujourd’hui ». Le métalangage, en tant que système second qui s’empare du signe linguistique, déjà plein, et l’utilise comme signifiant – faisant ainsi passer son message et ses valeurs pour naturels –, s’oppose dans la dichotomie de cette époque au langage-objet, qui ne transmet rien au-delà de sa signification linguistique. Cette distinction permet à Barthes de penser, au début, qu’un langage non mythique est possible [3]. D’un point de vue politique, à l’époque du « Mythe aujourd’hui », le mythe est principalement à droite et la production de l’idéologie est plutôt la fonction de la classe dominante. Mais à partir de la fin des années 1960, Barthes – inspiré de Lacan – commence à douter de cette différence entre le métalangage et le langage-objet. Il le dit dans son séminaire intitulé Sarrasine de Balzac, après avoir repris la phrase de Lacan (« il n’y a pas de métalangage ») : « En fait, tout discours renvoie à un autre discours : l’anaphore est le régime normal de tout langage. En ce sens, il n’y a que des métalangages ». (Barthes : 2011, p. 100) Ce qui reste alors n’est pas un langage-objet mais, au contraire, uniquement un métalangage. Ce renversement est signifiant : la fonction de la production idéologique et mythique n’est plus limitée à un certain niveau de la langue, mais étendue à son ensemble. L’autre différence entre le moment de la Leçon et l’époque du « Mythe aujourd’hui » concerne le rapport à la gauche. Après les événements du mai 1968, Barthes ne peut plus affirmer que le langage révolutionnaire n’est pas un langage mythique ; au contraire il voit dans le mode d’apparition de ce langage une violence inquiétante, ce qu’il a expliqué à plusieurs reprises et notamment dans la Leçon : « chaque groupe oppositionnel devenait à son tour et à sa manière un groupe de pression entonnant en son propre nom le discours même du pouvoir, le discours universel… » (Barthes : 2002, V, p. 440-441).
Avant de reprendre le dialogue avec Pasolini sur la question du fascisme, il faudrait mettre l’accent sur un autre point qui contribue à la confusion créée par la fameuse phrase de Barthes : dans les premières pages de la Leçon où Barthes décrit le rapport entre la langue et le pouvoir, il déplace plusieurs fois implicitement et rapidement l’objet de son analyse ; d’abord il évoque l’aspect uniquement syntaxique de ce rapport, puis, en citant Renan et en expliquant la citation, il fait allusion à l’ensemble de la langue, à l’ensemble de ses mécanismes sémantiques et syntaxiques qui collaborent pour produire le sens secondaire, mythique, de l’énoncé linguistique. Enfin, tout de suite après avoir affirmé que la langue était fasciste, comme pour donner un exemple de ce fascisme, il rappelle « l’autorité de l’assertion » et « la grégarité de la répétition » qui « se dessinent immanquablement dans chaque parole proférée », ce qui relève du niveau discursif, des unités plus grandes que la phrase, dont la sémiologie essayait de s’occuper dès les premières années de l’enseignement de Barthes à la VIe section de l’EPHE. Quelques pages plus loin, il explique la raison de cette confusion :
Vous avez pu voir que, tout au long de ma présentation, je suis passé subrepticement de la langue au discours, pour revenir, parfois sans prévenir, du discours à la langue, comme s’il s’agissait du même objet. Je crois en effet aujourd’hui que, sous la pertinence qui est ici choisie, langue et discours sont indivis, car ils glissent selon le même axe de pouvoir (ibid., p. 439).
Nous pouvons dès lors reprendre les critiques adressées par Pasolini à la société de consommation pour voir comment, selon Barthes, elles sont déjà en fonction dans la langue. Appliquée au texte de Barthes lui-même, la distinction entre la « substance-fascisme » et le « système-fascisme » montre que la langue réunit les deux formes à deux niveaux : au niveau discursif, elle est la résidence perpétuelle de la substance-fascisme ; au niveau syntaxique, en tant que système de violence et d’oppression organisé, elle est un système-fascisme. L’idée de Jakobson selon laquelle la langue se définit moins par ce qu’elle permet de dire que par ce qu’elle nous oblige à dire est répétée dans la Leçon (Barthes s’y référait déjà en 1973 dans « La Division des langages ») comme un premier exemple de l’aliénation linguistique. En commentant Boas, Jakobson affirme que ces obligations grammaticales n’ajoutent rien à la clarté de la langue : s’il est indispensable d’atteindre cette clarté, on peut toujours y parvenir au moyen de suppléments lexicaux. Boas donnait l’exemple du temps ou de la pluralité : lorsque ces notions sont absentes de la grammaire d’une langue, elles sont exprimées par les moyens lexicaux. De l’idée de Boas, Jakobson peut conclure « que la vraie différence entre les langues ne réside pas dans ce qu’elles peuvent ou ne peuvent pas exprimer mais dans ce que les locuteurs doivent ou ne doivent pas transmettre » (Jakobson : [1959] 1963, p. 201). L’importance de cet aspect d’obligation apparaît davantage lorsque Jakobson évalue son impact sur les croyances, les décisions et même la pensée d’une communauté linguistique :
La grammaire est un véritable ars obligatoria, comme disaient les scolastiques ; elle impose des décisions par oui ou non. Comme Boas n’a cessé de le faire remarquer, les concepts grammaticaux d’une langue donnée orientent l’attention de la communauté linguistique dans une direction déterminée, et, par leur caractère contraignant, influencent la poésie, les croyances et même la pensée spéculative… (ibid., p. 201-202).
L’apport de Barthes est donc uniquement d’ordre politique : sur le plan scientifique, l’idée se trouve telle quelle chez Boas et dans l’interprétation que Jakobson fait de son texte. Chez Barthes, en revanche, la donnée scientifique est analysée par ses conséquences politiques.
Il serait intéressant d’aborder la même question de l’obligation à travers les contraintes qu’elle impose à la traduction, en prenant l’exemple d’une langue éloignée du français. Gilbert Lazard commence ainsi sa traduction française d’un des ghazals de Hâfez : « Elle a ravi mon cœur et caché son visage… » (Hâfez [Lazard] : 2010, p. 102). Le ghazal est devenu d’emblée un poème d’amour hétérosexuel et masculin. Or le persan ne permet de faire aucune distinction entre le masculin et le féminin, et la communauté littéraire iranienne discute, depuis quelques décennies, pour savoir si la poésie lyrique persane de cette époque (de XIIe au XVIe siècle) est principalement homosexuelle ou hétérosexuelle, pour constater finalement que cette distinction n’est pas valable en ce qui concerne cette période : le même poème pouvait être écrit pour une fille ou un garçon indifféremment. La même indécision existe du côté du lecteur, qui peut s’identifier – sans tenir compte de son sexe –, et sans aucun obstacle linguistique, selon son orientation sexuelle ou selon son désir, au sujet d’énonciation. Le pronom de troisième personne du singulier en persan او [ou] signifie il/elle, mais le traducteur français ne peut que choisir l’un ou l’autre. Il est donc obligé par la langue d’inventer une sexualité (fausse) pour le poète, il doit être soit homosexuel soit hétérosexuel. Mais ces contraintes ne se limitent pas aux obligations syntaxiques. En prenant l’exemple de Renan, Barthes indique le déplacement qu’il a effectué par rapport à l’époque du « Mythe aujourd’hui ». C’est maintenant la langue qui fait entendre « dans une résonance souvent terrible autre chose que son message principal », deuxième raison qui fait de la langue un alibi du pouvoir, car, comme nous l’avons expliqué, elle fonctionne dans son intégralité comme un métalangage. Si « l’anaphore est le régime même de tout langage », c’est-à-dire si chaque mot renvoie immanquablement à d’autres mots, à d’autres valeurs, et m’oblige toujours à en dire plus que ce que je ne voulais, et si le langage-objet me paraît alors impossible, je ne peux que me voir être pris dans un piège étouffant [4]. » Avec un troisième exemple, celui du niveau discursif, Barthes met en parallèle le discours de la droite et de la gauche, et les compare : l’un fonctionne par répétition (celui de droite) l’autre par assertion ; l’un est déjà dans le pouvoir, l’autre y aspire. Les deux exercent des violences discursives qui essaient de ne pas laisser l’autre parler, ou de l’obliger à parler en se conformant à certaines valeurs. Déjà, dans « La division des langages », il l’avait expliqué :
Aussi, la division des deux grands types de sociolectes ne fait qu’opposer des types d’intimidation, ou si l’on préfère, des modes de pression : le sociolecte encratique agit par oppression […], le sociolecte acratique (étant hors du pouvoir, il doit recourir à la violence) agit par sujétion, il met en batterie des figures offensives de discours, destinées à contraindre l’autre plus qu’à l’envahir… (Barthes : 2002, IV, p. 359).
Or, remarque Barthes, d’un côté le sociolecte ne fait pas uniquement violence à ceux qui en sont exclus (à l’autre), mais aussi à ceux qui le partagent (par les contraintes qu’il leur impose) ; d’un autre côté, il est impossible de parler en dehors de tout sociolecte : en parlant, donc, je me fais violence à moi-même et je fais violence à mon interlocuteur. La violence et l’aliénation linguistique ne sont donc pas seulement une question d’imposition de la langue de la classe dominante à travers la culture de masse, comme semble le penser Pasolini ; elles la dépassent pour faire de la langue un lieu où le pouvoir s’exerce sans avoir aucun sujet d’exercice désigné.
Barthes est aussi critique que Pasolini vis-à-vis de la culture de masse. Par son pessimisme, il se distingue de lui, ainsi que par le lieu où il perçoit le problème. Malgré toute son amertume, Pasolini reste optimiste quant à un changement possible : « Mais si à côté d’elle (la société de consommation) et de l’angoisse qu’elle suscite, il n’y avait pas aussi en moi une part d’optimisme, autrement dit la pensée qu’il est possible de lutter contre tout cela, je ne serais tout simplement pas ici, au milieu de vous, pour parler » (Pasolini : 1976, p. 266). Si Pasolini croit encore à la possibilité de la résistance, si Michel Foucault, malgré son rationalisme froid et sceptique peut être fasciné par la révolution iranienne, comme une éventuelle issue de l’impasse politique de son temps proposée par la spiritualité, Barthes est au contraire, et comme toujours, le thermomètre incroyablement sensible des changements sociaux. Avec les premières pages de la Leçon, il annonce la fin d’une époque, la sienne, et le début d’une autre, la nôtre, celle de la fin de l’espoir révolutionnaire.
La fin de l’espoir révolutionnaire, pourtant, ne signifie pas l’abandon de la résistance : il faut, comme Barthes l’a toujours cru, en changer le lieu et la méthode. Si atteindre le langage-objet est impossible, si la langue transmet, que je le veuille ou non, par le biais de connotations et de sous-entendus envahis par la doxa, du sens et des valeurs supplémentaires, on doit alors agir à l’intérieur de la logique même de la langue. Jakobson, comme nous l’avons vu, avait expliqué qu’indépendamment de ces contraintes syntaxiques, là où la langue a besoin de plus de précision ou de clarté, elle recourt aux ajouts lexicaux. Peu avant son entrée au Collège de France, dans un article sur Brecht, Barthes donne un exemple de cette méthode. En lisant un texte de l’officier nazi Rudolf Hess, Brecht ajoute à chaque phrase des suppléments qui établissent la vérité historique du texte : « Chaque phrase est retournée parce qu’elle est supplémentée : la critique ne retranche pas, elle ne supprime pas, elle ajoute » (Barthes : 2002, IV, p. 785-786). Nous pouvons penser au fameux enfant noir saluant le drapeau français, au fait que le mythe fonctionne par les sous-entendus qui, une fois qu’ils sont rendus explicites, le retournent contre lui-même. S’il n’est pas possible de démystifier le mythe, nous pouvons en revanche le re-mythifier en y ajoutant une couche. Cette deuxième mythification sera ce que Barthes appelle « tricher avec la langue, tricher la langue ».
La sémiologie étant conçue par Barthes comme un moyen d’analyser et donc de résister à la production mythique de la langue, le « fascisme de la langue » devient non pas une conclusion mais la problématique même de cette sémiologie. En permettant de déjouer les obligations syntaxiques, de fuir les énoncés affirmatifs, d’ajouter les sous-entendus connotatifs et de mythifier le mythe, la littérature sera le lieu même de cette résistance discursive. Mais le discours en soi n’est ni oppressif ni libérateur, c’est sa position historico-sociale qui en fait une oppression ou bien une libération. C’est par la répétition que le discours le plus libérateur devient oppressif. Marx ou Freud ont produit des mutations discursives, comme Barthes l’explique dans l’article déjà cité sur « La division des langages. » Mais le discours qu’ils ont fondé est devenu ensuite répétitif et par conséquent oppressif. Il ne suffit donc pas de penser le contenu libérateur de son discours, il faut également veiller, à un niveau formel, à ce qu’il ne se fige pas. La littérature, pensée comme le lieu d’un déplacement discursif permanent, peut résister devant ce figement. Ce souci explique le déplacement permanent que l’on aperçoit dans l’ensemble de l’œuvre de Barthes.
Hessam Noghrehchi, Littérature 2017/2 (N° 186), pages 34 à 43
Mis en ligne sur Cairn.info le 05/10/2017.
Hessam Noghrehchi a soutenu sa thèse de doctorat sur Barthes, l’histoire, les historiens, sous la direction de Tiphaine Samoyault, en décembre 2017.
LIRE : Hessam Noghrehchi, Roland Barthes et les Annales.


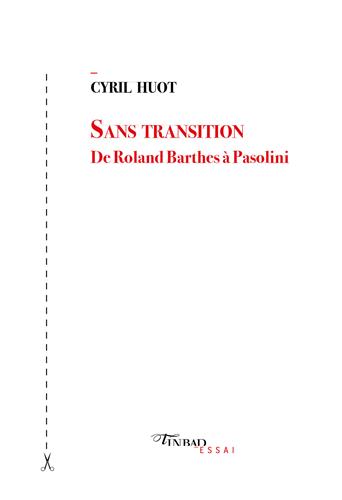 On connaît ces mots de Barthes à l´intention de ses éventuels biographes, écrits dans la préface à son recueil de textes intitulé Sade, Fourier, Loyola : « Si j’étais écrivain, et mort, comme j’aimerais que ma vie se réduisît, par les soins d’un biographe amical et désinvolte, à quelques détails, à quelques goûts, à quelques inflexions, disons des biographèmes. » C’est fort de ce conseil que nous avons entrepris ici d’évoquer sa mémoire et de revisiter quelques unes des pistes ouvertes par son oeuvre, plus particulièrement celles qu´il explorait dans la toute dernière partie de sa vie, après la mort de sa mère — événement qui l´avait profondément bouleversé et avait ébranlé ses fondements au point de l’inciter à les remettre en cause, qu’il s’agisse de ceux sur lesquels il avait bâti l’ensemble de sa démarche intellectuelle ou de ceux sur lesquels toute son existence elle-même reposait jusqu’alors.
On connaît ces mots de Barthes à l´intention de ses éventuels biographes, écrits dans la préface à son recueil de textes intitulé Sade, Fourier, Loyola : « Si j’étais écrivain, et mort, comme j’aimerais que ma vie se réduisît, par les soins d’un biographe amical et désinvolte, à quelques détails, à quelques goûts, à quelques inflexions, disons des biographèmes. » C’est fort de ce conseil que nous avons entrepris ici d’évoquer sa mémoire et de revisiter quelques unes des pistes ouvertes par son oeuvre, plus particulièrement celles qu´il explorait dans la toute dernière partie de sa vie, après la mort de sa mère — événement qui l´avait profondément bouleversé et avait ébranlé ses fondements au point de l’inciter à les remettre en cause, qu’il s’agisse de ceux sur lesquels il avait bâti l’ensemble de sa démarche intellectuelle ou de ceux sur lesquels toute son existence elle-même reposait jusqu’alors.


« Sans transition » : n’est-ce pas la posture même de Roland Barthes lorsqu’à la fin de sa vie il laisse s’introduire dans le processus de son écriture un principe pourtant contraire à la loi dans le cadre de laquelle il avait jusque-là voulu la tenir, à savoir aspirer à y voir au final s’intégrer quelques éléments autobiographiques jugés de prime abord superficiels voire fallacieux, éloignés de l’exigence formaliste du phrasé littéraire, plus opaques qu’éclaireurs d’un parcours ? Quelle place accorder aux « biographèmes » (« néologisme forgé par Barthes », précise l’auteur Cyril Huot) dans l’entreprise de l’écriture, ces fragments biographiques épars sur le chemin d’une vie ? Et n’est-ce pas contradictoire de la part de celui qui déclara « la mort de l’auteur » que de le voir rédiger un Roland Barthes par Roland Barthes ; de le surprendre, dans la dernière ligne droite de sa vie, désireux de voir s’introduire dans la mémoire qu’il laissera de lui et de son œuvre quelques fragments de son histoire personnelle ?
Le silence gardé autour de sa propre vie – paratexte tacite d’une pensée, d’une réflexion formelle malaxant la matière à saisir du monde – ne finit-il pas par sourdre des profondeurs souterraines où il était assigné à demeure de sa propre sagesse, et ne revient-il pas toujours au final agiter de ses résurgences jusqu’à fleur des lignes, des mots, une représentation intentionnelle du monde ?
Cyril Huot ne suit pas les routes balisées de la célèbre figure de Barthes – si tant est que l’homme puisse avoir jamais suivi ces routes –, il nous tire par la manche et nous préoccupe au fil des pages de nous interroger sur cette virevolte de l’auteur des Fragments du discours amoureux : comment, à la mort de sa mère, événement traumatisant unique et radical, il reprend racine dans les sources personnelles de son existence jusqu’à les répandre dans le flux de sa vie écrite ? Jusqu’à les ressaisir tout en laissant sourdre son propre « moi » en les réécrivant ? Ne sommes-nous pas tout compte fait les perpétuels dragueurs de notre propre mystère, scellé d’abord par des lèvres sibyllines que nos limites nous laissent seulement envisager tout en ne cherchant pas à les révéler pour, au final, nous insuffler le désir de les donner à voir au bout d’un saisissement aussi attirant qu’un trou noir, que l’accès au cœur d’un arc-en-ciel, le point de fuite au bout sans cesse reculé des lignes de l’horizon vers où inlassables nous continuons de courir ?
Cyril Huot entreprend dans cet essai d’évoquer la mémoire de Barthes et de revisiter quelques pistes ouvertes par son œuvre, notamment celle explorée dans la toute dernière partie de sa vie après la mort de celle qui l’avait enfanté, mort venant secouer le socle de fondements à l’œuvre dans l’écriture du penseur et écrivain ; venant les remettre en cause, tremblements d’une démarche intellectuelle dont des strates se mettent à s’ouvrir tout en formant une brèche dans le palimpseste d’une vie transfigurée par l’écriture ; mort-renaissance.
L’originalité de C. Huot est de nous propulser à ce point de frictions et de scission d’un fantasme de Barthes et de nous montrer comme ses lapsus ou lacunes ou actes manqués n’ont eu de cesse de parcourir la source souterraine mais vive d’une écriture à l’œuvre fragmentaire, désinvolte, près de secouer ses propres spectres à l’intérieur du séisme du langage, révolution de biographèmes, nébuleuse d’atomes de biographie intriqués dans les laps tacites ou dévoilés d’une langue ici soulevée, décryptée, déchiffrée, approchée. Cette nébuleuse, Cyril Huot l’a en outre étendue au-delà de la figure de R. Barthes, effectuant une apparente absence de « transition » entre ce dernier et d’autres figures fortes de la littérature ainsi Pasolini, d’autres penseurs, d’autres écrivains, d’autres artistes, aussi vers d’autres espaces thématiques qui traversent et interfèrent dans la galaxie littéraire. Une galaxie mue par « la hantise du vide », le vide spirituel, objet d’une inquiétude accrue chez le mystique, le poète, chez tous ces génies noirs au rire triomphant de perdant (Cf. Le rire triomphant des perdants, Cyril Huot, éd. Tinbad) parmi le silence effroyable du grand bruit du monde et de ses simulacres de surface : « et c’était bien dans cette hantise du vide spirituel que les correspondances entre un Jean de la Croix, un Dostoïevski, un Kierkegaard, sautaient aux yeux ». Sautillements fulgurants comme le saut des synapses interconnectées qui interfèrent dans nos forteresses hantées par la langue, l’Écrire, sans que nous puissions y entrevoir pleinement l’étendue du gouffre, des brèches non dites bien que s’ouvrant infiniment – brèche d’absurdité sous nos cheminements accablés, acharnés, transfigurés, fantasmés. Brèche d’absurdité, quoique… car de secrets réseaux de la pensée ne font-ils pas de nous les gardiens d’un sens implacable dont nous demeurons les sourciers, les lecteurs, les archéologues du Texte, infiniment ? C’est ainsi que cette absence de « transition » que constitue ce livre de Cyril Huot à propos d’un Roland Barthes nouvellement éclairé par la projection parcellaire de biographèmes sur l’étendue froide de son idéation, n’est-elle pas si raccordement que cela ; ainsi révèle-t-elle – plutôt qu’un archi-texte neutre sous-tendant le livre/le texte érotique de tous nos pensées et actes, actions et créations – une pluralité harmonieuse et insoupçonnée de réseaux interactifs ; ainsi de Barthes à Pasolini l’écart peut-il se rejoindre en un frémissement d’ondes que l’espace solidaire – du cosmos, du logos – disjoint et joint pareillement. Ainsi court ce « fil invisible d’affinités électives qui relie certains êtres entre eux et que la mort non seulement ne rompt pas mais qu’au contraire elle contribue souterrainement à tisser ».
La finalité de Sans transition, De Roland Barthes à Pasolini, est explicité en ces mots :
« Atomes de biographies (de la sienne comme de celles de quelques autres) – Quelques-uns de ses goûts et de ses dégoûts – Quelques-unes de ses idées arbitrairement choisies au gré de notre fantaisie – Quelques-unes de ses formules – Citations – Brefs commentaires – Mobilité – Digressions – Dispersion – Stratégie du coq-à-l’âne. En résumé : Fragments de biographie(s) s’inscrivant dans un genre littéraire qui relève d’un fantasme de Barthes. Biographèmes donc, se rapportant à celui-ci et à quelques autres, entrecoupés de tout ce qui nous passera par la tête à mesure que nous écrivons. On peut dire que, comme il nous le suggère, nous prenons Barthes (et, dans la foulée, les autres aussi), à la légère. Quand les hommes sérieux, les vrais, n’aspirent en dernière instance qu’à la légèreté, et cela de plus en plus à mesure qu’ils approchent de la mort. C’est d’ailleurs à ce trait qu’on les reconnaît.
Le danger qui guette le biographe et le critique, même les mieux intentionnés, c’est d’en arriver à jouer les réducteurs de tête. Loin d’avoir jamais eu la grosse tête (il a toujours profondément douté de lui-même et n’a cessé de se poser la question de savoir s’il était un imposteur), Barthes n’en avait pas moins un cerveau hors norme et il ne saurait être question pour nous de vouloir le ramener coûte que coûte à la dimension de celui de tout un chacun, comme font ordinairement nombre de ces petits Jivaros qui pullulent dans le monde des médias, mais aussi, trop souvent, dans celui des gens de lettres, et tout spécialement dans celui des critiques ».
Comment la mort de la mère peut-elle faire advenir la désincarcération du Je personnel étouffé jusqu’alors sous une « neutralité » délibérée dans la langue exprimée par l’écrivain ? Barthes se montre même prêt à laisser surgir un certain pathos, ouvert à une volte-face dans sa démarche d’écriture désormais offerte à la fébrilité de sa sensibilité. Un « fantasme » prend corps, puits artésien dans la langue/dans l’écriture, qui se révèle, à un moment post-traumatique causé par le décès de sa mère, consentement à l’expression de l’Amour (la générosité, l’empathie, la bonté, la charité, « tout ce qu’il est convenu d’appeler l’Amour qu’incarnait pour (Barthes) jusque-là sa mère, le fondement même de l’existence comme la raison d’être et le seul but digne de ce nom de toute littérature (…) » (Avant-propos). Une « mutation de sensibilité » s’opère chez le philosophe et sémiologue, dont rend compte Cyril Huot dans cet essai à l’écriture fragmentaire barthésienne. Par-delà les rives du texte-fleuve formel, l’auteur Barthes émet le désir de drainer via ses derniers mots le personnel de son existence. Cyril Huot nous propose dans ce livre d’entrevoir « l’essence de cet homme qu’avait été Roland Barthes », telle qu’elle nous apparaît au soir de son existence. Il précise : « Dès lors, nous savons bien que tout ce que nous pourrons dire dans ces textes ne sera que de l’ordre du bavardage à propos du bavardage d’un inconnu qui avait vécu 65 ans sous le nom de Roland Barthes. Bavardage de très second ordre à propos d’un bavardage de tout premier ordre ». Bavardage précieux, bijou de littérature (« Il y a, ou non, de la littérature. Et, comme on peut le voir par la masse énorme, vertigineuse, insensée, de ce qui est publié, il y en a de moins en moins »). Le livre de Huot nous donne la nostalgie de la littérature. Enfin, la force de cet essai réside dans son actualité, Huot surenchérissant dans l’arrogance reliée à l’impertinence ou la lucidité qui visitèrent « le dernier » Barthes, ajoutant là une couche à l’impéritie du fonctionnement de notre société contemporaine, ici, à la prolifération d’une mauvaise littérature promue par la gouverne médiatique, ailleurs à la saturation d’un sens si répandu et galvaudé qu’il en perd toute la retenue qu’il avait pour vocation de porter, etc. Un rire énormément gratifiant éclate des fragments de ce livre désinvolte – le rire salutaire des « perdants » qui n’auront rien perdu pour attendre et revenir – revenus des frasques du monde –, ressurgir, invinciblement debout, virulents, fervents, terriblement vivants. Tel le poète, tel Barthes se tournant résolument à la fin de sa vie vers la poésie (plus particulièrement le haïku pour sa densité de pierre précieuse), Cyril Huot nous entraîne dans ces propos où « y voir clair », « là où tous pérorent sans fin » alors que le poète-aphoriste en quelques « phrases lapidaires surgissant de nulle part (…) va droit au cœur des choses et le/(nous) met brutalement à nu ».
Murielle Compère-Demarcy, La Cause littéraire.
Cyril Huot a notamment été acteur et metteur en scène de théâtre, réalisateur et critique de cinéma. Il est l’auteur d’un livre consacré à Katherine Mansfield, Lettre à ce monde qui jamais ne répond (éditions De la Nuit), ainsi que : Le rire triomphant des perdants (journal de guerre) ; Secret, le silence ; Le spectre de Thomas Bernhard (publiés aux éditions Tinbad).


Depuis que Robert Badinter en a popularisé l’expression à la fin des années 1990, la « lepénisation des esprits » s’est banalisée. Le Front National est devenu le Rassemblement National. Il rassemble désormais beaucoup de Français, dont de nombreux jeunes, déçus ou laissés-pour-compte par la politique néolibérale et autoritaire (ce dernier aspect aggravé par la gestion de l’épidémie de Covid) menée par la classe politique de l’hexagone. Ses épigones disposent de temps d’antenne impressionnants (exemple : Eric Zemmour sur CNEWS). La question reste donc d’une actualité brûlante dans la France de 2021.


LIRE : Parler de fascisme à propos de la France actuelle n’est pas un abus de langage.
A.G., le 13 juin 2021.
Supplément du 7 décembre 2021.
Si j’ai pointé en juin l’omniprésence médiatique d’Eric Zemmour (qui a trouvé un interlocuteur complaisant en la personne du philosophe proudhonien Onfray [5]), j’ignorais qu’il envisageait d’être candidat à l’élection présidentielle. Ce qui est intéressant c’est maintenant d’analyser dans quelle langue, avec quels mots, avec quelles références historiques et littéraires, le candidat Zemmour est capable de mobiliser 12 000 personnes à Villepinte comme le 5 décembre dernier.
Parcours et rhétorique d’Eric Zemmour
Signes des temps par Marc Weitzmann, 5 décembre 2021.
Une émission consacrée au parcours d’Eric Zemmour, à sa vision de l’histoire et à ses références culturelles quelques heures avant le début de son premier meeting à Villepinte. La présence de ce candidat dans la course à l’élection présidentielle est incontestablement un signe des temps.

- Portrait d’Eric Zemmour, 1995.
Crédits : Eric Fougere - Corbis - Getty
On s’est refusé à parler de lui dans cette émission sinon pour se faire l’écho des historiens et écrivains rectifiant ses propos parce qu’il était hors de question de relayer la campagne de promotion fascinée de la presse pour son livre. Maintenant que le voilà officiellement candidat cependant, et alors que s’ouvre son meeting de lancement de campagne à Villepinte, il faut s’intéresser un peu directement à celui qui est si obsédé par le déclin de la France qu’on ne sait plus trop s’il le déplore, ou s’il le désire, à moins qu’il n’en soit l’un des plus criants symptômes. La présence d’un personnage si bizarre dans la course à la présidentielle, en tous cas, est incontestablement un signe des temps.

Incohérence idéologique et références culturelles
Étienne Girard revient sur les écrits d’Eric Zemmour et son obsession du triomphe, il ajoute “et son obsession de la défaite en miroir inversé. C’est pour cette idée du triomphe qu’il aime tellement Napoléon.”.
Les invités proposent une analyse de la fascination d’Eric Zemmour pour Les illusions perdues de Balzac et le personnage de Rubempré. Gaston Crémieux énonce qu’on vit un moment balzacien en France, l’univers le plus noir de Balzac décrit une société en profonde décadence ; pour Gaston Crémieux cela “recroise l’univers mental de la défaite et de la décadence d’Eric Zemmour”.
Benjamin Haddad souligne les contradictions du candidat à l’élection présidentielle : “dans ce roman de Balzac il s’agit effectivement d’une dénonciation du cynisme des élites parisiennes du XIXe siècle, y compris du cynisme des personnages principaux !, c’est un modèle révélateur pour Eric Zemmour”.
Musiques diffusées
L’odeur de l’essence de Oreslan
You can’t always get what you want des Rolling Stones


Supplément du 19 avril 2022.
La langue de Zemmour
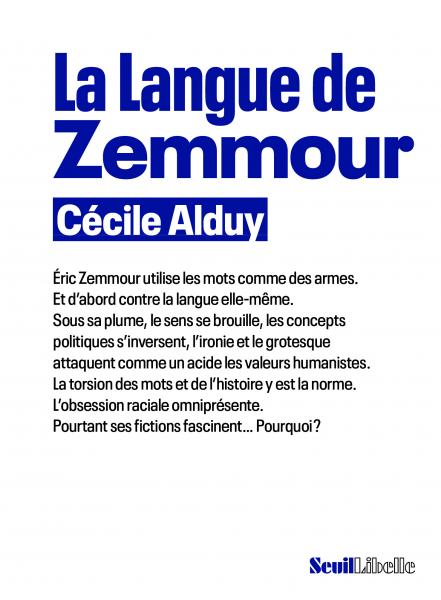
Professeure à l’université de Stanford, Cécile Alduy travaille depuis des années sur l’analyse des discours et écrits politiques. Avec l’appui de logiciels lexicographiques, elle a publié un livre sur Marine Le Pen, quand celle-ci mettait en place la stratégie de « dédiabolisation », et sur les candidats à la présidentielle de 2017, marquée par l’émergence du langage macronien. Cette fois, c’est à Eric Zemmour qu’elle s’intéresse en publiant une courte dissection des discours du candidat d’extrême droite dans la toute nouvelle collection « Libelle » du Seuil (qui vient concurrencer les « Tracts » de Gallimard). Entretien.
L’OBS. Votre analyse du discours zemmourien est placée sous l’ombre d’une citation de « La Psychologie des foules » (1895) de Gustave Le Bon, livre considéré comme annonciateur des totalitarismes du XXe siècle : « La puissance des mots est si grande qu’il suffit de termes bien choisis pour faire accepter les choses les plus odieuses. » Pourquoi ce choix ?
Cécile Alduy. Parce que le discours d’Eric Zemmour tend subrepticement à engourdir l’empathie de son auditoire et à banaliser la violence. C’est une langue qui use de l’antithèse et de l’amalgame pour diffuser l’impression d’une guerre civile larvée, qui manie l’ironie et la confusion pour brouiller tous les repères éthiques, conceptuels ou historiques. De cette violence verbale peuvent découler des « conclusions » terribles.
Par quels moyens rhétoriques Eric Zemmour diffuse-t-il cet imaginaire de guerre et de conflit ?
J’ai analysé le champ sémantique de ses sept livres principaux, depuis « le Premier sexe », publié en 2006, jusqu’à « La France n’a pas dit son dernier mot », publié l’année dernière. Le mot « guerre » est le troisième nom commun le plus utilisé, ce qui ne peut qu’étonner s’agissant de la chronique d’une France engagée dans des opérations extérieures mais qui ne connaît pas la guerre sur son propre territoire. Même dans son livre sur les rapports entre les hommes et les femmes, Eric Zemmour distille un vocabulaire guerrier. Chez lui, tout est affaire de domination, de lutte pour la survie. Il n’y a aucun espace pour le dialogue, l’hésitation, la conversation réelle, celle qui s’autorise à changer d’avis, à se laisser affecter par ce que dit son interlocuteur, à l’entendre même ! Avec son célèbre « ben voyons », et ses affirmations péremptoires qui ne souffrent aucune réplique, il clôt la discussion.
On peut aller jusqu’à dire qu’il n’y a aucun espace dans son schéma mental pour la démocratie, qui suppose l’accord sur des valeurs communes et le respect de la parole de l’autre. Cette mise en scène d’un conflit permanent des sociétés enjoint les auditeurs ou les lecteurs à choisir leur camp. Elle fait ressurgir des instincts de survie, viscéraux, et ne peut que se traduire par le rejet de groupes portraiturés comme des ennemis de l’intérieur. Ses propos ambigus sur ce qu’il faudrait faire des immigrés et la façon dont il justifie la déportation des juifs étrangers par le régime de Vichy, tout cela vise à rendre acceptable l’idée de la violence et de l’agression physique.
Qu’est-ce qui vous a le plus surpris en analysant ce corpus de textes ?
L’abondance du mot « race ». Il y avait bien son esclandre de 2008 avec Rokhaya Diallo (« J’appartiens à la race blanche, vous appartenez à la race noire ! »), mais je ne soupçonnais pas à quel point il travaillait à réhabiliter cette notion. La langue zemmourienne s’éloigne de celle de Marine Le Pen, qui s’est efforcée de gommer les aspérités les plus évidemment racistes du Front national et de sortir son parti du mono-thématisme de la guerre civilisationnelle. Le bon point de comparaison est plutôt le Jean-Marie Le Pen des années 1990. Lui aussi usait d’images eschatologiques et manichéennes, une figure qu’a reprise Eric Zemmour au Mont-Saint-Michel en parlant du « combat éternel que se livrent le Bien et le Mal depuis des millénaires ». Mais, même Jean-Marie Le Pen n’utilisait pas autant le mot « race »…
Quand il parle de l’acteur Omar Sy, Zemmour évoque le « corps musclé et félin, [le] sourire béat, [le] regard vide »…
Oui, ça, ce sont les commentaires sur le physique des personnes racisées, réduites à des corps sauvages. Même lorsqu’il parle positivement des résultats de l’équipe de France de football, il ne peut s’empêcher d’attribuer leur réussite à leur force physique plutôt qu’à leur sens tactique. On retrouve, de façon décomplexée et exacerbée, un inconscient raciste collectif, issu de la colonisation. Mais la réhabilitation de la race est bien plus explicite chez lui que ce tissage souterrain : là comme ailleurs, il use d’un argument d’autorité reposant sur une construction historique toute personnelle. Il va piocher une citation probablement apocryphe du général de Gaulle (« La France est un pays de race blanche ») et les écrits d’historiens du XIXe partisans de la théorie des races, comme Augustin Thierry, pour appuyer l’idée que les « races » existent. Rappelons que la citation attribuée au général de Gaulle provient d’un livre d’Alain Peyrefitte, publié vingt ans après la mort de Charles de Gaulle…
L’avez-vous comparé aux écrits d’hommes politiques ou d’écrivains plus anciens que Jean-Marie Le Pen ?
Sans réelle surprise, puisqu’il s’en réclame lui-même, on trouve beaucoup de correspondances entre les discours de Zemmour et les thèses de Charles Maurras ou de Jacques Bainville, les deux grands noms du royalisme français. On retrouve d’abord des méthodes communes. L’historien Jacques Bainville tenait chronique dans « Candide » et ses écrits étaient périodiquement repris dans des volumes. C’est ce fonctionnement pamphlétaire qu’a adopté Eric Zemmour au fil de sa carrière. Il lui a permis de donner une grande force de persuasion à ses analyses, toujours articulées à un récit, à des histoires, à des faits divers. Sous sa plume, les anecdotes les plus absurdes prennent le sens d’une grande lutte civilisationnelle. Il y a ensuite le cadre théorique : Maurras a développé l’idée d’une France immuable, éternelle, d’un principe quasi mystique coulant dans les veines des « vrais Français », et que viendraient saper les « quatre Etats confédérés », c’est-à-dire les protestants, les juifs, les francs-maçons et les « métèques ». Chez Zemmour, ces ennemis de l’intérieur sont les immigrés et descendants d’immigrés. On retrouve aussi le projet de prendre les institutions démocratiques de l’intérieur, de profiter de ce qu’ils jugent être des faiblesses, pour les retourner et servir leur propre projet politique.
Et l’avez-vous comparé aux écrits d’Oswald Spengler, auteur du « Déclin de l’Occident » (1918-1922) ? On y trouve aussi l’idée que les civilisations sont telles des corps biologiques, qu’elles suivent une croissance puis finissent par mourir.
Ce sont plutôt des références françaises qu’utilise Eric Zemmour, même s’il mobilise aussi beaucoup la thèse du politologue américain Samuel Huntington sur le choc des civilisations. Chez Zemmour, les catégories s’essentialisent : ce sont d’immenses blocs stables qui traversent toute l’Histoire selon des lois cycliques. L’Histoire repasse toujours les plats, c’est sa grande formule. Cela donne des passages assez savoureux : il est capable de nous expliquer doctement que telle ou telle décision de politique étrangère va avoir telle ou telle conséquence parce que l’Empereur Maximilien Ier a fait ceci ou cela au XVIe siècle. Parfois, c’est plus inquiétant, comme lorsqu’il explique qu’il faudrait un « implacable Richelieu » pour faire tomber « les La Rochelle islamiques », comprendre la Seine-Saint-Denis. Ce prisme de répétition le rend totalement aveugle à la nouveauté. Dans son dernier livre, il ne parle, par exemple, que très peu de la pandémie et lorsqu’il le fait, c’est à travers des images passées ou étranges : il déambule dans Paris vide et c’est l’Occupation qui lui vient à l’esprit.
« Ben voyons ! » : c’est devenu un gimmick zemmourien, au point que ses militants en font des t-shirts. Que traduit cette expression ?
C’est presque l’essence de la langue de Zemmour : elle ferme la discussion en renvoyant l’autre à l’inanité et en créant une communauté de moquerie. Zemmour paralyse ceux qui l’écoutent, qu’ils soient d’accord ou pas avec lui. Ou bien ce que l’on dira n’aura aucune prise parce que de toute éternité, etc., etc. Ou bien vous êtes enrégimentés dans sa moquerie avec pour seul rôle de répéter ses mantras. La fonction normale du langage est de penser, elle se dérobe sous la plume du candidat d’extrême droite.
J’ai vraiment résisté, en écrivant ce livre, à la comparaison avec l’ouvrage classique du philologue Victor Klemperer, « la Langue du Troisième Reich ». Certains passages y sont tout de même très éclairants : il décrit très bien comment les nazis ont retourné le sens du mot « fanatisme ». Dans leur bouche, c’est devenu synonyme de l’énergie vitale du peuple allemand. Chez Zemmour, la « guerre » sert aussi une exaltation de la violence, comme principe historique de régénération des civilisations. Le plus marquant, c’est l’usage des guillemets d’ironie par Eric Zemmour autour de mots comme « égalité ». A droite et à gauche, on peut avoir des conceptions différentes de l’égalité, ou de la manière d’y parvenir, mais on s’accorde sur le fait que c’est un horizon essentiel. En mettant cette notion à distance, il sape le socle commun de la démocratie. Autre stratégie : l’implosion du sens sous le retournement (les « colonisateurs » sont désormais les immigrés) ou l’utilisation hyperbolique de concepts pour les rendre inoffensifs (le « totalitarisme » féministe, de la transparence, etc.)
On pense souvent, dans le sillage d’Orwell, que les langues autoritaires s’appauvrissent. Cela ne semble pas être le cas chez Eric Zemmour.
Non, il n’appauvrit pas le langage, ce n’est pas comme Donald Trump qui n’avait qu’une palette de termes limitée. L’appauvrissement de la réflexion se fait à travers l’usage d’un filtre unique : s’il voit une série romantique sur France 3 où il est question d’adultère, ça y est, c’est le symbole du « terrorisme » de la transparence… Sa verve, son incontestable culture sont mises au service d’une vision répétitive, obsessionnelle.
Vous soulignez aussi un mélange constant avec la fiction, comme lorsque Zemmour enjoint ses interlocuteurs à ouvrir les yeux sur la réalité en regardant le film « Bac Nord »…
Oui, c’est assez symptomatique. Il met sur le même plan les films de Gérard Oury et la parole scientifique des historiens. C’est une façon de niveler les hiérarchies du savoir et d’établir une connivence faussement populaire avec son auditoire. « Qu’est-ce qu’ils viennent nous embêter, ces chercheurs, alors qu’il suffit de regarder “la Grande Vadrouille” ? » Le mélange de la fiction et de la réalité est constant dans ses écrits et appuie sa puissance de persuasion : un effet de véracité se dégage de l’accumulation des anecdotes.
Cette dissolution du sens et cette polarisation du monde en blocs homogènes font-elles écho à la structure même des réseaux sociaux ?
Peut-être, mais la vision manichéenne de l’extrême droite n’a pas attendu les réseaux sociaux pour se déployer. En revanche, il est frappant de constater que Jean-Marie Le Pen était éloigné de la télévision à cause de ses propos violents, alors qu’Eric Zemmour y a fait carrière pour ses outrances : à l’ère du clash, la violence verbale est vendeuse.
Votre livre sort en même temps que celui d’un collectif d’historiens critiquant l’usage fallacieux de l’Histoire par le candidat. Est-ce qu’en parlant de lui, vous ne le renforcez pas ?
Je me suis posé la question. Mais Zemmour domine les médias, il n’y rencontre presque pas d’opposition. Il me semble important que des historiens en parlent plutôt que Pascal Praud. Beaucoup de gens m’ont écrit pour me remercier : « Je sentais bien en l’écoutant qu’il y avait un problème, mais je n’avais pas mis les mots sur ses méthodes. » Ces outils critiques me paraissent d’autant plus importants que l’imaginaire zemmourien contamine le débat public : quand j’entends le candidat communiste Fabien Roussel expliquer que des « citoyens d’origine étrangère, musulmans, ont peur d’être renvoyés chez eux s’il accède au pouvoir », comme si « chez eux » ce n’était pas la France, je me dis que la situation est grave !
L’OBS, 24 février 2022.

LIRA AUSSI : Un présent de mensonge général
Pour aller plus loin
 “Éric Zemmour, glaive et bouclier de l’extrême droite”, par Gaston Crémieux, Le Droit de Vivre, 15 octobre 2021.
“Éric Zemmour, glaive et bouclier de l’extrême droite”, par Gaston Crémieux, Le Droit de Vivre, 15 octobre 2021.
 "Lire Eric Zemmour, c’est découvrir une obsession pour le déclin qui confine à la haine de soi" par Benjamin Haddad, Le Monde, 2 décembre 2021.
"Lire Eric Zemmour, c’est découvrir une obsession pour le déclin qui confine à la haine de soi" par Benjamin Haddad, Le Monde, 2 décembre 2021.
 "Les illusions confuses d’Éric Zemmour", par Baptiste Roger-Lacan, Le Grand Continent, 1 octobre 2021.
"Les illusions confuses d’Éric Zemmour", par Baptiste Roger-Lacan, Le Grand Continent, 1 octobre 2021.
 Signes des temps
Signes des temps
 Ce que Zemmour fait au nom juif par Bernard-Henri Lévy.
Ce que Zemmour fait au nom juif par Bernard-Henri Lévy.



Est-ce Marine Le Pen ou Michel Onfray qui a changé ?
Vingt ans après le lancement de son Université populaire pour « lutter contre les idées du FN », suite à l’accession au second tour de Jean-Marie Le Pen, le philosophe a estimé sur RMC que la candidate du RN n’était « pas d’extrême droite ».

- Michel Onfray en octobre 2018 à Paris.
(Joël Saget /AFP)
par Simon Blin
publié le 19 avril 2022 à 13h29
« Ça me paraît évident que Marine Le Pen n’est pas d’extrême droite. » Après l’historien et philosophe Marcel Gauchet, c’est au tour de Michel Onfray de banaliser la candidature de la leader du Rassemblement national (RN), à cinq jours du second tour et à la veille du débat de l’entre-deux-tours. « Je trouve ça étonnant qu’on puisse faire porter les péchés du père sur la fille. Tous les partis ont changé, a déclaré le philosophe et polémiste sur l’antenne de RMC […] Je lis les programmes, j’écoute ce que les gens disent et je regarde ce qu’ils font […] Faisons de l’histoire, pas de la propagande. »
Histoire et programme, allons-y. Il se trouve que la mesure phare du programme de Marine Le Pen s’appelle la « préférence nationale ». On n’a cessé de l’écrire et de l’analyser dans Libération : il s’agit d’un concept issu de la pensée nationaliste la plus pure, déjà présent dans le programme du Front national, qui consiste à privilégier les « nationaux » aux étrangers et donc à établir une différence de traitement entre les citoyens selon leur identité. Certes, Marine Le Pen n’est pas son père mais la nature de son projet politique continue de cocher les fondamentaux historiques du lepénisme. Est-ce alors l’extrême droite qui a changé ou Michel Onfray ?
Bingo de la pensée ultra-réactionnaire
Personne ne tombera de sa chaise. Ces dernières années, le pamphlétaire nous avait habitués à ce genre de glissement idéologique, tout occupé à dénoncer avec virulence le « politiquement correct », le « wokisme », l’« islamo-gauchisme », la « tyrannie des minorités », les nouvelles féministes, l’Europe, le cosmopolitisme, l’islam ou les médias mainstream dont il se dit ostracisé tout en y étant continuellement invité. Chacune de ses sorties médiatiques en une de Valeurs actuelles ou d’Elément, la revue d’extrême droite d’Alain de Benoist, dans le FigaroVox, Causeur ou sur CNews, s’apparente au fil des ans à un bingo de la pensée ultra-réactionnaire n’ayant rien à envier à Eric Zemmour.
En 2020, le lancement de sa revue Front populaire, média d’opinion à la coloration identitaire et censé réunir les « souverainistes de droite et de gauche », avait marqué un nouveau tournant dans la carrière de l’essayiste à la rhétorique vindicative. A l’époque, les représentants des droites les plus radicales ne s’y étaient d’ailleurs pas trompés. Alain de Benoist avait salué « une initiative excellente » dans le Monde. Philippe Vardon, membre du bureau national du RN et ancien du Bloc identitaire, avait jugé l’entreprise « intéressante ». Tout comme Marine Le Pen qui s’était félicitée dans un tweet d’une « initiative […] positive ».
Après des couvertures dédiées à l’immigration, à l’ensauvagement ou à l’Etat profond, où en est la revue deux ans plus tard ? Plume régulière de Front populaire, l’avocat Régis de Castelnau vient d’y publier un texte, le 15 avril, sans équivoque intitulé « Moi, communiste patriote, je voterai Marine Le Pen ». Cruel retournement de situation pour Michel Onfray, qui lançait il y a vingt ans, suite au 21 avril 2002 et l’accession de Jean-Marie Le Pen au second tour de l’élection présidentielle, son Université populaire à Caen dans le but de « lutter contre les idées du FN ».
Libération, 19 avril 2022.


[1] « La société modernisée jusqu’au stade du spectaculaire intégré se caractérise par l’effet combiné de cinq traits principaux, qui sont : le renouvellement technologique incessant ; la fusion économico-étatique ; le secret généralisé ; le faux sans réplique ; un présent perpétuel. » Commentaires sur la société du spectacle.
[2] « Mais la langue, comme performance de tout langage, n’est ni réactionnaire ni progressiste ; elle est tout simplement : fasciste ; car le fascisme, ce n’est pas d’empêcher de dire, c’est d’obliger à dire » (Barthes : 2002, V, p. 432).
[3] « Il y a donc un langage qui n’est pas mythique, c’est le langage de l’homme producteur : partout où l’homme parle pour transformer le réel et non plus pour le conserver en image, partout où il lie son langage à la fabrication des choses, le métalangage est renvoyé à un langage objet, le mythe est impossible. Voilà pourquoi le langage proprement révolutionnaire ne peut être un langage mythique » (Barthes : 2002, I, p. 857).
[4] Il est intéressant de noter que dans une perspective bien plus précise, concerné par les concepts que les historiens forgent pour expliquer un phénomène ou une période, Lucien Febvre analyse aussi ce phénomène d’élargissement incontrôlable du sens d’un mot : « … la Renaissance, au départ, c’est avant tout l’apparition d’une nouvelle peinture. Et puis, de la peinture le mot passe à la sculpture, à l’architecture, à tout l’ensemble des arts plastiques. Et puis, des arts plastiques, il passe à la littérature. Et à l’érudition, dans tous les domaines. A la philosophie et à la science comme humanisme, au sens restreint du mot. Voilà l’étiquette devenue système cohérent, elle aussi, et système qui prend vie. […] Et la Renaissance cessant d’être un épisode de l’histoire artistique et littéraire de l’Occident, devient toute une époque, tout un genre de vie, toute une manière d’être. […] Un être qui engendre, qui façonne, qui marque des hommes : les hommes de la Renaissance. […] Étonnante puissance des mots que l’homme crée pour ses besoins. Mais qui, sitôt créés, volent de leurs propres ailes, courent leur fortune, connaissent leur destin. […] Qu’y a-t-il derrière tous ces débats verbaux ? rien que des mots. Supprimons-les, jurons de ne plus prononcer ni le mot Moyen Âge, ni le mot Renaissance. […] Je veux bien. Je ne tiens pas aux mots. Je me méfie singulièrement, toujours, de leur pouvoir occulte. Biffons-les. Ce ne sera d’ailleurs pas si facile que l’on pourrait croire. Car les mots se défendent. Nous ne saurions en créer sans la complicité des masses : ce sont elles, qui d’un néologisme, font un mot de la langue. Nous ne saurions de même en supprimer sans la complicité des masses : ce sont elles, et elles seules, qui brusquement laissent tomber les mots dans l’oubli… » (Lucien Febvre, Michelet et la Renaissance, Cours au Collège de France 1942-1943, éd. Flammarion, Paris, 1992, p. 25-26)
[5] Cf. Éric Zemmour-Michel Onfray : leur premier débat (entre autres).





 Version imprimable
Version imprimable
 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?



2 Messages
Pour Cécile Alduy, spécialiste de l’analyse du discours politique, le nouveau nom du parti présidentiel est une pure opération de communication qui révèle l’essence du macronisme : c’est un « enrobage doucereux qui fera passer la pilule des réformes ». LIRE : « “Renaissance” : quand le marketing remplace la politique ». LIRE AUSSI : La langue de Zemmour.
Vient de paraître aux éditions Tinbad : Cyril Huot , Sans transition, De Roland Barthes à Pasolini.