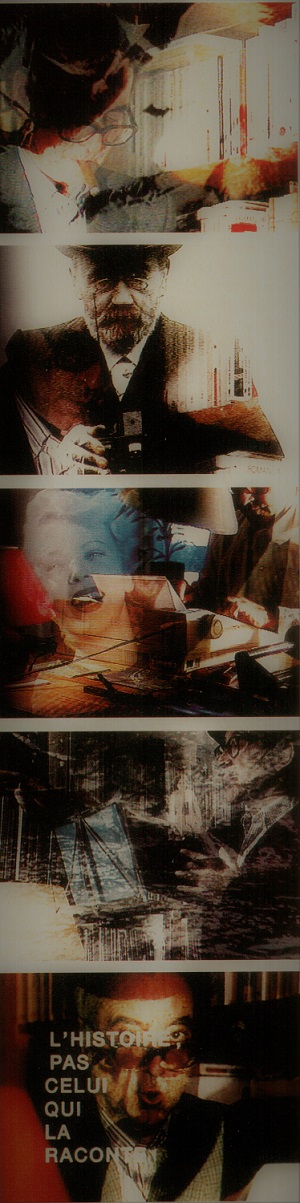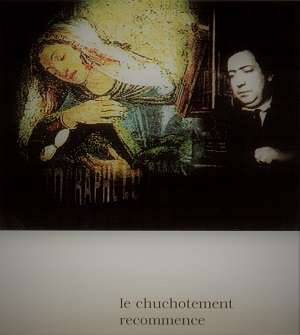Deux images des Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard.
ZOOM : cliquer sur l’image.

Mai 1997, Cahiers du cinéma n°513. Le Festival de Cannes approche. Qui va-t-on célébrer ? Quelles stars ? Dans son éditorial, Serge Toubiana, alors rédacteur-en-chef de la revue, écrit : « Godard, avec ses Histoire(s) du cinéma a évidemment trouvé la réponse juste. C’est le cinéma qu’il faut honorer, et tous ceux — cinéastes, producteurs, stars, sans oublier les films, les sujets, les histoires — tombés au champ d’honneur, pour avoir voulu, désiré ou rêvé d’en faire la grandeur. Grandeurs et misères du cinéma. Une des initiatives, sans doute la plus judicieuse, de ce 50e Festival de Cannes consistera dans la projection, dans le cadre d’Un Certain Regard, de deux chapitres de la somptueuse série conçue par Godard depuis une dizaine d’années. C’est un travail gigantesque, inouï, de remémoration à la fois gaie et funèbre, de tout ce qui brasse l’histoire de ce siècle, met le cinéma en question, ou se sert du cinéma pour questionner l’Histoire, remonte le fil de sa naissance, à la fin du XIXe, jusqu’à la peinture et la photographie. Ce sont ces Histoire(s) du cinéma que les Cahiers ont voulu prendre en compte dans ce numéro, en donnant la parole à Philippe Sollers, et en reproduisant de longs extraits inédits d’un dialogue entre Godard et Serge Daney. »
Le 28 mars 1997, Godard a donc invité Serge Toubiana, Antoine de Baecque et Philippe Sollers à visionner plusieurs heures de son work in progress, Histoire(s) du cinéma. Expérience insolite, concrète (« la divinité du concret »). L’entretien avec Sollers est un document passionnant où l’écrivain, enthousiaste, compare Godard à « un saint », « une sorte de Noé », « un chef d’orchestre des spectres ». Il n’a jamais été réédité. Il est suivi, dans les Cahiers, d’un long extrait d’un dialogue entre Serge Daney (1944-1992) et Godard, datant du 3 novembre 1988, qui avait déjà été publié dans Libération le 26 décembre 1988 sous le titre « Godard fait des histoire(s) » [1], et qui, filmé en vidéo, servira de trame pour certaines séquences des Histoire(s) 2a : seul le cinéma [2]. Le dossier des Cahiers est introduit par Antoine de Baecque qui écrira plus tard une importante biographie de Godard, la première de langue française (Godard, Grasset, 2010, 944 p. [3]).
Ce n’est pas la première fois que l’occasion est donnée à Sollers de s’exprimer sur le cinéma de Jean-Luc Godard ou de dialoguer avec le réalisateur. C’est même souvent JLG qui a été à l’initiative de telle ou telle rencontre. Citons, pour mémoire, Godard/Sollers : L’entretien, réalisé par Jean Paul Fargier, le 21 novembre 1984 (Je vous salue Marie !), ou encore, cet échange télévisé, le 26 novembre 1996, lors de la sortie de For ever Mozart, au Cercle de Minuit animé par Laure Adler. Mais on peut aussi citer les écrits de Sollers : La « bonne nouvelle » de Godard (sur Détective, avec Johnny Halliday, 1985), ou JLG/JLG, un cinéma de l’être-là (sur JLG/JLG, autoportrait de décembre, 1995). Intérêt et dialogue mêlés d’admiration et de distance réciproques entre le catholique et le protestant, où se jouent les rapports complexes, souvent conflictuels, entre cinéma et littérature, image et parole, et leur rapport singulier aux histoire(s) (narration, récit, roman) et à l’Histoire, qu’on la pense comme Histoire monumentale (Nietzsche), Événement ou Avènement (Ereignis : Heidegger).
Pile et face. Marcelin Pleynet a vu, lui aussi, ces Histoire(s) du cinéma. C’était un an et demi plus tard, le 1er octobre 1998, alors que Godard venait de publier un coffret de quatre volumes éponyme (Gallimard/Gaumont). S’appuyant sur certains écrits datés (anciens et qui font date) de L’Internationale situationniste ou de Guy Debord, mais aussi de Heidegger (D’un entretien de la parole [entre un Japonais et un qui demande]), l’analyse de Pleynet, qu’il relate dès le lendemain dans son Journal, publié en 2000, dans Les voyageurs de l’an 2000, sous-titré « romans » (Gallimard, coll. L’infini), manifeste, à travers une lecture « symptomale », une distance critique certaine, quoique nuancée, non seulement par rapport au cinéma de Godard, mais à la pratique cinématographique en général à l’heure du « spectaculaire intégré » (« il n’y a rien à attendre de ce qui se présente comme art cinématographique »). Pleynet reprend là les critiques explicites qu’il formulait dès mars 1969 dans la revue Cinéthique à propos de Godard (entre autres), incapable, selon lui, de penser la spécificité cinématographique et l’idéologie produite par la caméra comme appareil idéologique (1969 : « une caméra productrice d’un code perspectif directement hérité, construit sur le modèle de la perspective scientifique du Quattrocento. » 1998 : « cette Histoire(s) du cinéma justifie la pensée profonde de l’appareil [4]. »). Dès lors, on imagine que le « dialogue » entre le cinéaste et le poète est, sinon impossible, du moins difficile. C’est la même distance (mêlée cette fois d’admiration et de « passion persévérante ») qu’on retrouve sous la plume d’un cinéphile repenti devenu écrivain (je préfère l’essayiste au romancier), Thomas A. Ravier, dans le chapitre consacré à Godard de son percutant essai L’oeil du Prince (Gallimard, coll. L’infini, 2008) sous le titre suggestif « Leçon de ténèbres ».
En 1997, Antoine de Baeque terminait son article des Cahiers par ces mots : « Nous n’en avons pas fini avec ces histoire(s). » (« ces histoire(s) » sans italiques). Si, hélas pour eux, les Cahiers du cinéma n’ont guère poursuivi la réflexion qu’ils promettaient (au point que c’est peu après cette époque que j’ai pratiquement cessé de les lire), force est de considérer que la phrase reste vraie et que, bon an mal an, Godard continue, en Suisse, c’est-à-dire aux antipodes, à bousculer nos repères et à nous maintenir en éveil dans un monde qu’il sait être un monde de fantômes. Sollers écrivait en 1985 : « Godard est un scandale qui dure, à la grande surprise des cons, parce qu’il ne cède pas sur sa sensation intime, donc sur son désir. C’est, tout simplement, un des plus grands artistes de notre temps. » Un scandale qui dure au point d’obliger, d’une certaine manière, l’écrivain et le poète à continuer à fonder, de livre en livre, ce qui demeure, quand les images, written on the wind, risquent toujours d’être emportées par le vent. Sollers encore (et cela vaut pour tous et pour chacun) : « Il faut être bien seul pour faire ce travail ! Mais si on est habité, il faut aller jusqu’au bout. »

Histoire(s) du cinéma.
ZOOM : cliquer sur l’image.

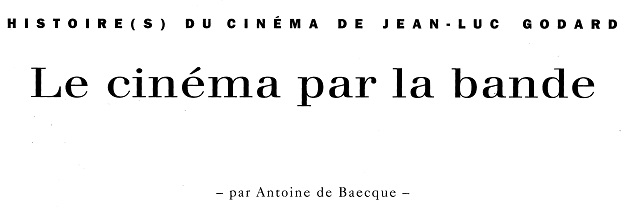 Comment circulent les Histoire(s) du cinéma que nous raconte Jean-Luc Godard ? En contrebande, par moments volés, mais laissant alors un impact démesuré dans notre regard. Cela rappelle un peu le cubisme. 1907, Les Demoiselles d’Avignon. Picasso n’exposera pas sa toile-manifeste avant vingt ans, mais déjà « on » parle de quelque chose d’absolument essentiel. Qui passe à côté rate l’entrée dans le siècle. Et s’ils sont nombreux, très nombreux à passer à côté, quelques-uns voient la toile, dans l’atelier de Picasso. Ils en parlent, la commentent, commencent à écrire à son sujet, dans les revues d’art. Ils inventent même un mot pour désigner la révolution qu’ils y ont vue : cubisme. Un passeur se propose, Apollinaire, qui, sous le choc, comme inspiré par le tableau, par Picasso et Braque, dit l’importance et la vérité de ce regard. La nouvelle, peu à peu, se répand, plaçant l’art sous influence, et gagne son combat par contamination, clandestinement, par rumeur, insidieusement. C’est un complot, contre l’art académique et le bon goût, et Picasso possède les armes des comploteurs : il fait son coup en secret, peu à peu, ruminant ses obsessions, et cela éclate, puis cela prend. Quelques années plus tard, tous les artistes parlent du cubisme même si très peu ont vu, de leurs yeux, ces Demoiselles d’Avignon. On pourrait dire la même chose de Proust, de Joyce (qui a lu Finnegans Wake ?). Et des Histoire(s) du cinéma de Godard : qui n’aura pas vu cela, qui n’aura pas compris ces histoire(s), ratera la sortie du siècle. Pourtant, combien les verront ? On ne sait toujours pas si ces histoire(s) seront montrées à la télévision, en salles, ou si elles trouveront la forme d’un livre...
Comment circulent les Histoire(s) du cinéma que nous raconte Jean-Luc Godard ? En contrebande, par moments volés, mais laissant alors un impact démesuré dans notre regard. Cela rappelle un peu le cubisme. 1907, Les Demoiselles d’Avignon. Picasso n’exposera pas sa toile-manifeste avant vingt ans, mais déjà « on » parle de quelque chose d’absolument essentiel. Qui passe à côté rate l’entrée dans le siècle. Et s’ils sont nombreux, très nombreux à passer à côté, quelques-uns voient la toile, dans l’atelier de Picasso. Ils en parlent, la commentent, commencent à écrire à son sujet, dans les revues d’art. Ils inventent même un mot pour désigner la révolution qu’ils y ont vue : cubisme. Un passeur se propose, Apollinaire, qui, sous le choc, comme inspiré par le tableau, par Picasso et Braque, dit l’importance et la vérité de ce regard. La nouvelle, peu à peu, se répand, plaçant l’art sous influence, et gagne son combat par contamination, clandestinement, par rumeur, insidieusement. C’est un complot, contre l’art académique et le bon goût, et Picasso possède les armes des comploteurs : il fait son coup en secret, peu à peu, ruminant ses obsessions, et cela éclate, puis cela prend. Quelques années plus tard, tous les artistes parlent du cubisme même si très peu ont vu, de leurs yeux, ces Demoiselles d’Avignon. On pourrait dire la même chose de Proust, de Joyce (qui a lu Finnegans Wake ?). Et des Histoire(s) du cinéma de Godard : qui n’aura pas vu cela, qui n’aura pas compris ces histoire(s), ratera la sortie du siècle. Pourtant, combien les verront ? On ne sait toujours pas si ces histoire(s) seront montrées à la télévision, en salles, ou si elles trouveront la forme d’un livre...
Mais « ça » circule déjà, et « ça » nous fait comprendre le monde. Comme le dit Philippe Sollers, « ça » nous fait gagner du temps, le temps d’un regard, le temps d’une pensée. Un peu comme une drogue dont on deviendrait dépendant : les idées et les images circulent par la bande, conte nues dans des cassettes-vidéos que l’on se passe de main en main avant de les passer sur nos magnétoscopes. Il y a des épisodes très « vus », les 1 A et 1 B par exemple, déjà passés à la télévision donc enregistrés sans difficulté. Il y a aussi les raretés, 2 A et 2 B, dont un trafic pourrait très bientôt se mettre en place. Parce qu’il existe une demande, avide, au point qu’on peut téléphoner à untel-qui-les-aura-sûrement parce qu’on est en manque, vers deux heures du matin, qu’il nous faut une image, un son, une association, une citation, la voix de Godard qui lit Victor Hugo, sa machine à écrire qui crépite sèchement, le bruit du déroulement de la bobine sur la table de montage, tous ces bouts de films qui racontent des histoire(s).
Parfois, il y a un événement : on va voir les films en projection « officielle », à Locarno en août 1995, à Cannes cette année pour deux d’entre eux (3 A et 4 B, dans le cadre d’Un Certain Regard, à la Cinémathèque (non, c’est annulé au dernier moment), et Godard sera là, il parlera, on parlera avec lui, on écoutera aussi des gens qui ont vu, qui ont compris. Agamben, Rancière, Labarthe... Ou alors, on peut lire des textes, les premiers textes qui commencent à dire l’importance des histoire(s), Jonathan Rosenbaum dans Trafic (n°22), Dominique Païni dans Artpress (n°221), on y puise des idées, on y partage une expérience, et cela donne l’envie de revoir des épisodes, des moments. « Ça » nous nourrit, à nouveau. C’est l’entêtante fonction de ces histoire(s) : elles sont là, on peut les voir sur des supports très différents, très inégaux, mauvaises copies en cassettes, vidéo-projections dans quelques festivals, ou même sur l’écran idéal, chez Godard, à Rolle, à Paris, avec le cinéaste qui tourne en rond dans la pièce d’à côté, qui change lui-même les précieuses cassettes Béta, et la cassette de la bande-son, magnifique... Elles sont là, elles diffusent, comme des formes qui pensent. Et il faut tenter de penser avec elles, parce qu’il serait coupable, où dommage tout simplement, d’oublier qu’on peut penser notre siècle avec des morceaux du cinéma.
Ce work in progress sur lequel Godard travaille depuis dix ans — forme peut-être à jamais ouverte (il doit réaliser ce qu’il appelle le « dernier » épisode dans les mois qui viennent, mais ensuite il y aura encore le livre reprenant les films, et d’autres essais, pourquoi pas) —, monte et montre ensemble « ce qu’était le cinéma » et « ce qu’était le XXe siècle ». Tout cela grâce à la vidéo, comme s’il fallait passer par ce procédé technique assez simple et imaginatif, bricolé, grâce aux collages, aux arrêts, trucages, ralentis, citations, pour inventer le juste « ensemble » qui fait s’impressionner le cinéma sur l’histoire et l’histoire sur le cinéma. Un dialogue à trois, donc, avec un (s) à histoire(s), où chacun réclame sa part de mots, d’images, de sons, de corps. A quatre plutôt, car Godard est omniprésent, par son visage, son ombre, sa voix, son dispositif. Il se moule dans ce dialogue, puisqu’il est le cinéma, la vidéo, ou la littérature dont il lit des titres, des passages, des noms. L’idée, chez lui, consiste d’abord à filmer ces protagonistes , le cinéma, l’histoire, la vidéo, la peinture, la littérature, Godard lui-même, comme des personnages, donc comme des corps, tout en les montrant comme des concepts, des idées, donc comme des âmes. Les Histoire(s) sont fondées sur cet équilibre entre corps et âmes. C’est ce qui sauve le siècle en l’imprimant sur les images. On voit son corps, ces millions de corps qui bougent, meurent, et ressuscitent parfois grâce au cinéma — la séquence finale d’Ordet génialement doublée par la chanson de Gilda —, et on voit son âme, cet esprit que la peinture, parfois, approche (le baigneur de Seurat au moment de l’invasion allemande) ou que le cinéma hante de ses fantômes (il y en a tant pour nos nuits noires de cinéphiles). Si bien que les Histoire(s) de Godard parviennent à un sommet de réflexion, où la texture des idées est terriblement dense, Somme au sens philosophique et théologique du terme, essai historique tout autant : la mise en concordance des « usines de rêves » hollywoodienne et soviétique par exemple, avec le parallélisme des destins de Thalberg et de Lénine, un même fantasme du contrôle absolu sur les sens et les esprits, sur les corps que l’on façonne et les âmes que l’on conditionne. Et à un sommet d’émotion mobilisant les affects à travers le jeu des couleurs, le mélange des arts, le voyeurisme sensuel (ou pornographique parfois) des corps, et, surtout, le montage des images et des sons qui produit de brusques bouffées d’émotion, submergeant d’un coup les pensées comme une vague les rochers d’une côte sauvage : Baudelaire sur un très long et doux passage de La Nuit du chasseur, tel un rêve ; un moment d’Alphaville recouvrant les Trois Lumières de Fritz Lang, avec un jeu de rimes d’un visage l’autre, d’une pâleur l’autre, d’une lumière l’autre ; une chanson de Richard Cocciante qui parle de la langue italienne, sur une mosaïque de films néoréalistes, hymne élégiaque comme on n’en a jamais composé de plus beau au cinéma italien.
Comment regarder ces Histoire(s) ? Comme un joueur, un candide, un innocent, un élu, un savant, un cinéphile, un philosophe, un historien, un amateur ? Comment, surtout, en rendre compte : faire comprendre qu’il s’agit d’un des moments exceptionnels où le cinéma pense son siècle, tout en restituant un peu de l’émotion qui vous saisit parfois face aux images et aux sons. Comment raconter les Histoire(s) de Godard, avec leurs pleins et leurs creux, les échos et les voix étouffées, les brillances, les fulgurances, et les matités ? Ces Histoire(s) ont commencé à nous nourrir, et vont continuer pendant un certain temps. Les Cahiers travaillent avec elles, sur la durée, autant qu’ils tentent d’être travaillés par elles, dans le temps des projections, des réflexions, des émotions. Cela circule entre nous mais aussi dans la revue. Pour rendre compte de ce travail, il faut voir, faire voir, débattre, faire débattre, écrire, faire écrire. Cela a commencé il y a quelques mois et va, espérons-le, irriguer les pages de la revue pendant le temps qu’il faudra, comme une entreprise de mise à nu de nous-mêmes et des gens qui se confrontent à ces films. Nous avons donc demandé à quelques-unes des personnes que nous aimons lire, de travailler avec ces Histoire(s), de vivre une expérience avec elles, de se mettre en disponibilité vis-à vis de Godard, pour lui parler, lui faire reprendre le chemin de ces films. Des écrivains, philosophes, historiens, critiques d’art, cinéastes, comme en un vaste chantier à la taille de ces Histoire(s), avec la volonté de s’y mesurer, avec l’idée que cela doit nous faire mieux voir le cinéma, mieux l’écrire aussi. Dans ce numéro, les fondations sont posées par Daney, dans un entretien avec et filmé par Godard datant de 1988, et par Philippe Sollers, qui a vu les sept épisodes, les cinq heures de film, et qui en parle. Nous n’en avons pas fini avec ces histoire(s).

Serge Toubiana. Notre intuition était que ces Histoire (s) du cinéma de Godard ne pouvaient que vous intéresser. D’abord parce qu’il n’y est pas seulement question de cinéma. Mais du cinéma dans ses relations de filiation avec les autres arts, ceux du XIXe siècle, et en même temps approche contemporaine de l’image cinématographique dans un contexte ou une complexion plus large, se mêlant à d’autres images, picturales ou musicales. Et cette idée selon laquelle Godard est le seul, dans la sphère du cinéma, à tenter ce genre d’entreprise gigantesque, qui consiste à raconter une ou des histoires du cinéma, et sur tout, à les convoquer chez lui, dans une sorte de dimension romanesque. La tête ou le cerveau de Godard, où toutes ces histoires se réfléchissent, comme lieu ou caverne où tout revient, ses souvenirs de spectateur en même temps que ses projections vers l’extérieur. Cette démarche est évidemment très solitaire, même si d’autres cinéastes comme Hitchcock s’y sont confrontés, mais sur leur seul territoire fantasmatique.
Philippe Sollers. Dans Pierrot le Fou apparaît Céline. J’ai eu envie d’aller voir ce que disait Céline du cinéma, au moment où ce dernier allait prendre en main le rapport à la réalité, massif, de la société tout entière. Nous sommes au moment où la société du spectacle prend sa consistance. C’est-à-dire, probablement, si l’on reprend la datation de Guy Debord, au détour des années 20-30, dans ce basculement des années 20 dans les années 30. Le cinéma passe du muet au parlant, et puis il y a tout à coup cette prise en main industrielle, qui va devenir planétaire et qui l’est désormais, ce qui implique aussi la fin du cinéma au sens d’un art, témoignage donc que le cinéma est une tangente révélatrice de la mise en spectacle de la société. Comme si l’Histoire elle-même nous avait fait son cinéma. C’est le moins qu’on puisse dire. Et les formules de Céline, à propos du cinéma, sont très funèbres. C’est : « caveau d’illusions », « il y a des fantômes plein l’écran... » Et cette phrase terrible, à savoir qu’il s’agit de « mettre tout ce miroitement fantomatique, dans une fosse commune, dit-il, capitonnée, féerique et moite ». Le thème de la possibilité, ou pas, d’un fantôme, d’un spectre, d’un mort, qui se lèverait, dans cette fosse commune, ce caveau d’illusions, qui aurait un peu la figure, qui se profile d’ailleurs dans les Histoire(s) de Godard, du Noé d’Uccello, renversé contre sa coque après un déluge. Et lui-même, Godard, est à ce moment-là comme une sorte de Noé, il va vers une énorme prolifération d’illusions qui tout à coup se saborde, après avoir créé son océan, ses continents, son humanité asservie à cette subjectivité-là. Ça croule, il y a un déluge... Le thème apocalyptique est clair, Godard est là, à plusieurs reprises, assis derrière son micro et sa machine à écrire, ou alors debout, admirablement, comme un chef d’orchestre des spectres, évoquant ces milliers d’ombres qui ont été projetées, pas seulement sur les écrans, mais aussi dans les cerveaux humains pendant très longtemps. On est dans la caverne, allusion platonicienne. Il s’agirait en quelque sorte de tirer quelqu’un, qui se réveillerait de cette hypnose gigantesque, vers un dehors peut-être impossible, énigmatique. Mais maintenu comme tel dans la tension, c’est un acte révolutionnaire, dans la mesure où un acte révolutionnaire est ce qui essaie de ramasser le plus possible de temps dans une récapitulation, une remémoration très rapide, en vivant tout ce qui s’est déposé très lentement, dans la souffrance, l’imagination latérale, vers quelque chose qui pourrait indiquer une sortie.
Alors Histoire(s) du cinéma, avec ce s entre parenthèses, c’est pour moi une tentative de remémoration héroïque d’un corps qui voudrait cesser d’être un agent des fantômes, dans « une fosse commune, capitonnée, féerique et moite ». Il y a là un sursaut, un cri, presque christique, qui d’ailleurs est souligné à plusieurs reprises avec l’apparition de la prédication du Christ de Pasolini : De profundis clamavi... J’en appelle au réel qui aurait sans cesse été enveloppé, celui du XXe siècle. Il n’y a pas de problème sur ce point : le cinéma est une matière qui enveloppe la façon de se raconter l’Histoire. Il est très difficile de trouver quelqu’un aujourd’hui qui puisse être détaché, dans son point de vue sur l’histoire, de la mécanique projective du cinéma. Là, on rejoint une démonstration qui n’a en effet jamais été tentée : ranger cette longue histoire temporelle du cinéma dans ce que Nietzsche appelait l’Histoire monumentale. C’est-à-dire lui donner la dignité d’un art, alors qu’on aurait pu en douter, car c’est une revendication très violente. D’un art qui serait celui de la notation physique de tel ou tel corps à tel ou tel moment, promis à la disparition puisque ce n’est qu’un fantôme de corps, finalement. Une Histoire monumentale. Ou alors ce que Heidegger appelle l’Historial, qui n’est pas l’historicité ; ni l’histoire de l’historicisme. Point de vue vertical : l’Historial du cinéma. Historial rimant avec mémorial, on a affaire à un monument pratiquement funéraire. C’est très blasphématoire, par rapport à ce qui veut encore se considérer, réalistement, naturalistement, via la photographie ou le cinéma, qui sont tout de suite des procédures funèbres. La prédication de saint Godard est claire : d’abord le noir et blanc, ensuite on « farde », on colorise, on « cosmétise » le propos. Mais d’emblée, il s’agit bien du royaume des morts. C’était frappant, l’autre soir, dans le petit montage de l’émission « Métropolis », sur Arte, à propos de l’an 2000. D’un côté, on se posait la question : qu’est-ce que c’est que l’an 2000 ? C’est une question de calendrier, vous n’êtes pas obligé d’y croire... Mais le montage était intéressant, avec des images de l’Exposition de 1900, tous ces personnages en haut-de-forme, en habit, les femmes en chapeau et voilette, gigotant dans cette espèce d’euphorie de calendrier halluciné, avec le premier trottoir roulant, le premier petit train électrique ... Et il y avait aussi les responsables des manifestations prévues dans le monde, que ce soit en France ou en Allemagne, pour célébrer l’an 2000. On se rend compte que ça va être une énorme exposition : la planète va être une expo ! Il y aura des colloques dans des expos ! La sphère terrestre entière sera une énorme expo, par rapport à quoi l’expo de 1900 paraît folklorique. Pourtant, les corps qui sont là sont des fantômes vivants au moment où ils sont filmés. C’est là qu’on voit que Proust est grand. Tous ces corps s’évanouissent en fumée, mais si je peux me dire que Charlus est parmi eux, que Madame de Guermantes passe peut-être au loin, qu’Albertine se faufile pour aller à on ne sait quel rendez-vous... Et là on voit bien ce qui reste de 1900 : il reste Proust. La question vertigineuse est donc : qu’est-ce qui reste du XXe siècle ? Que ce soit Godard qui pose la question d’une façon dramatique ne doit pas nous étonner. Mais il le fait avec une grandeur qui, en effet, ne peut pas ne pas se confronter brusquement à la poésie et à la littérature. Ce qui reste ? On peut prendre, comme le fait Godard, un long passage d’Elie Faure sur Rembrandt, et remplacer Rembrandt par le mot « cinéma ». Ce qui veut dire l’aspiration même à la durée. Poésie, littérature, peinture, ô combien ! On n’a probablement jamais vu un homme de cinéma à ce point travaillé par la peinture. Et par la musique, bien entendu. Avec de la musique, si on a fait un peu de montage, on peut changer n’importe quelle image en ce qu’on veut. Tout ça, donc, c’est du son. Et puis, des images qui arrivent en fonction de ce son, ou de ce ton, fondamental. A travers l’ensemble, on entend la voix de Godard, qui s’est mis là, très modestement, en chef d’orchestre. Il orchestre sa partition, on entend ce qu’il dit, ses aphorismes viennent s’inscrire... Disons que c’est sa voix, organisatrice d’un oratorio.
Antoine de Baecque. Cette voix, d’où vient-elle ? Est-ce qu ’elle vient d’après la catastrophe, ou alors l’accompagne-t-elle ? C’est une voix qui appelle les Justes après le jugement et leur demande de sortir ? Ou est-ce que cette voix fait partie de la catastrophe ?
Ph. Sollers. C’est : De profundis clamavi. Godard s’est mis dans une position prophétique, il en appelle à... A vous, à nous, à qui veut. C’est un réquisitoire, c’est une prière, c’est un oratorio, c’est un pamphlet, c’est un récit, etc. Dans la force hypnotique du spectacle, qui est toujours, ne l’oublions jamais, une certaine fausse coïncidence entre l’image et le son, (par fausse j’entends quelque chose que vous pouvez vérifier en regardant une image avec ou sans commentaire, par exemple dans le « No Comment » de je ne sais plus quelle chaîne d’informations), un des seuls à être réveillé, c’est Godard. Comment est-ce qu’on n’a jamais vu, pensé, que l’image et le son étaient en train de vivre faussement et fantomatiquement ensemble, sur le même support ? Il y a eu une certaine insurrection surréaliste très tôt, il y a eu ensuite des doutes, passant plus ou moins par le fantastique, sur cet être imaginaire, mais tout ça ne tient pas une seconde. C’est d’un charlatanisme éhonté, puissant. Avoir maintenu ce doute, cette critique, ce point de vue, c’est vraiment être très résistant à l’hypnose. Je crois que nous pouvons reconnaître ça à notre ami. Il aurait fallu faire un petit reportage sur cette journée du 28 mars, que nous avons vécue ensemble. Il aurait fallu filmer la façon dont nous avons regardé ces cassettes de Godard. Nous arrivons dans cet immeuble, nous montons à l’étage, les rideaux sont tirés, nous sommes brusquement, pendant des heures, comme des gens qui vont s’amuser ensemble. Godard est là, il se met à quatre pattes pour changer les cassettes... Au fond, ça ressemble à une réunion d’étudiants. Puis nous allons déjeuner, et on recommence. Godard de nouveau se met à quatre pattes pour nous montrer ses cassettes.
C’est assez drôle qu’avec si peu de moyens, dans une pièce assez sombre, soient mis à notre disposition, par ce travail énorme, des sommes d’argent incalculables, en même temps que des millions et des millions de corps, pas seulement de fictions hollywoodiennes ou... russes, ex-révolutionnaires, en même temps que des images d’actualités, c’est-à-dire, tiens, là, ce sont de vrais morts : les camps, les massacres. Tout ça ! L’Histoire nous a fait ce cinéma. Et nous étions là. Ce serait intéressant de savoir à quel point exact de l’espace et du temps nous étions tout récemment. Ce matin, cet après-midi-là. A quel point de la pensée nous sommes, quand nous regardons ces Histoire(s) du cinéma. On est très détaché, on n’est pas impliqué, on reconnaît de temps en temps tel ou tel passage de film, tel ou tel acteur, actrice ou film célèbres, je me faufile dans les surimpressions, dans le montage qui est admirable, avec la musique, les citations, les peintures... En même temps, il est possible d’arrêter et d’aller prendre un verre... Quel est ce moment ? En quoi, en ce printemps 1997, sommes-nous là ? Dans cette possibilité-là, qui n’aurait visiblement pas pu avoir lieu avant ? Cela a lieu depuis longtemps, mais si cela vient vers nous maintenant avec un certain détachement, alors quel est ce maintenant ? Je crains que nous ne soyons pas très nombreux à être dans ce maintenant. Je ne pense pas que l’industrie cinématographique, qui roule à sa perte avec des cris joyeux, comme dirait Lautréamont, nous rejoigne sur ce moment de décalage. Alors, qu’est-ce qui m’a frappé dans ces Histoire(s) du cinéma ? C’est l’art. Montrer, par exemple — c’est d’actualité — l’invasion de la France par les nazis, avec de Gaulle en contrepoint : c’est le cinéma. Penser, au-delà de l’histoire qui nous a fait du cinéma, ce qu’a vraiment dit l’histoire. C’est donc très ambitieux. Avec ce s qui est comme un exposant algébrique : l’histoire au carré, au cube... L’envahissement de la France par les nazis, montré à travers un tableau de Seurat, c’est une idée grandiose. A ce moment-là, vous avez tout un pays, toute une civilisation, toute une culture, représentés par un type qui est censé aller se baigner, d’un moment à l’autre... La dévastation en cours, est montrée superbement comme ayant moins de poids — alors qu’elle est immense — qu’une peinture de Seurat. C’est en gros, je crois, le rôle que joue la peinture dans cette épopée. Que ce soit Uccello, Van Gogh, Rembrandt, Manet, Monet, Picasso... On a l’impression que l’Histoire faisant son cinéma, et le cinéma lui-même, n’arriveront jamais à avaler un tableau. Et que tous ces millions de kilomètres de pellicule, dans leur ralenti ou leur accélération, dans leur mouvement, n’arriveront jamais à un repos convaincant. C’est-à-dire à la condensation du mouvement intime de s’arrêter, comme des vagues qui viennent mourir depuis si longtemps sur le rivage des tableaux, ou des mots. A ce moment-là, l’expérience du cinéma, ce serait, par négativité intense, reconnaître ça, qui a une vérité considérable. Parce que les gens devant des tableaux, écoutant de la musique, ou lisant des livres, ne sont pas forcément dans cet état. Il faudrait donc leur démontrer, qu’avant de rejoindre un tableau, un texte vraiment écrit, ou une musique vraiment composée, il faut tout le déferlement des fantômes dans la fosse commune, et qu’il y aurait toute cette dépense dite cinémato-graphique, antérieurement photographique, tout ce déluge de morts, pour arriver à l’évidence. C’est donc une démonstration extraordinaire, qui n’a rien à voir avec le fait de dire : « Ce tableau est beau, j’aime bien Seurat, j’aime bien Manet... ». C’est un geste métaphysique. Godard poursuit une intention philosophique fondamentale à travers le cinéma : le cinéma, c’est de la métaphysique par d’autres moyens. Il y a très peu de philosophes au XXe siècle qui soient de cette ampleur. Les philosophes blablatent, ils sont devenus d’ailleurs des salariés de la bien-pensance aujourd’hui, ça n’a plus beaucoup d’intérêt, ça pense très peu. Là nous avons quelque chose qui pense très fort. Encore une fois héroïquement, et non sans humour, avec de temps en temps le sujet de cette méditation, avec sa visière, torse nu.
Qu’est-ce qui m’a encore frappé ? La première chose qu’on ait vue, tout de suite, c’est Virgile et Freud. Noctes atque dies patet atrijanua ditis... Du latin. Ça manque un peu de grec. Hoc opus hic tabor est... « Les portes de l’Enfer sont ouvertes jour et nuit... Sed revocare gradum superasque evadere ad auras... Revenir sur ses pas et de là, s’élever jusqu’au jour »... Thème fameux : Dante, Platon... Est-ce qu’on va pouvoir sortir, ou pas, de la caverne d’illusions ou de l’Enfer. De l’Enfer avec ses séductions, ces girls qui sont des guns ? Là, Freud est bienvenu, avec cette inscription sur l’écran : Père ne vois-tu pas que je brûle ? L’appel au père est quelque chose de brûlant... Au secours ! On brûle, on est en Enfer, et vous dormez tous, là, avec votre cinéma !
S. Toubiana. D’autant que la brûlure concerne de près la pellicule, et que nous voyons à l’image des scènes d’incendie.
Ph. Sollers. C’est juste, tout ce qui est filmé est brûlable. Et cette histoire qui nous aurait fait du cinéma, brûlerait elle-même. « Père ne vois-tu pas que je brûle ? », « Girl égale gun », c’est du Freud classique : girl égale phallus. Il y aurait donc eu toute une histoire forcenée, on aurait montré du phallus aux foules hypnotisées... sous prétexte de prestations féminines. Des tas de phallus qui passeraient sous nos yeux... On croit qu’elles l’attendent, ou qu’elles veulent l’avoir, alors qu’elles le sont. Ce n’est pas moi qui ai inventé la vérité qu’on peut opposer à l’hystérique, mais on peut la redire : l’hystérique veut un maître sur lequel elle règne. C’est du Lacan pur sucre (rires). Ça fait assez cinéma ! Et il y a eu les servants de ce culte : l’admirable Thalberg, par exemple !
Serge Toubiana. L’opposition que fait Godard entre Thalberg et Lénine.
Ph. Sollers. L’opposition et la complémentarité énigmatique. Le système de poumons symétriques entre Hollywood, et le cinéma soviétique, ce système de mise en miroir, avec Eisenstein qui se rend à Hollywood voir Chaplin, puis qui revient ... Est-ce qu’on aura montré, mieux que Godard, cette co-naturalité des deux événements ?
S. Toubiana. Les deux usines à rêves dont parle Godard.
Ph. Sollers. Oui, les deux usines à rêves ou à cauchemars. Le drame du XXe siècle, c’est quand même ça. Il y avait ça, en même temps. Cette affaire n’est pas encore bien pensée dans la réalité philosophique, politique ou historique. Ici, avec Godard, la preuve est massive.
S. Toubiana. Avec le contrôle sur les masses comme fantasme.
Ph. Sollers. Exactement. Ce n’est pas par hasard si la figure de Hitler se profile. Il me semble que Staline est un peu absent : j’aurais mis deux ou trois images de Staline... Le « con-trôle de l’univers » enveloppe toute cette comédie-tragédie. Le cinématographe a été comme un poisson dans l’eau dans le spectaculaire concentré (le totalitaire ou la visée totalitaire), comme dans le spectaculaire diffus (la levée du soleil de la marchandise planétaire),et comme nous sommes dans le spectaculaire intégré, le cinéma se retrouve pétrifié, coincé dans son histoire. Tout cela pour employer les termes de Debord, qui décrivent bien le processus. Mais il s’agit bien du spectaculaire, de part et d’autre, avec des réussites grandioses. Qui va nier que si nous sommes assis dans une salle de cinéma, nous ne pouvons pas ne pas vibrer devant des dizaines de grands films qui, légitimement, nous auront convaincus que l’horizon de l’aventure humaine se situait là ? C’est le fond des choses, n’est-ce pas, cet illusionnisme séculaire.
S. Toubiana. Est-ce que Godard ne se met pas en scène lui-même comme l’ouvrier de cette grande cérémonie du cinéma ?
Ph. Sollers. Dans la série des Histoires proprement dites, l’attitude est prophétique : je me dresse parmi les décombres... Le thème est indubitablement apocalyptique, avec une mélancolie et une grande ténacité. C’est ce qui me frappe chez lui : il ne lâche pas prise, c’est un chien de l’Enfer... Cette idée qu’on va recueillir, rassembler, tout ça, de façon lyrique, dénonciatrice, et puis on ferme, en somme. C’est son diagnostic. Je ne suis pas compétent sur le cinéma, Godard prophétise sa mort, il me semble qu’avec l’extension du numérique elle est probable... Labarthe dit : « Si les cinéastes savaient ce qu’il est en train d’arriver au cinéma, ils pleureraient tout le temps ; Godard pleure, il sait ce qui l’attend » (rires). C’est la phrase d’un professionnel. Mais là où je suis, j’observe avec passion ce qui est en train d’arriver à ce continent énorme. Avant de rejoindre le degré de lucidité où se situe Godard pour faire cette compression — pour parler en termes de sculpture —, je crois que tout le monde est très en retard. C’est pour ça que je voulais qu’on médite sur le « maintenant » où nous étions en train de faire ce geste, à Paris, en France, ce qui a probablement son intérêt. Il y a dans les Histoire(s) un hommage aux cinémas américain, italien, russe et français. Ça se joue à peu près dans ce carré. Plus le cinéma allemand jusqu’à la guerre. Cette temporalisation m’intéresse beaucoup. C’est comme si Godard disait que le XIXe siècle nous a proposé la mort photographique et son extension mouvementée, puis fardée : il y a encore des gens qui pensent que le cinéma c’est de la couleur, mais on crache parfois le morceau : « on colorise »... La peinture, en revanche, on peut la filmer mais ce ne seront pas ses couleurs, ni ses dimensions : comme disait Duchamp, dès qu’on reproduit on ment. Ce ne sont ni les vraies couleurs ni les vraies dimensions : on remplace le corps par une image. II y a des tas de gens qui pensent que la peinture est une image. Mais elle n’est pas une image : elle fait semblant. Donc il y a cette hypothèse très forte : le XIXe a inventé la mort visible et la bêtise, il a formulé l’hypothèse que la bêtise était une sorte de fondement d’essence dans l’humanoïde, et peut être même dans Dieu, qui sait..., hypothèse rarement formulée mais il faut bien en avoir l’audace : Dieu serait aussi bête que l’homme qu’il a créé... Tout cela est quand même dans l’ordre du diabolo en train de se constituer sans cesse. A partir de là, on serait dans le XIXe siècle à jamais, à cause, aussi, du cinématographe. J’ai eu tout à coup cette vision de Proust gagnant sur les actualités de son temps, après ça je pourrais vous parler de Stravinski, de Joyce, de Picasso, de qui vous voulez, de quelque chose de très grave, en fait, il me semble. Le spectacle, qui est prêt à laisser tomber le cinéma si ça ne sert plus comme prise psychique et subjective, est bien décidé à ne rien reconnaître des grandes créations du XXe siècle. C’est une question de vie ou de mort. Et l’on y assiste, à cette intentionnalité. Après tout, c’est un siècle où il y a eu trop de massacres, de dévastations : il vaudrait mieux faire comme si rien ne s’était passé, allez, hop... S’il ne s’est rien passé, ça va être très ennuyeux, justement parce qu’il s’est passé beaucoup de choses, anti-mort. Des créations. Le geste de Godard porte aussi là-dessus. Ce qu’il sent menacé, c’est cette formidable énergie de créativité qui risque d’être passée par profits et pertes. Et il s’appuie sur la musique, la poésie, la peinture, la littérature, ou sur la prédication métaphysique, ce n’est pas par hasard. Donc, il trahit. Il trahit le cinéma. Ou, plus exactement, il trahit l’utilisation transitoire que le cinéma aura été pour une organisation de la liquidation de toute créativité non réductible. C’est le sens de sa démarche, de son hymne. Et c’est pour ça que c’est beau. Il y a ce moment de méditation sur Manet : la transformation du regard, le moment où l’on passe de l’autre côté de la représentation, où l’art se saisit, non plus de ce qui est là en face, mais de ce qui vient de l’intérieur de ce qui est là. Évidemment, après il y a des problèmes : est-ce que l’omnispection, le « voir de partout » de Picasso n’est pas une critique anticipatrice de tout ce qui fait semblant d’être déchiffrable comme image ? Il y a une phrase dans les Histoire(s) de Godard qui m’a frappé, et qui fait référence à ce qui lui est arrivé comme découverte du cinéma : le vrai cinéma était celui qui ne peut se voir. II y aurait eu un moment où l’on ne voyait pas le « vrai cinéma ». Ça va assez loin, on pourrait en faire un programme : le vrai cinéma serait celui qui ne peut se voir. Imaginez un peu l’aventure, de même que vous essaieriez de déchiffrer à travers tout ce qu’on vous dit ce qu’on vous cache, vous feriez un film de tout ce que vous n’avez pas vu au cinéma. Hypothèse mathématique, inscrite dans le projet de Godard. Un immense film qui n’aurait pas de prix, dans la mesure où l’on ne pourrait pas le voir. Qui serait fondé sur cette conviction que, à chaque instant de chaque film, sauf ce qui fait un peu relief de temps en temps dans ce qu’on voit, il y a quelque chose qui ne se voir pas. Quand il m’est arrivé d’aborder cette technique, que ce soit avec Méditerranée de Jean Daniel Pollet, ou avec le film que j’ai fait sur Rodin, parce qu’il me semblait qu’il fallait mettre en coordonnées strictes une image sur la sculpture, et la voix sortie de l’écriture par rapport à ce que l’image ne peut pas montrer de la sculpture, j’avais un peu ce problème : il fallait que ça se résolve par quelque chose que finalement on aurait pensé mais pas vu. Il fallait affirmer de l’invisible. Dans les hommages appuyés que Godard rend à un certain nombre de films ou de cinéastes, par exemple La Nuit du chasseur, on a fort l’impression qu’on est en train, à ce moment-là, de voir autre chose. Ou dans son hommage à Hitchcock, c’est de ça qu’il s’agit. C’est une intuition qu’on va montrer quelque chose pour faire en sorte que cela ne se « voie » pas. Comme ce n’est pas très courant, il faut abonder dans son sens, parce que du coup, c’est extrêmement subversif. Et même explicitement révolutionnaire, si l’on s’en tient au fait qu’un révolutionnaire, je me répète, est quelqu’un qui n’est pas du tout satisfait de l’Histoire telle qu’on la lui raconte d’habitude, et qui n’arrête pas de voir autre chose dans ce qu’on lui montre comme déroulement de l’historicité. En général, il est rejoint très longtemps après par les historiens, lesquels mettent un temps fou à s’apercevoir de choses qui étaient évidentes, mais qui doivent être dogmatisées en quelque sorte pour faire consensus social. Là, il y a une façon qu’a Godard de s’adresser à une personne et à une seule. Dans le « ce qui ne se voit pas » , on ne peut pas s’adresser à une communauté d’aveugles. C’est quand même, aussi, une façon, comme par hasard, de rendre hommage aux morts dans leur individualité la plus radicale. Etre respectueux de chaque mort, travail impossible mais tout de même exigible. Je pense aux photographies qui apparaissent de temps en temps, vous voyez passer Virginia Woolf, Hannah Arendt, Picasso, qui vous voulez... Brusquement, vous avez la vision de cette formule d’Artaud que j’aime tout particulièrement : « La société se croit seule, mais il y a quelqu’un. » Ou alors le prodigieux coup de gueule de Von Stroheim. C’est-à-dire la présence de cette unicité dite « artiste », qui fait trou dans l’ensemble.
S. Toubiana. Je pense à une phrase de Deleuze, à propos de l’histoire du cinéma, qui disait que c’était un martyrologue. Godard nous le fait bien comprendre.
Ph. Sollers. Help ! Help ! Tous ces cinéastes qui ont mangé avec une longue cuiller en forme de caméra avec le diable... C’est là où je rappelais, après notre visionnage chez Godard, ce mot si extraordinaire de Hitchcock à Truffaut — dont j’ai toujours regretté qu’il n’ait pas été poussé plus loin par Truffaut — qui lui demandait, à propos de I Confess, si l’atmosphère de ses films n’était pas due à son éducation catholique chez les Jésuites, si son oeuvre n’était pas imprégnée par une sorte de péché ou de sens de la culpabilité. Hitchcock lui répond : comment pouvez vous me dire ça, puisque tous mes films décrivent la situation d’un homme innocent dans un monde coupable ? En effet, on s’est mêlé de choses pas claires du tout dans cette affaire de cinéma, mais la revendication de l’innocence est là. Alors, martyrologue, peut-être, mais il y a des saints.
S. Toubiana. Comment voyez-vous le statut de la citation dans ces Histoire (s) du cinéma de Godard ? Il invente une formule, une sorte de rhétorique, dans l’ordre de l’image, totalement inédite : ce ne sont pas des extraits, c’est autre chose.
Ph. Sollers. Je comprends ça très bien, d’autant plus que je m’en suis beaucoup occupé moi-même dans d’autres domaines. Par exemple, Paradis, sans ponctuation ni guillemets, est souvent fait de prélèvements recyclés. La tension c’est de montrer, précisément à travers une histoire monumentale, que tout est disponible, mais pas dans le passé, immédiatement là. A la limite, ce ne sont pas des citations mais des preuves qu’on avance en même temps qu’on poursuit son discours. Ça n’a pas le statut de citations, ce sont des témoins qui viennent renforcer la méditation fondamentale, laquelle les dépasse, les réinsère... Il peut s’agir de détournements, le siècle est fécond dans ce genre de choses, c’est posé dès le principe par Lautréamont dans ses Poésies. Brusquement, l’illumination verticale c’est que l’on peut être pratiquement là où on se situe partout à la fois comme présent. C’est un temps spécifique, c’est un plus que présent, c’est le temps de la méditation qui peut passer d’une chose à l’autre, avec le plus grand naturel, sans éloquence, parce qu’à ce moment-là ce serait le Musée imaginaire à la Malraux...
S. Toubiana. Dont Godard se réclame beaucoup.
Ph. Sollers. Il y a cette tendance, mais Godard est beaucoup plus pragmatique, convaincant, dans la mesure où il part de la forme et non pas des idées qui s’enchaîneraient par des illustrations. Ce ne sont pas des illustrations, ce sont des blocs formels, parfaitement invisibles, qui viennent là, et qui tombent pile. L’Allemagne envahit la France : voilà Seurat. Il fallait y penser ! Il faut aussi avoir vécu quelque chose comme un traumatisme devant ce Seurat, avec sa fragilité... Ce sont des éléments très biographiques.
A. de Baecque. Mais ces éléments, mis ensemble, donnent une forme qui pense.
Ph. Sollers. Oui, c’est une forme qui donne forme, tout en étant très autobiographique. Il y a, à chaque fois, on le sent, un choc biographique très profond. Ça vient là pour dire : tiens, à ce moment-là, un élément de ma biographie secrète passe par là. A la limite, cela pourrait devenir interminable : pourquoi à tel moment ce Seurat ? A quoi vous a-t-il fait penser ? Vous l’avez vu quand ? Godard nous l’a dit. Vous vous en souvenez : on devrait faire un film uniquement avec des gens qui seraient là et diraient : oui, c’est machin qui connaissait truc... On s’était vus... Ça serait un fleuve interminable d’anecdotes. Ça, c’est la divinité du concret qui est évidente. Autrement, ce sont des idées qui s’incarnent avec des illustrations et qui conduisent à des massacres énormes, sans que telle ou telle biographie s’y trouve directement impliquée.
S. Toubiana. Godard se sert des images des autres, dans ses films et dans ces Histoire(s) du cinéma. Vous le faîtes aussi dans vos romans. Et surtout, vous évoquez cette espèce de marché de l’art, ce trafic d ’art généralisé, mondialisé. Le geste fondamental de Godard consiste à dire : ces images appartiennent à tout le monde, pas question de payer des droits. C’est très courageux de se mettre à dos tous les ayants droit.
Ph. Sollers. Très courageux ! Bravo ! Le trafic d’art est incessant, sous un nuage de fumée culturel. Le 20 juin, il va y avoir un procès parce que j’ai publié des extraits de la Conférence du Vieux Colombier, d’Artaud. De plus en plus, les gens ne s’intéressent pas du tout au sens. Je n’ai jamais touché un kopeck sur Artaud, je ne trafique pas les manuscrits ou les tableaux. Les gens veulent la propriété matérielle, les droits, les manuscrits. On vend des partitions de Mozart en les découpant : vous voulez l’allegro ? C’est très juste et vrai de dire que tout ce qui a été fait a été fait, par moments, pas toujours, dans un désir d’atteindre une vérité. Et par conséquent, la vérité n’a pas de prix. Les morts n’ont pas de prix.
S. Toubiana. Et on retrouve la position de sainteté de Godard : si vous voulez m’attaquer, eh bien vous attaquerez un saint du cinéma !
A. de Baecque. Et je m’intègre moi-même dans cette communauté de martyrs...
Ph. Sollers. Ce dont les gens ont le plus peur, c’est probablement de savoir à quel point le temps est infini. Ça a l’exacte pertinence de montrer à quel point chaque corps humain, dans la société qui le cerne, vit dans un temps extrêmement réduit. Alors que c’est immense. Qu’il s’en déduise un sentiment d’immensité me paraît une des grandes réussites de ces Histoire (s). Immensité intense, parce qu’on n’a jamais le sentiment de s’ennuyer.
S. Toubiana. Avec une forte érotisation généralisée du sens.
Ph. Sollers. Oui, mais l ’érotisme, c’est le sens du temps. Toute perception intense du temps est de toute façon érotique (rires). Sous telle ou telle forme : une nuit parfois suffit. Ou trente secondes. Une perception intense du temps. Là, ça y est. Il y a aussi le fait que, de temps en temps, des textes sont lus. Lire un texte, c’est toujours avec risques et périls. On n’est pas forcément, quand on lit un texte à haute voix, en train de comprendre ce qu’on lit. Surtout si c’est un poème de Baudelaire par exemple. La pauvre actrice qui lit Baudelaire pose sa voix totalement à côté, et son corps aussi. Par conséquent, le témoignage cinématographique sera qu’il y a incompatibilité totale entre l’image et le sens du son. C’est très difficile de tricher avec la poésie. Les acteurs, avec la poésie, sont récusés presque dans leur totalité : il suffit de leur faire réciter un poème.
A. de Baecque. C’est curieux que Godard ne lise pas lui même ces poèmes. Il y a des moments où lui-même lit du Victor Hugo, à d’autres moments on sent une pudeur...
Ph. Sollers. Souvent, maintenant, quand on me demande des leçons d’écriture, je laisse tomber le manuscrit qu’on me tend, et si la personne est intéressante, je lui demande de réciter un poème par cœur : j’ arrête mot par mot. La voix ne peut pas tricher. Le style de Sarah Bernhardt, qui est encore celui d’Apollinaire, si vous écoutez les enregistrements d’Apollinaire : « Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant... », et qui est encore celui d’Aragon et de Malraux, eh bien c’est aussi le XIXe siècle ! Quand on voit les images d’actualité 1900, on se dit que Proust a gagné, parce qu’on voit ces corps bouger, ils sont tous morts, on n’entend pas leurs voix, et on se dit que c’est Proust qui avait toutes leurs voix, dans leurs nuances : tantôt graves, tantôt aiguës, quand le sens change, quand on ment... Je crois beaucoup à ces choses-là : c’est mon travail de romancier de savoir comment les voix en disent plus long que I’œil sur les corps.
S. Toubiana. Ce sont aussi des voix d’avant la reproductibilité technique.
Ph. Sollers. Oui. Diogène, penseur cynique s’il en fut, dit qu’il est curieux que pour reconnaître du bronze on tape dessus, alors que pour les hommes on se contente de les regarder (rires). Il a raison : il faudrait un peu taper dessus pour voir... Il faut la voix. Que ça résonne ! Je crois que Godard s’est rendu compte de ça.
A. de Baecque. Dans les Histoire(s), ça résonne de plusieurs façons différentes, exactement comme Godard pratique des montages très différents, d’images, de bruits, de citations...
Ph. Sollers. C’est évidemment un chef-d’œuvre de montage. Il y a eu oblitération du montage pendant très longtemps. Le montage est inquiétant par définition, il n’a pas forcément bonne réputation. Or c’est là que tout se passe, il me semble. Au millimètre près. Travail de très haute précision, dont les gens n’ont pas la moindre idée. Quels sont pour vous les génies du montage ?
S. Toubiana. Eisenstein, Vertov, Hitchcock, Lang, Godard... Les cinéastes du plan : il faut pratiquer l’art du plan pour avoir un art du montage.
A. de Baecque. C’est aussi le montage qui donne la personnalité : les citations qu’utilise Godard appartiennent à tout le monde, mais sa manière de les rapprocher n’appartient qu’à lui.
Ph. Sollers. C’est symphonique.
A. de Baecque. Est-ce qu’on pourrait imaginer la même entreprise dans un livre ?
Ph. Sollers. Paradis (rires). Imaginez qu’il n’y a pas que le siècle à dire, il y a tous les siècles ! C’est très difficile, pour le cinéma, compte tenu de l’énorme quantité d’images en si peu de temps. Mais imaginez ce que peut être l’immense quantité de mots si l’on se mesure à tous les siècles. Si vous voulez être à la fois chez Héraclite, Parménide, dans la Bible, chez les Chinois, chez Joyce, Proust, Diderot ou Sade... Mon problème d’intégrale devient alors extraordinairement concentré. C’est son Paradis, en somme, que fait Godard, sa Saison en enfer. De toute façon, c’est le geste, plus ou moins ample, on peut le faire sentir par fragments, d’un artiste fondamental du XXe siècle. C’est la ressaisie, ou le recueillement, ou le faire sentir que le temps a changé de substance. Faire sentir ça. II s’agit donc de tout ce qui s’est déroulé, dans telle ou telle contrainte, linéaire, ou dans telle ou telle époque, puisque nul ne peut, ou ne pouvait, sauter par dessus son temps, comme dit Hegel. Mais justement, nous ne sommes pas dans la situation de l’esprit absolu, nous sommes dans ce faire sentir autre immaîtrisable, incontrôlable, contrairement à ce qu’ont cru, alors que c’était en train de leur péter dans la gueule, ceux qui ont fait des massacres pour ce contrôle supposé. Ils continuent, d ’ailleurs, sous d’autres formes.
Qu’appelle-t-on penser ? II y a un moment, à mon avis extraordinaire, où Heidegger cite Nietzsche pour définir l’esprit de vengeance. Qu’est-ce que l’esprit de vengeance ? C’est, dit Nietzsche, le « ressentiment de la volonté contre le temps et son "il était" ». Là-dessus, vous pouvez rester un certain nombre de mois, ou d’années, à réfléchir à toutes les implications que cela suppose. Qu’est-ce que ne pas éprouver, sans arrêt, le ressentiment de la volonté contre le temps et son « il était » ? A ce moment-là, vous n’êtes plus dans l’esprit de vengeance, mais dans la célébration absolument indéfinie du temps.
S. Toubiana. Mais le cinéma est né dans cette définition même : son handicap s’y trouve, en même temps que sa puissance.
Ph. Sollers. Voilà ! Eh bien, le geste de Godard est une tentative d’exorcisme.
S. Toubiana. Le cinéma n’est qu’un il était, en même temps qu’il affirme une volonté d’inscrire du temps qui dure.
Ph. Sollers. Oui, mais est-ce qu’il ne se venge pas ?
S. Toubiana. Ce sont les spectateurs qui se vengent du cinéma, parce qu’on ne peut pas vivre dans la fascination du spectacle sans avoir envie, à un moment où un autre. de se venger, de « donner le change », de s’en libérer.
Ph. Sollers. Manque d’amour.
S. Toubiana. D’où le mépris !
Ph. Sollers. A la place du temps retrouvé.
A. de Baecque. Vous disiez que Proust a gagné par rapport aux actualités. Alors, est-ce que Godard gagne, et par rapport à quoi ?
Ph. Sollers. Je crois que, pour employer une expression triviale, il ramasse la monnaie du cinéma. Sauf surgissement d’un chef d’œuvre de pensée et de méditation aussi fort, je ne vois pour l’instant pas d’équivalent. C’est une question de pensée : au lieu où il se place, d’habitude il n’y a personne pour penser. Il le pense, donc il ramasse. Je pense ce qu’il y a à penser quand personne ne pense, donc j’ai raison. Avant d’être rejoint là où il est... (rires). Autant essayer de rejoindre Proust, par exemple, c’est très compliqué...
A. de Baecque. Vous parliez du ici et maintenant de notre séance de visionnement, le 28 mars dernier. Or, nous risquons d’être très peu à les voir, ces Histoire(s) du cinéma...
Ph. Sollers. Ce n’est pas grave : ça a eu lieu ! Nous étions dans un appartement, les rideaux tirés, Godard nous montrait ses cassettes... C’est le geste de penser qui compte, à la limite, personne n’en aurait connaissance que ça aurait eu lieu quand même. Une fois que c’est pensé, chose étrange, inouïe, c’est comme si tout le monde était au courant. Tant pis pour ceux qui ne s’en rendent pas compte, mais il devrait le penser par eux-mêmes. savoir que quelque chose comme ces histoires devait exister quelque part. S’ils pensent par eux-mêmes, avec leurs moyens, sur d’autres sujets... Il me semble que quelqu’un qui pense approuve automatiquement le geste de Godard, se retrouve chez lui.
A. de Baecque. En sortant de cette séance de visionnement, vous avez dit à Godard cette phrase : tu m ’as fait gagner du temps.
Ph. Sollers. C’est ce que je voulais dire. Quand on pense, on gagne du temps, et quand on ne pense pas on en perd énormément. A la recherche du temps perdu : là c’est du temps retrouvé. Ce qui suppose un investissement de mémoire, une information gigantesque, un filtre pour retenir tel ou tel détail. tel plan, tel enchaînement dans tel film. Cela suppose un travail considérable...
S. Toubiana. Et aucune faute de goût !
Ph. Sollers. Voilà ! Appelons goût, le filtre des filtres qui, à partir d’un travail considérable sur un ensemble de détails quasiment infinis, va faire que vous choisissez tel plan ou telle séquence. C’est pour ça que les citations, quand elles sont vraiment, exactement là où il faut, sont beaucoup plus que des citations. C’est du vivant qui prouve du vivant. Le problème, c’est qu’il ne faut pas être en défaut lorsqu’arrive la citation... Je reçois des textes d’universitaires, on ne fait que lire les citations, c’est tellement plus simple ! En général, ils ont fait un petit effort, ils ont découpé mais vous pouvez vous passer de ce qu’ils disent. C’est le cas des philosophes aujourd’hui. Pas comme chez Montaigne ! C’est un très grand art, la citation, il faut que le corps qui est là, vivant, soit à la mesure de tout ce qu’il cite. Et que ça respire en même temps. Quelqu’un m’a dit à propos de Studio : Rimbaud arrive là naturellement... Plus grand compliment je n’attends pas ! Si Rimbaud arrive comme ça, dans la foulée, ça va...(rires). Si Manet arrive dans la foulée, c’est fort !
A. de Baecque. Il y a une masse énorme dans ces Histoire(s), mais beaucoup de choses reviennent souvent, comme si Godard fonctionnait dans son atelier, dans son petit studio...
Ph. Sollers. Studio (rires) ! Il suffit que quelqu’un se mette à penser, avec très peu de moyens, très simplement — ce qui prouve que penser est un art — pour que ça vienne et que ça demande à s’orchestrer. C’est la puissance de la logique, si elle est vraiment fondamentale. Un musicien fait ça, Stravinski a fait ça, Joyce aussi.
S. Toubiana. Contrairement à ce que vous dites, Godard utilise beaucoup de moyens technologiques, mais il les domine.
Ph. Sollers. C’est la méditation qui l’emporte, la cogitation incessante. La technique s’adapte à la « visionnarité » : il voit tout le temps, et ensuite il met en œuvre.
S. Toubiana. C’est un voyant proliférant.
Ph. Sollers. Mais ce n’est pas contradictoire que ce soit si proliférant et que ça tienne sur quelques pilotis. Il faut simplement des convictions, qui sautent aux yeux et à l’oreille. La mise en place du narrateur : le micro, le tac tac de la machine à écrire, la lumière, les livres. Voilà une attitude liturgique. Ou alors la position debout, avec le livret, comme un chef d’orchestre : j’appelle les haut-bois, les trompettes... J’appelle les morts, les voix, les plans, tout ça c’est pareil. C’est une messe, pour ce protestant c’est bien... C’est sa Missa solemnis (rires). C’est une grande messe solennelle, il y a tout le monde, tous les morts, tous les saints, tous les martyrs...
A. de Baecque. C’est extrêmement baroque, ce n’est pas du tout protestant ...
Ph. Sollers. Mais je lui donne ma bénédiction apostolique (rires) : Amen ! Pasolini est quand même très présent, avec L’Évangile selon saint Matthieu, avec cette voix forcenée qui vous dit qu’il ne faut pas prier, sauf dans le secret. C’est une position ascétique de moine artisanal, c’est la tentation de saint Godard : le cinéma se présente comme une énorme fantasmagorie dont il s’agit de dégager l’essence. C’est inspiré, quoi ! Il faut être bien seul pour faire ce travail ! Mais si on est habité, il faut aller jusqu’au bout.
Entretien réalisé à Paris le 8 avril 1997.

Histoire du cinéma 2a (avec Serge Daney).

Serge Daney. Tu fais l’histoire du cinéma au moment où il est clair pour toi que cette recherche n’a pas abouti, ou qu’elle est finie, et que les enseignements qu’elle aurait pu avoir sur la vie des gens, des peuples, des cultures n’ont pas été tirés. Quand tu étais plus didactique, quand tu croyais davantage à la transmission des choses, de manière plus militante, je me disais que tu essayais toujours de remettre l’acquis qu’on peut avoir à travers un film dans la vie des gens, et même que tu l’imposais de façon très dure. Maintenant, tu dirais qu’il est impossible d’en faire quelque chose même si le cinéma a essayé de le faire. Donc, est-ce seulement l’histoire d’un échec, ou est-ce un échec tellement grandiose que ça vaut encore le coup de le raconter ?
Jean-Luc Godard. Le bonheur n’a pas d’histoire...
S. Daney. Si tu regardes un film de Vertov aujourd’hui : il y avait chez lui des hypothèses très originales, qui ont fait de lui un cinéaste très minoritaire. Admettons que cela a été recouvert par Staline...
J-L. Godard. Même par Eisenstein. Mais leurs disputes étaient très saines. Le problème venait plutôt de ceux qui l’ont raconté : le langage, la presse. On n’est pas guéri de cette langue, sauf lorsqu’on parle quand on est très malade, et que l’on doit voir un bon analyste (et il y en a peu, de même qu’il y a peu de bons savants). Le fait que mon père était docteur m’a probablement inconsciemment mené à ça : dire d’une maladie que c’est une sinusite, c’est déjà du montage. Le cinéma indique que quelque chose est possible si on se donne du mal pour appeler les choses par leur nom. Et le cinéma, c’était une nouvelle manière, vaste et populaire, d’appeler les choses par leur nom. [...].
S. Daney. Je reprends cet exemple de Vertov. Il y a quelque chose dans le cinéma qui a essayé d’être vu, qui a été visible, puis qui a été recouvert. Mais les films, eux, restent : il est possible de regarder une cassette d’un film de Vertov. La chose qu’il fallait voir à travers Vertov a été recouverte, mais il reste quand même l’objet, qui survit à toutes les lectures, à toutes les non-lectures. Mais toi, que ressens-tu devant cet objet : de l’admiration, de la tristesse, de la mélancolie ? Est-ce que tu te dis que tout cela est beau ?
J-L. Godard. Le cinéma est un art, et la science est aussi un art. C’est ce que je dis dans mes Histoire(s) du cinéma. Au XIXe siècle, la technique est née, dans un sens opératoire, et non artistique (pas au niveau du mouvement de montre d’un petit horloger du Jura, mais de cent vingt millions de Swatch). Or Flaubert raconte que cette naissance de la technique (les télécommunications, les sémaphores) est simultanée à la bêtise, celle de Madame Bovary.
La science est devenue de la culture, donc autre chose. Le cinéma, qui était un art populaire, a donné naissance à la télévision, et cela à cause de sa popularité, mais aussi du développement de la science. Or, la télévision, c’est de la culture, c’est-à-dire du commerce, de la transmission, pas de l’art. Ce que les Occidentaux appelaient l’art est un peu perdu. Mon hypothèse de travail par rapport à l’histoire du cinéma, c’est que le cinéma est le dernier chapitre de l’histoire de l’art d’un certain type de civilisation indo-européenne. Les autres civilisations n’ont pas eu d’art (cela ne veut pas dire qu’elles n’ont pas créé), elles n’avaient pas cette idée d’art liée au christianisme, à un seul dieu. Ce n’est pas étonnant qu’on parle beaucoup de l’Europe aujourd’hui : c’est parce qu’elle a disparu, donc, il faut créer un ersatz, comme disaient les Allemands pendant la guerre. On a eu beaucoup de mal à démembrer l’empire de Charlemagne, et on le refait ... Mais cela ne concerne que l’Europe centrale ; le reste, comme la Grèce, n’existe pas.
Donc, le cinéma, c’est de l’art pour nous. On s’est d’ailleurs toujours disputé avec Hollywood, à qui on leur reprochait de ne pas se comporter comme Durand-Ruel ou Ambroise Vollard avec Cézanne, ou Théo Van Gogh avec son frère. On lui reprochait d’avoir un point de vue uniquement commercial, de type culturel et non artistique. Seule la Nouvelle Vague a dit que le cinéma américain, c’était de l’art. Bazin admettait que L’Ombre d’un doute était un bon Hitchcock, mais pas Notorious. En tant que vrai social-démocrate, il trouvait abject que sur un sujet aussi « nul » , on puisse faire une mise en scène aussi merveilleuse. Oui, seule la Nouvelle Vague a reconnu de l’art dans certains objets qui sont détournés de leur sujet par les grandes compagnies. On sait d’ailleurs, historiquement, qu’à un moment, ces grandes compagnies, comme les grands féodaux, ont pris du pouvoir sur les grands poètes. Comme si François 1er avait dit à Léonard de Vinci, ou Jules II à Michel Ange : « Vous peignez l’aile de l’ange de cette façon, et pas d’une autre ! » C’est un peu le rapport qu’il a dû y avoir entre Stroheim et Thalberg.
Pour moi, l’art, c’est de la science, ou la science, c’est de l’art. Je ne pense pas que Picasso soit supérieur ou inférieur à Vésale, ils sont égaux dans leur désir. Un docteur qui parvient à soigner une sinusite, c’est du même ordre que si j’arrive à faire un beau plan avec Maruschka Detmers. Il ne faut pas faire trop de livres sur la science. Einstein a écrit trois lignes, on ne peut pas écrire beaucoup sur lui. Et c’est bien que la langue ne s’en mêle pas. J’aime beaucoup La Nature dans la physique moderne, où ce qu’Eisenberg dit, ce n’est pas ce qu’il a vu. Il y a un grand combat entre les yeux et la langue. Freud a essayé de voir cela d’une autre manière ...
S. Daney. Essayons de résumer. Premièrement, le cinéma est un art, et le dernier chapitre de l’histoire de l’idée de l’art en Occident. Deuxièmement, ce qui est important dans le cinéma, c’est qu’il donne des informations sur ce que les gens pouvaient voir.
J-L. Godard. Oui, et de manière agréable : en racontant des histoires. Le cinéma était aussi un lien vers d’autres civilisations. Un film de Lubitsch raconte ce que tu peux lire dans Les Mille et Une Nuits. Les autres formes d’art n’avaient pas cet aspect-là, elles étaient strictement européennes. Puis, sous l’influence du cinéma, les choses ont pu changer. Ainsi, la période nègre de Picasso est venue à l’époque du cinéma. Elle n’est pas motivée par le colonialisme, mais par le cinéma. Delacroix, qui vivait au temps du colonialisme, n’a pas été influencé par l’art nègre et arabe comme Picasso. Le cinéma appartient au visuel, et on ne lui a pas laissé trouver sa propre parole, qui ne vienne pas de L’Événement du jeudi... Mallarmé a certainement parlé de la page blanche en sortant d’un film de Feuillade, et je dirai même lequel : Erreur tragique. C’est ce que trouverait un juge d’instruction s’il recherchait ce que Mallarmé a fait le jour où il a écrit ce texte [5]...
S. Daney. Le cinéma a aussi créé ce sentiment d’appartenance au monde et même à la planète, qui est en train de disparaître avec la communication. Moi, quand j’allais au cinéma, j’étais pris en charge un peu comme un orphelin du social ; le film (grâce au montage, au récit) me prélevait du social avant de m’y remettre. Cela a changé avec la télévision, et en général avec les médias, qui ont une importance de plus en plus grande. Devant ma télévision, tard le soir, je vois par exemple des informations qui évoquent des événements très prenants, très réels. Or le sentiment n’est pas le même : je ne suis pas pris en tant que sujet, mais en tant qu’adulte impuissant, avec un vague sentiment de compassion, lié à la communication moderne, qui fait qu’on est triste d"être impuissant. C’est là qu’on voit que le cinéma, lui, nous avait adoptés en nous donnant un monde supplémentaire, qui pouvait faire la liaison entre la culture qui avait le monopole de la perception et le monde à percevoir. [ ...]
J-L. Godard. L’échec dont tu parles, ce n’est pas l’échec du cinéma, c’est l’échec de ses parents. C’est aussi pour cette raison qu’il a été tellement populaire. Tout le monde peut aimer un Van Gogh, comme Les Corbeaux, mais le cinéma permet de le diffuser partout, et sous une forme moins terrible. C’est ce qui fait que tout le monde a aimé le cinéma et s’en est senti si proche. En fait, le cinéma, c’est la terre, puis la télévision, c’est l’invention de la charrue. La charrue est mauvaise si on ne sait pas s’en servir. L’échec, je le sens surtout quand je pense : « Ah ! si on nous laissait faire... ». C’est d’ailleurs ce que pensent beaucoup de cinéastes. L’échec, c’est que les points cardinaux du cinéma se sont perdus : il y avait l’Est et l’Ouest, et l’Europe centrale. Il n’y a pas de cinéma égyptien, même s’il y a des films magnifiques, c’est pareil pour le cinéma suédois. Il n’y a plus de grand axe, alors que le cinéma, c’est fait pour étaler, pour mettre à plat, c’est comme un dossier qu’on ouvre. C’est proche du roman, dans la mesure où les choses se suivent, mais le visuel fait qu’il y a le poids d’une page, et le poids d’une autre page. Il y aussi le sens : il faut les quatre points cardinaux. Or, la télévision se rabat sur l’Est et l’Ouest, mais ne fait pas le Nord et le Sud. La télévision, ne serait-ce que d’une manière bête, doit jouer sur le temps, c’est son rôle. [...]
La Nouvelle Vague a été exceptionnelle dans le sens où, après Langlois, elle a cru à ce qu’elle voyait. C’est tout.
S. Daney. Mais la Nouvelle Vague est la seule génération qui a commencé à faire du cinéma au moment où est arrivée la télévision. Donc elle appartient déjà aux deux mondes. D’ailleurs, Rossellini, qui a joué un rôle très important pour la Nouvelle Vague, a lui-même franchi le pas plus tard.
J-L. Godard. L’histoire de Rossellini, c’est la même que celle du Christ... C’est pareil pour Renoir, qui a filmé Le Docteur Cordelier à l’époque où Claude Barma faisait ses dramatiques. On a été subjugué par le travail de Renoir, alors qu’on incendiait Claude Barma...
S. Daney. Ce double héritage de la télévision est très intéressant. La télévision française s’est construite en grande partie sur la continuation du cinéma de qualité française, la dramatique. Et en même temps, dans les années 50, certains grands cinéastes comme Rossellini, ou même comme Bresson ou Tati, qui n’ont pas forcément travaillé pour la télévision, anticipaient sur le dispositif de la télévision, en voyant qu’ils pouvaient obtenir d’autres effets de grande amplitude avec une mémoire du cinéma, c’est-à-dire un film. Vous étiez critiques, puis cinéastes à ce moment-là, et vous avez hésité entre les deux. Il n’y a jamais eu de discours anti-télévision de la part de cinéastes comme Welles, Hitchcock ou Tati. Il y a donc eu une sorte d’inceste heureux au début, qui est devenu ensuite malheureux.
J-L. Godard. Pour reprendre l’image de la terre et de la charrue, disons qu’ils étaient à la fois l’âne et le bœuf... Il ne faut pas confondre le terrain et l’outil : la télévision n’est pas un terrain, elle est un outil. A partir du moment où l’outil devient le terrain, on aboutit au sida... Je pense qu’on ne veut pas guérir, on ne veut pas voir, on améliorera. mais on ne guérira pas de sitôt... Quand François Jacob examine des lymphocytes. des antigènes, des anticorps, s’il ne fait pas la même mise en relation que celle qu’il fait, grâce aux quatre cents ans d’intervalle, avec Yésale et Copernic, il ne voit pas. Dans ce cas, il devrait regarder Chandler, ou même John Le Carré, et surtout les premiers romans de Peter Cheney : il verrait le travail de la cellule, de l’espion, du code. Ce sont les mêmes mots. Moi, je ne suis pas capable d"aller plus loin, je dis juste que c’est là qu’il faut voir, et qu’avec leur génie d’individus, ils peuvent trouver un début de vaccin. Pour cela, il faut faire du cinéma, mais quand ils y vont, ils aiment L’Eté meurtrier, que veux-tu... La télévision est quelque chose de faramineux, à cause de sa popularité. Le cinéma, le roman, la peinture d’inspiration européenne ont fait une partie des choses qu’ils pouvaient faire : l’enfant a grandi. Alors que la télévision ne l’a quasiment pas fait ; et vu son universalisme et sa popularité, c’est une catastrophe à l’échelon mondial.
S. Daney. C’est le passage de quelque chose qui pouvait être universel à quelque chose qui est redevenu villageois... Là, en Suisse, si on allume la télévision, on voit ce qui se passe dans le « village suisse » , mais on sait que c’est aussi ce qui se passe dans le « village italien » d’à côté. Chacun a ses rites, ses mâts de cocagne... On a le sentiment d’un agrandissement énorme du terrain et d’une toute petite charrue, qui va toujours dans le même sens. Alors que le cinéma avait un terrain qui n’était pas complet, un terrain d’explorateur, où ce qui avait été découvert l’avait été personnellement....
J-L. Godard. Pour moi, cela s’est clarifié quand je me suis aperçu, après un certain nombre d’années, que l’on n’avait pas montré les camps de concentration. On en avait parlé, mais on ne les avait pas montrés. C’est aussi peut-être à cause de ma classe, de ma culpabilité, que je me suis intéressé à ça... C’est cela qui m’a montré, par exemple, que la Nouvelle Vague n’était pas un début, mais une fin.
S. Daney. Si le cinéma a pu explorer et montrer tant, n’est-ce pas à cause de ces événements inédits dans l’histoire de l’humanité : les deux grandes guerres mondiales et les camps ? La Première Guerre mondiale a tout de suite puissamment modifié le langage du cinéma. Je pense à Gance, à Griffith, à Vidor, à Raymond Bernard, ou à Renoir qui a fait cette guerre en tant que cavalier... La perception du monde a été retournée comme les champs, comme les tranchées.
J-L. Godard. Puis, il y a eu deux sursauts : le Néo-réalisme italien et la Nouvelle Vague.
S. Daney. Oui, et je pense que Fassbinder clôt ce sursaut, en essayant de reconstituer quelque chose qui n’avait pas eu d’image, l’Allemagne de l’après-guerre. [...] C’est quoi, aujourd’hui, avoir besoin d’une image, dans ce paysage audiovisuel qui se dessine, avec la société qui a changé ?
J-L. Godard. C’est une question que je me pose souvent, quand j’essaie de montrer des images, des pictures comme disent les Américains. J’essaie de trouver des réponses, en cherchant à savoir quelle était la question à ces réponses qui ont été données.
Il ne faut pas confondre le besoin et le désir. A la fin du XIXe siècle, l’individu s’est senti une identité, ce n’était plus le peuple dont parle Malraux, celui qui écoutait Saint-Bernard. On se reconnaît : si je vois une image de toi, je ne dis pas que c’est une image de Toubiana. Dans cette reconnaissance, il y a aussi le point de vue guerrier, de l’éclaireur, comme Davy Crockett dans le film de John Ford : on est reconnaissant au monde de nous reconnaître et de nous permettre de se reconnaître.
Jusqu’aux camps, le cinéma a été les identités des nations, des peuples. Après, il a un peu disparu. J’examine cela dans l’émission 3B, qui s’appelle La Réponse des ténèbres, qui parle des films de guerre. Elle dit en gros que le cinéma est un art occidental, fait par des garçons blancs. Anne Marie [Miéville, nde] a aimé le cinéma avant moi, à un moment où le cinéma était interdit par sa famille, car il était considéré comme quelque chose de basse qualité. Or, quand elle y allait, elle n’avait droit qu’aux westerns. A part Jeff Chandler qui la faisait rire et qu’elle aimait bien, elle ne supportait pas, et même encore aujourd’hui, tous ces types à cheval. Les Américains ont envahi le monde par le cinéma, puis ils ont envahi plus ou moins amicalement selon d ’autres procédés. Aujourd’hui, ce sont eux qui racontent la guerre du Vietnam, et pas les Chinois, ni les Vietnamiens. La Guerre de 1914 a aussi été surtout racontée par les Américains. Il y a aussi beaucoup à dire sur le désir qu’ont les anciens Européens par rapport aux nouveaux Européens de garder des liens et de se prosterner, de soutenir le dollar quand il est faible, de l’aider à baisser quand il est trop fort... Il n’y a personne d’autre que nous, les Cahiers, qui ait vraiment aimé le cinéma américain. Qu’est-ce qui fait que dans les années 40 il n’y ait pas eu de cinéma de résistance ? Il y a eu des films de résistance, ici ou là, mais le seul cinéma qui ait résisté à l’occupation du cinéma par des moyens standardisés, c’est le cinéma italien. C’est un pays qui avait perdu son identité. L’Italie est repartie après Rome, ville ouverte. Benedetti devrait acheter des tonnes de Canigou aux descendants des chiens de Rossellini...
Les Russes ont fait des films de propagande, les Américains ont fait des films de publicité, les Anglais ont fait leur cinéma habituel, l’Allemagne n’a pas su le faire pour elle, les Français n’ont fait que des films de prisonniers comme La Bataille du Rail, les Polonais ont essayé deux fois de faire des films sur les camps : La Passagère et Dernière Etape. Mais c’était des tentatives individuelles, ce n’était pas la démarche d’une nation. Or en Italie, le cinéma a représenté la possibilité de faire partie d’une nation, et d’être soi-même à l’intérieur de cette nation. Puis, cela a disparu.
Si on aime encore cette idée du cinéma à la télévision, c’est qu’il reste un souvenir de cela, c’est comme lorsque les Grecs aiment écouter les histoires de Zeus. On n’a plus notre identité, mais lorsqu’on allume la télévision, il y a un vague petit signal que peut-être on en a encore une. Puis, les films disparaîtront de la télévision.
S. Daney. L’Amérique est un pays à part, qui continue à faire des films en renouvelant très peu les modes d e récit et les formes. C’est un cinéma très formaté une fois pour toutes, depuis le début du parlant.
J-L. Godard. L’Amérique n’a pas d’histoire au même sens que la Chine, la Perse ou l’Egypte. Par contre, elle est remplie de milliers de petites histoires et tout à coup, par le biais inconscient de la Première Guerre mondiale, puis très conscient de la Deuxième, elle s’est emparée du cinéma le plus puissant du monde, qui était le cinéma français. Elle s’en est emparé comme un propriétaire s’empare d’une maison parce que le locataire est mort à la guerre.
S. Daney. La spécificité du cinéma américain n’est pas seulement liée à l’identité. Tout le monde se pose cette question, les Japonais se la posent beaucoup en ce moment, et ils abandonnent leur cinéma. Chez les Américains, ce qui fonctionne, c’est aussi l’idée de l’origine : l’Europe, un passage de la Bible, un scénario puritain, une certaine forme de récit... Le cinéma permet de vérifier si cela marche toujours. Cette idée des origines fonctionne d’ailleurs encore à la télévision. Mais l’Europe était trop vieille pour dire d’où elle venait, et pas assez forte pour dire ce qu’elle pouvait inventer de son côté.
Qu’impliquent comme besoin d’image l’individualisme, ou les conquêtes sociales ? Qu’est-ce qu’un individu attend d’images qui ne seraient pas, comme les images publicitaires, des images qui servent à en cacher d’autres, mais qui ouvriraient sur autre chose ? Cet individu ne serait plus esclave de la salle de cinéma, mais il serait un peu comme toi aujourd’hui : il pourrait prendre des cassettes, découper des photos, se servir de la vidéo, et se faire tout seul son cinéma. Après tout, tu n’es, parmi les individus qui cautionnent les images, que celui qui a la meilleure mémoire de ce qu’a été le cinéma, mais pas celui d’aujourd’hui. Nous en sommes tous là : que faire avec les images, puisqu’on a tendance à les consommer seul et à les faire servir à des buts personnels ?
J-L. Godard. On en revient au montage : on emploie le mot image, mais ce n’en sont plus. Il n’y a plus que des rapports. Les Américains, qui sont plus pragmatiques, utilisent cette force.
Une image n’est jamais seule, elle en appelle une autre. Or, aujourd’hui, ce qu’on appelle les images, ce sont des ensembles de solitude reliés par du dire qui est, au pire, celui d’Hitler, et qui n’arrive jamais à être celui de Dolto, de Freud, de Wittgenstein. Les Impressionnistes (qui sont d’ailleurs très peu aimés, peu de gens ont chez eux des reproductions de Monet, ou d’un pot de fleurs de Renoir) ont eu une vision, et le cinéma est d’ailleurs né techniquement à peu près à la même époque. Avant, il n’y avait pas une aussi grande différence qu’aujourd’hui entre un aveugle et quelqu’un qui voyait. J’ai toujours dit que pour continuer à faire des films, je préférerais perdre mes yeux que perdre mes mains [...]
Les Américains disent pictures pour les images et pour les photographies, alors que pour les films, ils disent movie. Ils ont gardé la notion de mouvement, ils sont plus justes. Et pour la télévision, ils disent net work, c’est la toile d’araignée... Dans tous les grands films qu’on a vus depuis cent ans, les difficultés dans le travail étaient l’élément-moteur du scénario. C’est d’ailleurs encore le cas dans leurs séries, comme Starsky et Hutch : c’est un détective au travail. Les gens ont toujours voulu montrer le travail, et en même temps, ils en souffrent. Maintenant, ils n’aiment plus leur travail. Avant, ils l’aimaient, ce qu’ils n’aimaient pas, c’était d’être si peu payés. Tu retrouves cela dans les endroits les plus défavorisés : un chauffeur de bus aime son bus, ce qu’il n’aime pas ce sont les conditions de travail. Sur le fond, il ne se considère pas inférieur à Picasso. Le fait qu’on ne montre plus le travail fait qu’il n’y plus de travail. On demande à l’image de travailler « à l’oeil », pas à la parole. Le français est intéressant pour ces tours de passe-passe... On pourrait dire « travailler à la main » ... « Travailler à l’oeil » veut dire ne pas travailler. L’identité est dans l’embryon... On n’attend plus de représentations du réel, et du coup, on ne l’attend plus de soi-même, et on veut des figures au sens où les patineurs font des figures.
S. Daney. C’est ce qu’on disait allègrement dans les années 70 : à bas la représentation, politique et artistique. Mais dans le cinéma dont tu fais l’histoire aujourd’hui, on était représenté sur l’écran, on pouvait être pris en otage par le film, puis restitué au monde, enrichi. Mais c’était très lié à la peur d’être pris, puis d’être relâché, et c’était aussi très lié au sujet. Les gens se faisaient eux-mêmes une sorte de psychanalyse sauvage en voyant des films. Mais ce n’était pas une représentation faite en notre absence, contrairement à ce qu’on a trop dit. On avait fait un pas de côté, et on se regardait soi-même. C’est là qu’il y a eu ce dédoublement du cinéma moderne, qui a aussi donné des impasses, de véritables folies. On se posait en effet ces questions : est-ce que je suis bien pris en otage ? est ce que les procédures sont bonnes ? est-ce que je vais quelque part ? On a moralisé la perception de la façon dont on était représenté par les films. Souvent d’ailleurs, ils ne pouvaient pas fonctionner sans nous. C’est Hitchcock qui faisait cela le mieux. Puis on est passé vers un autre système, dont les technocrates parlent avec une grande candeur et une grande joie, car ça leur ouvre les portes d’on ne sait quel paradis : la participation. On part du principe qu’on a un rapport interactif avec l’image, donc qu’elle n’a plus à nous représenter, qu’on n’a plus à la surveiller, ni à voir si elle travaille le réel. On n’est alors plus dans une période de guerre et de peur, mais plutôt de paix (avec le monde de la télévision) et d’angoisse, et je suis visé en tant qu’individu, dans le meilleur des cas, en tant que citoyen. Quand on réfléchit à l’image numérique, à l’image de synthèse, on a le drôle de sentiment que les images peuvent s’autogénérer les unes et les autres grâce à des programmes (comme la scissiparité, c’est-à-dire qu’au lieu de faire un film comme un enfant, suite à un acte sexuel, d’amour, l’image se dédoublerait comme un clone). C’est un monde de plus en plus synthétique, comme si on avait prélevé des figures sur le monde qui les environnait, comme si on avait constaté que la caméra enregistrait non seulement les figures, mais aussi ce qu’il y avait autour. Il est vrai que certains cinéastes avaient travaillé comment aller du détail à l’ensemble. Aujourd’hui, il semble que le seul but est d ’avoir des images qui travaillent toutes seules, et qui travaillent comme dans un numéro de trapèze : dans le vide, à vide, in vitro. On ne veut plus de l’environnement. Or l’environnement, c’est notre rapport aux autres, mais aussi au reste du monde. C’est pour cela qu’il est devenu si tribal : la télévision ne s’occupe pas du reste du monde, elle n’en donne que quelques documents.
En fait, ce qui me frappe, c’est que le cinéma moderne a prélevé la figure humaine, en avertissant le spectateur qu’elle avait été détruite, et qu’il ne s’agissait pas de la refigurer en montrant des héros superbes qui sortaient des camps. Là, il y avait eu une atteinte physique à l’essence humaine ; on l’a su très tôt, on l’a digéré très tard, et même pas complètement. On est aujourd’hui dans une période où le cinéma ne peut plus rendre compte de l’environnement, il aura donc beaucoup de mal à travailler la question qui semble pourtant intéresser tous les hommes de pouvoir, les publicitaires, les gens de communication et de médias : maintenant qu’on a des petits personnages synthétiques qu’on a prélevés, dans quel environnement va-t-on les mettre ? Or, il n ’y en a pas pour le moment... C’est la raison pour laquelle des films comme L’Ours ou Le Grand Bleu ont eu un tel succès : ils racontent l’histoire de petits spécimens individués dans un paysage beaucoup trop grand pour eux. La publicité, qu’on a surtout critiquée pour des raisons morales un peu courtes, a certainement joué un grand rôle dans ce sens : elle nous a habitués à ne plus voir qu’un personnage, qu’un corps, à la fois. Ce qu’il vendait, du déodorant ou des Marlboro, n’avait en fait aucune importance. L’essentiel, c’était qu’on ne voyait qu’un individu dans un non-environnement : un peu d’azur, une piscine... La question de refaire l’environnement est très importante, car on ne sait pas dans quel monde l’individu moderne va habiter. Pour le moment, il est tout seul, et il a une figure qui est beaucoup plus proche de celle des expériences de L’Ile du Docteur Moreau, ou de Frankenstein. On ne sait pas très bien comment ça marche, et on applique le mime sur un animal voisin de l’homme, sur un mammifère qui est l’ours. On veut apprendre à l’homme à quoi il ressemble en regardant à côté une bête qui se dresse comme lui. On cherche à lui dire que son histoire ressemble à celle-là, mais on n’en est pas vraiment sûr. C’est ce doute qui amène Jean-Jacques Annaud, assez crapuleusement d’ailleurs, à jouer aussi bien le réalisme que le trucage. Pour moi, c’est tragique de voir comment, lorsque les questions de montage ne se posent plus, c’est la question de la figure, pas forcément humaine, qui se pose. Si cela est un peu vrai, on comprend pourquoi tu t’intéresses à l’histoire du cinéma, car le cinéma ne s’est pas intéressé à cela. Il a simplement, au moment du parlant, joué un jeu qui lui a gravement pété à la gueule par la suite, en flirtant avec les propagandes qui créaient des spécimens de surhommes. Ça a avorté, et ensuite tout le cinéma moderne a été une tentative pour ne pas réconcilier trop vite, pour reprendre le titre du film magnifique de Jean-Marie [Straub]. Aujourd’hui, c’est « Nuit et brouillard non-réconciliés ». Mais une voix très diffuse, un peu cynique et angoissée dit qu’il y a une réconciliation, on ne sait pas entre quoi et quoi. On ne veut plus s’embarrasser avec l’enregistrement du monde, mais on veut faire travailler pour nous des figures qui ne viendront plus de la perception, mais du monde mental de nos besoins commer ciaux.
J-L. Godard. On peut essayer d’apporter d’autres figures ; au patinage, il y a les figures libres et les figures imposées... Regarde les matches à la télévision, j’aime bien le tennis, le football, il y a hélas trop peu de hand-ball et de volley-ball, trop peu de matches féminins aussi ... Mais c’est une des rares choses, avec les films, qui fassent les plus fortes audiences de la télé parce que les gens communiquent en suivant des règles, ou en les transgressant. Il y a donc à la fois droit, devoir, désir, jeu et travail, car ce sont des professionnels. On ne voit jamais d’amateurs à la télévision. Eh bien nous, nous continuerons à faire des films d’amateurs, avec des figures d’amateurs et d’autres figures... Quand tu regardes un dessin de Matisse et un autre de Giotto, c’est presque le même, et pourtant, ça n’a pas empêché Matisse de peindre toute sa vie. [...]
S. Daney. J’aimerais que tu décrives ces dossiers impeccables, de couleurs différentes, qui sont devant toi. C’est ta batterie de guerre pour faire ton histoire du cinéma ?
J-L. Godard. Oui, ce sont des classements, des sous-classements. Avant, je m’étais dit que je devais lire la Vie de Littré, et ensuite celle de Cuvier... Pour voir comment l’idée de classement leur était venue à un moment donné. C’est aussi un peu le moment où Marx a inventé la notion de lutte des classes. Donc mon histoire du cinéma s’appelle d’abord Toutes les histoires, ce sont des tas de petites histoires où on peut voir des signes. Puis, c’est Une histoire seule, car c’est la seule histoire qu’il y ait jamais eue, et tu connais mon ambition : j’en déduis que c’est la seule histoire qu’il y ait eue, qu’il y aura, et qu’il ne peut pas y en avoir d’autre. C’est mon côté curé de campagne. Puis, il y a des études ponctuelles, des coupes, comme Fatale beauté, qui part du souvenir du film de Siodmak, Beauté fatale, avec Ava Gardner, d’après Le Joueur de Dostoïevski. C’est sur le fait que ce sont surtout des garçons qui ont filmé des filles, et que cela a aussi été fatal à cette histoire, au fait même qu’on veut raconter des histoires. Puis, il y a une étude plus pratique que j’ai appelée la Monnaie de l’absolu, d’après le titre d’un livre de Malraux sur l’art. C’est une analyse de la critique, car ça n’avait jamais été fait. Moi, j’ai toujours fait ce qui n’est pas fait. C’était même systématique à u n moment : Rivette a fait ça, Rohmer a fait ça, Chabrol a fait ça, eh bien alors moi, je fais ce qu’ils n’ont pas fait. Comme ça, on couvrira le terrain. Je suis resté ,très sartrien de ce point de vue-là : l’homme est ce qu’il fait, ce qu’on a fait de lui. Ce sont des critiques visuelles, j’ai voulu améliorer ce que j’avais déjà fait dans une émission. On prend par exemple la guerre : voici comment un cinéaste estimable comme Kubrick montre la guerre, voici comment un documentariste cubain montre la même guerre, voici deux cinémas. Là, je pense que je vais prendre Quatorze juillet, lire trois de tes phrases sur ce film, et voir comment tu peux dire ça ? Peut-on décrire de cette manière ? Non, là je dirai : le mal absolu est passé sur Serge le temps d’un coup d’aile !
Puis, La Réponse des ténèbres montre pourquoi c’est l’Italie qui a fait le seul film de résistance.
Ensuite, Montage, mon beau souci repart d’un article à moi, dont je ne comprends plus grand-chose aujourd’hui : c’est l’idée que le cinéma aurait dû réussir quelque chose. La peinture a réussi à un moment la perspective, Bach a réussi un certain nombre de choses en musique, le roman a réussi certaines choses, mais le cinéma, lui, aurait dû et n’a pas pu, à cause de l’application de l’invention du parlant. Quand on voit Papa d’un jour, d’Harry Langdon, on en voit des traces : on pouvait faire un film d’une heure sur « mettre un bébé dans une poussette ». Ce serait impensable aujourd’hui.
La dernière partie, Les signes parmi nous, montre que le cinéma est une image d’image d’image d’image... qui représente une grande partie de l’humanité, et qu’on aurait pu y trouver beaucoup de solutions. Si on filme un embouteillage à Paris et qu’on sait le voir (François Jacob et moi, par exemple), on peut trouver un vaccin contre le sida. Car le cinéma montre en grand. C’est comme le roman de Ramuz, que j’ai toujours eu envie de faire, qui raconte l’histoire d’un colporteur qui arrive dans un petit village et qui annonce la fin du monde. Il y a un terrible orage de cinq jours, puis le soleil revient, et le colporteur est foutu à la porte. Le cinéma, c’est ce colporteur.
S. Daney. Qu’y-a-t-il dans chaque chemise ? Des photos ?
J-L. Godard. Oui, des photos qui ne peuvent être que des photos de cinéma. Il y a aussi des sous-dossiers qui les préparent. Le cinéma a été seul, et seul le cinéma a été ça. Il y aussi des bouts de films, qui sont des citations, mais pas nécessairement. Il faut ramener la photo à son caractère individuel : il ne faut pas trop mettre de texte, car vu ce qu’est devenue la télévision, ça prend trop de pouvoir. Tu en dis beaucoup trop. La photo n’existe que par la légende qu’on lui donne, c’est ce que disait Walter Benjamin. Mais le film peut exister sans légende. La photo doit avoir son nom à elle sans être emblématique. Par exemple, pour montrer la guerre d’Espagne, j’avais une photo de Malraux, et une photo d’Ingrid Bergman dans Pour qui sonne le glas. J’avais aussi Malraux en vidéo. J’ai longtemps hésité. J’ai choisi de le mettre en photo, car montrer la vidéo, c’est montrer une interview de Jean-Marie Drot, et l’ensemble ne passait plus. Donc j’ai mis la photo, et gardé le son. Et le couple de Pour qui sonne le glas, le couple de l’espoir, c’est Malraux et Bergman. Si j’avais mis le plan de Malraux, j’aurais dû trouver le plan de Bergman. Je me sens dans ce sens très proche de Francis Ponge, qui dit que le créateur est un réparateur de l’univers. On doit réparer des torts, et je dois sans doute être le premier à avoir tort de penser que je dois réparer des torts !
S. Daney. Et ta présence physique de commentateur dans tes Histoires ?
J.-L. Godard. C’est pour faire télévision. La première série est faite avec des titres de livres, la deuxième sera faite avec des titres d’œuvres musicales, picturales, puis de paysages.
S. Daney. Quel dossier te donne le plus de mal ?
J.-L. Godard. Aucun. J’ai même fait la première série sans les consulter. C’est ce que j’appelle l’entraînement. A la télévision, ce n’est pas qu’il n’y a pas de travail, il n’y a pas d’entraînement. Donc le résultat, c’est comme un match de Leconte... Pendant longtemps, j’ai été défaitiste, j’ai un peu trop critiqué. A des moments, je suis jaloux de voir que L’Ours ait un tel succès. Ça me fait du bien de voir que Straub me bat pour l’amertume à ce niveau-là !
J’ai fait des centaines d’histoires de couples, et si je les ai ratées, c’est peut-être qu’il n’y avait pas la bonne figure. Il faut faire un personnage qui fasse bonne figure.
Si l’image de synthèse arrivait aujourd’hui comme est arrivé le parlant, je pense que j’arrêterais. J’essaierais un peu, je n’y arriverais pas, je n’aurais pas envie et j’arrêterais. Je ne me sens pas tout à fait égal avec ces gens qui travaillent avec des machines qui leur permettent de croire qu’ils font quelq ue chose. C’est comme le Minitel, deux ans après, quand on a des problèmes avec sa petite amie, le Minitel ne sert à rien. Pourtant, j’aime beaucoup les machines. Quand j’ai eu fini les Histoire(s) du cinéma, je suis allé dire merci à chaque machine, même aux clignotants. Je n’en veux pas aux Japonais d’avoir fait des machines, je leur en veux pour ce qu’ils en font. Qu’ils fassent des films en images de synthèse, mais qu’ils ne comptent pas sur moi pour écrire le scénario... Comme dit Rostand, les théories passent, mais la grenouille reste...
(Retranscrit par Pauline Le Diset et Alain Bergala).


Une image d’Histoire(s) du cinéma.
ZOOM : cliquer sur l’image.

Entretien de Jean-Luc Godard avec Noël Simsolo
Dix ans après une première série d’"A voix nue", Jean-Luc Godard, qui vient de terminer sa série de films Histoire(s) du cinéma, est à nouveau l’invité du critique Noël Simsolo pour cinq entretiens diffusés, sur France Culture, du 30 mars au 3 avril 1998.

Premier volet de la série "A voix nue" avec Jean-Luc Godard diffusée en 1998 dans lequel le cinéaste évoque les images au cinéma qui ont marqué sa mémoire et analyse l’importance du plan dans un film.
On ne se souvient pas de soi, parce qu’il y a une partie qu’on doit oublier. Les films, je pense, sont là d’une façon plus intéressante que d’autres parce qu’elles sont données par des moyens naturels, par l’invention technique qu’était le cinéma et qui vous rappelle ce droit de la mémoire à intervenir sur votre vie. C’est les cailloux du Petit Poucet.

"Il faut confondre ce qui ne peut pas être confondu, juste pour pouvoir raisonner"

Dans ce deuxième entretien, Jean-Luc Godard se souvient de ses premiers films vus au cinéma et raconte comment l’idée d’en faire sa vocation a cheminé en lui. Il s’interroge aussi sur l’héritage que laissent les cinéastes aux générations qui suivent.
J’ai toujours trouvé bizarre les gens comme Lelouch qui disent "Un jour j’ai vu un film de Chaplin", il avait 4 ans et puis après il a décidé qu’il ferait du cinéma. J’y crois pas tellement...


Au cours de ce troisième volet, le cinéaste se penche sur la représentation de la guerre au cinéma et sur le penchant à l’obscénité dans le 7ème art.
Les garçons aiment la guerre. Moi j’en ai peu fait, peu mis, sinon parce ça appartenait à mon pays ou à mon histoire, je ne pouvais pas l’ignorer petit à petit sauf pendant l’enfance où je l’ai ignorée, dans une famille riche, j’ai pu l’ignorer. Après c’est quelque chose que je comprends pas. (...) Je comprends très bien qu’on ait le désir de s’engueuler avec quelqu’un même violemment et que si on arrive à le faire on n’a pas envie de lui taper dessus puisque la langue est faite pour ça, c’est merveilleux.


Dans ce quatrième épisode, Jean-Luc Godard parle de la relation entre documentaire et fiction au cinéma. Il émet aussi un avis très critique sur des films récents ayant eu du succès.
Le fond de chacun c’est d’avoir une maison. Tout le monde veut avoir quatre murs et un toit, c’est la moindre des choses, mais ça ils l’avaient du temps de l’âge de pierre. Ceux qui voulaient étaient au bord de la mer, ils étaient contents, ils avaient la mer, la forêt... Aujourd’hui, à partir du moment où on gagne plus de 20 000 francs par mois, le but de tout le monde c’est d’avoir une forêt, de l’eau et une maison et à partir du moment où on gagne 50 000 francs il faut si possible deux maisons. Et après une fois qu’on a deux maisons, comme dit Cadet Rousselle, on perd la raison. Eh bien tous ceux qui gagnent plus de 50 000 francs ont perdu la raison.


Cinquième et dernier volet de la série "A voix nue" de 1998 consacrée à Jean-Luc Godard autour de sa série de films Histoire(s) du cinéma. Dans cet entretien, le cinéaste livre ses critiques sur le travail des comédiens et explique en quoi le cinéma peut ne pas aimer des réalisateurs.
Si le théâtre ne marche pas c’est que les grands textes, les gens ne les reçoivent pas, ils ne leur donnent pas l’hospitalité avant. Moi j’ai toujours dit aux acteurs "Accueillez le texte !" ou je leur dis même simplement "Ecrivez-le !", non pas pour le mémoriser... et si vous l’écrivez, apprenez d’abord la phrase de l’autre et puis après vous soulignerez la vôtre, et puis l’autre fait pareil... Mais non, ils ne veulent pas, ils veulent tout de suite dire et exister, ça c’est le problème aujourd’hui.

En août 1998, Histoire(s) du cinéma, un coffret de quatre volumes, est édité par Gallimard/Gaumont (972 pages, 490 F). Lors de l’exposition de Godard au Centre Pompidou en 2006, l’ouvrage sera réédité en un seul volume (Gallimard/Gaumont, 316 p., 45 €). Le 1er octobre 1998, Histoire(s) du cinéma est projeté dans une salle de l’hôtel Montalembert à Paris. Nouvelle(s) interview(s) de Godard. Marcelin Pleynet, qui a vu les films à cette occasion, en fait une lecture « debordienne » (donc sévère) dans son Journal à la date du 2 octobre 1998. On en trouve la trace dans Les voyageurs de l’an 2000 (Gallimard, coll. L’infini, 2000).
Histoire(s) du cinéma : le livre
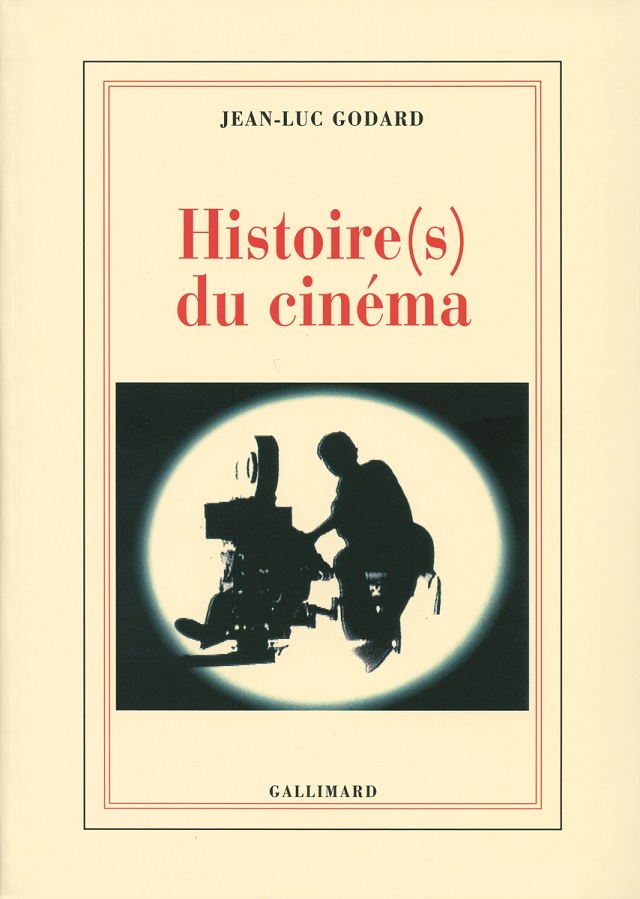
Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard.
ZOOM : cliquer sur l’image.

« Et si la mort de Puig et du Négus, la mort du capitaine de Boïeldieu, la mort du petit lapin ont été inaudibles, c’est que la vie n’a jamais redonné aux films ce qu’elle leur avait volé. Et que l’oubli de l’extermination fait partie de l’extermination.
Voilà presque cinquante ans que, dans le noir, le peuple des salles obscures brûle de l’imaginaire pour réchauffer du réel. Maintenant celui-ci se venge et veut de vraies larmes et du vrai sang.
Mais de Vienne à Madrid, de Siodmak à Capra, de Paris à Los Angeles et Moscou, de Renoir à Malraux et Dovjenko, les grands réalisateurs de fiction ont été incapables de contrôler la vengeance qu’ils avaient vingt fois mise en scène. [...]
Oui, mais l’histoire. Au fond, qu’est-ce que c’est ? Tout au fond. Malraux : nous sentions tous que l’enjeu appartenait à un domaine plus obscur que le domaine politique. Braudel : qu’on mesure la foule de ceux qui nient leur misère. Le nombre de ces cœurs qui veulent être eux-mêmes, vivre de leur vie malgré tout. Comme si notre vie était à nous. Hélas, à notre disposition. Et cet enfoiré de Cioran : rien de ce que nous savons ne reste sans expiation. Nous payons chèrement, tôt ou tard, n’importe quel courage de la pensée ou indiscrétion de l’esprit. Et le jeune Péguy : ah, l’histoire ! une sombre fidélité pour les choses tombées.
Qu’arrive-t-il toujours, mon ami ? Le soir tombe. Les vacances finissent. Il me faut une journée pour faire l’histoire d’une seconde. Il me faut une année pour faire l’histoire d’une minute. [...] On peut tout faire, excepté l’histoire de ce que l’on fait. »

Une image d’Histoire(s) du cinéma.
ZOOM : cliquer sur l’image.

Entretien avec Jean-Luc Godard
Pourquoi vos Histoire(s) du cinéma sont-elles traversées par l’idée de la fin du cinéma ?
La fin d’un certain cinéma, d’une certaine idée du cinéma qui a pris son essor au milieu du XIXème siècle et qui a commencé à disparaître au bout de cent vingt ans, remplacé par d’autres enfants techniques, d’autres machines et d’autres cultures, qui ne sont plus liés à la représentation et à l’art qui venaient de la Grèce et d’Homère. On perd cet art comme idée de la vie et de la création pour passer à une autre idée. Un changement beaucoup plus rapide et définitif que la fin de la perspective.
La fin de ce cinéma vous rend-elle triste ?
Je ne peux pas dire que je suis jaloux de Spielberg. Mais sur le fond, je regrette d’avoir moins l’occasion de voir des films que j’aime bien, ça me manque : il y en a beaucoup moins qu’avant et c’est moins neuf. J’ai vu un film de Kitano, Hana-bi, que j’ai trouvé absolument splendide, mais je ne ressens pas le besoin d’aller voir les autres, que je trouverai probablement moins bien. Kiarostami, j’ai vu un film magnifique et un autre mauvais, il n’a pas eu la possibilité de faire trois bons films à la suite. Possibilité que je n’ai pas non plus, d’ailleurs. Il y a une baisse considérable de la qualité moyenne. Le dernier Rohmer, il y a deux bons premiers tiers, après il ne sait plus quoi faire et il se trompe de chemin, c’est moins bien que La Collectionneuse, même si la fin est bien à nouveau. Dans mes films, il y a de bons moments et d’autres complètement toc, et des films entièrement ratés. C’est exceptionnel qu’on puisse faire, comme Hitchcock, six ou sept films à la suite dans lesquels il y a tous les fondements de l’art.
Quand les huit épisodes des Histoire(s) du cinéma seront-ils diffusés ?
J’ai été dépouillé de tous mes droits par Gaumont, qui a aidé à faire les films. Il ne me reste que mes droits d’auteur sur les livres et mes droits SACD sur les films. Les films seront diffusés dans un an. C’est ridicule, mais qu’est-ce qu’on y peut ? Je voudrais qu’ils passent à la télé et puisqu’ils sortent en DVD, une sorte d’édition de luxe dans le meilleur format domestique possible. Mais Gaumont, on ne peut pas leur parler. Je suis dans la situation d’Edgar Ulmer faisant autrefois un film à la Fox. Comme j’ai bien aimé Edgar Ulmer, j’ai aimé être dans toutes les situations du cinéma : faire des films qui ont du succès, faire des films qui ne marchent pas, faire des films comme les derniers qui non seulement ne marchent pas, mais qui ne sortent même pas, me marier avec une actrice... A chaque fois, il y a une situation de plus, plutôt dans l’épreuve que dans la satisfaction, depuis quelques années. Mais bon, le monde change... Si on arrive à se lever le matin et à mettre son pantalon, on peut déjà considérer ça comme un succès. Mais aujourd’hui, je partage avec le reste du monde cette préférence pour un mauvais film américain à un mauvais film bulgare. Ça m’intrigue beaucoup : pourquoi va-t-on se bourrer à un de ces gros films américains qu’avec Anne-Marie Miéville on appelle "pâté" ? On y va, on achète un gros cône... Et après on pleure, en se demandant dans quelle honte on s’est mis. Moi, avec d’autres, on a été les thuriféraires de films américains qui n’étaient pas appréciés. On a préféré un film d’Ulmer à La Symphonie pastorale de Delannoy, on a dit nettement que si Chateaubriand est l’auteur des Mémoires d’outre-tombe, l’auteur de Rio Bravo, c’est Hawks. On reconnaissait même certaines maisons de production comme des auteurs : les films Warner n’étaient pas les mêmes que les Columbia. Je n’ai donc pas à me mettre à genoux aujourd’hui devant Spielberg comme le font les Français, le public et la critique. D’abord parce que ce n’est pas très bon et que, en plus, c’est malhonnête. Même quand on dit que ce n’est pas très bon, il faut quand même six pages pour le dire, comme le fait Libération. Mais personne ne les force, c’est eux qui se mettent dans cette position, qu’ils ne viennent pas se plaindre ensuite... Spielberg est le représentant maximum de cet état d’esprit, comme Bill Gates en informatique.
Etes-vous allé voir Il faut sauver le soldat Ryan ?
Oui, par curiosité, parce qu’avec Anne-Marie on n’est pas sectaires. Si on avait trouvé ça bien, on l’aurait dit : il a fait cent mille saloperies puis ce truc splendide, puisque j’avais lu dans les journaux que c’était splendide. Alors, allons voir... Et on s’aperçoit que le monde baisse, que la nouvelle Citroën est moins bonne que l’ancienne... Après cette fameuse première demi-heure du Débarquement, qui est correcte, où je reconnais un certain talent par moments, et non pas un talent certain, ou un incertain talent qui aurait eu le charme de l’incertitude, on attend la suite et on s’aperçoit qu’on l’a vue et revue, que Cote 465 d’Anthony Mann était plus intéressant. Spielberg est roublard, il sait ce qu’il fait. Il est naïvement dans le succès, dans ce qui fera qu’Anne-Marie et Jean-Luc iront voir le film, en s’achetant un cône, en pleurant et en vomissant.
Avez-vous eu quand même un certain plaisir à le voir ?
Je n’arrive pas à dire... Cette histoire de guerre mondiale m’intéresse, parce que j’ai une relation équivoque à cette époque-là, parce que je suis navré de constater que les bons films sur le sujet n’ont jamais été faits, que c’est toujours des grimaces. Ça ne vaut pas John Ford, ça ne vaut pas Les Plus belles années de notre vie de Wyler, un beau film, classique et honnête. La vraie question est de savoir pourquoi les gens veulent gagner de l’argent au-delà de 20-25 000 f par mois, pour en faire quoi ? Tout le monde veut une maison, moi aussi, ça vient de loin, comme les lapins veulent un terrier. Mais les lapins ne veulent pas quatre terriers... C’est une certaine bêtise de gens peu qualifiés, comme l’histoire de ce fonds de pension qui fait perdre des milliards de dollars, dont les directeurs étaient prix Nobel d’économie et dont le fondateur, un escroc de première, s’appelle "Heureux-temps", Merryweather ; et personne ne se méfie de ce type qui dit "Prenez du bon temps avec moi, confiez-moi vos économies" ! Mais tout ce que veut l’Amérique, ce pays dont les habitants n’ont pas de nom, c’est qu’on parle d’elle. C’est la phrase de Giraudoux que j’avais mise dans Allemagne neuf zéro : les Etats-Unis n’ont jamais connu la guerre, ils n’ont connu que la guerre civile, d’abord contre les Anglais, puis entre eux. Ensuite, comme les trois quarts venaient d’Allemagne, ils se sont rués contre les Germains : du coup, le premier soldat américain à faire un prisonnier pendant la guerre de 14-18 s’appelait Meyer et son prisonnier aussi.
En voyant ou en lisant vos Histoire(s) du cinéma, on est frappé par votre sentiment de solitude.
Le cinéma n’est pas admis comme instrument de pensée sauf un peu par Deleuze, qui était un bon compagnon du cinéma. C’était une certaine culture classique, composée d’un peu de tout, où on pouvait aimer Pascal, Faulkner et Cézanne. Nous, on rajoutait Renoir, Hawks ou Eisenstein. C’est un travail assez solitaire parce qu’il n’intéresse pas vraiment un historien d’aujourd’hui, même un historien d’art. C’est plus divisé qu’avant, on est donc un peu seul en étant spécialiste de rien : quelqu’un dont on se méfie un peu. Et puis mes aînés, mes concitoyens dans ce domaine sont morts un certain nombre d’essayistes comme Fernand Braudel en histoire, ou Alexandre Koyre. Ces livres et ces émissions, je les ai faits comme un peintre ou un écrivain, donc assez seul.
Comment avez-vous procédé ?
J’ai accumulé les documents, en repiquant des films qui me plaisaient et des documentaires dont je pensais avoir besoin, en découpant beaucoup de photos. Et puis je les ai classés par sujet, un classement assez simple : femmes, hommes, couples, enfants, guerres. Il y avait une dizaine de chemises, pas énormes, de manière à pouvoir retrouver les documents. Finalement, ça s’est fait avec relativement peu de choses, mais ce peu donne l’impression de beaucoup.
Est-ce une histoire ou une mémoire du cinéma ?
C’est la même chose. A cause de sa matière, de la façon dont il est fait et construit techniquement, le cinéma peut se raconter et faire sa propre histoire. En la faisant, il est le seul à pouvoir donner un sentiment, une idée de ce qu’on a convenu d’appeler l’Histoire. Cette histoire sera différente de toutes les autres puisqu’elle est visible et vivante, puisqu’elle reproduit du vivant à la façon dont le cinéma ou la photo le font. Le cinéma est donc le seul qui peut donner un sentiment du tissu ou du fleuve histoire. Le cinéma peut donner ce que les journaux appelaient autrefois "le film des événements". En littérature, on ne peut pas. Quand Joyce écrit Finnegans Wake, qui est la somme de tout ce qui peut s’écrire, il dit "Je" : c’est de la littérature, mais pas l’histoire de la littérature. De la même manière, la sculpture ou la peinture ne peuvent pas faire leur propre histoire. Alors que le cinéma peut vraiment raconter une histoire, on l’a toujours dit. Moi, je lui ai fait raconter l’histoire de l’Histoire, à travers le cinéma.
Qui sont les historiens d’art qui vous ont inspiré ?
J’en connais très peu. Elie Faure passait par la vision et un style un peu exalté, lyrique. Malraux aussi. Alors que beaucoup d’autres se contentent d’une idée que la peinture doit étayer, comme une simple preuve de leurs dires. Quand passe à la télévision une émission qui s’appelle La Leçon d’histoire de Fernand Braudel, je la repique et j’en passe un extrait. Il parle du siège de Toulon. Donc dans mes Histoire(s), on voit un plan de Napoléon qui part sur sa barque dans le film de Gance et, en même temps, on dit : "Voilà comment on est allé chez Langlois à la Cinémathèque." Ça me semble mieux que de dire "Un jour, X ou Y sont allés à la Cinémathèque avenue de Messine."
Quel rapport avez-vous avec les historiens du cinéma, des gens comme Mitry, Sadoul, Bardèche et Brasillach ?
Je les ai peu lus. C’est maintenant que j’ai envie de les ouvrir, pour y trouver des informations, comme un juge d’instruction. Bardèche et Brasillach étaient des jeunes gens de droite qui allaient au cinéma sans qu’on leur ait dit que le cinéma était intéressant. C’est le même élan juvénile qui nous a permis de découvrir le cinéma dans les livres, pas dans les salles, et ces livres nous ont fait aller vers un certain cinéma. Parce que les films, on ne les voyait pas : on lisait ce qu’en disait Jean George Auriol dans La Revue du cinéma. On a aimé ces films avant de les avoir vus et il y en a que je n’ai encore pas vus. En les voyant sur un écran, on a eu la révélation, même sans être chrétiens. On regardait des films muets en plein cinéma parlant mais pour nous, il n’y avait pas de différence, pas plus qu’entre une peinture de Goya et un tableau d’Hartung. C’était de la peinture, c’était le cinéma. La vraie Nouvelle Vague, c’était La Revue du cinéma. C’est la phrase de Paul Klee, "La peinture, c’est ce qui rend visible l’invisible" : La Revue du cinéma a eu ce rôle car la censure interdisait Potemkine et les cinémathèques étaient encore balbutiantes, à part celle de Langlois. En découvrant enfin ces films, on leur a fait acte d’allégeance. Une autre raison : nos parents ne nous en avaient pas parlé. Ma mère m’avait un peu parlé de littérature ou de musique, mais pas de cinéma, Sartre ne m’avait pas parlé de Murnau. Moi, l’envie de cinéma m’est venue très tard. Les gens qui parlent de leur vocation en la faisant remonter à l’âge de 3 ans, quand ils ont vu leur premier Charlot, m’ont toujours fait rire. Pour moi, le cinéma a été quelque chose qu’on peut choisir, comme on choisit de partir en voyage. Le cinéma échappait à la fois à la sphère de la culture et à la sphère des parents.
Dans un des épisodes, Serge Daney vous dit que votre génération, celle de la Nouvelle Vague, était vouée à faire une histoire du cinéma.
On était au milieu du siècle et au milieu du cinéma. On pouvait donc regarder à la fois devant et derrière. Aujourd’hui, j’avance plus à reculons dans l’avenir, mais j’avance à reculons de bon coeur. J’ai fait une échographie de l’Histoire par le biais du cinéma. De par sa matière, qui est à la fois du temps, de la projection et du souvenir, le cinéma peut faire une échographie de l’Histoire en faisant sa propre échographie. Et donner une vague idée du temps et de l’histoire du temps. Puisque le cinéma, c’est du temps qui passe. Si on se servait des moyens du cinéma qui est fait pour ça, on obtiendrait un certain mode de pensée qui permettrait de voir les choses. Mais on n’en veut pas, on préfère parler et avoir de mauvaises surprises. L’homme est un animal spécial qui aime bien vivre dans le malheur, qui se bourre de chocolat pour être malade quand il est en bonne santé. Comme l’analyse, née au même moment, est une façon de dire, le cinéma est une façon de voir. Et les deux n’ont guère été aimés par la pensée moderne. Aujourd’hui, on vous dit que c’est dépassé. Dans le cinéma, le documentaire a été très vite rétamé au profit de la fiction, et de quelle fiction ! Alors elle s’est appauvrie. Le cinéma devrait être un moyen de voir, de regarder avant de parler, ou de vérifier ce qu’on a dit pour retrouver une deuxième parole. Mais ça, les gens n’en veulent pas... Ça aboutit forcément à une catastrophe.
Quand a débuté le projet des Histoire(s) du cinéma ?
Vers 75-76, c’est une idée que j’avais proposée à Langlois. Au même moment, je lui disais de dynamiter la Cinémathèque, tout en conservant deux ou trois films, pour pouvoir prétendre qu’il les avait sauvés du désastre. Sous une forme imaginaire, c’est devenu dans les émissions et dans les livres : "Il faut brûler les films, avec le feu intérieur bien sûr." Langlois allait donner des cours à Montréal, et quand il est mort, les Canadiens m’ont proposé de continuer.
C’est comme ça qu’est né le premier livre, Introduction à une véritable histoire du cinéma (Albatros, 1980) : l’enregistrement des cours que je faisais devant deux ou trois malheureux. Après, j’ai essayé plusieurs fois de mettre les huit émissions en route. Elles avaient déjà les mêmes titres, sans que je sache ce que je mettrais dans chacune, mais les titres sont restés, ce qui a aidé au mode de classification : huit chemises pour huit émissions. Les deux premières ont été prises par Canal+, tout au début de la chaîne. Ça s’est encore arrêté, et puis ça a repris avec La Sept, future Arte. Et puis après, Gaumont a commencé à les acheter, d’abord 2 %, puis 3 %, puis 10 %, exactement comme le faisait Tapie. Au bout de huit ans, ils ont 100 %, et même 200 %.
Y avez-vous mis un point final ? Considérez-vous que c’est achevé ?
Ça pourrait durer éternellement... Mais à un moment, il faut mettre le point final, sinon ça dure trente ans, avec une série d’annexes, genre Nouvelles histoire(s) du cinéma, ça n’en finirait plus. Il y a déjà deux films que je considère comme des annexes : Les Enfants jouent à la Russie et 2 fois 50 ans de cinéma français. Ou alors il faut que je sois engagé au CNRS avec un salaire convenable... Et puis mon matériel est devenu obsolète, ce sont des films faits à la main, avec des images qui ont plusieurs générations et qu’on reconnaît à peine. Ce ne sont pas des mauvaises reproductions, seulement des souvenirs d’émotions qui sont respectueux vis-à-vis de l’oeuvre. Le moyen scientifique et simple pour ces émissions et ces livres, c’est la comparaison et la métaphore. Car toute image est métaphore. Et le cinéma, encore aujourd’hui, est annonciateur, prévoit les choses, les annonce un peu que le film soit bon ou mauvais.
Pourquoi avez-vous retouché les deux premières émissions ?
Pour qu’elles fassent partie du même rythme et de la même dynamique que les autres. Au début, on n’ose pas y aller à fond et je les trouvais un peu plus faibles que les autres. Et puis des documents sont venus se rajouter, comme ce petit film où on voit Jean Moulin, que j’ai mis juste après l’actrice des Dames du bois de Boulogne qui dit "Je lutte" ; et après, on entend de Gaulle parler de la bataille de France.
Quel statut accordez-vous aux films, aux textes ou aux tableaux que vous utilisez ?
Quand Seguela utilise les images de Bardot nue dans Le Mépris pour une publicité sans mon autorisation, je lui fais un procès, parce qu’il exploite la chose et qu’il doit donc la payer, parce qu’il n’a pas respecté la loi d’usage. Quand on rechante la chose dans une autre chanson, comme moi, ce n’est pas pareil. Si on en tire trop de profit artistique ou commercial pour soi-même, il faut payer. Si Baudelaire était vivant, j’aurais dû lui payer l’extrait du Voyage que j’ai utilisé : ça aurait été normal et moral. Comme avec Belhaj Kacem, qui est pauvre : on lui a payé son extrait presque trop cher, mais c’est normal. La frontière est difficile. Dans chaque cas, il faut interroger l’honnêteté morale de l’artiste par rapport à ça, voir ce qu’il en tire pour lui, s’il cite parce qu’il n’est pas capable de l’écrire lui-même. J’ai pris un extrait d’Elie Faure, en changeant le mot "Rembrandt" par le mot "cinéma", mais je n’ai pas l’impression de l’avoir exploité, je l’ai intégré dans une histoire dont il fait partie, je lui ai rendu les intérêts de ce qu’il m’a apporté, je lui devais bien ça. En littérature, le droit de citation, c’est tant de lignes autorisées ; en musique, c’est tant de mesures. Et au cinéma, c’est rien du tout : le copyright et c’est tout, aucun droit de citation. En ce qui concerne mes émissions, les deux premières sont déjà passées sur quatre chaînes nationales et personne n’a rien réclamé. Donc elles ont déjà fait jurisprudence. C’est pour ça que Gaumont a tort de faire négocier les droits des extraits des films par une armée d’avocats. Ils ont peur d’être en porte-à-faux, qu’on applique le même traitement aux archives qu’ils détiennent. Ce sont des industriels qui défendent le copyright. Ce n’est pas Hitchcock qui songerait à me demander de l’argent pour le plan de la petite fille par terre des Oiseaux, parce qu’il fait partie de ma famille et qu’à un moment je l’ai reconnu... Mon point commun avec les peintres, c’est que j’ai toujours vendu mes toiles pour continuer à en faire ou pour payer cette pièce où je vous reçois. Je n’ai réussi à conserver aucun de mes droits. Là, Gaumont a acheté mes toiles. Je peux juste regretter qu’ils ne les montrent pas de temps en temps.
Les livres comme les émissions mélangent images et écriture, alors qu’on vit dans un monde qui ne cesse d’opposer le visuel et l’écrit.
C’est une opposition très mensongère, puisque ce qu’ils appellent du visuel est en fait du super écrit, sur lequel on dit et on redit des choses, jusqu’à ce qu’une photo d’atrocités ne fasse plus peur. Alors qu’elle est plus atroce que la première demi-heure de Spielberg qui, lui, n’a rien à dire, sinon la volonté des Américains de continuer à être les leaders. On est plus que jamais dans l’écrit, mais un écrit dépouillé de sa valeur d’écrit. Ce qui sert encore la littérature et certains écrivains, heureusement. Alors que les films sont dépouillés sur les deux tableaux. C’est comme quand on nous parle de la vitesse de la communication : c’est faux. Moi qui habite la province, hors d’Europe, en Suisse, quand les gens veulent m’envoyer un colis urgent, je leur dis de l’envoyer par la poste en petite vitesse, il m’arrivera dans deux jours. Alors que s’ils me l’envoient en express, il ne m’arrivera jamais ! Parce que DHL ou Chronopost sont dans la ville voisine, ils viennent quand ça leur chante. Si on n’est pas là, ils ne livrent pas. Voilà le progrès, voilà la grande vitesse. Ne mentons pas, disons la vérité, et constatons que ça ne va pas plus vite... Constatons qu’il y a très peu d’images à la télévision au lieu de parler du "tout-visuel" encore un mensonge. La télévision n’a jamais rien dévoilé, c’est toujours des journalistes qui le font, par l’écriture. Chez Hitchcock, au contraire, on ne se souvient que de l’image, du sable dans la bouteille des Enchaînés et pas de ce qu’Ingrid Bergman est venue faire à Rio : c’est l’image seule qui fait tenir tout le reste. Ma formule à propos d’Hitchcock, c’est "le seul poète maudit qui ait eu du succès". Alors que quelqu’un comme Warhol, l’image ne signifiait rien pour lui, il n’y avait plus de foi ni de loi, sinon l’utilisation qu’on en fait : c’était déjà la publicité et ça se termine par l’image de Marilyn sur des paquets de cigarettes. La pauvre Marilyn, elle aura servi... L’image fondatrice de tout ça, c’est le premier ready-made de Duchamp, puis de cinq ou six autres. Mais après, ça s’arrête. C’est comme si quelqu’un voulait faire une galerie de cet appartement pour y exposer un piano, et après il me demande de faire un trou dans le mur pour faire entrer le piano ! Et puis d’exposer ça ! Mais s’il n’y a pas le texte de Duchamp, ça ne marche pas. Si ce n’est pas signé Duchamp, tout le monde dira "Attention, ça, ce n’est qu’un piano !" Il faut le nom d’auteur... Il faudrait un mélange d’Elie Faure et de Fernand Braudel pour faire l’histoire de ça, et pour montrer comment la télévision est le dernier avatar du christianisme, par son utilisation des icônes.
Comment avez-vous conçu la circulation de l’oeil dans les livres ?
J’ai voulu que l’oeil soit à égalité avec le texte et les images, il n’y a pas une peinture de Cézanne et un texte de Sollers à côté : c’est à égalité. On regarde et on s’aperçoit que l’image est à égalité avec le texte. J’ai voulu que les livres ne soient pas trop grands pour que les gens puissent les emporter avec eux. Et puis quand on m’a dit qu’un caractère d’imprimerie que j’aimais bien s’appelait Bookman, je me suis dit que c’était le bon.
Les films n’ont pas été tournés en numérique. Mais est-ce que ce procédé n’améliore pas la qualité de l’image ?
Encore un mensonge. Le numérique n’est pas fait pour améliorer la qualité de l’image mais pour réaliser une fusion d’une masse d’images qui doivent être transportées ensemble, comme des déportés dans un wagon. Pour pouvoir les transporter ensemble, il faut d’abord les compresser. Ensuite, il faut les décompresser, les réanimer... De toute façon, il n’y aura bientôt plus de télévision, il y aura un four à micro-ondes avec Internet, votre banquier qui vous téléphone en même temps et un poulet qui cuira dans le fond, pauvre mère de famille !
Pourquoi vous êtes-vous engagé aux côtés de cinéastes plus jeunes, et dont vous n’appréciez pas forcément les films, en faveur des sans-papiers ?
Parce que je ne suis pas sectaire. C’est Guiguet qui nous a recommandé de voir Mange ta soupe, de Mathieu Amalric, et on a trouvé ça splendide. Dans cette affaire de sans-papiers, le jeune cinéma français voyait tout à coup ce qu’il faisait au lieu de le dire. D’habitude, ils disent "J’ai fait ça" ou "J’ai voulu faire ça", plus rarement "J’ai pas réussi à faire ça." Alors qu’il faudrait se contenter de regarder le résultat. Dans le sport, on ne peut pas tricher, il y a une vérité de la performance physique : on ne peut pas dire qu’on saute deux mètres en hauteur si on saute cinquante centimètres. Ces jeunes cinéastes ont fait un montage, c’est ce qui m’a frappé, alors qu’ils ne font plus de montage depuis longtemps ils montent tous en virtuel. Dans un autre domaine, ils sont donc parvenus à faire les films qu’ils ne font pas, ils ont fait du cinéma en rapprochant des choses, en montrant ce qu’ils avaient vu. Ils ont sauvé l’honneur. Ce texte en main, je pouvais donc oser accepter un deuxième César d’honneur, c’était un texte-bouclier qui me protégeait.
On sent une volonté de lyrisme dans les Histoire(s) du cinéma...
C’est mon naturel lyrique et plastique. J’ai toujours été un romantique tenu par une clé de sol classique. Mais peut-être que si je savais chanter dans la vie, pour moi tout seul, je serais moins lyrique dans les oeuvres.
Il y a un plan de vous à votre machine à écrire, avec une casquette à visière de plastique, où vous semblez hagard, comme si vous sortiez d’un cauchemar qui serait l’histoire du cinéma.
Ah ben, ça alors... Je n’ai pas du tout pensé à ça... Mon idée, c’était de faire scénariste d’Hollywood. Vu votre réaction, c’est loupé... Ça me fait penser à cette phrase de Bonnard qui dit "Les intentions sont néant." Voilà, dès qu’il y a une intention, c’est néant, on en a la preuve par l’exemple. Ce que j’ai fait de mieux, c’était quand il n’y avait pas d’intentions. Je ne vais pas vous dire que vous n’avez pas compris, c’est moi qui suis mauvais si vous avez vu autre chose. Si vous posez la question, c’est que c’est raté, j’ai laissé le sens contaminer, je n’ai pas fait assez attention. Quand c’est réussi, on n’a pas besoin de me demander ce que j’ai voulu dire par là : ça le dit et il n’y a pas à en parler.
Au début de chaque livre, il y a écrit : Introduction à une véritable histoire du cinéma, la seule la vraie.
C’est le vrai titre, ce n’est qu’une introduction, comme ces livres de philosophie que j’aime bien qui s’intitulent Introduction à la philosophie de Hegel : ça signifie "venez là". "La seule la vraie", ça signifie la seule, la vraie possible.
De toute façon, il y a des grands hauts et des bas dans ces émissions. La plus élaborée est la première, du point de vue mélange de thèmes et de documents c’est pourquoi je l’ai appelée Toutes les histoires. La deuxième, Une Histoire seule, est celle que j’ai le plus reprise, où ça tire le plus la langue. Les deux suivantes, Seul le cinéma et Fatale beauté, ça a été dur aussi, il a fallu les reprendre. Tandis qu’arrivé à la cinquième, La Monnaie de l’absolu, je pédalais bien, c’est venu plus facilement, comme un éditorial chanté. Une Vague nouvelle, c’est la Nouvelle Vague, c’est donc plus personnel, c’est plus pour Sadoul, avec le côté "Qu’est-ce que c’était la Nouvelle Vague ?" des aveugles à qui on a ouvert les yeux. Les deux dernières, je suis revenu à la philosophie de l’histoire du cinéma, à son échographie. Je me suis effacé pour former un discours fait de combinaisons, comme un romancier qui combine des phrases. La toute dernière est plus historique au sens classique, elle essaie de penser l’histoire de ce siècle qu’a parcouru le cinéma. L’ensemble est un essai romanesque, une échographie cinématographique de l’histoire.
Auschwitz reste le point aveugle de cette histoire ?
Je pense qu’il faut deux générations. Mon grand-père était collabo, mes parents étaient médecins à la Croix-Rouge suisse et ils ne m’ont rien dit alors que mon père avait peut-être vu quelque chose des camps. J’ai eu une formation de droite, même sans le savoir. La littérature, après mon adolescence, m’a aidé à en sortir. Mais j’étais beaucoup moins militant que Rivette. Je me souviens qu’une fois, place de l’Alma, des voitures passaient en klaxonnant "Algérie française !" ; et j’ai dit comme ça "Oh, il est beau ce son." Rivette m’a presque giflé, il m’a drôlement engueulé.
Pourquoi les nazis ont-ils filmé les camps alors qu’ils ont tout fait pour que ça ne se sache pas ?
Parce qu’ils avaient la manie de tout enregistrer. Les Allemands sont comme le criminel malade qui ne peut pas garder pour lui la preuve de son crime, qui ne peut pas s’empêcher de l’envoyer à la police alors qu’il était bien tranquille dans son coin. Regardez ce médecin d’Auschwitz dont les journaux ont parlé, qui ne peut s’empêcher encore aujourd’hui de se vanter de ses crimes. Les archives, on les découvre toujours longtemps après. Regardez le procès Papon, dont on n’aura le droit de voir les débats qu’en 2030, c’est incroyable ! Incroyable qu’on n’ait pas pu suivre les débats sur une chaîne d’histoire ! Je n’ai aucune preuve de ce que j’avance, mais je pense que si je m’y mettais avec un bon journaliste d’investigation, je trouverais les images des chambres à gaz au bout de vingt ans. On verrait entrer les déportés et on verrait dans quel état ils ressortent. Il ne s’agit pas de prononcer des interdictions comme le font Lanzmann ou Adorno, qui exagèrent parce qu’on se retrouve alors à discuter à l’infini sur des formules du style "c’est infilmable" il ne faut pas empêcher les gens de filmer, il ne faut pas brûler les livres, sinon on ne peut plus les critiquer. Moi, je dis qu’on est passé de "plus jamais ça" à "c’est toujours ça" et je montre une image de La Passagère de Munk et une image d’un film porno ouest-allemand où on voit un chien qui se bat avec un déporté, c’est tout : le cinéma permet de penser les choses.
Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, tome 2 (1984-1997), écrits, documents et entretiens réunis par Alain Bergala (Cahiers du cinéma), 512 pages, 250 f.
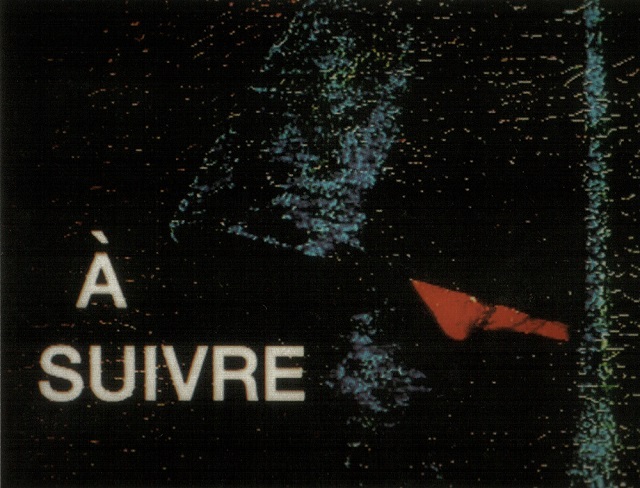
Dernier photogramme du volume 1 des Histoire(s) du cinéma.
ZOOM : cliquer sur l’image.


Une image d’Histoire(s) du cinéma.
ZOOM : cliquer sur l’image.

Journal de Marcelin Pleynet
![]() Vendredi 2 octobre [1998]
Vendredi 2 octobre [1998]
JEAN-LUC GODARD SE FAIT SON CINÉMA
Jean-Luc Godard, Histoire(s) du cinéma, six films vidéo présentés, hier matin, dans une des salles de réunion de l’hôtel Montalembert, à l’occasion de la publication, aux Éditions Gallimard, d’un fort curieux ouvrage, qu’il faut peut-être oublier.
Les Éditions Gallimard ont publié les Œuvres cinématographiques complètes de Guy Debord, dans la collection « Blanche », il y a quatre ans (1994).
Histoire(s) du cinéma, six films, deux fois trois projections : quatre heures vingt minutes.
À la mi-temps, je croise W, écrivain et journaliste à I’occasion, dont la triste figure me laisse supposer qu’il est là en mission commandée. Il essaie de me faire dire ce qu’il pense du film, à savoir beaucoup de mal. Comme je le vois venir, je lui dis tout au contraire : « Je suis un inconditionnel de Godard. » Il le publiera dans Le Point, hargneux, mécontent. Bonjour, W.
Non je ne suis pas « un inconditionnel de Godard ». S’il fallait choisir entre la Nouvelle Vague et le Nouveau Roman... J’ai, à l’époque, choisi la Nouvelle Vague. Mais fallait-il choisir ? Le cinéma permettait (Dreyer, Eisenstein) une enquête historique sur les enjeux et les limites de la technique : la caméra appareil idéologique. J’ai, au début des années soixante-dix, publié un texte sur le sujet, qui troubla fort les marxistes-léninistes althussériens de l’époque.
Je devais retrouver ce qui alors me préoccupait de l’idéologie de « l’appareil » cinématographique, en 1976, lors de la publication par les Éditions Gallimard d’Acheminement vers la parole, où Heidegger, s’entretenant avec un Japonais, lui fait déclarer : « Parlant du réalisme du film, je voulais au fond dire quelque chose de tout autre, à savoir que le monde japonais en général était capturé dans l’objectivation de la photographie, qu’il était proprement forcé à prendre la pose devant elle... », avec ce commentaire : « Si je vous ai bien prêté attention, vous aimeriez dire que le monde d’Extrême-Orient et le produit techniquement esthétique de l’industrie cinématographique sont mutuellement incompatibles », et finalement en réponse : « C’est exactement cela. Quelle que soit la qualité esthétique d’un film japonais, le seul fait que notre monde soit exposé dans le film réduit ce monde à prendre place dans le domaine de ce que vous nommez l’obstant [das Gegenstandige : le se-tenir en face caractéristique de l’objet]. Le film et son faire-devenir-objet, n’est-ce pas déjà une conséquence d’une européanisation qui s’étend toujours plus avant ? »
La conclusion de Heidegger ne manque pas d’humour :
« Un Européen ne peut que difficilement comprendre ce que vous dites. »
N’est-ce pas dans cette perspective que, en attendant Mai 68, les années soixante sont occupées par des débats plus ou moins délibérément confus sur la question de la modernité ? Godard y trouve sa place. Et l’industrie du spectacle cinématographique étant ce qu’elle est, Godard incontestablement, avec les moyens qui sont les siens, s’emploie à en troubler le jeu. Je parierai alors déclarativement, avec quelques autres, pour ce trouble qui fait question, sans cacher mon admiration pour celui par qui le scandale arrive, en attendant mieux, et sachant qu’il n’y a rien à attendre de ce qui se présente comme art cinématographique.
Ce que la revue L’Internationale situationniste (n° 10, mars 1966) publie sur « Le rôle de Godard » s’inscrit dans la prise en compte globale d’une analyse de la « modernité », qui porte aussi bien sur Perec (« Un Perec, le consommateur des Choses, quand il écrit que "la crise du langage est un refus du réel" ignore le réel du refus ») que sur la « néo-littérature des Robbe-Grillet ».
Ainsi, pour L’Internationale situationniste : « Dans le cinéma, Godard représente actuellement la pseudo-liberté formelle et la pseudo-critique des habitudes, c’est-à-dire les deux manifestations inséparables de tous les ersatz de l’art moderne récupéré. » Et encore : « Godard est l’équivalent cinématographique de ce que peuvent être Lefebvre ou Morin dans la critique sociale ; il possède l’apparence d’une certaine liberté dans son propos (ici un minimum de désinvolture par rapport aux dogmes poussiéreux du récit cinématographique). Mais cette liberté même, ils l’ont prise ailleurs, dans ce qu’ils ont pu saisir des expériences avancées de l’époque... Ils se servent d’une caricature de liberté en tant que pacotille vendable, à la place de l’authentique. »
HISTOIRE(S) DU CINÉMA
Ce qui frappe immédiatement, et va en quelque sorte crescendo, au cours de ces quatre heures de projection, c’est la voix de Godard et, assez vite, la conviction que s’il s’écoute (mais s’écoute-t-il parler ?), il ne s’entend pas. Dès le départ et jusqu’à la fin, les films baignent dans un pathos vocal qui semble d’abord inadéquat au projet, et dont on se demande ce qui le justifie, jusqu’à ce que l’on comprenne qu’il est fondateur.
Tout est dans la voix, dans le ton : la pensée d’un discours, le discours, sa philosophie. Le ton, la manière de lire, de parler, est significative d’un état d’esprit. Et l’on ne peut pas ne pas penser, à l’écoute, quatre heures durant, de la voix de Godard, quelle que soit l’illustration visuelle qui l’accompagne, qu’effectivement elle donne (à son corps défendant) le ton général (la pensée) de l’œuvre, celui du pathos d’une emphase métaphysique.
Ce pathos deviendra particulièrement remarquable lorsque Godard s’attardera sur l’œuvre de Malraux, et lorsque l’on sera à même de comparer le ton de Malraux, lisant son oraison funèbre à Jean Moulin, et la voix Godard.
Pourquoi ? Qu’est-ce qui se joue, dans le ton d’une semblable démonstration, de conviction métaphysique, j’entends nihiliste ?
La première chose qui vient à l’esprit, puisque parmi de très très nombreuses citations des titres d’ouvrages littéraires et philosophiques, Godard croit devoir citer un des livres de Heidegger (Chemins qui ne mènent nulle part), c’est que Godard ne lit pas vraiment les livres dont il énonce les titres.
« Pour savoir écrire, il faut savoir lire... » Cette Histoire(s) du cinéma semble mettre en évidence ce qu’il faut considérer comme un problème propre au cinéma de Godard, à savoir le rapport que le cinéaste entretient avec la littérature et, par voie de conséquence, avec la pensée.
Si l’on considère ce qui se propose comme discours littéraire en contrepoint du discours visuel, on ne peut pas ne pas être frappé par la pauvreté d’énoncés comme (à propos des frères Lumière) : « Ils auraient pu s’appeler abat-jour mais ils s’appelaient Lumière » ; « Comme par hasard au cinéma on a appelé la bobine de gauche l’esclave et la bobine de droite le maître » (sic) ; « C’est le vieux Charcot qui ouvre à Freud les portes du rêve, à lui de trouver la clef des songes » ; « Histoire de la solitude, solitude de l’Histoire » ; « Les deux grandes histoires ont été le sexe et la mort », etc.
N’est-ce pas à ce propos (de littérature) que L’Internationale situationniste écrivait déjà dans son numéro de mars 1966 : « Chez Godard la répétition des mêmes balourdises est déconcertante par postulat. Elle excède toute tentative d’explication ; les admirateurs en prennent et en laissent dans une confusion corollaire à celle de l’auteur [...]. L’étalage de sa culture recoupe celle de son public qui a lu précisément les mêmes pages aux mêmes pocket books... »
Cette Histoire(s) du cinéma excède-t-elle toute tentative d’explication ? Bien au contraire, me semble-t-il. L’ampleur et l’ambition du projet, accompagnées en effet d’un exceptionnel étalage de culture (réduite à la citation du titre des pocket books de la bibliothèque), dévoilent assez vite ce qui commande la pose culturelle, aussi facile qu’intéressée, d’un œil que ses dons naturels troublent.
La spontanéité, d’une sensibilité naturelle et exceptionnelle aux images, se trouble et se précipite sur l’insaisissable pensée d’une ratio dont la singularité lui échappe. Le recours culturel s’affiche, mais reste superficiel, apparemment pas maîtrisable, Godard n’est pas un écrivain, ce qui paraît déterminer chez le cinéaste un doute profond, ontologique, et un pessimisme qui, fondamentalement, verse l’entreprise au compte du pathos, du nihilisme propre à l’histoire de la métaphysique ici ressassée.
Ici, le récit impossible fait des « histoires » comme Godard se fait du cinéma. C’est en faisant du cinéma qu’il découvre, et recouvre, la mesure littéraire qu’il prend en charge par défaut. C’est-à-dire, notamment tout au long de ces quatre heures de film, dans un étalage de références culturelles qui témoigne d’abord de l’ambivalence des sentiments qu’il entretient non seulement avec la littérature, mais aussi bien avec l’histoire de la pensée qu’avec l’histoire de l’art (faut-il préciser qu’un tableau présenté et cité dans un film n’est jamais que la photographie d’un tableau, c’est-à-dire quelque chose qui fait de ce tableau un faux, plus faux qu’un faux tableau).
Est-ce en fonction de ce mode de rapport à la littérature et des ambivalences qui le commandent que Godard a tenu à ce qu’une version imprimée de son Histoire(s) du cinéma paraisse, aux Éditions Gallimard, et dans la collection « Blanche » ?
HISTOIRE(S) OU ROMAN(S)
DANS LE CINÉMA DE GODARD
« Espérant voir promptement, un jour ou l’autre, la consécration de mes théories acceptées par telle ou telle forme littéraire, je crois avoir enfin trouvé, après quelques tâtonnements, ma formule définitive. C’est la meilleure : puisque c’est le roman ! », Isidore Ducasse, comte de Lautréamont, Les Chants de Maldoror, chant sixième.
Le titre que Godard a choisi pour l’ensemble des vidéogrammes joue sur l’ambiguïté des emplois du mot « histoire » au singulier (tel qu’il s’écrit avec un H majuscule : l’Histoire) et au pluriel (les histoires qu’on raconte ou qu’on se raconte). Et c’est peu de dire que le film (vidéogramme) exploite ce jeu de mots.
On peut comprendre que le cinéma dans l’état où il se trouve aujourd’hui ait en effet réclamé une Histoire susceptible de faire face à sa décrépitude, et que Godard, plus que tout autre, ait ressenti cette nécessité.
Il n’en reste pas moins que le mouvement même d’une aventure, qui sombre dans l’ordonnance et l’exploitation des dispositions techniques qui lui ont donné naissance, et qui datent très précisément cette naissance, ne peut faire Histoire qu’à s’assimiler à l’achèvement de la pensée qui la justifie en justifiant en elle un certain mode de rapport au langage. À savoir : le langage comme instrument, servant par exemple à raconter des histoires.
Consciemment ou inconsciemment, Godard est sensible à ce problème. Et il s’emploie à le contourner en associant l’aventure cinématographique à l’aventure picturale. Il déclare, dans la quatrième et dernière partie de son Histoire(s) du cinéma : « La peinture moderne, c’est-à-dire le cinéma », oubliant par la même occasion que très généralement la peinture, et singulièrement la peinture moderne, ne raconte pas d’histoires.
L’autre symptôme de ce malaise à traiter aujourd’hui d’une Histoire du cinéma n’a, autant que je sache, pas été remarqué par qui que ce soit, et pour cause, puisqu’il porte sur ce que Lautréamont présente comme une « formule définitive », « la meilleure : puisque c’est le roman ! »
Il y a ainsi à la fin des Chants de Maldoror une « théorie » du roman (indépendant des formes) qu’un certain nombre d’écrivains du XXe siècle ont en effet consacrée, à commencer par Marcel Proust avec À la Recherche du temps perdu.
Ce qui définit, dans ses réalisations les plus vivantes, l’œuvre romanesque ne consiste pas à utiliser un instrument, la langue, pour en finalité raconter des histoires (cela n’est plus pris au sérieux que dans les émissions littéraires de la télévision), mais se constitue (non pas histoire, mais monde) de ce qui appartient (historialement) à la langue, dans un état singulier de cette langue.
C’est, n’en doutons pas, cette langue qui fait défaut au cinéaste.
Au cours de ces quatre heures de projection, où je n’ai pas laissé mon attention se distraire, il me semble bien que le mot « roman » n’est jamais prononcé (bien que les titres d’un incalculable nombre de romans soient cités) si ce n’est une fois dans la dernière partie, où il apparaît sur l’écran sous la rubrique « Il y avait une fois », à propos d’un roman de... Ramuz. « Il y avait une fois un roman de Ramuz qui racontait qu’un jeune colporteur arriva dans un village au bord du Rhône et qu’il devint ami avec tout le monde parce qu’il savait raconter mille et une histoires. »
Comme on l’entend bien, pour Godard, le roman, comme le cinéma, racontent des histoires parce que l’Histoire dans la modalité de l’information historique est constituée d’histoires. N’est-ce pas cette seule conviction qui justifie la curiosité typographique du titre qu’il a adopté ?
Mais si l’Histoire, dont Heidegger dit qu’elle est « Avènement », n’était que l’Avènement, le dévoilement de l’historialité de la langue, telle que, dans ce dévoilement, elle fait roman : monde du dévoilement ?
Faut-il s’étonner qu’un cinéaste, et non des moindres, soit d’abord sensible à la technique (importance et virtuosité technique du montage dans cette Histoire(s) du cinéma) et à l’instrumentalité de la langue ?
Ce qui ne va pas sans embarras (et souvent même pesanteur) lorsque le metteur en scène décide d’associer cinématographe et littérature (poésie ou roman). Nous aurons ainsi, toujours dans la dernière partie, des formulations du genre : « Diderot, Baudelaire, Malraux, et moi je mets tout de suite après Truffaut » (sic). Affirmation volontariste qui s’impose un peu comme ce que je dirai... une salade russe.
Sont-ce ces embarras qui déterminent le nihilisme et le ton de plus en plus pathétique des discours, finalement confiés à Alain Cuny ? Faut-il mettre au compte de ces embarras la quasi-oblitération du cinéma porno, et le flou des quelques rares scènes où l’image d’un sexe, ou d’un acte sexuel, se trouve très vite rapprochée de l’image d’un cadavre ? Pour ne pas parler, en conséquence, dirai-je, quatre heures durant, d’une totale absence d’humour. Ce qui incontestablement différencie les dernières productions de Godard de celles qui l’ont révélé dans les années soixante.
CINÉMA ET POLITIQUE
Que peut le cinéma dans La Société du Spectacle ? En 1973, Guy Debord a cru devoir faire un film avec son livre. Le film ne va pas sans le livre. Et les qualités et l’efficacité du cinéma de Guy Debord tiennent d’abord à ce qu’il est d’abord un écrivain. J’ai été récemment étonné de découvrir, dans une librairie, l’édition de ses Œuvres cinématographiques complètes, sur les rayonnages consacrés aux livres de cinéma, alors que je cherchais le volume dans les œuvres littéraires.
VOIR
Que penser de ses films, que l’on a si rarement l’occasion de voir ? Ils gardent incontestablement toute leur efficacité politique dans la mesure où ils sont aussi justement pensés qu’écrits et où, quelle que soit la manière qui les caractérise, le discours, et ce n’est pas peu dire, excède la forme, pourtant fort difficile à oublier. En ce sens, ils ne ressemblent à rien d’autre, et ils continuent aujourd’hui encore à faire politiquement événement et avènement dans l’histoire ou les histoires du cinéma, dont ils dévoilent le caractère essentiellement réactionnaire et le politiquement correct des craintes, des plaintes, des revendications d’évolution sociale et morale dans le monde du spectaculaire intégré.
Il n’empêche, le pari pessimiste qui consiste à maintenir coûte que coûte ce qui est achevé, et souvent même déjà dépassé, peut dans sa torsion prendre des formes d’une certaine façon admirables, surtout lorsque leurs reflets se jouent des surprises qu’elles se font à elles-mêmes, en se troublant, comme un buisson touffu, dans un œil que ses qualités naturelles embarrassent.
En conclusion, cette Histoire(s) du cinéma justifie la pensée profonde de l’appareil et ce que, en conséquence, il se condamne à perpétuer sous des formes plus ou moins misérables et vulgaires.
Mais aussi, dans ce geste même, cette Histoire(s) du cinéma manifeste et dévoile, comme essence du cinéma, à l’ère du spectaculaire intégré, l’idéologie et le pessimisme profond qui président à toute production cinématographique (voir l’ensemble de la production cinématographique mondiale en cette fin de siècle). Et, en ce sens, cette œuvre cinématographique, car c’en est une, ne manquera pas de troubler la quiétude, l’état de repos angoissé de l’intégration généralisée du monde du spectacle cinématographique, littéraire, artistique et autre. Parions, dès aujourd’hui, qu’elle rencontrera, de façon précipitée, une forme d’accord superficiel, destiné à marquer un refus radical, une forme de refus qui ne pourra être objectivement qu’un accord profond. En ce sens, à sa façon elle fait date.
Les voyageurs de l’an 2000, Gallimard, p. 236-247.
LIRE SUR PILEFACE :
La spécificité cinématographique et la politique « révolutionnaire » (Cinéthique n°3, mars 1969)
Sur les avant-gardes révolutionnaires (par Pleynet, Kristeva et... Godard)
et Vita Nova. Écrit en dansant.

Dernier photogramme du volume 2 des Histoire(s) du cinéma.
ZOOM : cliquer sur l’image.

Voici, pour (ne pas) finir, un extrait du chapitre de L’oeil du prince [6] consacré à Jean-Luc Godard sous le titre « Leçon de ténèbres ». Il faut le lire en se souvenant que les Leçons des Ténèbres sont un genre musical liturgique créé en France au XVIIe siècle et destiné au premier des trois nocturnes qui accompagnent chaque office des Ténèbres (matines des jeudi, vendredi et samedi saints). Ce sont des « lamentations ». Les plus célèbres sont celles de François Couperin, Marc-Antoine Charpentier, Michel Corrette, Michel-Richard de Lalande. Rappelons également que Guy Debord a choisi la sonate de Michel Corette, Les Délices de la Solitude pour son film La Société du spectacle (1974).
Leçon de ténèbres
par Thomas A. Ravier
[...] Nous sommes en 1988. Histoire(s) du cinéma : avec un s. Un homme se filme lui-même, ce qui n’est pas habituel. Écrivant, écoutant, parlant, improvisant, murmurant, chantonnant, chuchotant-hurlant s’il le faut. Torse nu comme le sont souvent les peintres et les écrivains ; debout comme un chef d’orchestre. Solitaire et très accompagné, dans sa bibliothèque. Comme le souligne Philippe Sollers, il s’agit d’une attitude résolument liturgique. Plan sur la main qui écrit (on n’est jamais trop concret). Du reste : « J’ai toujours dit que pour continuer à faire des films, je préférerais perdre mes yeux que perdre mes mains. » Qu’est-ce qu’un film composé, touche après touche, à partir de la main plutôt que l’œil ? Y a-t-il un ruban du temps à dérouler in extremis de sa bobine ?
« Peut-on raconter le temps ? Le temps en lui-même ? »
Un cinéaste aura fini par poser la question. Sur son lieu de travail. Dans son atelier (bruit de la machine). Partant d’un point précis. Parlant d’un point en particulier (plan sur le micro).
Est-ce un imprécateur ? Un prophète ? Un farceur ? Un survivant du spectacle ? Un suicidé du cinéma ? Un bouffon briffé ? Un saint ? Un historien émotif ? Un exorciste ? Un archiviste amnésique ? Un traître ? Un illuminé ?
Une voix.
Le cinéma se croyait seul, quelqu’un lui répond.
Dès lors, cela peut parfaitement se poursuivre en dehors d’une œuvre répertoriée : encore récemment, pla cer dès l’ouverture de son exposition apocalyptique de Beaubourg, dans la salle inaugurale, une reproduction de L’homme qui marche de Giacometti, puis écrire personnellement, moi Jean-Luc Godard, à la main, en dessous, « je ne marche pas », est un effet d’interruption bricolé mais foudroyant du tourbillon des apparences culturelles. C’est déjà du montage, une forme à la fois inapparente et décisive d’intervention d’une éloquence primitive saisis sante, surtout quand on connaît le rapport godardien à l’État (irréconciliable. L’enfance de l’art, en effet. On sent très bien que pour dire ça, un discours, même hâté, ou un texte, même bref, auraient été encore trop intellectuels. Mondains. Pas assez intuitifs. Trop peu physiques. Tortueux. Tordus. Triviaux. Académiques.
A-t-on jamais mieux exprimé au contraire, et dans une immense simplicité, ce que la marche peut être un principe moins mécanique que politique, donc impossible à interrompre, non socialisable ? Et soudain : voici un marcheur qui a tout son temps contrairement à nous ! Détalant sur les talons ! Sur son talent ! Le contraire d’un touriste. Frêle, mais volonté de bronze. Un surfeur, toujours sur la crête de l’événement. Suivant le rythme de la lame. En sursis sur ses rails émotifs. Irrattrapable, donc. Je marche donc je suis. Stop. Qui m’aime me suive dans le Temps. Stop. Bon pied, bon œil ! Stop. C’était un message d’adieu. Le marcheur a semé le marché. Vous aurez de ses nouvelles dans les siècles futurs si vous pensez jusque-là.
Il ne faut pas regretter, je crois, l’échec de l’exposition de Beaubourg mais tenir son programme imaginaire initial comme suffisant en soi poétiquement. Un générique de rêve, en somme. Ainsi, de salle en salle :« Le mythe (allégorie), l’humanité (l’image), la caméra (métaphore), le(s) film(s) (devoir(s)), l’alliance (l’inconscient, totem, tabou), les salauds (parabole), le réel (rêverie), le meurtre (sésame, théorème, montage), le tombeau, (fable). »
Qu’ajouter, finalement ?
C’était il y a quelques mois dans le centre de Paris. Néanmoins, la présence d’esprit est celle de quelqu’un qui, douze ans plus tôt, pour une commande de la Gaumont, dans son autoportrait JLG par JLG a choisi de ne plus se laisser raconter à travers des passions collectives ou une scénarisation extérieure et de remplacer les aventures futiles que conte le cinémapar l’examen d’un sujet important [7] : lui même. Film dans lequel, en l’occurrence, Godard marche beaucoup. Faisant courir Gaumont ou le cinéma.
Alors oui j’ai admiré Godard ! Je trouvais formidable qu’un cinéaste puisse affirmer : « J’aimerais rendre mon corps moins intellectuel. Mon rêve c’est d’apprendre à faire des cabrioles. » S’il y a quelque chose de touchant, héroïque même, dans les Histoires du cinéma, c’est, pour moi, cette volonté de s’extraire du groupe afin que, pour la première fois, le cinéma concerne un individu seul. C’est cette manière d’introduire son corps, un corps moins intellectuel, quitte à le dénuder. Le pire du cinéma de Godard est effectivement sa part cérébrale et l’on se dit que ce cinéaste a eu raison de vouloir se faire sauter la tête, en l’entourant, un beau jour d’été, au bord de la Méditerranée, d’un rouleau de dynamite... Bel exorcisme estival. Le ciel s’en souvient.
Oui, j’admirais qu’un cinéaste dans la tourmente, plutôt que de prétendre que tout ce qui est bon apparaît, ou que tout ce qui apparaît est bon, à un malheureux journaliste culturel, quant à savoir si lorsqu’il lit un roman il imagine des images, puisse répondre : « Si c’était le cas, je serais un mauvais cinéaste. Quel intérêt de voir une jeune fille penchée sur l’oreiller quand on lit Albertine disparue ? » J’étais prêt, pour une réponse comme celle-ci, à fermer les yeux sur cent mille affirmations ridicules. Cette perle, par exemple : « La période de l’art nègre de Picasso est venue à l’époque du cinéma. Elle n’est pas motivée par le colonialisme, mais par le cinéma. » Et celle-ci : « Avec Manet commence la peinture moderne c’est-à-dire le cinématographe. » Et celle-là :« Pour moi les images, c’est la vie, et les textes, c’est la mort. » Symptomissime : « La force de la Bible, c’est que c’est un beau scénario. » Consternant pour consternant, dans Je vous salue Marie, l’ange Gabriel devient un Boeing, et son message une cassette vidéo !
Non, non et non, Passion, je vous salue Marie ou Nouvelle Vague ne disent rien de la déroute de la crucifixion, de la merveille de l’annonciation, de l’étonnement burlesque de la résurrection. Ainsi, dès le premier épisode des Histoire(s) du cinéma, un détail d’importance me pose problème. Le Noli me tangere de Giotto que Godard a détourné de son sens grâce à une affligeante rotation de l’image ! Ça tourne ! Qu’on ne me dise pas que nous sommes ici dans le collage artistique : nous sommes dans l’image pieuse. La main du Christ, celle de son orgueilleuse indépendance charnelle, est devenue un appel au secours en direction de Marie Madeleine surélevée, déifiée, une invitation à le rejoindre, lui, le Sauveur, au sépulcre ! Au rendez-vous du tombeau ! Bravo, beau vœu de conjugalité terminale... un beau happy end identitaire : accorde-moi donc ta main pour une noce de béton. Pas de montée au ciel, plus de père (c’est l’époque). On se bornera à entretenir gentiment son jardin (puisqu’on est jardinier). On fera pousser, à la limite, quelques fleurs autour du catafalque, gentiment, le dimanche... Et ils vécurent heureux dans leur sépulcre et eurent beaucoup de cinéphiles ! À la maison, le Sauveur... Encore un peu et on assistera à la scène où Jésus, chez lui, plie délicatement son linge, repasse ses bandes, dans le meilleur des scripts ménagers possibles... Oubliées, nos aventures corporelles légendaires. Et tant pis pour la clandestinité lévitatoire heureuse !
Dieu, s’il existe, est un gentil mari (qui lit avant de s’endormir, dans son canapé Ikéa, quelques pages du Da Vinci Code).
Amen.
Chez les cinéphiles, on ne monte que chez la mère : lire Gide.
Longtemps, j’ai loué chez Godard cette conscience précoce de ce que le Spectacle est d’abord une modification du langage sous emprise publicitaire générale. Comme dans Pierrot le Fou (nous sommes en 1965). J’ai vanté, chez ce suicidé du cinéma, cette obstination héroïque à vouloir faire advenir la parole, ainsi que dans cette scène d’action haletante — pour moi une des plus fortes de l’histoire du cinéma — dans Deux ou trois choses que je sais d’elle, autour de la tasse de café : avec comme résultat immédiat ces images élégiaques d’un Paris léger, printa mer.
Sur l’usage d’images cinématographiques antérieures dans ses films, Guy Debord écrit : « Ces films de fiction volés, étant étrangers à mon film mais transportés là, sont chargés, quel qu’ait pu être leur sens précédent, de représenter, au contraire, le renversement du "renversement artistique de la vie". »
Ce qui nous ramène aux Histoire(s) du cinéma.
Dix années de travail. Une leçon de ténèbres (pour Godard, le cinéma a toujours été une sorte de ville sainte pécheresse dont les oppresseurs ont triomphé), pleine de lyrisme et de charme burlesque durant laquelle, une à une, les illusions cinéphiliques sont soufflées, jusqu’au noir complet. Oui, complet. Pour la première fois, quelqu’un nous dit ce qu’il en est de ce deuil photographique (celui du réel), de cette industrie « vendue à l’industrie de la mort », de ce XXe siècle fantomal mais entièrement colorisé. Ce sont des précisions historiques d’importance qui jamais, jamais, n’avaient été formulées jusqu’ici.
Premièrement, l’histoire du cinéma est moins liée à celle de la peinture que de la médecine : « Toute la fortune de Kodak s’est faite avec des plaques de radio, pas avec Blanche-Neige » ! Ici, Godard s’empare enfin du récit en faisant intervenir sa mémoire individuelle, son expérience biographique paternelle :« Je me souviens des plaques que mon père utilisait en radiologie. C’étaient des négatifs Kodak » (Libération, 15 mai 2004).
Deuxièmement, les corps torturés d’Eisenstein, par delà le Caravage et le Greco, « s’adressent aux premiers écorchés de Vésale » !
Troisièmement, le premier bouquet de fleurs de Nadar n’a rien à voir avec une rose de Cézanne : « Il la nie. »
Et maintenant, on peut commencer de discuter sérieusement, avant que les vampires ne s’évaporent. À travers diverses aventures vocales, nous voilà confrontés à un grand roman plastique intuitif et suggestif : les choses avancent directement, comme des masses de sens tactiles, se heurtant miraculeusement, s’entremêlant suggestivement dans la chair épiphanisée du temps, et ce par contagion émotive naturelle. Pas d’idées, pas d’opinions. Des images ? Pas du tout. Rien n’apparaît, tout est audible. Rien n’est dit, sur le mode volontariste ou militant [8], et pourtant tout se parle. C’était possible ! On peut dénoter organiquement ce qui dans le communisme s’avère vraisemblablement hollywoodien, et réciproquement, par des preuves implicites de l’allégeance stalinienne d’Eisenstein et de la soumission des cinéastes américains aux usines à rêves des grands studios. Actualité de l’Histoire ? Actualité d’une collision. Celle du XXe siècle que ses œuvres d’art les plus fondamentales viennent percuter massivement, une par une, dans un désordre artistique volontaire, par frémissements concertés du réel... Oui, le réel chaloupé se hérisse, il tremble, vibre devant nous, se contracte. On peut déterminer la sombre complicité entre l’occupant allemand et l’administré français contre la vieille part désirable de gaieté sexuelle hexagonale (et le miracle de son transfert provisoire outre-Atlantique) en laissant librement dialoguer une scène dansante d’Un Américain à Paris et l’image d’un fusillé au poteau phallique des bourreaux. L’Histoire interrompt son cinéma : en un plan. Le passé se montre, se démonte : en se montant. Un passé enfin rendu sensible à l’œil et à l’oreille par la confrontation d’événements mal employés jusqu’ ici, en tout cas séparés artificiellement.
Vous devez pouvoir le ressentir dans un récit plus frémissant, plus présent, plus émotif, plus guttural. Plus incandescent. Vous êtes en contact avec un siècle complet sous la forme d’une étrange expérience spirite d’une densité noire affolante.
Pour commencer, essorer au maximum le linge de Véronique sur lequel, entre nous, trop sont venus essuyer leurs pleurs ces derniers siècles. Exercez-vous ! Jamais le spectateur de cinéma n’avait joui d’autant de liberté (même si l’expérience exige une énorme concentration). À chacun de trouver son bonheur, de se faufiler poétiquement dans le siècle, en fonction de sa sensibilité, de sa vitesse d’esprit.
Un plan de Napoléon (d’Abel Gance) de retour d’exil était sans doute la meilleure manière d’exprimer l’état d’esprit des jeunes gens de la Nouvelle Vague lorsqu’ils se rendirent chez Henri Langlois : un magnifique raccourci, un bel éclair narratif tirant de l’absence d’explication directe sa profondeur ouverte, sa lumière clarificatrice.
Et ainsi de suite.
Démonstration rapide de ce mois de juin français poignardé par Hitler à travers un tableau de Seurat.
Et ainsi de suite.
Une image de Nosferatu placée comme il faut résonne soudain métaphoriquement comme le regard du néant sur nous, qui est aussi celui du cinéma [9] !
Et ainsi de suite.
Le monstre de Freaks nous raconte pour la première fois à quoi il pense... (pourquoi pas à Albertine).
Marilyn et Hitler avaient peut-être, sans qu’on s’en doute, un rendez-vous secret à Berlin ?
Nous savons désormais d’où nous vient la silhouette vagabonde de James Dean : d’un poème de Baudelaire, Le Voyage.
Max Linder nous parle de l’Amérique de Bush !
La voix de Cocteau prend soudain une clarté prophétique que le poète lui-même n’aurait jamais soupçonnée.
Rêvons un peu... voici le drapeau français, pour une république en couleurs, peint par Nicolas de Staël... Remarquez que, inversement, la photo de Mitterrand dans La Monnaie de l’absolu nous sort brutalement de la léthargie militante, elle prend sa place, grâce à Victor Hugo, parmi d’autres portraits de tyrans européens, entre la rose et la francisque.
Je remarque.
La grâce peut être provoquée. L’histoire doit être bousculée. Le Temps va être dégoupillé. C’est une question d’objectivité, de faculté manuelle (de toucher : toujours la main qui déroule le ruban), d’oreille (et non d’œil), et, quel que soit le sujet, j’insiste, d’humour.
Or, l’humour, cette grande qualité érotique, n’est pas ce qui caractérise un enfant métaphysique de Malraux (le mauvais ange de Godard). Godard, ce comparatiste enfiévré, titube devant le réel lorsque le réel est trop à vif, trop saignant, en un mot trop sexuel (c’est Poirot-Delpech qui surnommait Malraux le « comparatiste titubant »). Il court ainsi se réfugier au musée imaginaire. Maman ! D’où cet autre visage, celui d’une œuvre dénaturée par sa grandiloquence, sa mélancolie muséale, emphatique, kitsch, etc. Messianisme chic. Le grand bazar suisse, en somme. La grande misère puritaine universelle, en résumé.
Si j’étais Godard, je me serais empressé de joindre à ses histoires du cinéma ce passage explosif de La Main au collet, lorsque Cary Grant rejoint la nébuleuse française criminelle à Monaco, et l’affolement sexuel admirablement mis en scène par Hitchcock que provoque ce corps américain, anglais même — donc quelque part innocent —, en 1953. De même, peut-être Godard aurait-il pu s’attarder plus longuement sur Un Américain à Paris, la preuve au-delà des discours des répercussions musicales de cette présence américaine dans la France comateuse et figée de 1951 : si un homme a traversé le paradis, non pas en songe comme dans le conte de Borges mais pratiquement, physiquement, concrètement, et en a rapporté une rose — revoyez donc le film —, c’est Gene Kelly ! Mais Gene Kelly, c’est également cette leçon de danse administrée au Français Yves Montand dans Le Milliardaire de Cukor (1960), une leçon de danse qui a toujours été pour moi hautement métaphorique. Au sujet du chapitre Fatale beauté et pour illustrer cette consommation effrayante que le cinéma aura fait du vivant, il y avait le film extraordinaire de Franju, Les Yeux sans visage ! Avec, pour l’accompagner, la lecture de Une charogne ou du Voyage à Cythère... Les Yeux sans visage ? Ce portrait de cinéaste en chirurgien obsessionnel, obnubilé par l’identité génétique de ses patientes, rappellera, selon qu’on ait plus au moins d’imagination historique, une période précise. Cela permet d’envisager le cinéma comme le prolongement populaire évident des diverses expériences scientifiques du XXe siècle sur l’être humain. Après vous, mademoiselle... Welcome Welcome ! L’ogre à la caméra vous attend... Le fait est qu’on n’avait jamais, jusqu’au film de Franju, indiqué de manière aussi précise les similitudes entre un plateau de cinéma et une salle d’opération, donc quelque part entre l’actrice d’un film et une patiente médicale entièrement soumise biologiquement. D’où l’intérêt. Malgré divers masques cosmétiques, malgré l’illusion publicitaire fanatique, le spectateur doit pressentir la décomposition — placer ici un plan sur le visage nécrosé, après l’échec de son opération, d’Édith Scob. Réveil brutal. L’écran séculaire du cinéma se déchire. Il y a du sang sur la marguerite... Après cela, et après cela seulement, on peut avancer comme Godard que, en effet, le regard de Joan Fontaine n’a rien à voir avec celui d’une héroïne de Delacroix mais, fondamentalement, est le même que celui du chien de Pasteur. Le Spectacle est une immense greffe nocturne au service du pacte médico-légal. La femme n’a jamais existé au cinéma, ou presque. La déesse organique et publicitaire émergeante est le résultat de ce tourisme de masse à Cythère. Finalement, il est normal que les rares manifestations cinématographiques de liberté féminine dissimulent en réalité un plus ou moins discret rappel à l’ordre moral. Ici, juxtaposer le monologue de Françoise Lebrun dans La Maman et la Putain et celui de Molly Bloom dans Ulysse... Molly Boum ! Effet garanti. Merci Joyce. Thank you Satan.
Une tout autre intelligence de la cinémathèque et voilà, le puritanisme familial du cinéma est confondu sans avoir eu besoin de dire un mot, de « forcer » théoriquement. Question de lectures. Mon sentiment est qu’il y a deux grands absents par rapport au projet que constituent ces Histoire(s) du cinéma : pour commencer Claudel, qui aurait permis à Godard, puisqu’il s’agit d’une célébration, de mieux se positionner liturgiquement ; puis, l’anti Malraux atomique Artaud dont l’écriture, c’est le moins qu’on puisse dire, se démarque paternellement des grandes manipulations historiques du siècle. Sans parler des situationnistes dont Godard semble s’être énormément inspiré depuis le début sans retenir que la question de la citation s’inscrivait pour eux dans une perspective de destruction farouche du passé culturel, tout cet aspect patrimonial pompeux qui, je le répète, ramène ces Histoire(s) du cinéma en deçà de ce qu’elles auraient dû, ou pu être.
Du côté des partisans fanatiques de Godard, nous avons Antoine de Baecque qui soutient dans les Cahiers du cinéma que les Histoire(s) sont extrêmement baroques, et pas du tout protestantes. C’est partiellement faux, et c’est toute la question.
Du côté des adversaires fanatiques de Godard, il s’agit plutôt de laisser croire que ce dernier souffre trop de ne pas être écrivain. Or, si la démarche de Godard est foncièrement littéraire, ce n’est pas dû à l’usage culturel qu’il fait des œuvres d’art dans ses films mais au contraire à ce grand projet de métamorphose pour lequel son sens du rapprochement improbable comme paradoxalement son dilettantisme font merveille. Les discours sont pris de vitesse. Donc les images : « Le vrai cinéma était celui qui ne peut se voir, n’était que celui-là. » Ce qui est en jeu est ici vertigineux, attention, et mérite d’être appelé, en effet, l’enfance de l’art (les formes dialoguant d’elles-mêmes objectivement grâce à des fragments ressuscités d’œuvres antérieures). Même si, selon moi, au risque de me répéter, le manque d’humour de Godard, son manque de distance, trop de subjectivité, ramènent le projet à l’état de velléité. Au cinéma, le Temps manquera toujours de temps libre pour ses jeux poétiques. Le principal est que l’on ait senti ce que le créateur cherchait, et touche par instants : la chose qui parle d’elle-même, nous bondissant presque dessus (tout le reste est journalisme). Puisque : « Une comparaison par bonds successifs entre réalité secrètement analogue et l’aptitude à poser des questions paradoxales sont bien plus utiles que la rigueur méthodique » (Nietzsche).
L’aptitude à poser des questions paradoxales sans forcément pouvoir — ou vouloir — y répondre, telles sont les qualités évidentes de Godard, celles qu’on ne peut lui retirer, avec lesquelles il a traversé obliquement, toujours caustique, toujours impertinent, la société française ces cinquante dernières années (et au-delà desquelles, personnellement, je trouve raisonnable de ne pas aller le chercher). Je me souviendrai toujours de la stupeur de ce présentateur lorsque, à la question de savoir qui pourrait-on choisir pour illustrer un nouveau billet de banque, Godard avait répondu « Hitler ». Une image juste, et non juste une image. Ces qualités d’improvisation, ce don de la rupture dramaturgique, font que, malgré tout, une forme d’électricité poétique (et même, contre toute attente, une sorte de « texte-appeal ») reste perceptible dans les Histoire(s) du cinéma. Voyez comme, à côté, la plupart des créations contemporaines, y compris les plus intéressantes, semblent bêtement pédagogiques, privées de la souple opacité de l’ouverture poétique qui fait seule, en tout cas pour moi, qu’une œuvre, fût-elle critique, puisse être pensante [10].
Ce qu’est, pensante, l’œuvre si peu intellectuelle ou médiatisable dans sa forme de Debord : de par sa qualité rythmique d’insolence, de par l’orgueilleux resserrement harmonique, presque exagéré, mat et introversé, de sa prose — sans compter ces mêmes superpositions haletantes. Ce qui ne signifie en rien qu’on puisse comparer les deux hommes, paresseux réflexe contemporain : au contraire de Debord, tout le problème de Godard est de n’avoir jamais su intervenir réellement au cœur de l’imposture cinématographique, notamment cette fausse coïncidence industrielle de l’image et du son, et ce malgré quelques tentatives mémorables (une des meilleures idées de Godard — avoir montré à l’image les chèques de son producteur — étant néanmoins de Jean-Pierre Gorin avec qui il réalise le film). D’où son désespoir chronique religieusement scandé. Son nihilisme actif.
Comme le lui écrira Truffaut dans une lettre piquante :
« Quand même, tu continues à perdre des heures au cinéma à t’esquinter les yeux. Pourquoi ? Pour trouver de quoi alimenter ton mépris pour nous tous, pour te renforcer dans tes nouvelles certitudes ? »
S’il s’agit de dire que Godard n’est pas ce que Proust appelait un « artiste heureux », nous sommes entièrement d’accord. Mais comment un homme de cinéma pourrait-il l’être ? (à la limite s’il est américain). La chair est triste et les cinéastes n’ont rien compris des livres qu’ils ont lus. Voilà pourquoi, j’imagine, Godard semble toujours satisfait de trouver quelqu’un pour formuler plus énergiquement ce mauvais rapport au langage, cette mauvaise hygiène romanesque dans laquelle le cinéma le maintient depuis trop longtemps. Son masochisme évident continue à lui faire préférer une position autocritique douloureuse dans le cinéma au lieu de, conscient plus que d’autres de la nature démoniaque du langage cinématographique (« il y a une mauvaise diction dans le cinéma »), renoncer à sa relation avec son enfer une fois cet enfer enregistré, enregistré de l’intérieur. Lorsqu’il répète pour la énième fois que le cinéma a échoué dans sa mission historique, manquant à sa fonction, c’est de lui, en tant qu’artiste, bien entendu, qu’il parle ! Le romantisme expiatoire de Godard pressenti par Truffaut s’exprime ainsi de la façon suivante : le cœur gros de rancune, ne parler que dans la perspective de cette malédiction cinématographique pour mieux se plaindre des effets de cette position condamnée, cherchant ou feignant de chercher dans le cinéma, telle une réponse de la lumière, la totalité d’une vérité de parole enfantine qu’il sait, lui, Godard, par ailleurs — il l’a dit ! —, ne pouvoir y être contenue.
Bravo. Beau sophisme protestant. Amer savoir celui qu’on tire du cinéma ! Cette conviction ahurissante selon laquelle notre histoire individuelle ne nous serait accessible qu’à travers le cinéma (c’était également l’opinion de Daney) est là, en réalité, pour justifier un désespoir profond. Quelle bande d’esclaves, tout de même ! Cela revient à dire qu’une machine contient l’essentiel de votre mémoire, malheureux ! Le nihilisme passif des cinéphiles s’exprimant, lui, à travers ce détail religieux qui m’a toujours amusé énormément : la dernière séance.
Finalement, le mieux est d’être très calme pour évoquer Godard, ni excessivement élogieux par volonté de préserver le culte, ni excessivement critique, attitude qui cache généralement une naïve volonté iconoclaste, un besoin puéril de scandale spectaculaire, le désir de se singulariser inutilement au sein des admirateurs culturels. Bien sûr que les huit petits films des Histoire(s) du cinéma n’ont absolument rien de commun avec Finnegans Wake (pitoyable raccourci cinéphilique), mais, inversement, ils peuvent nous bouleverser, ils ponctuent magnifiquement le siècle, de façon à la fois intrigante et lyrique. Godard est un petit bricoleur inspiré (un zappeur fou), parfois fulgurant, capable d’intuitions géniales, d’un grand sens incantatoire ; Godard est superficiel, fastidieux, coincé, désenchanté, inculte, pompeux voire pompier.
Cela étant dit, comme le rappelle Sollers [11], il est un des seuls avec Debord à avoir entrepris la critique directe de cette incroyable aliénation industrielle par l’image. Dès 1966 : « Il n’y a pas besoin d’événements fortuits pour photographier et tuer le monde. » Pour le Journal de 20 heures ?
Lorsque, il y a quelques années, le cinéaste fut violemment pris à partie par mon ami Stéphane Zagdanski [12], j’avais été surpris de son incapacité à répondre à ces accusations, comme par exemple d’incarner à lui seul la morbidité cinématographique. Quelle mollesse. Quelle apathie. Quel las brisé ! Il lui aurait été facile, pourtant, de réagir et de définir en quoi, au contraire, lui seul est parvenu à plusieurs reprises à formuler la nature exacte de ce noyau ténébreux qui constitue le cinéma. Répétons-le, donc : Godard, plutôt que de participer à cette entreprise fanatique de cosmétisation globale, a choisi délibérément et depuis longtemps de travailler sur la négativité, comme avec ce requiem radical, cette messe apocalyptique et par fois clownesque, ces leçons de ténèbres athlétiques que sont ses Histoire(s) du cinéma.
En connaissance de cause : « Car encore, puisqu’il avait voulu imiter le mouvement de la vie, il était normal, il était logique que l’industrie du film se soit d’abord vendue à l’industrie de la mort. Ô, combien de scénarios sur un nouveau-né, sur une fleur qui pousse, mais combien sur des rafales de mitraillettes. Parce que voilà ce qui s’est passé. La photographie aurait pu être inventée en couleurs. Elles existaient. Mais voilà, au petit matin du XXe siècle, les techniques ont décidé de reproduire la vie.
On inventa donc la photographie. Mais comme la morale était encore forte, et qu’on se préparait à retirer à la vie jusqu’à son identité, on porta le deuil de cette mise à mort. Et c’est avec les couleurs du deuil, le noir et le blanc, que la photo se mit à exister ; pas à cause de la gravure. Le premier bouquet de fleurs de Nadar ne recopie pas une lithographie de Dorée, il la nie ; et, très vite pour masquer le deuil les premiers Technicolor prendront les mêmes dominantes que les couronnes mortuaires. »
Comme il est loin, pourtant, ce premier bouquet de fleurs de Nadar... Comme il semble désuet, sympathique, émouvant... Comme il a l’air presque vivant, à côté de notre bouquet satellite...
Finalement, le cinéaste aurait dû cueillir ce petit bouquet, discrètement, puis disparaître... loin du charnier...
Il ne le fait pas. Il s’en veut. Il se désespère.
J’écoute Godard avouer une fois de plus son immense mélancolie de cinéaste. Il n’y a pas de bonheur possible, dit-il. Le cinéma est fait de renoncements perpétuels. Je devrais arrêter, je continue. Il ajoute :« Avec un immense regret. »
J’appelle idolâtrie cette manière d’avoir en permanence la larme à l’œil. C’est une passion. Elle fatigue.
Goodbye, Mister malchance ! Goodbye et bonne nuit !
Finalement, la meilleure définition de Godard, c’est lui-même qui l’a donnée en parlant de son ami Serge Daney :« On retiendra une ou deux formules, mais je ne sais pas si on retiendra une pensée. Il y avait une recherche, un mouvement, une agitation, le regret d’être seul, mais je ne sais pas s’il y avait une pensée. »
Le 17 août 1959, au matin du premier jour de tournage d’À bout de souffle, Godard rédige un petit mot à l’attention de son producteur : « C’est lundi, Georges de Beauregard, il fait presque jour, la partie de poker va commencer. »
Ni tout à fait perdue. Ni tout à fait gagnée.
Thomas A. Ravier, L’oeil du prince, Gallimard, 2008, p. 249-267.
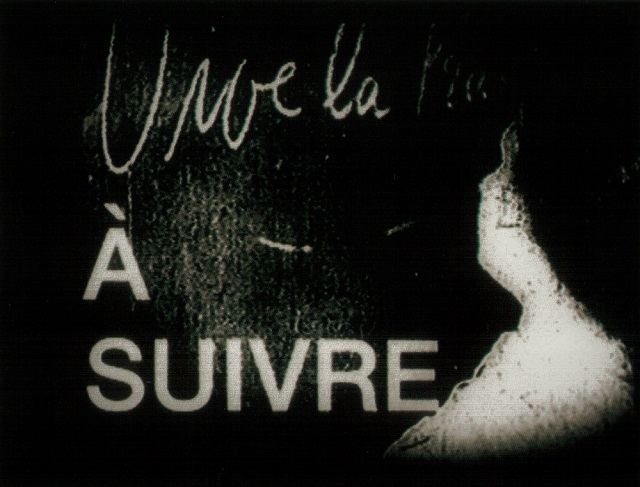
Dernier photogramme du volume 3 des Histoire(s) du cinéma.
ZOOM : cliquer sur l’image.

LIRE AUSSI :
Jacques Rancière, « Une fable sans morale : Godard, le cinéma, les histoires », dans La fable cinématographique, Seuil, 2001, p. 217-237.
Jean-Luc Godard dans l’interminable relève des archives du mal
[1] Repris dans Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, Paris, éditions Cahiers du Cinéma, 1998, tome 2, p. 161.
[2] Voir plus bas.
[3] Voir, à ce sujet, cet entretien radiophonique du 31 mars 2010 (avec Antoine de Baecque et Jean Narboni).

[4] J’ai publié des extraits du texte de 1969 dans Tel Quel versus Godard. On peut se demander si une telle définition peut s’appliquer, telle quelle, à l’usage que fait Godard, au montage, des séquences vidéo dans les Histoire(s) du cinéma. A.G.
[5] Erreur tragique ? Précisons que Mallarmé est mort en 1898 et que le film de Feuillade est de 1913. A.G.
[6] L’œil du prince, désignait, dans un théâtre à l’italienne, la loge située au centre du premier balcon, point d’où l’on voit le mieux.
[7] Debord, In girum imus nocte et consumimur igni, Gallimard, 1978.
[8] La crispation pédagogique ou le manque énigmatique qu’accumule dans l’agencement rationnel des idées la sphère officielle de la pensée et que Godard met d’ailleurs en scène ironiquement, me semble-t-il, à travers son inutile conversation mondaine avec Daney dans le second volet.
[9] Même si exprimer la réalité du cinéma à travers un vampire expressionniste, c’est encore nourrir, inconsciemment, la grande machine sociale à fantasmes.
[10] D’où ma passion persévérante, au moins théoriquement, pour ces Histoire(s) du cinéma, même si j’y aurai attendu en vain dans sa totalité ce qu’il faut à une grande œuvre de mystère et d’évasivité d’un côté ; de précision clinique et de mémoire impitoyable — et drolatique — de l’autre.
[11] Éloge de l’infini, Gallimard, 2001.
[12] Zagdanski-Godard, dialogue autour de La mort dans l’oeil, 4 novembre 2004.

LIRE AUSSI : Thomas A. Ravier, Le K Zagdanski.




 Version imprimable
Version imprimable