 06/07/2014 : restauration fichier audio + ajout citations, illustrations et section « La guerre d’un dieu : Dionysos »
06/07/2014 : restauration fichier audio + ajout citations, illustrations et section « La guerre d’un dieu : Dionysos »


![]() Ecoutez (60’)
Ecoutez (60’)
Le pseudo que s’est choisi Sollers n’est qu’une variante d’ Ulysse. L’auteur nous l’a dit plus d’une fois et le redit dans Guerres secrètes :
« Je prends alors le nom d’Ulysse, « Sollers », lequel nom me renvoie immédiatement à ce qui fut pour moi, très tôt, l’éblouissement de L’Odyssée : ce héros, comme nul autre, m’a paru le plus vivant. Imitation consciente, devant la sublimité du texte lui-même. Grande efficacité aussi de ce modèle, jamais là où on voudrait lui assigner une place. »
Guerres secrètes avec aussi en exergue :
Et nous devenus matelots sur le bateau d’Ulysse
toujours nous servirons Dionysos
Euripide


- Philippe Sollers en Grèce, 1978
La guerre d’un dieu : Dionysos
Extrait de Guerres secrètes.
Pour aller vers ce dieu grec, si étrange, et sur lequel il reste sans arrêt des choses à dire — puisqu’il est la mobilité même, le masque, la métamorphose incessante —, il faut rappeler quelques données.
Il a d’abord deux naissances. Dionysos est conçu de l’union de Zeus et d’une mortelle, laquelle influencée par Héra fort jalouse, qui lui suggérait de demander à son amant de lui apparaître dans toute sa gloire, est foudroyée, alors que le fœtus divin n’a que six mois. Il est donc introduit dans la « cuisse » de Zeus lui-même, qui lui donne une deuxième naissance, le moment venu. Notons que Zeus a suscité, au moins deux fois, une jalousie intense de Héra : lors des naissances d’Athéna et de Dionysos.
Lisons sur ce point Marcel Detienne :
« La colère d’Héra est très grande, elle vient se plaindre de la conduite de son époux, non pas de ses infidélités qui lui donnent parfois de l’humeur. Mais pour avoir avalé Métis et pour avoir englouti toute la ruse du monde, Zeus devenu gros d’une fille sans mère a engendré de lui-même Athéna. Il est devenu père sans l’aide de son épouse, à lui seul il possède les deux noms de père et de mère. Héra se trouve dessaisie de son pouvoir essentiel : la légitimité du lit conjugal. La naissance insolite d’Athéna dénie sa souveraineté sur la couche royale. [1] »
Un Dieu à la fois père et mère, nous avons cela dans d’autres coordonnées. Retenons surtout, pour notre propos, que la persécution de Dionysos sera le fait de Héra.
Je commence par le mythe de Zagreus, la façon dont les Orphiques racontent l’histoire de Dionysos. On a retrouvé des graffitis avec ces inscriptions : « vie - mort - vie » ; plus étrange : « vérité -Dio » ; plus intéressant encore : « paix - guerre » et « vérité - tromperie ». Voilà ce que les Orphiques disent d’eux-mêmes. Il est fort intéressant de voir que tout cela touche la couche la plus profonde, la mise à mort de Dionysos par les Titans.
Sur le conseil de Héra, ils attirent l’enfant Dionysos et l’égorgent, le font bouillir, rôtir, à l’exception de son cœur. Le « cœur absolu » de Dionysos échappe à cette scène sauvage. Mais cela n’a rien à voir avec Osiris. Nous sommes ici dans le fond grec : d’où viennent les mortels ? Des cendres (ou de la suie) des Titans foudroyés par Zeus. Ils sont définis comme porteurs d’un meurtre originaire et c’est pour cela qu’il faut regarder par là. Je sais bien que l’on nous parle évangéliquement du « père du mensonge, homicide depuis le début », mais en grec, la sauvagerie dont sont issus les mortels eux-mêmes consiste à avoir entraîné un dieu enfant - c’est le massacre d’un innocent -, dans une violence qui rejaillit en pluie fine de cendres et de suie sur l’espèce humaine elle-même.
Ce dieu, qui est toujours représenté entre vie et mort, et comme né plutôt deux fois qu’une, vient hanter les mortels, à commencer par les Grecs eux-mêmes. Il est sûrement le plus grec des dieux grecs puisqu’il clôt le cycle et que, dernier dieu, c’est lui qui accomplit la boucle des dieux. Qu’il soit inséparable d’Apollon est encore une autre affaire.
Que dire de sa naissance avec une mortelle ? Zeus engrosse Sémélé, laquelle lui demande ensuite de se montrer à elle dans toute sa puissance. C’est une ruse de Héra. Zeus se montre à elle et la foudroie. Il sauve alors l’embryon, le fait renaître, et le confie à Hermès. Il faut échapper à la jalousie de Héra, incapable de supporter la naissance de ce dieu. Voilà pourquoi on l’habille en femme, cela va le suivre pendant toutes ses productions. Mais ça ne suffit pas : il faut qu’il s’enfuie à Nysa, quelque part en Asie, en Ethiopie ou en Afrique. Il prendra alors la forme d’un chevreau. C’est là aussi qu’il va découvrir la vigne et le lierre. Héra le poursuit toujours de sa vindicte implacable, mais Dionysos s’en tire quand même, non sans être frappé de folie par Héra.
Voilà que se dressent deux personnages fondamentaux : la mort et la folie. Que serait donc le fait d’échapper en même temps à la mort et à la folie, comme s’il s’agissait de deux termes interchangeables ? Dionysos erre alors à travers l’Égypte et la Syrie, il est recueilli en Phrygie par Cybèle et il va se faire purifier et initier. En Thrace, il est poursuivi par le roi Lycurgue, et il doit se réfugier au fond de l’eau chez Thétis. Après cela, c’est l’Inde, avant de revenir à Thèbes, le lieu de sa naissance où le refoulement de sa divinité doit être évidemment le plus violent, la dénégation dont il est l’objet la plus évidente, et les conséquences de cette dénégation les plus dramatiques. Revoici, mais plus violente, nous allons le voir, l’affaire des prétendants.
Nul n’est dieu dans sa patrie et dans son pays, en tout cas c’est la démonstration la plus extravagante qui nous en est donnée par le vieil Euripide. Mais ce n’est pas fini. Dionysos se rend à Argos, où il va passer de plus en plus évidemment par la folie féminine. Ce dieu va faire éclater ce qu’il en est de la substance féminine domestique, ou domestiquée. C’est pour cela qu’à Argos, les femmes se mettent à dévorer leurs enfants, ce qui est pour le moins extrême. Elles dévorent ce qu’elles ont de plus précieux, du moins peut-on le supposer. L’aventure du dieu n’est pas finie : il va à Naxos, il est enlevé par des pirates. Les avirons se changent en serpents, le lierre envahit le navire, des flûtes invisibles se mettent à résonner, des guirlandes de vigne s’enroulent au mât. Et les pirates deviennent fous, se jettent à l’eau où, soit disant repentis, ils seront appelés dauphins. Après quoi, le dieu continue sa mission, il va chercher sa mère Sémélé aux enfers. Hadès lui demande en échange quelque chose de précieux : le myrte qui ornera le front des Élyséens.
Après quoi il monte au ciel. Il l’a bien mérité. Non sans avoir eu, juste avant, son aventure extrêmement mystérieuse avec Ariane. Ce dieu de la sauvagerie qui rend fol(le) a une élue. Il n’est pas là pour faire des orgies lui-même, le malentendu va porter là-dessus. Tout ça bouillonne, en effet, mais avec une étrange pudeur, qui fait que le dieu lui-même est tout à fait distant par rapport à ce qui se produit. Ce qui bouillonne, c’est plutôt le refoulement dont ce dieu est l’objet : ce que Freud, si l’on veut, appellera l’hystérie. Nous savons que les bacchanales ont envahi Rome. Pourquoi ne pas penser que cela continue en sous-main, cette illusion du bouillonnement sexuel, d’un dieu peut-être, qui ne souhaite pas forcément le bien humain ? Pourquoi un dieu devrait-il faire le bien ? Voilà une obligation à laquelle les dieux ne sont pas tenus le moins du monde.
Walter Otto a tendance à faire de Dionysos un dieu dément, parce qu’il déclenche la démence. Ce dieu qui n’est pas celui des philosophes et des savants, est un « dieu philosophe ». Un dieu qui pense, et dont les menées sont encore plus obscures que celles des Olympiens, Zeus compris. Ce fils de Sémélé, c’est le dieu qui vient. Il est immédiatement sensible, on ne le connaît que dans le face-à-face, raison pour laquelle il porte souvent un masque. C’est un dieu pour qui tout ce qui est fermé s’ouvre et, dans le vacarme qui l’accompagne, nous entendons un silence de mort. Avec lui, toutes les contradictions peuvent jouer, espace et temps. C’est un dieu qui fait immédiatement danser, y compris sa mère. Un dieu qui est libérateur, comme le vin lui-même et que l’on peut appeler aussi bien « le joyeux » que « le nocturne » ou le « dispensateur de richesses ». Vous pouvez l’appeler aussi« celui qui est né du feu », « l’ardent ». C’est un dieu par-delà bien et mal, par-delà la mort et la folie, ce qui va encore plus loin. Il est multiforme, taureau, lion, léopard, son animal indicatif étant la panthère. C’est un dieu enfin qui passe par les femmes.
In vino veritas. Quel vin ? Quelle vérité ? Il y a de fâcheuses vérités dans le vin, surtout dans le mauvais, connaissance en vins est requise, raison pour laquelle quand Hölderlin arrive vers Bordeaux et qu’il dit « Apollon m’a frappé », c’est de Dionysos qu’il s’agit. Il faut croire que, là aussi, un dieu s’est présenté à un mortel. Nous pouvons faire ici une petite embardée par la Genèse avec l’ivresse de Noé — il va s’ensuivre des histoires de fils qui ne sont pas claires.
Nous avons vu les animaux, la vigne et le vin qui fermenter à l’approche du dieu, qui va bouillonner dans des piscines, qui va se transformer en eau si on le transporte à quelque distance. Je signale, en passant, que Dionysos a des arbres et des plantes bien à lui : le lierre, le myrte donné en échange de sa mère, et enfin le pin. Et puis nous avons le figuier. On peut donc l’appeler, comme Pindare, « le dieu des arbres ». Nous remarquons qu’il n’a pas de temple à lui, il est là où il se manifeste. Nous savons aussi, par Pindare, que Bacchus est l’autre nom de Bromios, notre Dionysos, et qu’il aime les fleurs, par exemple. Il sort de l’eau et y retourne, c’est le dieu qui vient de la mer couleur de vin. C’est le navigateur, le dieu de la mer et de la côte, en tout cas familier des grottes. Plutarque est très précis : ses emblèmes sont une cruche de vin, une vigne, un bouc, une corbeille de figues et enfin le phallus. On retrouve tout cela sur des vases.
Walter Otto écrit :
« Faire sauter les liens du devoir conjugal et de la moralité domestique pour suivre sur les cimes la torche du dieu et remplir les forêts de sauvages cris d’allégresse, voilà à quoi Dionysos appelle les femmes. »
Et sur l’arrivée de ce dieu qui vient :
« Il glisse en silence sur la surface des eaux et, avec son arrivée, la nature s’anime [2]. »
Voilà comment se manifeste ce dieu étranger, qui est réellement né au lieu qui lui dénie sa naissance, que nous rencontrons partout et qui n’est nulle part chez lui, qui se manifeste de façon épidémique, ce dieu pressenti par Baudelaire qui parle du « dieu mystérieux caché dans les fibres de la vigne » — le vin n’étant d’ailleurs que la conséquence d’une goutte du sang des dieux. Ce dieu-là vient du dehors, il arrive d’un ailleurs. Mais paradoxe apparent : cet ailleurs est l’endroit même où il est né. C’est pour cela qu’entre la vie et la mort, il n’arrête pas d’osciller entre la présence et l’absence.
Roland Barthes a fait en 1978 une improvisation à mon sujet, qui s’appelle « L’oscillation ». Il y fait le parallèle entre l’hésitation gidienne et l’oscillation incessante dont je semble être possédé. Il rapporte en passant que l’hésitation, voie initiatique de compréhension progressive, est très bien tolérée socialement, comme si c’était un modèle parrainé d’une certaine façon par la vision intellectuelle. C’est une voie progressive, je dirais même progressiste, qui implique des retours, des autocritiques, des mises au point. Il part donc d’une phrase de Kafka : « Je n’ai rien de définitif », et il dit que mon axe d’action est d’empêcher l’image de prendre. Il prophétise que nous allons vivre de plus en plus dans une civilisation de l’image, et que celui qui s’attaque à la non-fixation de l’image commet là un acte grave. J’allais dire dionysien. Le terme choisi là est l’oscillation, très mal tolérée.
Ce dieu oscille entre présence et absence et sa nature est éminemment épiphanique, ou « théophanique », comme le dit Otto. Problème que j’ai déjà posé : comment reconnaître un dieu que l’on ne connaît pas ? Le surgissement singulier du divin a toujours pour conséquence le fait de n’être pas reconnu. C’est précieux : « n’être pas reconnu » est presque la marque du divin lui-même. Les conséquences qui s’ensuivent débouchent pour Dionysos sur le paroxysme en terre natale.
Elle est retrouvée.
Quoi ? L’Éternité,
C’est la mer mêlée
Au soleil
La mère s’est mêlée au soleil ? Tiens, tiens. Verlaine n’a pas compris qu’il était en présence de Dionysos. Il l’a senti, et ça l’a bouleversé, mais il n’a pas compris grand chose.
Marcel Detienne écrit :
« Le seul théâtre à la mesure de ses bonds, c’est la mer. Les îles, une à une, et la terre mille fois découpée de l’Hellade. Son aire de danse est vaste autant que la Grèce entière [3]. »
Voilà pour l’espace. Pour le temps, c’est le dieu qui bouleverse la temporalité régulière des saisons. Ce dieu échappe au « ni... ni », c’est le « et... et », ce qui coupe court à toute prétention monomaniaque, monotonement maniaque. Dans ce qu’on dédaigne sous le nom de polythéisme, on ne voit pas qu’est à l’œuvre cette extraordinaire et féconde expérience de l’un et du multiple à la fois.
Pour aller plus loin dans ce qu’il faut se représenter comme drame, nous allons à Thèbes, bien avant que s’y introduise une peste due à un meurtre du père et à un inceste avec la mère. Bien avant l’histoire d’Œdipe, humaine, trop humaine, nous allons droit aux Bacchantes d’Euripide, chef-d’œuvre étonnant : pièce de grande transgression qui nous dit en quoi la négation du dieu, de celui-là en particulier et du dieu en général — mais c’est celui-là qui justement fait sauter la dénégation, la forclusion —, entraîne une catastrophe passant par les femmes. « Ni l’homme, ni la femme », nous disait l’apôtre ? Nous allons voir cela de plus près.
En tout cas, ce n’est pas le rêve androgynal qui va nous apprendre la virulence de ce qui ne sommeille que d’un œil, par les femmes, dans les sociétés humaines.Voir -on y revient décidément toujours — le début de Femmes :
« Le monde appartient aux femmes, c’est-à-dire à la mort. Là-dessus, tout le monde ment. »
Fronton dionysien explicite.
(...)
PHILIPPE SOLLERS
Guerres secrètes,Gallimard, Folio n°4995
Crédit texte et photos : www.philippesollers.net
Philippe Sollers (Un vrai roman)
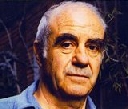
par Jacques Henric
Paru dans art press, no 340, décembre 2007.

Philippe Sollers
Un vrai roman
Éditions Plon
« Voilà ma vie, ma vie comme mes romans, mes romans comme ma vie », écrit Sollers, dans Un vrai roman. Un livre qui, en effet, plus que de simples « mémoires », comme le sous-titre l’annonce (gare à ne pas faire tombeau), plus qu’un journal (avec sa pesanteur narcissique), plus qu’une autobiographie (avec ses entêtements et ses prurits obsessionnels) - plus, je veux dire mieux - est un roman, un vrai roman, un roman vrai parce qu’il est le roman d’une vraie vie. Mais qu’est-ce qu’une vraie vie ? Eh bien, c’est ce que Sollers nous donne à lire de sa vie, à lire dans ses romans, mais aussi de façon biaisée dans ses essais, et enfin dans ce nouveau livre qui éclaire ses ouvrages précédents, en prolonge le sens, en confirme la vérité. Une vie qu’il donne en exemple ? Sûrement pas. Ni philosophe, ni moraliste, Sollers. Héros, encore moins, sauf à donner à ce mot le sens qu’il réserve au Ulysse de l’Odyssée, à savoir qualité héroïque de celui qui refuse « toute servitude volontaire » et gagne sa guerre en conquérant une autonomie absolue. Rien à voir donc avec une « sculpture de soi » qu’on hisse sur un piédestal et qu’on passe son temps à briquer pour faire reluire et la proposer à l’admiration des foules, ou un joujou qu’on prend un masochiste plaisir à casser à coups de marteau rageurs. C’est dire que les 350 pages d’Un vrai roman ne sont classables dans aucun genre littéraire connu. Comment le seraient-elles, d’ailleurs, quand elles sont le récit d’une vie qui, comme toute vie vraie, toute vie vraiment vécue, est absolument singulière ? Et s’agissant de cette vie-là, du roman vrai de cette vie-là, peu de chances que vous y trouviez quelque ressemblance avec les romans faux des vies falsifiées des milliers de morts-vivants dont les productions marchandes envahissent les étals des libraires et les colonnes de journaux. Il y a un mot que Sollers tient à distance, celui de « fraternité », comme celui d’« égalité ». En revanche, celui de « solidarité » lui convient. « Tous les réfractaires spontanés sont solidaires. Ils ont vu la douleur, l’absurde, le néant, la mort, et ils n’oublient rien, ni les précipices ni les fêtes. On les croit rangés, ils restent étrangers ». Beau passage qui donne à entendre ce que peut être une vie vraie. À retenir les deux termes : « réfractaire », « étranger ». Et que ceux qui, ayant lu de travers, ou jamais lu les livres de Sollers, ont de lui l’image stéréotypée d’un jouisseur libertin, pèsent ces mots : « douleur », « absurde », « néant », « mort », « fêtes » bien sûr, mais aussi « précipice ». C’est qu’il a eu ses saisons en enfer, au cours desquelles il a beaucoup appris, l’auteur de Paradis. S’est-on avisé que les « réfractaires » dont il se sent solidaires ne sont pas que Vivant Denon, Voltaire, Casanova, La Fontaine, Mme de Sévigné, Watteau, Fragonard..., mais aussi Hölderlin, Pascal, Bossuet, Kafka, Joyce, Artaud, Bataille, Faulkner...
Un vrai roman est d’autant moins classable que son projet et son esprit imposent une forme inhabituelle : au récit biographique, l’essentiel du livre, répondent des développements critiques sur Shakespeare, Dante, Saint-Simon, Nietzsche, Baudelaire, Rimbaud, Céline, Debord. Des digressions, des échappatoires ? Au contraire, cette convocation des grandes individualités « réfractaires », ces « personnages-oeuvres », comme il les nomme, le rappel de leur « guerre secrète », ont pour but d’éclairer celle que très tôt, le jeune Philippe Joyaux, bientôt sous son nom d’écrivain, Philippe Sollers, va mener au fil de sa vraie vie. Un combat pour quel objectif, pour quelle victoire ? Ceux d’une oeuvre, cette oeuvre, la sienne, sur laquelle il revient, qu’il commente, l’éclairant des moments-clés de sa biographie, De son premier roman, Une curieuse solitude, jusqu’à Une vie divine paru l’an dernier, on suit les mille péripéties de ce qu’on peut appeler ses guerres de libération.
La fiction sauve
« La réalité tue, la fiction sauve. C’est par la fiction qu’on trouve le réel et la vérité. » D’où la confiance inentamée de Sollers dans le roman. De quoi a été faite cette réalité que la fiction a sauvée et continue de sauver ? L’invasion nazie, les escarmouches intra-familiales (avec les s ?urs - avant-goût de la guerre des sexes, après celle de la guerre des classes : « Joyaux au poteau ! »), la maladie, la découverte précoce que « la clé des situations se trouve dans le sexe et les livres », les désertions (adieu ! Jésuites, armée, « familles recomposées » du milieu littéraire), la fréquentation des bordels, les saouleries, les drogues et les marches pour rien comme expériences de la dépense et comme préparations à la connaissance du négatif (« Qui n’a pas vécu à fond dans le négatif n’a pas droit à la moindre affirmation ultérieure »), la guerre d’Algérie, les hôpitaux militaires, l’aventure de Tel quel puis de l’Infini, Mai 68, le maoïsme, le poids de plomb des années 1970, plomb à transformer en or, et ce sera l’écriture de Paradis, les rencontres et les amitiés, Mauriac, Aragon, Breton, Bataille, Ponge, Foucault, Althusser, Derrida, Barthes, Lacan..., les ruptures avec certains, les voyages, Espagne, Italie, Chine, États-Unis... Et j’allais oublier l’essentiel pour qui a voulu mener à bien la (sa) Révolution (entendez par ce noble mot galvaudé un ensemble détonant comprenant : « le transcendantal, la mystique, la poésie, la pensée, l’amour, l’érotisme, l’ironie ») : l’appui, la complicité des femmes, de certaines femmes, principalement de deux femmes dont Sollers esquisse un émouvant portrait : « La fée », Dominique Rolin (rencontrée quand Sollers a 22 ans, Dominique Rolin en a alors 45) ; Julia Kristeva, cette jeune et belle Bulgare arrivée à Paris en 1966, que Sollers épousera en 1967.
« Dominique, Julia, l’art de vivre ». S’il fallait un critère, un seul, pour juger de la liberté qu’un homme, un écrivain, s’est donné dans sa vie, avec le souci de ne causer aucun dommage à autrui, la nature des liens avec ces deux femmes aimées y suffirait amplement. De cet « enfer des femmes » dont parle Rimbaud, que tout écrivain vrai se devrait d’avoir « vu » et connu, ce sont paradoxalement des femmes qui apportent leur précieux concours pour vous en libérer. Femmes, la Fête à Venise, le Lys d’or, Passion fixe, une Vie divine... sont les romans qui racontent cette Odyssée-là. Celle qui mène à la « vivace pérennité » dont parle Nietzsche et qui permet à Sollers de retourner ainsi la formule de Debord (« Nous tournons en rond dans la nuit et sommes consumés par le feu ») : « Nous planons en plein jour, et, comme le phénix, nous sommes vivifiés par le feu ». Comment se réveiller du « cauchemar de l’Histoire » et sortir de la nuit ? Lisez Sollers, mais il nous prévient : « Se réveiller est chaque fois un miracle ».
Jacques Henric

Philippe Sollers, René Girard par Fabrice Hadjadj
René Girard
Achever Clausewitz
Éditions Carnets Nord
Philippe Sollers
Guerres secrètes
Éditions Carnets Nord
La menace est désormais radicale, mais elle se présente sous une forme si double et si contradictoire qu’il est facile de se l’occulter et par là de la radicaliser encore. D’un côté, il y a la menace du bien-être, où la facilité technique de vivre éteint les dernières lumières de l’esprit ; de l’autre, celle de la violence, où la puissance technique de détruire laisse tout loisir de faire sauter la planète. La peur oscille de l’une à l’autre de ces menaces et parfois entend se protéger de l’une par l’autre, aggravant encore l’alternative entre une consommation anesthésiante et une destruction totale.
Cette double menace, la nouvelle maison d’édition dirigée par Benoît Chantre, Carnets Nord, la rappelle à notre vigilance. Elle démarre d’un coup par deux ouvrages majeurs, l’un de René Girard, l’autre de Philippe Sollers, qui donnent à regarder les « lieux du péril » en face. Deux livres sur la guerre. Deux livres qui se font la guerre (de bonne guerre) tant leurs perspectives s’opposent alors qu’elles brassent les mêmes références et aboutissent - comme par miracle - à une même conclusion. Tous les chemins mènent à Rome, dit l’adage, mais on s’étonne ici que ce qui conduit jusqu’au Vatican emprunte des routes si opposées. Pour nos deux auteurs, le danger n’est pas la guerre, mais sa terrible disparition. Sollers, du côté de l’existence personnelle, pointe l’oubli du « combat spirituel » dont parle Rimbaud. Girard, du côté de la vie collective, voit s’effacer l’« institution de la guerre », avec ses codes et son droit, au profit de la « montée aux extrêmes » que conceptualise Clausewitz. Ainsi le premier affronte la menace du somnolent bien-être que voudrait réaliser la société du spectacle ; le second, celle de l’extermination de masse que laisse entrevoir une violence déchaînée par la perte des vieilles issues sacrificielles. Pour nos deux auteurs, aussi, si l’on ne veut pas se rendre complice de cette liquidation physique ou spirituelle, c’est vers le catholicisme et les papes qu’il faut regarder. Et les voici qui convoquent presque les mêmes auteurs au renfort de leurs analyses : Euripide, Maistre, Hölderlin, Nietzsche,
Baudelaire, Benoît XVI...
Déclarations de guerre
Leurs deux livres présentent néanmoins d’extrêmes différences de ton et de point de vue. Girard est un b ?uf de somme qui laboure sans cesse son même champ de spéculations. Sollers est un papillon de nuit qui passe d’une fulgurance à l’autre sans jamais faire durer l’éclair. Aussi reproche-t-on souvent au premier son obsession de systématique, tandis qu’on vilipende le second pour sa légèreté d’esthète. Cette différence de style les distingue, mais ce qui tend à les confronter, c’est l’opposition de leurs procédés démonstratifs. Ils rappellent deux types contraires d’apologétique. Sollers procède par assomption : de la figure d’Ulysse, il passe à celle de Dionysos, puis à celle du Christ (en passant par le Tao). C’est une ascension continue dont Nietzsche fournit la clef : s’il tue le christianisme, celui du père, pasteur puritain, c’est pour qu’il ressuscite catholique, baroque, assumant en lui tous les mythes grecs dans la sensualité transfigurée d’un Michel-Ange. À l’inverse, Girard procède par rupture, même si, au fil du temps, ses ruptures sont devenues de plus en plus intégratrices : Dionysos est le contraire du Crucifié, Nietzsche n’est pas la clef mais le contre-exemple, celui qui tôt perçut le dilemme, ne sut pas choisir, s’effondra finalement aux sabots d’un cheval. Girard brise les idoles, Sollers les reprend dans la sculpture du Bernin. Le premier ressemble à un chrétien des temps primitifs, annonçant l’imminence du Royaume au milieu du désastre. Le second fait penser à un catholique du temps des Borgia, affirmant les joies du corps parmi les élévations de l’âme. Mais cette opposition ne saurait tourner à une quelconque « rivalité mimétique » (c’est là qu’il faut saluer l’invention éditoriale de Chantre). Les deux vues sont complémentaires et, reliées l’une à l’autre, fournissent une considération essentielle sur le vertige de nos temps.
Aveugler le Cyclope
Les Guerres secrètes commencent par un long commentaire de l’Odyssée. Le nom même de Sollers (Sollus-ars, c’est-à-dire « tout-art ») est le décalque latin du Polumétis dont Homère qualifie son héros. Ulysse est l’homme « aux mille desseins », insaisissable, métamorphique, « qui sait utiliser son apparence au profit de sa liberté ». C’est le modèle qui hante Sollers depuis l’enfance. Aussi, tandis qu’il publie chez Plon ses Mémoires, c’est dans cet essai que le lecteur trouverait son autobiographie théorique. Il y fait retour sur le Retour, revient sur l’Odyssée et, d’une vie dont certains ont trop vite fait d’accuser le disparate, dévoile le principe unificateur : jouer chinoisement avec le « médiatique » pour mieux protéger un secret qui ne se révèle que par une cicatrice et par un lit...
Il y a ces pages remarquables où Sollers assimile la caverne du Cyclope à celle de Platon. L’oeil unique est celui de la « caméra dévoratrice » qui voudrait transsubstantier le réel en marchandise. Le dernier homme est là qui par son écran consomme tout dans le « sans-distance », ignorant le proche comme le lointain, la demeure comme le voyage. Il est pareil à ces prétendants qui festoient dans une maison qui n’est pas la leur et qui seront bientôt massacrés.
Il est semblable à ce Cyclope qui raille les dieux et mange les compagnons d’Ulysse pour son divertissement. La moindre des charités est de lui ficher un pieu dans l’orbite. C’est là que Sollers va plus loin que Debord, non pas dans l’analyse, sans doute, mais dans la résistance. Debord fit une critique de la société du spectacle, mais le génie de cette société est justement de vivre de son auto-critique, de la mettre en scène, de la changer en cirque qui n’en fascine que mieux le spectateur. Combien d’épigones debordiens qui n’en sont jamais que les courtisans ? Le négatif ne suffit pas. Il faut du positif. Sollers l’entrevoit. Il sait que pour lutter contre cette fantômatisation de l’existence qui ne peut déboucher que sur la « fabrication des corps », il faut revenir à l’esprit de la chair et donc, par Dionysos afin d’éviter toute régression puritaine, au mystère de l’Incarnation. De là son affirmation baroque : Titien, Bernin, Rubens, et ce vin de Bordeaux qu’une consécration peut convertir en sang du dieu...
Ce qu’il propose pour aveugler le Cyclope est pour le moins étonnant à qui voudrait ne voir en Sollers qu’un esthète évasif. C’est quelque chose comme l’apothéose du Carré blanc sur fond blanc, ou encore comme du Jarry transfiguré, le pataphysique et la métaphysique assumés et dépassés dans un geste divin. Mais il vaut mieux citer cette page stupéfiante : « J’ai proposé un jour à un responsable important de la télévision, de filmer la messe catholique tout autour de la planète. En ce moment même en effet, des messes ont lieu. Je me contenterais, lui disais-je, de l’élévation. J’opposerais au monoculaire noir de la caméra, et comme pour faire ressortir ce qui lui échappe à jamais, le rond blanc de l’hostie sujette à une dévotion particulière. Ce rond blanc est donc du pain devenu du corps, grâce à cette Cène qui s’oppose ainsi à toute scène. J’aurais donc pris cinq cents messes dans le monde entier, l’élévation vers le ciel d’un rond blanc indéfiniment opposable au rond noir de l’enregistrement, pourtant forcé d’enregistrer ledit phénomène. Mon interlocuteur m’a bel et bien pris pour un fou. »
Or nous savons, depuis Euripide et saint Paul, les Bacchantes et l’Épître aux Corinthiens, que la folie du dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Tel est le combat spirituel qu’il faudrait soutenir, celui qui ouvre à cette folie divine, celui où le regard consent à s’abîmer dans « ce qui lui échappe à jamais ».
Voir l’apocalypse
Le Cyclope aveuglé, il convient, comme « l’être le plus débordant de vie » selon Nietzsche, de « regarder l’énigmatique et l’effrayant ». C’est ce que Girard nous convie à faire avec son dernier livre, peut-être le plus radical qu’il ait écrit, et sans doute quelque chose comme un testament. Achever Clausewitz, titre dans lequel on ne peut pas ne pas entendre « Auschwitz », c’est d’abord constater « ce monstrueux dérapage sacrificiel qu’est l’entreprise d’extermination des Juifs... où l’essence même de l’idée européenne a été entachée ». Girard applique sa théorie mimétique à l’histoire moderne et fait voir comment la rivalité gémellaire de la France et de l’Allemagne a conduit à l’explosion de l’Europe et au saccage du monde.
Derrière Clausewitz, c’est Hegel qu’il s’agit d’abattre. Pour le philosophe qui voyant passer Napoléon sous ses fenêtres voulait reconnaître l’esprit du monde à cheval, la guerre est toujours sacrifice des intérêts privés et donc moment nécessaire vers la réconciliation dans l’universel concret. La violence serait le ressort dialectique de la vérité. Girard montre que rien n’est moins sûr. Avec Clausewitz, il repense le phénomène de l’« action réciproque » et de la « montée aux extrêmes » qui, loin de mener à quelque paix plus haute, ne peut qu’aller vers une frénésie d’extermination. Avec Pascal, il témoigne que la vérité et la violence s’affrontent dans une lutte inexorable, sans aucune réconciliation possible, mais non sans une révélation paradoxale et mutuelle : « Tous les efforts de la violence ne peuvent affaiblir la vérité, et ne servent qu’à la relever davantage. Toutes les lumières de la vérité ne peuvent rien pour arrêter la violence, et ne font que l’irriter encore plus. »
Devant le néant
Fini le progressisme et son utopie d’un monde réconcilié qui fut la caution de tous les carnages. Fini le rationalisme et son humanisme trop humain qui nous piège dans une concurrence horizontale. Girard adopte le ton prophétique pour annoncer l’apocalypse : « Nous sommes aujourd’hui vraiment devant le néant. Sur le plan politique, sur le plan littéraire, sur tous les plans. Vous allez voir, cela se réalise peu à peu... Est-on encore dans un monde où la force peut céder au droit ? C’est précisément ce dont je doute. Le droit lui-même est fini, il échoue dans tous les coins. » Mais ce n’est pas tout : le christianisme lui-même a échoué. Telle est justement sa grâce : il est « la seule religion qui a prévu son propre échec » : « Par suite de l’iniquité croissante, l’amour se refroidira chez le grand nombre » (Matthieu 24, 12). « L’heure vient même où qui vous tuera estimera rendre un culte à Dieu » (Jean 16, 2).
Il faut lire cet admirable chapitre intitulé « Tristesse de Hölderlin » où, après une lecture des désastres annoncés par le Christ dans les Évangiles synoptiques, Girard médite les célèbres vers du poète : « Mais aux lieux du péril croît / Aussi ce qui sauve. » Ce qui sauve exige qu’auparavant l’on parvienne aux lieux du péril. Nul n’est sauvé s’il ne reconnaît d’abord qu’il est perdu. Or tout conspire désormais à faire éclater au grand jour cette perte et à prouver concrètement, selon le mot de Heidegger aux journalistes médusés du Spiegel en 1962, que « seul un dieu peut encore nous sauver ». Car, Pascal l’a rappelé, tous les efforts de la violence ne peuvent que relever la vérité davantage, si bien qu’à l’endroit où commence le désespoir à l’égard du monde, commence aussi l’espérance qui le déchire : « Je persiste à penser que l’histoire à un sens, écrit Girard. Cette montée vers l’apocalypse est la réalisation supérieure de l’humanité. » Apocalypse dit à la fois cataclysme et révélation, et même révélation au sein du cataclysme. Rien d’un Teilhard de Chardin et son avancée optimiste vers le point Oméga. Rien d’une dialectique immanente réalisant sa lente synthèse. Mais un brusque retournement, comme si l’on passait d’un coup de l’autre côté des choses.
Pour ce qui est de nos temps, Girard n’aperçoit de lueur que du côté de cette Europe explosée et ne pouvant se reformer qu’autour de cette catholicité qui, à travers la figure de Benoît XVI, réveille une rationalité religieuse, réunit la France et l’Allemagne en profondeur, et oppose une résistance réelle aussi bien à l’islamisme qu’à la mondialisation. Sollers songe aussi à une échappée où le mythe et la raison s’épousent dans un catholicisme purgé de « sa moraline sexuelle idiote ». De part et d’autre c’est un éloge du « Discours de Ratisbonne » de ce pape qui sait jouer Mozart. Mais Sollers pense aussi à ce temps du grand missionnaire Matteo Ricci où l’Europe et la Chine faillirent consommer leurs noces sacramentelles... C’est la voie du baroque chinois. Mais qui s’en souvient, de nous jours ? Et qui la désire ?
Cap au pire, donc. À moins de reconnaître notre radicale impuissance. À moins de refaire une place aux dieux, et surtout à ce dieu crucifié dont la vérité déchaîne la violence - mais la violence s’épuise contre sa vulnérabilité infinie. Cela n’ira pas mieux. Le monde ne deviendra pas meilleur. C’est à partir de ce constat que les c ?urs peuvent connaître ce « retour » qu’Ulysse n’obtient qu’à travers le naufrage. La dernière phrase est de Girard : « Vouloir rassurer, c’est toujours contribuer au pire. »
Fabrice Hadjadj



 Version imprimable
Version imprimable

 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?



5 Messages
Pour ceux qui veulent prolonger la lecture de Guerres secrètes, sur France-Culture jusqu’au 22 août :
Sur le bateau d’Ulysse
Hölderlin, déjà en 1802, interrogeait le devenir des Anciens Grecs. Ne sont-ils pas menacés ? Ne risquent-il pas, un jour, de disparaître ? Cette inquiétude est largement confirmée aujourd’hui : nous sommes en train d’oublier les Grecs, et le nouvel ordre mondial renforce chaque jour cette ignorance, cet illettrisme. Les Européens se sont détournés de la source grecque, acceptent un monde sans mémoire, et ne savent plus qui ils sont !
La question de Hölderlin : « que devient le Grec ? », les hellénistes ne sont plus seuls à la poser. Des écrivains, des artistes, des intellectuels ont compris l’intérêt qu’il y a à redécouvrir les Grecs. Car revenir aux anciens Grecs, c’est revenir à nous-mêmes, c’est nous redécouvrir autrement.
Le titre de cette série s’inspire d’un vers d’Euripide : « Et nous, devenus matelots sur le bateau d’Ulysse, toujours nous servirons Dyonisos [sic] ». Ces 25 émissions donneront l’occasion à des « professionnels de l’Antiquité grecque » : épigraphistes, archéologues, historiens, anthropologues, philosophes, mais aussi à des spécialistes d’autres disciplines : astrophysiciens, juristes, sinologues, passionnés d’éthologie, de remonter vers les anciens grecs en portant à la connaissance du public les découvertes, les perspectives, les nouveaux chantiers. Mais c’est d’abord par la littérature et l’art, - que l’on songe à l’Odyssée, à l’Orestie, aux nouvelles traductions de la métaphysique d’Aristote -, que l’Antiquité grecque monte aujourd’hui vers nous. Les témoignages sont là qui constatent l’étonnante fraîcheur de ces vieux textes, que nous sommes peut-être prêts, en ces temps de profonds bouleversements, à entendre vraiment.
Le 7 août : Yannick Haenel ; le 22, pour conclure la série : François Jullien (La Grèce au risque de la Chine).
Voir en ligne : Sur le bateau d’Ulysse
Oui, il y avait une erreur d’aiguillage. C’est maintenant corrigé.
Toutefois si vous voulez encore écouter Baudelaire, Le serpent qui danse chanté par Serge Gainsbourg, c’est ici :
[mp3]
Pour démarrer l’écoute, cliquez deux fois sur la flèche verte
Le lien exact vers l’émission de France Culture est celui-ci : }}
}}
{{ Ulysse et Dionysos
Après une écoute plus approfondie de la chanson : Le serpent qui danse de charles baudelaire.
On comprend que tout cela n’est pas fortuit et que poséidon est dans le coup, on reconait facilement sa signature, mais c’est à la dernière strophe, dans l’ivresse du dernier couplet que c’est dionysos, cette fois, qui est évoqué.
Un petit soucis au niveau du lecteur, un problème de lien surement, ou alors une mauvaise récupération du fichier son, en effet celui-ci pointe sur une petite chanson de gainsbourg qui pourrait faire penser à ces petites musiques qui précédent les émissions de france culture, une tromperie donc ...
D’où mon interrogation, faut-il y voir une ruse quelconque, un complot divin ?
Si oui quels dieux ? Dionysos ?
Faut-il mettre cette erreur sous le coup de ces fêtes de fin d’année un peu trop arrosées ?
En attendant, voici les liens pour écouter cette émission :
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/vivants/