MÉMOIRE
Où en est la France ? Le pays, la République, les villes, les banlieues, les habitants, la circulation, l’histoire, la mémoire ? Je me frotte les yeux, je m’endors, je rêve, je me réveille à nouveau. S’agit-il d’un déclin, d’une crise, d’une amnésie passagère, d’un trou dans le scénario habituel ? Prenez Napoléon, par exemple. Si quelqu’un semblait pouvoir dormir tranquille aux Invalides, c’est lui. Eh bien, non. Il a rétabli l’esclavage, il doit être maintenant considéré comme un précurseur de Hitler. La victoire d’Austerlitz n’est pas célébrée, ou à peine. De toute façon, il paraît qu’on nous a menti sur la colonisation. Elle a eu ses bons côtés, paraît-il, l’affaire n’est pas claire, des associations s’en mêlent, les Antilles protestent, la tension entre Blancs et Noirs est de retour, l’universel se délite, et c’est probablement la faute des élites...
Voilà ce qu’on pouvait lire dans le JDD du 25 décembre 2005...
Je lis dans la presse de ce jour (5 mai 2021) : « En célébrant le bicentenaire de la mort de Napoléon, Emmanuel Macron sait qu’il s’expose à de nombreuses critiques car l’Empereur est notamment accusé d’avoir rétabli l’esclavage sur certains territoires. Mais le chef de l’Etat assume sa volonté de "regarder l’Histoire en face" : il prend la parole ce mercredi à 16 heures. C’est un risque assumé… Commémorer Napoléon alors qu’il y a à peine un an, une partie de la jeunesse française déboulonnait les symboles de l’esclavagisme et du colonialisme, n’a rien d’évident. L’Élysée n’ignore rien de la colère qui gronde, à nouveau, en outremer mais aussi en métropole. Aussi, lundi, les conseillers du chef de l’Etat, chargés d’expliquer la démarche, pesaient leurs mots, tous leurs mots, afin de ne pas jeter d’huile sur le feu. » Bon. L’Histoire avance lentement (si toutefois elle avance) et n’est pas Premier Consul, encore moins Empereur, qui veut... A suivre (en différé)...
Philippe Forest ne s’est pas posé la question dans ces termes — ce qui ne l’a pas empêché de « peser ses mots ». Fin 2020, il a publié Napoléon, la fin et le commencement. Ce n’est pas une célébration, mais plutôt une remémoration et un beau portrait littéraire d’où il ressort que la vérité comme la légende est affaire de fiction.


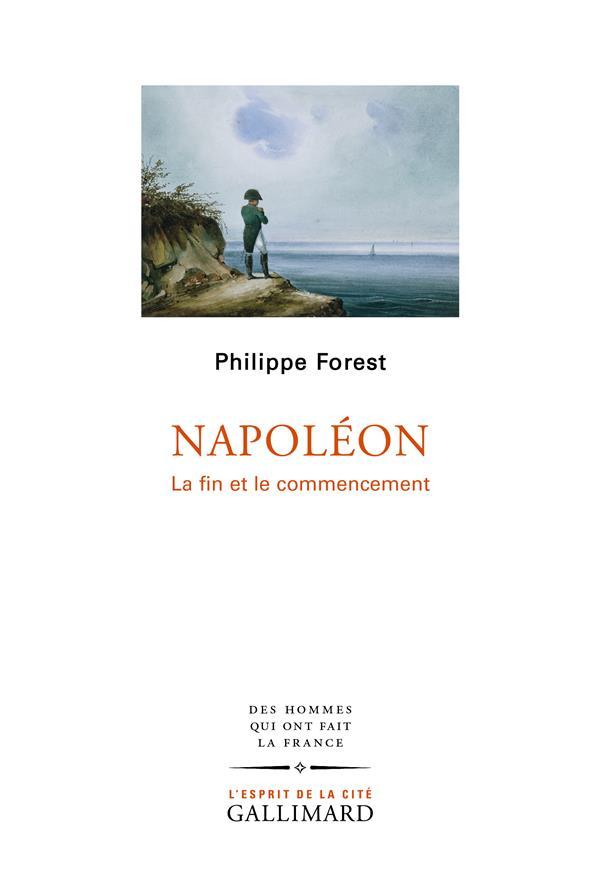
Napoléon : la fin et le commencement
À propos
Napoléon comparait sa vie à un roman. Il en fut le héros et l’auteur. Seul ce roman nous reste. Depuis deux siècles, il continue à s’écrire sans lui. Et avec lui se perpétue ce « songe immense mais rapide comme la nuit désordonnée qui l’avait enfanté » dont parlent les Mémoires d’OutreTombe. Chateaubriand dit de Napoléon : « Il n’a pas fait la France, la France l’a fait. » Mais peut-être la France, au fond, Napoléon l’a-t-il faite par sa défaite autant que par ses victoires. Car, outre des institutions et des lois qui existent toujours, le vide qu’il laisse a duré plus longtemps que le monument qu’il avait édifié et dont ne nous demeurent que des vestiges et des symboles. Le soleil qui s’était levé à Austerlitz, écrit Hugo, se couche sur Waterloo. Avec le romancier des Misérables, les plus grands écrivains du passé sont venus visiter la légende obscure et éclatante sous la forme de laquelle, pour notre présent, cette histoire reste encore vivante. Philippe Forest interroge l’aventure de cet homme, et de la France qu’il a faite, au miroir littéraire de l’épopée dont il nous a légué l’impérissable souvenir.
« Si Napoléon n’était pas mort à Sainte-Hélène,
peut-être n’aurait-il jamais vu le jour à Ajaccio. »
Le Destin dans Les Portes de la nuit
de Jacques Prévert.



Chateaubriand a écrit de lui : « Il n’a pas fait la France, la France l’a fait. »
Sorti de nulle part, parti de rien, Bonaparte devient Napoléon. Pendant une quinzaine d’années, il règne sur la France et il domine l’Europe. Aucun destin, peut-être, dans notre histoire nationale, n’a été aussi exceptionnel que le sien. D’où la fascination qu’il exerce, l’admiration qu’il suscite. Et la méfiance voire la détestation qu’il inspire également. Deux siècles après sa mort, son souvenir divise presque autant qu’il unit. Il est douteux désormais que vienne jamais le moment où, à son propos, s’exprimera une opinion unanime.
Chateaubriand a raison : « La France l’a fait. » La France de la Révolution qui, mettant à bas l’Ancien Régime, créant les conditions d’un chaos dont tout se trouvait soudain susceptible de sortir, a rendu possible – sinon nécessaire – une ascension comme la sienne et qui, sans nul doute, avant qu’il devienne la première victime de son propre dessein, haussa Napoléon au-dessus de tous les hommes de son temps.
Mais l’Empire s’écroule. Le rideau tombe. Et l’échec avec lequel le drame s’achève porte condamnation, apparemment définitive, de tout ce qui le précéda sur la scène du siècle. Terminée, la pièce qui s’est jouée paraît n’avoir eu d’autre rai-son d’être que de conduire vers le pathétique épilogue auquel l’épopée se réduit enfin.
En 1815, la France de Napoléon n’est pas seulement vaincue. Elle semble réduite à rien – de sorte que, la parenthèse de la Révolution et de l’Empire refermée, puisse se trouver provisoirement restauré, dans le pays et sur le continent, l’ordre ancien auquel elle avait prétendu substituer le sien. Du moins – et en dépit de tout ce qui subsistera à sa chute – est- ce le sentiment que suscite sur le coup le spectacle d’un semblable désastre. L’aventure d’un homme se termine mais, du fait de son fiasco personnel, la page semble se tourner aussi sur l’idée de la France qu’il avait passagèrement incarnée et qui, semble- t-il, se trouve alors rendue au néant dont il l’avait tirée.
La formule de Chateaubriand, cependant, est trompeuse : si la France a fait Napoléon, Napoléon, également, a fait la France.
Comme on le verra, on peut en produire sans peine toutes sortes de preuves. Elles attestent pareillement la manière durable dont un tel homme façonna le pays qu’il avait gouverné, les marques multiples qu’il lui a imprimées et que le passage des ans n’a pas totalement effacées. Mais peut- être la France, au fond, Napoléon l’a- t-il faite par sa défaite davantage que par ses victoires. Car le vide qu’il laisse a duré plus longtemps que le monument qu’il avait édifié et dont ne nous demeurent que des vestiges, des symboles auxquels, lorsqu’il les a conservés, notre présent confère une tout autre valeur que celle que le passé leur avait attribuée.
Ce vide a compté de façon plus essentielle. C’est de lui, je crois, que nous sommes les héritiers. Le soleil qui s’était levé à Austerlitz, écrit Hugo, se couche sur Waterloo et, avec le romancier des Misérables, les plus grands écrivains du passé – qui nous serviront ici de guides – sont venus interroger la légende obscure et éclatante sous la forme de laquelle, pour notre pré-sent, cette histoire reste encore un tout petit peu vivante. Dans l’ombre qui s’étend alors et que le souvenir de sa grandeur ne cessera de hanter brille toujours l’étoile en laquelle Napoléon avait cru et chacun de nous reste libre de rêver, après lui, à la direction qu’elle indique.
Ce rêve qui nous reste, duquel la France fut faite et qui mena à sa défaite, ce rêve qui fit la France en la défaisant, qui la défit en la faisant, peut- être n’est- il pas complètement absurde de poser l’hypothèse qu’il naquit, en vérité, des livres. De ceux qu’il lut, Napoléon tira l’idée qu’il se fabriqua de son destin et son rêve ne subsiste qu’en raison de ceux qu’il suscita et qui ne cessent depuis de donner à son histoire ses formes et ses significations nouvelles.
Évoquant les lectures dont ce rêve sortit, qui furent le creuset où se forgea l’esprit du jeune général victorieux et qui demeurèrent la consolation du vieil Empereur vaincu, fantasmes et fantômes de papier dont la compagnie exalta l’ascension du premier et adoucit la déchéance du second, Chateaubriand, à propos des ouvrages dont Bonaparte ne se séparait pas, le dit : « Dans la bibliothèque qu’il emporta se trouvaient Ossian, Werther, la Nouvelle Héloïse et le Vieux Testament : indication du chaos de la tête de Napoléon. Il mêlait les idées positives et les sentiments romanesques, les systèmes et les chimères, les études sérieuses et les emportements de l’imagination, la sagesse et la folie. De ces productions incohérentes du siècle il tira l’Empire ; songe immense mais rapide comme la nuit désordonnée qui l’avait enfanté. »
Ce « songe immense » dont parle Chateaubriand et auquel la réalité emprunta sa transitoire substance, ne se distingue plus guère des fictions auxquelles il se mêle maintenant et par lesquelles nous le connaissons encore. Napoléon lui-même comparait sa vie à un roman. Il en fut le héros et l’auteur. Seul ce roman nous reste. Depuis deux siècles, il continue sans lui à s’écrire. Car s’il sortit des livres, ce rêve a depuis longtemps repris sa place parmi eux – comme en témoigne l’immense et pléthorique bibliothèque que Napoléon inspira à tant d’écrivains. Il n’existe désormais qu’à la façon d’une fiction à l’invention perpétuelle de laquelle collaborent tous ceux qui n’ont pas renoncé à en reprendre le récit, à en méditer la leçon, à en interroger l’énigme.
Convient- il de croire aux rêves ? Et quelle importance faut-il leur accorder ? Le Code Napoléon interdisait explicitement qu’on fît autrefois profession de les interpréter. Bonaparte, pourtant, savait leur puissance : « Car, disait-il, il y a force choses qu’on ignore et bien d’autres qu’on ne saurait expliquer. » Il lui arrivait de ne pas être indifférent aux signes qu’ils lui adressaient. Il prétendit même que ses victoires venaient de ceux que ses soldats avaient faits. Leurs songes servaient le sien. Ils donnaient leur forme et procuraient leur énergie à la grande fantasmagorie à laquelle se rapportait la gloire de leur chef et à travers laquelle elle subsiste.
« Toute la vie de Napoléon, écrit Léon Bloy, fut un songe. » L’écrivain ajoutant à sa manière mystique : « C’est à suer de peur de penser à l’agitation surnaturelle de ce sommeil de Titan. Alors toutes ses batailles auraient eu lieu dans son âme et il les aurait regardées ou entendues de loin, dans une angoisse infinie, comme un prodigieux poème qu’Un plus grand et plus redoutable que lui aurait conçu. » On pense à ce formidable paysage de tempête que Napoléon, en 1804, décrit dans l’une de ses lettres et dont le spectacle proprement sublime lui pro-cure « la sensation d’un rêve romanesque et épique ».
Un pareil rêve est l’objet du livre qui suit. Autant en faire tout de suite l’aveu : ce livre n’est pas le fait d’un historien, celui qui le signe ne dispose d’aucun titre savant à raconter ou à interpréter, après des milliers d’autres, l’aventure de l’individu d’exception qui en fut le héros. Sa matière est faite des livres que j’ai lus et auxquels j’ai appliqué la même méthode que celle qui m’est familière et qui s’applique à la littérature. Ni plus ni moins et pas autrement. Car ce sont les livres qui recueillent inévitablement tout ce qui reste de ce qui fit un homme, constituant le plus fidèle miroir du monde : ils recèlent les rêves dont procède et auxquels toute réalité ramène, déployant devant nos yeux cette formidable sédimentation de songes en quoi consiste toujours l’histoire humaine et à laquelle chacun d’entre nous est toujours en droit d’apporter sa part personnelle.
Que reste-t-il de Napoléon aujourd’hui ? Que demeure-t-il désormais, deux siècles après, de cette légende disparue dont seules quelques traces subsistent encore sous nos yeux, signes qui ne se distinguent plus qu’à peine parmi le panorama oublieux du présent servant quotidiennement de décor à nos vies ? Afin de répondre à cette question et avant d’en arriver au récit lui- même, imaginons un petit instant et tant que dure encore ce prologue où, exerçant les droits qui lui appartiennent, avant de disparaître dans la coulisse, le romancier, l’essayiste peut provisoirement se permettre quelque fantaisie, s’avançant un instant sur le devant de la scène ainsi que la convention l’y autorisait autrefois.
Si Honoré de Balzac, revenu parmi nous, imaginons-le fantôme se faufilant dans la foule, entreprenait de remettre aujourd’hui ses pas dans ceux qui, autrefois, furent les siens ou bien de parcourir à nouveau les rues par lesquelles passèrent certains des personnages qu’il créa, nul doute qu’il trouverait bien changé le Paris que, tout jeune homme, il découvrit alors que s’écroulait l’Empire. À la physionomie d’une capitale qu’il décrivit sous tous ses aspects et dans tous ses recoins, sûrement, il ne reconnaîtrait plus rien sinon de vagues vestiges auxquels s’accrocheraient seulement des semblants de souvenirs. Je ne sais s’il s’en désolerait. Je veux croire qu’il ne succomberait pas à la nostalgie que lui inspirerait le Paris désormais disparu qui servit de décor à tant de ses romans. Son insatiable curiosité pour le présent l’emporterait certainement et elle lui persuaderait de partir, enthousiaste, à la découverte d’une cité dont le tableau qu’il en fit dans les premières pages de La Fille aux yeux d’or, s’il reste juste, appelle cependant les quelques corrections d’une indispensable mise à jour.
C’est que Paris, depuis Napoléon, a grandi. En deux siècles, non contente d’avoir plusieurs fois changé de forme, la ville s’est étendue au- delà du mur des fermiers généraux qui, à l’époque, en marquait la frontière. Elle a absorbé les faubourgs, les campagnes qui s’égaillaient à ses portes, annexé le territoire des communes environnantes afin d’en faire celui de ses nouveaux arrondissements qui, avec les autres, s’entortillent à la manière d’une coquille d’escargot ou bien des cases du jeu de l’oie au sein du cercle approximatif dont le centre se situe quelque part entre les îles jumelles de la Seine et dont les boulevards des Maréchaux tracent au loin la circonférence.
Sous la Restauration, peu après que Napoléon eut quitté la scène, la cité cessait presque d’exister au- delà du boulevard de l’Hôpital. Dans Les Misérables – dont l’action est à peu près contemporaine de celle de la plupart des romans de Balzac –, Hugo se rappelle à quoi ressemblait, du temps de sa jeunesse, ce quartier déshérité : « Il y a quarante ans, écrit- il, le promeneur solitaire qui s’aventurait dans les pays perdus de la Salpêtrière, et qui montait par le boulevard jusque vers la barrière d’Italie, arrivait à des endroits où l’on eût pu dire que Paris disparais-sait. Ce n’était pas la solitude, il y avait des passants ; ce n’était pas la campagne, il y avait des maisons et des rues ; ce n’était pas une ville, les rues avaient des ornières comme les grandes routes et l’herbe y poussait ; ce n’était pas un village, les maisons étaient trop hautes. Qu’était- ce donc ? C’était un lieu habité où il n’y avait personne, c’était un lieu désert où il y avait quelqu’un ; c’était un boulevard de la grande ville, une rue de Paris, plus farouche la nuit qu’une forêt, plus morne le jour qu’un cimetière. »
Que Balzac aille traîner aujourd’hui du côté de ce qui est désormais le treizième arrondissement de Paris, rien ne m’interdit de l’imaginer. Qui raconte, en effet, n’en déplaise à certains, a toujours tous les droits. C’est pourquoi je peux me le représenter errant du côté de la place d’Italie, un peu perdu bien sûr, on le serait à moins. Que fait-il là ? se demandera le lecteur. À quoi l’auteur de ce livre, parce qu’il a réponse à tout, répliquera qu’il est soucieux de trouver la route qui conduit du côté de Bicêtre. Avec l’idée de rendre visite au vieux colonel Chabert qu’aux dernières pages de son roman Balzac laissa, désolé, dans le mélancolique hospice où, abandonné de tous, le héros déchu de l’épopée impériale traîne depuis terriblement ses jours. Deux revenants ont ainsi rendez- vous : le soldat donné pour mort et auquel plus aucune place ne reste parmi les vivants et l’écrivain qui fit de lui l’un de ses personnages les plus poignants. C’est ainsi : les romanciers se sentent toujours quelque responsabilité à l’égard des êtres de papier qu’ils ont créés et ils ne peuvent se désintéresser de ce que ceux- ci deviennent une fois fini le livre qu’ils leur ont consacré.
Ici, hier, c’était Ivry. Un peu plus loin, on va vers Vitry. Mais, jusqu’à Bicêtre, il y a une trotte. Et le paysage, moins bucolique, n’est guère plus riant aujourd’hui qu’il ne l’était hier. Une rue a remplacé le vieux chemin vicinal du Chevaleret. Interminablement rectiligne, elle court en contrebas de la récente avenue de France sur laquelle se détachent les tours, debout en forme de livres ouverts et posés sur leur tranche, de la nouvelle Bibliothèque nationale. Elle passe sous le pont de Tolbiac. À l’endroit où paraît surgir de nulle part le tunnel de la rue Watt, elle fait une fourche dont les deux branches se répartissent de part et d’autre d’un ensemble de bâtiments plus anciens que ceux qui se dressent alentour. Je connais bien l’endroit. Je l’ai décrit dans un de mes romans. Et pour cause : j’y habite lorsque je suis à Paris.
Et, puisque j’imagine, rien ne m’empêche de raconter encore comment l’autre jour, près du pont de Tolbiac, j’ai croisé l’illustre personnage dont je parle, revenu parmi nous et s’enquérant auprès de moi de la direction qu’il devait prendre pour sortir de Paris. Il m’a interrogé sur l’itinéraire à suivre pour rejoindre Bicêtre, m’expliquant qu’il souhaitait revoir là-bas l’une de ses anciennes connaissances, un officier de ses amis, s’il était encore en vie. Lui-même avait été longtemps absent de Paris et son désir était de parler du passé et de prendre des nouvelles du monde tel qu’il va auprès du colonel de cavalerie auquel il destinait sa visite.
Il n’empruntait certainement pas, lui ai-je répondu, la route la plus rapide ! Il en avait sans doute, estimais-je, encore pour une bonne heure de marche. Je lui ai indiqué qu’il devait rejoindre le bas de la rue de Patay, prendre sur sa droite le boulevard Masséna en suivant la ligne du tramway et, arrivé Porte d’Italie, tourner à gauche, passer au-dessus du périphérique pour, enjambant la ronde des automobiles, prendre vers le sud par l’avenue de Fontainebleau.
Levant les yeux j’ai cherché à lui donner une indication qu’il comprendrait mieux. Je lui ai conseillé, dans un premier temps, de mettre le cap sur le Napoléon de David que nous apercevions au loin, qu’il reconnaîtrait certainement et que je lui ai pointé du doigt. C’est un repère commode : sur une façade bien visible, une fresque qui doit mesurer une bonne vingtaine de mètres de haut. On ne saurait la manquer. Avec ceci de particulier qu’elle n’a conservé que ses contours du fameux portrait équestre dont l’une des versions se trouve à la Malmaison et que David fit de Napoléon — de Bonaparte, plutôt, sur son cheval, le destrier dressé sur ses pattes de derrière, alors que le jeune consul se prépare, tel Hannibal, à franchir les Alpes. Ainsi que l’a voulu l’artiste contemporain qui s’en est inspiré, la silhouette du cavalier unie à celle de sa monture se présente à la manière d’un collage assez kitch ajointant des morceaux d’images où l’on distingue, à condition de s’en approcher assez près, des figures prises dans un dessin animé américain, d’autres tirées du vieux cinéma français, d’autres encore qui paraissent avoir été découpées dans un magazine de mode, un dépliant publicitaire ou confection nées par un enfant à l’aide de décalcomanies, de gommettes et de crayons de couleur, le tout formant une énorme chimère, une créature hybride dont le multicolore corps de centaure ou de griffon se trouve constitué de la somme d’éléments disparates pris à droite et à gauche : l’aile d’un papillon et la queue d’un serpent, un chat, une souris, une jambe de femme gainée dans un bas noir et dont on peut imaginer qu’elle appartient à la vedette d’autrefois dont on aperçoit plus haut le profil. Un vrai manteau d’Arlequin !
L’œuvre — elle date d’il y a cinq ou six ans — est le fait d’un artiste spécialisé dans ce genre de méfaits muraux. Chacun se fera son idée. La fresque dont je parle est si monumentale que l’on peut l’admirer de partout — sauf, heureusement, des fenêtres de chez moi puisque mon appartement se trouve situé juste en dessous. Il s’agit sans doute d’un bel exemple de ce que l’on nommait il y a trente ans le postmoderne : une œuvre d’art tirant son inspiration d’une autre, moins pour lui rendre un authentique et sincère hommage que pour en susciter au second degré le souvenir sur le mode de l’allusion ironique, du clin d’œil désinvolte, voire de la référence ricanante. D’ailleurs, le programme esthétique qui préside à de pareilles réalisations se trouve énoncé en toutes lettres — des lettres énormes — au sein même de l’image qui en constitue l’exécution et où figure, de la main du maître, le slogan suivant : « The Revolution will be trivialized. » Ce qui n’est pas très commode à traduire en bon français : banalisé, vulgarisé ? Mais « trivialized » ne signifie pas exactement : mis à la portée de tous. Plutôt : réduit à quelque chose d’ordinaire et de dérisoire. Ce qui, en l’occurrence, est tout à fait le cas, je le crains.
Finalement, j’ai fait un bout de chemin avec le promeneur un peu perdu qui m’avait demandé sa direction. Je voulais au moins le conduire jusque sur le boulevard Masséna — à partir duquel, pensais-je, il parviendrait sans trop de mal à sa destination. Nous sommes passés au pied de la fresque qu’il n’a pas manqué d’observer. Je n’ai pas fait de commentaire. Il est resté silencieux aussi — pensant peut-être, de son côté, que toute remarque un peu désobligeante de sa part risquerait de heurter la sensibilité du serviable autochtone qui, en ma personne, lui tenait si aimablement compagnie. Je l’ai laissé continuer son chemin. Je ne me suis pas enquis de la conversation que le romancier souhaitait avoir avec son personnage et des propos qu’il pensait échanger avec lui. ]’ignore quelle réflexion pouvait lui inspirer la métamorphose dont, par hasard, sur le chemin de Bicêtre, il se trouvait ainsi le témoin. Elle transformait en une parodie un peu risible de lui-même l’homme qui fut Napoléon et en lequel, dans tous ses romans, l’auteur de La Comédie humaine avait vu le plus grand des héros d’un siècle pourtant fécond en géants : l’individu d’exception qui, seul, par sa volonté et son génie, avait fait la France ou plutôt l’avait refaite et puis l’avait défaite, l’avait refaite peut-être par sa défaite.
Même si on ne leur prête plus trop attention, la capitale ne manque pas de monuments qui célèbrent le souvenir de l’Empereur : la colonne Vendôme, les Invalides, la Madeleine et l’Arc de triomphe. Sans oublier tous ces noms de batailles et de soldats qui servent à baptiser partout stations de métro, ponts, boulevards et avenues. Ni omettre non plus ce qui, désormais, a disparu : je pense au gigantesque éléphant de la place des Victoires que l’Empereur désira ériger, affaissé comme une baleine échouée sur une plage, ruine énorme dans les flancs de laquelle le Gavroche de Hugo vient s’abriter.
Que Napoléon y soit ainsi partout présent, c’est justice. Napoléon aimait Paris où il voulut reposer. Aux membres du corps municipal de sa « bonne ville », en 1804, il déclarait : « Je veux que vous sachiez que dans les batailles, dans les plus grands périls, sur les mers, au milieu des déserts mêmes, j’ai toujours eu en vue l’opinion de cette grande capitale de l’Europe... » Paris, à ses yeux, passait pour le lieu sur terre où l’on trouvait le plus de goût et le plus d’esprit. Je le déplore mais je ne suis pas certain que, de la ville qu’il aimait tellement, l’on puisse encore en dire autant. Du coup, peut-être l’image au pied de laquelle nous venions de passer et que nous avions maintenant laissée derrière nous était-elle la plus exemplaire, la plus représentative de toutes puisqu’elle exprimait, mieux qu’un long discours, quel sort digne de pitié notre petit présent réserve parfois aux titans du passé.
Mais cette fresque, je l’avais peut-être jugée trop sévèrement, après tout. Mieux qu’une autre représentation plus respectueuse et plus académique, elle méritait de servir de frontispice à mon livre. Elle disait vrai, au fond, et montrait à quelle condition et sous quelle forme un artiste ou un écrivain d’aujourd’hui peut s’essayer à montrer un héros d’autrefois qu’il serait absurde de prétendre dépeindre selon les codes et les conventions qui prévalaient en son temps, faisant faussement du David ou du Gros, du Balzac ou du Chateaubriand quand ce n’est jamais qu’au présent, et avec les formes et les mots du présent, que le passé se dit avec chacun de ceux qui le réinventent.
Marx — qui avait lu Balzac — déclare, la formule est fameuse, que toute tragédie qui se répète devient farce. Il le dit à propos de la consternante contrefaçon que constitua à ses yeux la comédie du futur Napoléon III réitérant sur le mode du grotesque, après le coup du 2 Décembre rééditant celui du 18 Brumaire, le sublime de la geste napoléonienne. Il n’y a pas de pire punition — c’est aussi l’idée de Hugo, bien sûr — pour un grand homme qui aspira à une ineffaçable gloire, que de revenir à la vie sous une apparence honteuse. Cela fait longtemps que le vainqueur d’Austerlitz n’existe plus autrement pour nous que sous l’apparence que lui donnèrent des images semblables à celles que l’on fabriquait autrefois à Épinal ou que l’on accrochait, sous forme de grands panneaux illustrés, aux murs des petites classes de l’école républicaine — sans parler de celles qui nous viennent maintenant des romans, des films, des séries télévisées et de tout l’échantillon des « souvenirs » et autres
« produits dérivés » manufacturés dans des usines lointaines à l’intention des touristes de passage par Ajaccio, Fontainebleau, la Malmaison ou le musée des Invalides.
Que Napoléon termine ainsi, sous la forme de la fresque dont j’ai parlé, dans l’un des quartiers les plus excentrés de la capitale depuis laquelle il rêva de régner sur le monde et qui elle-même n’existe plus sur la planète qu’à la manière d’une cité de second rang constitue peut-être une morale appropriée pour la fable que fut son destin. La sinistre loi de l’histoire en décide souvent de la sorte. Mais rien n’oblige, bien sûr, à se résoudre à une si terne leçon. Car la triste façon dont une aventure semble parfois se finir ne dit pas grand-chose, au fond, de ce qu’elle fut et de ce qu’elle reste, malgré tout, susceptible, pour qui le souhaite, de signifier encore.


Sacre et massacre

Jacques-Louis David, Le Sacre de Napoléon, 1805-1807.
ZOOM : cliquer sur l’image.


Antoine-Jean Gros, Napoléon sur le champ de bataille d’Eylau, 1807-1808.
ZOOM : cliquer sur l’image.



Entretien avec Philippe Forest
La Salle des machines par Mathias Énard, 29 novembre 2020.
Essayiste, professeur de littérature, spécialiste de la revue Tel Quel, Philippe Forest est également l’auteur de plusieurs romans parmi lesquels Sarinagara, en 2004 ou Le siècle des nuages en 2010. Après s’être attelé à l’écriture d’une biographie de Louis Aragon (Prix Goncourt de la biographie 2016), l’écrivain publie Napoléon, la fin et le commencement.

Quand commence l’épopée bonapartiste ? Et quand se termine le règne de Napoléon ? Philippe Forest s’est attelé à ces questions, happé comme il le dit par "une histoire qui n’en finit pas de finir, et de recommencer." En revisitant la fascination exercée par Napoléon sur les écrivains du XIXe siècle, il raconte les différentes visions de la naissance d’une gloire, et de sa chute.
Philippe Forest : « Victor Hugo, Stendhal, Chateaubriand, Balzac ou Alexandre Dumas écrivent dans l’après-coup de la défaite de Waterloo, c’est à dire sur les ruines de l’empire, dans le souvenir de la gloire disparue. Ils le font soit dans la perspective d’en porter le deuil, soit dans celle d’en envisager le renouveau. Parce que cette histoire n’en finit pas de finir, et donc de recommencer. Quand finit l’histoire de Napoléon ? En 1799 comme le pense Stendhal ? En 1804 comme l’affirme Chateaubriand ? Napoléon incite au délire et justifie la manière dont on peut délirer à son propos. Chateaubriand, comme Hegel, comme Balzac, cherchent à se mesurer à lui. Comme s’il s’agissait pour ces grands écrivains d’engager une sorte de dialogue, de face à face, voire de duel avec lui. Tous ces écrivains se prennent en quelque sorte pour Napoléon, à la manière des mythomanes, simplement ils font de cette folie qui s’empare d’eux une base à partir de laquelle ils vont développer de grands livres. »
Quel roman pourtant que ma vie ! Napoléon


Napoléon selon Philippe Forest, un écrivain à l’assaut d’une légende
RTS, le 10 décembre 2020.

Le règne de Napoléon Ier, de son sacre en 1804 à sa défaite à Waterloo en 1815, a nourri une geste littéraire qui se poursuit toujours. Philippe Forest s’en empare à son tour en revendiquant le droit à la fiction souveraine dans "Napoléon, la fin et le commencement".

Emboîtant le pas de ses illustres prédécesseurs, de Chateaubriand à Bloy, en passant par Hugo, Stendhal, Goethe, Tolstoï ou plus récemment Jean Rolin et Philippe Tesson, le romancier Philippe Forest prend la mesure d’un songe immense que le général devenu empereur a lui-même rêvé.
[…] l’individu d’exception qui, seul, par sa volonté et son génie, avait fait la France ou plutôt l’avait refaite et puis l’avait défaite, l’avait refaite peut-être par sa défaite.
Extrait de "Napoléon" de Philippe Forest
Un rêve écroulé
Comment Napoléon, petit Corse de bonne famille originaire d’Italie, les Buonaparte, a-t-il indissociablement mêlé sa destinée à celle de la France ? Car ses débuts n’en font pas un patriote. Jeune officier formé à Brienne dès l’âge de neuf ans, il n’ambitionnait que de libérer son île natale du joug français à partir du rattachement de 1768. Pris dans la tourmente révolutionnaire, il en épousa les grands principes d’égalité et de liberté bourgeoises, mais en modéré.
Sur appel de son frère aîné Joseph, il dirigea le coup d’État du 18 brumaire 1799 (9-10 novembre) pour conforter la République contre les menées séditieuses des royalistes et des nations européennes. Puis vint le temps des conquêtes fulgurantes en Italie puis en Égypte, conduites par ce général trentenaire, plus rapide que l’éclair.
Flambeau de la Révolution qu’il entendait exporter dans toute l’Europe, Bonaparte s’est métamorphosé en empereur, le 2 décembre 1804, par plébiscite populaire, soit dit en passant. De là date, pour beaucoup de ses admirateurs dont Stendhal, le renversement irréparable. Le héros est devenu tyran, et plutôt sanguinaire par les amas de cadavres semés sur sa route martiale. Le rêve de liberté s’est écroulé dans les défaites prévisibles, la démesure, l’hybris d’un héros antique qui comme Alexandre et César voyait plus loin que ses contemporains. La violence dont il a libéré la France en lui donnant un État de droit, s’est déversée sur le continent encore largement gouverné par les inégalités de l’Ancien Régime.
Avec Napoléon, quelque chose finit, commence à finir, n’en finira plus de finir afin que s’opère de la sorte, aujourd’hui comme hier, le continuel recommencement de l’Histoire.
Extrait de "Napoléon" de Philippe Forest
"Quel roman pourtant que ma vie !"
Cultivé, nourri par d’abondantes lectures dont celle de Jean-Jacques Rousseau, Napoléon aimait la tragédie et ne concevait la fin des héros de théâtre que dans la mort. Cette sombre visée s’accordait à sa mélancolie, il se voyait lui-même en protagoniste d’un roman dont la France agrandie eût été la scène pacifiée. "Les spectres de l’époque romaine [qui] avaient veillé sur son berceau", comme l’écrira Marx plus tard, l’auraient-ils destiné à anticiper sur son temps, par ce court-circuit repassant par l’Antiquité ? Porté vers l’avenir, hors-sol et hors temps, Napoléon était taillé dans ses chevauchées pour enflammer l’imagination des écrivains. Son histoire, achevée le 18 juin à Waterloo, puis humainement le 5 mai 1821 dans son exil à Sainte-Hélène, a fait de sa défaite une victoire par le mythe toujours recommencé.
Dans son essai méditatif, à la fois biographique et littéraire, Philippe Forest s’interroge sur les ressorts d’une fiction nommée Napoléon, réchauffée depuis deux siècles par l’effort des historiens et les fécondes élucubrations des écrivains.
 "Napoléon, la fin et le commencement" de Philippe Forest dans la collection Des hommes qui ont fait la France, Gallimard, 2020.
"Napoléon, la fin et le commencement" de Philippe Forest dans la collection Des hommes qui ont fait la France, Gallimard, 2020.
 "L’Université en première ligne à l’heure de la dictature numérique", Philippe Forest, coll. Tracts N° 18, Gallimard.
"L’Université en première ligne à l’heure de la dictature numérique", Philippe Forest, coll. Tracts N° 18, Gallimard.
 "L’Éloge de l’aplomb et autres textes sur l’art et la peinture", Philippe Forest, coll. Art et Artistes, Gallimard.
"L’Éloge de l’aplomb et autres textes sur l’art et la peinture", Philippe Forest, coll. Art et Artistes, Gallimard.


2021 : bicentenaire de la mort de Napoléon, portrait littéraire avec Philippe Forest
RFI, Littérature sans frontière par Catherine Fruchon-Toussaint, 8 janvier 2021.

Philippe Forest est un écrivain français, auteur d’une trentaine de livres depuis « L’enfant éternel » en 1997. Une œuvre composée d’essais et de romans tels que « Le Chat de Schrödinger », « Crue » ou encore « L’oubli » et plus récemment « Je reste roi de mes chagrins » ainsi qu’une biographie de Aragon. Il vient de publier un essai littéraire intitulé « Napoléon, la fin et le commencement », aux éditions Gallimard.



Dans la presse
“Napoléon”, de Philippe Forest
Voici Napoléon Bonaparte tombé dans un puits de littérature. L’écrivain Philippe Forest se livre avec Napoléon. La fin et le commencement (Gallimard, 2020) à un exercice dont il avertit rapidement qu’il risque d’être vain. L’Empereur n’est-il pas celui sur lequel on a tant écrit ? Comment atteindre la singularité à laquelle tout livre aspire ? La réponse de Philippe Forest est de ne s’appesantir ni sur le génie, ni sur le législateur, ni sur le tyran ; plutôt de donner à voir l’hybridation des trois. Dans l’œil successif de Chateaubriand, de Nietzsche, de Rostand, et de Philippe Forest les rassemblant, l’Empereur devient un être aux mille visages. Visions sur visions, les calques littéraires se superposent comme autant de lentilles optiques déformant leur objet. Le Napoléon de Forest finit par ne plus avoir aucune netteté, comme un kaléidoscope – flou, bigarré. Mais c’est en cela qu’il plaît. Loin de partir à la recherche du vrai Napoléon, l’auteur prend plaisir à en faire un objet de littérature, à jouer de sa nature fictive ; c’est-à-dire... à continuer de tisser sa légende. Et Forest de citer Chateaubriand : “Achille n’existe que par Homère. Ôtez de ce monde l’art d’écrire, il est probable que vous en ôterez la gloire.”
Le fourmillement des petits plaisirs. Philippe Forest fait sienne une vision dilettante et aventureuse de l’écriture historique. Au système logique de la preuve, aux grands boulevards rectilignes, il préfère l’esprit hédoniste des petites ruelles, des références curieuses, des joies littéraires. On s’amuse avec lui d’imaginer la rencontre satisfaite de Napoléon avec le tsar en Saxe, en 1808, pendant laquelle l’Empereur fait venir la Comédie-Française pour donner à voir le génie français. “Son idée à lui de ce que l’on ne nommait pas encore le “soft power”. Devant Alexandre Ier, les acteurs déclament ces vers de Voltaire, républicains avant l’heure et personnellement choisis par Napoléon : “Les mortels sont égaux, ce n’est point la naissance / C’est la seule vertu qui fait la différence.” Une autre pépite pour la route ? Près d’un siècle plus tard, Edmond Rostand, l’auteur de Cyrano de Bergerac, publie L’Aiglon (1900), une pièce presque oubliée aujourd’hui. À l’acte III, le diplomate autrichien Metternich prend la mythique bicorne de l’Empereur entre les mains et médite sur cette “chauve-souris des champs de bataille”. Rostand a les savoureux vers suivants : “Grand coquillage noir que les vagues rapportent / Et dans lequel l’oreille écoute en s’approchant / Le bruit de mer que fait un grand peuple en marchant.”
Le héros tragique. Napoléon était féru de tragédie, “l’école la plus digne des hommes supérieurs”, disait-il avec des accents nietzschéens. L’auteur préféré de Napoléon était Pierre Corneille (1606-1684), dont il disait que s’il avait vécu en son temps, il l’aurait fait Prince. En citant ces vers de Cinna (1643), Forest nous fait comprendre sans difficulté pourquoi l’Empereur sans repos, qui a bataillé incessamment pendant toute sa vie, y voyait son reflet et son destin :
“J’ai souhaité l’empire, et j’y suis parvenu ;
Mais, en le souhaitant, je ne l’ai pas connu :
Dans sa possession, j’ai trouvé pour tous charmes
D’effroyables soucis, d’éternelles alarmes,
Mille ennemis secrets, la mort à tous propos,
Point de plaisir sans trouble, et jamais de repos”
(Cinna, Corneille, 1643)
Et les grands esprits tragiques se rencontrent. Friedrich Nietzsche écrivit de Napoléon : “Le premier en date et le plus moderne des hommes des temps nouveaux.” La vie de Napoléon a bien quelque chose de tragique au sens que Nietzsche donne au mot, une sagesse que nous aurions perdue mais que les anciens Grecs détenaient. Acceptant les deux forces esthétiques qui font le monde, l’apollinien (l’art des formes et de la raison) et le dionysiaque (l’ivresse et l’incertain), la sagesse tragique était un amor fati, un amour du destin même quand il réserve une chute brutale. “Il faut que les héros meurent”, disait Napoléon d’après Philippe Forest – mais la citation est peut-être apocryphe. Napoléon a été l’homme des plus grandes victoires et des pires défaites, d’Austerlitz et de Waterloo, des Pyramides puis de l’exil. Forest relate qu’en 1916, Freud s’interroge sur l’exemple étrange de “ceux qui échouent dans le succès”, de ceux qui subissent la tension contraire de “l’aspiration aux cimes et l’abandon aux abîmes.” Pourquoi Napoléon ne jouit-il pas paresseusement de sa puissance ? Pourquoi remet-il tout en jeu à chaque guerre. “Quelle fureur, se demandait le jeune Napoléon, me porte donc à vouloir la destruction ?” La réponse qu’il donna lui-même et que Forest reprend, on pourrait l’appeler la sagesse tragique de l’Empereur : “Les hommes de génie sont des météores destinés à brûler pour éclairer leur siècle.”
Nicolas Gastineau, philosophie magazine, le 20 novembre 2020

František Xaver Sandmann, Napoléon à Sainte-Hélène, vers 1820.
ZOOM : cliquer sur l’image.



Napoléon, la destinée et la mort
Documentaire de Mathieu Schwartz (France, 2021, 1h30mn)
Disponible jusqu’au 30/06/2021
Il y a deux siècles, le 5 mai 1821, Napoléon Bonaparte rendait son dernier soupir à Sainte-Hélène. Au travers de sept moments clés qui l’ont vu braver la mort, une captivante relecture de son épopée.

En ce mois de mai 1821, Napoléon Bonaparte, empereur déchu et exilé sur l’île de Sainte-Hélène, est sur le point de rendre son dernier soupir. La mort ne l’effraie pas. Ce fils de bonne famille corse, encore jeune capitaine de l’armée révolutionnaire, l’a approchée tant de fois depuis qu’il a repris Toulon aux royalistes, en 1793. Son destin va basculer deux ans plus tard quand, déjà promu général, il affronte les émeutiers parisiens qui ébranlent la République. Sans états d’âme, il mate l’insurrection en s’exposant une fois encore aux balles, malgré son féroce appétit de vivre. Sa rencontre avec Joséphine de Beauharnais, qu’il épouse civilement en mars 1796, le propulse dans les hautes sphères de la capitale : l’élégante mondaine a beaucoup d’entregent. Bientôt, l’audace militaire de Napoléon, au pont d’Arcole, lors de la campagne d’Italie, va asseoir sa renommée. Plus rien ne l’arrêtera...
Alchimie
Axant son film sur sept moments clés au cours desquels Napoléon Bonaparte a été confronté à la mort, Mathieu Schwartz (Pasteur et Koch) retrace avec subtilité la destinée flamboyante du “petit caporal” devenu empereur et décrypte comment ce pas de deux avec la Camarde a influé sur sa vie et contribué à sa légende. Éclairés notamment par les historiens Patrice Gueniffey, Pierre Branda, Thierry Lentz et Charles-Éloi Vial, la commissaire des expositions du musée de l’Armée-Hôtel des Invalides Émilie Robbe et l’académicien Jean-Marie Rouart, ces épisodes cruciaux sont mis en scène au moyen de superbes séquences d’animation 2D en rotoscopie et en motion design. Dans une alchimie entre le fond et la forme, une relecture captivante de l’épopée napoléonienne, à l’occasion d’une année 2021 dédiée à sa célébration.
Sur France Culture : "Ouf", Napoléon est mort 4 ÉPISODES.
"Quand je ne serai plus là tout le monde dira : Ouf !" déclare Napoléon pendant son exil à Sainte-Hélène. Pourtant, loin d’avoir disparu avec sa mort, le mythe Bonaparte se prolonge encore aujourd’hui. Deux-cents ans après, que reste-t-il de l’épisode impérial ?




 Version imprimable
Version imprimable

 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?


