
- Bernard Lamarche-Vadel
Bernard Lamarche-Vadel, le plus grand écrivain français
 Yannick Haenel vous recommande fortement la lecture des ouvrages de Bernard Lamarche-Vadel, écrivain méconnu, disparu en mai 2000, à l’âge de 50 ans.
Yannick Haenel vous recommande fortement la lecture des ouvrages de Bernard Lamarche-Vadel, écrivain méconnu, disparu en mai 2000, à l’âge de 50 ans.
Il est temps que je vous parle de Bernard Lamarche-Vadel. Cela fait des années qu’il est devenu le plus grand écrivain français, ex aequo avec Pierre Michon ; et que trop peu de gens le savent. Pierre Michon est la figure glorieuse explicite de la littérature française contemporaine ; et Bernard Lamarche-Vadel, sa figure glorieuse obscure.
Le règne de Pierre Michon est longtemps demeuré occulte, comme un secret savouré par les seuls connaisseurs, mais désormais il occupe le trône et s’expose à sa propre lumière explicite, celle du roi incontestable. Le règne de Bernard Lamarche-Vadel demeure quant à lui souterrain, son rayonnement est encore marginal, mais ceux et celles qui en reconnaissent la souveraineté ne jurent secrètement que par lui.
Ses trois romans Vétérinaires (1993), Tout casse (1995), Sa vie, son oeuvre (1997), tous publiés chez Gallimard, et les deux premiers dans la collection « L’Infini », sont ce que j’ai lu de plus déterminant ces vingt dernières années, ils établissent à mon avis dans la littérature un acte de supériorité. Bernard Lamarche-Vadel s’est suicidé en mai 2000, à 50 ans, ainsi ne montera-t-il jamais sur le trône, sinon à titre posthume, comme un fantôme.
Je profite de la publication d’un inédit pour parler de lui, État stationnaire, un tout petit récit de 37 pages aux très belles Éditions Unes, et c’est une porte d’entrée idéale dans son oeuvre : « L’idée principale était de favoriser la plus grande immobilité des choses, de parler très peu, et de contempler le plus longtemps possible des intervalles où rien ne se passait. » Contempler des intervalles, quoi de mieux ?
Dans ses romans, façonnés comme des oeuvres d’art, un phrasé baroque serpente entre la fulgurance et l’humour noir. Dans Vétérinaires, on se bat à mains nues contre un molosse dans la cage d’une voiture pour valider la face ésotérique de son diplôme de vétérinaire.
Dans Tout casse, les animaux meurent les pattes en l’air, un déluge emporte les maisons, et le gouvernement pour sauver le pays lance les jours « boum-boum » : il faut procréer à tout prix, des hordes de femmes se répandent pour vous soutirer la reproduction, et seul de son espèce, un homme, retiré dans la lecture de Bossuet, résiste aux consignes libidinales.
Dans Sa vie, son oeuvre, le Dr Paul Marbach, spécialisé dans les oraisons funèbres, rédige avec ses cinq enfants, qu’il a baptisés de noms d’artistes allemands, le mémoire qui, en racontant l’histoire des violations dont il a été l’objet, rétablira la sombre vérité des emboîtements qui hantent l’esprit.
De ces féeries noires naissent des enthousiasmes inoubliables. Qu’avons-nous à faire désormais des divertissements culturels ? Il nous faut des livres qui regardent la mort et qui dénudent la vie ; des livres qui tranchent, et creusent, et rient. Il nous faut Bernard Lamarche-Vadel.
Yannick Haenel, Charlie Hebdo 1464 du 12 août.
LIRE AUSSI : Un peu d’histoire (1/2) et Un peu d’histoire (2/2)
Yannick Haenel a déjà évoqué Bernard Lamarche-Vadel dans un entretien avec Fabien Ribery en 2017, A propos de la revue Ligne de risque, revue dans laquelle BLV publia des textes dans les numéros 2/3 (mai-août 1997), 6 (janvier-avril 1998) et 11 (janvier-avril 1999) [1].
Sur quelles bases reposait votre amitié avec Bernard Lamarche-Vadel ?
Au départ, Bernard Lamarche-Vadel est un ami de François Meyronnis, qui écrivait très précocement, à 17 ans je crois, dans sa revue Artistes. BLV était alors critique d’art et curateur de génie, avec un côté agitateur, troubleur de circuit. En 1997, on le contacte lorsqu’on fonde Ligne de risque, on voulait qu’il signe le manifeste inaugural de la revue. On le voit alors régulièrement au Café Sélect, à Montparnasse, où François Meyronnis et moi on se réunissait. C’est l’époque où il est devenu écrivain. Je tiens Vétérinaires, Tout Casse et Sa Vie, Son Œuvre pour ce qui est arrivé de mieux à la littérature française depuis le dernier livre de Jean Genet.
BLV disait pour rire (et sérieusement) qu’il était notre précurseur. Nous a-t-il baptisés ? En quelque sorte oui. C’est le dernier des grands marginaux. Le seigneur d’un champ littéraire qui, depuis son suicide en 2001 (depuis celui de Deleuze, depuis celui de Debord), est devenu une flaque de bouse. Ce triple glas résonne à nos oreilles comme l’annonce de la fin d’une époque. En un sens, BLV a été mis à mort. La société a gagné contre les maquisards. Mais, comme nous le rappelait sans cesse BLV en citant la phrase d’Artaud : « La société se croit seule, et il y a quelqu’un ». Cette phrase est de plus en plus vraie.

- Bernard Lamarche-Vadel
Le récit de François Meyronnis
Dans Tout autre, sous-titré « Une confession » (2012), François Meyronnis raconte :
Cette fois, j’ai une trentaine d’années : dans le crâne, pas d’autre dessein que de m’approcher de la parole, et même d’être la parole « dans une âme et un corps ». Tous les jours, s’asseoir devant du papier pour que cela advienne. Ce jour-là, comme la veille et l’avant-veille, je fais les gestes. Mais à peine assis à une table du café Select, une jeune femme s’avance vers moi et me dit que quelqu’un souhaite me voir. Revêtu d’un manteau sombre et d’un chapeau de feutre, avec une barbe de deux jours presque blanche, celui qui m’appelle est mon ami Bernard Lamarche-Vadel. Une fois à sa table, je pense aussitôt au roi Lear errant sur la lande, dont la folie pénètre les énigmes du monde. Très noire, sa prunelle est plus intense qu’autrefois ; encore plus grave, mais toujours aussi précise, sa voix ; mieux qu’avant, il ressemble à un loup, dont il a vaguement les oreilles. Et pourtant il différait de l’homme encore jeune auquel on m’avait présenté dix-sept ans auparavant, alors que je n’en avais moi-même que dix-sept.
À cette période, il était un critique d’art influent, comme on dit ; en apparence, couvert de femmes, élégant, désinvolte. Avec quelque chose du dandy, il aimait être serré au cou par des cravates, et aux poignets, par des boutons de manchette ; avec quelque chose aussi du boucanier ou de l’écumeur, sachant battre monnaie avec les simulacres. Mais obsédé déjà par ce qui dans l’art regarde vers l’invisible et par la possibilité, toujours reculée, d’être lui-même un écrivain. Cette possibilité, entre-temps, il avait dansé le sabbat avec elle : un fossé le séparait donc de l’homme que j’avais côtoyé au début des années quatre-vingt.
Tout d’un coup, Bernard retire son chapeau. Surprise de découvrir que sa crinière, jadis abondante, est rasée : cette coupe mutilatrice, m’apprend-il en désignant son crâne tondu, est le résultat d’une oblation, en vue d’adresser ses cheveux, en ce jour de l’automne 1996, aux différentes autorités du pays. Le président de la République en a reçu une enveloppe, une autre le Premier ministre, et de même le ministre de la Culture, et celui de la Justice, sans parler d’autres instances, sur lesquelles il ne s’étend pas. C’est qu’on l’a condamné, affirme-t-il. On l’a frappé d’une peine infamante. La justice française — il tient à m’en informer a prononcé un jugement contre lui, qui le déshonore, de même que sa descendance. Une iniquité, cet arrêt, dont il ne se relèvera jamais ; mais, de son point de vue, il s’agit plus gravement du maquillage d’un assassinat. En effet, on ne lui a pas fait subir un procès. Plutôt une mascarade, où l’on a grimé le bouc émissaire en coupable, sans avoir le courage d’aller jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’au meurtre.
Émousser le scandale, ce fut leur méthode. Cela a toujours été leur choix, d’ailleurs. Seulement, il n’entend plus se rendre complice de telles atténuations. S’il faut donner son sang, banco, il accepte ! En gros, c’est ce qu’il me dit.
De deux choses l’une : ou les autorités supérieures du pays le réhabilitent, abrogeant les sentences qui le flétrissent ; ou lui-même exécutera à plein le jugement rendu au nom de ceux qui parlent sa langue. Avec sa chevelure en guise de caution, voilà le message qu’il avait fait parvenir aux sommités françaises. Aussi la jeune femme le menait-elle jusqu’à une clinique du Vésinet, le café Select n’étant qu’une brève station pendant la montée au Calvaire, une simple halte avec l’idée peut-être de me retrouver, avant un nouveau séjour dans cette maison de santé où, de plus en plus fréquemment, on l’hospitalisait du chapeau, selon son expression. Cet endroit, du reste, il l’appréciait. Sans doute se le représentait-il, à l’instar du manoir où il vivait depuis quelques années, comme un lieu de séparation — un lieu où il s’isolait loin du déséquilibre corrosif et du dérèglement profond qui ravagent le globe de manière incessante et continuelle. C’est pourquoi il n’écrivait plus que derrière les murs de la clinique, sous la surveillance des médecins et des infirmiers ; ou alors derrière les enceintes de son château, dans la Mayenne, sous la protection de ses chiens bas-rouges. Pas de liberté, à ses yeux, sans réclusion. Comment vivre, sinon, sur la ligne, comme il disait, où tout casse et rien ne passe ? Pour qu’un être singulier advienne, pensait-il, il lui faut d’abord un havre.
Lorsque je l’ai revu, quelques semaines plus tard, il allait mieux. Un havre, il l’avait trouvé dans la chambre Zéro, au rez-de-chaussée de la clinique, d’où il pouvait regarder en face son bourreau, la France, et se souvenir de son histoire, avec toute la cruauté nécessaire. Aussitôt entre les murs blancs de cette chambre, il avait repris la rédaction de Sa Vie, Son Œuvre, dont les affres l’avaient conduit au seuil de l’effondrement. Car il y raconte comment son existence a été maléficiée dès le principe, et la manière dont le suicide y a d’emblée pris la place de la naissance. Autant dire que les démêlés juridiques, consécutifs à la revente d’une œuvre d’art de Joseph Beuys, son modèle allemand, que ces démêlés, donc, avaient réactivé un dol beaucoup plus ancien. Avec, pour contrecoup, la réceptivité d’un sismographe.
Une idée déposait son halo sur chacune de ses minutes, à tel point qu’il lui fallait des cachets à heure fixe, qu’une aide-soignante lui apportait dans une assiette. Que s’est il passé ? Quelle catastrophe ? Et si le train des guerres mondiales du XXe siècle en avait caché un autre — une guerre invisible, planant au-dessus des conjonctures et des situations, mais capable de tout rafler, de sauter entre les fuseaux horaires, d’empocher le monde à chaque battement ? Cette hypothèse inquiétante, presque folle, Bernard l’endurait, même si elle lui glaçait le sang.
En vérité, il tenait ferme. Mais à condition d’avaler un cachet bleu roi à une heure, avec le café ; puis un autre, rose saumoné, à cinq heures, avec le thé.
Aucun doute pour lui. L’effroyable a déjà eu lieu. Nous sommes après la catastrophe. Sur ce point, nous étions d’accord. Et sur la difficulté, à partir de là, de se faire entendre par les autres. Par ceux qu’on a dressés à roupiller, et qui, malgré l’agitation des cauchemars, se laissent exproprier de leur vie. Parmi les quelques-uns qui s’affublent du bonnet d’artiste, disait-il, et surtout parmi les écrivains, la plupart ne songent qu’à distraire. Il regrettait qu’on eût fait au lecteur une tête de moineau pressée. C’était sa formule. Or cette tête de moineau, il est difficile, pour une parole, de l’atteindre. Enfin, pour une parole vivante. Car, coupé de son écoute, le moineau humain l’est aussi de toute délivrance. Entre chaque être et sa parole, disait Bernard, on a dressé un mur de surdité. Et contre ce mur, il luttait. Avec ses phrases torses, infusées de syntaxe allemande, il luttait. Au prix de quelle angoisse, personne ne saura.
Dans la chambre Zéro, sur sa petite table recouverte de feuilles et de livres, Bernard écrivait pour rendre vie à une parole qui s’est déjà tue. Ou qu’on a déjà tuée. Une langue spectrale, ce qu’il cherchait : dans son cas, entre français et allemand. Avec elle, il espérait probablement rien moins que faire revenir le langage, quitte à mettre en cause l’ordre même de la phrase. Comme si trouver une langue au déluge lui semblait, pour en sortir, indispensable. Sinon, disait-il, comment faire un trou dans la toile ?
Son œil prenait parfois une lueur malicieuse. En riant, il disait que les Oraisons funèbres de Bossuet était le dernier livre, à condition de le lire depuis Lautréamont et Rimbaud, ou depuis Proust et Céline ; celui vers lequel confluent tous les livres. N’incombe-t-il pas à l’écrivain d’être à la fois le témoin de la parole et celui de la mort ? L’évêque de Meaux ouvrait les tombeaux devant la cour. Eh bien, lui, à sa manière, recommençait ce geste. Mais ce n’était plus la même mort, et il n’y avait plus de cour. Ce qu’il voulait, jusqu’à l’insupportable, c’était coïncider avec le réel. Rien à voir avec les épigones tardifs de Balzac, car il prenait le risque de sortir du cadre. Je veux comprendre mon époque, disait-il, et en devenir l’ange ou le fantôme. Il bouffonnait, ensuite : ne suis-je pas un vivant mort qui parle à des morts-vivants ? C’est ainsi qu’il nommait les Français.
En France, disait-il, rien ne chante plus, mais tout y est chantage. La Collaboration, pour un peu, il n’aurait vu qu’elle d’un bout à l’autre de l’histoire récente : non plus un moment honteux, mais la mentalité même d’un peuple. Français parmi les Français, comme il aimait dire, de cet avilissement palpable, il souffrait. Né à la fin des années quarante, il estimait qu’on lui avait joué un sale tour. Sous le couvert du général de Gaulle, on s’était targué de renouer avec une certaine gloire. Dans celle-ci, beaucoup de postiche ; mais cela tenait vaille que vaille. L’oiseleur roucoulait sa romance nationale. L’indignité au sommet, celle de Pétain et de Laval, on répétait sur tous les tons qu’il n’en restait plus trace, hormis dans quelques milieux fermés. Ne l’avait-on pas balayée, cette valetaille du crime, avec son fascisme de laquais, mesquin jusque dans l’ignominie ? Mieux : sans que le gaullisme y fût pour grand-chose, la France redevenait soudain intelligente, c’est-à-dire subversive. Dans sa jeunesse à Vincennes, Bernard avait connu une effervescence de la pensée, autour des noms prestigieux de Lacan, Foucault, Derrida, Lévi-Strauss, Barthes, sans parler de Deleuze, qu’il aimait par-dessus tout.
L’esprit de Mai 68 étendait ses grandes ailes blanches. Donc aussi celui de Dada et du surréalisme ; celui de Tristan Tzara, André Breton, Antonin Artaud, et de tous les anarchistes de Paris, en guerre contre les insipidités.
Et puis, effondrement dans l’ineptie. Le spectre de Vichy se requinque dans un mauvais air. On roule dans un sirocco lugubre, qui provoque bientôt un assèchement spectaculaire.
Après un certain laps, des saisons fastueuses ne persistait que la honte d’en être exclu. L’option Zéro ! Le pays tout entier, conduit par des paillasses, avait fait ce choix morfondant. Collaborer, disait Bernard, tel est de nouveau le minable antidestin de chaque Français. Et d’abord à son propre affaissement. Nous les Français, disait-il, on s’enfonce dans une non-valeur toujours plus abyssale : on sombre toujours plus bas, dans une inconsistance répugnante pour nous autant que pour les autres. Et afin de la supporter, on recourt à l’amnésie. Gommer, couvrir : nous faisons cela. On efface tout : les dates, les noms, mais d’abord la langue et, avec elle, les sensations, les gestes. Déjà, nous ne sentons plus les nuances. C’est-à-dire que nos prédécesseurs, nous ne les comprenons plus : ceux qui, avant nous, ont parlé avec les mêmes mots. Mais ce n’étaient pas vraiment les mêmes. Dans nos bouches, ils tombent en déliquescence.
Cousus dans le minime, nous sommes. Rapiécés dans le négligeable... Sans cesse ni repos, ravaudés dans la broutille. Quotidiennement, disait Bernard, les blutoirs mentaux médiatiques nous aident à descendre d’un cran. Notre bêtise, en effet, on nous l’enfourne toute mâchée. On ne nous ménage ni les spectacles sportifs, désespérants d’idiotie ; ni les débats poussifs, sans autre horizon qu’une débilité obscène. Claquemurés dans un petit rêve, toujours plus petit, on se laisse fermer les yeux et les oreilles. Comme si nous ne voulions pas admettre ce qui pourtant se montre très nettement : à savoir que la République française se transforme en royaume des morts ; que cette république est même devenue un synonyme de la mort, ou du moins qu’elle désigne une région macabre. Et du coup, nous mentons ; mais sans en posséder l’art comme les Gitans. Nous ne cessons pas de mentir, maussadement, à nous en retourner le cœur.
« M’ont menti, me mentent et me mentiront », cette phrase venait à Bernard dès qu’il évoquait les Français. Non sans produire un effet comique, il en usait en guise de ritournelle. Engendrés dans le mensonge, il signalait à quel point ils étaient conditionnés par lui, et comment ils mentaient tous les jours pour survivre dans la mort. C’est pourquoi, en tant que Français, nous ne pouvons faire autrement que de collaborer, disait Bernard. Il ajoutait : c’est pourquoi, depuis longtemps, nous ratons l’art, surtout en littérature, et de façon pathétique et pitoyable, à proportion de la grandeur qui nous précède dans notre langue. Acerbe, il considérait le lamentable échec de sa génération artistique, promettant à la suivante un échec encore plus lamentable. Cela excitait son côté narquois, et il devenait irrésistiblement drôle, levant le voile sur les différents degrés du loupage, lorsqu’il clamait les noms des principaux bousilleurs, prônés en raison même du flop.
La chambre Zéro, il l’identifiait, mieux que le palais de l’Élysée ou le siège des Éditions Gallimard, comme le véritable cœur de la patrie. Que personne n’en sût rien ne le troublait pas. À ses yeux, l’ombilic du pays, son pivot secret, ce ne pouvait être que cette chambre éclairée par un plafonnier, avec lit étroit, table basse, lavabo, petit bureau adossé au mur et fenêtre donnant sur le parc de la clinique. Pourquoi ? Parce que dans cette chambre quelqu’un éprouvait totalement et se rendait totalement conscient du point où le pays était rendu, et que Bernard, en montrant le symbole numéral inscrit sur la porte, nommait le point nul de son histoire. Bref, dans cette chambre la France, à travers le système nerveux d’une de ses victimes, ressentait ce qui l’épluche et la réduit à néant. Si mes concitoyens ne faisaient pas que mentir et mentir, serais-je, moi, contraint à la folie ? demandait Bernard. Et se doutent-ils que, pour occuper cette chambre, il faut avoir du doigté envers sa propre faiblesse ? Car se rendre présent à un tel anéantissement, cela demande une énergie qui nous manque, une profondeur dont nous n’avons plus la ressource, et un sens de la civilisation qui nous a abandonné depuis longtemps.
Soyons justes. Cet anéantissement s’élargit à la planète. En détachant chaque syllabe, Bernard affirmait que le sommet innommable du diable se confond avec une emprise du chiffre, et que celle-ci s’exerce à l’échelle des cinq continents. Rien, désormais, qui ne soit subordonné à des forêts de chiffres, disait-il ; car à chaque instant l’empire mondial du chiffre refait le monde à son image et à sa ressemblance. À chaque instant la moindre parcelle du monde, êtres humains compris, est convertible en chiffres, pour devenir aussitôt échangeable et donc remplaçable. En interposant entre eux du calcul, puis en les alignant dans une suite de nombres, on met les individus en équivalence. Alors, disait Bernard, personne n’est plus personne. Quand tout est dans la puissance du nombre, il ne reste qu’à fabriquer en série les vivants, à produire les animaux dans des sortes d’usines, en leur faisant quotidiennement avaler leur propre souffrance. Quand tout est dans la puissance du nombre, disait-il, tout est virtuellement anéanti, sans exemption pour l’être qui parle.
Dans la chambre Zéro, Bernard méditait sur l’édifice du chiffre (il le nommait ainsi), dont faisaient partie les camps allemands et soviétiques, mais non moins le marché intégré. La haine de la parole et la haine de la gratuité, pensait-il, voilà sur quoi se fonde cet édifice, qui correspond maintenant au monde lui-même, alors que l’écrasante majorité des hommes ne se confronte jamais avec ce qui en eux gicle du fiel sur la parole et la gratuité, et donc ne le surmonte pas.
Vers la fin, il était obsédé par la manière dont les nazis ont inscrit des numéros sur les corps juifs, avant de faire mourir ces hommes, ces femmes et ces enfants dans le chiffre d’une comptabilité forcenée, comme si celle-ci pouvait s’achever avec une somme calculable. D’après lui, les nazis se défendaient de le comprendre, mais chaque juif était pour eux la parole. Et cette parole, ils l’ont offerte en sacrifice au chiffre. Or la fureur rabique qui les contraignait à transformer l’Europe en immense abattoir, cette fureur nous sommes loin de l’avoir laissée derrière nous. Cela aussi, pensait-il, nous nous défendons de le comprendre. C’est d’ailleurs pour le masquer que nous mentons sans arrêt, et pas seulement nous, les Français.
Le délire des nazis, bien naïf qui pense que ce n’était qu’une parenthèse dans l’histoire de l’Occident, et qu’après 1945 on a restauré la nouvelle trinité évangélique : la démocratie, le progrès, la science. En fait, chacun des termes a tourné, muant en ondes de mort. Pour Bernard, cela prenait l’aspect d’une poussée infernale, engrenage sans fin d’une malédiction. De dégagement, il n’en espérait plus qu’à travers l’éclair du suicide. Pour ma part, cette alternative : insignifiance ou autodestruction, je la récusais. L’éclair, selon moi, traçait sa zébrure entre les deux nuages, en apportant la lumière de l’instant.
Difficile d’être plus éloignés : au cœur de l’horreur, il me semble toujours que demeure un indemne. Et si la prépotence du néfaste s’enroule autour de nous, nous enveloppe de ses mailles et de ses nœuds, si elle se vrille dans le temps lui-même, elle laisse en moi une enclave de sérénité. À chaque seconde un étroit défilé m’y donne accès. Peu importe si ce lieu voisine avec des écueils, et même si la folie ou l’abandon me brisent. Malgré sa hauteur et son éclat, ce lieu, je le suis, et rien ni personne ne pourra faire que je ne le sois pas, hormis ma faiblesse.
De moi, Bernard disait : tu es double. A une partie très lumineuse s’en ajoute une autre, franchement obscure, inquiétante. Vers la fin, il jouait avec l’idée d’un sacrifice, et que je sois son instrument. Un entretien donné à la revue Ligne de risque un an avant son suicide porte la trace de ce jeu. Il imagine qu’un jeune homme, à sa demande, l’abatte d’un coup de revolver, et par avance il implore qu’on relâche le tueur et même qu’on le gratifie. Ce serait un jeune écrivain — disait-il — ; rien de son ouvrage n’a encore été édité. Mon cas, à l’époque. Sa harangue, il la concluait ainsi : « Qu’il poursuive son travail et que l’esprit de mes livres, si faible, hésitant et cafouilleux qu’il soit, le soir, la nuit, autant que faire se peut, l’aide à insister, et l’aide enfin à
résister. »
Lorsque j’ai publié mon premier roman, Ma tête en liberté, en mars 2000, je l’ai envoyé à Bernard, d’autant qu’il en était un personnage. Le livre, d’abord, se perd et il m’appelle pour que je le lui adresse de nouveau, ce que je fais aussitôt. Venant tout juste de le recevoir, le lundi 24 avril, il délivra par téléphone ses premières impressions de lecture à l’ami Frédéric Badré : il faudra qu’il prenne garde, dit-il en riant, car ils lui feront payer son arrogance.
Au sujet de cette prédiction, il aura eu du nez, hélas !
Le dimanche 30 avril, telle la colombe qui rentre dans l’arche obscure faute d’avoir trouvé l’heure vraie, c’est-à dire l’instant de l’instant, selon ses mots, Bernard se tue avec une carabine 22 long rifle, au château de la Rongère, lieu-dit de la Croixille. Comme il aimait le répéter à ses amis, insistant sur la puissance des noms : « Je suis rongé, sur la petite croix. »
Une phrase de lui, souvent, me revient en mémoire : « Tout est symbolique, car tout est symbolique. »
François Meyronnis, Tout autre, Gallimard, coll. L’infini, 2012, p. 55-67.
Livres
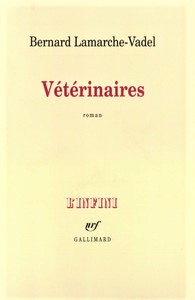 « Un grand livre est une expérience immédiate : voici des phrases simples, obstinées, glissantes, qui vous enveloppent et ne vous lâcheront pas. L’auteur a son idée, il la développe, vous sentez que rien ne peut perturber sa logique. Le sujet, en apparence, est très calme : ce narrateur a, comme son frère, une vocation de vétérinaire. C’est son destin naturel, les animaux, leur vie, leur mort, les paysages où ils persistent, jardins, bords de fleuve, pavillons de banlieue. Oui, ce narrateur est très attentif, il observe, il soigne en passant. Il y a aussi Klaus Friedrich, curieux ami, menuisier et peintre. Il y a une jeune femme et son chat. Il y a, surtout, l’Union des Vétérinaires et son club confortable. Tout est normal. Extrêmement normal. Humour ? Comble de folie raisonnable ? Force de la littérature, en tout cas. »
« Un grand livre est une expérience immédiate : voici des phrases simples, obstinées, glissantes, qui vous enveloppent et ne vous lâcheront pas. L’auteur a son idée, il la développe, vous sentez que rien ne peut perturber sa logique. Le sujet, en apparence, est très calme : ce narrateur a, comme son frère, une vocation de vétérinaire. C’est son destin naturel, les animaux, leur vie, leur mort, les paysages où ils persistent, jardins, bords de fleuve, pavillons de banlieue. Oui, ce narrateur est très attentif, il observe, il soigne en passant. Il y a aussi Klaus Friedrich, curieux ami, menuisier et peintre. Il y a une jeune femme et son chat. Il y a, surtout, l’Union des Vétérinaires et son club confortable. Tout est normal. Extrêmement normal. Humour ? Comble de folie raisonnable ? Force de la littérature, en tout cas. »
Philippe Sollers.
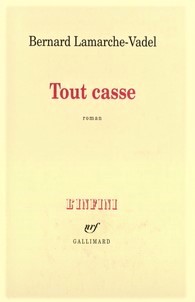 « Que se passe-t-il quand tout casse ? D’abord, dans cet étrange pays qui s’appelle, de nos jours, Zamenhof ou Marbach, les animaux meurent. Le personnage central du livre, replié dans son château avec ses chiens, apprend la progression du désastre par le récit d’un couple étrange, M. et Mme Bonheur. Ce narrateur, sorte d’aristocrate enfermé dans une méditation du temps et de la mort, a un livre de chevet : les Oraisons funèbres de Bossuet. Il veille, il lit, il écoute, il rumine on ne sait quel chagrin radical ou une sourde et meurtrière vengeance.
« Que se passe-t-il quand tout casse ? D’abord, dans cet étrange pays qui s’appelle, de nos jours, Zamenhof ou Marbach, les animaux meurent. Le personnage central du livre, replié dans son château avec ses chiens, apprend la progression du désastre par le récit d’un couple étrange, M. et Mme Bonheur. Ce narrateur, sorte d’aristocrate enfermé dans une méditation du temps et de la mort, a un livre de chevet : les Oraisons funèbres de Bossuet. Il veille, il lit, il écoute, il rumine on ne sait quel chagrin radical ou une sourde et meurtrière vengeance.
Mais voici, dans le même mouvement, les jours "boum-boum". Partout, dans le pays, les envahisseurs sont là : Occupation, Collaboration. Les jours "boum-boum" sont constitués par l’ordre transmis constamment aux populations de se livrer à une intense reproduction de l’espèce. Il faut procréer à tout prix. Pour cela, jeux télévisés piégés, surveillance renforcée des mâles, dénonciations, propagande. Des bataillons de femmes se répandent dans le paysage. En avant ! Au travail !
Ce roman est, sous forme de fable à peine fantastique, l’autopsie de notre époque, de la désagrégation d’un monde sans pitié à cause de ses détails. C’est peu dire qu’il amène à son comble l’humour noir. D’où la souffrance hautaine et terrible qui s’en dégage. »
Philippe Sollers.
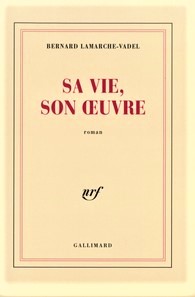 « Ce livre paraîtra le 6 mai 1997, elle ne nommait Charlotte Salomon, c’était ma fille. Mon plus beau et mon dernier roman avec qui j’ai tant aimé construire, soir après soir, ce que nous appelions notre boîte à camembert ; Charlotte, ce roman est le tien, où que tu sois pour le lire, et entendre peut-être le lointain murmure de la voix de ton père lorsqu’il le lisait à sa petite fille adorée autant qu’admirée, dans sa chambre nue, à Marbach, jusqu’à l’année dernière.
« Ce livre paraîtra le 6 mai 1997, elle ne nommait Charlotte Salomon, c’était ma fille. Mon plus beau et mon dernier roman avec qui j’ai tant aimé construire, soir après soir, ce que nous appelions notre boîte à camembert ; Charlotte, ce roman est le tien, où que tu sois pour le lire, et entendre peut-être le lointain murmure de la voix de ton père lorsqu’il le lisait à sa petite fille adorée autant qu’admirée, dans sa chambre nue, à Marbach, jusqu’à l’année dernière.
Maintenant qu’il sera mieux compris dans quel esprit ce livre fut composé, j’ose ajouter en forme de vœu qu’à cette édition française de Sa vie, son œuvre, dans la langue originale grâce à quoi ce livre fut écrit, j’espère que se substituera un jour une nouvelle édition en français, mais traduite de l’allemand. Tel demeura encore notre état d’esprit commun à ma fille et à moi-même lorsque nous concevions cette histoire pour qu’il fût légitime de la déclarer authentiquement achevée. »
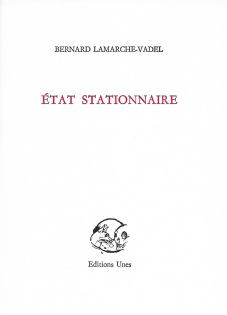 L’idée principale était de favoriser la plus grande immobilité des choses, de parler très peu, et de contempler le plus longtemps possible des intervalles où rien de particulier ne se passait ; et l’idée était aussi d’être heureux dans l’état stationnaire. De ne plus vouloir à côté de l’état où j’étais, mais de me pelotonner dans la chaleur de l’état, dans le réconfort d’une durée, sans aucun accident, ni des pensées ou des imaginations, qui m’auraient poussé à déborder ou entreprendre. Je me contentais très bien des idées nécessaires et de l’imagination suffisante.
L’idée principale était de favoriser la plus grande immobilité des choses, de parler très peu, et de contempler le plus longtemps possible des intervalles où rien de particulier ne se passait ; et l’idée était aussi d’être heureux dans l’état stationnaire. De ne plus vouloir à côté de l’état où j’étais, mais de me pelotonner dans la chaleur de l’état, dans le réconfort d’une durée, sans aucun accident, ni des pensées ou des imaginations, qui m’auraient poussé à déborder ou entreprendre. Je me contentais très bien des idées nécessaires et de l’imagination suffisante.
Dans la famille, on est vétérinaires de pères en fils, décision implacable voulue par tous et décidée par personne. C’est le point de départ d’État stationnaire bref récit de 1985, que Bernard Lamarche-Vadel reprendra partiellement en 1994 en ouverture de son premier roman, Vétérinaires . Si Vétérinaires déploie ses tableaux hallucinés, entre drame et farce féroce, État stationnaire suit pour sa part la lente dérive mélancolique de son personnage, sans que l’on sache jamais si l’on est dans la violence ou dans la douceur. Lamarche-Vadel impose le paysage, les journées répétitives autour des idées enfouies au bord de la Marne, dans les panoramas ternes d’Ile-de-France, entre deux visites de routine à des animaux vaguement malades. Il trace la géographie d’une existence impossible à saisir, cherche un point d’accroche en observant les feuilles s’agglutiner sur le fleuve, au fil des saisons. On pourrait se fondre dans la comédie des autres, dans « la politesse comme l’altitude la plus efficace protection de soi-même » ; mais on ne peut pas. Ce sont les instants qui s’étendent comme on étend un corps. Dans l’immobilité du corps, c’est au langage d’inventer de nouvelles constructions, de creuser des possibles, d’inventer un état avec lequel il soit possible de vivre. Il doit trouver une place nette dans la divagation de l’esprit. Il reste alors la vision des amitiés immobiles, des amours un peu mornes, dans une vie qu’on a fait en restant à sa petite place, sans rien déplacer. « L’idée était que tout demeurait, le fil n’était pas coupé », on s’accroche au meilleur moyen de laisser-faire, dans une forme de célébration nue de l’ordinaire. Dans cette vie où les mots vont trop vite, le meilleur moyen de laisser-faire est d’observer le lent mouvement des autres, leur cordialité quotidienne, la solitude impossible à combler et la répétition des heures. De parler peu, de ne rien perturber et d’être ainsi peut-être heureux. « Parfois nous nous tournions l’un vers l’autre en souriant, c’était l’état stationnaire », on respire lentement, et dans un geste tout aussi lent, on laisse pousser les végétations du réel.
2019, Frontispice de Daniel Nadaud.
Imprimé en typographie, 48 p., format 11x16 cm, 9782877042062, 12 €
Editions Unes
Bernard Lamarche-Vadel :
« Je ne crois pas tellement à la poésie, je crois plus à la littérature »

- Lamarche-Vadel © Bettina Rheims
Bernard Lamarche-Vadel écrivait à contre-courant, critique d’art, romancier, poète, il était à la fois un penseur et un savant. Dans cet entretien il évoque ses lectures, son double savoir d’universitaire et "d’homme de la nuit". Il analyse ses ambitions, donne son opinion sur des écrivains et sa définition du poète.
Son entretien débutait ainsi, à propos du livre qu’il venait de publier chez Bourgois intitulé Du chien les bonbonnes :
« Je ne crois pas tellement à la poésie, je crois beaucoup plus à la littérature, au travail textuel. »
Par Gérard-Julien Salvy
1ère diffusion : 17/04/1976 - Les matinées de France Culture

La "Nuit rêvée" de Yannick Haenel, France Culture, 13 mars 2016
Bernard Lamarche-Vadel, Conférence à la villa d’Arson, 1989
Le Musée d’Art moderne de la ville de Paris / ARC organise la première exposition majeure sur un critique d’art : Bernard Lamarche-Vadel (1949-2000). Ses écrits inclassables, sa personnalité flamboyante et son engagement auprès des artistes ont marqué le monde de l’art des années 1970 à aujourd’hui : Arman, Lewis Baltz, Joseph Beuys, Robert Combas, Jean Degottex, Erik Dietman, Gérard Gasiorowski, Mario Merz Helmut Newton, Roman Opalka, Bettina Rheims, Richard Serra...

 La « bande-son de l’art contemporain », pour reprendre les mots de Bernard Lamarche-Vadel, désigne la critique d’art dans le rôle qui est le sien de donner à voir l’œuvre qu’elle accompagne. Cet ouvrage retranscrit l’essentiel des conférences sur l’art moderne et contemporain données par Bernard Lamarche-Vadel à l’IFM entre 1991 et 1999. Un parcours esthétique de grande ampleur qui va de l’impressionnisme à la trans-avant-garde en passant par des figures de la modernité aussi marquantes que Malevitch, Mondrian, Pollock ou Opalka. Au-delà de la compréhension de trajectoires artistiques, Bernard Lamarche-Vadel se saisit surtout des enjeux philosophiques et esthétiques de la modernité. Parce qu’il cherchait à communiquer, de son propre aveu, le goût de s’approcher « non seulement des œuvres elles-mêmes, mais aussi des discours qui se sont tenus à propos de ces œuvres et qui les éclairent », cet ouvrage offre un accès inattendu et percutant à la pensée d’un des plus importants critiques d’art de sa génération.
La « bande-son de l’art contemporain », pour reprendre les mots de Bernard Lamarche-Vadel, désigne la critique d’art dans le rôle qui est le sien de donner à voir l’œuvre qu’elle accompagne. Cet ouvrage retranscrit l’essentiel des conférences sur l’art moderne et contemporain données par Bernard Lamarche-Vadel à l’IFM entre 1991 et 1999. Un parcours esthétique de grande ampleur qui va de l’impressionnisme à la trans-avant-garde en passant par des figures de la modernité aussi marquantes que Malevitch, Mondrian, Pollock ou Opalka. Au-delà de la compréhension de trajectoires artistiques, Bernard Lamarche-Vadel se saisit surtout des enjeux philosophiques et esthétiques de la modernité. Parce qu’il cherchait à communiquer, de son propre aveu, le goût de s’approcher « non seulement des œuvres elles-mêmes, mais aussi des discours qui se sont tenus à propos de ces œuvres et qui les éclairent », cet ouvrage offre un accès inattendu et percutant à la pensée d’un des plus importants critiques d’art de sa génération.
Edition établie et présentée par Joël Denot.
Bernard Lamarche-Vadel : La bande-son de l’art contemporain
Critique d’art perspicace, Bernard Lamarche-Vadel fut d’abord un écrivain. Son projet, au sens d’un projet de sa vie, fut, fondamentalement et radicalement, littéraire. Son ambition était de parvenir, par l’écriture, « à produire une forme, un objet, qui aurait valeur d’œuvre d’art. » Entreprendre d’éditer post-mortem un choix de conférences d’un écrivain à ce point soucieux du style, et de la question du style, est audacieux. « Le choix a été fait, indique Joël Denot, maître d’œuvre de l’entreprise, de prendre des moments issus de différentes années afin de constituer un cycle d’une année “ idéale ” … » Quel traitement, quel usage, BLV aurait fait, de son vivant, des Conférences qu’il donna de 1991 à 1999 à l’Institut Français de la Mode ? Nous l’ignorons. Le CD joint à l’ouvrage nous restitue l’ampleur et la précision de son expression. BLV possédait en propre la faculté de s’adresser à « un public de non-spécialistes ». Il savait « se faire l’avocat du travail des artistes auxquels il croyait auprès de gens qui, par ignorance, auraient pu le condamner. ». De ce point de vue, l’initiative est crédible. Loin de l’austérité des discours universitaires, BLV rebondit opportunément sur l’incrédulité de ses auditeurs. À la question « Est-ce qu’on peut parler de duperie ? », il répond sans s’émouvoir : « Le principe de l’art a toujours été d’une certaine manière de duper ceux qui le regardent. » La force et l’autorité de son propos sont certes soutenues par son érudition, mais aussi et surtout par la relation de complicité qu’il sut avec passion, comme amateur et comme critique d’art, entretenir avec les artistes et les œuvres de son temps. Le chapitre intitulé « Le rôle de la critique » est un modèle de pédagogie inspirée. Se référant à un tableau d’On Kawara accroché au mur de sa propre salle de séjour, il déclare : « Dans l’émotion qui me porte, ce tableau, je crois, est l’équivalent d’un Renoir qui figurerait un crépuscule… ». Deux principes actifs fondent sa pensée et son discours : l’art est d’abord un « travail » (il convient de cheminer mentalement vers les œuvres), mais l’art est « aussi un texte » (les œuvres sont nourries des commentaires qu’elles suscitent). Partant des Impressionnistes, saluant les Fauves, puis les trois grands M (Malevitch, Mondrian, Matisse), BLV démontre que la « mission » des artistes est désormais de « représenter une totalité impossible à représenter ». L’œuvre s’est dématérialisée (émergence et pertinence de l’art conceptuel et minimal) et les institutions ont favorisé une « coexistence somme toute pacifique des styles ». Le parcours s’achève, à la fin des années 80, sur un double constat qui conserve toute son actualité : le postmodernisme est avant tout « un produit sociologique et signale la réussite des classes moyennes » ; les artistes vivent « comme des rock stars, et s’engagent dans un marché qui leur fournit des moyens équivalents à ceux des artistes qui font des disques. » Percutant et lucide, BLV conclut en s’excusant auprès de son auditoire : « Je vous donne quelques minuscules clés, dont j’ai honte d’ailleurs tant elles sont minuscules. »
Paru dans Critique d’art n° 27, Printemps 2006. Alain Coulange
[1] Il y a aussi des témoignages de Yannick Haenel, François Meyronnis, Marie Darrieussecq et Danielle Robert-Guédon dans le N° 15 (janvier 2001), après le suicide de BLV.




 Version imprimable
Version imprimable Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?



1 Messages
Il serait intéressant de mettre en série cette conférence de la villa d’Arson, 1989, de Bernard Lamarche Vadel, avec l’intervention de Jean-Marc Poinsot du 24 octobre 2017 au séminaire ‘’Penser la Biennale de Paris aujourd’ hui ’’ (en ligne), qu’il intitule ‘’ Drame en un acte et une seule scène – les jeunes critiques à la Biennale de Paris en 1971’’.
Voir en ligne : www.youtube.com › watch