La rentrée littéraire de l’automne 2017 a déjà commencé avec la publication d’un nouveau livre de Yannick Haenel, le 17 août, « Tiens ferme ta couronne » dans la collection Gallimard/L’Infini de Philippe Sollers.
Rentrée littéraire qui s’annonce avec 581 romans (20 de plus que l’année dernière), dont 390 français.
 9/11/2017 : Ajout section Prix Médicis 2017
9/11/2017 : Ajout section Prix Médicis 2017


Alors pourquoi avoir choisi de vous parler de ce livre en particulier ? Pour trois raisons principalement : parce que c’est un des premiers publiés à l’occasion de cette rentrée et aussi, vous le savez, nous avons un tropisme pour ce qui tourne autour de Sollers et ce livre de Yannick Haenel est publié dans la collection L’Infini / Gallimard de Philippe Sollers.


- Ph. Sollers en conférence avec Y. Haenel
- Dans L’Infini N° 100, Automne 2007
C’est pour rendre compte de cette proximité, et affinités partagées que nous avons sous-titré : « un livre sollersien et plus » comme nous le verrons aussi. La troisième raison est que les œuvres de Yannick Haenel sont des œuvres littéraires.

Tiens ferme ta couronne
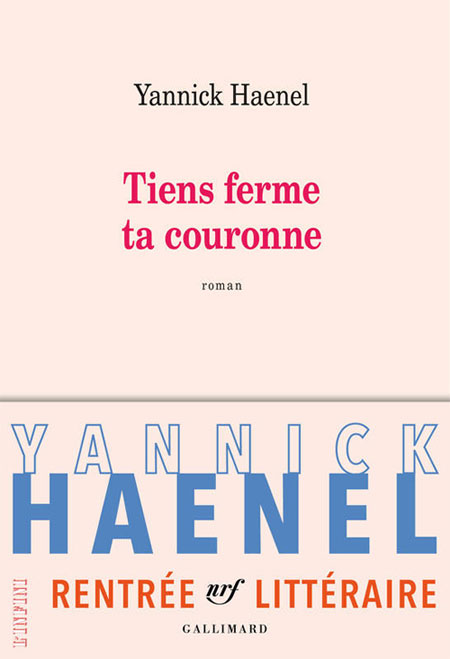
Collection L’Infini, Gallimard
352 pages
Parution : 17-08-2017
Un « homme a écrit un énorme scénario sur la vie de Herman Melville : The Great Melville, dont aucun producteur ne veut. Un jour, on lui procure le numéro de téléphone du grand cinéaste américain Michael Cimino, le réalisateur mythique de Voyage au bout de l’enfer et de La Porte du paradis. Une rencontre a lieu à New York : Cimino lit le manuscrit.
S’ensuivent une série d’aventures rocambolesques entre le musée de la Chasse à Paris, l’île d’Ellis Island au large de New York, et un lac en Italie.
On y croise Isabelle Huppert, la déesse Diane, un dalmatien nommé Sabbat, un voisin démoniaque et deux moustachus louches ; il y a aussi une jolie thésarde, une concierge retorse et un très agressif maître d’hôtel sosie d’Emmanuel Macron.Quelle vérité scintille entre cinéma et littérature ?
La comédie de notre vie cache une histoire sacrée : ce roman part à sa recherche.

Frédéric Pagès
Le Canard enchaîné

Alexandre Lacroix
Philosophie Magazine

Un livre sollersien et plus
Prenez un élément autobiographique, la fascination de Haenel pour Melville, l’auteur de Moby Dick,(il nous en parle dans un entretien de 2007 avec Michel Crépu cité plus avant) transformez le en fiction, mais pas une petite histoire, même si votre livre est catalogué « roman », il faut que le livre soit imprégné de références littéraires, artistiques et ici cinématographiques, de citations – l’auteur se doit d’avoir beaucoup lu – vu – pensé, réfléchi. L’auteur glisse son point de vue. L’auteur ? enfin le narrateur… mais on a tendance à les confondre tant le narrateur semble refléter le point de vue de l’auteur. Et là, le commentaire peut sortir du roman, se faire digression, morceau d’essai. Ajoutez du symbolisme, beaucoup de symbolisme, du mythe et du sacré autour du thème de la chasse et de la mort, – du rocambolesque pour ne pas faire trop sérieux ou pesant. Une pirouette çà et là pour retomber sur vos pieds et revenir dans le thème principal. Tout ça, le plus souvent bien appareillé, comme on le dit d’un mur de pierres réalisé par un maître maçon qui aime le travail bien fait –quand l’artisan se fait artiste.
Ce n’est pas du Sollers, mais la recette est la même ! Ou presque.
Même le réemploi. Ainsi, les développements sur le rôle de l’écrivain déjà publiés dans L’Infini N° 133 sous le même titre. Une préversion de celle publiée dans le livre.
Diane, la reine de Némi, faisait déjà l’objet d’un chapitre de "Je cherche l’Italie.
Le Cavalier polonais de Rembrandt à la Frick Collection de New York a aussi été largement utilisé dans Jan Karski – avec talent. (voir ICI). Sollers avait aussi écrit une belle page sur le même Cavalier polonais. (Voir ICI) Tous deux sont allés l’admirer à New York, à la Frick Collection, Yannick Haenel sur les pas de Sollers ? On le retrouve aussi (pas dans ce roman), visiter l’atelier d’Alain Kirili à New York qu’a aussi fréquenté Sollers. (voir ICI)
« ll suffit d’avoir été là, un soir, au 17 White Street, dans le quartier de Tribeca, à New York, où habitent Ariane Lopez-Huici et Alain Kirili, et d’avoir assisté à l’un de ces concerts de free-jazz qu’ils organisent chez eux avec des musiciens amis pour savoir ce qui se joue entre les photographies, les sculptures et la musique. »
Yannick Haenel, 2014
Parcours Croisés, Musée des Beaux-Arts de Caen.
Mais à partir de la même recette, chacun - Haenel et Sollers – la décline à sa façon.
Si Sollers multiplie les citations et références comme Haenel, sauf erreur, il n’en a pas fait le titre d’un roman. Ici Yannick Haenel puise son titre dans les Carnets de Marcel Proust, qui l’avait lui-même puisé dans l’Apocalypse de Jean. Il faut être érudit pour le savoir, ou lire un critique qui l’est ou en a été informé. Savoir ou faire savoir, va savoir ? Toujours est-il que ce titre convoque déjà le mystère et le mythe avec cette couronne… Comme Sollers, il aime les déesses, le livre se termine avec la déesse Diane.
Par ailleurs, cette ode au cinéma avec tous ses développements autour du cinéaste Michael Cimino, le réalisateur mythique de Voyage au bout de l’enfer et de La Porte du paradis se situe résolument hors du champ littéraire sollersien.
Sur le Titre (Entretien avec Fabien Ribery)
« Tiens ferme ta couronne ». Immédiatement, dès le titre, nous entrons dans une dimension empreinte de mystère, le ton est donné, une croisade sous les couleurs de l’étendard littéraire commence.
Yannick Haenel s’explique à ce sujet dans un magnifique entretien avec Fabien Ribery – un universitaire dont nous avons déjà célébré sur pileface la finesse des articles Voir notamment :
Philippe Sollers, Girondin à travers les siècles

Tiens ferme ta couronne est le titre de votre livre, mais n’est-ce pas aussi une injonction proustienne ? Comment faire pour ne pas être expulsé du royaume des élus ? La fermeté est-elle de l’ordre d’une endurance spirituelle ?
J’ai effectivement trouvé le titre dans Proust : dans ses Carnets. Mais cette phrase, il l’a lui-même recopiée de l’ Apocalypse de Jean. C’est un énoncé avec lequel je joue depuis des années, il fait partie de mes phrases-talismans. Je crois même qu’on l’a placée il y a longtemps, François Meyronnis et moi, en exergue d’un numéro de Ligne de risque. C’est pour vous dire qu’elle vient de loin, et que j’ai eu tout mon temps pour décider que c’était elle et pas une autre qui déclencherait ce roman (car un titre est aussi une première phrase — la vraie première phrase du livre).
De quelle royauté le narrateur de mon roman est-il donc le porteur ? S’il y en a bien un qui ne possède rien, c’est lui. Son royaume est vide : à presque cinquante ans, il vivote dans un studio, sa vie sociale semble un désert, et il passe son temps, allongé sur son divan-lit, à visionner des films en buvant de la vodka et de la bière. Mais comme vous le savez, le royaume peut prendre des formes saugrenues, voire peu reluisantes, et n’être pas plus étendu qu’un grain de moutarde. Bref, si cet homme est roi, il a oublié qu’il l’est ; et ce que raconte le roman, c’est comment la couronne va lui revenir — comment il va retrouver un peu de lumière autour de sa tête.
Alors roi de quoi, finalement ? C’est sans doute le mystère du livre, celui autour duquel tourne un collier de motifs que j’ai pris soin d’entrelacer en empruntant l’allure de la comédie. Car l’élément équivoque dans lequel baignent les journées et les nuits du narrateur n’entame en rien la limpidité de son âme ; et cette histoire raconte, en filigrane, ce que peut subir une âme sans se perdre.
Vous parlez d’élection. « Être élu », personne ne sait ce que ça veut dire, et même si la grâce intervient dans le livre, si la substance des phrases qui sortent de la tête du narrateur émanent en quelque sorte du salut lui-même — lequel l’enjoint à se sortir d’un monde qui se referme sur lui comme un tombeau —, la souveraineté dont je parle, et dont sa personne est quand même auréolée (ne serait-ce que par l’espèce d’innocence qu’il y a dans sa fatigue) relève plutôt de l’expérience : d’une exposition à ce qui ouvre sa vie au sacré. Est-ce la mort, comme dans le mythe du roi du Bois, dont il va épouser la démarche au fil du roman ? Peut-être avant tout ce feu qui habite le langage — cette endurance au risque qu’on découvre lorsqu’on se met à vivre dans les phrases.
Cette endurance contient une liturgie. J’aime bien raconter les emplois du temps, car le profane et le sacré se nouent dans les détails — dans la ritualisation, parfois comique, de notre usage des journées. Au début, Jean Deichel peut apparaître d’une certaine manière comme un homme déchu, un looser, mais il n’a pas pour autant été destitué de sa vie. Au contraire, celle-ci se double d’une dimension mystique : il y a bel et bien un mystère qui, dans sa vie, le transmet au sacré ; il y a bel et bien, autour de sa personne, d’étranges protections qui relèguent chez lui les impacts négatifs au second plan, et lui procurent cette « nouvelle nuance de joie » dont parle Proust, qui est la marque de la grande innocence.
Même les péripéties les plus foireuses appartiennent au monde de l’esprit : Jean Deichel, titubant ivre mort, à moitié nu, dans les couloirs d’un musée, ou se battant dans un restaurant avec deux moustachus n’évolue-t-il pas, sans le savoir, dans une histoire sacrée ? J’ai voulu faire apparaître combien la densité spirituelle d’une existence relevait non seulement de l’imperceptible, mais pouvait toucher les zones où seule la drôlerie accède. Il ne tient qu’à chacun de vivre selon la parole, d’habiter la région de l’être qui lui est propice, et de régner sur son âme. Car à la fin, il s’agit très simplement de cela : être roi, c’est avoir une âme. Mon livre raconte l’histoire de quelqu’un qui, à la faveur des épreuves, va élargir la frontière de son âme (et cela suppose d’aller vers la lumière, mais aussi de ne pas se détourner de l’obscurité).
Alors, « tenir bon » est en effet un programme éthique, certes minimal, mais crucial : il s’agit de ne pas perdre son âme. C’est-à-dire de demeurer dans la vérité. Rien n’est moins simple, et les aventures, ou plutôt les mésaventures de Jean Deichel, montrent bien comment, si l’on baisse la garde, on se trouve sans cesse absorbé par l’enfer. Vous savez que la couronne est la représentation du temple ; c’est Jérusalem sur sa tête. Et en même temps, c’est la nuit, les étoiles et l’ivresse. Voilà : il ne faut pas cesser de croire en son étoile, sinon on rampe en enfer.
Sur la composition du livre en trois parties
Vous adoptez comme dans Cercle une structure tripartite. Que vous autorise le chiffre trois ? Votre narrateur voit apparaître des triangles de noms qui sont des formules magiques, des sortes de contrepoisons.

- Triskel celtique
C’est vrai que le 3 revient sans cesse. C’est la vieille alchimie narrative. Je fais toujours ça : donner trois coups sur la page avec mon bâton de sorcier, c’est de la magie simple ! J’imagine que le 3 me protège : il déborde les alternatives, aussi bien que les équilibres et déséquilibres trop prévisibles du balancier.
Dans la construction du livre, je ne l’avais pas prévu, c’est venu en l’écrivant, mais il faut croire que ça relève d’une structure intime : il faut trois points pour faire une forme, non ? Il y a donc d’abord la partie, assez statique, quoique rocambolesque, qui se passe dans le studio du narrateur, où il raconte sa rencontre avec Michael Cimino et ses visionnages obsessionnels : c’est la partie des FILMS ; puis une partie qui se passe entièrement de nuit, dans la brasserie Bofinger, où chaque personnage prend la parole : c’est la partie des HISTOIRES ; enfin une partie « action », plus mouvementée, rapide, sombre, tragique, et sans doute plus mystérieuse : la partie des NOMS.
Le 3 intervient aussi dans la structure symbolique sur laquelle j’ai construit le livre (et la difficulté a été de conduire simultanément tous ces affluents jusqu’au bout — jusqu’à la source —, de tenir l’intensité sans qu’on s’y perde). En effet, il y a trois niveaux dans la narration : le stade-Melville (le manuscrit du scénario) ; le stade-Cimino (la rencontre avec le cinéaste) ; le stade-Deichel (les aventures parisiennes). Ces trois étages coïncident à la fin lorsque le narrateur se met à écrire, et que Melville, Cimino et Deichel ne forment plus qu’une seule tête (le couronnement a lieu dans le lac — par le lac qui entoure la tête enfin délivrée de Jean Deichel).
Cette histoire de transmission est aussi une fable mystique : la littérature (Melville) en passe par le cinéma (Cimino) pour devenir enfin de la littérature (Deichel). D’ailleurs Michael Cimino est lui-même passé du cinéma à la littérature (et l’on voit bien que derrière le cinéma, lorsque l’écran tombe, il y a la parole).
Les triangles, je ne sais pas. Faire des triangles avec les noms, avec les angles des bancs et le tronc des arbres, c’est un peu psychotique, non ? J’avance ainsi de phrase en phrase, j’essaie d’y voir de mieux en mieux, et de petits miroirs tournent dans les rues pour moi. Je pourrais très bien dire que ces triangles, c’est Dieu qui me parle. Mais c’est pour rire, bien sûr.
Fabien Ribery, auteur, enseignant, agrégé de lettres modernes, journaliste free lance
L’entretien complet sur le remarquable blog de Fabien Ribery
Sur Herman Melville (Entretien avec Michel Crépu)
Les livres de Yannick Haenel suivent un lent processus de maturation et celui-ci en particulier. L’importance de Herman Melville pour Yannick Haenel remonte à ses 14 ans alors qu’il était élève au Prytanée militaire de La Flèche dans la Sarthe. Il faut lire un entretien avec Michel Crépu de 2010 pour en prendre la mesure, alors qu’il venait de publier Cercle, un entretien essentiel pour comprendre Yannick Haenel et les racines qui alimentent Tiens ferme ta couronne.
Michel Crépu : Je suis content de me trouver à cette table en compagnie de Yannick Haenel, qui a publié Cercle cet automne, et je suis heureux que nous « ouvrions le feu » pour approcher, explorer l’acte d’écriture. La présence de Yannick Haenel, à cet égard, constitue une magnifique ouverture de feu.
On dit souvent que l’on constitue son écriture « contre ». C’est certainement vrai, mais l’écriture est tout aussi bien un mouvement d’aspiration qui nous tire vers le haut, une aspiration par quelqu’un, par quelque chose, par un langage ou un événement de langage. On peut essayer de dater le début de ce mouvement. J’avais envie, Yannick, de te demander quel avait été, si l’on peut le définir ainsi, le premier ébranlement, le premier commencement de ta vie d’écrivain.
Yannick Haenel : Sans hésitation, c’est la lecture de Moby Dick. J’avais quatorze ans. C’est la première fois que je rencontrais quelque chose comme de la littérature. C’était très différent de ce que je lisais à l’époque : j’étais emporté par quelque chose de plus grand que l’aventure, je sentais que je participais à un désir immense, un désir qui bouleversait les coordonnées du monde. Il y avait du langage. Voilà, le soulèvement de la mer, dans Moby Dick, c’est ça, c’est le langage. Cela m’a mis dans un état d’éveil exacerbé – cela m’a soulevé.
Moby Dick est peut-être le livre que j’ai lu le plus de fois. Il y a aussi les Illuminations de Rimbaud, Les Chants de Maldoror de Lautréamont ; mais Moby Dick a eu de l’importance pour moi à chaque période de ma vie. Ce livre a scandé mon entrée dans le langage, et en gros à chaque fois que j’écris un livre, je relis Moby Dick. C’est à tel point que dans Cercle, Moby Dick fait carrément partie du roman : je l’ai intégré – je raconte l’histoire de quelqu’un qui, pour s’affranchir de sa propre vie, commence par lire Moby Dick : c’est une sorte d’épreuve du feu.
Ce n’est pas comme modèle que Moby Dickm’intéresse. Il est impossible d’écrire ainsi aujourd’hui, et je ne pense pas que cela soit souhaitable : du point de vue métaphysique, du point de vue de ce qu’il en est du mal, on n’en est plus là. En revanche, la terreur, le ravage, la dévastation : Moby Dick en donne à lire une approche, et permet d’entendre la venue de quelque chose comme le devenir nihiliste du XXe siècle. La blancheur mystique de la baleine suscite de l’amour chez le lecteur, mais aussi de la terreur : Melville dit que la baleine, c’est le « massacre ». Ce qui m’a intéressé dès le début, ce n’est pas le capitaine Achab : c’est Ismaël. Ismaël est le narrateur du livre. Il paraît, selon certains commentateurs, que ce personnage serait insignifiant : il ne lui arrive pas grand-chose. Je pense au contraire que la présence d’Ismaël est celle de la résurrection. La grande ligne spirituelle du livre, c’est Ismaël qui la tient, à travers sa manière de raconter. Peut-être même que le véritable sujet du livre est là : un narrateur qui, dès les premières lignes, se baptise (cela dépend des traductions : « Appelez-moi Ismaël » ou « Mettons que je m’appelle Ismaël ») – et pas de n’importe quel nom : il se baptise du nom du fils illégitime d’Abraham. Dans l’Ancien Testament, Ismaël est celui qui, chassé, rejeté, fait l’épreuve du désert. À la fin de Moby Dick, cet Ismaël qui, initié au mal, vit un nouveau baptême, en ce sens qu’il est le seul survivant : il est « celui qui est venu pour nous le dire », comme dit Job. Tout le monde est mort sauf Ismaël.
Dans ce livre, ce qui m’a frappé dès la première lecture – et peut-être que le choc initial de l’écriture, du désir d’écrire, est venu de là – n’est pas la rencontre avec la baleine, mais la rencontre entre Ismaël et l’étranger absolu, un prince des îles du Sud, un cannibale qui s’appelle Queequeg. Le corps de ce prince est entièrement tatoué – il est devenu écriture. Et Ismaël, qui n’a encore rien vu quand il rencontre ce fils de roi, qui est illégitime, va trouver, en racontant Moby Dick, sa propre légitimité. C’est ce qui me requiert dans l’écriture : le témoin, celui qui prend en charge la narration – celui qui se met à faire de la littérature –, trouve sa légitimité par le récit. En un sens, il entre dans un royaume. Pour moi, Moby Dick et tous les grands livres participent de ce royaume : un royaume sans domination, un royaume de non-pouvoir, le royaume à partir duquel, dans la parole, quelque chose peut avoir lieu qui réplique au mal, ou invite à la dimension mystique du langage.
Depuis toujours, Moby Dick est le livre qui blasonne mon rapport à l’écriture. Et Ismaël, au même titre qu’Ulysse, au même titre qu’Ulrich dans L’Homme sans qualités de Robert Musil, m’apparaît comme le porteur de phrases, comme le porteur de la parole, comme quelqu’un qui, en un sens, n’est rien, mais qui fait précisément de ce néant son entrée dans la littérature et qui, par la littérature, devient roi.
Et puis, il y a l’Odyssée, évidemment. J’en parle parce qu’au début du livre, à Ithaque, Homère relate un étrange protocole : Ulysse réunit ses amis, les habitants de l’île – ce qu’on pourrait appeler le gouvernement – et, pendant l’assemblée, chaque personne qui prend la parole prend en main le sceptre. Chaque personne qui parle pendant l’assemblée d’Ithaque devient roi d’Ithaque. Pour moi, entrer dans le langage, se mettre à écrire, c’est devenir roi. Évidemment, c’est une royauté qui demande à être définie, et que seule la littérature définit. Je pense que la prise de parole telle qu’elle est mise en abîme dans Moby Dick, et telle qu’elle est représentée dans l’assemblée d’Ithaque, a à voir avec ce que j’appelle aujourd’hui « la littérature ».
Michel Crépu : Je suis surpris que tu envisages Moby Dick sous le signe d’un avènement royal par la parole. Mais tu as évoqué au début le caractère de massacre peut-être un peu prémonitoire au regard de l’Histoire. Comme tu l’as dit, quoique l’événement littéraire que représente Moby Dick pour l’histoire de la littérature aujourd’hui reste essentiel, nous ne sommes plus dans le même contexte historique. Tu as parlé du nihilisme du siècle. Comment fais-tu le lien entre la dimension royale que tu as évoquée et la dimension du mal, du massacre, de la malédiction qui imprègne le livre de Melville ?
Yannick Haenel : C’est toute la question. Rilke écrit dans les Élégies à Duino : « La beauté est le commencement de la terreur que nous sommes capables de supporter. » Je crois que la littérature est ce qui prend en charge l’irreprésentable qui, à chaque époque, anime le « massacre », comme dit Melville. En même temps, si la littérature ne propose pas une forme de liberté par rapport à cet emprisonnement, si elle ne propose pas une sortie hors de l’emprise du massacre, alors, à mon sens, elle n’est pas littérature. Là réside la difficulté. Je pense que chaque personne qui se mêle d’écrire de la littérature est confrontée à ce problème. Bien sûr, on peut très bien se contenter de raconter des anecdotes plus ou moins bien ciselées ; beaucoup s’en satisfont. Mais si l’on essaie de se confronter à la dimension absolue de la littérature, alors le langage met en jeu nécessairement ces deux faces : massacre et liberté.
Entrer dans le langage, c’est entrer dans une dimension où l’on est complètement exproprié. Je pense qu’aujourd’hui, l’un des critères indiscutables du nihilisme, c’est cela : l’expropriation de chaque corps en dehors de la parole. La langue est déchiquetée depuis belle lurette par les puissances de communication, elle est devenue le lieu même de la dévastation. Se contenter de décrire cette dévastation, c’est participer à la surenchère nihiliste. Cette surenchère est précisément l’un des phénomènes littéraires les plus marquants de ces trente dernières années. Dans la publicité culturelle en France, ce qui sature le champ depuis trente ans, c’est la surenchère nihiliste, le surcroît de dévastation : on répond à la dévastation par la dévastation – on en jouit, fasciné.
Michel Crépu : Tu parles de dévastation… Peut-on considérer le mot « misère » comme un synonyme ?
Yannick Haenel : Oui. La littérature commence peut-être à ce moment mystérieux où s’ouvre, au cœur du langage, dans l’épreuve même de la dévastation, quelque chose comme de l’« indemne » ou du « sauf » – un bond hors de l’emprise. Je pense que la littérature parle forcément de ces deux polarités qui agissent l’une sur l’autre : la dévastation et le bond. Un bond qui, dans mon cas, passe par une érotisation du monde, par une érotisation du langage.
Dans Cercle, chaque scène agit comme une possibilité d’extension du domaine de l’érotisme. Il s’agit d’étendre au monde la zone érogène qui s’est allumée le temps d’une étreinte. C’est par cet élargissement-là que les narrateurs de mes romans se délivrent de la dévastation dont ils font l’expérience. Ce n’est pas seulement un érotisme lié au domaine de l’anatomie, mais un érotisme qui ouvrirait, dans chaque phrase, ce qu’il en est du corps à corps.
Michel Crépu : Avant Cercle, un premier livre paraît en 1996 : Les Petits Soldats.
Yannick Haenel : C’est un roman d’apprentissage très codé, lié à une forme traditionnelle de la langue. À 15 ans, tout jeune adolescent, j’ai été envoyé dans un pensionnat militaire où, pris au piège, j’ai vécu la langue de manière très négative, sous la forme du commandement. Pendant trois ans, j’ai vécu sous ce régime de la langue : celui des ordres, du règlement, de la punition. Comment répliquer à ça ? Je ne savais pas. Vers 15 ans – mais c’étaient des balbutiements épiphaniques – je sentais bien que seule l’extase pouvait me libérer de l’arraisonnement (en l’occurrence, de l’arraisonnement d’une langue). À l’époque, je n’avais pas les moyens de ces extases. C’est le problème qui se pose face à la littérature : avoir les moyens de sa propre langue. Quand j’ai écrit Les Petits Soldats, c’était pour rendre compte de mon expérience de combat avec la langue de la violence. J’avais alors en tête quelque chose de prodigieux, qu’il m’était absolument impossible de mettre en forme.
Michel Crépu : Moby Dick, c’était en même temps ?
Yannick Haenel : C’était en même temps, oui. Quand je suis entré au Prytanée militaire, j’ai lu Moby Dick et Lautréamont. Cela m’a pulvérisé la tête, et m’a donné une grande force de solitude : j’ai pu passer, dans cet internat des années quatre-vingt, d’une solitude comme punition à une solitude comme couronne.
[déjà la couronne que l’on retrouve dans le titre de son dernier ouvrage]
Michel Crépu : Comme élection.
Yannick Haenel : Voilà. Il y a une petite phrase dans les Carnets de Proust qui dit : « Tiens ferme ta couronne. » C’est la voie royale qui continue… J’aime bien mettre cette phrase en relation avec celle de Lacan : « Il ne faut pas céder sur son désir. »
Michel Crépu : C’est la même chose ?
Yannick Haenel : Tenir ferme sa couronne consiste à se détourner de ce qui prétend nous dépouiller de notre désir. Quand j’ai voulu publier – ce qui n’est pas tout à fait la même chose qu’écrire –, je savais que je n’étais pas prêt. Mais il fallait absolument, dans mon cheminement nerveux, que je publie quelque chose. J’ai donc choisi de décrire ce qui m’était arrivé au pensionnat, et ce de manière assez classique, en me masquant. Avec ce petit roman initiatique, je m’avançais masqué.
Mais pour moi, les choses sérieuses ont commencé bien après. Pour être à la hauteur de ce que j’avais pu entr’apercevoir dans Moby Dick– je ne dis pas pour être à la hauteur de ce livre mais à la hauteur de ce qu’ouvre ce livre –, il me fallait beaucoup de temps – il me fallait des « stocks d’études », comme dit Rimbaud, de longues « provisions de relance » comme dit Ponge. Autrement dit, il fallait que je m’achemine vers la pensée. Que je lise – et que je lise la philosophie. Je n’avais absolument pas étudié la philosophie, mais c’est venu comme une nécessité. Et cela s’est réalisé à travers une revue, quand j’ai rencontré François Meyronnis et Frédéric Badré, et que nous avons fondé à trois la revue Ligne de risque.
Michel Crépu : En quelle année était-ce ?
Yannick Haenel : En 1997.
Michel Crépu : Très peu de temps après la parution des Petits Soldats.
Yannick Haenel : Oui. La revue Ligne de risque est devenue, au fil des ans, un espace de pensée très étrange. « Ligne de risque », au fond, est le nom des conversations que j’ai avec François Meyronnis : ce n’est pas seulement une revue, mais le lieu où chacun d’entre nous s’est mis à naître, à se préparer à entrer dans la littérature. Ligne de risque nous a permis (à moi et, je pense, à François Meyronnis aussi)d’étudier– de nous donner une réserve, nécessaire me semble-t-il, pour écrire des livres.
Michel Crépu : L’outil « revue » s’est avéré être à ce moment-là l’outil approprié, mais cela ne va pas de soi.
Yannick Haenel : Dans mon cas, c’était nécessaire. Cela m’a apporté un surcroît d’énergie. Si j’avais continué ce parcours seul, je n’aurais peut-être pas trouvé « le lieu et la formule », pour parler comme Rimbaud. L’expérience Ligne de risque a vraiment fait naître ce que nous voulions écrire. Je pense que la plupart des livres qui se publient ne sont pas nés. Il y a quelque chose dans la naissance – qui peut avoir lieu n’importe quand – qui a à voir avec cette couronne dont je parlais tout à l’heure…
Il m’est apparu que, pour écrire des livres à la fin duxxeet au début duxxiesiècle, il fallait fonder une revue. Mon projet était le contraire, par exemple, de La Nouvelle Revue française : ce n’était pas une revue faite pour colliger des textes ; il s’agissait d’un coup de force dans le champ de la littérature. Écrire de la littérature va de pair avec une proposition de liberté. Je le dis avec modestie : si l’on n’écrit pas avec l’idée qu’on va tout reprendre, alors ce n’est pas la peine d’écrire. Si l’on n’a pas d’ambition artistique, on n’est pas un artiste. J’en parlais tout à l’heure concernant Moby Dick : s’il y a un domaine où c’est tout ou rien, c’est bien celui de la littérature.Ligne de risquea cristallisé mon désir d’absolu.
Michel Crépu : Encore un mot sur l’irruption nécessaire de la philosophie : quels interlocuteurs ? quels textes ? quel chemin ?
Yannick Haenel : Il y a deux choses. D’abord, ce « cône d’ombre », comme dit Rilke, entre Nietzsche et Heidegger : un travail d’autant plus difficile pour moi qu’il a lieu dans la dimension philosophique, qui ne m’est pas propre et dans laquelle je ne veux pasintervenir, puisque c’est la littérature mon élément. Mais ce « cône d’ombre » éclaire ce qui a lieu auxxesiècle et qui continuera auxxie, ce que Nietzsche et Heidegger ont appelé – et qu’on appelle aujourd’hui communément – « nihilisme ». Ce mot ne va pas de soi. L’une des vocations de la revueLigne de risque, au départ, était de travailler sur cette question-là.
D’autre part, je pense que toute confrontation avec le langage, toute approche de la parole, trouve nécessairement une sorte d’écho spirituel. Je pense aujourd’hui que la parole et le sacré sont une même chose. Donc, le deuxième aspect des recherches qui ont lieu sous le nom deLigne de risqueest à trouver du côté d’un questionnement, que François Meyronnis et moi poursuivons inlassablement, de toutes les traditions. On s’intéresse à Tchouang-Tseu, à Li-Tseu, à Lao-Tseu : au taoïsme, donc – mais aussi à l’orphisme avec Marcel Detienne [1] ou à la pensée védique, avec Charles Malamoud [2]. Avec l’idée que, là où nous en sommes du « massacre », là où nous en sommes de la mutation du mal, « étudier ces traditions permet de penser le néant, et toutes les formes de nihil ». Évidemment, il ne s’agit pas de faire du syncrétisme, ou je ne sais quel amalgame : il y a un vide entre chaque conception du sacré, et c’est ce vide qu’il faut maintenir. Mais je pense qu’un écrivain qui essaye aujourd’hui de formuler ce qui a lieu avec le langage trouve des ressources à s’abreuver ainsi. Il y a très peu de temps encore – il y a une cinquantaine d’années –, on a découvert des écrits gnostiques ; et ce qu’il en est des écrits gnostiques sur lesquels nous travaillons aujourd’hui à Ligne de risque éclaire ce que je disais tout à l’heure de Moby Dick, éclaire ce qu’il en est de l’histoire du nihilisme, éclaire ce qu’il en est du destin mondial et du charnier du XXe siècle et éclaire, dans la puissance de la parole elle-même, ce qu’il en est de la possibilité d’illumination. Ligne de risque travaille sur un objet mouvant presque mystique. Il est très dangereux de travailler sur ces questions-là, parce qu’elles sont explosives, parce qu’on peut déraper. Mais je pense que c’est précisément là que l’essentiel se joue.
Michel Crépu : Ce qui revient à introduire un troisième terme dans la conversation : littérature, philosophie, et donc un troisième pôle, qui ne se confond ni avec la littérature ni avec la philosophie, qui renvoie à une série de traditions spirituelles aussi bien occidentales qu’orientales, que tu désignes sous le terme de « sacré » et qui est aussi partie prenante de ce travail.
Yannick Haenel : Ce qui m’intéresse, ce que j’essaie de mettre en scène dans mes fictions, c’est le saut dans le vide. Qu’est-ce qu’un saut ? Qu’est-ce que le vide ? À partir du moment où l’écriture se met à penser au-delà de l’anecdote, des traditions entières s’ouvrent à vous : sous le nom de « saut », sous le nom de « vide », elles vous parlent de spiritualité. Ce qu’il en est de l’expérience du néant peut se dire dans toutes les langues. Pour éviter cet angle mort qui menace à chaque instant ce qu’on écrit, l’idéal serait de faire parler la parole dans toutes les langues ; et réaliser ce qu’a fait Joyce – à mon avis, c’est un cas unique – avec Finnegans Wake, c’est-à-dire inventer une langue dans laquelle toutes les langues s’écoutent les unes les autres à travers une sorte de Pentecôte verbale. Bien sûr, Finnegans Wake, c’est l’Himalaya : il faudrait être un dieu pour se rendre capable, après Joyce, d’un tel exploit. Mais, dans des proportions plus humaines, je pense qu’il est possible d’écrire aujourd’hui des fictions qui soient en elles des sauts dans le vide ; je pense qu’il est possible d’habiter une parole qui arrache le néant au mal, et donne à entendre ce qui, précisément, dans le néant, vous délivre.
[…]
Sur le narrateur
Public : Vous sentez-vous proche ou éloigné du narrateur de Cercle aujourd’hui, six mois après la rédaction de l’ouvrage ?
[La question et la réponse relative à Cercle pourrait être la même pour Tiens bon ta couronne]
Yannick Haenel : Je pense avoir manifesté ce soir que je coïncidais avec ce livre. Comme j’ai tenté de l’expliquer tout à l’heure, Cercle est la synthèse de multiples expériences qui se sont tramées pour moi ces dernières années, et c’est aussi le fruit d’une réflexion sur la littérature initiée avec la revue Ligne de risque.
Avez-vous un rituel d’écriture ?
[Question du public]
Yannick Haenel : Pas vraiment. D’ailleurs, pendant longtemps, je n’avais pas de table pour écrire… Je n’écris pas à heure fixe, mes journées sont un peu désordonnées. J’ai toujours écrit n’importe où, dans les cafés, en marchant (comme le montre le film), ou même sur mes genoux dans le métro. J’écris bien en circulant, il est possible que mon corps ait besoin de ça. Et puis, vous l’avez vu, j’écris à la main, sur des petits cahiers Clairefontaine, sur des bouts de papier, des enveloppes. Pendant les cinq années où j’ai écrit Cercle, je me promenais, j’allais un peu partout en Europe, j’écrivais les choses comme elles me venaient. Alors après, mettre tout cela en récit est vraiment un gros problème. Mais c’est lié à ma conception – que je n’ai pas choisie – du récit : je n’arrive pas à écrire une histoire de A à Z. Je ne suis pas un conteur. Je serais incapable de dérouler une histoire. Ce que j’écris, ce sont des mosaïques : il y a des épiphanies, elles s’ajustent entre elles, et font naître quelque chose comme du récit… Il y a toujours du récit, finalement, même dans les épiphanies d’ordre poétique.
Écrivain et rédacteur en chef de La Revue des Deux Mondes
© Éditions de la Bibliothèque publique d’information, 2010
Sur le rôle de l’écrivain
Extrait du premier chapitre ; Le daim
Sous le titre « Tiens ferme ta couronne »
Déjà une pré-version :

« Au fond, un écrivain – un véritable écrivain – est quelqu’un qui voue sa vie à l’impossible. Quelqu’un qui fait une expérience fondamentale avec la parole (qui trouve dans la parole un passage pour l’impossible). Quelqu’un à qui il arrive quelque chose qui n’a lieu que sur le plan de l’impossible. Et ce n’est pas parce que cette chose est impossible qu’elle ne lui arrive pas : au contraire, l’impossible lui arrive parce que sa solitude (c’est-à-dire son expérience avec la parole) est telle que ce genre de chose inconcevable peut avoir lieu, et qu’elle a lieu à travers les phrases, à travers les livres qu’il écrit, phrases et livres qui, même s’ils ont l’air de parler d’autre chose, ne parlent secrètement que de ça. […] Quelqu’un dont la solitude manifeste un rapport avec la vérité et qui s’y voue à chaque instant, même si cet instant relève de la légère tribulation, même si cette vérité lui échappe et lui paraît obscure, voire démente ; un écrivain est quelqu’un qui, même s’il existe à peine aux yeux du monde, sait entendre au cœur de celui-ci la beauté en même temps que le crime, et qui porte en lui, avec humour ou désolation, à travers les pensées les plus révolutionnaires ou les plus dépressives, un certain destin de l’être. (…) Qu’y-a-t-il de plus important que d’engager sa vie dans l’être et de veiller à chaque instant de sa vie un dialogue avec cette dimension ? Car alors, nous n’avons plus seulement une vie, mais une existence : nous existons enfin. […] Quelqu’un qui fait coïncider son expérience de la parole avec une expérience de l’être ; et qu’au fond, grâce à une disponibilité permanente à la parole – à ce qui vient quand il écrit –, il ouvre son existence toute entière, qu’il le veuille ou non, à une telle expérience. Que celle-ci soit illuminée par Dieu ou au contraire par la mort de Dieu, qu’elle soit habitée ou désertée, qu’elle consiste à se laisser absorber par le tronc d’un arbre ou par des sillons dans la neige, à s’ouvrir au cœur démesuré d’une femme étrange ou à déchiffrer des signes sur les murs, elle porte en elle quelque chose d’illimité qui la destine à être elle-même un monde, et donc à modifier l’histoire du monde. »
:
Yannick Haenel (L’infini n° 133)
Au fond, un écrivain — un véritable écrivain (Melville, et aussi Kafka, me disais-je, ou Lowry ou Joyce : oui, Melville, Kafka, Lowry, Joyce, très exactement ces quatre-là, et je répétais leur nom à mes amis et aux producteurs que je rencontrais) — est quelqu’un qui voue sa vie à l’impossible. Quelqu’un qui fait une expérience fondamentale avec la parole (qui trouve dans la parole un passage pour l’impossible). Quelqu’un à qui il arrive quelque chose qui n’a lieu que sur le plan de l’impossible. Et ce n’est pas parce que cette chose est impossible qu’elle ne lui arrive pas : au contraire, l’impossible lui arrive parce que sa solitude (c’est-à-dire son expérience avec la parole) est telle que ce genre de chose inconcevable peut avoir lieu, et qu’elle a lieu à travers les phrases, à travers les livres qu’il écrit, phrases et livres qui, même s’ils ont l’air de parler d’autre chose, ne parlent secrètement que de ça.
Un écrivain, me disais-je, disais-je à mes amis, ainsi qu’aux rares producteurs avec qui je réussissais à obtenir un rendez-vous pour parler deThe Great Melville, un écrivain (Melville, et aussi Kafka ou Hölderlin, Walser ou Beckett —car je variais ma liste) est quelqu’un dont la solitude manifeste un rapport avec la vérité et qui s’y voue à chaque instant, même si cet instant relève de la légère tribulation, même si cette vérité lui échappe et lui paraît obscure, voire démente ; un écrivain est quelqu’un qui, même s’il existe à peine aux yeux du monde, sait entendre au cœur de celui-ci la beauté en même temps que le crime, et qui porte en lui, avec humour ou désolation, à travers les pensées les plus révolutionnaires ou les plus dépressives, un certain destin de l’être.
Je dois dire que lorsque je prononçais les mots « destin de l’être », même mes amis les plus bienveillants semblaient découragés. Sans doute y voyaient-ils une présomption délirante, mais qu’y a-t-il de plus simple (et de plus compliqué, bien sûr) que l’être ? Qu’y a-t-il de plus important que d’engager sa vie dans l’être et de veiller à ce que chaque instant de sa vie dialogue avec cette dimension ? Car alors, nous n’avons plus seulement une vie, mais une existence : nous existons enfin.
Je me disais qu’un écrivain, du moins Melville ou Hamsun ou Proust ou Dostoïevski (je fais beaucoup d’efforts pour varier ma liste), est quelqu’un qui fait coïncider son expérience de la parole avec une expérience de l’être ; et qu’au fond, grâce à sa disponibilité permanente à la parole — à ce qui vient quand il écrit —, il ouvre son existence tout entière, qu’il le veuille ou non, à une telle expérience.
Que celle-ci soit illuminée par Dieu ou au contraire par la mort de Dieu, qu’elle soit habitée ou désertée, qu’elle consiste à se laisser absorber par le tronc d’un arbre ou par des sillons dans la neige, à s’ouvrir au cœur démesuré d’une femme étrange ou à déchiffrer des signes sur les murs, elle porte en elle quelque chose d’illimité qui la destine à être elle-même un monde, et donc à modifier l’histoire du monde.
Je me perdais un peu dans ma démonstration, mais je ne perdais pas de vue une chose, la plus importante pour moi : à travers Melville, s’écrivait quelque chose du destin de l’être. La preuve, c’est que sa tête était mystiquement alvéolée.
Je me souviens d’une amie qui prétendait que l’absolu n’est qu’une illusion, une manière de se « monter le bourrichon », comme dit Flaubert (elle citait Flaubert). Selon elle, Melville, avant d’être éventuellement le saint que j’imaginais, était surtout tout un type normal, avec sa routine, ses fatigues et ses emportements : un type adossé à un mur, qui ne faisait que spéculer sur l’existence d’un trou dans ce mur. Elle avait raison, mais moi, cette spéculation, ce trou dans le mur, même infime, ça me suffisait. Il me suffisait de penser qu’il y a un trou dans le mur pour que le mur ne m’intéresse plus et que toutes mes pensées se destinent autrou. Celui ou celle qui un jour a vu un trou dans le mur, ou qui l’a simplement imaginé, est voué à vivre avec cette idée du trou dans le mur, et il est impossible de vivre avec cette idée du trou dans le mur sans lui consacrer entièrement sa vie, voilà ce que je disais à cette amie, ce que je répétais à la plupart de mes amis, et aux producteurs qui faisaient mine de s’intéresser à ce scénario que j’avais appeléThe Great Melville.
Alors voilà : un jour, j’avais entendu une phrase de Melville qui disait qu’en ce monde de mensonges, la vérité était forcée de fuir dans les bois comme un daim blanc effarouché, et j’avais pensé à ce film de Michael Cimino qu’on appelle en FranceVoyage au bout de l’enfer, mais dont le titre original estThe Deer Hunter, c’est-à-dire le chasseur de daim.
Dans ce film qui porte sur la guerre du Vietnam, où de longues scènes de roulette russe jouées par Christopher Walken donnent à cette guerre absurde la dimension d’un suicide collectif, le chasseur, joué par Robert De Niro, poursuit un daim à travers les forêts du nord de l’Amérique ; lorsque enfin il le rattrape, lorsque celui-ci est dans son viseur, il s’abstient de tirer.
Comme dans certaines légendes, comme dans l’histoire de saint Julien l’Hospitalier où le grand cerf désarme le sacrificateur, le daim épargné par De Niro dans le film de Cimino est le survivant d’un monde régi par le crime, il témoigne d’une vérité cachée dans les bois, de quelque chose qui déborde la criminalité du monde et qui, en un sens, lui tient tête : l’innocence qui échappe à une Amérique absorbée dans son suicide guerrier. Car le daim, en échappant au sacrifice, révèle avant tout ce qui le menace, c’est-à-dire le monde devenu entièrement la proie d’un sacrifice.
Cet après-midi-là, je me suis dit : ce daim, c’est Melville — c’est Melville-Kafka-Lowry-Joyce ou Melville-Hölderlin-Walser-Beckett ou encore Melville-Hamsun-Proust-Dostoïevski —, c’est le destin de la littérature, son incarnation mystique, peut-être même sa tête alvéolée
Sur la littérature et le cinéma
Romancier, essayiste, critique, cofondateur de la revue Ligne de Risque, Yannick Haenel est aussi depuis peu cinéaste. Un domaine où Sollers a toujours refusé de s’aventurer considérant que l’écriture littéraire et l’écriture cinématographique d’un scénario sont des univers différents, pour ne pas dire parallèles - comme on dit de lignes parallèles qu’elles ne se rejoignent qu’à l’infini… Même si nombre d’œuvres littéraires ont été adaptées au cinéma et que des écrivains se sont faits cinéastes : Alain Robe Grillet (il excècre), Marguerite Duras, et bien d’autres avec aujourd’hui Yannick Haenel. Et son nouveau livre est une ode au cinéma ! Un roman sollersien où le « disciple » s’affranchit du maître.
Dans le livre, Haenel, se fait d’ailleurs, indirectement, l’avocat du diable des thèses sollersiennes. Clin d’œil ? Lisons :
« Selon eux [ses amis], il aurait été plus judicieux que j’écrive un livre sur Melville, par exemple une biographie, mais pas un scénario : le scénario, c’est la mort de l’écrivain, me disaient-ils ; le moment où les écrivains se mettent à rêver de cinéma est précisément celui qui marque leur mort en tant qu’écrivains ; le signe de la ruine, pour un écrivain, ruine financière, et surtout ruine morale, ruine psychique, ruine mentale, c’est lorsqu’il se met en tête d’écrire un scénario.
Mais moi, le scénario, je l’avais déjà écrit : je n’avais plus rien à craindre. Quelle ruine pouvais-je redouter ? J’avais écrit des romans, j’en écrirais encore — j’avais mille idées de roman en tête, mais d’abord je voulais vivre l’aventure de ce scénario jusqu’au bout, je tenais à The Great Melville, je tenais à parler de la solitude de l’écrivain et du caractère mystique de cette solitude, je voulais faire entendre ce qu’il y a à l’intérieur d’une tête mystiquement alvéolée.
Car les gens, et même mes amis, voient les écrivains comme de simples raconteurs, éventuellement comme de bons raconteurs qui ont éventuellement des idées singulières, voire passionnantes, sur la vie et la mort. Sauf qu’un type dont l’intérieur de la tête est mystiquement alvéolé, en général ils trouvent ça exagéré. »
La reine de Némi, réalisation Yannick Haenel
Comme Philippe Sollers, Yannick Haenel aime les déesses et la fin du roman se passe aux abords du lac de Nemi en Italie, lieu de l’ancien sanctuaire de Diane, déesse de la chasse représentée avec une biche. Il aime tant les déesses que le livre juste terminé reprendra le thème de la déesse Diane pour en faire un film « La reine de Némi ».
Voici, à ce propos, un extrait d’entretien entre Yannick Haenel et Franck Ribery dont vous pouvez retrouver l’intégralité sur son excellent blog ICI :
Vous venez de réaliser un film au lac de Némi près de Rome. Quelle en est l’ambition ?
Ce film s’appelle La Reine de Némi, il dure trente minutes. C’est une fiction, avec une partie documentaire, qui tourne autour d’un mythe, celui du roi du Bois, dont on en trouve trace dans la somme ethnographique de James Frazer, Le Rameau d’or. Frazer raconte que bien avant la fondation de Rome, il y avait dans les bois de Némi, autour de ce lac situé dans les monts Albains, une étrange royauté sacrée autour de la déesse Diane.
Ce mythe a passionné Georges Bataille, qui n’a cessé, toute sa vie, d’y revenir : « Je suis le roi du bois, le Zeus, le criminel ! », écrit-il par exemple dans Le Coupable. Il se pourrait même que derrière la société secrète d’Acéphale, au cœur de la forêt de Marly, il y ait Némi.
Némi est un lieu qui n’a jamais été filmé, sauf en noir et blanc par les actualités mussoliniennes, à des fins de propagande (Mussolini désirait récupérer comme trophée de souveraineté les vestiges des deux navires de Caligula coulés au fond du lac).
J’ai voulu délivrer Némi de cette récupération fasciste, et rouvrir le bois sacré à sa dimension fondamentalement hors-la-loi. Au cœur de cette histoire, il y a un en effet couple : le roi-bandit et la déesse. Le réfugié-hors la loi et la Diane du Bois. J’ai voulu interroger leur lien, c’est-à-dire mettre à jour ce qu’il y a de sacré — de très ancien, de ténébreux même — dans ce qui lie les amants. Pour parler comme Aby Warburg, il y a dans toute histoire d’amour une « survivance » des amours mythologiques. Faire revenir des gestes de la déesse antique sous ceux d’une femme contemporaine, c’est une idée de cinéma.
L’enjeu, c’était aussi de conjurer cette vieille histoire d’amour fatal : Actéon surprenant la nudité de Diane au bain devrait, selon Ovide, en mourir. C’est injuste. J’ai voulu sauver Actéon. Comment voir la déesse nue sans en mourir, c’est l’une des ambitions du film.
Que découvrez-vous à l’occasion de cette première expérience de réalisation ?
J’ai écrit, conçu et réalisé ce film juste après avoir terminé l’écriture de Tiens ferme ta couronne, roman qui, entre autre, dans la tramage multiple qu’il met en scène, parle du lac de Némi et de la déesse Diane, qui sont déjà des obsessions du narrateur. Je me suis donc amusé à imaginer un supplément cinématographique à ce roman. C’est un film d’écrivain, très écrit, presque entièrement en voix off (tous les personnages parlent, mais toujours en voix off), qui parle de la manière dont on passe des livres à la vie.
Ce que j’ai découvert ? D’abord, un grand plaisir à faire s’animer des obsessions — à les élargir. À composer un cadre, une séquence, à imaginer les lieux, à les trouver, à mettre en place une continuité, des ruptures, des échos.
Ensuite, l’émotion d’enregistrer un moment du vivant : les corps, les visages, les voix, les rivages, les arbres. Tout cela est désormais stocké.
J’ai découvert à ce propos que ma femme, Barbara, qui est déjà l’héroïne du livre Je cherche l’Italie, est une actrice : je lui ai fait endosser le rôle de Diane, tandis que je « joue » Actéon. Ou plutôt nous jouons nos propres rôles en tant que nous nous prenons pour ces deux personnages.
L’idée est un peu klossowskienne, du moins au départ : c’est un home-movie mythologique. Puis la déesse emmène l’écrivain en Italie, à Némi, où elle lui ouvre les portes du sanctuaire de Diane. S’en suivent une série de rites, de nature érotiques, portant sur la nudité.
Crédit : Le blog de Fabien Ribery
Dans l’atelier de Yannick Haenel : l’étonnant making of du livre

Cette année, Yannick Haenel donne des ateliers d’écriture à l’école Les Mots. C’est donc aussi en professeur d’écriture qu’il va nous faire entrer dans le making of de son roman. Pourquoi écrit-il dans les cafés, à la main, remplissant des centaines de pages de cahier ? Comment le visionnage d’Apocalypse Now et de Voyage au bout de l’enfer a-t-il nourri son écriture ? Pourquoi a-t-il prêté un monologue halluciné à Isabelle Huppert ? Où a-t-il trouvé son titre fascinant ? Et pourquoi le roman raconte-t-il un vieux mythe attaché au sanctuaire de Diane ? Réponses à ces questions, et bien d’autres, le 11 septembre. Une date mythologique.
Une rencontre animée par Alexandre Lacroix.
La rencontre aura lieu à La Maison de la Poésie, Passage Molière, 157 rue Saint-Martin, 75003 Paris
Crédit : https://lesmots.co/
Feuilleter le livre

 9/11/2017 : Prix Médicis
9/11/2017 : Prix Médicis
Sur le site Gallimard :


Publié dans la Collection L’Infini de Gallimard - la collection dirigée par Philippe Sollers - lui qui soutient l’aventure littéraire Haenel debuit ses débuts doit aussi apprécier.

Paris Match| Publié le 09/11/2017
La Rédaction, avec AFP
Finaliste malheureux du Goncourt et du Grand prix du roman de l’Académie française, Yannick Haenel a été récompensé du prix Médicis pour "Tiens ferme ta couronne".
Le Médicis, un des derniers prix littéraires de la saison, a célébré jeudi les noces entre la littérature et le cinéma en donnant son prix à Yannick Haenel,

"J’ai deux passions dans la vie : le cinéma, notamment le cinéma américain et la littérature. J’ai essayé avec ce livre d’assouvir ma cinéphilie avec des phrases", a réagi le romancier, âgé de 50 ans. "Tiens ferme ta couronne" (Gallimard) est un roman inclassable où l’on croise le cinéaste américain Michael Cimino (disparu en 2016), la déesse Diane, un dalmatien nommé Sabbat et un maître d’hôtel irascible sosie d’Emmanuel Macron.

Le jury du Médicis, très affecté par la disparition cette année de deux de ses membres, la romancière et scénariste Emmanuèle Bernheim et la romancière et comédienne Anne Wiazemsky, semble avoir voulu rendre hommage à ces deux femmes, liées à la littérature et au cinéma, en choisissant comme lauréat le cinéphile Yannick Haenel.

Le romancier, par ailleurs chroniqueur pour le magazine de littérature et de cinéma Transfuge et à Charlie Hebdo, a tenu à saluer la mémoire d’Anne Wiazemsky. "Comme mon livre porte sur les noces entre le cinéma et la littérature, si quelqu’un l’a incarné merveilleusement c’est elle. Baisers à Anne Wiazemsky", a-t-il dit.

Il a été choisi au 4e tour par 5 voix contre une à François-Henri Désérable ("Un certain M. Piekielny", Gallimard).

Crédit : Paris Match 9/11/2017
VOIR AUSSI
Jan Karski Gallimard L’Infini, 2009, Prix du roman Fnac 2009, Prix Interallié 2009
Poker, entretiens avec Philippe Sollers, Gallimard L’Infini, 2005.
Une série d’entretiens conduits avec son comparse François Meyronnis de la revue Ligne de risque. Tous deux sont des exégètes de Sollers ! Philippe Sollers et Yannick Haenel ont animé des conférences ensemble.
Comme Sollers, Haenel a une haute idée du rôle de l’écrivain et des points de convergence avec son aîné dans sa façon d’aborder la littérature et la vivre à travers ses écrits. Disciple ? Ni l’un ni l’autre, sans doute, n’utiliserait ce mot, mais sûrement une forme de respect mutuel pour ce que l’autre fait.
[1] Marcel Detienne (né en 1935 en Belgique) est un helléniste et un auteur belge, essayiste, anthropologue comparatiste, spécialiste notamment de la parole et de l’autochtonie dans la Grèce ancienne.
[2] Linguiste de formation, ce spécialiste de l’Inde est aujourd’hui Directeur d’Études honoraire des religions de l’Inde à l’École Pratique des Hautes Études (EPHE).




 Version imprimable
Version imprimable
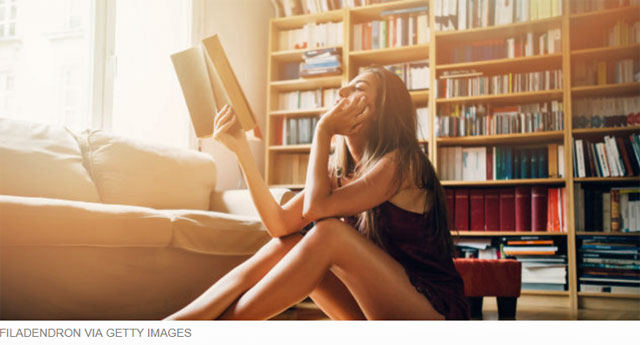



 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?



15 Messages
Grand admirateur de "Moby Dick", le chef d’oeuvre d’Hermann Melville, depuis l’enfance, l’écrivain et essayiste Yannick Haenel explique au micro de Marie Sorbier sur France Culture comment et pourquoi cette oeuvre continue de fasciner des artistes de toutes disciplines et générations.
La Cinémathèque Française propose, ce samedi 10/02, une projection de "La Porte du paradis" de Michael Cimino suivie d’une discussion avec l’écrivain L’auteur connaît bien son sujet puisqu’il est au cœur de son dernier roman "Tiens ferme ta couronne" (Prix Médicis 2017).
Plus ICI : www.lesinrocks.com/
[Le livre de la semaine] Tiens ferme ta couronne, de Yannick Haenel
Fabrice Delmeire,, Journaliste
Le Vif Focus du 24/11/17
ROMAN | Yannick Haenel déchiffre les arcanes de la solitude, offrant au lecteur abasourdi des tourbillons de prophétie à décrocher les étoiles. Prix Médicis.
"Croirez-vous sérieusement qu’on puisse attendre la rédemption, un peu pété, tout seul, le soir de ses cinquante ans, entre un aquarium à crustacés et un sosie d’Emmanuel Macron ? Ces choses-là relèvent du mystère." Jean a écrit un énorme scénario sur la vie de Herman Melville, The Great Melville, dont aucun producteur ne veut. Plongé dans une solitude aberrante, il fait tourner sa vie autour de la sainte trinité -ordinateur, frigo, vodka-, ressassant des films jusqu’à l’obsession : Apocalypse Now de Coppola et The Deer Hunter (Voyage au bout de l’enfer) du grand Cimino, auxquels il porte un dévouement sacré. "Oui, j’étais assez fou pour croire qu’un secret circule à travers des films ; assez fou pour imaginer qu’il soit possible d’y accéder, et même d’en recevoir des lumières. (...) impossible, certains soirs, de savoir si je ne me montais pas complètement le bourrichon." Il est alors frappé par une épiphanie : il lui faut impérativement faire lire The Great Melville à Michael Cimino, réalisateur mythique de La Porte du paradis. La rencontre a lieu à New York et accoste sur Ellis Island, entrée principale des immigrants au début du XXe siècle. Embrasé par le feu qui consume le réalisateur américain, notre héros revient transformé à Paris ; où s’enchaînent les aventures rocambolesques en compagnie d’Isabelle Huppert, d’un dalmatien, de la déesse Diane et de deux moustachus louches. "Aujourd’hui, c’était mon anniversaire, et à cinquante ans je m’offrais ce cadeau : vivre dans un roman d’aventures."
Love will tear us apart
Vous êtes de ceux qui voudraient participer à l’ivresse du ciel et la pesanteur vous écrase ? Le livre s’ouvre sur un coup de force : une phrase, merveilleuse invitation au voyage, qui se déploie sur toute la page. La comédie de notre vie cache une histoire sacrée, ce roman part à sa recherche. Quelle vérité scintille entre cinéma et littérature ? Tel le capitaine Achab lancé sur les traces de la baleine blanche dans Moby Dick, Yannick Haenel (Cercle, Jan Karski) allume un brasier, une mutinerie aux dimensions du monde. Et avec quelle maestria ! Pour faire entendre la solitude d’un écrivain, ce mystique à la recherche d’un trésor, l’auteur fait feu de tous bois et nous entraîne dans la population de ses pensées."(...) j’étais possédé : les noms, les livres, les phrases, les films n’arrêtaient pas de vivre à l’intérieur de ma tête, ils se donnaient rendez-vous entre eux pour former des extases (...)" Avec un humour salvateur, Haenel conte les péripéties d’un héros saugrenu qui, doutant de tout, croyait en son étoile. En découle des tourbillons de prophéties, un déluge de révélations, la volupté des gouttes. Plus loin dans la forêt de signes, c’est toute l’histoire du monde qui s’affole -les attentats de Paris, les campements de réfugiés. Frôlant l’abîme, Haenel embrasse l’hécatombe qui signe l’espèce humaine, tous ceux que le monde avait exclus -les Juifs d’Europe et les Indiens des Plaines, les parias de la société occidentale. Une autre histoire se raconte, crève l’écran et s’adresse à votre âme. Il faut s’abandonner à ce grand livre magique, un coup à vous convertir à la littérature ! "Le sourire de Cimino disait : "quelle joie de vivre dans un récit" -il : "viens"."
Tiens ferme ta couronne, de Yannick Haenel, Éditions Gallimard, collection L’Infini, 350 pages. ****
Dans le cadre du festival du TNB à Rennes, Marie Darrieussecq et Yannick Haenel échangent sur la question de l’adaptation, leur rapport au théâtre, et ce qu’écrire veut dire.
Marie Darrieussecq et Yannick Haenel ont tous deux collaboré avec Arthur Nauzyciel : sur Le Musée de la mer et Ordet pour la première, pour l’adaptation de Jan Karski pour le second. Le prétexte de cette rencontre, le rapport littérature et théâtre – du roman à la scène – pourra être élargie aux conditions dans lesquelles des artistes de différents champs artistiques peuvent déployer des récits communs, « polliniser » leurs imaginaires… L’occasion pour le public du TNB de rencontrer et d’échanger avec deux auteurs associés au TNB.
« J’ai essayé de m’intéresser à d’autres choses que l’écriture : l’enseignement, la recherche, la cuisine, la natation, la psychanalyse, les promenades, tomber amoureuse. Tout m’intéresse mais rien autant qu’écrire. Ce qui aurait pu être une maladie est devenu un métier grâce au fait d’être publiée. Mais en vingt ans et une quinzaine de romans, c’est redevenu une sorte de maladie, mais une maladie heureuse. Si je n’avais pas pu écrire je serais sans doute devenue folle. Les mots sont ma colonne vertébrale. »
– Marie Darrieusecq
(Dernier roman paru Notre vie dans les forêts)
« Là où la fiction se substitue au réel, le climat devient moins pesant, la vision plus large… » Louis-René des Forêts est - avec Blanchot et Bataille - figure tutélaire, pour Yannick Haenel. « Chez ces trois auteurs, la littérature et la pensée sont une même chose. Cela continue de m’animer. Avec l’idée — et le livre Jan Karski en émane — que la littérature touche toujours à quelque chose de transgressif, d’interdit, de sacrilège en un sens. Ce que j’écris a à voir avec ce défi là. C’est une littérature qui ne se satisfait pas seulement de la narration. »
–Yannick Haenel
(Prix Médicis 2017 pour Tiens ferme ta couronne)
Yannick Haenel remporte le prix Médicis 2017 pour son roman Tiens ferme ta couronne (Gallimard). Il a obtenu cinq voix parmi les six jurés présents. François-Henri Désérable a eu une voix.nnick Haenel remporte le prix Médicis 2017.
Salué sur le site Gallimard avec ce bandeau, ICI
Le Goncourt échappe à Yannick Haenel qui figurait dans la dernière sélection des 4 finalistes. La bataille n’est cependant pas complètement terminée, il reste quelques prix à attribuer.
C’est Eric Vuillard qui est l’heureux élu, "Prix Goncourt 2017. Dans son livre "L’ordre du jour", Eric Vuillard revient sur les prémisses de l’horreur : le rôle des industriels allemands dans les agissements nazis. A l’arrivée, une évocation assez magistrale, grinçante par endroits, des coulisses de l’Anschluss.
Pourquoi il faut lire "L’ordre du jour" d’Eric Vuillard, prix Goncourt 2017 ?
Voir ICI
Six voix contre quatre. L’écrivain de 49 ans a été récompensé au troisième tour de scrutin par six voix contre quatre (pour le roman - pourtant favori - de Véronique Olmi), a annoncé Didier Decoin, membre de l’académie Goncourt, qui compte dix jurés. Sorti en mai, L’Ordre du jour s’intéresse au rôle des industriels allemands dans la montée du nazisme. Eric Vuillard était en compétition avec Yannick Haenel, pour Tiens ferme ta couronne (Gallimard), Alice Zeniter pour L’Art de perdre (Flammarion) et Véronique Olmi pour Bakhita (Albin Michel).
europe1.fr
www.huffingtonpost.fr
Le jury de l’Académie Goncourt a retenu lundi 30 octobre deux hommes - Yannick Haenel et Eric Vuillard - et deux femmes - Véronique Olmi et Alice Zeniter pour son prestigieux prix. Pa ordre alphabétique :
- Yannick Haenel, "Tiens ferme la couronne" (Gallimard)
- Véronique Olmi, "Bakhita" (Albin Michel)
- Eric Vuillard, "L’ordre du jour" (Actes Sud)
- Alice Zeniter, "L’Art de perdre" (Flammarion)
L’académie Goncourt, présidée par Bernard Pivot, se compose de Pierre Assouline, Tahar Ben Jelloun, Françoise Chandernagor, Philippe Claudel, Paule Constant, Didier Decoin, Virginie Despentes, Patrick Rambaud et Eric-Emmanuel Schmitt.
Le prix Goncourt sera attribué le 6 novembre.
Un gage de ventes exceptionnelles dans le monde francophone. Mais c’est aussi, pour ses lauréats, l’assurance d’une visibilité incomparable dans le reste du monde. "Nous ne sommes pas aussi connus que Coca Cola mais tout de même", s’amuse Bernard Pivot.
C’était jeudi 19 octobre 2017. Sur le thème « Littérature et Cinéma », François Busnel réunissait sur le plateau de la Grande Librairie, Pierre Lemaitre, en compagnie du comédien Laurent Lafitte, à l’occasion de la sortie du film « Au revoir là-haut », adapté de son roman éponyme, rejoints par Yannick Haenel, qui publie « Tiens ferme ta couronne », chez Gallimard, l’histoire d’un écrivain qui tente de faire adapter son scénario sur la vie d’Hermann Melville par le réalisateur américain Michael Cimino. Aussi sur le plateau : Joann Sfar pour « Vous connaissez peut-être », chez Albin Michel, Olivier Norek « Entre deux mondes », chez Michel Lafon, et Delphine Coulin « Une fille dans la jungle », chez Grasset.
Ci après deux extraits :
Extrait 1 :
Au fil des échanges, Yannick Haenel nous précise comment il écrit dans les bistrots…
Extrait 2 :
Sur son livre « Tiens bon ta couronne »…
Crédit : France 5 / La grande librairie
Une rencontre animée par Alexandre Lacroix et proposée par L’Ecole des Mots, une école d’écriture d’un nouveau genre, ouverte à tous et où Yannick Haenel donne des ateliers d’écriture

C’est donc aussi en professeur d’écriture qu’il va nous faire entrer dans le making of de son très beau roman Tiens ferme ta couronne qu’il publie en cette rentrée. Son héros, sans travail, passe ses journées à boire et à regarder en boucle les films de Francis Ford Coppola et de Michael Cimino. De plus en plus fou, il est obsédé par des visions de cerfs et de chasse. Et il va traverser une initiation.
Pourquoi écrit-il dans les cafés, à la main, remplissant des centaines de pages de cahier ? Comment le visionnage d’Apocalypse Now et de Voyage au bout de l’enfer a-t-il nourri son écriture ? Pourquoi a-t-il prêté un monologue halluciné à Isabelle Huppert ? Où a-t-il trouvé son titre fascinant ? Et pourquoi le roman raconte-t-il un vieux mythe attaché au sanctuaire de Diane ? Réponses à ces questions, et bien d’autres dans cette rencontre.
C’est le titre de la chronique de Bernard Pivot dans le Journal du Dimanche du 3 septembre 2017 à propos de Tiens ferme ta couronne qui se poursuit ainsi :
Crédit : le JDD
L’entretien 8/8 entre Yannick Haenel et Fabien Ribéry aborde le thème de la chasse qui traverse le livre.
Quelles parentés voyez-vous entre écriture et art cynégétique ?
C’est le sujet du livre — sa métaphysique, son arcane.
[…]
Je ne parle pas de la chasse comme prédation réelle (même si le personnage de Tot entraîne Jean Deichel, pour le souiller, dans une virée nocturne de mise à mort), mais de la constellation symbolique qui s’en déduit : j’ai agencé mon livre autour de cette couronne que forment les bois du cerf. La chasse dont je parle est mystique.
[…]
Il y a, au départ, le daim blanc de la vérité dans la phrase de Melville ; puis ce daim se met à proliférer à travers des figures de cerfs qui ne cessent d’apparaître dans le livre comme des épiphanies de l’aléthéia. Dans le film de Cimino, le chasseur baisse son arme après avoir eu dans son viseur un grand cerf. Ce qui a lieu à travers cette abstention ouvre un espace sacré : celui où le crime se suspend. L’absence de crime est le sacré, pas l’inverse.
[…]
J’envoie Jean Deichel [le narrateur] souffrir dans ces parages pour avoir des lumières sur cette question. Il est initié à la chasse, mais sa manière de chasser s’arrête à l’instant de donner la mort
[…]
Ce que j’appelle la chasse, c’est ce qui sature criminellement le monde lorsque celui-ci est parvenu au bout de lui-même : il a franchi alors cette limite à partir de laquelle le mal est partout chez lui. Faire l’expérience d’une telle spiritualisation négative, c’est rencontrer la destruction. Alors la parole témoigne. Le récit accède à des abîmes. On chuchote dans le noir. J’écris pour atteindre ces états, souvent effrayants, où l’on se retrouve à hauteur de secret. Où le silence nous prodigue une délivrance.
[…]
ce roman porte trace de tout ce que j’ai dû vaincre : lorsque le narrateur s’échappe de cet enfer pour se réfugier au milieu d’un lac, ce n’est pas qu’une métaphore. L’innocence exige d’avoir envisagé l’œil du crime. Personne ne peut se targuer d’être immunisé, personne ne parle en dehors de l’espèce humaine, laquelle est travaillée par le crime. En sortir implique une initiation, c’est-à-dire un face-à-face suivi d’un écart : une catabase. La littérature est le seul lieu susceptible de recueillir cette ambiguïté — de faire entendre la proximité de l’effrayant et du sauf.
Ce livre est écrit tout entier depuis la révélation du daim blanc : il est la trace de son impact hallucinatoire, narratif, métaphysique. Tiens ferme ta couronne est une histoire racontée par quelqu’un qui a eu la chance de voir la vérité passer comme un daim blanc effarouché à travers les bois — et qui témoigne de ce passage. Qui témoigne de la difficulté à rester fidèle à cette vision. Qui témoigne d’une tentative pour s’en rapprocher — pour coïncider, d’une manière folle, avec lui (cela s’appelle la mystique). Pour ne pas mourir d’en être séparé. Pour jouir de ce séjour auprès de la divinité.
L’opération du livre, vous l’avez compris, consiste à métamorphoser cette carabine qui porte mon nom en stylo-plume. À raconter la métamorphose du feu qui tue en feu qui sauve. À changer, comme diraient les mystiques juifs, le sang en encre.
[…]
Dans les arcanes de ce livre, il y a des choses inavouables, peut-être effrayantes : c’est un livre qui en dit long sur la nature des feux multiples qui embrasent mon âme. Il m’a semblé parfois, en l’écrivant, que j’étais assis à la table divine, et que Dieu et le Diable devisaient à mes côtés, à la fois pour m’enseigner et pour rire de moi. Je restais silencieux. Ce silence dure encore : il ne peut s’exprimer qu’à travers ce livre.
[…]
je ressens très fortement, jusqu’à l’évanouissement, le crime autour de moi. Je trouve que le monde pue la criminalité. J’essaie de créer chaque jour des livres, des phrases pour conjurer le crime du monde.
[…]
Diane chasseresse, 1872 par Joseph Victor Ranvier (Lyon 1832, 1896)
Athéna guide Ulysse. Diane est-elle votre déesse protectrice ?
Absolument, c’est elle — c’est Diane. Celle de Némi, la Diana Nemorensis : Diane du Bois. Elle n’est pas seulement, comme l’Artémis grecque, la déesse de la chasse et des forêts, mais aussi la protectrice des réfugiés. J’aime qu’elle soit farouche, dangereuse […]
Sa virginité ne relève pas spécialement du refus : c’est juste que personne n’a réussi à sentir un peu son immense corps, à lever un à un ses voiles, comme dirait Rimbaud. Le voile de Diane est moins protégé par son arc et ses redoutables flèches que par la maladresse masculine, par l’inintelligence humaine : il faudrait à chacun l’équivalent du Poème de Parménide pour être guidé sur la voie de l’être et espérer rencontrer la déesse.
Écrire, aujourd’hui, c’est encore et toujours chercher à s’orienter dans la tempête de l’existence, c’est naviguer à vue vers la jouissance de la vérité.
L’intégrale de l’entretien ICI
Pour une analyse en profondeur de « Tiens ferme ta couronne » et son auteur Yannick Haenel, vous recommande vivement de vous reporter à l’excellente série de 8 entretiens conduits par Fabien Ribery avec l’auteur ICI :
https://fabienribery.wordpress.com/
Nous vous avons proposé de larges extraits des entretiens 3/8 (La Reine de Némi) et 4/8 (« Tiens ferme ta couronne »- les développements sur le Titre du livre et sa composition tripartite) - avec la bienveillante autorisation de l’interviewer.
L’intégrale de l’entretien 3/8
L’intégrale de l’entretien 4/8
Nous vous invitons à découvrir la suite directement sur son blog.
L’entretien 5/8 éclaire les rapports de l’écrivain avec le cinéma. Juste ici, une citation :
Yannick Haenel a la parole facile qui s’appuie sur une pensée riche et profonde, une occasion d’entrer dans son univers.
L’entretien 6/8 aborde notamment la question du making of du livre. Comment il écrit et Où, les interférences des lieux et de l’actualité qui se reflètent dans le livre en cours d’écriture…
Les entretiens 7 et 8 sont encore à venir…
Les entretiens 1 et 2 étaient consacrés à la revue Ligne de Risque, le cœur du réacteur qui alimente en électricité la pensée de Yannick Haenel.
Entretien 1/8
Entretien 2/8.
Un blog de qualité tant pour les textes proposés que pour l’iconographie. La qualité appelant la qualité, Fabien Ribéry réussit à faire livrer à Yannick Haenel, le meilleur décryptage de son livre que j’ai lu jusqu’à présent.