SOMMAIRE
 Judith Brouste présente son roman
Judith Brouste présente son roman
 Entretiens radiophoniques
Entretiens radiophoniques
Critiques
 Jacques Drillon, La famille Frankenstein vue par Judith Brouste
Jacques Drillon, La famille Frankenstein vue par Judith Brouste
 Le Cercle des tempêtes par Philippe Chauché et Stéphane Guégan
Le Cercle des tempêtes par Philippe Chauché et Stéphane Guégan
 Jacques Henric, Avis de gros temps dans le 19e
Jacques Henric, Avis de gros temps dans le 19e
Les trois précédents romans de Judith Brouste lus par Jacques Henric
 Jours de guerre — le dur plaisir de souffrir
Jours de guerre — le dur plaisir de souffrir
 Après Shanghai — Une fille perdue
Après Shanghai — Une fille perdue
 Ruines de Vienne — Fini de danser
Ruines de Vienne — Fini de danser
Sur Le rire fou des chimères, le premier livre de Judith Brouste (1979)
 Philippe Sollers, Un petit livre qui danse
Philippe Sollers, Un petit livre qui danse Comment et pourquoi, en 1816, Mary Shelley, une jeune femme de dix-neuf ans, écrit-elle l’histoire la plus horrible de tous les temps ? À la suite de sa propre blessure, Judith Brouste découvre Frankenstein et la vie du poète anglais Shelley (1792-1822), son engagement poétique et révolutionnaire. Le cercle des tempêtes dévoile cette réalité cachée de la création, celle de la double écriture de Mary et Percy Shelley, liée aux événements de leur vie, de leur errance, de leur folie. Roman vrai, inspiration d’une autobiographie. Judith Brouste reprend le thème du corps, de la peur, dans un contexte historique précis et détaillé, en s’appuyant sur les journaux et la correspondance.
Extraits - pdf
 — Autres extraits
— Autres extraits
Judith Brouste présente son roman
Judith Brouste - Le cercle des tempêtes par Librairie_Mollat
Entretiens radiophoniques
Le RDV du 6/10 avec Judith Brouste et Vincent Macaigne
Laure Adler s’entretient avec la romancière Judith Brouste
Critiques
La famille Frankenstein vue par Judith Brouste
par Jacques Drillon
Encadrée par quelques pages d’autofiction, mystérieuses jusqu’à l’obscurité, la biographie que consacre Judith Brouste aux deux Shelley, Percy et Mary, vient allonger une liste plutôt brève d’ouvrages en français sur ces deux personnages. Percy, c’est le poète anti-bourgeois, renvoyé d’Oxford pour athéisme ; Mary, sa femme, est l’auteur de « Frankenstein ».
Leur vie est une suite de départs qui sont des fuites, de voyages qui sont des errances, de villégiatures qui sont des enfermements. Une suite de ménages à trois, jamais les mêmes, avec suicides et noyades. Une suite de malheurs et de déceptions. Une vie de pauvreté extrême, et de création fiévreuse, parfois géniale.
Le livre de Judith Brouste est très curieux : froid, dans l’enchaînement des événements, presque encyclopédique, sans aucun détour par la « psychologie », mais interrompu parfois de subits éclairs brûlants : la poésie, les journaux intimes, un bout de description. C’est un peu comme si elle redoutait qu’on s’attache à l’un ou l’autre de ces personnages ; comme si elle confiait aux seules citations la tâche de les faire vivre sous les yeux du lecteur. Leur vie est un roman, mais c’est justement le roman qu’elle ne veut pas écrire.
Les questions de recompositions familiales, tout à fait essentielles dans cette histoire pleine d’allées et venues de femmes, de grossesses simultanées, d’enfants qui passent de l’un à l’autre, de vies en communauté, sont traitées avec la plus grande minutie ; si grande que, du fait même de cette minutie et de la complexité familiale dont elle rend compte, il n’est pas inutile de tracer soi-même un arbre généalogique des Shelley. Pas inutile, mais pas miraculeux pour autant. Certains passages doivent être lus avec la même attention, le même courage, que la « Critique de la raison pure ». Par exemple, au début, le jeune Shelley va voir le poète Godwin (rencontre déterminante pour la suite) :
Il vit là, pauvrement, avec sa femme et ses quatre enfants. L’aînée, Fanny Imlay fille de Mary Wollstonecraft et d’un aventurier disparu en Amérique, adoptée par Godwin lors de son mariage avec celle-ci. Jane Clairmont, fille de Mme Godwin, née d’un premier mariage. Mary, sa fille, unique enfant de son union avec Mary Wollstonecraft, morte quelques jours après lui avoir donné naissance. Et le petit Charles, enfant de sa femme actuelle.
Rien d’insoluble là-dedans, mais les problèmes de robinets ne l’étaient pas non plus.
Jacques Drillon, Le Nouvel Observateur du 01-09-14.
Judith Brouste, Paris, juin 2006. Zoom : cliquer sur l’image.

Le Cercle des tempêtes, par Judith Brouste
par Philippe Chauché
« Ainsi c’est Frankenstein qui m’apprit à mourir et à renaître. C’est sa mort, dans les eaux glacées fictives d’une scène, qui m’a fait résister au monde tel qu’il se présentait pour accéder à celui de l’invisible. Dans la peur et la conscience du danger. Je vis que dans l’histoire on avait le droit de se révolter pourvu qu’on joue sa vie ».
Naissance du roman : une ville, un corps, une tempête théâtrale dont les éclats scintillent de page en page, mais aussi, un poète en disgrâce et en Acte permanent, des amours gagnés et perdus, des passions, et une certitude chevillée à la peau : la littérature sauve des tumeurs du monde. De Bordeaux à Londres en passant par Naples et Rome, la vie incandescente du Cercle des tempêtes embrase les corps et les idées, celles de Shelley, Fanny, Harriet, Mary, Byron, guerre sociale permanente dans l’Europe du début du 19° siècle. Frankenstein, Prométhée délivrée, Les Cenci, ils sont là sous nos yeux ces livres de tous les dangers qui flamboient sous la main romanesque de Judith Brouste, qui sait qu’être attentif aux révoltes qui se lèvent revient à être soucieux de la manière dont tout cela se vit et s’écrit.
« Un jour de juillet, il est au café, chemise et gilet ouverts. La chaleur est immense. Dehors, sur les pavés, résonnent le sabot des chevaux, le cliquetis des harnais, le grondement des roues. Harriet, la fille du cafetier, encore écolière, s’assoit à sa table : Elle avait seize ans, une belle allure, légère, active et gracieuse. Pour la première fois, il se confie, parle de ses projets : vivre différemment, à part ».
Vivre différemment et écrire différemment, voilà le projet de Shelley que poursuit Judith Brouste et voilà sa réussite. Le cercle des tempêtes est à mille lieux du roman historique, de sa frigidité installée. A chaque poème, à chaque phrase du roman, il s’agit d’enchanter les corps et la révolte, même si la chaleur est immense, même si la douleur s’invite, les trahisons, les renoncements, les créanciers, les espions, même si la mort tourne dans la nuit comme les sorcières de Shakespeare, même si les plus belles raisons s’enflamment dans les plus troublantes déraisons. Suivre page à page la vie tumultueuse de Shelley, voilà l’aventure romanesque qu’insuffle l’écrivain, voilà l’aventure qu’elle s’offre et nous offre, vitesse du roman, de l’amour, de la guerre sociale et de la poésie prise entre glace et feu.
« En poésie, c’est toujours la guerre. Comment s’échapper de cette vie ? Elle est ailleurs. Il faut lutter pour exister, face aux autres, face au monde insignifiant, satisfait de sa médiocrité. Pour Shelley, il s’agit alors de tenir, de créer sa propre loi. Ecrire est la clé de voûte de ce dispositif ».
En littérature c’est toujours et plus que jamais la guerre du goût, et il n’est pas surprenant de savoir que Le cercle des tempêtes soit publié par un expert, Philippe Sollers. Shelley, l’aristocrate sans qualités, l’ami des corps, des rebelles, de la nature et du verbe, trouve dans ce roman le plus beau des miroirs, en s’y penchant il découvrira les ombres portées de Cravan et Debord, deux autres figures de mauvaise réputation, et en prenant un peu de recul, la vibrante évocation de sa liberté libre. La propre loi du roman a échappé aux lecteurs professionnels des prix littéraires, pas lu, pas pris, pourrions-nous leur répondre.
« Où est Shelley ? Que fait-il ? Il continue de donner des nouvelles du monde, dans le secret troublant de la naissance du temps ».
Où est Judith Brouste ? Que fait-elle ? Elle continue d’écrire Le Cercle des Tempêtes, errance stylée dont elle trace les lignes vibrantes, le cœur intact au milieu des flammes.
Philippe Chauché, La Cause littéraire.
par Stéphane Guégan
À quoi tient le grand charme de cette nouvelle traversée de la biographie orageuse des Shelley, Percy et Mary, unis de corps et d’âme malgré un libertinage symétrique qu’ils voulaient libertaire ? À vingt ans de distance, André Maurois et Gaston Bachelard ont cherché à définir la poésie du premier, l’une des plus hautes du romantisme anglais avec celle de Keats (les lire impérativement dans la langue de Shakespeare). Saisir Percy ? Autant chercher à arrêter un souffle ou épingler un papillon de nuit affolé par les injustices et les cruautés du jour. Si son ami Byron s’identifiait à Don Juan, lui se voyait en Ariel, comme le jeune Gautier. Sans un mot de trop, Judith Brouste est parvenue à tenir au bout de sa plume nette cet esprit aérien, qui fit de la nature sa confidente étonnée et dressait l’universel des anciens Grecs contre la censure du libre amour et le capitalisme sauvage de la terrible Albion. Ce mauvais sujet du futur George IV, dont Marx a salué la rage présocialiste et l’athéisme prométhéen, fascine aussi en ceci que son idéalisme de nanti a semé la mort autour de lui. Femmes, enfants, rêves et spectres, rien ne résiste bien longtemps à sa fureur de vivre. Il eut le bon goût de dissoudre en mer ses utopies de fraternité universelle. Un vrai feu follet. Mary lui survécut, Mary et son immortel Frankenstein, où la réversibilité de la beauté et du monstrueux garde le goût doux-amer d’une génération perdue. Le Cercle des tempêtes, superbe titre, est une des bonnes surprises de cette rentrée littéraire très prêchi-prêcha.
Stéphane Guégan, Motsdits.
Avis de gros temps dans le 19e
par Jacques Henric
art press 408, octobre 2014. Zoom : cliquer sur l’image.

Les trois précédents romans de Judith Brouste lus par Jacques Henric
Jours de guerre
 Collection L’Infini, Gallimard
Collection L’Infini, Gallimard
Parution : 11-03-2004
« Tous des porcs. Tous des salauds. Ils sont là, ils m’attendent. Dès que je sors, ils me cernent, me frôlent, m’empêchent de penser, de vivre. Ils sont là, collés contre moi, comme des tiques dont je n’arrive pas à me débarrasser. C’est dégoûtant, immonde. Me poursuivre, ne jamais me laisser de répit, me voler ma pensée, prendre possession ainsi de moi. Partout ils me voient, me suivent, me fixent. Leurs regards sont des monstres vides collés sur moi, des sangsues dont il faut me défaire une à une. C’est infect. Cela m’épuise, on n’a jamais fait ça à personne. »
le dur plaisir de souffrir
par Jacques Henric
Non, ce n’est pas parce que nombre d’éditeurs nous foutent régulièrement le blues en nous donnant à lire les produits de raconteurs d’histoires bien tartinées du genre « Il a refoulé sa grand-mère... il a découpé son grand-père ! Il baise plus sa femme... il va épouser son petit frère » (dixit Céline), pas parce que des galériens de l’ordinateur y vont tous les six mois de leurs petits romans bien formatés qui envahissent les étals des libraires, qu’il faut désespérer. Il y a encore (pour combien de temps ?), ici, là, un éditeur pour reconnaître au milieu des chromos qui font, croit-on faussement, le bonheur des lecteurs, un manuscrit pas classable, un ovni littéraire, un de ces écrits dans lequel l’auteur se présente « nerfs à vif », comme disait Céline dans ses Entretiens avec le Professeur Y (« Les vôtres !..., précisait-il, pas les nerfs d’autrui !... plus qu’à poil !... à vif !... plus que « tout nu » !... et tout votre je en avant !... hardi !... pas de tricheries ! »). Jours de guerre, de Judith Brouste, est un de ces récits où un je se présente à nous « nerfs à vif », mais sans pathos et débarrassé de ces chics costards et beaux uniformes qu’affectionnent tant de héros de romans contemporains.
Déjà le titre : Jours de guerre... Une façon, d’entrée, de ne pas nous bourrer le mou avec tous les nobles et émollients discours des belles âmes nous assurant que l’homme ne cesse de progresser, que nous avançons chaque jour sur la voie royale d’une paix universelle. C’est que la guerre est partout. Pas seulement dans les endroits du monde où les voitures explosent, les immeubles s’effondrent, les femmes sont lapidées, les enfants meurent sous les bombes ; elle se fait aussi, la guerre, avec le voisin de palier, dans les bureaux, les partis politiques, les églises, les familles, les couples, elle se fait aussi, et en premier, à l’intérieur de chacun de nous. C’est de cette guerre-là, qui ne fait pas de gros bruits, guerre discrète, étouffée, honteuse, dévastatrice à sa façon, qu’il est question dans le court et brûlant récit de Judith Brouste.
Une femme retrouve un homme qu’elle a connu, il y a longtemps. L’homme est devenu un SDF, il vit dans la rue depuis des années, couche la nuit dans les squares ou dans un « placard » qu’il squatte près de la gare Saint-Lazare. Il est sale, édenté, vêtu de loques. Cet homme néanmoins est beau, est resté beau, il a une douceur en lui que ne réussissent pas à masquer ses fréquents accès de violence. C’est un homme cultivé, il a beaucoup lu, lit toujours (Faulkner, Heidegger, Kafka, Platon, Sartre, Sollers...), mais il est atteint de ce mal connu qui lui fait croire que c’est lui qui a écrit tous les livres, qu’on le vole, le persécute, le déloge de son corps et lui ravit l’esprit... Ce mal s’appelle paranoïa. « Tous des porcs. Tous des salauds. Ils sont là, ils m’attendent... ». Cet homme est en guerre, contre la ville entière, contre le monde entier. Alors que la narratrice est déjà en conflit violent avec sa propre mère (ah ! les rapports mère-fille !...), quelle pulsion, quel affect, quel sentiment, quelle tension morale, quel démon intérieur, vont l’amener à prendre en charge ce personnage délirant, à le recueillir chez elle, à le soigner, à tenter de lui redonner sa dignité d’homme ? Elle n’est pas chrétienne, pas une sainte pratiquant masochistement une charité démesurée, sa lucidité ne la fait pas déborder de compassion pour ses semblables, alors ? L’amour ? Une forme d’amour, peut-être, qui ne serait pas la passion ? Mais sait-elle elle-même ce qui l’amène à se promener dans les rues de Paris, main dans la main, avec cet homme perdu ? C’est la force de ce livre d’éviter les réponses, tant une telle une question touchant à l’amour a toujours été vaine. À moins que cet improbable et fantomatique amant n’ait été pour la femme qu’un passeur. Par lui, avec lui, au cours de leurs errances, voilà qu’elle retrouve la mémoire d’une ville en voie de disparition, le souvenir de sa propre jeunesse. Les pages sur Paris sont habitées d’une beauté nostalgique. On pense parfois à Debord que connut la narratrice. Étonnerai-je en vous apprenant que la tentative de sauvetage de l’homme à profil de Sioux échoua. Que cet amour, si amour il y eut, fut aussi une guerre. Comme tout amour ? Comme tout amour ! Qui en aurait douté ?
Jacques Henric, art press 300.
Après Shanghai
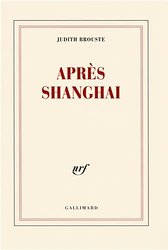
Collection Blanche, Gallimard
Parution : 28-09-2006
« À la fin du jour, je devenais l’otage d’une autre vie commencée au bar du Black Cat, où des filles aux cheveux laqués d’huile d’orchidée, avides de fortune, offraient leur cœur sur la glace pilée des drinks. Lumières de Shanghai, aventure espagnole, désastre d’un amour, féeries d’un monde mort. Décombres splendides sur lesquels il avait bâti une famille. Doucement, j’allais piller, piétiner les images de ses merveilles. »
Une fille perdue
par Jacques Henric
Jours de guerre. C’était le précédent livre de Judith Brouste. Un beau et terrible récit, au titre ad hoc, qui relatait la relation amoureuse de la narratrice avec un homme que la folie avait conduit à la déchéance physique et sociale. Ce n’est pas tout à fait de la même guerre qu’il est question dans Après Shanghai, mais c’est bien d’une guerre qu’il s’agit, ou plutôt de deux guerres. Celle dans laquelle se trouve plongé le père de la narratrice, comme médecin colonial, lors du second conflit mondial du siècle passé. Celle que sa jeune enfant va mener contre lui, le père autoritaire et violent. « Tout pour la guerre », c’est le mot d’ordre du papa militaire. Pas tombé dans l’oreille d’une sourde. Sa fifille le reprend à son compte, et la gentille demoiselle de bonne famille, à qui on impose de jouer au piano une ballade de Chopin, va devenir une autre va-t-en-guerre, pas contre l’ennemi combattu par son géniteur, ce père à la fois admiré et haï, mais contre un ennemi plus proche, tout proche, incarnation d’une classe sociale, de son idéologie, de ses moeurs, de son déclin en cours (fin d’un empire, fin du monde colonial). À seize ans, elle « prend le maquis ». Elle refuse école, travail, maison, famille. La guerre est déclarée, entre le père et elle. Il lui faut acquérir une « langue de lutte », car ce n’est pas avec les bons vieux fusils de papa qu’elle va guerroyer, mais avec des mots, ceux-là mêmes qui feront plus tard d’elle un écrivain. Elle ne part pas au maquis sans munitions et sans soutiens. Quelques « bandits » de grands chemins la guident : Villon, Rimbaud, Genet, Vaché... Beaucoup plus tard, quand au cours de sa rébellion elle va prendre trop de gnons, trop de blessures intérieures, c’est le docteur Lacan qui sera appelé à la rescousse et lui filera un signalé coup de main (il fait une apparition dans le livre aussi brève que drôle). Lacan qui, ainsi que le rappelle la narratrice, a commencé sa carrière de psy en analysant le cas Aimée, cette femme qui voulait devenir romancière et a fini par tenter d’assassiner une actrice de théâtre. « Tuer et écrire. Deux déchaînements, deux défis au monde », commente Judith Brouste. C’est, Dieu merci, à la différence d’Aimée, le second qu’elle va victorieusement relever. Mais avant d’y parvenir, il lui faut galérer, un vrai parcours du combattant. N’appartenir à personne, comme elle le revendique, se paie au prix fort. « Je me définissais comme une fille perdue, introuvable. Sans me douter, ajoute-t-elle, que cela signifiait débauchée, livrée au plaisir. » Il faudra sans doute attendre le prochain livre pour savoir ce que ces derniers mots veulent dire. Après Shanghai est un écrit de transition, dont le centre est le père. C’est son histoire que reconstitue, bien après sa mort, la narratrice. Impressionnante figure que cet homme, qui suscite des sentiments forts, contrastés, et des réactions violemment contradictoires. Peur, agressivité. « Haine et vengeance. Amour et pardon. Ni amertume ni chagrin. » Le livre s’ouvre sur la mort de ce père aimé/honni. Pages sans pathos, superbes d’émotion contenue, de délicatesse, de lucidité. « Comment s’échapper d’une histoire ? En la ressassant. Jamais je n’aurais cru arriver à cette étendue inimaginable, à ce temps où je vivrais sans lui. Il s’étale devant moi, comme s’il n’avait pas de fin. » C’est dans ce temps étale, sans fin, qu’une jeune femme, par l’écriture, est entrée. C’est par l’écriture qu’elle s’est échappée d’une histoire qui ne pouvait être la sienne, par l’écriture qu’elle vit aujourd’hui sa propre histoire et en maîtrise le temps.
Jacques Henric, art press 327.
Ruines de Vienne
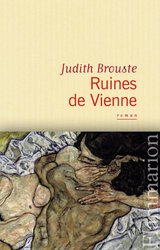
Éditions Flammarion, 2010
« J’ai huit ans, l’été 1956, lorsqu’elle a voulu revenir au Sacher. Vienne n’est plus occupée par les Allemands ni par les armées victorieuses. Plus de chars au pied de la Grande Roue ni de marché noir. Plus de soldats russes ni de police internationale. Les décombres ont été déblayés depuis longtemps devant le café Mozart. Maria cherche les lieux dont elle a conservé les noms, le Dianabad, Marienbrücke, le quartier de Josefstadt derrière l’université, où elle donnait ses rendez-vous. Elle m’entraîne par la main à Margaretenstrasse, comme par inadvertance, lunettes noires, chevelure platine, gourmette en or à breloques, jupe droite sur ses fines jambes. Sa jeunesse. »
Fini de danser
par Jacques Henric
Il y a chez les écrivains contemporains ceux qui ont enregistré quelle catastrophe a été le siècle qu’on a quitté, et les autres, ceux à la mémoire labile qui n’ont rien compris au tragique de notre histoire et continuent de nous tartiner de jolis contes de fées sur les lendemains de notre espèce qui se sont remis à chanter de plus belle. Et parmi ceux qui ont pris acte de l’horreur du siècle, il conviendrait de faire également le tri entre ceux qui ont décidé de ne pas céder aux sinistres magisters du cafard, et ceux qui plutôt que de se battre hurlent lugubrement à la mort leur dégoût de la vie. En un mot, il y a ceux pour qui la vie est une guerre, et les autres.
La Clandestine, l’État d’alerte, Jours de guerre... Ces titres à eux seuls suffisent à désigner à quel camp appartient la romancière Judith Brouste. En guerre, oui, elle l’est, contre son temps, contre les fantômes de son histoire familiale, ses vies amoureuses et sexuelles, contre la maladie. Avec Ruines de Vienne, la voici donc qui remonte au front. Un front qui passe entre la capitale autrichienne et Paris. Deux points stratégiques de l’histoire contemporaine. Deux villes en ruines ? Oui, d’une certaine façon, pas des ruines matérielles, bien sûr (encore que...), mais l’une et l’autre gagnées par une sorte de sournois cancer, comme son corps de femme en a subi à plusieurs reprises les outrages. Et pourtant, le regard qu’elle pose sur cette lente dégradation d’un monde, s’il est entaché d’une certaine nostalgie, n’est jamais gagné par la désespérance. L’exergue de Marcel Schwob donne le ton du livre « Fuis les ruines et ne pleure pas parmi. »
Un grand nombre d’images de Vienne, quand les valses n’y sont plus de saison, habitent la mémoire de l’auteur, mais son livre reste pour l’essentiel un beau poème en prose consacré à Paris. Un Paris qui n’est plus celui de Villon, de Baudelaire, de Lautréamont, d’Aragon, de Breton, de Céline, c’est le Paris des années 1970, ce Paris que Guy Debord voyait comme une ville abaissée, ravagée. Il était d’ailleurs inévitable que la narratrice, au gré de ses errances entre la Contrescarpe, Saint-Médard, les rues du Four, Gît-le-Coeur, de Lappe..., le croisât, l’auteur de In girum imus nocte et consimimur igni et échangeât avec lui des paroles désenchantées. Dans leur Paris commun, la toute jeune provinciale tourne elle aussi en rond et est dévorée par le feu, ses propres feux, ceux de l’amour, du sexe, de la solitude, des rêves avortés, ceux aussi des comptoirs de bars populaires, des hôtels miteux, où elle côtoie les déjetés de la vie, post-existentialistes, vieux anars alcoolos, clodos, drogués, prostituées, révolutionnaires sans révolution... À côté de cette faune, se détachent de pittoresques ou de tragiques figures : l’amie des débuts, Françoise, et surtout l’insaisissable, le fuyant, le trop aimé « cynique, goujat et tendre » Christian. Les portraits qu’en trace Judith Brouste sont d’une impressionnante vérité. C’est un des points forts de son livre, cette attention portée aux corps, à leur présence physique. Le poids des deux villes en ruines qui pèse sur la narratrice ne l’empêchera pas de retrouver son enfance à la fin du récit, l’esprit et jusqu’au corps de son enfance. Quant aux petites poches d’enfer où elle a séjourné, elle les oublie pour se rappeler les seuls lieux bénis de l’amour. Ainsi, « Formentera, les sentiers brûlés aux brindilles séchées (...) Après midi brûlantes aux persiennes demi-fermées, à la lente approche des corps.. » [...]
Jacques Henric, art press 366, avril 2010.
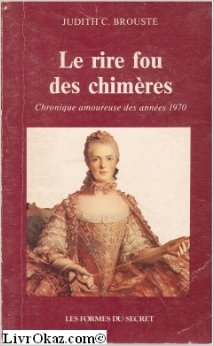 En 1979, après quatre ans de psychanalyse avec Lacan, Judith Brouste publie son premier livre, Le rire fou des chimères : chronique amoureuse des années 1970 [1]. Philippe Sollers en rend compte dans Le Monde des livres.
En 1979, après quatre ans de psychanalyse avec Lacan, Judith Brouste publie son premier livre, Le rire fou des chimères : chronique amoureuse des années 1970 [1]. Philippe Sollers en rend compte dans Le Monde des livres.
Un petit livre qui danse
par Philippe Sollers
Tout est fait, jour après jour, pour nous faire croire à l’histoire officielle, celle des masses, des groupes humains, en train, paraît-il, d’accomplir une nécessité qui les tient. Mais voici un petit livre modeste, léger, emporté, une « chronique amoureuse des années 70 », un journal rapide des perceptions de l’époque, entièrement dédié au temps qui passe et ne passe pas, à la répétition de l’insaisissable vie quotidienne, battante, vide, ennuyeuse, joyeuse. C’est écrit par petits bouts tournoyants, emmêlés, banals, éblouis.
Au cas où vous ne le sauriez pas vraiment, apprenez donc que, d’une certaine façon, effroyable et sans importance, la fin de l’histoire a eu lieu, qu’un point de non-retour a été atteint. Pourquoi ? Par qui ? Par les femmes. Pourquoi ? Parce qu’elles n’y croient plus. À quoi ? À leur fonction, leur destin, leur auréole, leur magie, leur culte. N’est-il pas stupéfiant de voir, par exemple, en Iran, où certains pensaient déjà assister à une révolution authentique, à la naissance d’une nouvelle « spiritualité politique », n’est-il pas ahurissant de voir le nouveau pouvoir proposer de revoiler les femmes et, là, devant l’énormité de cet archaïsme, hésiter tout à coup, reculer, tout en poursuivant par ailleurs ses exécutions ? Des femmes dans la rue manifester contre le fait qu’on veuille les rhabiller à l’antique... Cette fin de siècle aura décidément tout vu.
Conseillons donc aux autorités religieuses, comme aux responsables politiques, de lire cette « chronique ». Ils verront que le terrain sur lequel ils se meuvent est définitivement miné. Et, en réalité, pas du tout par une nouvelle révolution au nom des femmes, pas du tout par un nouvel "isme" qui prendrait la relève de l’effondrement généralisé des "ismes", mais par le mouvement même qui s’est emparé, comme atomiquement des individus.
De quoi irriter, agacer, dégoûter tout l’ancien monde, c’est-à-dire très concrètement celui qui croit que LA femme existe. Qui fondait donc sa réalité et son réalisme sur cette surréalité. Comme une insolence supplémentaire, ce livre porte en couverture une reproduction de Nattier : Madame Adélaïde faisant des nœuds. Manière de dire que les deux derniers siècles se sont pour le moins égarés sur cette affaire féminine, en la durcissant, en l’emphatisant, en l’obscurcissant au-delà de ce qu’elle veut dire en effet.
Les jours d’aujourd’hui passent donc, et il ne se passe pas grand-chose, mari, enfants, amants, amantes, corps, dîners, lectures et ça recommence. Ce n’est pas du tout sérieux.
Mais regardez autour de vous. Qu’est-ce qui est sérieux ? Précisément l’apparition du dérisoire comme tel, des vies dépensées "pour rien", du tourbillon des habitudes et des rencontres. L’auteur s’intéresse à la danse : voilà, il s’agit de savoir qui sait danser, ou pas.
Et ce petit livre danse, sans recherche, sans calcul, immédiatement, constamment. Il ne manque même pas à sa lucidité de poser ce qui apparaîtra, peu à peu, comme le principal symptôme de l’époque : le « saut » très étrange accompli en France par la psychanalyse et ses remous. Judith C. Brouste, toujours en dansant, souffrant, parlant et riant, est donc allée « s’étendre » chez Lacan. « Je ne sais pas ce que je dis. Et Lacan me dit que "c’est vrai", que "c’est normal". Ce mot dans sa bouche me fait rire... Il semble rire lui aussi... » Bien entendu, il n’est pas non plus question de faire une "vraie" psychanalyse. Mais le portrait esquissé de Lacan à toute allure est aussi "vrai", d’une vérité que porte l’intuition littéraire : chimérique, folle, généreuse, désintéressée. C’est la meilleure partie de ce livre bouclé comme une sonate, une ronde.
Les Lettres persanes, aussi, disaient déjà la vérité. L’art inné, très critique, consiste à ne pas appuyer et à passer vite là où tout le monde piétine dans le faux sérieux boursouflé.
Philippe Sollers, Le Monde du 13 avril 1979.
Odna, la nuit, 14 poèmes, livre d’artiste peint par Christiane Malval, 2011.
[1] Editions Les formes du secret.






 Version imprimable
Version imprimable




 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?



2 Messages
J’ai lu la totalité (ou pratiquement,car je doute toujours) des oeuvres de Judith Brouste . Passionnée par cette auteure.
Aussi, je me suis précipitée sur " L’ENFANCE FUTURE" dès sa parution. C’est un chef d’oeuvre admirable à tout point de vue . Les textes entrelacés sont prenants d’un bout à l’autre : Evocation de la guerre du Viet-Nam , lien avec le père, récit de l’enfance. tout est évoqué avec une Sensibilté et une Sincérité immenses. Merci, Judith !
En 1979, après quatre ans de psychanalyse avec Lacan, Judith Brouste publie son premier livre, Le rire fou des chimères : chronique amoureuse des années 1970. Philippe Sollers en rend compte dans Le Monde des livres. Lire ici.