
- 9 mai 1968, place de la Sorbonne : Alain Geismar, Louis Aragon, Daniel Cohn-Bendit.
Photo Serge Hambourg
« Il y a un moment historique où certains se montrent capables d’écrire ce qui est imminent. C’est la coïncidence bizarre entre le temps historique et la possibilité de le dire. À ce moment-là le temps prend des dimensions énormes, et en une semaine on franchit vingt ans.
En 1928, c’était le cas. Enchaînez les discours, passez de 28 à 68. Eh bien, voilà Aragon sur le boulevard Saint-Michel, et ça ne s’est pas très bien passé. « Mais enfin, mec, tu nous a laissés en 1928 et tu nous reviens quarante ans après ? » S’est-il rendu compte de ce qu’il avait fait pendant quarante ans ? En tout cas, ce qui a parlé, à ce moment-là, c’est sans doute l’Aragon de 1928. Aux dépens de l’auteur, bien sûr. Son texte occulté de l’époque a été publié ensuite. Qui était capable d’écrire La Défense de l’infini en 68 ? Eh bien, voilà qui n’est pas si mal... Reprenons donc, malgré toutes les régressions, en 28 et en 68. »
Ph. Sollers, 1997, Éloge de l’infini, Folio, p. 784.
Faut-il relire Aragon ? Oui. Mais comment ? J’avais déjà suggéré quelques pistes dans mon dossier Littérature et politique : le cas Aragon (I), il y a un peu plus de trois ans. Ce dossier laissait un peu dans l’ombre le rapport entre Aragon et la revue Tel Quel. Trente ans après la mort de l’écrivain, la relecture du texte de Philippe Forest, « Aragon/Tel Quel : le chassé croisé » (2004), m’a incité à rouvrir mes archives et à le compléter.
Il revenait à Forest, auteur de l’incontournable Histoire de Tel Quel (Seuil, 1995), à laquelle Pileface s’est maintes fois référé, d’écrire — de l’extérieur — la première approche historique du rapport, non seulement entre Aragon et Sollers, mais, plus largement, entre Aragon et Tel Quel. Il s’agit d’abord pour Forest de réévaluer l’oeuvre d’Aragon. Il écrit : « l’enjeu est bien entendu d’abord esthétique », mais il « est tout autant politique ». C’est tout l’enjeu, nommément, de la question de Staline ou du communisme dont Aragon fut (pendant plus de cinquante ans !) le défenseur. C’est aussi la question « femmes » — « La Femme » idéalisée (elsadéifiée) sur fond de refoulement homosexuel — que (dans ce texte du moins) Forest n’aborde pas, mais que Sollers et Kristeva traitent résolument (voir plus loin).
On peut contester certains points de l’analyse de Forest. La tentation est grande d’idéaliser le rôle, indéniable, d’Aragon et de la réunion du comité central d’Argenteuil du PCF (mars 1966) où l’écrivain défendit pourtant un Roger Garaudy, défenseur d’un inepte « réalisme sans rivage » [1] tandis que d’autres y critiquaient Louis Althusser qui avait quand même une autre envergure théorique. On peut s’étonner que ne soient aucunement évoqués la publication du Lautréamont par lui-même de Marcelin Pleynet en 1967 et le long article qu’il suscitera de la part d’Aragon, Lautréamont et nous (Les Lettres françaises du 8-14 juin 1967) [2]. On peut regretter que ne soient pas plus évoquées les contradictions qui éclatèrent, en avril 1970, lors du colloque de Cluny II organisé par La Nouvelle Critique sur Littérature et idéologies (mais il est vrai qu’Aragon n’y était pas en cause) [3]. On peut s’interroger sur la présentation réductrice qui est faite de la revue Promesse ou de Peinture, cahiers théoriques qui, après 1968, jouèrent un rôle non négligeable, dans le sillage de Tel Quel, pour lutter contre une sinophobie bien réelle « à gauche » (ce ne fut pas leur seul apport, j’en ai déjà rendu compte).
Certes le Bulletin Tel Quel/Mouvement de juin 1971 a des aspects bien caricaturaux ; on y trouve les excès, les anathèmes qui rappellent l’époque des... surréalistes qui n’étaient pas avares en insultes (relisez leurs tracts ou, d’Aragon, le Traité du style ou encore, dans Un cadavre (Anatole France), son virulent Avez-vous déjà giflé un mort ? : « Je tiens tout admirateur d’Anatole France pour un être dégradé. », etc. [4]) ; mais comme l’écrit Marcelin Pleynet dans L’Infini n° 114 (printemps 2011) à propos de cette période dont, manifestement, il ne regrette rien :
« Ce n’était qu’un début... Nous continuons le combat... Ne serait-ce que pour déjouer ce qui se met progressivement en place d’une évidente tentative d’entrisme et des influences du parti stalinien dans les décisions de la revue...
[...] Pratique chinoise de "datzibao".On peut voir un de ces "datzibao" dans le film (Vita Nova) que Florence D. Lambert m’a consacré, il y a trois ans... Et, comme les "datzibao" semble-t-il ne suffisent pas, et que les revues se multiplient sur le modèle communiste, en jouant l’ambiguïté avec nos propres sommaires, nous décidons de doubler la publication de « Tel Quel » d’un bulletin qui comprendra 6 ou 7 numéros et que nous intitulons « Mouvement de Juin 71 ». Le ton général en étant très agressif et décidé à ne pas laisser en paix, et à liquider à l’intérieur de la revue, ceux qui se sont laissés prendre aux ruses sociales de la politique du parti stalinien... »
Je renvoie aussi à L’art de la guerre et à ce que Julia Kristeva, citant Sun-zi, écrivait en 1972 sur les lieux de mort et la manière d’en sortir (car c’est bien de cela qu’il s’agissait) :
[...] par des lieux de mort, j’entends tous ceux où l’on se trouve tellement réduit que, quelque parti que l’on prenne, on est toujours en danger [...] Si vous êtes dans des lieux de mort, n’hésitez point à combattre, allez droit à l’ennemi, le plus tôt est le meilleur ».
On sent que Forest, né en 1962, n’a pas vécu cette époque (ce qu’on ne peut lui reprocher !). Et son objectif n’est-il pas d’abord de « penser le dernier Aragon » et, ce faisant, de le réhabiliter ?
A part ces réserves, l’intérêt de son analyse est, après avoir retracé, textes à l’appui, l’histoire « Aragon/Tel Quel » — l’histoire d’un « malentendu », écrit-il — (ce qui n’avait jamais été fait), d’ouvrir (à la fin et trop brièvement, mais ce n’était pas son objet) sur la période qui suit l’aventure de Tel Quel, celle de la revue L’Infini. Il se trouve, par un de ces curieux hasards dont la vie est prolifique, que cette période nouvelle s’ouvre avec la mort de Louis Aragon et la publication du roman de Sollers Femmes. Qu’en est-il donc d’Aragon de Tel Quel à L’Infini ? On ne peut, bien entendu, réduire l’enjeu de la question à un « dialogue » avorté ou à un malentendu. Et il ne s’agit plus là de chassé-croisé.
Le texte de Forest est disponible sur la toile. Je le reproduis ci-dessous — accompagné de certains documents, parfois non réédités, auxquels il se réfère. Parmi ceux-ci, deux textes fondamentaux publiés dans un « numéro spécial Aragon » des Lettres françaises en mars 1992 : d’abord Un perpétuel printemps, le très long et enthousiaste article d’Aragon consacré, en novembre 1958, au premier roman de Sollers, Une curieuse solitude, ensuite l’entretien de 1992 entre Jean Ristat et Philippe Sollers, S’engager contre soi-même ?. Je termine par un extrait du livre de Julia Kristeva, Sens et non-sens de la révolte qui explique en quoi « le stalinisme » ne pouvait qu’être « contre l’infini sensible » ; puis un retour au premier Aragon, celui du Con d’Irène — un des chapitres de Défense de l’infini —, lu par Philippe Sollers ; enfin, après un portrait croisé du couple Aragon-Elsa par eux-mêmes, vous lirez un article de Jacques Henric qui livre quelques anecdotes dont l’une sur « le dernier Aragon », révélée en 2004 lors d’un colloque « qui ronronnait », semble ne pas avoir plu à tout le monde [5]...
Philippe Forest achève son article par ces mots :
A ce retour d’Aragon, disons juste, pour conclure, qu’il n’est pas exclu qu’il y ait aussi une signification politique.
En est-il de même pour le choix des textes qui vous est ici proposé ? Ce n’est pas impossible.
Je reviens un instant — c’est d’actualité — sur le texte de Kristeva dont vous lirez des passages plus bas. Il est extrait de son cours du 21 mars 1995 (17 ans déjà, vraiment ?). Nous sommes en pleine campagne électorale, Kristeva s’adresse à ses étudiants, elle leur parle de la révolte. La question de « la partition "droite" et "gauche" » est à nouveau posée.
Au moment où les discours des candidats à la présidence de la République — discours de rassemblement qui vont dans le sens des urnes — cherchent démagogiquement à gommer clivages et différences, le terme de révolte fait peur. Il fait peur parce qu’il consisterait précisément à s’interroger sur les contradictions présentes et sur les nouvelles formes de révolte dans notre société postindustrielle. Parler de révolte n’appelle pas d’emblée au « rassemblement » susceptible de faire gagner un candidat, mais incite, au contraire, à l’auscultation, au déplacement, à la dissemblance, à l’analyse, à la dissolution. Parler de révolte n’appelle pas à l’intégration, à l’inclusion, à l’idylle sociale dans l’immobilité, mais souligne qu’il existe des contradictions d’ordre économique, psychique, spirituel, et, qui plus est, que ces contradictions sont permanentes : entendez bien, elles ne sont pas solvables. C’est même lorsqu’on s’aperçoit que les contradictions de la pensée et de la société sont insolubles que la révolte apparaît — avec ses risques — comme une nécessité continue pour le maintien en vie de la psyché, de la pensée et du lien social lui-même. Bien sûr, le paysage politique n’est pas nécessairement le lieu où la question de la révolte peut se poser ; peut-être le deviendra-t-il si certains, comme ils le proclament, parviennent à refonder la gauche. Mais cela prendra du temps — après un temps, pour ce parti nécessaire, de diète du pouvoir.
Avis aux jeunes (et au moins jeunes !) lecteurs de Pileface !
Allez, le printemps — l’éternel printemps — est de retour. Ne doutez pas de le revoir. Bonne lecture.
ARAGON/TEL QUEL : LE CHASSÉ-CROISÉ
par Philippe Forest [6]
1.
Quel que soit le travail critique d’ores et déjà accompli, l’importance des investigations actuellement en cours, et bien que commence depuis quelques années à céder un certain verrou interdisant l’accès conduisant jusqu’à lui, le dernier Aragon reste encore pour l’essentiel à penser. Il y va d’une évaluation juste — intègre et entière — d’une des oeuvres romanesques et poétiques capitales du siècle dernier mais aussi d’une compréhension exacte du jeu qui s’est joué au cours des années 60 et 70 dans l’histoire de la culture française, jeu dont dépend directement notre présent mais qui pourtant attend encore d’être vraiment étudié, décrit, raconté ou bien et jusqu’à présent ne l’a été que par fragments, par bribes.
L’enjeu est bien entendu d’abord esthétique. Il concerne la grande aventure révolue des avant-gardes et la façon dont les vagues successives qui ont fait cette aventure se sont poussées en avant les unes les autres, chevauchées, recouvertes. De l’avant-garde des années 20 à celle des années 60, du temps du surréalisme au temps du structuralisme, quelque chose a lieu deux fois dans l’histoire de la pensée, à quoi Aragon n’a à chaque fois jamais été étranger et qui détermine encore aujourd’hui la possibilité d’une littérature ne renonçant pas au principe de mise en question critique qui définit l’esprit même de la modernité.
Mais l’enjeu est tout autant politique. Il nous reconduit vers l’aventure également révolue de l’entreprise révolutionnaire dont les avatars successifs ont fait l’histoire du vingtième siècle. Aragon a tout vu et presque tout vécu, de la révolution russe dont il fut le spectateur désabusé puis l’inconditionnel partisan jusqu’au moment de l’après 68 où, vieillissant, il assista sans doute à la progressive dissolution de tout authentique esprit de contestation au sein de ce que l’on nommera au choix la société du spectacle ou de consommation, et qui est encore la nôtre.
Littérairement, politiquement, du fait de la formidable longévité de son talent, Aragon eut le privilège terrible d’assister à ce phénomène d’éternel recommencement qui fait l’Histoire. Plusieurs fois, il vit venir, s’en aller et puis revenir le balancier des choses. De ce fait, sa situation place le dernier Aragon en un point particulier du temps qui nécessairement nous importe : avec lui, quelque chose s’achève (une certaine histoire de la modernité esthétique et idéologique) dont il peut nous aider à penser le lendemain : liquidation sans reste, répétition parodique ou reprise véritable qui rende à nouveau vivant et sous une forme inédite le principe même autrefois au coeur de l’expérience moderne.
2.
Penser le dernier Aragon oblige à considérer ce que fut au cours des années 60 et 70 le dialogue du principal des survivants de l’avant-garde surréaliste avec certains des plus notables représentants de l’avant-garde nouvelle se développant alors au temps du structuralisme. Il y a là un chantier critique d’importance et qui concerne le jeu dans lequel Aragon a choisi à cette époque d’entrer afin de réviser son entreprise littéraire à la lumière de ce que de jeunes écrivains engagés dans un travail expérimental lui rappelaient d’un passé surréaliste qui avait pris pour eux valeur de modèle ou de contre-modèle, en tout cas : de référence.
De ce chantier (où il devrait être aussi question de poètes comme Jean Ristat, Jacques Roubaud, Lionel Ray, de cinéastes comme Jean-Luc Godard, de romanciers comme Michel Butor), on n’envisagera que l’un des aspects, celui qui touche aux relations nouées entre Aragon et les écrivains de la revue Tel Quel — revue fondée en 1960 par Philippe Sollers et qui, au grand étonnement des éditions du Seuil qui l’abritaient, va s’imposer comme le pôle principal de l’avant-garde littéraire française, dans la proximité d’abord du nouveau roman et avec le soutien de Francis Ponge, dans le souvenir des grands dissidents du surréalisme (principalement Artaud et Bataille) puis dans le questionnement de plus en plus insistant des oeuvres majeures alors en cours de constitution dans le domaine de la philosophie et des sciences humaines (Foucault, Barthes, Lacan, puis Derrida ou Kristeva).
De 1958 à 1968 — et ces dates sont déjà porteuses d’une signification politique évidente — d’Aragon à Tel Quel va se trouver engagé un dialogue dont importe surtout le malentendu sur lequel il repose, malentendu qui conduira à une rupture d’une particulière violence au début de la décennie suivante — lorsque l’affrontement entre communistes et maoïstes français prendra le tour que l’on sait. L’expression de "chassé croisé" est certainement celle qui rend le mieux compte de la figure qu’ont tracée ensemble les protagonistes de cette histoire dans le champ littéraire français, figure que détermine essentiellement un certain état du débat politique parmi les intellectuels. De cette expression, le dictionnaire rappelle qu’elle désigne en danse un "pas figuré où le cavalier et sa danseuse passent alternativement l’un devant l’autre" et qu’au sens courant elle s’applique à un "échange réciproque et simultané de place, de situation". Pour rendre compte du phénomène de la bipolarisation, un politologue, Guy Rossi-Landi, usait il y a vingt-cinq ans de cette même expression et en faisait le titre d’un ouvrage consacré à l’histoire de la droite et de la gauche en France depuis 1789.
C’est en ce dernier sens qu’on doit parler de chassé-croisé concernant la brève histoire des relations entre Aragon et Tel Quel : Aragon marquant dès la fin des années 50 le désir — qu’exprimera à sa suite le Congrès d’Argenteuil de 1966 — d’un art moins directement soumis au discours idéologique en faisant l’éloge des jeunes romanciers désengagés de la revue Tel Quel qui, ironiquement, vont, dans le moment même où Aragon appellera les intellectuels du Parti à libéraliser leur position, mettre leur littérature au service d’une cause révolutionnaire à laquelle ils donneront une apparence particulièrement doctrinaire sinon dogmatique. Disons, pour parler le langage du journalisme politique, et même si ce langage s’avère inadapté à rendre compte de la complexité des enjeux esthétiques, que le virage libéral d’Aragon et des Lettres françaises coïncidera exactement avec le tournant radical — en l’occurrence : le ralliement successif au communisme puis au maoïsme — de Sollers et de Tel quel et que ce double mouvement, loin de favoriser un rapprochement des deux camps, va au contraire les conduire à échanger leurs positions, rendant irréversible et spectaculaire leur rupture.
3.

- n°748 du 20 novembre 1958
Le chassé croisé dans lequel vont s’engager Aragon et Sollers, les Lettres françaises et Tel Quel commence en 1958 avec l’article fleuve dans lequel l’auteur consacré de la Semaine Sainte salue le romancier débutant qui, aux éditions du Seuil, vient de signer son premier vrai livre : Une curieuse solitude. Intitulé "Un perpétuel printemps", ce texte d’Aragon est resté assez célèbre pour toutes sortes de raisons. Repris dès l’année suivante (en 1959), il figure en tête de J’abats mon jeu comme si, avec lui, se trouvait fixée d’entrée la position dont tout l’ouvrage va se faire le développement.
Sollers ne manquera pas de citer souvent l’hommage d’Aragon qui, venant redoubler et confirmer celui de Mauriac saluant dans son Bloc-Notes de l’Express l’année précédente son premier texte "Le Défi", marque le moment de ses débuts littéraires et lui fait recevoir, comme il le note avec humour, la double bénédiction du Vatican et du Kremlin.
L’Histoire littéraire a moins retenu l’article d’Aragon signe dans Les Lettres françaises du 12 avril 1962, "D’un Parnasse à bâtons rompus" et dans lequel, évoquant Ponge et Butor, il rend compte du Voyage d’Hiver, le premier roman de Jacques Coudol, jeune écrivain, ami de Philippe Sollers, ayant comme lui publié ses tout premiers textes dans la revue de Jean Cayrol Ecrire et comptant comme lui au nombre des membres fondateurs de la revue Tel Quel. Depuis la parution d’Une curieuse solitude, les choses sont en effet allées vite pour les jeunes gens auxquels les Editions du Seuil, misant sur le succès du premier roman de Philippe Sollers, ont confié la responsabilité d’une revue. La rencontre des nouveaux talents découverts par Cayrol et publiés par Ecrire (outre Sollers et Coudol, Boisrouvray) avec de jeunes journalistes écrivant dans La Table Ronde et dans Arts (Jean-Edern Hallier, Jean-René Huguenin et Renaud Matignon) a permis que se constitue l’ébauche d’un groupe — sinon d’un mouvement littéraire — qui a en l’espace de quelques mois acquis une vraie forme d’existence et de visibilité dans le champ littéraire français.
Aragon parle de la "grâce" d’Une curieuse solitude, du "charme" du Voyage d’Hiver. Par deux fois, il salue la naissance d’un écrivain véritable. Mais surtout, prenant le prétexte que lui fournissent les jeunes écrivains de Tel quel, Aragon par deux fois se justifie d’aimer une littérature que l’on pourrait croire si peu conforme à celle que devrait aimer le grand écrivain communiste qu’il est. A propos de Sollers, feignant de défendre Une curieuse solitude devant les plus sourcilleux des censeurs de son propre parti mais entreprenant surtout de répondre aux critiques que lui avaient values Aurélien ou La Semaine sainte, Aragon fait mine de se reconnaître coupable afin de mieux se disculper :
je commets le crime d’aimer la littérature bourgeoise.
Et encore :
Tout ceci pour dire que je veux bien qu’Aurélien soit de la littérature bourgeoise, mais je vous prie de me laisser tranquillement me plaire à la lecture d’Une curieuse solitude, livre auquel il vous sera certainement plus difficile de donner "un sens social" qu’à La Vie parisienne, dont je vois très bien comment on peut dire sans se troubler que c’est une critique de la bourgeoisie, qui ne va peut-être pas très loin, mais enfin... Eh bien, il faut que je l’avoue : j’aime Une curieuse solitude, et cela sans l’ombre d’une justification "sociale".
Et quatre ans plus tard, au moment même où paraît la monumentale Histoire parallèle de l’URSS et des USA dont l’écriture le força, dit-il, à descendre dans le "tombeau mal fermé de l’histoire", tandis que l’actualité immédiate devrait solliciter seule son attention, Aragon se justifie encore d’écouter une voix nouvelle à laquelle il ne devrait pas prêter l’oreille :
Procès des Barricades, mort de Patrice Lumumba, Bourguiba à Rambouillet, quatrième "spoutnik", assassinat du maire d’Evian... C’est alors que je lus ce livre au cerne vermillon, Le Voyage d’Hiver, de Jacques Caudal... Je vois parfaitement les raisons qu’il y a pour que personne ne s’y intéresse. Il faut être un fou dans mon genre pour tenir pour un événement l’apparition d’un écrivain véritable.
Faisant l’éloge de Sollers et de Caudal (de Jean-René Huguenin également), Aragon sait très exactement ce qu’il fait, jetant son dévolu sur de jeunes écrivains désengagés dont l’inspiration romantique (Aragon compare Sollers à Lamartine) et surréaliste (comme le remarquait à l’époque Michel Foucault, la filiation est évidente [7]) les rapproche de lui, il entend marquer sa solidarité avec une littérature nouvelle dont l’apolitisme revendiqué est l’une des caractéristiques majeures. Contre le magistère sartrien mais sans se résoudre à la dérision faible et au dandysme sans profondeur des hussards, prenant place dans la guerre des revues quelque part entre Les Temps modernes et La Parisienne, Tel Quel, avec pour patrons Ponge et Paulhan, dans le sillage du nouveau roman, cherche à s’engager dans une voie strictement expérimentale où la revue naissante reçoit le soutien inattendu et précieux de Louis Aragon.
4.
Lire l’article que, dans Le Monde du 13 septembre 1967, Philippe Sollers, sous le titre de "Une science de l’anomalie" (voir ci-dessous), consacre au nouveau roman d’Aragon, Blanche ou l’oubli, en comparer le contenu à celui d’"Un perpétuel printemps" permet de prendre la mesure des changements qui sont intervenus en l’espace d’une petite décennie.
L’année précédente a vu Aragon jouer le rôle de premier plan que l’on sait dans la redéfinition de la position culturelle du PCF lors du comité central d’Argenteuil, plaidant pour la liberté sans réserve de la recherche et de la création, contribuant à faire reculer le dogmatisme idéologique et esthétique du communisme français. Simultanément a lieu ce que l’on pourrait nommer le virage politique du telquelisme. Depuis sa fondation, la revue a considérablement évolué, voyant son comité de rédaction entièrement renouvelé, Philippe Sollers restant seul des fondateurs et se trouvant rejoint par des poètes comme Marcelin Pleynet et Denis Roche, des romanciers comme Jean-Louis Baudry, Jean-Pierre Faye, Jean Thibaudeau et Jean Ricardou dont l’orientation littéraire situe désormais sans ambiguïtés le groupe du côté de l’avant-garde. Sous l’effet de toutes sortes de facteurs propres à l’époque (l’hostilité à la guerre du Viet-Nam étant l’un des principaux), Tel Quel se politise et, taisant son enthousiasme immédiat pour la révolution culturelle chinoise, accepte que se nouent des relations plus étroites avec certains des organes culturels du PCF qui, sous l’impulsion du programme d’Argenteuil, sont en train de poser les bases d’une politique d’ouverture en direction des intellectuels et des écrivains de pointe. Toutes les conditions d’un rapprochement sont ainsi réunies auxquels vont effectivement oeuvrer de jeunes écrivains communistes, déjà ou bientôt gagnés à la cause du telquelisme : ainsi Jacques Henric auquel l’amitié d’André Stil a permis de devenir le chroniqueur littéraire de France Nouvelle où il défend la littérature expérimentale ; ou encore, Jean-Louis Houdebine qui, avec le soutien de Claude Prévost, va servir d’intermédiaire entre Tel Quel et La Nouvelle Critique, permettant que dès 1967 semble acquis un ralliement de la revue au camp communiste. La question consiste à savoir sur quelle base théorique et esthétique repose cette nouvelle alliance : c’est parce qu’ils ne sont pas marxistes que les écrivains de l’avant-garde telquelienne apparaissent comme des interlocuteurs souhaitables à un PCF soucieux d’ouverture et d’élargissement ; mais c’est précisément parce qu’ils entreprennent de marxiser leur projet que ces mêmes écrivains de l’avant-garde telquelienne veulent nouer des liens plus étroits avec un PCF dont la politique d’ouverture et d’élargissement va vite décevoir le désir de rigueur et de radicalité.
Le malentendu gît là mais en 1967, il est encore pour l’essentiel inaperçu. La lecture que Sollers propose alors du dernier roman d’Aragon manifeste bien la façon dont le telquelisme peut alors s’imaginer construire une théorie nouvelle de la littérature, susceptible de concilier l’ensemble des pensées de pointe développées sous le signe du structuralisme et relevant d’un marxisme revisité qui permette à la revue de faire cause commune avec le communisme littéraire dont Aragon apparaît en France comme le plus prestigieux représentant en raison et de son passé surréaliste et de son enthousiasme retrouvé pour les formes les plus expérimentales de la création. Rendant hommage à Aragon (dont le nom, écrit-il, figure dans l’Histoire " comme un symptôme majeur, une cause de conflits, de haines et de contresens"), prenant appui sur la réflexion poétique que contient Blanche ou l’oubli, Sollers verse ce roman au compte de la littérature nouvelle dont participent à l’époque ses propres livres (Drame, Nombres) ainsi que ceux des autres expérimentateurs de l’écriture textuelle (par exemple Jean-Louis Baudry ou Jean Thibaudeau). "Machine à interroger la fonction romanesque" et à l’intérieur de laquelle "toute fiction représentative (pseudo-réaliste) est contrecarrée volontairement, démystifiée constamment de façon à reporter l’attention sur le geste producteur lui-même", Blanche ou l’oubli se voit ainsi enrôlé sous la bannière du "matérialisme sémantique" dont Tel Quel, entreprenant de concilier Marx et Mallarmé, construit alors la théorie : une écriture où c’est le texte lui-même qui se prend pour objet et qui se donne comme exploration exclusive des conditions de sa propre production.
Aragon parle

Zoom - 12/09/1967. Interview de Louis Aragon sur le rôle de l’écrivain. Il vient de publier "Blanche ou l’oubli" et commence par refuser de parler de cette oeuvre. Il refuse l’étiquette (sartrienne) d’écrivain engagé (oublié le « réalisme socialiste »). Il écrit ce qu’il pense, c’est tout. Le roman comme la littérature sont des événements et doivent être considérés comme tels. Il revient sur l’affaire Siniavski-Daniel [8], les pays qu’il aime et dont « les gouvernements ont raison sur les faits essentiels ». « On sait quel est le sens général de ma vie, et c’est à la lumière de cela qu’il faut comprendre mes paroles. »

Une science de l’anomalie
par Philippe Sollers
La prétention de la littérature moderne, depuis la fin du dix-neuvième siècle, à cesser d’être un art d’agrément pour se constituer en science, théorique et pratique, en est encore à scandaliser la pensée bourgeoise. Ce scandale porte d’abord le nom de surréalisme (l’accent mis délibérément sur les "exceptions" du langage poétique et l’affirmation d’un rapport fondamental de ces exceptions avec les bouleversements du savoir). Il continue ensuite à inquiéter l’histoire de ces dernières années, histoire où le nom d’Aragon figure comme un symptôme majeur, une cause de conflits, de haines et de contresens qui font apparaître la signification profondément politique de l’événement. Aragon, ne l’oublions pas, est communiste et dirige le seul journal qui manifeste la continuité, l’ouverture et la virulence de ce scandale : sans action de ce genre, on finirait souvent par penser qu’il ne se passe rien dans la "culture" de la société où nous travaillons.
Une question mal posée
Ce travail a ses lieux stratégiques, dont le roman, pour des raisons historiques précises, est l’un des principaux enjeux. Mais la question du roman est le plus souvent mal posée : elle l’est mal par les "nouveaux romanciers" dont les justifications ne quittent pas un niveau individualiste, psychologique ou métaphysique sommaire. Elle l’est mal par la régression classiciste ou "libertine" du néo-surréalisme mondain. Elle l’est encore plus mal par les fonctionnaires installés pour l’éternité dans le dix-neuvième siècle naturaliste et qui continuent à produire une marchandise périmée dans ce code étroit.
Que, dans ce contexte, l’auteur du Paysan de Paris en arrive aujourd’hui à écrire avec une virtuosité incessante des livres comme la Mise à mort et Blanche ou l’oubli prend alors une signification idéologique précise. Le roman s’interrogeant sur sa fonction historique et formelle, sur sa génétique propre ; le roman situé par rapport à la grande aventure intellectuelle de notre époque (la linguistique) ; le roman cherchant, par la dénudation de ses procédés (selon l’expression des formalistes russes), à se faire "sémantique du roman", voilà en effet ce qu’il est intéressant, maintenant, de dégager malgré tous les préjugés obscurantistes. Aragon, sentant et appliquant cette nécessité et cette méthode, montre que son passé, son présent, sont directement liés à l’avenir : "Chaque fois qu’il y a une révolution, en principe, il faudrait changer la grammaire."
"l’homme dans la langue"
Blanche ou l’oubli est une machine à interroger la fonction romanesque, l’arbitraire du récit, et, du même coup, l’histoire. Non seulement son "sujet" est, comme le dit Benveniste, "l’homme dans la langue", — puisque c’est un linguiste qui est censé ici parler devant nous et un linguiste qui peut affirmer : " Nous en sommes venus à une époque ou le linguiste, éprouvant l’insatisfaction d’être limité par les mots, la syntaxe, doit dépasser ce champ d’exploration, considérer les mots dans d’autres combinaisons, plus complexes, de jeu moins immédiat ", — mais encore "l’homme dans l’histoire" conçue non plus abstraitement mais dans sa complexité unifiée de langues, de textes, de luttes sociales.
Cet " homme ", on s’en doute, a peu de chose à voir avec l’entité divinisée sous ce nom par la bourgeoisie, lequel n’était qu’une fonction d’échange et non de production, une fonction parlante et non écrivante. C’est au contraire un opérateur placé entre "les mots et les choses" (le livre comporte une "défense" de Foucault liée à un rappel de l’œuvre capitale de Raymond Roussel), entre la fiction et le réel, devenu conscient des possibilités transformatrices du langage. "L’homm " est un effet historique de production matérielle et de langue, d’écriture et de langue, à la fois objet et sujet, et le roman doit devenir la science de cette anomalie, de cet aléatoire qu’il est : le roman est une "astronomie de l’homme". "Je pratique par les mots, dans les mots, une sorte de vivisection de l’homme. [...] Le langage est l’image que j’ai de moi comme d’un être en marche, les nuances du temps, ma grammaire, et la complexité d’être et de se souvenir, d’être et de devenir."
Le roman, en effet, est capable d’être le "je organisateur du nous", il peut mettre directement en cause la vraisemblance sur laquelle se fonde le récit appelé "vie" et même la science, proposer des hypothèses improbables bientôt ramenées au rang de données, découvrir dans son "hypotexte" les lois du réel qui s’annonce. Il est une lecture de l’histoire au premier et au second degré — dans ses aspects de texte violent : les massacres de communistes indonésiens, la guerre du Vietnam, la France dérisoire de consommation gaulliste avec ses petits problèmes de psychisme, de sexe ou d’emploi ; et de texte esthétique : Shakespeare, Hölderlin, Flaubert — une lecture gagnée sur la censure ou l’oubli, dans la mesure où elle scande la transformation simultanée, indissociable, des mots et du monde. Le roman se change alors en une "étoffe d’intentions, pas même, d’intentions. D’amorces".
Dans ce livre, toute fiction représentative (pseudo-réaliste) est contrecarrée volontairement, démystifiée constamment de façon à reporter l’attention sur le geste producteur lui-même. Il s’agit en effet d’étendre, d’exposer, d’étudier " le cheminement des mots, leur façon de s’accrocher les uns aux autres en dehors d’un vocabulaire, d’un langage reconnu, défini, colmaté. [...] Si vous prenez le récit qui précède au pied de la lettre, cela montre qu’au lieu de tenir le roman pour une explication du réel, vous le confondez avec lui ".
Par l’effet de connaissance appelé "roman", il est donc possible d’en finir pratiquement avec la "croyance" (la crédulité vraisemblable) qui ne répond à aucune exploration réelle du fonctionnement humain. Le roman est l’appareil qui change l’oubli en inoubli, la page blanche de la mémoire en histoire voulue et déterminante, l’entassement livresque en pratique réelle.
Il faut saluer Aragon qui, à soixante-dix ans, peut écrire : "Le grand jeu de mots qui aura été ma vie ", et : "Jusqu’ici les romanciers se sont contentés de parodier le monde. Il s’agit maintenant de l’inventer." Une phrase marxiste, entre parenthèses.
Philippe Sollers, Le Monde du 13 septembre 1967.
5.
Tout se joue en 1968 : en deux temps qui marquent le moment de la plus grande proximité puis celui où apparaît la fissure qui va rapidement décider de l’écart, puis de la rupture entre Aragon et Sollers, entre Les Lettres françaises et Tel Quel. En avril 1968, le ralliement de la revue à la cause du Parti paraît chose acquise : le colloque organisé à l’abbaye de Cluny par La Nouvelle Critique a surtout été l’occasion d’une confrontation des intellectuels communistes avec les principaux représentants de l’avant-garde telquelienne, confrontation à laquelle le journal d’Aragon marque son entier soutien [9] en publiant à la une de son édition du 24 avril un entretien entre Philippe Sollers et Jacques Henric intitulé "Ecriture et révolution". Mais ce sont les événements du mois suivant qui, induisant des réactions en apparence opposées, vont faire apparaître la précarité de l’alliance ainsi nouée. Certes, en toute logique, Aragon et Sollers, l’équipe de Tel quel et celle des Lettres françaises défilent côte à côte lors du grand défilé parisien organisé par la CGT le 29 mai. Mais tandis que Louis Aragon, malgré les réserves et les méfiances de son camp, s’aventure à un dialogue avec les jeunes gauchistes insurgés (et notamment Daniel Cohn-Bendit), les écrivains de Tel Quel, en dépit de leur sympathie pour le mouvement étudiant, choisissent d’adopter à son égard une position de grande intransigeance doctrinale en ne reconnaissant d’autre force authentiquement révolutionnaire que la classe ouvrière conduite par le parti communiste et en se dissociant du mouvement de protestation, jugé trop peu marxiste-léniniste, conduit par des écrivains comme Michel Butor, Jean-Pierre Faye ou Alain Jouffroy, créant alors l’Union des Ecrivains dans les locaux de la Société des Gens de Lettre à l’Hotel de Massa.
Disons que, afin de se démarquer des formes à ses yeux les plus faibles et les plus opportunistes de la contestation, Tel Quel choisit de revendiquer la forme la plus orthodoxe de positionnement révolutionnaire. Le résultat en devient un peu "surréaliste" — au sens commun que l’on donne désormais à cet adjectif — car il place les représentants d’une revue d’avant-garde sur la même ligne apparente que les plus dogmatiques des membres du parti communiste, avec lesquels bien entendu aucun rapprochement n’est véritablement possible. Et en ce sens, la rencontre sous les banderoles de la CGT des jeunes partisans du matérialisme sémantique avec les vieux tenants d’un militantisme ouvriériste et stalinien n’est pas moins belle et incongru que celle, fameuse, du parapluie et de la machine à coudre sur la table de dissection.
Photo Les Lettres françaises, 8 juin 1972 (archives A.G.)

La question tchécoslovaque va agir à la façon d’un révélateur. Déjà en 1966, certains des membres de Tel Quel avaient exprimé leur réticence à s’associer à la vague de protestations consécutive à l’affaire Daniel et Siniavski, considérant qu’il y avait là comme une manoeuvre de diversion organisée par la droite à l’heure où la guerre de Viet Nam devait mobiliser toutes les énergies. On sait qu’Aragon n’avait pas eu de tels scrupules. De même, la condamnation sans ambiguïté par les Lettres françaises de l’écrasement du Printemps de Prague — avec les conséquences que cette condamnation eut — fait singulièrement contraste avec le silence de Tel Quel — dont personne, à l’époque, ne doutait qu’il avait valeur d’approbation tacite [10].
Sollers, Pleynet et l’avant-garde

Enquête sur la revue Tel Quel -
Le Fond et la forme - 19/03/1970.
Pierre de Boisdeffre reçoit Philippe Sollers et Marcelin Pleynet sur le thème de la revue Tel Quel à l’occasion des dix ans d’existence de cette dernière. Philippe Sollers retrace l’histoire des 10 ans d’un travail collectif avec en illustration un extrait d’une déclaration d’Antonin Artaud sur les asiles d’aliénés. Alain Bosquet interroge les deux écrivains sur littérature et communisme. Après la lecture d’un extrait de Pleynet Incantation dite au bandeau d’or [11], Bosquet les interroge sur la difficulté de leurs textes et le manque d’accessibilité de leur littérature.

6.
La rupture de Tel Quel avec le P.C.F, entraînant le ralliement de la revue à la cause maoïste et permettant que s’exprime au grand jour l’enthousiasme immédiat de certains de ses membres (et notamment Sollers) pour la révolution culturelle chinoise, intervient en 1971 suite à deux gestes de censure dont les telqueliens attribuent aux communistes la responsabilité. Le premier de ces gestes concerne l’ouvrage de Maria-Antonietta Macciocchi, De la Chine, publié au Seuil sur l’intervention de Louis Althusser par l’intermédiaire de Philippe Sollers, et qui se voit écarté lors de la Fête de l’Humanité [12].
LIRE
-
Pierre Guyotat, tel quel
notamment les notes
Le second de ces gestes — où va se trouver impliqué Aragon — porte sur le roman de Pierre Guyotat, Eden, Eden, Eden, qu’une décision du ministère de l’Intérieur interdit à l’automne 1971, en raison de son caractère pornographique. Soutenant avec moins d’énergie les écrivains proches de Tel Quel, allant jusqu’à ignorer leurs livres, Les Lettres françaises font paraître un article assez hostile à Guyotat et, tout en condamnant la censure dont son livre est victime, ne reviennent qu’en partie sur l’appréciation réservée qu’il leur avait inspiré, déclenchant la colère de l’auteur et de ses amis de Tel Quel.
L’histoire du chassé croisé Aragon/Tel Quel s’arrête là. Entre maoïsme et communisme, la revue choisit et oblige chacun à se déterminer soit en quittant la revue (comme le feront Thibaudeau et Ricardou) soit en quittant le parti (ce sera le cas de Guyotat, Henric, Houdebine ou Guy Scarpetta). Dans la mesure où Pierre Guyotat a publié dans la collection du chemin chez Gallimard sous le titre de Littérature interdite l’ensemble des documents qui la concernent et que ce volume est assez aisément consultable, il n’y a sans doute pas lieu de revenir à cette affaire. Chaque lecteur peut vérifier dans ces pages la manière dont entre Aragon et Tel Quel les rapports ont spectaculairement dégénéré.
En revanche, il existe de nombreux documents périphériques que l’histoire littéraire a un peu oubliés et qui présentent l’intérêt peut-être un peu anecdotique d’enrichir le volumineux dossier contenant toutes les insultes dont l’auteur du Traité du Style a été l’objet. Avec Sartre peut-être, Aragon a sans doute été le plus injurié des écrivains français et certaines des invectives les plus violentes qui lui ont été adressées sont venues au début des années 70 de l’avant-garde littéraire pro-chinoise. Trois revues satellites de Tel Quel constituent à cet égard une mine d’informations — qu’on jugera selon son humeur réjouissantes ou consternantes. Il s’agit de la revue Promesse — animée par Jean-Louis Houdebine et Guy Scarpetta, et rapidement gagnée à la cause du telquelisme —, de la revue Peinture, cahiers théoriques [13] — où s’expriment les artistes du Groupe Support/Surface et notamment Marc Devade ou Louis Cane — et surtout du Bulletin du Mouvement de Juin 71 [14] — de ces trois publications, celle dont le ton polémique et insultant se trouve assumé sans le moindre état d’âme.
Outre que son caractère excessif lui donne l’allure d’une farce et d’une plaisanterie, la haine nouvelle pour Aragon n’est pourtant pas une haine aveugle et elle ne se dispense pas de toute justification théorique. En une analyse clairement et habilement démarquée du célèbre texte de Mao Zedong intitulé "A propos de la pratique" et dans lequel le leader chinois renvoie dos à dos empiristes et dogmatiques, Sollers introduit pour rendre compte de la position du P.C.F le concept de "dogmatico-révisionnisme" signifiant ainsi que l’opposition apparente au sein du parti de ces deux lignes en principe antagoniques recouvre en fait un accord de fond contre lequel il s’agit désormais de se dresser.
Figure incontestée du stalinisme national puis acteur éminent de la libéralisation intellectuelle du communisme français, Aragon — qui n’est plus désigné désormais par Sollers que comme le "fantoche Aragon-Cardin" — se voit ainsi dénoncé comme l’un des principaux représentants de ce "dogmatico-révisionnisme" et devient dès lors la cible favorite du camp telquelien qui voit en lui le symbole même du "dogmatisme désormais repensé, redessiné et rhabillé par la bourgeoisie à des fins de drugstore".
Aragon parle du PCF

Antenne 2, 19/11/1979. Au cours d’un entretien avec Jean Ristat, Louis Aragon parle de la difficile évolution du Parti Communiste Français pendant les cinquante-et-une années qu’il y a passées, évoque le rôle de Maurice Thorez, la disparition de la revue Les lettres françaises et les « grands cris », selon lui, inutiles de Jean-Paul Sartre.

7.
S’il faut une fin à cette histoire, on pourra la trouver dans le tout premier numéro de la revue L’Infini — qui, en 1983, chez Denoël, succède à Tel Quel. Il se termine par un article consacré par Philippe Sollers à Louis Aragon très récemment disparu, article qui a presque autant valeur de manifeste, de déclaration d’intention inaugurale que le dialogue qui occupe les premières pages de la revue. A vingt-trois ans d’écart, ce texte fait écho à celui, très comparable par son esprit, que Philippe Sollers avait fait figurer au sommaire du premier numéro de Tel Quel pour y saluer la mémoire d’Albert Camus.
LIRE
Avec Camus en 1960, avec Aragon en 1983, pour une revue littéraire qui naît par deux fois, il s’agit bien de dire adieu au grand écrivain tout juste décédé qui, à chaque fois, incarne une époque soudainement révolue et à laquelle il faut désormais dire adieu.
Qu’une page tourne en 1983 dans l’histoire politique et littéraire française, cela est certain. Pourtant, on n’en a jamais fini avec Aragon. Vingt ans après le temps des affrontements et des insultes, dix ans après le temps du deuil et des adieux, à l’occasion du numéro spécial des Lettres françaises de 1992 consacré par Jean Ristat à la mémoire de l’écrivain, Philippe Sollers revient à Aragon, sur Aragon en un long entretien conduisant à cette question : " comment, pourquoi, se sent-on obligé de s’engager contre soi-même ?" D’autres textes suivront qui prendront place dans La Guerre du goût ou dans Éloge de l’Infini tandis que chez d’autres écrivains, collaborateurs de la revue issue de Tel Quel, la question Aragon va reprendre toute sa puissance d’interpellation : ainsi pour moi-même, signant à l’Hiver 1994 dans le numéro 45 de L’Infini un long article consacré à Anicet, pour Jacques Henric comme en témoigne la même année son roman Adorations perpétuelles et en 1996 dans un petit ouvrage autobiographique intitulé C’est là que j’entreprendrai des sortes de romans... et surtout pour Julia Kristeva qui fait d’Aragon, aux côtés de Sartre et de Barthes, l’une des figures interrogées dans les deux volumes de ses Pouvoirs et limites de la psychanalyse : Sens et non-sens de la révolte (1996), La Révolte intime (1997).
A ce retour d’Aragon, disons juste, pour conclure, qu’il n’est pas exclu qu’il y ait aussi une signification politique.
Philippe Forest
Actes du Colloque "Aragon politique" de mars 2004,
publié dans Recherches croisées Aragon / Elsa Triolet - n°11 - « Aragon politique ».
Le texte en pdf

A la mort d’Aragon
Aragon meurt le 24 décembre 1982. Le journal télévisé d’Antenne 2, présenté par Patrick Poivre-d’Arvor, fait retour sur sa longue carrière de poète et de romancier.
Commentaire sur des photographies et des archives : Aragon à la fête de l’Humanité (septembre 1982), Aragon expliquant son engagement politique, en train d’écrire, ou encore avec Elsa Triolet (expliquant les mots célèbres : « Il n’y a pas d’amour heureux »).

Ses obsèques ont lieu à Paris le 28 décembre. Le journal télévisé d’Antenne 2, présenté par Noël Mamère, rend compte de l’évènement. Georges Marchais, secrétaire général du PCF, et Pierre Mauroy, premier ministre, rendent hommage à l’écrivain.

De Tel Quel à L’Infini
La coïncidence des dates est étrange. Faut-il y voir un signe ? Le dernier numéro de Tel Quel (n° 94, Hiver 1982) paraît en novembre 1982. Aragon meurt le 24 décembre 1982 [15]. Le 1er janvier 1983, Sollers publie un article dans Le Nouvel Observateur. Il l’intitule Traité du style, reprenant le titre de l’oeuvre polémique qu’Aragon avait écrite durant l’été 1927, peu après son adhésion au parti communiste, et publiée en 1928 chez Gallimard [16].
Le début de l’article de Sollers, Le Nouvel Observateur du 1er janvier 1983.

Le roman de Sollers Femmes est achevé d’imprimer le 10 janvier 1983 aux éditions Gallimard [17]. Qu’y lit-on ?
« Et qu’est-ce qu’on voit là, tout à coup, devant nous ? Une masse informe, tassée, beige, porté à bout de bras par deux gardes du corps, "ex-jeunes poètes-romantiques-membres-du-parti"... Aragon ! Lui-même... Tel qu’en lui-même enfin l’absence d’éternité le change... Le surréalisme vitreux... Le communisme hébété... »
Le premier numéro de L’Infini sort en mars 1983. Dans l’Éditorial [18], Sollers évoque un certain nombre d’écrivains, plus ou moins embarrassés avec cette histoire d’« infini » (Michaux, Blanchot). Parmi eux, Aragon :
« — Aragon voulait écrire une "Défense de l’infini"...
— Hélas, hélas ! Elsa ! »
En deux phrases, on pourrait considérer que tout est dit.
Mais, évidemment, il est difficile, deux mois après la mort d’Aragon, de ne pas en dire plus sur celui qui, le premier avec Mauriac, avait salué le jeune Sollers. Impossible aussi de passer sous silence les rapports tumultueux des deux décennies précédentes. Sollers republie donc dans L’Infini, non sans provocation (mais Aragon n’en usait-il pas 55 ans plus tôt ?), son article du N.O., cette fois sous le titre : « Aragon ».
Alors Aragon ? Au Paradis ? En Enfer ? Au Purgatoire ? « Le purgatoire in extremis », écrit Sollers. C’est ironique, mais ce n’est pas si cruel : Dante ne mettait-il pas Giotto au Purgatoire ? Et n’est-ce pas là une manière de laisser toute sa chance à la re-lecture de l’écrivain controversé ?
ARAGON

par Philippe Sollers
Écrire sur Aragon ? Redire ce que chacun sait, ce que chacun a ruminé, ressassé ? La tragique et affreusement comique histoire de la sanglante party communiste ? Les éléments positifs, le bilan globalement négatif ? Le quiproquo surréaliste, la scène de ménage automatique Aragon-Breton, sujet de thèse obligatoire dans routes les universités ? Le montage du tableau d’Elsa en Joconde ? La réhabilitation romanesque du réalisme bourgeois ? Les fortifiants de Jdanov ? L’alexandrin résistant ? La France profonde ? Le parallèle trouble avec Drieu, valant comme diplôme d’Etat ? Les dessous des Lettres françaises ? Le Staline en jeune boucher de Picasso ? La colombe de la Paix parlant russe ? L’emphase à tout prix ? Les délicatesses de détail ? L’hugolâtrie prix Lénine ? La fascination de Jakobson via Lili Brik ? Le revolver de Maïakovski ? « Feu sur les ours savants de la social-démocratie » ? « Moscou la gâteuse » ? Le masque de cire ? Le gant de velours ? Le dévouement du prolétariat ? La constance de Ristat ? L’insignifiance de Bérénice ? L’article tonitruant sur moi ? Mon génie ? Ma ressemblance avec Oïstrakh ? La voix hyper-maniérée ? La confusion entre Henry Bataille et Georges, le grand oublié des thés avec Lacan ? Les sacrifices de Marcenac qui pense en direct que les Polonais doivent résoudre leurs problèmes par leurs propres moyens militaires ? La vigilance de Roland Leroy ? La façon de dire « nessa ? » pour « n’est-ce pas » en sifflant entre les lèvres comme s’il y avait encore des Beaux Quartiers ? La pruderie sans défaillance ? Les interminables lectures à haute voix dans le style Sarah Bernhardt ? La dédicace de Mme Triolet au jeune homme que je devais paraître : « A machin, maternellement » ? Le moisi des couples ? Le baiser à Kundera ? Godard ? Brejnev ? Siniavski ? Et encore Brejnev ? Le Biafra de l’Esprit ? La matière du délit ? « Tu comprends, petit, ce qui compte, c’est d’abord de savoir si on plaît aux femmes » ? L’élégance ? La vulgarité ? Le mentir-vrai ? Le faux plus vrai que le vrai ? L’incapacité absolue de dire la vérité vraie ? La tragédie de la bâtardise ? La police comme idéal secret ? L’erreur constante sur le sexe des anges ? L’accord avec Breton contre le libertinage et pour la fidélité en amour, l’amour, l’amour, l’amour, la Femme et l’Amour, et puis ricanement pour finir ? L’inaptitude à l’occultisme dont il est le jouet ? La démagogie spontanée ? Le flirt linguistique ? L’absence totale de Freud ? Le romantisme Géricault ? Les poèmes récités d’avance ? Mieux que Valéry ou Char, en tout cas ? La supériorité sur Saint-John Perse ? L’infériorité rythmique par rapport à Claudel ? L’inexistence pure et simple si l’on pense à Artaud ? Le néant plein d’entourloupettes si l’on s’avise que Céline a eu lieu ? L’incroyable provincialisme franco-soviétique si l’hypothèse que les romans de Faulkner Ont bien été écrits devenait vérifiable ? L’habile transfusion de Matisse ? Fougeron en banlieue ? Mon idiotie de penser qu’il était possible de le déborder sur l’extrême gauche avec l’aide de l’autre Louis non décoré, Althusser, en train de sombrer, lui, dans Dostoïevski ? Le vaudeville charnier des Productions Goulag et Co ? La sensibilité sibylline de Georges Marchais ? Les apparitions de la Vierge à Waldeck Rochet ? La douceur presque féminine et inoubliable de Thorez ? Le manque de Chine ? Le XVIIIe siècle au service du béton ? La surdité musicale ? La capacité rhétorique désormais tellement négligée ? Le Traité du style ? Le Paysan de Paris ? Les langueurs de Fénelon ? Le coup de Ronsard ? Le spectre d’Apollinaire ? Le con énigmatique d’Irène ? Les descriptions ratées, que celles de Robbe-Grillet ne sont pourtant pas parvenues à faire oublier ? La rigueur exsangue de Blanchot ? Les champignons de Michaux ? Les sublimes poubelles de Beckett ? Le bon point qui consiste à nous avoir épargné des pièces de théâtre ? Caligula ? Les Mains sales ? Nekrassov ? Beaucoup de bruit pour rien ? Le mot célèbre de Léon Blum : « Aragon n’est ni à droite ni à gauche, mais à l’Est » ? Le mot non moins célèbre de Paulhan : « Qui attendrait d’Aragon une idée juste ? » Les disques Ferrat ou Ferré ? Des poèmes, toujours des poèmes, encore des poèmes ? L’Aragon ? Un somnifère ? Harengon, comme dit Céline dans Rigodon ? Ma préférence morale pour Mauriac, due à des préjugés de classe indéracinables, d’où mon vote définitif en faveur du vin de Bordeaux et du Vatican ? Ai-je bien tout dit ? N’ai-je rien oublié ? Les morts sont-ils assez indifférents ? Ou vont-ils lui régler son compte ? L’Enfer ? Le Purgatoire ? Le Purgatoire, in extremis, pour avoir écrit ce qui suit :
« Il m’arrive de perdre soudain tout le fil de ma vie : je me demande, assis dans quelque coin de l’univers, près d’un café fumant et noir, devant des morceaux polis de métal, au milieu des allées et venues de grandes femmes douces, par quel chemin de la folie j’échoue enfin sous cette arche, ce qu’est au vrai ce pont qu’ils ont nommé le ciel. Ce moment que tout m’échappe, que d’immenses lézardes se font jour dans le palais du monde, je lui sacrifierais toute ma vie, s’il voulait seulement durer à ce prix dérisoire. Alors l’esprit se déprend un peu de la mécanique humaine, alors je ne suis plus la bicyclette de mes sens, la meule à aiguiser les souvenirs et les rencontres. Alors je saisis en moi l’occasionnel, je saisis tout à coup comment je me dépasse : l’occasionnel c’est moi, et cette proposition formée je ris à la mémoire de toute l’activité humaine. C’est à ce point sans doute qu’il y aurait de la grandeur à mourir, c’est à ce point sans doute qu’ils se ruent, ceux qui partent un jour avec un regard clair.
« Qui est là ? Ah très bien : faites entrer l’infini. »
Ça s’appelle Une vague de rêves [19]. Mon exemplaire est orange grand format, Hors Commerce, Paris, sans aucune mention d’éditeur. La dédicace, subtilement séductrice, dit : « Ce petit livre, d’un de ses cadets. Affectueusement. Aragon. » On venait de se rencontrer, je crois.
Ph. S., Le Nouvel Observateur du samedi 1er janvier 1983.
L’infini n°1, Hiver 1983.
Les Lettres françaises, mars 1992 (archives A.G.)

Voici l’article célèbre (20 novembre 1958) sur le premier roman d’un jeune écrivain de 22 ans, Philippe Sollers, dans lequel Aragon « remercie l’auteur d’Une curieuse solitude de [lui] permettre un instant de revoir la jeunesse du monde avec ses "yeux chinois" » (sic) et en qui il voit un « violoniste » qui n’a peut-être pas « encore la pleine maîtrise de l’instrument, mais » qui « à la première fois qu’il se fait entendre, » a déjà « l’attaque qui ne trompe pas, la pureté du son... »

Je n’ai jamais rien demandé à ce que je lis que le vertige : merci à qui me fait me perdre, et il suffit d’une phrase, d’une de ces phrases où la tête part, ou c’est une histoire qui vous prend. Aucune règle ne préside à ce chancellement pour quoi je donnerais tout l’or du monde. J’ouvre un livre, et je tombe sur deux lignes qui l’anéantissent, car, après cela, qu’en entendrais-je ? Rien ne m’y paraît plus égal à ce qui m’a frappé, j’abandonne ce contexte de pages et de pages pour une parole résonnante en moi, qui se prolonge. Et aussi bien dans le roman que dans le poème, prose ou vers, c’est tout un : ils sont rares les auteurs qui peuvent me garder, ayant eu l’imprudence de trop bien écrire une chose dont ils n’ont su se retenir, de s’abandonner avec trop de bonheur à leur propre musique, et voilà que cet accord me cache la symphonie. Ainsi, comment t’écouterais-je, ô Phèdre ! Au-delà de l’ombre des forêts, qu’est-ce que je retiens de ta chanson, Valmore, à cause du refrain :
« Beaux innocents morts à minuit,
Éteignez mon coeur qui me nuit... »
et, maître des incipit, c’est Baudelaire même qui m’interrompt au premier vers de ses poèmes, tant je crains après ce vers-là de descendre. La beauté d’une première page tue un roman, un éclair dans la prose la déchire, et combien de fois me suis-je arrêté dans la tragédie d’All for love, pour arriver au dernier vers — Nuls amants ne vécurent si grandement ou si bien ne moururent...
« No lovers liv’d so great, or dy’d so weil... »
Mais avant que si bien ne mourussent Antoine et Cléopâtre, trop de fois mon regard s’est levé de l’écriture admirable, j’ai mis des années à lire ce que Dryden avait rêvé qu’une soirée me fit entendre. Je n’arrivais pas à passer ce début du troisième acte où Marc-Antoine, retour du combat, entre chez la reine d’Égypte, disant : « J’ai pensé à comment ces bras blancs allaient m’envelopper, — Et me serrer étroitement, et me fondre d’amour ; — Si content de cette douce image, je bondissais de l’avant, - Et j’adjoignais toute ma force à chaque coup porté... », Et que, de toute ma décision, j’eusse outrepassé ces vers, une vingtaine encore, après eux, je me heurtais à ce que ce soldat dit à la reine :
« There’s no satiety oflove in thee... »
(« Il n’y a pas satiété d’amour en toi :
— Quand tu jouis tu es encore neuve ; un perpétuel printemps — Est dans mes bras... »)
Voilà la supériorité des arts visuels : le tableau s’embrasse d’un coup d’oeil, le film contraint à l’attention parce qu’il continue à l’écran... il force notre rêve, il entraîne, lui.
Je me disais tout ceci, l’autre soir, au cinéma, ramené perpétuellement à Dryden : on donnait Les Amants. J’ai lu dans les journaux ce qu’on en dit. Pour et contre. Tout cela est bien grossier, cela sent la fumée froide dans l’étoffe des vestons, il y a des critiques qui se prennent pour le jeune premier, tous ne sont pourtant pas si stupides... mais, que voulez-vous, ils parlent de ces choses comme on fait entre hommes. Ah ! cela lève le coeur.
« No loyers liv’d so greal, or dy’d so well... »
Trop facilement les doigts gras marquent sur la chair. On n’aura pas dit ce qui est : que le film de Louis Malle, c’est quelque chose comme L’Invitation au voyage. Il paraît qu’il y a des gens qui sifflent. Mais ce soir-là où j’ai vu Les Amants, la salle était habitée d’un merveilleux silence. Les Français n’ont pas perdu le sens infini de la pureté.

Je voulais parler du roman. Voilà comme je suis. Qu’on ne s’y trompe pourtant pas, ceci est écrit à propos d’un roman, d’un roman auquel je pensais, mais dont je me suis mis à écrire, ayant déjà un peu dérivé de lui. Il n’est pas sans attache, sans parenté avec ce dont je parlais, Les Amants ou All for love. Il est plus simple de dire tout de suite que ceci est parti d’Une curieuse solitude de Philippe Sollers. Comme cela, je pourrai n’importe quand, et sans artifice, y revenir.
[Aragon évoque ensuite un roman de Michel Zéraffa, « la littérature du XIXe siècle, la grande », certains aspects du Nouveau roman, puis...]
Non, ceci ne m’écarte pas de Philippe Sollers, mais m’y ramène. Parce que l’étrange, avec lui, c’est que ce qui chez les autres est affaire de maturité, est ce qui frappe à son premier pas, à ce début, peut-être trop éclatant, trop heureux, avec le cri qu’il a arraché d’abord à François Mauriac, et qui, bien sûr, pouvait agacer les critiques, les rendre injustes. Cela a bien failli m’arriver, j’en conviens. D’ailleurs, Le Défi, ce petit conte que nous avions couronné au début de l’année, le Jury Fénéon, et qui avait valu à son auteur cette reconnaissance, à vrai dire ne valait pas le bruit mené. N’empêche que Mauriac avait entendu venir cet enfant, qui, déjà à son premier vrai livre, est un écrivain : ne lui marchandons pas notre gratitude.
« Un perpétuel printemps... » dit Antoine. Je suis parvenu à cet âge où l’on attend le printemps de l’année, doutant un peu plus chaque fois de le revoir. Au fur et à mesure que l’on avance dans la vie, l’écoulement du temps change de caractère, tout se passe comme s’il fuyait plus vite et l’on a du mal à retrouver cette épaisseur des jours qui est la jeunesse, cette lenteur merveilleuse de la vie. C’est la première remarque que je fais d’Une curieuse solitude : le temps des jeunes gens ici retrouvé, ne voilà-t-il pas que, m’interrompant dans ma lecture, je me surprends à croire qu’il a, dans l’histoire contée, passé toute une vie, quand l ’histoire au plus a traversé huit jours. Non que les pages aient été nombreuses. Le récit est rapide, sans surcharge. Non, cela vient de moi, de la discordance entre ce printemps et l’automne. C’est d’abord par là que Philippe Sollers m’émeut. Bien entendu, nous sommes sensibilisés au printemps, et peut-être que cette beau- té qui me semble émaner d’un texte, où j’entre comme dans un jardin secret, touffu, ce n’est que la beauté du diable.. Je l’ai cru pendant quelques pages, c’est que je me défendais encore.
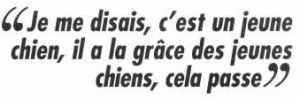
Je me disais, c’est un jeune chien, il a la grâce des jeunes chiens, cela passe. Au fond, ce n’est pas sa jeunesse, ici, que je me prends à suivre, mais la mienne. Je lis cette assez simple histoire, je crois la lire au moins, je souris de ses maladresses, il y a tout de ce que je sais mieux que l’auteur, mais cela ressemble, comme cela ressemble à ma propre jeunesse... Rien, même après les années, ne se ressemble plus qu’une jeunesse et une autre jeunesse. Est-ce que je m’intéresse vraiment à ce Philippe de seize ans qui ressemble à l’auteur comme un frère, ou à moi-même, à cette enfance de moi- même ? Pourtant, à prendre les choses par l’extérieur, qu’avons-nous de commun, rien, ni des conditions de vie, ni du costume, ni des amitiés : ce Philippe, étrangement seul à cet âge, on ne voit même pas cette famille autour de lui, avec laquelle il vit pourtant, personne, que lui et la femme qui est comme par hasard entrée dans sa vie. Il n’y a pas de monde autour d’eux. Il n’y a ici de place que pour l’émerveillement de l’amour découvert. Rien d’autre. Et peu à peu me voilà envahi par ce parfum, par ce chant, cette histoire transparente, comme une eau fraîche après une longue marche.
Voyons. Tout cela est bien subjectif. ce n’est pas une façon de parler d’un livre. À vrai dire, je n’en parle pas encore. Je rêve autour. Et déjà quelle vertu, quelle force d’incantation dans ces mots parcourus, s’ils ont cet effet de me ramener à mon propre printemps...
On dit : « de mon temps... » ou : « nous autres... » Ce sont les différences qui d’abord saisissent, entre les générations. Oui, nous ne portions pas de blue-jeans, nous coiffions autrement nos cheveux. mais en passant, je vous l’avoue, même le décor changé, tout ce qu’on me dit des jeunes gens d’aujourd’hui, pour peu que j’oublie en quoi résident les modifications du décor, fait pour moi renaître les miens, ceux avec qui j’ai eu vingt ans. Tenez, je regardais un film, Les Tricheurs : tout cela, paraît-il, si daté, si « années cinquante »... eh bien ! tout à coup, pendant la réception chez cette fille « du monde », qui a ouvert sa maison aux Tricheurs, à ces garçons qui versent tous les vins, les alcools ensemble, mêlent les bouteilles, vous savez ? je me retrouvais dans les années vingt, place des États-Unis, chez Marie-Laure de Noailles qui avait abandonné sa maison aux surréalistes pour y voir un film de Bunuel, les salons, ce buffet saccagé par les jolis goujats que nous étions. Il n’y a pas grand-chose de changé sous les lampes électriques. Même cela, c’est toujours un phénomène du printemps, du perpétuel printemps.
La beauté du diable... on voudrait bien nous faire prendre la jeunesse pour le diable, c’est rassurant pour ceux que leurs miroirs attristent. Il y a plein de lieux communs sur la jeunesse pour rassurer ceux qui ont perdu la leur. Et pas tous comme Rimbaud :
« Par délicatesse
J’ai perdu ma vie... »
Les Tricheurs, c’est un de ces lieux communs-là, un lieu commun parfaitement monté, mais un lieu commun. Pas beaucoup plus... On me dira : « Pourtant cela a fait trembler en vous un souvenir ! Alors, dites donc ? les surréalistes.. c’étaient aussi des Tricheurs ? » Oh non ! Justement. Il y avait la vie de chacun, et même quand cela avait l’air de ressembler... je pense à la rue du Château quand y habitaient Tanguy, Duhamel et Prévert... mon Dieu, comme nous ne trichions pas ! Et puis nous aimions quelque chose dans la vie, la peinture, les poèmes. Avec cette pudeur blasphématoire, bien sûr. Oh non ! cela ne ressemblait pas. Si bien qu’entre nous je doute un peu que cela ressemble vraiment à la jeunesse d’aujourd’hui, au-delà de la convention, des blue-jeans, ceux qu’on se passe sur les jambes comme ceux qu’on se met sur les sentiments. Tenez : Philippe Sollers, son livre, c’est exactement le démenti aux Tricheurs. C’est peut-être pour cela que si profondément j’en ressens en moi les harmoniques. Parce que je n’aurais pas aimé qu’on parlât de ma jeunesse comme on fait de cette jeunesse en blue-jeans, qu’on parlât des miens à coups de lieux communs, même parfaitement mis au point, polis, montés sur roulement à billes.
On s’étonnera peut-être dise, avec une telle insistance, les miens, parlant des surréalistes. On sait assez ce qui nous a séparés, la violence, les injures, les attaques. Oui. Pas de ma part, n’avez-vous pas remarqué ? Pas une fois depuis trente ans bientôt. Croyez-vous que ce soit le hasard ? Je n’aime pas qu’on parle d’eux d’une certaine façon, je ne m’y suis jamais associé. Bien qu’ils aient beaucoup fait pour me le rendre difficile. Pour moi, tous les moyens ne sont pas bons, qu’y puis-je ? c’est mon caractère. La vie nous a séparés, dressés les uns contre les autres, tel qui d’abord était de ceux qui me crachaient au visage est venu me rejoindre, comme Paul, sur la tombe de qui j’ai été hier, un soir de ce Paris 1943 où « nous nous sommes aimés... » soudain nous accueillant avec Nouche à la gare de Lyon avec des fleurs pour Elsa, et une grande tarte que nous avons mangée ensemble dans notre planque du boulevard Morland. Mais je dis tout ceci aussi pour ceux qui ne me rejoindront jamais, pour ceux qui m’insulteront encore. Tous. Les nouveaux venus qui ne me connaissent pas, et les anciens amis de ma jeunesse. Ils ne pourront jamais faire que je ne pense pas à eux comme aux miens. Même avec entre nous les abîmes politiques, que je ne suis pas prêt à franchir. Je l’ai écrit quelque part :
« ... Mais j’aurai beau savoir comme on dit à merveille
Quelles gens mes amis d’alors sont devenus
Rien ne fera jamais que je prêle l’oreille
À ce que dira d’eux qui ne les a connu
.......................
Je jure qu’au départ c’était comme une eau pure »
Je ne m’en dédis pas. J’ajoute que je ne choisis pas dans mon passé, dans notre jeunesse. Je me souviens que l’un d’eux, André Breton pour le nommer (il y a longtemps que cela ne m’est pas arrivé), dans ces heures tragiques, je vous jure, où les choses entre nous se déchirèrent, parce que j’étais devenu communiste, que je voulais être fidèle à la parole donnée, me disait avec l’amertume du défi : « Mais quand la question se posera pour toi, Rimbaud, Lautréamont, est-ce que tu pourras les défendre devant ton parti ? » Cela semblait alors l’évidence de l’impossibilité. Eh bien ! alors, répondre n’était que d’intention, et je n’ai pas répondu. Mais au bout de trente ans on peut voir, et que pas seulement pour Rimbaud, Lautréamont, ce qui est devenu (et un peu à cause de moi) facile dans mon parti, j’ai toujours défendu le ciel de ma jeunesse. Je ne suis pas de ceux qui jettent la poésie par-dessus bord, les jours de fatigue. J’irai aujourd’hui jusqu’à dire, quand le surréalisme à son tour comme toute chose, s’est « classé », est devenu à la mode, entré dans les anthologies, qu’on ne rend pas justice à André Breton, comme poète, et pour la prose qu’il écrit [20]. On ne dit pas, ce qui est pourtant vrai, tandis que n’importe qui, n’importe quoi est porté aux nues, que ce langage aura été l’un des plus purs qu’on ait écrit dans notre pays. Même s’il aura trop souvent servi à ce contre quoi je donnerais ma vie.
Mes chers amis, Mérimée, c’était encore simple. Ma génération aura posé d’autres problèmes, et il faudra bien pourtant un jour considérer que ceci aussi est partie de l’héritage. Ou jetez- moi aux orties avec.
Bon : mais Philippe Sollers ?

La jeunesse n’a point tant changé qu’on croit. Du moins de notre vivant. On la juge toujours un peu comme ce père des Parents terribles, non pas ceux de Jean Cocteau, mais ceux de Gavarni, 1846, au Charivari, qui dit à son fils : « — Et moi, je défends qu’on ait de ces moustaches-là... sous aucun prétexte ! » Si la mode d’une génération est de se raser, que voulez-vous donc que fasse la suivante, sinon de se laisser pousser le poil ? À ces différences près, les printemps se suivent et se ressemblent. J’ai peur le plus souvent de juger ceux-là qui prennent leur tour en ce monde, comme ces vieux bonshommes que cela fâchait que nous ne portions point de bretelles vers 1920. Et ce n’est pas la critique, pourtant bienveillante, d’Une curieuse solitude qui me rassurera. Je voudrais parler de Philippe Sollers comme si j’étais de son âge. Et non pas lui distribuer des bons points. On compare son livre un peu à tout, aussi bien pour en dire du mal que pour le louer : Barrès, Radiguet, Proust... Si j’étais lui, cela m’irriterait. Eh bien sûr qu’il y a dans cet amour de seize à vingt ans du Diable au corps, dans ce passage sur Tolède quelque chose de barrésien, quant à Proust ces temps-ci il n’y a presque pas d’écrivain qu’on ne lui compare. Faut-il pourtant, à toute force, comparer ? Alors, moi, ce sera à Lamartine : c’est-à-dire à Graziella. Et ne me dites pas que cela fait sujet de pendule : la Concha de Philippe Sollers n’est point l’innocente enfant de Procida, bien sûr, et le roman ici entre dans ces détails qu’au temps de Lamartine on ne donnait pas de l’amour. Pourtant, là comme ici, ce qui me charme ou m’a charmé, c’est cette transparence. Je disais des Amants, cette pureté. De cela, il faut se faire une idée, il y a quelque chose de changé à la fois dans la société et la façon que nous avons de parler de l’amour. Aussi ne puis-je me résigner à résumer le sujet si simple du roman : les critiques diront, allant au plus rapide, qu’il s’agit d’un jeune garçon qui couche avec une bonne de sa mère, et voilà l’affaire étiquetée, les amours ancillaires, ça nous connaît. Il n’y a presque rien de plus au vrai dans le livre, mais quand on a dit cela, on n’en a rien dit. Parce que le cristal, vous pouvez en effet parler de sa transparence, mais non pas le décrire. Et cette façon pesante de ramener l’affaire à un cas connu me donne honte. À cause de cette clarté dans les yeux de l’enfant qui parle, ses yeux chinois comme dit Concha :
« Si tu n’es pas aimé maintenant — ajoutait-elle avec tristesse — quand le seras-tu, ojos chinas (yeux chinois) ? Mais qu’ai-je à faire de t’aimer ? »
Le miracle justement est que tout ce qu’il y a de mesquin, de facile, de vulgaire dans la situation du jeune homme qui couche avec la bonne, c’est la grâce de Philippe Sollers qu’il ait si totalement su l’éviter. Ce jeune bourgeois, comme on dit ici et là, n’a rien des préjugés anciens, rien de ce monde d’où il ne sort même pas. Il est pourtant à cet âge ingrat dont parle Lamartine :
« J’étais à cet âge ingrat où la légèreté et l’imitation font une mauvaise honte au jeune homme de ses meilleurs sentiments,’ âge cruel où les plus beaux dons de Dieu, l’amour pur, les affections naïves, tombent sur le sable et sont emportés en fleur par le vent du monde. Celle vanité mauvaise et ironique de mes amis combattaient souvent en moi la tendresse cachée et vivante au fond de mon coeur. je n’aurais pas osé , avouer sans rougir et sans m’exposer — aux railleries quels étaient le nom et la condition de l’objet de mes regrets et de mes tristesses... »
Ces mots de l’auteur de Graziella, après les avoir lus, qu’on lise Une curieuse solitude : c’est le moyen de mesurer ce qu’il y a vraiment de changé dans le monde. Le jeune homme d’aujourd’hui, s’il ne s’agit plus avec lui de l’amour pur, mais d’un amour vrai où la part physique est grande, et avouée, et décrite, il ne comprend même plus qu’on puisse rougir du nom et de la condition d’une Concha. Ce jeune bourgeois, comme vous dites, et précisément. Ceux qui se prévalent de l’âge, de l’expérience et du goût pourront peut-être se choquer que les amants ici ne leur cachent rien, et peut-être une ou deux fois outrepassent-ils les limites de l’indiscrétion... mais votre pudeur là-devant, il faut bien le reconnaître, est en train de devenir légèrement comique, dans un monde où l’on ne parle plus de ces choses comme il y a vingt ou trente ans. Il y a des lecteurs qui ne retiendront de ces amants-là que l’indécence, moi ce qui me frappe en eux, c’est une décence tout autre, qui ne relève plus des conventions anciennes. Choquez-vous qu’on fasse l’amour dans les romans des jeunes gens d’aujourd’hui, il y a parfois de quoi, parce que précisément ce n’est point l’amour. Le merveilleux amour de la jeunesse, avec sa curiosité neuve, et ses yeux chinois. La convention ici des « amours ancillaires » est tombée avec cette pudeur des choses physiques. Voyez à la dernière minute du livre, quand Philippe raccompagne Concha, placée à Paris, et la regarde de la rue monter dans l’escalier de service :
« Mais comme l’escalier de service donnait sur la rue par des fenêtres à verre dépoli, je pus encore distinguer son ombre qui montait la tête rejetée en arrière, lentement, comme si sa mission terminée, elle se fût trouvée fière ou encore comme si elle fût montée, grave, à quelque sacrifice. Ses longs cheveux faisaient derrière sa tête une ombre plus dense, plus émouvante. Je sifflai. Elle m’entendit, agita la main que je vis en transparence. La fenêtre de l’étage suivant était ouverte et j’espérai la voir lorsqu’elle l’atteindrait. Mais, brusquement, la minuterie s’éteignit, et Concha disparut tout à fait... »
Peut-on imaginer négation plus profonde, plus définitive, de la fausse honte de l’amant de Graziella ? Pourtant il y a, entre l’un et l’autre héros, une certaine parenté d’atmosphère, qui demanderait pour être sentie, qu’on fit ce que je viens de faire, qu’on lût ces deux romans d’époques incomparables l’un après l’autre, coup sur coup. Et la merveille est que l’un me fasse douter de l’autre, encore qu’on donne facilement raison à Lamartine, s’il s’écrie :
« Ah ! l’homme trop jeune est incapable d’aimer ! Il ne sait le prix de rien... L’amour vrai est le fruit mûr de la vie. À dix-huit ans, on ne le connaît pas, on l’imagine... »
Peut-être, mais ici, ah, qu’on l’imagine bien ! Quels que soient le nom et la condition de Concha. J’ignore, au vrai, si cet enfant Philippe sait le prix de quelque chose : mais quand il décrit une femme, Concha ou cette Béatrice, une amie d’enfance après le mariage qui lui donnera une nuit et un matin, les imagine-t-il seulement ? Et personne qui aura lu ce livre n’oubliera ce dernier regard sur l’escalier de service où monte Concha. Cette poésie sans draperies, sans affectation, simple, mesure l’espace de la Procida lamartinienne à cette rue de Paris — je n’ai jamais séparé — le fait de vivre de celui d’éprouver du plaisir... Le même ingénument qui disait :
« Une femme je ne pouvais la concevoir que possédée... »
Tiens, nous ne parlons plus même langage, mon cher Lamartine, et quand dirait-on ces choses-là, sinon à dix-huit ans, avec des yeux chinois.
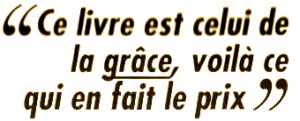
Ce livre est celui de la grâce, voilà ce qui en fait le prix, l’auteur, à dix-huit ans ou à vingt-deux, le sache ou non. Il est extrêmement malaisé d’en parler, parce qu’on ne peut aucunement démêler l’un de l’autre le Philippe du livre, et celui de la vie. Une curieuse solitude est écrit sur le ton de la confidence, et c’est peut-être là ce que ce roman a de lamartinien. L’auteur a tout fait pour cette confusion, si bien que si l’on parle de son héros voilà qu’on a l’air de parler de lui : tous deux sont de quelque part près de Bordeaux, d’une région de vignes, leurs familles se ressemblent, ils ont même âge et cela a quelque chose de gênant de parler de ce portrait quand le modèle vraisemblable est là, vivant. Il faut bien pourtant que Philippe Sollers ait un peu faussé l’histoire, ou le mari de Béatrice aurait drôlement pris ce roman. C’est le contraire du livre stendhalien où l’on cherche à savoir ce qui est emprunté à la réalité, où derrière les personnages on a la tentation de rechercher le « pilotis » : ici, on se demande non pas ce qui est vrai, mais ce qui est faux, arrangé. C’est fort difficile à dire. Et il faut craindre de simplifier : le Felipe de Concha est sans doute, et n’est pas, le Philippe, « né le 18 novembre 1936 à Talence, dans la banlieue bordelaise ». Peut-être en va-t-il de la création romanesque comme dit Lamartine de l’amour : elle est le fruit mûr de la vie, et à dix-huit ans... Ou à vingt-deux. Je ne vais pas lui demander grossièrement : « Alors, c’est vous Felipe ? », car même s’il me répondait c’est moi, je ne serais pas obligé de le croire. Ni à rebours.
Quand j’ai écrit Aurélien, j’ai été pris entre les feux de deux sortes de lecteurs : les uns qui voulaient à toute force, contre l’évidence, que je fusse Aurélien, les autres qui y reconnaissaient Drieu. J’avoue que jusqu’à aujourd’hui, entre ces deux maux, je ne sais comment choisir le moindre. Il est vrai qu’Aurélien est né de moi, et qu’il a des traits de Drieu, que j’y ai pensé, mais je n’ai pas dit plutôt l’un ou l’autre que je m’en repens. M- Bovary n’est ni Flaubert, ni la pharmacienne de Trouville. J’ai pris toutes les précautions oratoires : rien de ce qui fait la vie d’Aurélien ne ressemble à ma vie, et me relisant ces jours-ci (un critique avait dit de ce roman un bien qui m’a surpris), j’ai trouvé une phrase fort suspecte, touchant Drieu. C’est quand Aurélien dit à sa femme de ménage : « Mme Duvigne, vous n’avez pas de pharmacien dans votre famille ? » Parce que Drieu avait un oncle pharmacien, et que ça l’agaçait qu’on le sût. Pis que d’avoir couché avec la bonne pour le beau monde qu’il fréquentait. Ai-je inventé cette question à Mme Duvigne pour camoufler le pilotis, ou pour le souligner ? Ma foi, je n’en sais rien. Mais je pense que, quand il a lu cette phrase, Drieu a dû se sentir concerné. On dit qu’il a passé le dernier jour de sa vie à lire Aurélien. Il n’y avait en tout cas rien de blessant pour lui dans ce livre, dans ce personnage d’Aurélien, ni ce qui lui ressemblait, ni ce qui lui était évidemment étranger. C’est que, quand je pensais à lui, je ne pouvais voir que cet ami que j’avais eu, non ce qu’il avait pu devenir ensuite. Aurélien, par rapport au vrai Drieu, est une image faible. Qui a perdu la violence de cet homme, devenu un inconnu pour moi, lequel s’est fait si singulièrement le thuriféraire de Doriot. Une image faible, humaine. En cette dernière journée, habité de l’idée du suicide, le vrai Drieu n’aura rien pu trouver dans cette image de ce que lui eût montré le moindre miroir. Nous ne nous parlions plus depuis des années. Voilà qu’à cet instant il s’est fait entre nous un échange involontaire d’idées. Il est mort. Je n’ai jamais dit mot de lui, depuis. Ce n’est pas que je lui pardonne un mal qui ne me concerne pas seul. C’est autre chose. Il y a Aurélien entre nous : qui n’avait pas de pharmacien dans sa famille.
Justement, comme je voulais parler du livre de Philippe Sollers, j’en ai été détourné par une autre lecture. Un livre de Bernard Frank qui se sépare entre Sartre et Drieu. Ce Drieu-ci ne ressemble ni à celui à qui je ne puis pardonner, ni à l’autre, qui fut mon ami. C’est plus compliqué encore que pour les héros de roman. On est en train de bâtir une légende Drieu. Il n’est pas sûr sur Drieu en soit le pilotis. Le Drieu qui a choisi le suicide. Et moi j’ai donné à Aurélien un autre avenir. Il est devenu un homme de Vichy dans cette partie des Communistes que je n’ai pas écrite, et n’écrirai sans doute jamais. Un homme de Vichy moyen... de ceux-là qui n’ont pas eu à opter pour le suicide (et à qui dans les jours où nous sommes il faut des héros légendaires pour en oublier d’autres). C’est que décidément Aurélien n’est pas Drieu. Mais un personnage de roman. Un vrai personnage de roman ne peut se permettre ce schématisme de pensée qu’on ne songe pas à reprocher à l’homme de chair et de sang.
Allons, c’est trop difficile. Je n’essayerai pas de séparer Felipe de Philippe Sollers. Dans ce livre-ci, ce ne sont pas les cancans qui m’intéressent.
On me disait déjà d’Aurélien, avec ce visage offusqué des gens qui savent et vivent hors du péché, mais comment, comment avez-vous pu écrire cela de 1941 à 1943 ? dans un pareil temps n’y avait-il pas mieux à faire ? C’est une des formes de ce cant, dénoncé par Byron et avec lui par Stendhal : je méprisais alors de répondre que, dans ce temps-là, j’avais écrit, et fait, autre chose. En fait, on voulait dire que dans Aurélien la lutte des classes ne tient pas la place qui lui revient. À cela, aussi, il faut mépriser de répondre. J’ai également entendu dire ces jours-ci que La Semaine sainte est de la 1ittérature de fuite, fuite dans l’histoire, devant les problèmes de la guerre d’Algérie, et que son héros, si peu positif, Théodore Géricault, à la fin, fuit à son tour dans la peinture (comme s’il eût dû plutôt se faire terrassier, comme si peindre pour un peintre ce n’était pas le contraire de fuir !). Mais au vrai ces manifestations du cant moderne se résument à une accusation plus précise, que ne peut que renforcer le bien que je dis, ou vais dire du livre de ce jeune bourgeois, Philippe Sollers. C’est qu’Aurélien, c’est de la littérature bourgeoise, c’est que je commets le crime d’aimer la littérature bourgeoise.
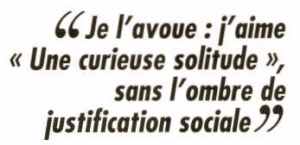
Eh bien, quoi ? Mérimée ou Baudelaire, ce n’était pas de la littérature bourgeoise ? Et tout le reste de la littérature, de la Complainte de sainte Eulalie à Paul Éluard, c’était de la littérature prolétarienne ? Il faudrait manier les mots avec un peu plus de sérieux. Il y a quelque chose de grotesque dans ce cant-là, qui, sous ce respect confit de la « lutte des classes », se fait l’héritier de la confusion romantique de l’emploi du mot bourgeois. Et donc, en vérité, Philippe Sollers est un jeune bourgeois, et pas un métallo. Fabrice dei Dongo ou Frédéric Moreau n’étaient pas syndiqués non plus. Il est vrai qu’il y a encore des gens que leurs convictions empêchent de lire La Chartreuse de Parme ou L’Éducation sentimentale. Étonnez-vous qu’ils n’aient pas de langage commun avec vous ou moi !
Voilà que je tombe dans mes petits travers : l’affaire n’est pas si simple, et une sottise ne doit pas faire oublier la sottise inverse. Dans ce même numéro que j’ai cité des Cahiers de la Compagnie Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault, Jean Duvignaud part en guerre, à propos de La Vie parisienne, pour la défense du "théâtre bourgeois" en s’autorisant de Marx : « Si demain au lieu de perdre son temps à s’indigner, un dramaturge tentait de maîtriser les formes actuelles du "théâtre bourgeois" et, renversant la vapeur, essayait d’utiliser les ressources qu’il contient, un jour nouveau se lèverait... » Un jour nouveau ! Allons, voilà encore une révolution en perspective où le théâtre de boulevard, récrit au bien, servira à abattre le capital. À la prochaine rentrée d’octobre sans doute...
(Tout cela pour se torturer l’esprit afin de pouvoir en toute bonne conscience déchirée assister à un des plus charmants spectacles qu’il soit, cette ravissante soirée que fait La Vie parisienne, comme l’a montée Jean-Louis Barrault, à laquelle les tenants, d’hier ou d’aujourd’hui, du cant de la lutte des classes ne peuvent se plaire directement sans des contorsions explicatives à leurs propres yeux touchant leur soudaine faiblesse pour le « théâtre bourgeois ».)
Mais soyons sérieux : la lutte des classes n’est pas entre le boulevard et l’avant-garde qui considère le boulevard comme bourgeois. Et il n’y a pas de doute que la Commune de Paris si elle eût été victorieuse, au bout de quelques temps on eût recommencé à jouer Offenbach, Meilhac et Halévy sur les théâtres d’État, pour le plus grand plaisir de l’ouvrier français, qui dansait le cancan et danse le cha-cha-cha, sans que cela touche le moins du monde au programme de ses revendications.
Tout ceci pour dire que je veux bien qu’Aurélien soit de la littérature bourgeoise, mais que je vous prie de me laisser tranquillement me plaire à la lecture d’Une curieuse solitude, livre auquel il vous sera certainement plus difficile de donner « un sens social » qu’à La Vie parisienne, dont je vois très bien comment on peut dire sans se troubler que c’est une critique de la bourgeoisie, qui ne va peut-être pas très loin, mais enfin... Comme Les Amants, par exemple. Eh bien, il faut que je l’avoue : j’aime Une curieuse solitude, et cela sans l’ombre de justification « sociale ».
« Que nous étions heureux ensemble lorsque nous pouvions oublier complètement qu’il existait un autre monde au-delà de nous... » Ne vous fâchez point : c’est une phrase de Lamartine. Mais pour Felipe et Concha, encore que celle-ci ait connu dans son pays la tragédie espagnole, ce bonheur avec quelle aisance il se nourrit de cet oubli-là ! Je voudrais que l’on se rappelât bien que l’auteur a vingt- deux ans, son héros de seize à vingt. Que sans doute le roman au sens plein du terme est une oeuvre de la maturité, comme l’amour pour Lamartine, et Stendhal écrivant Armance a quarante ans sonnés.
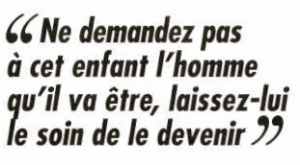
Que le romancier, quel que soit son âge, a pour matière du roman son expérience, son passé. Qu’est-ce que le passé d’un garçon de vingt ans ? Voilà sans doute ce qui expliquerait que le temps romanesque chez lui coule différemment de chez l’homme mûr, et n’allez pas lui demander d’avoir d’emblée l’échelle de nos valeurs ! L’essentiel est que d’emblée Philippe Sollers se révèle un écrivain véritable, et il n’y en a pas tant qu’il paraît en France, une âme haute, quelqu’un qui sait ce que c’est que rêver. Ne demandez pas à cet enfant l’homme qu’il va être, laissez lui le soin de le devenir. Pour moi, qu’un livre comme celui-ci paraisse, c’est déjà un bonheur, comme le retour du printemps. Je sais bien que le printemps ne donne pas les fruits de l’automne, qu’il n’a pas non plus le soleil de l’août. Mais si vous ne frémissez pas, lorsque sous votre pied pour la première fois de l’année, vous voyez surgir une primevère, si le pâle feuillage de mars n’émerveille pas vos yeux, allez ! vous êtes indignes de vivre.
« Quand à seize ans on est poète, et un tant soit peu joli garçon, il est certains airs qui font oublier qu’on est bête... »
Cette fois, ce n’est pas Lamartine, mais Sollers. Il y a dans des phrases de ce genre quelque chose d’inimité, et d’inimitable, où je vois respirer déjà l’avenir. Mais s’il vous plaît, restons-en à ce qui nous est donné, à ce mélange extraordinaire de la naïveté et du savoir-faire, car oui, à vingt-deux ans, Philippe Sollers est poète, pour parler comme lui, et pas bête, ou il l’a bien oublié. Nous avons oublié d’autres choses, en avançant dans la vie, et pour ma part je remercie l’auteur d’Une curieuse solitude de me permettre un instant de revoir la jeunesse du monde avec ses « yeux chinois ».
Une curieuse solitude relève d’un genre très ancien, dont la persistance étonnerait, s’il ne touchait pas à un moment inoubliable de l’homme, pour tout homme. C’est un livre d’oaristys. On me disait, quand j’étais jeune qu’il n’y avait rien de si vulgaire que de raconter son premier amour. Dire que je l’ai cru ! Mais il n’y a rien de si difficile, et, dans ce domaine, la réussite ou pour mieux dire LE BONHEUR, révèle comme rien le génie d’écrire.
« Plus tard, accoudés à l’un des balcons qui donnaient sur le jardin, il me semble — ne l’inventai-je pas — que la lune éclairait le jardin et que dans le désordre que la nuit jetait dans les branches éclatait la pureté d’une fleur. Je songe à l’émotion que c’est, la première fois de sa vie, d’entendre à ses côtés la respiration d’une femme... »
M’entendra-t-on si je dis qu’il y a là un merveilleux art du banal ? Sans parler de la prose : ce rimbaldisme de la syntaxe et celui de la parenthèse (« ne l’inventai-je pas ? »). Il ne se passe ici rien que de très ordinaire. C’est bien là le miracle, dans ce regard si pur porté sur les choses de tous les jours. Philippe Sollers peut parler de tout, rien ne choque, parce qu’il n’y a rien de choquant en lui. Son regard transforme les choses sans les changer, arrangez-vous. Il respire la beauté naturelle du monde, de la vie. Son livre n’est pas fait pour les philistins. Qu’ils ne l’ouvrent pas ! ce serait profanation. On lui reproche d’aimer faire des citations. Il faut dire qu’elles sont fort belles, et pas toujours recherchées. Ce n’est pas moi qui pourrais me joindre à ceux qui l’en blâment, et je n’ai plus son âge. Car, enfin, il en est de cela comme d’être aimé, quand sinon maintenant ce jeune homme s’enivrerait-il des phrases des autres, c’est une ingénuité qui se perd, pour ne revenir sur le tard qu’aux notaires en province. Et après tout on prend son bien où on le trouve, le tout est la lumière qu’on y met. Par exemple :
« J’aimerais dire de Paris ce que Chateaubriand disait des yeux de Mirabeau : d’orgueil, de vice et de génie ».
Je crois avoir lu tout ce qu’on a écrit de ce roman : nulle part, je n’ai vu en retenir cette phrase. Comment cela est-il possible ? C’est drôle, de toute ma vie, je ne me suis jamais senti si emprunté pour parler de rien que de ce petit livre. Sans doute est-ce là, plus que ce que je dis, l’hommage qu’il me faut lui rendre. Moi qui ai lu Le Défi avec froideur. Mais n’est-ce pas de ce premier texte, où François Mauriac a su le découvrir, que l’auteur parle page 114, lorsqu’il dit :
« Je commençai d’écrire. Je n’avais que vingt ans, je savais que ce que j’allais écrire serait d’abord mauvais, et qu’il le fallait sans doute si je voulais atteindre un jour à la perfection de mon provisoire enthousiasme. Mais je faisais du mot à mot au sens où l’on dit : lutter en corps à corps... »
Il y a dans cette confidence-là un écrivain véritable. Je n’avais que vingt ans... et il n’en a que vingt-deux. Qu’il me pardonne ce sourire : c’est celui de l’amitié.
« Convaincus qu’il n’y a que lui, dit-il encore , comme tout est nul lorsque nous sommes las du plaisir ! »
Pour moi, je ne me lasserais pas de citer ce livre dont je parle si mal. Il n’y a pas de raison que cela finisse, sinon la raison même. Je n’ai pourtant ni le mérite, ni l’originalité de découvrir Philippe Sollers, dont le destin, même s’il doit s’entourer de quelques criailleries, est désormais, et largement ouvert. Et puis il y a bien des choses que je préfère réserver de lui dire plus tard. Beaucoup plus tard peut-être, si cela pouvait m’être donné. Le destin d’écrire est devant lui comme une admirable prairie. À d’autres, de préjuger de l’avenir, de donner des conseils. Pour moi, j’aime à me contenter d’admirer. Cette fois au moins. C’est que ce n’est pas tous les jours qu’un jeune homme se lève et qu’il parle si bien des femmes. Je vous en prie, ne faites pas trop de bruit, le parterre, qu’on l’écoute ! Vous savez, un violoniste, il peut ne pas avoir encore la pleine maîtrise de l’instrument, mais à la première fois qu’il se fait entendre, il y a l’attaque qui ne trompe pas, la pureté du son... que sera-ce, dit-on, quand il jouera autre chose ? on a pour lui de l’ambition, le coeur vous bat... Et puis, l’on se dit aussi que voilà, ce n’est pas fini la musique, il y eu Kubelik et Menuhin, voilà Oïstrakh, puis ce jeune homme-ci à son tour avec ses manières à lui, sa façon de rejeter ses cheveux, de tenir l’archet... Non, ce n’est pas fini, le printemps est perpétuel. Il ne s’est pas terminé là-bas
« Sur la plage sonore où la mer de Sorrente
Déroule ses flots bleus au pied de l’oranger »
Et je sais, pour ma part, un peu mieux grâce à Philippe Sollers, que, non, nous ne mourrons pas tout entiers. Puisque les choses essentielles d’autres après nous vont les sentir, les toucher, les voir, en parler. Puisque nous pouvons bien disparaître, l’amour demeure. La vie. Ce mot après quoi on ne peut presque en écrire aucun autre.
Il m’a fallu m’arrêter un peu, pardonnez-moi, pour rêver là-dessus, et finir. J’emprunte à Dryden le titre que je donne à cet article écrit sans mesure, au hasard de moi-même : Un perpétuel printemps. Permettez que j’emprunte à ce poète, non pour conclure, qu’y a-t-il à conclure ? mais comme une citation dernière, une épitaphe qui n’est pas pour le tombeau du seul Marc-Antoine, ces deux vers de l’Epilogue d’All for love :
« Let Cesar’s pow’r the men’s ambition move,
But grace you him who lost the world for love ! »
C’est mal, ou comment ? traduire, tant pis :
« Que la puissance de César mène donc l’ambition des hommes
Mais rendez grâce à qui perdit le monde pour l’amour ! »
Louis Aragon, 1958, Les Lettres françaises n° 748, 20 novembre 1958.
Les Lettres françaises, Hors série, mars 1992,
repris dans J’abat mon jeu, coll. « LES LETTRES françaises », Mercure de France, 1992.
Aragon avec Jean Ristat. Photo Jean-Louis Rabeux.
Les Lettres françaises, mars 1992 (archives A.G.)

Jean RISTAT : On a dit que Philippe Sollers a plusieurs pères. Deux pères déclarés ou « déclaratifs » : Mauriac et Aragon.
Philippe SOLLERS : Eh oui, je ne suis pas dans la position classique de l’homme qui cherche un père. On m’a envisagé très souvent comme fils symbolique. C’est un trait de ma personnalité. Cette situation est probablement due aux conditions historiques dans lesquelles je suis apparu.
JR : Mauriac est ton premier père, puisqu’il célèbre Le Défi. Je cite Aragon : « Mauriac avait entendu venir cet enfant, qui déjà à son premier vrai livre, est un écrivain : ne lui marchandons pas notre gratitude. »
Ph S : Mauriac, dans un chuchotement privé, à l’écart de tout ce qui se passait de plus visible historiquement, à l’époque — c’est-à-dire De Gaulle, l’Algérie — me faisait part, la nuit, en marchant, ou chez lui, de ses souvenirs de Proust, et du fait que c’était une oeuvre incomparable à laquelle il était vain de vouloir se mesurer. Cela m’intéressait d’autant plus que j’aurais pu m’attendre, de sa part, à un prosélytisme religieux qui ne s’est pas présenté, sauf sous la forme d’un malentendu : il me demande où en est mon foie. Et j’entends « la foi ». Il devait avoir l’impression que je menais — déjà — une vie un peu dissolue et que je devais boire trop. Ce qui m’a amené à penser qu’un Dieu qui se présente sous une forme aussi elliptique, aussi épisodique, finalement doit tenir, d’une certaine façon, le coup. C’est un Dieu qui n’insiste pas.
JR : Mauriac est bordelais. Comme Sollers...
Ph S : Nous sommes deux Bordelais aussi opposés que possible. Le Bordeaux de Mauriac c’est le Bordeaux du Sud, brûlant, landais, hyper-névrotique, recuit de passions avides — voir Le Noeud de vipères. Mon Bordeaux est plutôt océanique, portuaire : Montesquieu et Montaigne réunis. Le grand Bordeaux des Lumières.
JR : Aragon écrit « Un éternel printemps » [21] lorsque paraît Une curieuse solitude : « Le destin d’écrire est devant lui, comme une admirable prairie... »
Ph S : La première fois que je vois Aragon, il m’emmène chez lui, rue de la Sourdière. Il m’assoit dans un fauteuil, sort ses papiers et me déclame, pendant deux à trois heures, des poèmes de lui, que j’écoute d’une oreille distraite. Les rimes se suivent, se ressemblent. Et je commence à me mettre en écoute différée. Au point que je me demande à quoi rime cette mise en scène qui consiste à évacuer l’autre au profit d’un exercice de diction dramatique. Je me demande pourquoi cet écrivain, que je suis extrêmement curieux de rencontrer dans la mesure où tous les jours, étudiant, je vais à la bibliothèque de l’Arsenal pour lire la mémoire surréaliste (La Révolution surréaliste, etc.) — je pense déjà à ce qu’on peut faire avec des revues, avec des brûlots, avec de l’action — donc, je me demande pourquoi, au lieu de me raconter — ce qui aurait été pour moi d’un très puissant intérêt — des anecdotes ou le dessous des cartes de cette époque, si importante pour la vie intellectuelle française, pourquoi il s’est enfermé dans une attitude d’acteur dramatique. On se voit, on va dîner, on prend des verres à la Régence. Il reste quelques bribes de trouvailles dans la conversation : « Tu sais, petit, le plus important dans la vie c’est de savoir si l’on plaît aux femmes » ou alors : « Nous, les communistes, nous sommes les pires des snobs ». Mais l’essentiel c’était bien de ramener, chez soi, la proie auditive — de qualité, je suppose — afin de lui faire subir ce rouleau compresseur d’alexandrins. Alexandrins qui d’ailleurs étaient parfois de toute beauté. Mais le côté lancinant et à proprement parler liturgique de la séance finissait par laisser penser qu’on pouvait abandonner son corps dans le fauteuil, aller faire un tour dehors, même passer dans différents cabarets et revenir quatre heures après, se réasseoir dans son corps et dire : « Bravo, c’était merveilleux, merci beaucoup. » C’était donc intéressant, symptomatique et fatigant.
Il écrit à propos d’Une curieuse solitude, « Un éternel printemps », article tout à fait merveilleux et qui m’éblouissait, bien sûr ; le texte de Mauriac était aussi des plus flatteur. J’étais sacré violoniste virtuose chez Aragon, et chez Mauriac ce dernier me comparait à Stendhal déjà en possession de tous ses moyens. Excusez du peu, pourquoi pas ? Ça a d’ailleurs entraîné le fait que je me suis ensuite volontairement mis sur des chemins de traverse pour faire ma propre biographie et pas celle qui m’était si obligeamment tendue à travers des masques prestigieux. Il s’en est suivi des invitations. Je me souviens du Moulin [22], un dimanche. J’ai été amené là-bas en voiture par je ne sais plus quel producteur — belle voiture américaine, d’ailleurs — et il y avait là Léo Ferré et d’autres personnes : congratulations, atmosphère extrêmement mondaine, artiste. Le thème « communiste » était très peu présent puisqu’il s’agissait en 1958, déjà, d’essayer de changer d’air et de faire face à la redoutable hypothèse du poids du cadavre de Staline. La poésie, la chanson occupaient le système médiatique de l’époque. Et je vois un homme qui visiblement se cache ou se dissimule par la tactique classique qui est l’extraversion supposée. Ça m’a laissé fatigué, ça aussi. Le mystère Aragon réside dans ce choix contraignant d’être dans le spectaculaire.
Cet épisode est suivi d’une ou deux rencontres. Mais déjà on sent que ça ne va pas donner lieu à une relation suivie, confiante. Je me rends une ou deux fois rue de Varenne [23] où je vois mieux son mode de vie quotidien avec Mrs Triolet. À peine étais-je arrivé, que je me retrouvai dans le bureau d’Aragon, assis en train d’écouter, de nouveau, un très long poème. Je servais une fois de plus de terrain d’expériences auditif. Je me rappelle qu’Elsa Triolet, de temps en temps, entrait et sortait de façon assez fébrile, sans raison apparente. A la fin de l’entretien elle était là. Et, un jour, elle me dédicace un de ses livres : « À Philippe Sollers, maternellement. » Un père de plus, ça va, mais — si j’ose dire — une mère en plus, bonjour les dégâts ! Ça aurait pu être un épisode comique et on aurait ri ensemble, mais c’était visiblement fait sans aucun humour.
II est possible qu’Aragon ait été un humoriste de génie, noir, comme il est possible aussi que cet humour ne lui soit pas forcément apparu dans toutes ses dimensions. Y a-t-il un Aragon anarchiste, hyper-humoristique ? Probablement était-il le plus doué pour une très grande carrière comique et humoristique, mais il semblerait qu’il se soit défaussé de cette carte. Lorsque je suis allé voir André Breton, celui-ci m’a fait un cours professoral sur l’état des lieux, des courages ou des lâchetés ambiantes, en me disant : « Regardez ce livre de Paulhan qui s’appelle Braque le patron, le patron, voilà comment parlent ces gens-là ! » Aragon ne me parle pas de Breton. Breton m’écrit qu’il a lu mon livre malgré le redoutable parrainage d’Aragon. Mon Dieu, mon Dieu, comme c’est choquant ; en tout cas ça manquait tout à fait d’humour. De temps en temps, je me baladais donc avec mon ami Mauriac qui me reparlait tout le temps de Proust, et qui, lui, ne manquait pas d’humour. Je pense qu’il regrettait de n’avoir pas su l’exprimer dans ses livres et qu’il enviait le vice de Proust qui est, comme chacun devrait le savoir, une superbe, définitive ironie. Car Proust est avant tout un magnifique auteur comique. Donc, la question se pose de l’humour d’Aragon. Je n’attendais pas de lui ce qu’on appelle en général la Pensée. Ce peu de don pour la métaphysique ou pour la philosophie en général, se double à mes yeux, chez lui, d’une qualité majeure : il n’a pas sombré dans ce que j’appellerais le mauvais goût systématique surréaliste en ce qui concerne l’image, la représentation.
En somme, en tant qu’homme de spectacle, il a compris quelque chose malgré le grotesque épisode Fougeron et ce qui a failli être le réalisme socialiste à la française (l’histoire du Portrait de Staline est à mourir de rire). II faut lire les confidences de Picasso. Pas de mauvais goût majeur chez Aragon, ce qui est, dans un pays où les écrivains ont souvent un goût détestable et atroce, très remarquable. Alors que Braque ou Fautrier servaient à Paulhan, Ponge ou Malraux à ne pas voir Matisse, par exemple. Donc ce « maternellement » m’a paru tuant. Tuant, pas pour moi, un peu pour Aragon : se mettre dans une situation de ce genre dit tout en un seul mot. À la campagne, chez Mauriac, je mettais mon verre sur la table de bois et ça faisait une marque. Je retirais mon verre et il me disait (tout bas) : « Mais laissez, laissez. Laissez, ça agace ma femme. » C’était drôle. Et puis madame Mauriac n’entrait pas tout le temps dans le bureau, et elle ne m’a jamais manifesté un désir maternel quelconque.
JR : Oui mais enfin, allons plus loin.
Ph S : Eh bien, l’Histoire est un animal, vivant. Cet animal vivant peut être apprivoisé, enjoué, délicieux, voluptueux, il s’agit de savoir comment on le prend. Mais il peut devenir aussi féroce si on vient à lui manquer. L’Histoire est un animal et il faut que nous considérions, je crois, en reprenant tout de zéro, la façon dont un écrivain est en phase ou non avec cet animal-là. Ce n’est pas une question d’idée abstraite, ni d’idéal, ni de programme, ni de bla-bla dialectique. Mauriac pensait que Proust était un merveilleux animal, qu’il était entré dans des raffinements inouïs avec l’animalité. Quoi de plus ironique qu’un animal qui joue ? Proust avait cette conscience aiguë qu’on ne peut pas prendre au sérieux ce qu’il en est du sexuel. La croyance dans cette affaire-là est en quelque sorte un résultat de l’animal maltraité de l’Histoire. Qu’on maltraite et qui va devenir féroce. Pour Louis Aragon, il faut remarquer le jeu extrêmement ouvert, magnifique, qu’il a dans ses débuts. L’animal Aragon, pourquoi devient-il à un moment donné le représentant de son spectacle inséré dans un autre spectacle ? Il n’a pas tellement de raison, en tant qu’animal libre. Sans doute l’a-t-il senti si profondément à la fin de sa vie, qu’il a voulu finir comme un animal sauvage !
JR : Belle formule !
Ph S : C’est beau, mais c’est tard. Et après combien d’atermoiements ! Alors, il faut maintenant se remettre dans la position des années 60, pour poser un certain nombre de questions. Proust est occulté, par tout le monde, semble-t-il, à part Mauriac qui me chuchote ça comme une messe basse qu’il fallait faire passer. Ça paraît grotesque aujourd’hui, mais enfin personne ne parle de Proust à ce moment-là. Il n’en était jamais question du côté de la NRF. On voit en relisant le journal de Drieu La Rochelle que Proust n’existe pas. Il n’y a pas un mot sur Proust chez Malraux, Camus, Sartre. On ne peut parler de Proust avec Breton, « mais cher ami vous n’y pensez pas, enfin ! ».
La position d’Aragon m’a choqué. Il traitait Proust d’une façon très désinvolte : on avait tout compris, selon lui, parce qu’on savait bien qu’Albertine s’appelait Albert ! Eh bien cette formule me paraissait tout à fait inadéquate. Qu’Albertine fût Albert ne me paraît pas jeter une lumière particulière sur l’oeuvre de Proust, bien au contraire ! Au fond c’est un reproche à la Gide. Il y avait aussi l’écrivain dont il n’était pas question de prononcer le nom, Céline. Quels sont les traits particuliers de Proust et de Céline, au bout du compte ? J’en retiendrai deux : l’incroyance sexuelle d’abord, poussée à un niveau d’animalité joueuse, vicieuse. L’athéisme n’est rien d’autre que ça. Si l’on n’est pas athée sur cette question, il ne faut pas prétendre l’être sur autre chose. Ensuite le comique, c’est-à-dire la possibilité de donner de l’existence humaine une vision corrosive, ironique.
Je voyais Aragon avec beaucoup d’intérêt. Que de dons, de puissance nerveuse ! Quelle capacité extraordinaire de travail, de verbalisation, de syllabisation, d’enchaînement ! Alors là, il est tout à fait extraordinaire et passionnant. Un animal de mots qui joue, rien n’est plus beau. Mais cet animalité verbale, qui ne demandait qu’à exploser, était prise dans la nécessité du spectacle. Pourquoi avoir besoin d’un autre pour vérifier qu’on a écrit ? Aragon seul, c’eût été étrange parce que vraiment, être seul avec un groupe, fût-il surréaliste, c’est en effet être moins seul que si on participe à l’énorme comédie de l’Histoire. J’ai nommé ce qui s’est appelé communisme, dont on dit qu’il s’effondre — ça reste à vérifier — mais enfin disons la comédie stalinienne, la comédie au sens tragique du mot parce que cela consiste à broyer des corps et à chanter des hymnes au futur idéalisé. L’hypothèse d’un Aragon humoriste noir se pose. C’est-à-dire vertiges, délices, volupté peut-être d’une solitude intime. On fait l’acteur dans cette immense comédie conviviale. Alors à ce moment-là un groupe est trop petit. Il faut quelque chose qui soit de la puissance, disons de la CNN aujourd’hui. Et à l’époque, le Parti communiste est un poste à galène : un petit bricolage. Aragon n’est pas allé, comme tout le monde après lui, se mêler du Parti communiste quand c’était la mode ! Il n’y est pas entré après l’Occupation comme beaucoup de gens qui avaient eu des petites défaillances de discours ou d’actes entre 40 et 44 ! Problème actuel. Gerbe ou pas gerbe au Vel’ d’Hiv’ [24], ce problème de la gerbe est à gerber de nouveau. Ce qui prouve qu’avant de sortir du XXe siècle, on va mettre beaucoup de temps.
Après, évidemment, le Parti communiste a pris des proportions considérables et Aragon s’est trouvé là. On aimerait le ramener des morts et le questionner : « Non, non vous lirez vos poèmes une autrefois. Ils sont là d’ailleurs, bien édités, on peut les lire tranquillement dans le silence, mais racontez-nous. » Quand j’étais un peu ami avec l’autre Louis — tout un problème de s’appeler Louis en France, ça pèse lourd, le tête qu’on a coupée, du père symbolique ! — quand j’étais avec l’autre Louis, Althusser évidemment, je ne me doutais pas vraiment qu’il allait nous livrer un jour son passage à l’acte, son crime en état second et ses épisodes psychiatriques ; qu’il allait nous raconter des choses aussi énormissimes sur son corps, sur le peu d’usage de son corps dans l’histoire. Il parle de son corps pour évoquer les travaux pénibles qui le mettaient dans une sorte de joie avec son grand-père et pour ensuite dire qu’il aurait découvert la masturbation à 27 ans dans les camps, et le premier acte à proprement parler coïtai, à l’âge de 28 ou 30 ans. On est toujours surpris, ahuri, de vérifier les corps. Si je veux vérifier le corps de Proust, je peux. C’est facile. Encore que ça choque tout le monde, ces histoires de Proust : Les rats.
JR : Et le corps de Bataille ?

- Aragon en 1927
Ph S : Un personnage intéressant qui ne m’a d’ailleurs jamais demandé d’être son fils en aucune façon, celui-là. Pas dans le spectacle pour un sou. Silencieux, aérien, immobile, bizarre. Je peux vérifier le corps de Bataille et comment fonctionne celui de Céline. Pas de mystère. Céline en parle. Il suffit de lire les lettres envoyées à ses amies et les conseils qu’il leur donne. Mais si je veux vérifier le corps d’Aragon, une façon nouvelle de faire de la critique littéraire, j’ai besoin de lui. Je ne peux pas le tirer de ce qu’il a écrit, sauf de ses premiers livres : Le Libertinage, le Con d’Irène, etc. Pourquoi faire des mystères pendant tant d’années sur ces histoires de Con d’Irène ? Ouf, ouf, dégageons ! À partir de ce moment-là il a bien dû se passer quelque chose qui fait que motus et bouche cousue et... « et qui pour vos beaux yeux tout aussitôt moururent ». Ce qui est un beau vers comme « vous mourûtes au bord où vous fûtes laissée ».
JR : Et tu peux vérifier le corps de Racine ?
Ph S : Dans le contexte de l’époque, je peux. Proust avait raison de trouver Racine passionnant et même plus immoral que Baudelaire. Je sais que Racine me dit quelque chose qui ne peut pas se dire autrement, à l’époque. Je suis obligé de me demander pourquoi, tout à coup, il y a chez Aragon ce saut dans l’ordre de ce qu’il faut bien appeler le refoulement. Un refoulement très particulier qui n’est pas le silence, l’inhibition, mais le déplacement vers le spectacle.
JR : Est-ce une sublimation ?
Ph S : Non, c’est une idéalisation. Et le brave Freud, quand il a posé la différence entre les deux, a su au fond qu’il ne serait jamais compris. La sublimation n’est pas l’idéalisation. Exemple : Picasso n’arrête pas de sublimer mais il n’idéalise pas ; il dit ce qu’il est en train de faire, et vous savez où, au lit. Ça se voit sur les toiles. Il ne peut pas y avoir d’image emblématiquement emphatisée de la femme. Très mauvaise nouvelle pour le romantisme généralisé ! Mais chez Aragon l’idéalisation est très prégnante. Qu’est-ce qui vous garantit l’idéalisation, en général ? Une trique. Appelons-la Staline pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté. Staline sert de garantie, c’est-à-dire de trique. Le réalisme de Picasso n’est pas d’ordre élégiaque. La tradition lyrique est un grand problème...
JR : Il y a tout de même la littérature courtoise, les troubadours, une tradition dont se réclame Aragon et dans laquelle il s’inscrit à une certaine époque (1943) d’où l’importance du vers compté pour la mémoire, donc du chant. Mais Aragon n’a jamais cessé, dit-il, d’en écrire d’autres. « Je ne suis pas plus asservi aux vers d’un type qu’aux vers de l’autre. »
Ph S : La littérature courtoise était subversive, de même que Racine était immoral, alors que le troubadourisme au XXe siècle s’est retrouvé conventionnel et moral. C’est la leçon, parmi d’autres, des retournements sensationnels que nous a infligés le XXe siècle. En 1913 à Paris, Ô grandeur de la France — grandeur mondiale, européenne — Proust prend un taxi avec Joyce. Stravinski passe et Proust lui demande s’il aime les quatuors de Beethoven. Picasso est là. Il a déjà fait ses Demoiselles d’Avignon. Le surréalisme se prépare. Il y a déjà un garçon qui a beaucoup d’énergie, et se forge dans l’ombre, Céline. Tout le monde a semble-t-il perdu le souvenir, la mémoire de cette époque. Ce Paris ne demandait qu’à continuer à être ce qu’il était. Et là, il y a un écrivain à la génialité indubitable qui s’appelle Louis Aragon. Il y a Faulkner au Luxembourg, Hemingway à Montparnasse. 1930/1940 : Staline, Hitler, Pétain. Hou, la gerbe ! Qu’est-ce qui s’est passé ? Voilà le problème. Qu’est-ce qu’il y avait brusquement dans les têtes pour que l’illumination géniale ait pu être oubliée, occultée ? Comme si cela n’avait jamais eu lieu ? L’Histoire est un animal vivant et cet animal a donné son coup de patte, brusquement. Il s’est vengé terriblement.
Nous sommes en 1992, toujours à nous poser la question de savoir si nous allons gerber ou pas. Bien sûr, la Chambre du Front populaire a voté les pleins pouvoirs à Pétain et le Parti communiste était stalinien, comme on sait. Nous pouvons soupçonner l’enfer privé d’Aragon, sa saison, sa longue saison en enfer pour un animal si doué pour la cavalcade, la course, la souplesse devant les arbres, le choix et la rapidité de l’attaque. Que s’est-il passé ? Qu’est-ce que c’est que ces histoires de l’Amour, de la Femme... mais qu’est-ce que c’est que cet incroyable bazar régressif ? Troubadours, troubadours ! Les troubadours disent, eux, pour la première fois, quelque chose qui n’a jamais eu lieu avant eux. Ils ne sont pas en état de régression par rapport à leur époque. À quelques années de distance, monsieur, je vous le demande, comment passe-t-on de la Juliette de Sade à Madame Bovary ? Problème. Mais comment passe-t-on de 1920-25 à 1930-40 ? Expliquez-moi. J’attends qu’on m’en parle tous les jours, plutôt que de savoir qui a tué qui, qui a tué quoi, qui sont les responsables, les coupables. Nous sommes sous hypnose.
Voilà comment il faut, à mon avis, reprendre Aragon, libérer Aragon, le faire vivre de façon complexe, contradictoire, peut-être plus criminelle qu’on ose le dire. Lui supposer cet humour effrayant, ce nihilisme, ce désespoir tragique de dimension shakespearienne, cette haine de soi qui prend corps alors à partir des années 30, se haïr soi-même de-vient en quelque sorte une obligation.
« Tu te détruiras, tu te suicideras, tu t’abomineras, tu t’ennuieras, tu adoreras ton Surmoi qui t’interdit... » Oh, mais comment est-ce possible ? Vous savez, le père, ce n’est pas grave. Comme le sexe ou autre chose. Il suffit de laisser jouer l’animal.
JR : Il faudrait prendre l’oeuvre d’Aragon dans son mouvement, avec ses contradictions. Il n’aimait rien tant qu’à brûler ses vaisseaux...
Ph S : Ce qui me manque dans l’oeuvre d’Aragon, c’est le petit livre terrible de 60 pages, que lui seul aurait pu écrire. Le petit traité de désespoir, génial. Le petit livre magique. Les romans, c’est bien, comme d’habitude il y a beaucoup de passages épatants ; ça traîne un peu, pourquoi pas ? Mais je crois qu’étant donné, encore une fois, le côté catégorique, nerveux, implacable, chatoyant mais strict de ses premiers écrits, ce petit traité illuminerait quand même la bibliothèque.
Althusser finit par en dire davantage, mais comme Althusser n’est pas un écrivain, cela n’a pas beaucoup d’influence sur la littérature.
JR : La question du désespoir, elle est partout dans l’oeuvre d’Aragon, et, me semble-t-il, à partir des années 60 — voir dans Les Poètes — l’épilogue qui est à lui seul un traité du désespoir, et puis la Valse des adieux ou Théâtre/Roman. Il dit qu’il a raté sa vie, et d’autres choses sur l’amour qui ont évidemment à l’époque scandalisé, et qu’on n’a pas voulu entendre au nom de l’optimisme historique, de la morale ou du mythe...
Ph S : Oui, il y a cette coloration tragique, désespérée, voire plaintive, romantique, en effet, sur l’échec, qui peut être d’ailleurs une des formes par lesquelles on présente une réussite. Mais il n’y a pas le rire sarcastique du criminel pour dire : « Je vous ai tous bien eus, tout ceci n’était qu’illusion. Je me suis toujours amusé de votre crédulité dans tous les domaines, y compris de votre crédulité politique... » Ce petit livre manque : j’ai envie de l’avoir dans la bibliothèque, sinon je ne parlerais pas d’Aragon avec une certaine excitation. Ce petit livre ferait chef-d’oeuvre. Je ne sais pas si vous l’imaginez. On l’écrit ? Non ? Ah, j’ai envie de l’écrire ! Voilà. J’ai envie de faire un faux Aragon : « Voilà, maintenant, je vais vous dire ce qu’était vraiment le surréalisme. Je vais vous dire ce que c’était que Lily Brik et Elsa Triolet, le Parti communiste et comment je me suis bien amusé et je vais vous dire... » Comme les Poésies d’Isidore Ducasse. Un Aragon froid, ô merveille ! Ce serait terrifiant d’efficacité, enfin de lumière ! Un Aragon victorieux, s’enterrant lui-même sous les quolibets de l’humanité entière. Ça aurait quand même de l’allure. Je dis ça parce que je pense qu’il le mérite.
JR : Aragon a tous les masques. Mais je ne crois pas qu’il se soit beaucoup amusé.
Ph S : Ah ! quand-même, c’était une insolence en marche, une grande force d’insolence !
JR : Oui, et il ne met pas fin à l’insolence au nom d’un engagement politique. Je me souviens d’une Fête de l’Humanité où il portait un masque rouge ! Mais ceci se passe dans les années 70. J’ai parlé d’« engagement politique », dont tu dis qu’il est un alibi...
Ph S : L’ALIBIDO, l’alibido politique. Le fait de mettre en scène son alibido politique me paraît être désormais quelque chose qu’on peut étudier. Aragon, pas plus que tous les autres, n’a jamais cru au moindre engagement politique. Il a été révulsé, et il y avait de quoi, par l’engagement politique des autres. Il y a en effet des moments dans la vie où, pour peu qu’on voie les gens passer leur temps à mettre leur alibido dans la politique, on en éprouve un tel dégoût, un tel écoeurement, c’est à gerber, qu’on s’engage ! Ça m’est arrivé, ça pourrait me réarriver. On va parler alors du bien, de la morale !
Aujourd’hui c’est le retour à Kant, et nous serons toujours platement du côté du bien contre le mal. Les meilleurs engagements sont les plus aberrants. Aujourd’hui on ne voit que des petites transactions quotidiennes, de rentabilisation des places déjà monnayées. Aragon, comme Céline, a un relief d’aberrations.
JR : Non, pas Aragon comme Céline !
Ph S : Mais si, et c’est pour ça qu’il est si intéressant de se demander ce qui est arrivé à Céline. Il faut exactement se poser la même question pour Aragon. C’est-à-dire en quoi ce relief est en lui-même intéressant. Il y a tant d’engagements dérisoires.
JR : Je crois entendre ce que tu dis mais je ne peux pas mettre à égalité l’engagement fasciste, antisémite, sur le même pied qu’un engagement socialiste, humaniste au plein sens du terme. Tout de même !
Ph S : Précisément que si, c’est même là où je vais blesser le bât...
JR : Eh bien, allons y !
Ph S : Ce bât, c’est le bla-bla constant, qu’on dit partout : « Vous ne pouvez pas comparer ! ! ! ... » Mais si, mais si, on peut. On le peut et même je dirai qu’on le doit, s’agissant de choses aussi importantes que la présence toujours exceptionnelle d’un animal vraiment doué pour le langage. Eh bien justement ça n’a que plus d’intérêt de se demander en quoi l’écrivain se croit obligé de faire autre chose. Ce sera plus utile à une meilleure politique, au sens fondamental, que de répéter à longueur de temps : « Il y a des bons et des méchants. » Parce que les bons d’hier deviennent les méchants de demain, etc., etc. Souvent propagande varie, bien fol est qui s’y fie. Ô idéologie ! Il n’y en a plus, paraît-il, mais il n’y a que ça, comme d’habitude. Bon. Alors, la morale, la morale, très bien. Mais avec la morale on ne va pas plus loin que le bout de son quotidien et on ne dit pas grand-chose de nouveau, d’intéressant. La véritable question est plutôt : comment, pourquoi, se sent-on obligé de s’engager contre soi-même ? Pourquoi imaginer qu’on est moins exceptionnel qu’on ne l’est ? Qui ou quoi, exactement, a intérêt à vous en convaincre ?
Les Lettres françaises. Spécial Aragon. Hors série. Septembre 1992.
L’Infini 40, Hiver 1992 (titre : Le théâtre d’Aragon).
Le site actuel des Lettres françaises
Pendant l’année universitaire 1994-1995, Julia Kristeva consacre son cours à l’UFR "Sciences des Textes et documents" de l’université paris 7-Denis Diderot au Sens et non-sens de la révolte. Elle y étudie trois « cas » d’écrivains : Aragon, Sartre et Barthes. Dans son cours sur Aragon, elle revient longuement sur les oeuvres de jeunesse, notamment La défense de l’infini et Le con d’Irène (Fayard, p. 283-295). Elle achève son étude sur la question du stalinisme. C’est ce passage que j’ai choisi.
LE STALINISME CONTRE L’INFINI SENSIBLE

par Julia Kristeva
Extraits
« Quand je ne sais pas qui je suis, j’en suis » :
« adhérer » remplace « être »
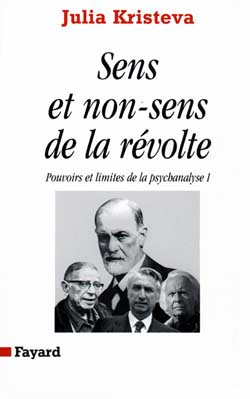
L’adhésion au stalinisme, c’est sur ce sujet que je vous ai quittés la dernière fois : la grande affaire de ce siècle ! Et vous pensez bien que ce n’est pas aujourd’hui que je vais épuiser la question ! Il faudrait tout de même commencer un jour, de mon point de vue, j’entends, qui n’est pas celui de l’utilité sociale (défendre les « damnés de la Terre » contre les bourgeois) ni celui de la nécessité politique (contrebalancer le totalitarisme brun par un totalitarisme rouge), bien que ces deux visions se défendent, je le dis sans pudeur et tout en ayant été moi-même une victime modeste — mais victime quand même — de ceux qui promettaient des « lendemains qui chantent ».
Adhérer au stalinisme s’est révélé une passion aux racines beaucoup plus sournoises. Prenez l’homme invalide dans Irène. On peut imaginer qu’un bonhomme comme ça se répare en adhérant à quelque chose de fort : il n’ y a plus de raison d’être, mais il existe un groupe qui incarne la raison de l’Histoire. La raison de l’Histoire est le contrepoids de la dépression, et le parti des masses populaires devient la version maniaque de la mélancolie. On oublie alors que la poésie s’insurge contre le monde de l’action, on trouve « trop con » cette révolte, on veut de l’action au nom de la raison et de l’Histoire. On voit le communisme comme une « conscience incarnée », comme l’esprit absolu « remis sur pied ». Hegel avait pourtant prévenu que la terreur, c’est Kant mis en pratique ; mais on ne se méfie plus de la terreur qu’impose la dialectique mise en pratique. Qui, « on » ? Dans le cas qui nous intéresse, « on » est d’autant plus adhérent à la dialectique incarnée dans le peuple qu’« on » a bataillé contre la loi et la norme d’une conscience opprimante, au point d’en défaire la stabilité en même temps que la sienne propre. Le désarroi identitaire se restabilise par l’érection du dogme de la raison incarnée.
J’ajouterai qu’une certaine tradition matérialiste française ne répugne pas non plus au culte de l’« incarnation » de la raison historique que représente le Parti. Qu’un groupe humain puisse matérialiser le pouvoir absolu que l’idéalisme allemand avait attribué à l’idée, voilà qui ne manque pas de séduire les descendants de ceux qui se réclament du sensualisme et qui honnissent l’obscurantisme des cathédrales. Le culte du merveilleux irrationnel substantifié par la femme frise l’inconstance et le pluriel du baroque, nous l’avons vu. Mais le culte du merveilleux rationnel que représente le matérialisme dialectique, en contrepoint du précédent, rassure, solidifie et enthousiasme à la fois.
Le fantasme d’un pouvoir populaire devient l’endroit social de cette magie sensorielle que la femme enchanteresse détient dans l’envers intime. Où la puissance imaginaire de la matrone phallique commande au sadomasochisme des mâles. Que l’homosexualité soit le secret de polichinelle de cette alchimie, certains ne tarderont pas à le savoir, et Aragon lui-même nous l’a joué, sur le tard, il est vrai, mais non sans dérision, ce qui, après tout, tient le symptôme à une certaine distance.
Pourtant, dans cette logique où les motivations de l’inconscient communiquent — décidément, les Vases communicants de Breton ont la vie longue ! — avec les options politiques, les credo idéologiques revêtent une intense versatilité qui caractérise par ailleurs le sadomasochisme des états amoureux et la polysémie du langage poétique. Et sous l’apparence d’un chantre politique — patriote, communiste et idéologue — on découvre la salubre provocation d’un histrion. Mais s’agit-il vraiment et seulement d’une manipulation amorale de la part d’un imposteur ? Ou d’un état limite de l’identité insoutenable : celle du soi, celle des groupes ? Ou encore d’une période critique de la conscience occidentale où le refus de ce couple que forment la conscience et la norme s’est figé dans une antinorme et une anti-conscience plus contraignantes et plus meurtrières que leurs cibles traditionnelles ? La révolte échouant ainsi dans une oppression radicale, faute de pouvoir suivre dans la pensée seule, dans la seule pensée, cette archéologie du sensible et du sensé, ce débat dans la métaphysique, et contre elle, qu’Aragon avait annoncé dans Le Paysan de Paris ?
Une chose est sûre : si nous avons dépassé cette période critique et en voyons aujourd’hui les impasses (qui ne concernent pas seulement les compromis d’Aragon), il n’est pas certain que nous n’en ayons pas perdu aussi l’inquiétante vitalité. Et qu’une ouverture de l’a-pensée ne se soit provisoirement fermée.
Au point où nous en sommes, en 1928, les impasses du stalinisme ne font que commencer ; j’y reviendrai dans d’autres séminaires et à propos d’autres écrits d’Aragon. Il y aura 1930 et le congrès de Kharkov avec cette redoutable adhésion au réalisme socialiste ; puis 1932 et la rupture avec le surréalisme ; Le Monde réel à partir de 1933 et jusqu’aux Communistes [25] de 1949 ; le pathos conjugal et patriotique du cycle poétique de la Résistance — mais fallait-il ne pas le faire ? qui jettera la première pierre aux alexandrins ? Puis Aurélien [26] en 1945 ; et enfin — je dis « enfin » pour moi, car ce fut le soulagement de retrouver une écriture reprenant son large souffle —, La Semaine sainte [27] en 1958. Mais personne n’entend plus parler de La Défense de l’infini, qui ne sera republiée, je vous l’ai dit qu’en 1986 (en 1969, dans Je n’ai jamais appris à écrire, bien que décrivant le style du roman brûlé, Aragon ne cite toujours pas Irène).
L’infini sensoriel ou l’a-pensée en danger
Revenons sur le sens de cet « infini brûlé ». En distinguant « penser » et « juger », intellect et raison, entendement et signification, Kant accorde au jugement et à la quête de signification un pouvoir illimité. Cet acharnement constitutif de la pensée elle-même, qui avait conduit les Grecs à considérer l’infini comme la source de tous les maux [28], se manifeste de manière redoutable dans le pouvoir illimité de la raison pragmatique moderne : je veux parler de la raison technique qui se détourne de la recherche de vérité afin de dominer le sensible. Ce débat, que Hannah Arendt mène notamment dans son livre La Vie de l’esprit [29], laisse cependant ouverte la question de l’infini sensible : domaine de l’âme et des passions dans la philosophie classique, cet univers — terre de prédilection non seulement de l’art et de la littérature, mais aussi de la psychanalyse — est loin d’être passif et uniforme, il fourmille de singularités infinies que l’esthétique classique, parce qu’elle est classique, ne parvient pas à manifester. Cet infini sensoriel, en doublure de la raison infinie, et bien que fondé sur et dans le monde sensible, en pulvérise l’évidence dans une démesure que seules les métaphores de l’infini peuvent approcher. Ainsi qu’un langage dont la stylistique polyphonique brise tous les pièges de l’unité cependant utilisée (unité du mot, de la syllabe, du rythme, de la phrase, du récit, du personnage, etc., convoqués et pulvérisés). C’est cet infini sensoriel que la jouissance met en scène et auquel l’écriture se mesure, qui « inspire » — car tel est le mot immémorial — le mystique autant que l’écrivain.
Force est de constater que la révolte apparemment formelle et passionnelle de l’écriture dans La Défense de l’infini, comme en d’autres expériences d’avant-garde, survient dans un monde dominé par l’infinie violence de la raison technique, pour y apposer la résistance de l’infini sensible. Pour autant que celui-ci serait la réserve d’une vérité humaine, elle-même interne au langage, à condition de l’arracher au calcul et de la rapprocher du battement de la pensée, de sa germination infinitésimale ; antérieur à l’Un, au sujet et au sens. On mesure alors le risque identitaire — mélancolique, psychotique — de cette démesure qui est l’autre mot pour désigner la liberté.
L’impossible de la révolte
Je voudrais raccorder ces remarques concernant le texte, la vie et l’engagement d’Aragon dans le mouvement surréaliste au thème de la révolte. Sans doute la liaison vous est-elle apparue en filigrane et fait-elle aussi écho, pour vous, à la partition « droite » et « gauche » dont on entend reparler par ces temps de campagne électorale. Au moment où les discours des candidats à la présidence de la République — discours de rassemblement qui vont dans le sens des urnes — cherchent démagogiquement à gommer clivages et différences, le terme de révolte fait peur. Il fait peur parce qu’il consisterait précisément à s’interroger sur les contradictions présentes et sur les nouvelles formes de révolte dans notre société postindustrielle. Parler de révolte n’appelle pas d’emblée au « rassemblement » susceptible de faire gagner un candidat, mais incite, au contraire, à l’auscultation, au déplacement, à la dissemblance, à l’analyse, à la dissolution. Parler de révolte n’appelle pas à l’intégration, à l’inclusion, à l’idylle sociale dans l’immobilité, mais souligne qu’il existe des contradictions d’ordre économique, psychique, spirituel, et, qui plus est, que ces contradictions sont permanentes : entendez bien, elles ne sont pas solvables. C’est même lorsqu’on s’aperçoit que les contradictions de la pensée et de la société sont insolubles que la révolte apparaît — avec ses risques — comme une nécessité continue pour le maintien en vie de la psyché, de la pensée et du lien socia1 lui-même. Bien sûr, le paysage politique n’est pas nécessairement le lieu où la question de la révolte peut se poser ; peut-être le deviendra-t-il si certains, comme ils le proclament, parviennent à refonder la gauche. Mais cela prendra du temps — après un temps, pour ce parti nécessaire, de diète du pouvoir.
Notre question ici est plutôt celle de la révolte psychique, de la révolte personnelle et, en conséquence de la révolte en tant que forme d’expression esthétique. La révolte politique et esthétique d’Aragon, le défaut de père dans son existence, le culte du féminin sous la forme que je vous ai indiquée, l’adhésion au Parti communiste constituent-ils des éléments d’une révolte que j’ai située dans le cadre de la pensée freudienne comme une révolte contre le père et contre la loi ? En partie, oui, comme le montrent, au début d’Irène, le narrateur et sa rage adolescente contre le conformisme de la société de province où il s’ennuie. Mais par-delà ce conflit avec le père ou la loi, et surtout lorsque la place de ce père est vacante, lorsque le fils est bâtard, une autre variante du tragique apparaît, outre le tragique ?dipien : c’est l’affrontement avec ce qu’il faut bien appeler l’impossible.
J’ai déjà prononcé à plusieurs reprises ce mot devant vous. C’est celui que Lacan emploie quand il parle du réel en affirmant qu’il est impossible [30]. L’impossible, selon Le Con d’Irène, se présente dans l’imaginaire d’Aragon comme une confrontation au maternel et au féminin, pour autant que ceux-ci représentent le fantasme de l’excitabilité irreprésentable : la mater-matière démoniaque. Nous sommes donc bien en deçà ou au-delà de la loi paternelle, de l’identité des signes que cette loi garantit : ce qui donne l’écriture surréaliste où les signes du langage — identitaires et identifiants — sont, justement, sortis de leurs gonds, sans pour autant subir une désidentification totale comme les mots-valises de Joyce ou les glossolalies d’Artaud.
Néanmoins, le surréalisme se caractérise par ces métaphores paradoxales dont je vous ai lu quelques exemples dans le passage des poissons et par ces rêveries qu’actualise l’écriture automatique et qui mettent à mal la logique. Sacralisation et fétichisme de la femme conduisent les surréalistes à une image fascinante autant qu’abjecte du féminin. Cette guerre ambivalente contre le féminin est à entendre en contrepoint de la guerre que le sujet livre à lui-même : à son identité surmoïque et paternelle. Pour se protéger de l’abjection de l’autre (à commencer par l’autre sexe) et de l’autre en soi, la femme est sacralisée, fétichisée : c’est ce que disent assez les deux versants (ambivalence-rejet, merveilleux-magie) qui constituent l’imagerie féminine surréaliste. La criminelle fascinante ou la sauvage Irène sont des alter ego de l’écrivain, dans lesquels se distribuent à la fois des rôles féminins imaginaires et des facettes du sujet lui-même délicieusement et horriblement confondues avec ce féminin tout à la fois oedipien, parce que désirable, et préoedipien, parce que reflet narcissique de soi.
Irène est le personnage inventé par Aragon qui montre le mieux ce tissage très particulier de trois images : une femme hypostasiée, idéalisée comme mère oedipienne désirable ; une autre négativée, ordure abyssale, engloutissante ignominie ; à laquelle s’ajoute une troisième composante constituée par l’identification de ce dédoublement avec la dynamique même de la représentation, de l’a-pensée, que s’attribue l’écrivain, l’énonciateur, le sujet parlant. Ni Victoire ni Irène ne sont des femmes réelles, bien sûr, des femmes au sens social du terme ; j’insiste sur ce point pour souligner qu’il s’agit là de fantasme, d’une prosopopée de l’inconscient du narrateur et de l’écrivain, au sens où la prosopopée est une mise en scène des absents, des morts, des êtres surnaturels ou inanimés qui parlent et agissent, alors que le fantasme réalise cette scénographie avec les rejetons de notre propre inconscient, rejetons qui ne sont pas du tout morts.
Dans cette mise en scène d’une nouvelle forme de tragique où l’homme-narrateur est confronté à l’impossible (de l’autre, du féminin, du sensible), nous sommes conduits, par le truchement du langage poétique aragonien, au coeur d’une double tragédie féminine, cette fois, et non plus oedipienne. D’une part, le poète méconnaît l’existence réelle, psychologique et sociale de la femme — il n’est que de penser aux drames biographiques d’un certain nombre de femmes qui ont gravité dans le sillage des surréalistes, à l’écrasement de leur autonomie et à leur désir qui en a conduit certaines au suicide. D’autre part, il s’identifie à une hypostase féminine, il l’absorbe, il est elle : il est Irène et il écrit l’impossible de la féminité, il l’assimile, il la vampirise. Ce faisant, il parvient cependant à témoigner de l’impossible en même temps que de la jouissance, lesquels, sans cette ambivalence tragique, seraient sans doute restés muets.

- Aragon et Elsa Triolet
L’engagement (politique, médiatique)
n’est-il pas toujours une imposture ?
Après cette période tragique et à partir des années 1930, l’adhésion au parti stalinien, le culte d’Elsa, enfin le passage à l’acte homosexuel se donnent à lire, avec le recul (et au-delà des utilités psychologiques, morales et politiques incontestables qu’ils peuvent avoir), comme un immense déploiement du burlesque. En effet, Aragon n’a cessé de jouer et de se ridiculiser à travers la mascarade, le maquillage et autres clowneries au coeur même de ses partis pris les plus « sérieux ». Témoin paroxystique, dans notre siècle, d’une variante pathétique et grotesque du tragique, de ce que j’appelais au début de cette introduction à Aragon le « héros impossible ». L’Anti-Oedipe de Deleuze et Guattari [31] a suggéré que certaines expériences « poétiques », telle celle d’Artaud, ignorent la stabilisation oedipienne et oeuvrent dans la psychose. Il n’y a pas, chez les surréalistes, cette exclusion asilaire que connaît Artaud ; au contraire : pour marginale et contestataire qu’elle soit, la position des surréalistes apparaît comme séductrice et intégrée, encadrée dans l’ésotérisme pour Breton et dans l’appareil du Parti en ce qui concerne Aragon dont l’écriture reste éminemment socialisée. Pourtant, c’est dans la tonalité non oedipienne d’un héroïsme impossible que se déploie l’instabilité polymorphe du Narcisse moderne. Ce succédané de l’inconstance baroque, désormais privée de Dieu pourtant, est un barde du féminin qu’il traverse et s’approprie pour mieux jouer le rôle du subtil au coeur des « appareils politiques », avant que ceux-ci ne lèguent leur pouvoir aux écrans télévisés. S’il ne parvient pas à cette intégration qui fait de lui un héros impossible ou le héros de l’impossible, ce versatile risque l’anéantissement. Explorateur de l’irreprésentable, il se compromet en histrion.
À côté de ce tragique intime, l’histoire d’Aragon a l’avantage, si l’on peut dire, de mettre en évidence l’engagement politique comme relève et enchaînement de la révolte tragique. Pour Aragon, l’engagement a eu lieu à un moment de grand malaise subjectif. Il prend des contacts avec le Parti dès 1926 ou 1927 et, après les longues procédures d’usage, se retrouve adhérent.
Quel est le sens de cet engagement dans le contexte de ce que nous avons appris jusqu’à présent de sa vie et de son oeuvre ? Eu égard à la fluidité, à l’instabilité qui prennent l’aspect d’une ambiguïté sexuelle et d’un jeu avec les signes ? Eh bien, on peut l’interpréter comme une sorte de désaveu de l’imaginaire : ce n’est plus dans l’imaginaire ou dans l’écriture que ma révolte s’exercera ; ce sera un acte qui assurera la véritable révolte en tant que celle-ci est simultanément vie psychique et engagement social. L’adoration du groupe social va prendre pour Aragon la suite de l’adoration du féminin. Je ne remets pas en cause ici toutes les bonnes raisons que l’on peut trouver pour justifier l’adhésion à un parti politique ; mais, si l’on cherche à comprendre en profondeur la signification psychique d’une « adhésion », il n’est pas rare de trouver à sa racine une volonté de réparer le père et la loi, pour lutter contre la déception de la dépression, contre l’envahissement par le féminin, contre ce chavirement dans l’a-pensée dont Le Con d’Irène est un si parfait exemple.
Je sais que certains d’entre vous restent sur leur faim, car ils n’ont pas retrouvé dans mon discours le mythe qui les avait séduit chez Aragon : le culte du couple et du peuple, d’Elsa et du Parti. Tout cela vous manque : non seulement parce que ces mythes font partie de l’histoire de France, mais aussi parce que votre imaginaire en est avide. Je dois vous dire que je n’ai pas perdu de vue cette mythologie — et votre exigence — de fidélité au cours de mes développements qui s’arrêtent aux années 1930 ; c’est même en fonction de cette mythologie que je vous ai parlé de ce qui la précède et qui, du fond d’un excès insoutenable dont Irène porte le témoignage, a imposé le recours à l’assurance. Une adhésion, à commencer par celle à la communauté duelle du couple, comporte une assurance identitaire qui garantit notre survie. Nous en voulons tous, et certains d’entre nous y arrivent, avec plus ou moins d’illusions. Grandeur et misère de l’illusion ? Soit. Le « Fou d’Elsa » sait, bien qu’il l’oublie, que l’amour fou qu’il chante est le contrepoids d’une autre folie ; que l’adhésion (à Elsa, au Parti) est appelée à colmater, à apaiser un autre et infini délire, d’Irène... Le sacre du couple contribue à lutter contre l’homosexualité, insinuent les malins. Mieux que cela : à lutter contre l’annulation de soi dans une confusion avec le féminin primaire, dans la génitalité menaçante. Le mythe de la fidélité et de l’adhésion sont d’autant plus nécessaires et réels — d’une réalité hypnotique pour les protagonistes comme pour le public — qu’ils se font fort de stabiliser l’orage. Le faux et le masque, dès lors, même s’ils sont perçus ainsi par les uns et par les autres, inspirent une gêne plus qu’un rejet au critique le plus intransigeant.
Car si nous entrevoyons désormais les causes historiques et sociales des totalitarismes, il n’est pas sûr que nous en ayons démonté les motivations psychiques, ni que nous soyons à l’abri du besoin identitaire qui, trop souvent et sans la monstruosité stalinienne, fait alterner nos révoltes avec nos impostures.
Sans doute sommes-nous ici au coeur de ce qui sous-tend une appartenance : « je » ne sais pas qui « je » suis, « je » ne sais pas si « je » suis (un homme ou une femme) ; mais « j »’en suis, de l’adhésion. Le dégel après la guerre froide, le révisionnisme, la critique du totalitarisme, la chute du mur de Berlin représentent autant de mutations de l’histoire qui réactivent les événements d’une révolte plus personnelle, plus subjective, et qui montrent que les affrontements avec le maternel sacré, d’une part, et la ceinture de sécurité du langage, d’autre part, sont la véritable doublure secrète de l’engagement politique, sa mise en abîme. L’engagement politique est un repère et un masque, la vie d’Aragon en est la preuve.
La raison pratique prenant le relais de l’a-pensée reconduit la contestation : résistance, défense des opprimés, lutte contre la ploutocratie impérialiste ; mais la raison pratique excelle en se compromettant dans des stratégies dialectiques, avant d’échouer dans l’égotisme et la justification critique du totalitarisme. Je vous le dis d’autant plus gravement qu’ayant vécu dans un pays stalinien, je suis de ceux qui ont apprécié les attitudes d’Aragon contre le dogmatisme et comptent sa contribution au dégel dans le processus d’érosion qui conduit à la chute du mur de Berlin. L’enthousiasme de l’adhésion et ce qu’elle implique comme choix de civilisation et comme choix subjectif n’en reste pas moins problématique.
Traître, clown, opportuniste, profiteur, imposteur, menteur, toutes ces épithètes ont collé à l’écrivain en dépit du fait qu’il fut un authentique alchimiste du Verbe, un vrai joueur qui a joué à fond le spectacle de l’adhésion sans jamais se départir de cette dimension de l’insondable qu’il a affrontée sur le terrain de l’écriture, dans une expérience rhétorique et subjective que l’on peut apprécier ou non, mais qui n’en reste pas moins unique.
Est-il légitime de parler, dans ce contexte, d’une impasse de la révolte, d’une impasse de l’imaginaire, au profit de la raison pratique dont le stalinisme est la sinistre apothéose ? On pourrait poser la question autrement : l’expérience imaginaire d’Aragon est-elle audible, lisible sans le support politique, sans la « médiatisation » avant la lettre que la popularité communiste lui procurait et qui lui donnait une de ses raisons d’être ? Aragon est peu lu aujourd’hui. Cet imaginaire, s’aventurant aux limites du sensible et du féminin, que je vous ai décrit comme lui étant spécifique, est-il impossible à sauver sous prétexte qu’il serait mort avec l’appartenance idéologique qui lui était parallèle, associée ? Il y a, en effet, un non-sens de la révolte dans les termes où Aragon l’a utilisée, qui la rend impossible à pratiquer aujourd’hui. Sartre nous en offrira un autre exemple. Et Barthes une tout autre approche.
Demeure néanmoins la question, toujours actuelle, de la pensée qui, lorsqu’elle se déploie comme une vie psychique, lorsqu’elle a l’ambition d’être la vie psychique au sens fort de reviviscence et de résurrection identitaire — au sens de l’a-pensée —, se confronte immanquablement avec le maternel d’une part, avec les signes d’autre part. Cette expérience est-elle inséparable de l’espèce de ceinture de sécurité que peut procurer l’appartenance institutionnelle ? Si oui, laquelle aujourd’hui ? Si non, quelle solitude !
Dans les deux cas, il est à craindre que personne n’en puisse assumer les risques au prix dont Aragon exhibe le paroxysme, mais qui est de structure lorsque le plus fort de l’interdit est associé au plus fort de l’archaïque ou du sensible. Ce qui voudrait dire que, par-delà la liberté, c’est l’a-pensée elle-même qui, avec cette révolte-là, est mise en péril. À moins qu’il ne soit possible de bâtir d’autres liens que les liens partisans de la raison pratique. À l’heure actuelle, tout porte à croire que nous en sommes loin.
Julia Kristeva, Sens et non-sens de la révolte,
Pouvoir et limites de la psychanalyse I, Fayard, 1996.
Livre de poche, Collection : Biblio Essais, 1999.
LA DÉFENSE DE L’INFINI
Philippe Sollers s’est lui aussi penché sur La Défense de l’infini. Le texte éponyme qu’il écrit en 1997 est publié dans Éloge de l’infini (Folio, p. 769-784). Sollers écrit alors :
« Je dis que le drame de La Défense de l’infini, l’histoire de son écriture et de sa quasi-destruction, sont questionnables aujourd’hui pour la première fois. Pour la première fois nous sommes en train de nous demander ouvertement ce qui, dans l’énergie révolutionnaire des années 20-30, s’est ensuite arrêté. Le retour au romanesque d’Aragon, après sa période surréaliste, consiste en réalité à un retour au XIXe siècle. [...]
Considérons que tout le monde ne sera pas d’accord : je vais, en poussant à bout s’il le faut ce que je sens comme souffrance d’Aragon, avancer la défense d’un Aragon qui aura été pendant six ans révolutionnaire. » (c’est Sollers qui souligne)
Six ans, c’est-à-dire de 1921 à 1927. Pendant cette période, Aragon publie Anicet ou le Panorama [32] (1921), Les Aventures de Télémaque (1922), Le Libertinage (1924), Le Paysan de Paris (1926) et, en 1928, Le Con d’Irène [33].
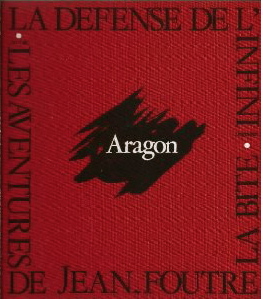
- Édition Messidor, 1986
La Défense de l’infini, a été écrit entre avril 1923 et l’hiver 1927. En janvier 1927, Aragon adhère au Parti communiste. Durant l’automne, en voyage à Madrid avec sa compagne, Nancy Cunard, il brûle une partie du manuscrit. On en retrouvera des fragments au Texas dans les archives de Nancy Cunard, morte en 1965 [34]. Quelques-uns seront publiés par Aragon lui-même, tandis que le reste sera édité, en 1986, après sa mort [35].
En 1969, dans Je n’ai jamais appris à écrire ou les Incipit, Aragon écrit :
Je me jetai, comme par une négation du groupe [surréaliste], dans une entreprise sans autre exemple dans ma vie, que je ne cachai point à mes amis, mais sans qu’ils en connussent le vrai développement, les perspectives, le dessin, le dessein... ce roman à quoi je sacrifiais quatre ans de ma folie, dont il n’est guère demeuré que le titre que lui donnais alors, qu’il n’aurait sûrement pas porté à jamais venu à terme, la Défense de l’infini, et que j’ai détruit en 1927.
Pourquoi Aragon a-t-il détruit le livre ? Parce que ses amis y virent « la poursuite isolée de la stupide aventure littéraire » qui motiva la rupture de Breton, Péret, Eluard et Unik avec Artaud et Soupault en novembre 1926 [36] ? Parce que sa certitude « d’avoir réinventé le roman » (genre littéraire que Breton exécrait) et la publication d’un fragment « sous le nom de Cahier noir, dans la Revue Européenne » « déchaîna un drame entre [ses] amis et [lui] » (Le libertinage [37]) ? Parce que Nancy Cunard en désapprouva l’écriture ? Nous en sommes réduits aux hypothèses.
Le Con d’Irène, un des chapitres du roman paraîtra « sous le manteau » et sans nom d’auteur en 1928, avec des illustrations d’André Masson. C’est Régine Deforges qui, en 1968, le rééditera sous le titre d’Irène et avec le pseudonyme d’Albert de Routisie. Aragon ne reconnaîtra jamais en être l’auteur.
LE CON D’IRÈNE
Illustrations d’André Masson pour la première édition (1928)
Cliquer sur la première image pour agrandir
A gauche : Page de titre de la première édition (1928).
A droite : Illustration d’André Masson

A gauche : ... une seule reconstitution de la Cathédrale de Chartres sans oublier une seule ogive (p. 40).
A droite : ... dans ses limites nacrées, la belle image du pessimisme ! (p. 63)

A gauche : ... Elle s’est attachée un peuple de filles qui n’ont d’autre désir que la grandeur de sa maison (p. 73).
A droite : ça ne fait rien, c’est quelque chose, l’amour d’Irène. (p. 76)

Crédit : Éditions Messidor.
Le con d’Irène a été réédité sous le nom d’Aragon au Mercure de France en mai 2000. Sollers en a rédigé la préface.
ARAGON SECRET

par Philippe Sollers
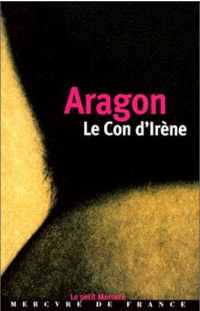
- Préface de Philippe Sollers
Comme il est seul, Aragon, en 1926, dans la province française ! L’aventure surréaliste est lancée, il en est le virtuose associé à Breton, le langage de la liberté vient d’être retrouvé à travers le libertinage et le rêve. Il écrit sans cesse ce gros livre qu’il voudra nier, détruire, oublier, et dont le titre dit tout : Défense de l’infini. Le con d’Irène n’en est qu’un chapitre, publié anonymement en 1928. Que d’histoires à propos de ce petit volume, que de rumeurs, de remous policiers, montrant à quel point la société est toujours sur la défensive si elle pressent en elle une fuite vers le non-fini !
« J’écrivais donc. Le temps devait être brûlé par quelque pierre infernale. La seule que je connaisse est la pensée, et j’ai dit qu’écrire est ma seule méthode de pensée. J’écrivais. J’ai toujours envié les érotiques, ces gens libres. Ils n’écrivent pas. »
Mais si, mais si, les érotiques écrivent parfois, et c’est bien ce qu’on leur reproche. Dans ces années vingt, décidément révolutionnaires (elles seront sévèrement punies par la suite), tout ce qui a été refoulé resurgit : Sade, Lautréamont, Rimbaud, l’explosion des frontières. Ulysse, de Joyce, vient de faire scandale, George Bataille est déjà là. Pourtant, la province règne, la « Grande Guerre » a multiplié les veuves, les rages, les soupçons. La IIIe République et ses hypocrisies de notables semble increvable. On ne s’amuse guère dans un bordel de campagne.
« La province française. La laideur des Françaises. La stupidité de leur corps, leurs cheveux. Petites rinçures. Bon. »
Livre érotique, Le con d’Irène ? Pas vraiment. Regardez :
« Quelle tristesse dans toutes les réalisations de l’érotisme ! Je pense à la lourdeur des chiens dans la rue, s’attroupant, et tâchant de s’enfiler à qui mieux mieux. Les chiens d’à côté avaient des bottes, voilà tout. »
Ce sont des soldats, ils font ce qu’ils peuvent. Et maintenant, on est à la ferme, c’est un vieux paralytique qui parle : « J’ai perdu le compte des années. » Aragon nous introduit dans le vrai sujet de la conscience nationale : un matriarcat de fer. Au commencement est une femme pieuse, la Mère, et puis vient la fille, Victoire, et la petite-fille, Irène. Le paralytique muet assiste à la débauche progressive de ses enfants : « L’inceste unissait sa grande voix tonnante à la tourmente de blasphèmes qui me traversaient. » Les femmes instrumentalisent les hommes présents, Gaston, Pierre, Joseph, Prudent. Cloué dans son fauteuil, le vieux jouit de la haine qu’il provoque, comme de la sienne propre. Il faut ici, comme par anticipation, entendre la voix de quelqu’un qui sera le vieil Aragon :
« Imbéciles spectateurs, vous ne comprendrez jamais rien... Si vous saviez seulement, jeunes gens qui riez de l’infirme, quelle espèce de joie sourde, quel frémissement éveille au fond de ma chair engourdie, le bruit léger de vos dérisions. Ah, riez, riez encore, beaux abrutis de vingt ans. Je vous tiens par le plaisir même que j’éprouve à vous écouter. Encore, encore riez de moi, je vous en prie, à en devenir rouges, à en étrangler, à en suffoquer. Là, là. »
C’est la grande joie terrible du masochisme. Un vieillard pétrifié devant sa fille tribade et sa petite-fille nymphomane : quel raccourci d’histoire annonçant l’orage, le stalinisme, le fascisme, les années 40-44, bref les dessous de l’Hexagone en folie. Aragon va devenir stalinien ? Oui, par terreur.
Soudain, le ton change, des poissons apparaissent. Ce sont de « souples masturbateurs », de « promptes images du plaisir, purs symboles de pollutions involontaires ». Nous allons vers une révélation sacrée, celle du con d’Irène, scène aussi incongrue que le fameux tableau de Courbet caché pendant tant d’années : L’origine du monde [38]. Ce qui frappe d’emblée, c’est le ton religieux d’Aragon devant ce dévoilement, son ivresse sacrée. Il s’agit bien d’une « église », d’une « ogive sainte ». Un palais, un écrin, une alcôve, une bouche de communion qui est en même temps un abîme. Le mot BONHEUR apparaît en capitales vers ces « lèvres adorables qui ont su donner aux baisers un sens nouveau et terrible, un sens à jamais perverti ». Éloge des nymphes. « Sous le satin griffé de l’aurore, la couleur de l’été quand on ferme les yeux. » Irène, avec son bouton « avertisseur d’incendie », part, avec ses partenaires, dans les « caravanes du spasme ». Une femme prend son plaisir : « Irène est comme une arche au-dessus de la mer. » Le jeune Louis Aragon devient de plus en plus Irène, Louireine. C’est qu’elle « pense beaucoup aux hommes », celle-là, qu’elle « s’empare d’un homme comme l’eau des marais, par infiltration sourde ». Contrairement à sa mère, Victoire, qui préfère les femmes, Irène trouve que « le corps de l’homme a quelque chose de très fort, qui l’appelle ». Nous sommes décidément dans une drôle de famille, « où depuis deux générations les mâles ont été réduits par leurs compagnes ». Analyse fine et prophétie : il s’agit du « triomphe des femmes et de leur orgueilleuse santé ». On comprend mieux pourquoi Aragon s’obstinera, plus tard, à répéter que la femme est l’avenir de l’homme. La terreur communiste, sur ce long chemin, n’aura été qu’une étape, une ruse de l’Histoire, un intermède mortel. Bien entendu, l’homosexualité masculine sera inscrite au programme : Irène est déjà une reine des abeilles mâles, « elle pense sans grand détour que l’amour n’est pas différent de son objet, qu’il n’y a rien à chercher ailleurs ». Les hommes sont simples : ils fonctionnent. Irène peut donc s’en servir en usant d’un « vocabulaire brûlant et ignoble ». Mieux : « Elle se roule dans les mots comme dans une sueur. »
Qui pouvait lire vraiment Le con d’Irène jusqu’à une époque récente ? Qui aurait osé penser que Sade serait un jour imprimé sur papier bible ? Il n’y a plus de livre sous le manteau, plus d’Enfer. Aragon, dans les années vingt du XXe siècle, brûle ses vaisseaux. Pas de retour possible en bourgeoisie, pas de compréhension de la part de ses amis surréalistes. Il va entrer dans l’ordre « prolétarien », c’est-à-dire là où on ne se doute de rien. Le camarade Aragon serait l’auteur du Con d’Irène ? Vous voulez rire, c’est une provocation. Et pourtant, la planète de la censure tourne, la Défense de l’infini nous montre que rien n’était fatal dans la régression « poétique » ou « réaliste » qui a suivi. Cela gêne encore beaucoup de monde ? Trop. Pour l’instant, restons avec Irène :
« Il flotte autour d’elle un grand parfum de brune, de brune heureuse, où l’idée d’autrui se dissout. »
Philippe Sollers, L’Infini 71, Automne 2000.
Préface à Aragon, Le con d’Irène, Mercure de France, 2000.
Sollers sur Aragon
En 1997, Sollers intervenait sur La défense de l’infini et Le con d’Irène
(France Culture, Aragon, une voix sans mesure)

Et après ça...

PORTRAITS CROISÉS : ARAGON ET ELSA TRIOLET

A « la vitrine du libraire », 22 février 1964.
1. Aragon évoque les heures de Montparnasse et sa rencontre avec Elsa Triolet.

2. Extrait de l’interview de Louis Aragon : « dans toute mon oeuvre même là ou Elsa n’est pas nommée elle est présente — ce n’est pas d’Elsa physique dont il est question, bien sûr il y a "les yeux D’Elsa" les "Mains d’Elsa" — mais pour moi c’est aussi l’aventure intellectuelle de ma vie. »

3. Extrait de l’interview d’Elsa Triolet


- Renaud Camus et Aragon au Palace, 1977. © Philippe Morillon
Dans son Journal couvrant les années 1976 et 1977, l’écrivain Renaud Camus évoque ses rencontres avec Louis Aragon.
« Lorsque j’ai fait sa connaissance, en 1976, Aragon était un homme illustre. Il vivait pourtant dans une solitude effrayante. Lors de nos longues marches dans Paris, sa célébrité, ses tenues de « planteur des îles », ses grands chapeaux clairs faisaient se retourner les passants sur sa silhouette. Mais il vivait dans la hantise de se retrouver seul le soir et appelait souvent à l’heure du dîner pour trouver un peu de société. Il se lançait dans de longs monologues, où il évoquait sa tentative de suicide à Venise par amour pour la milliardaire Nancy Cunard, son éprouvant voyage à Moscou avec Gide au moment des premières purges, son amour pour Elsa, son goût pour Barrès... C’était une fenêtre merveilleuse sur le siècle. Il ne voulait jamais se coucher, toujours prêt à sortir, au Palace ou ailleurs. Je me souviens aussi que, le soir de la mort d’André Malraux, il s’est mis à danser le tango avec moi dans l’appartement parisien d’Andy Warhol. » [39]
ARAGON, HOMOPHOBES ET CENSEURS
par Jacques Henric
Trente-trois ans après notre dernier échange, vingt-deux après sa mort, je m’aperçois que je n’en ai pas fini avec Aragon.
Mai 2004. Hommage du Centre Pompidou à l’écrivain, au poète, au romancier, au politique. Deux jours de colloque. Responsable : Daniel Bougnoux, universitaire, excellent commentateur de l’oeuvre d’Aragon, maître d’oeuvre du premier volume de la Pléiade [40]. Thèmes de la première journée : « Aragon et la modernité », « Aragon et la politique » (interventions de Philippe Forest et de Régis Debray). Jean Ristat et moi sommes invités par Daniel Bougnoux à parler librement de l’homme Aragon que nous avons connu ; Ristat du Aragon des dernières années ; moi, du Aragon des années 60-70. Public attentif. Ristat parle avec émotion de l’amitié qui le lia à « Louis » jusqu’à la fin de la vie de celui-ci. Après lui, j’évoque les rapports beaucoup plus distants que j’ai entretenus avec Aragon dans une des périodes les plus tendues de la vie politique française, je rappelle les conflits qui nous opposèrent et je termine en disant qu’avec le temps le souvenir de nos polémiques s’est estompé, qu’elles ont perdu de l’importance à mes yeux, et qu’Aragon est pour moi un des deux ou trois grands romanciers français du XXe siècle, j’ajoute que j’ai pour l’homme, pour cet homme qu’il m’est arrivé de détester, une estime qui ne cesse de croître. Je crois bon, pour finir, d’appeler à une relecture critique de son oeuvre à la lumière de ce qu’on a appris de sa sexualité. Aucune indiscrétion de ma part. L’homosexualité de l’auteur des poèmes d’amour à Elsa est depuis plusieurs années de notoriété publique. Elle s’est manifestée au grand jour après la mort d’Elsa Triolet, mais je savais par André Stil (comme d’autres l’ont su très tôt) qu’elle avait été une des faces cachées de l’existence d’Aragon. Aucune volonté de ma part, donc, de balancer un croustillant ragot. Je suggère simplement que la connaissance de l’oeuvre romanesque et poétique serait enrichie sous cet éclairage-là. Pas de réactions de la salle. On passe au débat entre nous, les intervenants, lequel débat doit se poursuivre avec le public.
Je profite de la présence à mes côtés de Jean Ristat pour lui poser une question que je souhaite lui adresser depuis longtemps : pourquoi, diable, dans tous les textes qu’il a écrits sur Aragon, en particulier celui de l’Album de la Pléiade, le nom d’André Stil n’apparaît jamais, alors que Stil a joué un rôle important non seulement dans la vie du PC, mais singulièrement dans celle d’Aragon ? Jean Ristat confirme l’élimination de ce nom (qui n’est pas sans me rappeler la pratique des photos retouchées sous le règne de Staline). Cet « oubli », Ristat le reconnaît volontaire et le revendique. La raison ? L’indignation qui avait été la sienne en prenant connaissance d’une anecdote rapportée par Stil dans un livre d’entretiens, Une vie à écrire. Stil, répondant à une question de Jean-Claude Lebrun, raconte que lors d’un comité central, entre deux séances, il se retrouve avec Louis pour une pose pipi dans les toilettes en sous-sol, et Louis, avec une mine de conspirateur, sort alors une photo de son portefeuille, qu’il lui tend. Des jeunes hommes nus (mais casqués et bottés) en train de se sodomiser en file dans la neige, « comme en un monôme à la Breughel », commente Aragon. Des soldats. De beaux gaillards. Oui, mais des soldats allemands ! De jeunes SS !... Ristat scandalisé. Odieuses calomnies de Stil. Jamais Louis n’aurait pu se délecter à la vue de jeunes nazis en train de s’enfiler ! Moi, dubitatif. Connaissant Aragon, et connaissant Stil, pas assez malin pour inventer une anecdote pareille, j’incline à penser que son récit était véridique. Et je trouve l’histoire plutôt plaisante, susceptible en tout cas de me rendre Aragon encore un peu plus humain et plus sympathique. Aux yeux du camarade Ristat, si les bidasses avaient été soviétiques, la morale était-elle sauve ? Sexuellement incorrect, le camarade Louis, on dit bravo ! Mais un enculage politiquement incorrect, ça non !
Notre séance prend fin. Plus assez de temps pour donner la parole à la salle. Daniel Bougnoux nous remercie chaleureusement, Philippe Forest, Jean Ristat et moi. Nous avons mis un peu de vie dans un colloque qui ronronnait et l’idée est lancée de poursuivre ailleurs cet échange entre nous. Daniel Bougnoux quitte la tribune pour retrouver dans le hall Régis Debray qui attend d’intervenir après nous. Forest, Ristat et moi, on s’attarde. La traversée de l’amphi pour gagner la sortie tient de la course d’obstacles. Nous voilà Ristat et moi violemment pris à partie par des énergumènes déchaînés. Anciens ou nouveaux adhérents du PC ? Vieux universitaires à la retraite ? Versificateurs lyriques en transes, tombés des génitoires du Poète de l’Amour ? Sectateurs enfiévrés du Couple ? Homophobes sans vergogne ? Et que c’est un scandale ce que nous avons dit du camarade Aragon ! Et que nous sommes d’indignes calomniateurs, de vils provocateurs ! Et que c’est honteux de salir ainsi un grand écrivain avec une salingue histoire de chiotte et de photos pornos... ! On se fraie tant bien que mal un passage au milieu de la petite troupe vociférante et on retrouve Daniel Bougnoux dans le hall du Centre. Il est en conciliabule avec son ami Régis Debray. On s’approche, je sens une gêne, une atmosphère lourde. Je tends la main à Debray qui ostensiblement me tourne le dos et s’éloigne. J’apprends par Bougnoux que « Régis » est fou de rage à cause de nos propos et que, choqué, indigné, il menace de ne pas conduire le débat suivant. Et je vois, éberlué, le même Daniel Bougnoux qui, il y a à peine deux minutes, nous tressait des couronnes de lauriers, soudain rouge de colère et de réprobation, nous faisant la morale, déclarant que nous étions conduits de façon déshonorante et que ce qui venait de se produire resterait une « tache » sur ce colloque... Pas besoin d’un dessin, on comprend que, travaillant aux côtés de Régis Debray aux Cahiers de médiologie, Daniel Bougnoux vient de se faire remonter les bretelles par son directeur de revue. Leçon de ce psychodrame : puritanisme et homophobie ont encore de beaux jours devant eux.
Jacques Henric, mondes francophones, 2004, Politique, Seuil, 2007, p. 148-151.
La Compagnie des auteurs par Matthieu Garrigou-Lagrange, 14/17 mars 2016.
Aragon ou le mentir-vrai

- Aragon en 1980. Crédit : Francis Apesteguy.
Comment résumer en une heure la vie aux multiples couches de Louis Aragon (1897-1982), poète et romancier, surréaliste et communiste, journaliste et éditeur ? C’est le premier pari d’une semaine consacrée à l’écrivain en écho au 18ème Printemps des Poètes.
"Mon destin et l’écriture ont toujours été une seule et même chose." Louis Aragon
C’est un peu une gageure que de faire tenir Louis Aragon en 4 fois une heure, car sa vie tout comme son œuvre est touffue, complexe, riche, sujette à interprétations et à digression sans fin… car l’homme a avancé masqué et a embrassé tous les remous de l’histoire… deux guerres plus une guerre froide si l’on peut dire… des amours nombreux et orageux… et cela d’un sexe à l’autre…Une vie marquée par l’intensité, au risque de se perdre. Sans parler de l’histoire de la littérature à laquelle il a participé grandement, lui qui n’aurait manqué pour rien au monde l’occasion de faire partie d’une avant-garde.
Personnage mystérieux, secret, Louis Aragon, au patronyme totalement inventé, réinventera sa vie constamment. Comment déceler la part du vrai et du faux ? Louis Aragon, mystère d’une vie romancée avec l’écrivain Philippe Forest, auteur d’une biographie somme de 800 pages, intitulée Aragon éditée chez Gallimard en septembre 2015.


Louis Aragon : Poète avant tout
Louis Aragon (1897-1982) est-il écrivain ou poète ? Peut-on dissocier les deux formes ? Est-il un poète avant d’être romancier ? Nous nous plongeons dans l’œuvre poétique plurielle d’Aragon pour ce deuxième volet.

- Louis Aragon et Elsa Triolet.
Tes yeux sont si profonds qu’en me penchant pour boire
J’ai vu tous les soleils y venir se mirer
S’y jeter à mourir tous les désespérés
Tes yeux sont si profonds que j’y perds la mémoire"Extrait du poème Les Yeux d’Elsa, de Louis Aragon, 1942.
La poésie de Louis Aragon est marquée par diverses formes syntaxiques et littéraires, allant du surréalisme au classicisme. Sa poésie est marquée par trois périodes : celle du surréalisme, celle du militantisme et la dernière, plus intime. Aragon est aujourd’hui considéré comme un poète majeur du XXème siècle, avec des textes mis en lumière par les grands chanteurs de ce siècle comme Léo Ferré, Jean Ferrat ou encore Brassens. Sans oublier l’influence conséquente de sa femme Elsa Triolet, un amour qui clame au cœur d’un très grand nombre de ses poèmes.
Louis Aragon est-il avant tout un poète ? Réponse avec Olivier Barbarant, poète, essayiste, éditeur des deux tomes Œuvres Poétiques pour la bibliothèque de la Pléiade et auteur de Aragon : La Mémoire et l’Excès en 1997 (Champ Vallon).


Compagnonnage communiste

- Louis Aragon devant le portrait du poète Maïakovski.
Crédits : Roger Viollet.
Du premier voyage de Louis Aragon (1897-1982) en URSS durant l’été 1930 à son engagement politique au sein du Parti communisme jusqu’à sa mort, de l’Humanité à la direction des Lettres Françaises, parcours d’un journalisme politique pour ce troisième épisode consacré à Louis Aragon.
En première partie, nous recevons Jacques Henric, critique, essayiste et romancier, qui a débuté aux Lettres Françaises, journal culturel né pendant la résistance, de 1960 à 1968, alors dirigées par Louis Aragon. Il nous raconte ses souvenirs de journaliste sous la direction de Louis Aragon.

En seconde partie, entretien avec Pierre Lepape, écrivain, critique littéraire, essayiste, est l’auteur du livre Le Pays de la littérature, des serments de Strasbourg à l’enterrement de Sartre publié en 2003 (Points Essai), où il propose au lecteur un voyage dans le temps, onze siècles, du IXème au XXème siècle , du 14 février 842, quand fut signé le Serment de Strasbourg au 19 avril 1980, à 14h, aux obsèques de Jean-Paul Sartre.
Deux ans plus tard, le 28 décembre 1982, ce sont les obsèques de Louis Aragon, à la place du Colonel Fabien, où se trouvait le siège du Parti communiste, était néanmoins noire de monde, avec là aussi plusieurs milliers de personnes se pressant autour du catafalque, dès 8 heure du matin, comme le raconte Philippe Forest à la toute fin de sa biographie… Mais avec Pierre Lepape, on voudrait parler d’un autre voyage, le premier voyage qu’Aragon fit en Russie, ou plutôt en URSS, pays qui sera déjà comme son paradis…

Louis Aragon : L’Art du roman

- Louis Aragon en 1951.
Crédits : Henri Martinie/Roger Viollet.
Émission au Salon Livre Paris avec Daniel Bougnoux, philosophe, professeur à l’Université Stendhal de Grenoble III, éditeur des œuvres romanesques de la Pléiade en cinq tomes, publiées entre 1997 et 2012, auteur notamment de Le vocabulaire d’Aragon chez Ellipses en 2001 ou encore Aragon, la confusion des genres en 2012 chez Gallimard.


Aragon, une voix sans mesure
1997 — Personnage mystérieux, secret, Louis Aragon, au patronyme totalement inventé, réinventera sa vie constamment. Comment déceler la part du vrai et du faux ?
En 1982, disparaissait l’un des écrivains français parmi les plus considérables de la littérature mondiale.
Aragon fut un des hommes les plus ambigus de l’histoire de la littérature du XXème siècle : il aura toujours été en "porte à faux". Romancier-surréaliste (alors que le surréalisme rejetait le roman), puis après son entrée fracassante au Parti Communiste Français (parti qui utilisera toujours les thèmes de la liberté contre la liberté), Aragon sera un homme libre et un homme du parti. Cette ambiguïté divise son oeuvre et lui permet de travailler et d’écrire dans plusieurs registres de discours.
Aujourd’hui, la querelle politique autour du nom d’Aragon doit laisser place à la lecture. Avant toute chose, il aura été celui qui récapitulait les formes, toutes les formes de la poésie française et qui réhabilitait le roman politique en achevant la tradition commencée par Barrès. C’est l’écrivain inspiré par Sthendal mais aussi l’inventeur de "La mise à mort" et de "Blanche ou l’oubli" qui nous importe. Aragon est pour son lecteur un des plus formidables analystes des clivages et des interdits culturels.
Lire Aragon, c’est se confronter soi-même à tout ce qui borne notre pensée. Nous sommes mis en demeure d’être sans cesse au-delà de nos propres appartenances à nos systèmes d’enfermements culturels, politiques, idéologiques, sexuels.. .
Lire Aragon est un travail qui nous permet de réévaluer notre bibliothèque intérieure, car Aragon est avant tout un des plus grands écrivains de tous les temps, égal pour notre siècle à Joyce ou à Pound.
Par Christine Goémé
Avec Jean d’Ormesson, Olivier Barbarant, Daniel Bougnoux, Marc Dachy, Dominique Desanti, Charles Dobzinsky, Lionel Follet, Yannick Haenel, Christian Jambet, Pierre Lartigue, Jean Ristat, Guy Scarpetta, Georges Sebbag, André Thirion, Philippe Sollers et la voix d’Aragon.
Réalisation Evelyne Frémy et Marie-Rose Derouet. France Culture.
Une voix sans mesure - Aragon (1897-1982) 1/2 : Faites entrer l’infini.
1ère diffusion : 16/08/1997.



Une voix sans mesure - Aragon (1897-1982) 2/2 : Je n’ai pas d’autre azur que ma fidélité.
1ère diffusion : 17/08/1997.



Vous pouvez prolonger le plaisir par ce document qui vous est proposée dans la collection Les Grandes Heures (Radio France / Ina) "Louis Aragon. Il n’y a pas d’amour heureux ?".
UN DESSIN D’ARAGON
Le coeur a toujours son ombre de pique. Dessin d’Aragon. Photo Bricage.
Les Lettres françaises, mars 1992 (archives A.G.)

[2] C’est pourtant là le point essentiel. Pleynet écrit dans ses Chroniques du journal ordinaire (L’Infini 60, hiver 1997) :
Dans la mesure où mon Lautréamont écrivain de toujours met essentiellement l’accent sur l’appareil topologique constitué par l’unité des Chants de Maldoror et des Poésies, je lis, dans les quelques cent pages qu’il détermine Aragon à écrire, beaucoup plus une entreprise de recouvrement biographique qu’une tentative d’éclaircissement de ce qui s’est joué en 1930.
C’est aussi sur la signification de la rupture, en 1930, d’Aragon avec le surréalisme, ou, plus précisément, comme l’écrit Pleynet, avec le « dévoilement de l’essence de la vérité dans l’oeuvre de Rimbaud et de Lautréamont » qu’avait, le premier, perçu Aragon, avec « sa lecture de Rimbaud et de Lautréamont telle qu’en témoignent les oeuvres essentielles auxquelles il s’est consacré de 1916 à 1929 », que porte, en 1967 et dans les années qui suivront, le « malentendu » entre Aragon et Tel Quel.
Lire aussi mon article Lautréamont politique aujourd’hui comme jamais.
[3] Cf. dans le passage consacré à « avril 1970. Le colloque de Cluny II : "Littérature et idéologies" » dans mon dossier Derrida, tel quel. Philippe Forest, lui, en parle dans son Histoire de Tel Quel, Seuil, p. 350-354.
[4] Avez-vous déjà giflé un mort ? ?
La colère me prend si, par quelque lassitude machinale, je consulte parfois les journaux des hommes. C’est qu’en eux se manifeste un peu de cette pensée commune, autour de laquelle, vaille que vaille, un beau jour ils tombent d’accord. Leur existence est fondée sur une croyance en cet accord, c’est là tout ce qu’ils exaltent, et il faut pour qu’un homme recueille enfin leurs suffrages, pour qu’aussi un homme recueille les suffrages des derniers des hommes, qu’il soit une figure évidente, une matérialisation de cette croyance.
Les conseils municipaux de localités à mes yeux indistinctes s’émeuvent aujourd’hui d’une mort, posent au fronton de leurs écoles des plaques où se lit un nom. Cela devrait suffire à dépeindre celui qui vient de disparaître, car l’on n’imagine pas Baudelaire, par exemple, ou tout autre qui se soit tenu à cet extrême de l’esprit qui seul défie la mort, Baudelaire célébré par la presse et ses contemporains comme un vulgaire Anatole France. Qu’avait-il, ce dernier, qui réussisse à émouvoir tous ceux qui sont la négation même de l’émotion et de la grandeur ? Un style précaire, et que tout le monde se croit autorisé à juger par le voeu même de son possesseur ; un langage universellement vanté quand le langage pourtant n’existe qu’au-delà, en dehors des appréciations vulgaires. Il écrivait bien mal, je vous jure, l’homme de l’ironie et du bon sens, le piètre escompteur de la peur du ridicule. Et c’est encore très peu que de bien écrire, que d’écrire, auprès de ce qui mérite un seul regard. Tout le médiocre de l’homme, le limité, le peureux, le conciliateur à tout prix, la spéculation à la manque, la complaisance dans la défaite, le genre satisfait, prudhomme, niais, roseau pensant, se retrouvent, les mains frottées, dans ce Bergeret dont on me fera vainement valoir la douceur. Merci, je n’irai pas finir sous ce climat facile une vie qui ne se soucie pas des excuses et du qu’en dira-t-on.
Je tiens tout admirateur d’Anatole France pour un être dégradé. Il me plaît que le littérateur que saluent à la fois aujourd’hui le tapir Maurras et Moscou la gâteuse, et par une incroyable duperie Paul Painlevé lui-même, ait écrit pour battre monnaie d’un instinct tout abject, la plus déshonorante des préfaces à un conte de Sade, lequel a passé sa vie en prison pour recevoir à la fin le coup de pied de cet âne officiel. Ce qui vous flatte en lui, ce qui le rend sacré, qu’on me laisse la paix, ce n’est pas même le talent, si discutable, mais la bassesse, qui permet à la première gouape venue de s’écrier : « Comment n’y avais-je pas pensé plus tôt ! » Exécrable histrion de l’esprit, fallait-il qu’il répondît vraiment à l’ignominie française pour que ce peuple obscur fût à ce point heureux de lui avoir prêté son nom ! Balbutiez donc à votre aise sur cette chose pourrissante, pour ce ver qu’à son tour les vers vont posséder, râclures de l’humanité, gens de partout, boutiquiers et bavards, domestiques d’état, domestiques du ventre, individus vautrés dans la crasse et l’argent, vous tous, qui venez de perdre un si bon serviteur de la compromission souveraine, déesse de vos foyers et de vos gentils bonheurs.
Je me tiens aujourd’hui au centre de cette moisissure, Paris, où le soleil est pâle, où le vent confie aux cheminées une épouvante et sa langueur. Autour de moi, se fait le remuement immonde et misérable, le train de l’univers où toute grandeur est devenue l’objet de la dérision. L’haleine de mon interlocuteur est empoisonnée par l’ignorance. En France, à ce qu’on dit, tout finit en chansons. Que donc celui qui vient de crever au coeur de la béatitude générale, s’en aille à son tour en fumée ! Il reste peu de choses d’un homme : il est encore révoltant d’imaginer de celui-ci, que de toute façon il a été. Certains jours j’ai rêvé d’une gomme à effacer l’immondice humaine.
Louis Aragon
A LA PROCHAINE OCCASION IL Y AURA UN NOUVEAU CADAVRE
[18 Octobre 1924] (in Tracts surréalistes).
[5] Lire aussi les extraits du journal de Marcelin Pleynet publiés dans le n° 60 de L’Infini (hiver 1997), p. 109-118, à l’occasion de la publication des Oeuvres romanesques complètes d’Aragon, tome I, dans la Pléiade.
[6] Divers documents : articles, vidéos, illustrations, etc., ont été ajoutés par moi. A.G.
[7] Cf. « Débat sur le roman », Cerisy-la-Salle, septembre 1963 : débat organisé par le groupe de Tel quel sur le thème « Une littérature nouvelle ? » (dirigé par M. Foucault, avec G. Amy, J.-L. Baudry, M.-J. Durry, J.P. Faye, M. de Gandillac, C. Ollier, M. Pleynet, E. Sanguineti, P. Sollers, J. Thibaudeau J. Torrel), Tel quel, n° 17, printemps 1964, pp. 12-54.)
M. Foucault :
Je n’ai à parler absolument aucun titre que ma naïveté, et je voudrais dire deux ou trois mots sans autre lien que celui de ma curiosité. Ce que je voudrais faire, c’est dire comment j’ai compris hier le texte de Sollers [Logique de la fiction, voir Tel quel, n° 15, automne 1963, p. 3-29.], la raison au fond pour laquelle je lis Tel quel, pour laquelle je lis tous les romans de ce groupe dont la cohérence est tout de même très évidente, sans que peut-être on puisse encore la formuler en termes explicites et dans un discours. Qu’est-ce qui m’intéresse, moi, homme naïf avec mes gros sabots de philosophe ? J’ai été frappé d’une chose, c’est que, dans le texte de Sollers et dans les romans que j’ai pu lire, il est fait sans cesse référence à un certain nombre d’expériences — si vous voulez, j’appellerai ça, avec beaucoup de guillemets, des expériences spirituelles (mais enfin le mot spirituel n’est pas bon) — comme le rêve, comme la folie, comme la déraison, comme la répétition, le double, la déroute du temps, le retour, etc. Ces expériences forment une constellation qui est probablement très cohérente. J’ai été frappé par le fait que cette constellation, on la trouve déjà à peu près dessinée de la même manière chez les surréalistes. Et, au fond, je crois que la référence souvent faite par Sollers à André Breton, ce n’est pas un hasard. Entre ce qui se fait actuellement à Tel quel et ce qui se faisait chez les surréalistes, il me semble qu’il y a comme une appartenance, une sorte d’isomorphisme. Et alors, la question que je me pose, c’est : quelle est la différence ? Quand Sollers parle du retour ou de la réminiscence, ou quand dans ces textes on parle du jour et de la nuit et du mouvement par lequel le jour et toute lumière se perdent dans la nuit, etc., en quoi est-ce différent d’expériences qu’on peut trouver chez les surréalistes ? ... Il me semble — mais sans que j’en sois très sûr — que les surréalistes avaient placé ces expériences dans un espace qu’on pourrait appeler psychologique, elles étaient en tout cas domaine de la psyché ; en faisant ces expériences, ils découvraient cet arrière-monde, cet au-delà ou en-deçà du monde et qui était pour eux le fond de toute raison. Ils y reconnaissaient une sorte d’inconscient, collectif ou non. Je crois que ce n’est absolument pas ce que l’on trouve chez Sollers et dans le groupe Tel quel ; il me semble que les expériences dont Sollers a parlé hier, il ne les place pas dans l’espace de la psyché, mais dans celui de la pensée ; c’est-à-dire que, pour ceux qui font de la philosophie, ce qu’il y a de tout à fait remarquable ici, c’est qu’on essaye de maintenir au niveau d’une expérience très difficile à formuler — celle de la pensée — un certain nombre d’épreuves limites comme celles de la raison, du rêve, de la veille, etc., de les maintenir à ce niveau de la pensée — niveau énigmatique que les surréalistes avaient, au fond, enfoncé dans une dimension psychologique. Dans cette mesure, je crois que des gens comme Sollers reprennent un effort qui a été bien souvent interrompu, brisé, et qui est aussi celui de Bataille et de Blanchot. Pourquoi est-ce que Bataille a été pour l’équipe de Tel quel quelqu’un de si important, sinon parce que Bataille a fait émerger des dimensions psychologiques du surréalisme quelque chose qu’il a appelé « limite », « transgression », « rire », « folie », pour en faire des expériences de la pensée ? Je dirais volontiers que se pose alors la question : qu’est-ce que c’est que penser, qu’est-ce que c’est que cette expérience extraordinaire de la pensée ? Et la littérature, actuellement, redécouvre cette question proche mais différente de celle qui a été ouverte récemment par l’oeuvre de Roussel et de Robbe-Grillet : qu’est-ce que voir et parler ?
Il me semble qu’il y a une seconde chose : pour les surréalistes, le langage n’était au fond qu’un instrument d’accès ou encore qu’une surface de réflexion pour leurs expériences. Le jeu des mots ou l’épaisseur des mots étaient simplement une porte entrebâillée vers cet arrière-fond à la fois psychologique et cosmique ; et l’écriture automatique, c’était la surface sur laquelle venaient se refléter ces expériences. J’ai l’impression que pour Sollers le langage est au contraire l’espace épais dans lequel et à l’intérieur duquel se font ces expériences ; c’est dans l’élément du langage — comme dans l’eau, ou dans l’air — que toutes ces expériences se font ; d’où l’importance pour lui de quelqu’un comme Ponge. Et le double patronage Ponge-Bataille qui peut paraître un peu curieux et sans cohérence trouverait là son sens ; l’un et l’autre ont arraché au domaine psychologique, pour les restituer à celui de la pensée, une série d’expériences qui Ont leur lieu de naissance, leur espace propre dans le langage ; c’est pourquoi les références philosophiques que Philippe Sollers a citées m’ont paru cohérentes. Tout l’antipsychologisme de la philosophie contemporaine, c’est bien dans cette ligne-là que Philippe Sollers se place.
Michel Foucault, Dits et écrits 1954-1988, Tome I, Gallimard, 1994.
[8] Cf. Bernard Féron, L’affaire Siniavski-Daniel.
[9] Ce point est contesté par Michel Appel-Muller, organisateur du colloque, dans Printemps 1968 : le pourquoi et le comment de Cluny :
Je trouve dans l’article de Philippe Forest [...] cette appréciation du colloque de Cluny :
En avril 1968, le ralliement de la revue [Tel Quel] à la cause du Parti paraît chose acquise : le colloque organisé à l’abbaye de Cluny par La Nouvelle Critique a surtout été l’occasion d’une confrontation des intellectuels communistes avec les principaux représentants de l’avant-garde telquelienne, confrontation à laquelle le journal d’Aragon marque son entier soutien en publiant à la une de son édition du 24 avril un entretien entre Philippe Sollers et Jacques Henric intitulé « Écriture et révolution ».
C’est tout de même un peu simplificateur, et je ne suis pas certain que tous les participants universitaires se reconnaîtraient dans l’image donnée d’eux. De la même façon, il est assez excessif d’attribuer au numéro des Lettres françaises concerné un « entier soutien » à l’entreprise de La Nouvelle Critique. Aragon savait quand il le fallait appeler un chat un chat et s’en tenir au silence quand c’est du silence qu’il attendait une utilité. L’approbation explicite d’Aragon, à notre grand dam, elle ne vint pas.
C’est ainsi. Les comportements politiques de mai 68, autour de la constitution d’une Union des écrivains dans les locaux de la Société des Gens de Lettres à l’Hôtel de Massa, par des écrivains comme Jean-Pierre Faye, Butor ou Alain Jouffroy, provoqua de vives réserves de la part des gens de Tel Quel. Les événements de Prague furent accueillis par les mêmes dans un silence qui fit contraste avec la célèbre condamnation d’Aragon. Les choses se gâtaient ainsi dangereusement. J’avais bien tenté de parler du colloque en préparation avec Aragon, espérant une présence visible des Lettres françaises à Cluny. En 1968 mes rapports personnels avec lui étaient bons même s’ils n’atteignaient pas encore le degré d’intimité qu’ils devaient prendre après la mort d’Elsa. Je partageais avec tous mes camarades de La Nouvelle Critique une grande admiration et beaucoup de déférence pour l’immense écrivain et pour le grand politique que fut aussi Aragon. Personne parmi nous n’oubliait son dernier roman paru en 1967, Blanche ou l’oubli où les amateurs et de littérature et de linguistique se trouvaient comblés. Je pensais donc, sans doute avec une certaine naïveté, que les choses seraient aisées. Rien de tel ! (Cf. PRINTEMPS 68 LA NOUVELLE CRITIQUE
 , p.28-29)
, p.28-29)
[10] Sur cet épisode, cf. mon article Derrida tel quel (à partir du « Derrida » de Benoît Peeters) :
Tchécoslovaquie :
- On lit dans TQ 47 (automne 1971) :
« L’analyse est que l’intervention soviétique est exploitée par la droite et, précisément, par l’opposition à Tel Quel (c’est-à-dire par ceux qui s’opposent à Tel Quel sur le plan de sa pratique spécifique pour des raisons réactionnaires spécifiques au champ de notre pratique). Le combat qui prime les autres est celui de la consolidation du groupe et de la revue. Silence. Positions "étroites". Incompréhension des positions chinoises d’alors (justes). Doctrine de "l’unité du camp anti-impérialiste" avant tout, etc. »
« [...] Le 20 août, les troupes du pacte de Varsovie envahissent la Tchécoslovaquie pour mettre fin au « Printemps de Prague ». Si Aragon et Les Lettres françaises prennent clairement parti contre l’intervention soviétique, les telqueliens campent sur une ligne plus dure et s’y disent plutôt favorables. Sollers l’écrit à son ami Jacques Henric : « Il ne faut pas compter sur moi pour désarmer, ne fût-ce qu’une seconde, l’armée Rouge (sans parler des tanks bulgares pour lesquels j’éprouve même une coupable passion). Les relents d’humanisme sordidement intéressés qui se développent achèvent de m’exaspérer. » Benoît Peeters, « Derrida » (Lettre de Ph. Sollers à Jacques Henric, 9 septembre 1968, citée par Philippe Forest, Histoire de Tel Quel, op. cit., p. 333).
N’oublions pas que Julia Kristeva est d’origine bulgare. La « passion » rendrait-elle aveugle ? Ou ne peut-on imaginer, dans le couple Ph. S. - J.K., des interrogations plus secrètes que les positions "tactiques" affichées ? (A.G.).
[11] Publié dans Tel Quel 40, Hiver 1970. Dans le même numéro, Dix poèmes de Mao Tse-toung, « lus et traduits par Philippe Sollers ».
[12] « Philippe Sollers n’ira pas à la fête de L’humanité »
Le Monde du 11 septembre 1971.
« J’avais accepté, comme tous les ans, de participer à la fête de L’Humanité, qui se présente, on le sait, comme une grande fête populaire et démocratique. Devant l’étonnement de quantité de lecteurs, sur le fait que le livre de Maria-Antonietta Macciocchi, De la Chine, ne soit pas annoncé à cette vente, j’ai, très surpris moi-même, demandé des explications. Il en ressort que la présence de ce livre est considérée, parlons net, comme indésirable par les autorités de cette manifestation. Aucun intellectuel d’avant-garde et plus encore aucun marxiste ne peut, me semble-t-il, rester indifférent devant cette mesure. De la Chine représente aujourd’hui non seulement un admirable témoignage sur la Chine révolutionnaire, mais encore une source d’analyses théoriques qu’il serait illusoire de croire refoulées. De la Chine, c’est la puissance et la vérité du « nouveau » lui-même. Son absence, sa censure dans une manifestation d’union de la gauche sont le symptôme grave d’un aveuglement navrant. C’est pourquoi je n’irai pas cette année coudoyer des « écrivains » — dont certains notoirement réactionnaires — à la fête de L’Humanité. Les livres ne sont pas des produits ménagers. De la Chine est l’un des très rares livres d’aujourd’hui, de demain. Le travail de Maria-Antonietta Macciocchi a devant lui toute l’histoire. »
[14] Cf. Tel Quel - Mouvement de juin 71 et Tel Quel - Mouvement de Juin 71. Informations sur Louis Aragon.
[15] Barthes et Sartre sont morts en 1980, Lacan en 1981. Foucault mourra en 1984.
[17] Cf. Femmes, roman, 1983.
[19] Une Vague de rêves paraît en automne 1924 dans la revue Commerce, à peu près au même moment que le Manifeste du surréalisme d’André Breton. A.G.
[20] Pas plus qu’on ne fait de nos jours à l’admirable prose de Lamartine, que personne ne lit plus.
[21] Le titre exact est Un perpétuel printemps.
[22] Propriété d’Aragon à Saint-Arnoult.
[23] 56, rue de Varenne. Son domicile à Paris.
[24] Question de la gerbe à déposer ou non sur la tombe de Pétain, et qui a agité les médias et la classe politique cet été (1992).
[25] Louis Aragon, Les Communistes, 6 volumes, Éditeurs français réunis, Paris, 1949-1951, 2e version 1967.
[26] Louis Aragon, Aurélien, NRF, Gallimard, Paris, 1944.
[27] Louis Aragon, La Semaine sainte, NRF, Gallimard, Paris, 1958.
[28] Platon, Philèbe ou Du plaisir, « Bibliothèque de la Pléiade ». Gallimard, Paris, 1981, 2e partie, pp. 21-32.
[29] Hannah Arendt, La Vie de l’esprit, Presses universitaires de France, Paris, 1981.
[30] Cf. Jacques Lacan, Écrits, pp. 388-389, 439, et RSI 1974-1976, in Ornicar 2, 3-4, 5.
[31] Gilles Deleuze et Félix Guattari, L’Anti-Oedipe. Capitalisme et Schizophrénie, Minuit, Paris, 1972.
[32] Cf. Philippe Forest, « Anicet : Panorama du roman », L’Infini n° 45, Hiver 1994.
[33] Cf. également : Philippe Sollers, Le dossier Aragon.
[34] Cf. La légende de Nancy Cunard.
[36] Cf. Au grand jour, Paris, 1927.
[37] L’imaginaire/Gallimard, p. 34.
[38] Cf. L’origine du délire.
[39] Cf. L’Express du 26-04-07.



 Louis Aragon, Un perpétuel printemps (1958) — De Tel Quel à L’Infini +
Louis Aragon, Un perpétuel printemps (1958) — De Tel Quel à L’Infini + 

 Version imprimable
Version imprimable

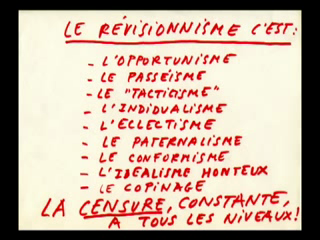



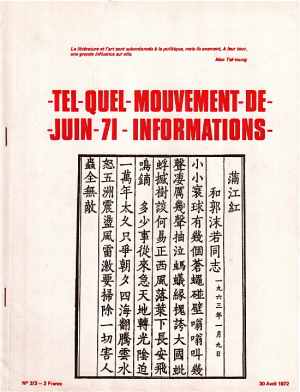

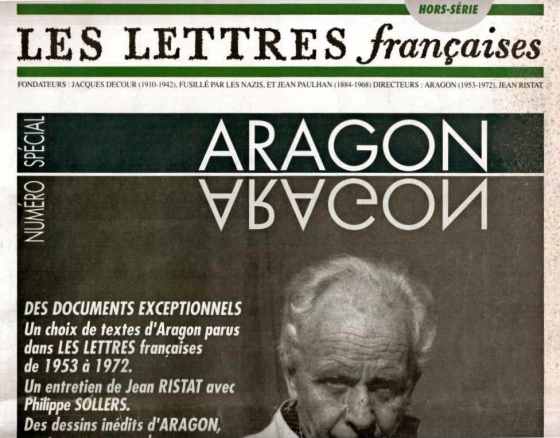


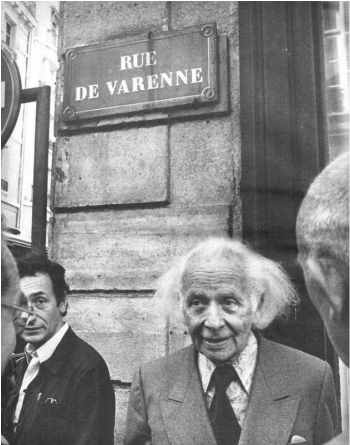


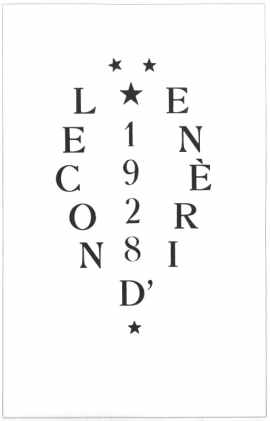




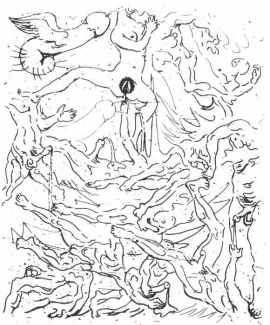

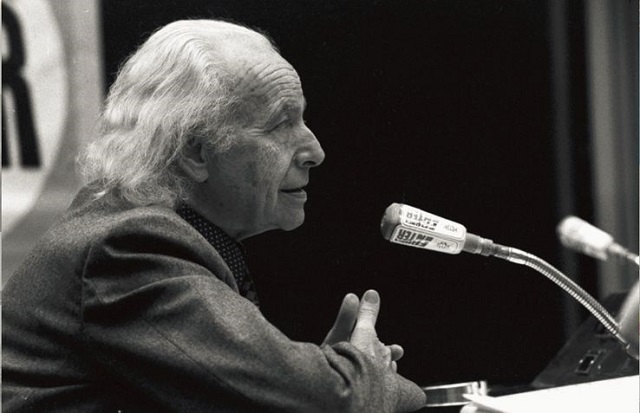

 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?



9 Messages
En complément à la note Mort de Jean Ristat, poète et camarade, lire :
Philippe Lançon, Jean Ristat, la dernière mort d’Aragon
Daniel Bougnoux, Jean Ristat, 1943-2023 et Jean Ristat, suite.
De nouveau Aragon :

 Philippe Forest, Aragon ou le mentir-vrai
Philippe Forest, Aragon ou le mentir-vrai

 Olivier Barbarant, Louis Aragon : Poète avant tout
Olivier Barbarant, Louis Aragon : Poète avant tout

 Jacques Henric, Compagnonnage communiste
Jacques Henric, Compagnonnage communiste

 Daniel Bougnoux, Louis Aragon : L’Art du roman
Daniel Bougnoux, Louis Aragon : L’Art du roman
Une journée du séminaire Aragon à l’ITEM-CNRS (Institut des Textes et Manuscrits), que nous tenons depuis plus de dix ans, Luc Vigier et moi-même, à l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm, sera consacrée le samedi 9 décembre prochain à « Erotisme et pornographie » dans l’œuvre de notre auteur (de 9 h 30 à 16 h, salle Daniel Reig).
Louise Mai, qui coordonne cette session, m’a chargé de l’ouvrir, et elle fait circuler sur le site de Fabula un lien qui donne le détail des deux séances, ouvertes à toutes et tous :
http://www.fabula.org/actualites/erotisme-et-pornographie-dans-l-oeuvre-de-louis-aragon_82084.php
Je relaye l’information sur mon blog car ce sujet à tous égards curieux devrait susciter quelque affluence. Il pose de fait un problème majeur.
J’ai moi-même édité (commenté, annoté) au tome I des Œuvres romanesques complètes dans la Bibliothèque de la Pléiade, l’essentiel du corpus qu’on peut dire érotique d’Aragon, qui tient en quelques titres contemporains de sa période surréaliste : Le Con d’Irène (publié anonymement en 1928 et qu’il n’a jamais reconnu), L’Instant (titre posthume ajouté à une liasse de manuscrits vendus circa 1930, et qui contient quelques-uns des textes les plus scabreux d’Aragon), Jean-Foutre la Bite (1930) et peut-être Entrée des succubes (1925), à quoi il conviendrait d’ajouter, ou de lire à leur lumière, telles pages flamboyantes du Paysan de Paris, ou encore du Mauvais plaisant… La question est en effet de raccorder Aragon à lui-même : comment le poète courtois des Yeux d’Elsa (1942), du Fou d’Elsa (1963) a-t-il été aussi l’auteur de ces pages (laissées pour l’essentiel sans signature) ? Comment mettre d’accord deux démarches, deux modes d’approches de l’amour apparemment aussi incompatibles ? La première chose à rappeler, au moment d’ouvrir ces textes peu frayés d’Aragon, c’est sa très haute conception de l’amour, dont il fit une sorte d’apprentissage sacré au terme duquel il écrit :
« Un vrai critique est celui qui apprend à aimer, et attention ! j’emploie toujours le verbe aimer au sens fort (…). Je suis peut-être un fou, peut-être un esclave, peut-être un sot, mais je vous le dis, de cette vie je n’ai appris qu’une chose, j’ai appris à aimer. Et je ne vous souhaite rien d’autre, savoir aimer » (J’abats mon jeu, 1959). De l’auteur du Libertinage au chanteur lyrique des poèmes à Elsa – du romancier qui fixa dans Les Cloches de Bâle ou Aurélien d’inoubliables rêveries amoureuses jusqu’au vieillard homosexuel de Théâtre/roman – quel usage de l’amour propose Aragon, et qu’a-t-il à nous apprendre d’essentiel sur ce sujet brûlant, le nouage de l’amour et de l’écriture ? LA SUITE ICI.
Un texte inédit de Simon Liberati : promenade littéraire
L’auteur des Rameaux noirs poursuit ses déambulations littéraires et part à la découverte d’anciennes revues souvent confidentielles, aux titres aussi évocateurs que Le Spectacle du monde, Matulu ou Supérieur Inconnu. On y lit Aragon sur Sollers ou le quartier Saint-Georges, les critiques cinéma de Lucien Rebatet, Jean Parvulesco rendant hommage à Jean-Pierre Melville…
A part le spiritisme, je ne connais rien de plus divertissant à la campagne en automne que de lire de vieux articles de presse. Je commence par Aragon (très présent dans ma vie en ce moment) et le recueil J’abats mon jeu (Les Editeurs français réunis, 1959, réédition par Jean Ristat, Mercure de France, 1992).
Premier article (célèbre), “Un perpétuel printemps”, paru le 20 novembre 1958 dans Les Lettres françaises. Une digression critique où il est surtout question d’Une curieuse solitude, le premier livre de Philippe Sollers, mais aussi des Amants de Louis Malle. Ce texte enivrant porte bien son titre.
Philippe Sollers fut la Cléopâtre d’Aragon
Aragon vante Sollers contre un auteur marxiste, Michel Zéraffa. Il explique aux communistes qu’il ne faut pas être sectaires, il dit surtout : “Je n’ai jamais rien demandé à ce que je lis que le vertige.” J’ai vu l’autre soir Sollers encore ému du vertige d’Aragon après toutes ces années, cette fierté‑là est ce que j’ai senti de plus frais depuis longtemps.
Plus loin, une citation de Marceline Desbordes-Valmore :
“Beaux innocents morts à minuit
Eteignez mon cœur qui me nuit…”
Puis un merveilleux centon de Dryden : un soldat dit à Cléopâtre :
There’s no satiety of love in thee…
(Il n’y a pas satiété d’amour en toi : – quand tu jouis tu es encore neuve ; un perpétuel printemps – Est dans mes bras…)
Le 20 novembre 1958, Philippe Sollers fut la Cléopâtre d’Aragon. Soixante ans plus tard, un soir de septembre, je l’ai vu yeux mi-clos laisser son page Josyane Savigneau réciter pour moi la promesse de jadis : “Le destin d’écrire est devant lui comme une admirable prairie…” Le parfum de lilas de ce perpétuel printemps était resté tel quel. LIRE ICI.
LIRE AUSSI : Le surréalisme tel que vécu par Sollers
Aragon ou l’oubli
Le séminaire littéraire de Yann Moix a repris le 31 janvier. Jusqu’en juin, il sera consacré à Aragon. Vous pouvez écouter la première séance ICI.
"Aragon" par Philippe Forest ,Gallimard, 896 pp., 29 €. En librairie le 24 septembre.
« On croit parfois avoir tout dit d’Aragon quand on a dit de lui comment commença sa vie ». Lire l’article de Philippe Forest dans Libération du 28 août.
C’est dur. Aragon disait plus de bien de Philippe Sollers dans je ne sais plus quel ouvrage (et de Johnny Hallyday en même temps, remarquez :-) )
Voir en ligne : http://juliette-presse.fr/Porcelaine/
Le mercredi 7 novembre 1928, Louis Aragon et Elsa Triolet se réveillent pour la première fois dans les bras l’un de l’autre... La suite sur lepoint.fr.
Actu : Louis Aragon prend place à Paris (28/03/2012)
Yves Montand chante Est-ce ainsi que les hommes vivent ? (Aragon/Ferré)