Pour ceux qui aiment Samuel BECKETT (1906-1989), dramaturge et romancier excellents, prix Nobel de Littérature en 1969, voici un texte, Mercier et Camier (1946) écrit directement en français et extrêmement innovant au niveau de la composition et de l’écriture.
C’est un roman certainement peu connu, considéré à tort mineur et sans doute obscurci par le succès des trois romans de la trilogie, Malloy, Malone meurt et L’Innommable, mais nous retenons que ce roman, mal aimé des critiques, constitue une étape indispensable si l’on veut avoir une connaissance plus fine de l’ ?uvre romanesque de l’écrivain irlandais [[L’Irlande maternelle est partout, dans les hautes landes, dans les vastes tourbières, dans les forts en ruine, dans les maisons abandonnées, dans les panoramas, dans les montagnes d’où, par temps clair, on réussit à voir les môles des deux ports et aussi les îles et les promontoires. Beckett est épris du sauvage environnant sa ville de Dublin et ses canaux. Il y respire l’odeur des sentiers parmi les tourbières tant de fois parcourus et admirés en compagnie de son père. Malgré ses déplacements, la vie irlandaise continue à lui donner pas mal d’images saisissantes, une multitude d’éléments authentiques qui constitueront un moment privilégié dans l’univers beckettien.
![]()
La décision de vivre loin d’Irlande, à vingt deux ans Beckett quitte Dublin pour Paris, répond à l’exigence toute intérieure d’aller du connu à l’inconnu afin d’apprendre d’autres styles de vie et rechercher un impact plus stimulant avec d’autres écrivains de nationalités diverses. C’est à Paris que Beckett rencontre J. Joyce et s’approche de la langue française.]].
Notre point de vue sur le texte/conversation est différent et nous pensons que l’historique Maison d’éditions de presque tous les écrivains du « Nouveau Roman », les Éditions de Minuit, a bien fait reproposant ce livre à trente six ans de sa première publication en France (1970). C’est l’occasion, d’un côté, pour mettre fin à une vieille et stérile polémique entre les tenants de Beckett, auteur de drames et ceux qui exaltent sa riche production romanesque et, de l’autre, de porter un regard rétrospectif sur la manière absolument innovante de questionner et de s’interroger.

Nous retenons que l’ ?uvre de Beckett est assurément unitaire. D’un livre à l’autre, il n’y a aucune rupture, aucun changement de ton ni de vision du monde. La même conception nihiliste de la condition humaine qui apparaît à Beckett dénaturée et source de sentiments tragiques et décadents.
On y retrouve, en fait, tout de Samuel Beckett-homme, son ironie grinçante (il se moque de la tradition), sa sensibilité brillante et sa capacité à jouer avec les mots, les langages, mais surtout l’artiste protéiforme, l’inventeur du roman dialogué où l’intrigue assez faible, voire banale, disparaît pour ne laisser subsister que l’expression. Bref, un Beckett attaché à ses racines qui a accordé sa plus grande attention au langage, recherchant d’entendre d’une manière nouvelle le rapport entre « l’ ?il et l’oreille ».
Ses personnages sont victimes des contradictions et des incohérences, soumis à la bêtise et à l’horreur de l’existence, et souffrent de l’impuissance à faire face à une réalité misérable et méchante qui les rend semblables à des marionnettes. Beckett préfère les regrouper en couple, continuant, par là, une longue tradition qui réunit Don Quichotte et Sancho Pança, Bouvard et Pécuchet, Laurel et Hardy. A ceux-là, Beckett ajoute Vladimir et Estragon et Lucky et Pozzo de « En attendant Godot », Nagg et Nell de « Fin de partie », Winnie et Willie de « Oh les beaux jours » et encore le tandem père/fils Hamm et Clov et Mercier et Camier, deux compagnons rompus par l’âge et par la vie qui décident d’entreprendre un voyage.
Ce qui unit ces personnages c’est qu’ils sont antithétiques. Ils sont souvent des vieillards qui ont du mal à se déplacer à cause de leur instable santé. Singuliers par tempérament, ils sont cependant tous indissociables. Mercier et Camier, eux-aussi, malgré de constantes frictions en matière d’élaboration et d’actualisation du voyage, sont complémentaires, en ce sens qu’il est presque impossible d’imaginer que l’un abandonne l’autre ou que le premier voit dans la figure de l’autre une entrave pour gêner leur marche. C’est qu’ils sont intimement contaminés et soutenus par une même idée forte. C’est pourquoi il n’y a entre les deux aucun rapport de domination ni culturelle ni sociale, mais un rapport apparemment paritaire, voire inexistant, une relation qui se caractérise davantage par ses procédures dialogiques (ils parlent trop) que par les décisions qui sont rares. Le débat, en fait, est leur ressource la plus efficace pour que l’un soit impliqué tout entier dans l’autre. De plus, on a la sensation, dans certains dialogues, d’écouter une seule voix qui tend irrésistiblement à se redire, à se répéter. Une sorte d’écho sonore qui se répand dans les brumes du matin alors que, à neuf heures cinquante, les deux compagnons se rencontrent au Square Saint-Ruth, un endroit « enclavé dans un fouillis de rues et de ruelles » [1] qu’ils ne connaissent pas mais facilement localisable pour « un hêtre pourpre immense et luisant » [2], placé au centre de la place.
Tout d’abord on s’étonne que les conditions météorologiques pas bonnes (le voyage se déroule sous une pluie intermittente) soient au centre de leur première conversation, mais cette extrême attention aux circonstances externes la dit long sur l’inquiétude qui anime les deux vieux, surtout Camier. En fait, c’est lui qui propose de rentrer et d’attendre un temps plus favorable, d’autant plus il ne supporte pas de rester debout pour une durée indéterminable. Confiants quele mauvais temps va passer, ils décident de se mettre en route profitant d’une éclaircie imprévisible. Le sac à provisions, le parapluie et l’imperméable, ils sortent de l’abri. Camier s’occupe de la bicyclette « de femme sans roue libre malheureusement » [3]. C’est Mercier qui conduit. Camier derrière lui, comme prévu. Ils partent, enfin.
Mais aller vers où ? Où trouver un lieu idéal où ils pourront s’abandonner ? Et encore, est-ce qu’il existe des lieux sans histoire, comme le dit Claude Lévi-Strauss, des sociétés sans marge, des villes dominées d’une sorte de pensée prélogique, loin de toute aspiration au modernisme et à la technologieinnovante ?
Les deux vieux l’ignorent. D’autre part, ça n’est pas une priorité de leur programme. Ce qu’ils désirent c’est de partir.
C’est « d’aller de l’avant », c’est de s’éloigner « de cet enfer le plus vite possible » [4], c’est de rompre avec le passé, de fuir ce qui est établi, connu et reconnu.
Pour ces deux malheureux il n’y a qu’une seule issue : quitter ce lieu contraire, voire hostile, un lieu de malédiction, bref, ils aiment aller vers la vie, s’envoyer, comme dit le poète Baudelaire, « n’importe où hors de ce monde ». Et sortir de la ville, ça veut dire s’éloigner une fois pour toutes des lieux de mémoire. Car ils ont horreur, pendant leurs rares promenades, de tomber dans tout espace qui les renvoie à un événement passé. C’est la campagne dublinoise qu’ils préfèrent à la stérilité des rues de la ville et de sa banlieue. La vie en ville est devenue étouffante et ils recherchent un « ailleurs » plus limpide, plus respirable. Camier voudrait aller au sud parce qu’il aura la chance « de compter les vaches(...) de voir les corbeaux s’envoler tout mouillés et dépenaillés » [5]. Sur cette vision, ils se montrent baudelairiens, en ce sens qu’ils pensent que la réalité est « l’union adéquate du sujet et de l’objet ». Quand cette union ne se réalise pas, alors il ne leur reste que rechercher soi-même en un ailleurs qui ne soit nécessairement pas le monde de l’idée.
Métaphoriquement la fuite que les deux vieux compères ont minutieusement préparée, jetant sur elle l’enthousiasme de leur première jeunesse, pesant les avantages et les désavantages de cette étrange aventure, c’est la fuite de Beckett d’une esthétique textuelle close, d’une idée de Littérature traditionnelle fondée sur la description et sur le « sujet », qu’il considère dangereuse parce que la tentation du pittoresque et l’analyse du « moi » détournent le lecteur de la vérité de l’existence humaine. Les deux héros sont en quête d’identité, de visibilité, de reconnaissance. Ils souffrent de la futilité d’esprit de leurs semblables. Beckett, lui, ressent le même sentiment d’opposition, la même tendance à se débarrasser des incongruités cocasses et mesquines. Comme eux, il souffre des horreurs de son monde frivole, il souffre de ce qu’il nomme « le gâchis ». Mais, contrairement à ses personnages, il préfère faire un autre type de voyage. Il recherche de nouveaux rapports avec les sons, les mots, l’écriture. Car il est convaincu qu’un texte vaut s’il est produit par le travail de et dans l’écriture. Dans Mercier et Camier, en fait, il expérimente une nouvelle mécanique de composition narrative tout à fait alternative à celle qui était appliquée au roman traditionnel.
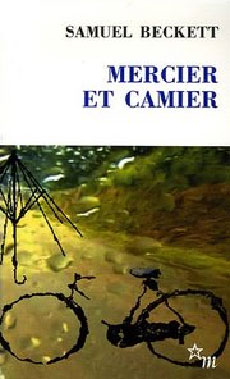
Pour lui il est temps de prendre les distances d’une vision du monde vieillie et convenue et de redonner plus d’initiative aux mots et à leurs multiples propriétés métaphoriques. Ce qu’il fait dans Mercier et Camier où les formes courtes, syntaxiquement imparfaites, remplacent les phrases longues et tortueuses. Les propositions subordonnées sont de plus en plus rares. L’usage du silence est réintroduit ainsi que les pauses qui sont systématiques parce que, comme écrit J-P. Sartre, ce sont « un moment du langage ».
Ce même procédé stylistique sera repris dans ses ?uvres de l’après-guerre. Il regarde la phrase qui se transforme en conversation où le « tu » est dominant et sert à avoir un rapport plus direct avec son lecteur. Sa littérature est substantiellement un éloge du double, du multiple, du chaotique et du contradictoire et si le déroulement du récit paraît illogique et extravagant c’est uniquement parce que la vie des hommes n’est pas contrôlée par la raison mais par l’Absurde.
Le roman devient, alors, multigenre, en ce sens qu’il s’ouvre à toutes formes de conceptualisation et le discours, aussi fragmentaire qu’il soit, progresse dans des directions interprétatives multiples, voire possibles.
Ça fait vite penser à « Finnegans Wake » (1939) de J. Joyce, aux romans les plus beaux de « l’épouvantable » Céline qui, pour Philippe Sollers et Claude Simon, sont « Féerie pour une autre fois », « D’un château l’autre », « Nord », « Rigodon », à « Paradis » (1981) de Philippe Sollers où l’on retrouve la primauté de la « langue parlée » sur le fond. En dépit de la fragmentation linguistique, « Paradis » renforce la conviction que l’avenir de la Littérature passe de et par l’écriture. « L’écriture se poursuit à la lecture », soutient Sollers, pour qui ce qui compte c’est d’établir un contact direct et intime avec le destinataire, favorisant son autonomie interprétative, en ce sens qu’il est absolument libre d’imposer son rythme à lui. Une activité de décodage, la sienne, qui n’a affaire qu’au langage et qui procède d’un geste destructeur nécessaire à exprimer la réalité.
Plusieurs années avant les débuts de Beckett au théâtre les deux amis errants, Mercier et Camier, pour sortir de la frustration et de la solitude routinière dialoguent sans cesse, racontant des histoires drôles. Ce qui importe, ce n’est pas tant la construction d’un dialogue visant à la solution d’une question de fond, mais la possibilité et le plaisir de prolonger le mouvement dialectique. D’où une suite de répliques souvent sans intérêt, parfois abstraites, s’appuyant sur la répétition de situations et de mots qui n’ont d’autre fonction sinon celle de remarquer l’absurdité et le non-sens du monde.
La conversation entre les deux amis continue mais leur dialogue est de sourds. Ils font semblant, en fait, de se comprendre et d’harmoniser leurs points de vue, ils sont victimes d’une ambigüité de fond, à savoir ils marchent vers quelle destination ? Ou mieux ils se sentent responsables de mener à bien une entreprise importante pour leur vie future mais ils perçoivent dans leurs voix intérieures une sorte d’hostilité qui rend le parcours difficile. Leur passé tenu longtemps à l’écart revient puissamment, il s’insinue dans les pensées de Mercier, père de famille, et de Camier opérant une déstabilisation émotionnelle plutôt grave (ils pensent au suicide). Il fait du vent et l’air est humide. Les deux compères n’ont rien à se dire. Ils se croient les perdants. Mercier semble le plus abattu. Camier, lui, attend des réponses qui permettent de dépasser ce moment d’impasse. Et surtout il voudrait comprendre pourquoi après avoir quitté la ville on y revient quand même. Il n’en peut plus de cette forme de désistement camouflé. Il retient que le programme a besoin d’une immédiate relecture, d’une mise au point plus ponctuelle des différentes phases du projet dont on ne sait pas ce qu’il va être, d’une plus efficace recharge d’enthousiasme et d’élan.
Pour le moment, il vaut mieux passer la nuit chez Hélène.
La vérité est qu’ils avancent avec hésitation dans les ténèbres de l’incertitude. Déceptions et incompréhensions sont les sentiments qui accompagnent les deux héros dans ce qui reste du voyage. Ils ne rivalisent plus, ils sont plus silencieux et plus inquiets qu’au départ. Camier arrive à dire qu’il est urgent de rentrer en ville pour récupérer le sac, la bicyclette et l’imperméable perdus car il est sûr que leur trouble dépend de ces objets-là qu’il juge indispensables pour que leur marche reprenne. Une motivation que pour Mercier paraît surprenante, absolument inconsistante car il ne réussit pas à comprendre la raison de cette inattendue volte-face.
Ils prennent enfin conscience que la distance entre eux augmente sensiblement. Par surcroît, ils sont responsables du meurtre d’un agent si que le profil absurde et burlesque des deux compagnons se complète, annonçant que leur séparation est inévitablement accomplie. Elle se dissout comme leur fragile amitié parce qu’elle ne s’alimente que des banalités et des incohérences.
Aussi bavards soient-ils, ils ne se rendent pas compte que l’identité qu’ils disent de rechercher suppose nécessairement la maîtrise de la parole et du langage, ce que Mercier et Camier n’ont pas du tout. Leur apprentissage est avant tout d’ordre langagier, d’où une trop évidente inquiétude dialogale qui les rend vulnérables et comiques. Au fond, baudelairiens sans qualités, ils racontent leur épuisement progressif, leur échec, la fin des illusions.
Ainsi, après leur énième retour dans le tumulte de la ville, les deux déchus entreprennent un nouveau voyage sous une pluie incessante, « la pluie, c’est la ruine de ce malheureux pays » [6]. Ils traversent un pont sur un canal et recommencent à discuter du temps peu propice et de la destination qu’ils ignorent. Le lecteur-modèle a justement la sensation que rien n’a changé et qu’on ne va pas apparemment nulle part, car la reprise est l’essence de la circularité.
Prof. Raphaël Frangione
Post-notes en contrepoint de pileface
![]() Samuel Beckett figure au Panthéon du dernier livre de Sollers Discours parfait, avec un article intitulé « Emouvant Becket », initialement publié dans L’Infini printemps 2004, [7]. De même que Sollers avait déjà inclus dans sa Guerre du Goût, un autre article dédié à Beckett : « L’Ethique de Beckett »
Samuel Beckett figure au Panthéon du dernier livre de Sollers Discours parfait, avec un article intitulé « Emouvant Becket », initialement publié dans L’Infini printemps 2004, [7]. De même que Sollers avait déjà inclus dans sa Guerre du Goût, un autre article dédié à Beckett : « L’Ethique de Beckett »
Emouvant Beckett
par Philippe Sollers
En 1959, à Paris, un bizarre écrivain marginal de 53 ans devient l’ami d’un couple étrange et réservé : un peintre et dessinateur, une poétesse d’origine américaine. Ils sont juifs, ils ont deux petites filles, le trio sort, boit et fume beaucoup la nuit, et elle décrit l’écrivain ainsi : « Un homme résolu, intense, érudit, passionné et par-dessus tout vrai, beau, habité par le souffle divin. » Ou encore : « Il était poète dans la moindre de ses fibres et de ses cellules. » N’est-ce pas exagéré ? Mais non, il s’agit de Samuel Beckett.
Avigdor Arikha connaît déjà Beckett, Anne Atik le découvre. Ils traînent ensemble jusqu’à 4 heures du matin à Montparnasse, surtout au Falstaff. Whisky, vin, bières, champagne. Ils rentrent en titubant et en se récitant des poèmes. L’austère femme de Beckett, Suzanne ("je suis une abbesse"), a vite abandonné la partie, mais Anne tient le coup malgré les volumes d’alcool (elle boit moins et observe avec intérêt ces deux fous lucides). Beckett n’a jamais l’air d’être saoul, sa mémoire est phénoménale, il a l’air de connaître par c ?ur des livres entiers et les détails de centaines de tableaux exposés aux quatre coins du monde. Ils croisent souvent Giacometti qui, après son travail et sans regarder personne, vient manger tous les hors-d’ ?uvre de la Coupole. Ils sont quand même aperçus, à leur insu, par un jeune écrivain français, très imbibé lui-même, qui marche très tard dans ces parages. Personne ne semble se douter de rien. C’est la vie.
La légende veut que Beckett ait été un sphinx ou une momie impassible, un squelette nihiliste, une froide abstraction inhumaine, un saint à l’envers, un mort-vivant montreur de marionnettes désespérées. Il s’est visiblement arrangé de ce montage pour avoir la paix, mais rien n’est plus inexact, et c’est en quoi le témoignage direct d’Anne Atik est si précieux, sensible, insolite. Beckett ? Générosité, bonté, attention aux enfants, joueur (échecs, billard, piano), sportif (nage, marche, cricket, amateur de matches), et surtout présence d’écoute intensive au point de mettre mal à l’aise ses interlocuteurs qui ne savent pas que chaque mot peut être important. Silencieux ? Ça oui, mais pour interrompre l’immense bavardage humain, sa routine, son inauthenticité, sa rengaine. J’ai vu Beckett et Pinget déjeuner ensemble sans se parler. Une bonne heure et demie, motus. A la fin, le pot de moutarde, devant eux, était devenu une tour jaune gigantesque. Aucune animosité, de l’espace pur. Beckett sur le boulevard ? Un jeune homme souple dans ses baskets, envoyant valser les feuilles mortes de l’automne. Un ailier.
Avec le temps et la célébrité dérangeante, il y a maintenant les dîners tranquilles chez Anne et Avigdor, avec leurs filles Alba et Noga. Beckett enseigne le jeu d’échecs à l’une, apporte des cadeaux, mange peu, préfère le poisson, mange les arêtes à cause, dit-il, du calcium. Il évoque une enfance de bonheur et de prospérité. "Il se demandait pourquoi, aux yeux de nombre de ses lecteurs, ses écrits indiquaient qu’il avait eu une enfance malheureuse." Pas du tout : promenades avec son père dans les ajoncs, confiance et lumière. « Il était très attaché à sa famille et se sentait responsable d’Edward, le fils de son frère. » Evidemment, de temps à autre, il passe d’un silence modéré à un mutisme de trou noir : « Il était délicat de briser le silence. Ç’aurait été pire que d’interrompre un aveu. » Anne Atik lui cite un jour un propos de Rabbi Zeev de Strykhov : « Je garde le silence et, lorsque je suis las du silence, je me repose, puis je retourne au silence. » Petit hochement de tête de Beckett. Quelque chose comme ça. En pire, bien sûr.
Mais voici l’essentiel : la poésie, la musique. Pas Mahler ni Wagner (« trop de choses là-dedans »), mais Haydn, Mozart, Schubert. On écoute, on réécoute, Beckett lève les yeux et les baisse, les larmes ne sont pas loin. On a bu un haut-brion (« nectar ») ou un rieussec. On s’est moqué d’un éditeur (lequel ?) dont Sam a dit "qu’il ne maintient pas la tête de ses auteurs hors de l’eau". "Après moi le déluge ?", questionne Anne. "Pendant moi le déluge", conclut Beckett. Plus que tout, on a récité des poèmes : Yeats, Dante, Villon, Hölderlin, Milton, Shakespeare ("personne n’a écrit comme lui"). Avigdor lit des psaumes en hébreu, l’anglais lui répond rythmiquement comme s’il était fait pour l’entendre. Parfois, Sam et Avigdor se lèvent, le poing serré, pour déclamer un vers. Du français ? Apollinaire. De l’allemand ? Goethe. De l’italien ? Dante et encore Dante. Beckett se met même au portugais pour lire Pessoa. « Hail, holy night », « Salut, sainte lumière ». Anne Atik note : « Il levait la tête et marquait une pause, laissant la phrase monter comme l’eau dans une fontaine. » Toute la concentration constante de l’auteur de Pas moi se révèle dans ces moments : consonnes, voyelles, rimes, chantonnement en couleurs, à l’opposé de ce qu’il demandait à ses comédiens (ton neutre et monotone, voix blanche). A l’intérieur, en privé, comme un secret, la modulation. A l’extérieur, au théâtre, pour le spectacle réglé mathématiquement, pour le public, donc, le vide, l’absence. C’est le monde qui est en détresse, pas la mémoire vivante. Les sonnets de Shakespeare sont là, Le Roi Lear est là (« irreprésentable »). Beckett, dit Anne Atik, était « un lecteur omnivore ». Très vite : Samuel Johnson, Rabelais, Ronsard, Racine (pour ses monologues), Flaubert, Nerval, Verlaine, Rimbaud, Jouve, Pétrarque, Maurice Scève, Sterne, Defoe, Stevenson (ses lettres), etc. Et Joyce ? Ah, Joyce ! Ici une anecdote révélatrice : Crevel, un jour, apporte le Deuxième Manifeste du surréalisme à Joyce pour savoir s’il le signerait. Joyce le lit et demande à Crevel : « Pouvez-vous justifier chaque mot ? » Il ajoute que lui, dans ce qu’il écrit, peut justifier chaque syllabe. Shakespeare, Joyce, la Bible. Et encore. Pour l’effet physique, pour l’émotion. Grande émotion du langage. Par exemple, juste cette formule de Keats pour le rossignol « full-throated ease », « aisance de gorge pleine ». Autrement dit : tout est dans la voix. Autre formule de Boccace à propos de Dante : « La douce odeur de l’incorruptible vérité. » La voix peut avoir le parfum de la vérité.
A la toute fin de sa vie (83 ans), dans sa maison de retraite sinistre, Beckett, avec sa bouteille de whisky Jameson ("en direction de l’Irlande") et ne refusant pas un cigare, reçoit encore ses amis. Il est élégant, comme toujours, et, aussitôt, récitation de poèmes. Quelques mois après, il s’effondre, et récite encore de la poésie jusque dans son délire. Il meurt enfin le 12 décembre 1989. Dehors, les journalistes sont à l’affût "comme des vautours", et les nécrologies d’un Prix Nobel de littérature sont déjà prêtes. Yeats : « La mort d’amis,/ La mort de chaque ?il qui brillait / Et qui coupait le souffle / Ne semblent plus que nuages du ciel... »
Philippe Sollers
Discours parfait, Gallimard, 2010 p. 320-323.
Anne Atik, Comment c’était.
Souvenirs sur Samuel Beckett, avec quatre portraits d’Avigdor Arikha,
traduit de l’anglais par Emmanuel Moses, Editions de l’Olivier, 2003.
« L’éthique de Beckett » (voir cache pileface
 )
)



 -
- 
 Version imprimable
Version imprimable

 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?


