« L’oeil et l’oreille, ce n’est pas la même chose. »
Un roman de Christine Angot, « Le Marché des amants », et un récit de Catherine Millet, « Jour de souffrance », font événement en cette rentrée littéraire. Les deux écrivains se connaissent, se lisent, s’apprécient. Nous les avons réunies pour un entretien. Leurs livres présentent des parentés et surtout des différences. Christine Angot met en scène une femme, la narratrice, et son amant, Bruno, qui appartient à une autre sphère sociale et culturelle. De son côté, Catherine Millet raconte, sans se ménager, la souffrance et l’effet de quasi-dédoublement que lui causèrent les incartades amoureuses de son compagnon, l’écrivain Jacques Henric.
Christine Rousseau et Josyane Savigneau, Le Monde du 29.08.08.
Une partie de la critique a décidé de vous opposer, d’encenser Catherine Millet pour mieux démolir Christine Angot [1]. Comment analysez-vous cela ?
Catherine Millet : Il y a des gens qui préfèrent la guerre à l’amour, qui préfèrent nous imaginer dans une relation de rivalité plutôt que dans une relation d’amitié et de respect mutuel.
Christine Angot : C’est plus profond qu’une rivalité entre personnes. On a d’un côté un roman, d’un autre un récit. Cette question n’est pas anodine. Certes, nous avons des points de vue en commun et une lucidité en commun, mais elle ne s’exerce pas de la même façon et pas avec les mêmes moyens - l’oeil et l’oreille, ce n’est pas la même chose. Roman et récit, ça divise...
On a toujours contesté votre travail romanesque. En ce moment, on publie des photos de Christine Angot avec le rappeur Doc Gynéco, alors que, dans le roman, une narratrice vit une histoire, non pas avec un personnage social...

- Christine Angot
Ch. A. : Mais avec un personnage littéraire. Globalement, ceux qui lisent le livre pour en faire la critique cherchent à traquer des faits. Il y a un déni du roman, du moins d’un certain type de roman. On m’oppose au récit de Catherine, qui, elle le dit, utilise un miroir, et le fait magnifiquement. Mais dans le roman on n’utilise pas de miroir. Un récit passe par l’observation, honnête et lucide dans certains cas, du reflet visible dans le miroir. Sur la représentation du réel par le reflet dans le miroir, tout le monde peut-être d’accord. En revanche, la transposition par l’imaginaire dérange, car le romancier impose sa vision sur la société, les personnages, sans autre preuve que le style.
Là, le personnage principal, Bruno, pour les critiques, s’en sort mieux que la narratrice...
Ch. A. : Avant publication, il y avait une personne pas trop conne, l’écrivain, et un type assez abruti. Le roman a opéré un retournement. La narratrice est tarte, et lui est subtil, raffiné, etc.
C. M. : Je trouve très beau ce portrait de Bruno, inscrit comme une figure vraiment littéraire. Il y a beaucoup de figures de femmes dans la littérature, mais peu de figures d’hommes écrites par des femmes.
Catherine Millet, n’avez-vous pas le sentiment que des personnes conventionnelles aiment votre livre parce qu’il serait la rédemption de La Vie sexuelle de Catherine M. ?
C. M. : C’est certain. Je m’attendais un peu à ce cliché. Cette crise de jalousie terrible n’était-elle pas une façon de payer ma liberté ? Ma réponse, c’est que l’on peut avoir connu ces terribles crises de jalousie sans avoir eu pour autant la vie très libre que j’ai eue. Donc autant en avoir profité.
Mais est-ce vraiment un livre sur la jalousie ?
C. M. : Je suis partie avec l’idée de faire le récit d’une crise de jalousie. En avançant, j’ai compris que ce n’était pas tout à fait cela. Par certains aspects, ce Jour de souffrance s’apparente à la jalousie. Le fait d’espionner, de fouiller dans les affaires... Mais c’est aussi le récit de la fascination que j’ai éprouvée pour ce Jacques inconnu qui s’est révélé à moi, ou plutôt qui ne s’est jamais révélé, et aussi une réflexion sur le rêve éveillé, sur bien des choses...
Bruno n’est pas le seul personnage masculin du Marché des amants. Au début, il y a Marc. La lucidité avec laquelle la narratrice le décrit devrait l’inciter à se détourner de lui...
Ch. A. : Pourquoi reste-t-elle ? Tant qu’on n’a pas compris... La lucidité... c’est elle qui me permet de commencer à écrire. Alors je peux construire mon personnage, faire les phrases. Moi, l’auteur, je vois les choses. La narratrice, elle, progresse à son rythme.
Vous pointez la différence entre auteur et narrateur, entre roman et récit. Pourquoi alors refuser le terme d’autofiction ?
Ch. A. : Il ressemble trop à « autobiographie ». J’ai craint qu’une fois de plus on en déduise : « Ce n’est pas vraiment du roman. » L’autofiction est portée par l’usage du « je ». Si ce « je » est celui du miroir, je ne fais pas d’autofiction. Si on reconnaît que ce « je » peut s’élaborer dans l’imaginaire, alors oui, je fais de l’autofiction. Le roman, je le répète, n’est pas du témoignage. C’est pourquoi ce qu’il dit de la société est politique.
De plus, ce qui m’importe avant tout, c’est la restitution de « qu’est-ce qu’être vivant ? » On n’a que le détour du personnage pour savoir ce qu’est « être vivant » pour quelqu’un d’autre. On peut faire toutes les coupes du cerveau, jamais rien ne remplacera ça. C’est pourquoi le roman ne mourra pas.

- Catherine Millet
C. M. : En écoutant Christine, je me dis que finalement, en avançant dans mon récit, je me suis rendu compte qu’il me fallait presque l’écrire comme un roman du XIXe siècle. Un début très lent, pour faire entrer le lecteur, avant de plonger dans cette souffrance terrible. Et puis un dénouement.
Catherine Millet, vous écrivez : « J’ai appris depuis qu’une forme d’égocentrisme tient moins paradoxalement à une focalisation sur l’être et à son affermissement, qu’à sa dispersion, son affolement. » L’écriture est-elle, elle, le lieu du rassemblement ?
C. M. : Oui... Je l’ai vraiment éprouvé lors de la réception de La Vie sexuelle... Je lisais des lettres où les lecteurs me livraient leur interprétation du personnage de Catherine M., en me disant que j’allais apprendre quelque chose sur moi. Dans la vie, je ne suis pas quelqu’un qui cherche sa vérité, j’aime ce mot d’Aragon dans Le Mentir-vrai : « Se distribuer à tous comme de la brioche ».
Vous est-il plus aisé, à toutes deux, de parler du corps que des sentiments ?
C. M. : C’est certain. Ce livre a été plus difficile à écrire que le précédent, car il y avait plus de pudeur à surmonter. On m’a demandé de faire des lectures de Jour de souffrance. Il me serait difficile de lire certains passages. J’aurais l’impression d’avouer une faute honteuse.
Ch. A. : Je ne fais pas de différence. C’est le moment où les choses s’incarnent qui m’intéresse. La société, le groupe n’ont pas de corps. Chacun transporte des bouts de monde, d’histoire. Le seul détour qui me paraisse honnête pour parler physiquement du corps social, c’est de passer par le roman, par le personnage, par ce qu’il dit ou fait dans son petit transport de ce bout de société qu’il exprime.
C.M. : Chez moi, il y a, je crois, un niveau dans les scènes sexuelles, que j’appelle « le niveau des sensations », c’est-à-dire ce qui se ressent à fleur de peau, avant l’introspection psychologique. C’est une façon de décrire les choses, en restant à la surface pour que le lecteur puisse interpréter.
On constate ici, comme dans La Vie sexuelle de Catherine M., que tout est essentiellement visuel. Et que signifie votre question : « Y a-t-il pour l’être humain du plaisir hors l’obscénité » ?
C.M. : Je suis une visuelle. Mais pour ce qui est de la pornographie, je suis très sensible aux mots obscènes. Parce que je n’ai pas de maîtrise dans le domaine de l’audition, je me laisse prendre plus facilement. Plaisir et obscénité ? Je ne crois pas au plaisir qui viendrait simplement d’un contact entre les muqueuses. Quand deux corps sont en contact, il y a aussi des cerveaux se représentant des images.
Christine Angot, l’agressivité que déclenche Le Marché des amants n’est-elle pas porteuse de racisme et d’une détestation de ce qui apparaît comme un déclassement de la narratrice ?
Ch. A. : Absolument. Je n’ai pas écrit en pensant faire un livre sur ce qu’on appelait avant la mésalliance, terme employé très justement par la critique de Libération. Mais c’est de ça qu’il s’agit. La mésalliance, est-ce que ça existe ? En tout cas, ça existe pour le corps social, et ça provoque un rejet. Il y a aussi du racisme. Alors, de peur de passer pour raciste, certains valorisent le personnage de Bruno, et c’est à moi qu’on trouve tous les défauts.
On se sert de vos romans sur l’inceste pour se scandaliser que la narratrice continue sa relation avec Bruno bien qu’un jour, au cinéma, il ait posé la main sur la cuisse de Léonore, la fille de la narratrice, dont il n’est pas le père...
Ch. A. : Si le livre s’était terminé à ce moment-là, sur une rupture, on n’aurait pas été scandalisé. Mais quel est le sens du mot amour, si l’on ne cherche pas à comprendre l’autre, même quand il fait un pas de côté ? C’est un moment dur pour la narratrice, mais il n’y a rien de mortel, tout est vivable. Il n’y a pas d’amour s’il n’y a pas de pardon. Je pense à la chanson dans le livre : « Quand ils entendent le mot amour, ils sortent les dictionnaires. » L’amour, comme le roman, ça n’intéresse pas.
Vous, Catherine Millet, vous ne pensiez pas que tout était vivable ?
C. M. : Si, car la question de la séparation d’avec Jacques ne s’est jamais posée. Ce n’était pas facile pour lui, et pour moi c’était d’autant plus douloureux que je ne voyais pas d’issue à ma souffrance. Et puis j’en suis sortie, par une porte qui n’est pas celle de la séparation. Christine a utilisé le mot de « pardon », car le geste de Bruno pouvait être pensé comme une faute. Moi je n’ai jamais pensé que Jacques avait commis une faute. Il avait vécu comme je crois qu’il faut vivre, librement.
Aviez-vous le sentiment que, contrairement à vous, avec des partenaires peu identifiés, il avait, lui, des histoires avec des personnes ?
C. M. : Non. Ces femmes n’étaient pas davantage des personnes. Je ne leur ai pas trouvé d’identité. L’une d’elles était très jolie, ce qui m’a ennuyé, mais elle n’avait pas certaines de mes qualités. La qualité de ces femmes n’a jamais été la cause de ma souffrance.
Ch. A. : Dès qu’on commence à peser les qualités, c’est la porte ouverte à la jalousie. J’ai choisi ce titre, Le Marché des amants, parce qu’on nous raconte qu’un amant doit avoir certaines qualités : des biens, du pouvoir, de la culture.... D’où la phrase du père de la narratrice : « Il faut quand même que je te prévienne, sur le marché des amants, un Noir vaut moins qu’un Blanc. » C’est la question du marché, qui nous rend tous esclaves et malheureux. Nous construisons notre vie par rapport à des rencontres faites sur des clichés et des préjugés, pour, un jour, se réveiller malheureux.
Au bout du compte, avez-vous toutes deux écrit un livre sur l’amour ?
C. M. : Oui, parce qu’à la fin c’est l’amour qui gagne.
Ch. A. : A condition d’enquêter un peu...
C. M. : Mais je n’enquêtais pas pour mettre en défaut Jacques, j’enquêtais pour me faire... du roman.
Propos recueillis par Christine Rousseau et Josyane Savigneau, Le Monde du 29.08.08.



 Version imprimable
Version imprimable
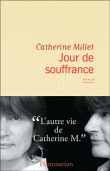
 Un message, un commentaire ?
Un message, un commentaire ?


